Rien qu’un violoneux
par
Hans Christian ANDERSEN
PRÉFACE
Il y a plus de vingt ans, les éditions Gedalge offraient à leur jeune public la primeur d’un roman, inédit en France, du plus grand écrivain du Danemark, Hans Christian Andersen.
Ce roman « Rien qu’un Violoneux » devait faire rapidement la conquête des jeunes Français. Sa traduction, choisie comme livre de prix pour les lycées et les écoles, connut de nombreuses éditions. Durant la guerre, les restrictions de papier empêchèrent de nouveaux tirages. Mais voici que les enfants de 1951 pourront à nouveau faire connaissance avec le violoneux Christian.
L’auteur de ce livre, H.-C. Andersen, occupe une place unique dans les lettres européennes. À lui fut réservé ce domaine mystérieux, étoilé de l’âme de l’enfant.
L’âme enfantine ! Jardin fleuri de cauchemars et d’enchantements, enfer et paradis peuplé d’images fantasques dont toute la vie parfois gardera le reflet. Ses blessures, ses secrets, ses élans, nul ne les révéla avec plus de tendresse et de grâce que l’écrivain danois. C’est qu’il demeura jusqu’aux derniers jours de son existence pareil à ces enfants qu’il aimait, à l’enfant qu’il n’avait cessé d’être, avec les mêmes enthousiasmes, le même refus d’accepter l’injustice et la laideur de la réalité.
Aussi depuis plus d’un siècle des millions de jeunes lecteurs du monde entier l’adoptèrent-ils pour compagnon de leur rêve. De la Suède à la Chine, de l’Amérique à l’Australie, combien d’entre eux se sont endormis en écoutant les aventures de la marchande d’allumettes, du Rossignol mécanique, de la Reine des Neiges et de la petite Sirène, tandis que le marchand de sable attendait pour fermer les yeux, les dernières lignes du conte.
*
* *
Hans-Christian Andersen naquit dans l’île de Fionie, à Odense, en 1805, et comme tant d’autres qui devaient jouer un rôle décisif dans la pensée ou l’action des peuples, il naquit pauvre. La détresse de ses parents était si grande, que, pour se mettre en ménage, ils avaient fabriqué leur lit avec les restes d’un vieux catafalque, une occasion dont ils avaient profité : c’est sur cette couche funèbre que le petit Christian avait reçu la lumière du jour.
Le père, humble cordonnier, se levait de grand matin. Tout en tirant l’alène, il narrait de belles histoires que le petit garçon écoutait ardemment. Avec lui on riait, on s’exaltait, on pleurait, on voyageait des jardins de Perse aux fjords de Norvège où le petit elfe se désole parce qu’il n’a pas encore reçu son âme. Et l’on s’amusait en agitant de minuscules marionnettes, de cocasses figures de bois fabriquées par le grand-père, aux trois quarts innocent, qui les distribuait aux enfants du village.
Quelques années plus tard, le cordonnier, ne pouvant résister à sa fièvre d’aventures, s’engagera pour la guerre contre la Prusse et, brisé par la fatigue des derniers combats, rentrera chez lui pour y mourir. « La vierge des glaces vient de l’emporter », dit la mère de Christian.
C’est elle, la maman, qui gagne maintenant la vie du foyer en lavant le linge chez les riches bourgeois d’Odense. Elle fait entrer le garçon, qui s’est montré jusqu’ici plus enclin au songe qu’au travail, dans une fabrique de drap. Là il enchante d’abord ses camarades par sa jolie voix de fillette, mais les garnements se moquent tant de lui, qu’il rentre en pleurant chez sa mère.
Sa carrière à la fabrique est terminée. C’est au théâtre que, secrètement, Christian se destine. Un jour, encouragé par des voisins, avec trois riksdalers – quelques francs – en poche, il part pour la capitale, se propose au directeur du théâtre de Copenhague : mais l’acteur est si chétif, sa voix si grêle, qu’il est durement éconduit.
Pourtant une magicienne a prédit gravement : « En l’honneur de Christian, la ville d’Odense s’illuminera un jour. »
La magicienne aura raison. Le rêveur finira par vaincre. Christian deviendra poète. Ses premiers essais, l’Enfant mourant, attirent sur lui l’attention de l’illustre écrivain Œlenschläger. Ses protecteurs le font entrer à un gymnase, puis obtiennent pour lui la bourse à l’Université de la capitale.
Douze ans après, l’enfant pleurard et miséreux, avec ses contes, avec ses fantaisies et esquisses, est devenu le premier poète du Nord. Une pension du roi lui permet alors de visiter l’Europe. De France, d’Allemagne et d’Italie, il rapporte des impressions émerveillées qui revivent dans les deux volumes de l’Improvisateur. En 1840, le public de Copenhague fait un vif succès à son drame, le Mulâtre, et à ce recueil qui tient à la fois du conte et du poème en prose, le Livre d’images sans images : une conversation avec la lune qui décrit au poète dans sa mansarde tous les paysages qu’éclairent ses rayons, des banquises du Groenland aux sables du Sahara, des steppes de Russie aux lagunes de Venise. Andersen devient ainsi le poète de la lune, et lorsqu’aujourd’hui l’on prononce son nom, nombre de ses lecteurs entrevoient par la fenêtre d’une chambre enfantine des flocons de neige sous un fantastique clair de lune.
Puissamment attiré par l’Orient où son imagination a voyagé si souvent, il y séjourne assez longuement et en retrace les principaux aspects dans le Bazar du poète. Pendant un quart de siècle, poussé par ce besoin d’errance qui est le démon de tant de paisibles cœurs danois, aigri aussi par certaines jalousies littéraires qu’a suscitées sa trop rapide gloire, il pèlerine à travers l’Europe, il regarde, il rêve, il écrit. L’univers entier a traduit et popularisé ses contes lorsqu’il meurt en 1875.
*
* *
Maintenant que la vie d’Andersen vous est familière, lisez les aventures de ce petit garçon qui lui ressemble comme un frère et qu’il a baptisé du même prénom que lui. Faites connaissance avec le héros de ce roman où l’on est tenté de reconnaître l’histoire de sa propre vie : Rien qu’un Violoneux. Suivez dans sa rêveuse et douloureuse existence l’enfant du peuple qui fut l’ombre de l’autre Christian, le tendre, l’indécis qui sentait le dieu en lui, mais ne trouvait point la hardiesse ou la brutalité nécessaires pour le réaliser et qui, parce qu’il ne possédait pas assez de génie – et peut-être trop de cœur – ne devint rien qu’un violoneux.
Vous voyagerez, à travers l’Europe, au bras de mer qui sépare le Danemark de la Suède, aux antiques splendeurs de Vienne, la ville impériale. Vous descendrez par les vertes vallées de Lombardie jusqu’à Rome, au temps du carnaval. Le Paris politique et littéraire de 1830 déploiera tous ses charmes. Et c’est au Danemark, où l’hirondelle et la cigogne sont revenues, que vous apprendrez la fin de l’histoire.
*
* *
Mais du violoneux Christian et de Hans-Christian Andersen, il faut bien que nous passions, en terminant, à leur vaillant, à leur généreux Danemark.
Souffrant – beaucoup moins que nous sans doute – de l’occupation allemande, son peuple a pris à son tour sa place dans le combat de la Résistance. Il s’est joué des lourds hitlériens. Il a saboté leur machine de guerre. Dans ce pays de plaines, il est parvenu à organiser lui aussi son maquis qu’on appelait le souterrain.
Le premier envahi, le Danemark s’est trouvé le dernier libéré. Il reprend aussitôt sa marche vers le progrès social, remplissant ses devoirs envers les peuples plus éprouvés, offrant chaque jour des milliers de goûters aux enfants sous-alimentés de notre Paris.
En vérité, Christian le violoneux, Hans-Christian Andersen, – l’enfant pauvre et l’éternel enfant devenu l’écrivain glorieux – retrouveraient, dans le Danemark délivré, la fidèle image de leur petite patrie, sa simplicité, son ironie, son goût de l’aventure. Et ses îles qui ressemblent à des navires faisant voile vers le large, avec leur drapeau déployé, des navires clairs et bien lavés aux cales encore pleines et dont les passagers attachent souvent leurs regards aux étoiles.
ANNE-MATHILDE et PIERRE PARAF.
PREMIÈRE PARTIE
I
LES CIGOGNES
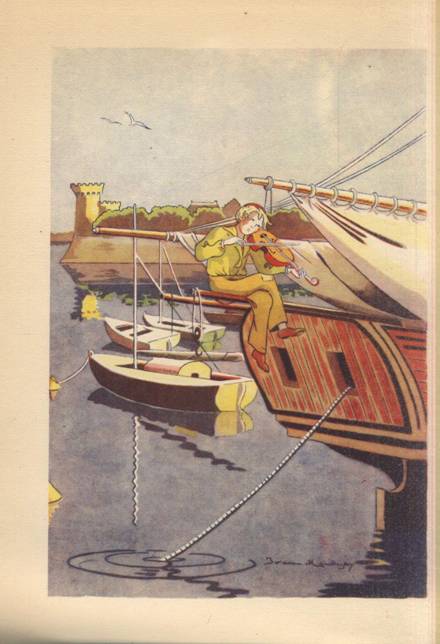
Quand la neige commence à fondre, quand les bois reverdissent, les cigognes reviennent de leur long voyage en Afrique. Elles ont bu là-bas l’eau du Nil et se sont reposées sur les Pyramides.
Tous les ans, au printemps, les habitants des côtes de Sicile et du cap Mysène, en Italie, les voient arriver par la mer en grandes hordes et faire halte sur les monts environnants qui en sont tout entiers couverts. Puis soudain elles reprennent leur vol vers le nord, par-dessus les nuages et les neiges des Alpes. L’immense cortège se divise alors en plusieurs groupes et chacun d’eux prend sans hésiter la direction de son pays. Le plus petit s’en va vers le petit Danemark.
Chaque oiseau connaît la baie qu’il doit retrouver, la courbe du bois et, sur le pignon du château, la cheminée blanche près de laquelle attend le nid. Chevauchant sur leurs grandes ailes, la douceur printanière envahit le pays et les bois deviennent plus verts et l’herbe plus épaisse et l’atmosphère plus chaude.
Un couple donc était revenu. Son nid s’élevait très haut au-dessus d’un magasin dans un quartier de Svendborg. Les cigognes s’y montraient fort affairées ; elles avaient traîné jusqu’au nid, qui avait besoin de réparations, un brin de paille d’au moins trois aunes, trouvé sur la place du Marché. Leur activité venait d’être observée dans la petite cour d’une maison toute proche et faisait l’objet d’une conversation entre deux hommes. Le premier, qui s’appuyait à la fenêtre ouverte, n’avait de remarquable qu’une immense paire de moustaches sombres ; l’autre, assis à une table dans la chambre, semblait fort robuste. Un shako de soldat eût mieux convenu à ses cheveux noirs que le bonnet blanc qui les coiffait, un sabre eût semblé plus à sa place dans sa main que l’épingle avec laquelle jouaient ses doigts.
L’homme près de la fenêtre était le sergent-major ; l’homme à la table, le maître tailleur. À côté d’eux, un petit garçon s’était couché sur le dos, le nez en l’air, pour mieux admirer les cigognes.
– Quelles drôles de bêtes ! disait le sergent-major en lissant ses moustaches. Quand on me donnerait ma solde d’un mois entier, je ne voudrais pas en tuer une ! Elles apportent le bonheur là où elles font leur nid et, comme de juste, c’est chez le Juif qu’elles sont allées.
– Oui, elles sont bien à leur place sur la maison du Juif, répliqua le maître tailleur. Mais nous aussi nous profitons de leur présence. Chaque année, elles paient leur dîme ; une fois c’est un œuf, une autre un petit ; quand elles ne le trouvent pas assez beau, elles le jettent hors du nid d’un coup de bec... Et quelle comédie aussi de les voir nourrir leurs petits et leur apprendre à voler !... Chaque fois que les cigognes reviennent de leur long voyage, il me semble que moi-même je reviens de mes vagabondages lointains ; une foule de vieux souvenirs me visitent ; je pense aux hautes montagnes sur lesquelles je grimpais, aux villes splendides dont les maisons ont l’air de palais, où les églises possèdent les trésors de l’empereur. Ah ! c’est beau quand même, les pays étrangers ! L’été y dure toute l’année. Le Seigneur n’a vraiment pas gâté les enfants du Danemark !
« Mais, qu’est-ce que je disais donc ? Ah ! oui, nous parlions des cigognes. On ne saura jamais au juste ce que ces diables d’animaux ont dans le corps. Avant de partir, à l’automne, elles s’assemblent toujours en divers points du pays. J’en ai vu une fois plusieurs centaines réunies, près de Kwerndrup, qui se livraient à de véritables manœuvres. Elles se mirent subitement à claquer du bec au point qu’on ne s’entendait plus. Elles parlaient sûrement de leur voyage et tenaient conseil, puis, brusquement, le groupe le plus important se jeta sur les isolés et les tua ; une dizaine d’entre elles restèrent sur la place. Elles suppriment ainsi, dit-on, les malades et les faibles qui n’auraient pas la force de faire la longue randonnée. Alors, les survivants s’envolèrent en des virages savants. Mon Dieu ! qu’elles allaient haut ! elles semblèrent bientôt un nuage de moustiques, puis disparurent.
– Est-ce que moi aussi la cigogne m’a cherché dans les pays chauds ? demanda tout à coup le petit garçon, qui avait gardé le visage obstinément tourné vers le nid, mais n’avait pas perdu un mot de la conversation.
– Elle t’a pêché dans l’étang du moulin, répondit le père ; tu sais qu’on cherche les petits enfants dans l’étang.
– Mais ils n’ont pas d’habits, dit le petit garçon ; comment les cigognes peuvent-elles reconnaître les filles des garçons ?
– C’est pourquoi elles se trompent souvent, dit le sergent-major, elles apportent une fille quand on attend un garçon.
– Si nous buvions un coup ? dit le tailleur.
Et il prit une bouteille bleue sur la commode ornée de pots et de tasses au milieu desquels trônait une poupée vêtue ainsi que la mère de Dieu dans les pays catholiques.
– La Vierge Marie est bien installée, dit le sergent-major en montrant la poupée du doigt. Vous l’avez sans doute faite vous-même ?
– La tête vient d’Autriche, répondit le tailleur en versant à boire ; quant aux vêtements, je les ai cousus moi-même. Elle me rappelle mes voyages de jeunesse. Mais vous allez voir maintenant mon image à transformation. Regardez, elle est de ma fabrication.
Il montra du doigt un mauvais dessin colorié dans un grand cadre.
– C’est le docteur Faust étudiant dans sa chambre. D’un côté voici son horloge marquant minuit, de l’autre la Bible. Tirez maintenant ce ruban-là, à gauche. Voyez, l’horloge se transforme en un démon tentateur. Si vous tirez cet autre ruban, à droite, la Bible s’ouvre et des anges sortent des pages pour prononcer les mots de paix.
Et en effet, tout se passait comme il le disait, et chaque figure prenait une expression de tentation chez le démon, d’exhortation chez les anges. Le tailleur tira encore le ruban de droite et les anges rentrèrent dans la Bible, mais le diable demeura auprès de Faust.
– Sapristi ! s’exclama le sergent-major, vous avez trouvé ça tout seul ? Vous ne devriez pas être tailleur, vous êtes un malin.
– Oui, j’ai fabriqué cette image en me souvenant d’une autre que j’avais vue en Allemagne. J’ai seulement inventé le mécanisme. L’histoire elle-même de Faust et de ses magies n’est pas de moi, je l’ai empruntée à un théâtre de marionnettes que j’ai vu dans mes voyages.
– Vous n’êtes pas fait pour être assis à une table, dit le sergent-major, vous ne vivez qu’en voyageant. La vie militaire serait tout à fait votre affaire. En avant ! marche ! une décoration sur la poitrine ! Vous seriez sergent-major avant que l’année soit écoulée.
– Et la femme ? Et le garçon ? dit le tailleur, voudriez-vous qu’ils me suivent, lui comme enfant de troupe, elle comme cantinière ! Non ! C’était le bon temps que ces cinq années-là ! Voyez-vous, sergent, j’avais dix-neuf ans, ni père, ni mère. Faaborg est une gentille ville où je suis né et où je suis allé en classe. Notre voisine, Maria, était déjà une jeune fille lorsqu’on me traitait encore de gamin, et c’est pourquoi j’étais fier quand cette belle me tendait la main. Mais qu’elle pût un jour devenir ma fiancée !... je n’aurais osé prétendre si haut. J’avais décidé de voyager quand je serais compagnon. Je voulais voir le monde dont j’avais lu maintes descriptions ; aussi, dès mon apprentissage terminé, mes économies rassemblées, je bouclai mon sac et dis au revoir aux amis.
« Maintenant il faut vous dire qu’à Faaborg l’église est à un bout de la ville et la tour à l’autre. Un soir, je passais devant la tour, quand je rencontrai Maria. Elle ma salua amicalement et m’embrassa. J’aurais voulu que toute la ville nous regardât, mais nous étions seuls tous les deux. Je levais les yeux vers la tour. Elle n’a pas de chemin de ronde, sinon celui qu’on a peint sur le mur et où l’on voit deux veilleurs en grandeur naturelle et en couleurs. Ces veilleurs, que n’aurais-je donné pour qu’ils fussent vivants ! Je n’ai pu m’empêcher quand même de leur crier : « Vous avez vu ; la plus belle fille de la ville m’a embrassé. »
– Et alors, vous vous êtes fiancés, demanda le sergent-major.
– Oui, sur-le-champ. J’étais étonné, mais ravi. La joie de mon voyage n’en fut que plus grande. Pendant cinq ans je suis allé de pays en pays, j’ai rencontré de braves gens et de bons maîtres, mais j’avais la bougeotte... Souvent, lorsque j’étais resté quelques semaines dans une ville, je croyais y avoir toujours vécu, avoir toujours connu ces camarades avec lesquels je sifflais des romances allemandes. C’est seulement lorsque je voyais quelque chose de tout à fait prodigieux, comme, par exemple, l’église Saint-Étienne de Vienne, ou ces hautes montagnes entourées de nuages et dont les pieds reposent dans des pays plus riches que le plus riche garde-manger, qu’alors je voyais Faaborg devant moi. Au moment où j’allais presque avoir la larme à l’œil en admirant ces merveilles du monde, je pensais irrésistiblement à la tour de Faaborg, avec le chemin de ronde peint et les gardiens qui avaient vu Maria m’embrasser, et il me semblait que tout aurait une saveur plus douce encore, si seulement il y avait près de moi la vieille tour et Maria avec sa jupe verte. Alors, je sifflais une romance et la gaieté revenait. Et je repartais avec les camarades, plus loin, toujours plus loin.
– C’est pourtant joli chez nous, dit le sergent-major.
– Oui, c’est joli, quand les arbres fruitiers sont en fleurs, quand le champ de trèfle embaume comme un vase plein de fleurs. Mais que diriez-vous si vous traversiez ces grandes montagnes bleues, les Alpes, comme on les appelle, dont on tire du marbre blanc comme du sucre et où les raisins ont la chair ferme comme les prunes de chez nous ? C’est là que j’étais depuis trois ans lorsque je reçus une lettre d’un de mes cousins, une lettre au coin de laquelle ma fiancée avait écrit de sa main : « Maria te fait dire bien des choses et te prie de ne pas l’oublier ! »
Mon cœur s’amollit de tendresse et je reconnus bien que c’était l’amour. Aussi, je fus pris d’un ardent désir de retour. Et je marchai durant des nuits et des nuits sur les routes solitaires, je passai devant de grands cloîtres, des villes étroites et des montagnes et des vallées. Puis j’entendis de nouveau le parler danois, je vis le clocher de Horne et les champs de bruyères près de Faaborg, – et quand je demandai Maria en mariage, je l’obtins.
« Maintenant je ne voyagerai plus, maintenant je regarde les cigognes, je les vois partir et revenir. Il m’arrive de n’être pas de bonne humeur, mais Maria a sa manière à elle de me calmer. Une fois l’été, nous traversons l’eau et nous allons à Thorseng faire un tour. Quant aux longs voyages, le garçon pourra les faire quand il sera grand. Il est audacieux, vous savez, sergent !
– C’est pourquoi il aura à boire, répondit ce dernier en lui tendant un verre à demi plein.
L’enfant le saisit des deux mains et but si vite que les larmes lui montèrent aux yeux.
– Voilà votre dame, dit le sergent-major comme entrait la mère du garçon.
Le port majestueux, les grands yeux noirs auraient encore pu faire revenir un amoureux de bien loin. Elle jeta à l’homme un regard sévère, eut un salut court mais aimable pour le sergent-major qui lui tapait sur l’épaule.
– On a entendu de belles histoires, lui dit-il, on a voyagé à droite et à gauche avec le patron.
– Comme si on n’avait pas mieux à faire ! répondit-elle d’un ton bref, en rangeant son fichu dans le tiroir. Il n’avait qu’à rester là-bas, puisque c’était si beau. Dieu sait ce qu’il est venu chercher ici. Tantôt trop de froid, tantôt trop de pluie. Aussi je lui dis : « Voyage, personne ne tient à toi. Moi je peux me placer et gagner le pain du garçon ! »
– Maria, dit l’homme, tu ne penses pas ce que tu dis. Si je n’étais pas revenu, tu ne serais peut-être pas encore mariée.
– Penses-tu ! répliqua la femme. Des maris, j’en aurais trouvé dix. Le fils du fermier d’Oerebœk m’avait demandée avant toi, mais j’étais une sotte dans ce temps-là, comme nous le sommes toutes.
– Tu ne l’as pas regretté, Maria, dit l’homme tendrement, en mettant sa joue contre la sienne.
Elle l’embrassa en riant, puis alla à la cuisine où l’on entendit bientôt grésiller le poisson du petit repas familial.
II
CHRISTIAN ET NOÉMIE
Et ils allèrent parmi les fleurs
En s’embrassant
Et ils tremblaient d’allégresse.
ŒHLENSCHLŒGER.
Dans les villes commerçantes, presque chaque maison possède un petit jardin, mais celle-ci n’en avait pas.
Cependant, puisqu’il en fallait, ne fût-ce que pour y récolter une poignée de poireaux et un peu de pourpier, on en avait créé un, un jardin suspendu du Nord, comme en ont les pauvres : une grande caisse remplie de terre, placée sur le toit pour que les canards ne viennent pas l’abîmer. On y accédait par une lucarne à travers laquelle il fallait, après avoir grimpé sur une échelle, passer la moitié de son corps pour atteindre le jardin.
– Nous éprouvons peut-être autant de plaisir de notre modeste verdure, disait Maria, que le Juif de son parc magnifique.
– Mais le plaisir serait encore plus grand si le parc était à nous, répondit l’homme ; ce doit être merveilleux ces fleurs, ces plantes rares comme il n’y en a dans aucun jardin de Svendborg. Dans les soirées d’été, quand le vent souffle de ce côté, on sent l’odeur des jasmins. Maria, ce superbe peuplier qui se dresse bien au-dessus du toit me jette dans mille étranges pensées. Dans les nuits d’été et de pleine lune, il se détache en noir sur le ciel bleu comme les grands cyprès d’Italie. Bien souvent, alors que tu dormais, il m’est arrivé de rester debout près de la fenêtre ouverte, et tandis que le vent m’apportait une bouffée du parfum des jasmins, je pouvais m’imaginer que j’étais encore en l’Italie la Belle.
– Le voilà qui recommence ! dit Maria en se retirant.
Mais le petit garçon écoutait les paroles de son père avec de grands yeux attentifs. Comme il serait heureux, lui aussi, de voler avec les cigognes vers les pays étrangers ! Et comme sa joie serait profonde également si seulement il pouvait être assis dans le nid et plonger ses regards en bas, dans le parc du Juif ! Ce parc était comme un monde mystérieux. Une fois, sa mère et lui étaient entrés dans la maison ; ils avaient assisté à la fête des Tabernacles. Jamais il n’oublierait ces magnificences.
Parfois, durant les longues soirées d’hiver, le père lisait les Mille et une Nuits à haute voix, mais ses propres voyages semblaient aussi féeriques au jeune garçon ; la cigogne était pour lui un animal fabuleux, et le parc du Juif, qu’il n’avait jamais vu, lui semblait le jardin des Hespérides et la maison de Shéhérazade avec l’or du jet d’eau et l’oiseau qui parlait...
C’était au mois de juillet. L’enfant jouait dans le hangar à tourbe, qui représentait la frontière entre sa maison et le monde enchanté. Dans un coin, quelques pierres s’étaient détachées. Le petit se coucha par terre et essaya de regarder par les interstices, mais il ne vit que des feuilles vertes que le soleil rendait transparentes. D’une main tremblante, comme s’il avait l’audace de soulever le voile d’un mystère, il arracha une pierre du mur ; celle qui était au-dessus glissa et se plaça en travers. Le cœur du gamin battait, il n’osait bouger. L’ouverture était plus grande, mais il ne voyait encore qu’un seul plant de fraises qui, dans sa fantaisie enfantine, avait le même éclat, la même somptuosité que, pour de grandes personnes, l’arbre le plus riche, dont les fruits lourds pendraient jusqu’à terre. Certaines feuilles du fraisier paraissaient déborder de sève parmi les rayons du soleil ; d’autres, au contraire, semblaient trembler dans l’ombre, et au milieu de cette splendeur deux grandes fraises, fraîches et rondes, s’offraient. Les raisins de Chanaan n’avaient pas plus de magnificence que ces deux fraises. Avec le plaisir de les contempler, vint la tentation de les cueillir ; mais cela, l’enfant ne l’osait pas. Avoir arraché cette pierre du mur était un assez grand péché pour un jour.
L’après-midi suivant, personne n’avait encore touché à la pierre. Le vent avait poussé les feuilles vertes vers le trou et les deux fraises étaient toujours là. La petite main s’avança et toucha le fruit sans le cueillir. Le garçon enlaça seulement la tige verte et, comme au même moment une petite main d’enfant rencontra la sienne, il la retira avec tant de hâte qu’une pierre du mur glissa.
C’est seulement après quelques instants d’attente qu’il osa se rapprocher et regarder à travers l’ouverture agrandie. Il aperçut Noémie, la petite fille du Juif, – elle était d’un an plus jeune que le petit garçon. Une fois déjà, il l’avait vue debout à la fenêtre de son grand-père et elle portait alors des bottines de maroquin jaune qui avaient produit sur lui la plus grande impression.
Les enfants, durant un moment, se regardèrent fixement.
– Petit garçon, dit Noémie, tu peux venir chefs moi, agrandis le trou...
Et comme si une fée puissante avait commandé, deux pierres glissèrent encore du mur.
– Comment t’appelles-tu ? demanda-t-elle.
– Christian, répondit le garçon, et sa tête apparut dans le jardin parfumé, inondé de soleil.
Noémie écarta les branches de la treille qui passait presque par-dessus le mur. Il fut dans le pays des rêves et s’oublia dans sa contemplation.
Des adultes n’auraient vu là qu’un beau petit jardin en pleine floraison, avec des plantes rares, des vignes grimpant aux murs, un peuplier et, plus loin, deux acacias ; mais ce jardin, il faut que nous le regardions avec les mêmes yeux que celui qui venait d’y pénétrer ; il nous faut respirer avec lui ce violent parfum de fleurs, sentir les chauds rayons du soleil, admirer toutes ces merveilles. Des treilles superbes, d’odorants chèvrefeuilles, des liserons roses et bleus grimpaient sur les murs et y formaient un tapis. Un bosquet de roses mousses dessinait une demi-lune autour d’un parterre de giroflées. Près du peuplier, où le sombre lierre accrochait ses feuilles vigoureuses, la petite Noémie se tenait debout avec ses yeux intelligents de gazelle, son teint brun révélant la race orientale, le sang frais avivant ses joues rondes entourées de cheveux noirs. Une robe sombre à ceinture de cuir enveloppait la jolie silhouette enfantine.
Elle l’entraîna vers le banc, sous l’acacia, dont les fleurs roses pendaient en grappes épaisses. Ils mangèrent les fraises les plus délicieuses. Le garçon regardait autour de lui, transporté dans ce jardin des Hespérides qui semblait si loin de son foyer habituel. La cigogne jacassait très haut et il reconnut le nid avec les petits. Alors il pensa à la petite cour de ses parents, à la petite caisse avec le poireau et le pourpier, et il s’étonna que tout cela pût être si proche.
Puis la petite Noémie le prit par la main et ils entrèrent dans le pavillon. Une seule fenêtre aux vitraux rouges jetait une étrange lumière sur une tapisserie où des bêtes, des oiseaux et des fleurs s’entremêlaient. Un œuf d’autruche, qui prenait sous cet éclairage une couleur de feu, pendait du plafond. Noémie montra le nid, Christian regarda à travers les vitraux et, tout, au dehors, dans cette fantastique clarté, lui faisait penser à la montagne en feu dont son père parlait. Tout lui semblait dans les flammes : les buissons, les fleurs flambaient, les nuages paraissaient de feu dans l’atmosphère enflammée.
– Au feu ! cria Christian.
Mais Noémie rit et battit de ses petites mains.
– Jouons à vendre de l’argent, dit-elle en tirant un brin d’herbe à travers deux feuilles ; voici la balance. Les pétales jaunes, rouges et bleus sont de l’argent. Les rouges sont les plus précieux. Toi, tu seras l’acheteur, mais il faut que tu me donnes un gage. Tu pourras me donner ta bouche ! C’est pour jouer seulement, je ne te la prendrai pas pour de vrai ; si tu veux, tu me donneras tes yeux.
Avec la main, elle fit le geste de les prendre, et Christian reçut des pétales rouges et bleus. Jamais de sa vie il n’avait joué à un jeu aussi délicieux.
– Seigneur ! c’est là qu’il est ! cria Maria en passant à demi la tête par l’ouverture, dont les petits s’étaient rapprochés.
Effrayé, Christian quitta la main de Noémie, laissa tomber les pétales et rampa à travers le trou derrière lequel l’attendait une volée de coups. Les pierres furent remises en place tant bien que mal, car de pareils exercices étaient, comme le disait Maria, sévèrement défendus. Ce qui ne l’empêcha pas de s’arrêter au milieu de son travail, de cueillir la fraise la plus proche et de la manger.
Le lendemain, Noémie avait dû raconter la visite ; on avait mis des planches du côté du jardin. C’est en vain que Christian essaya de les déplacer. L’entrée au pays enchanté des fleurs était fermée.
Mais toute cette splendeur restait vivante pour lui : les arbres et les fleurs, les vitraux rouges et la jolie Noémie. Il y pensait le soir, tandis que le sommeil descendait sur son petit lit.
III
AU FEU !
Au milieu de la nuit, Christian s’éveilla. Une étrange lueur rouge, semblable à celle qu’il avait vue dans le pavillon à travers les vitraux, illuminait la pièce. Oui, les vitres avaient la même couleur de feu, le ciel cet éclat flamboyant, le sombre cyprès lui-même semblait ardent.
Tout d’un coup, on entendit crier : « Au feu ! » Ses parents sautèrent de leur lit. La maison du Juif était en flammes, une pluie d’étincelles tombait dans la cour voisine, le ciel était rouge.
Maria confia le garçon aux voisins et ramassa en hâte les meilleures pièces de l’ameublement qu’elle voulait sauver, car le feu avait atteint déjà l’aile gauche de la maison, la plus proche de celle du tailleur. La chambre à coucher du vieux Juif donnait sur le jardin, mais il dormait encore, tandis que les flammes l’enveloppaient de leur mortel réseau. La hache à la main, le veilleur et quelques voisins firent un trou dans le mur et traversèrent le jardin. Il y faisait chaud comme dans un four, et les étincelles pleuvaient au-dessus de leurs têtes. On enfonça la porte. Personne ne se montrait encore dans la maison.
Tout à coup, la fenêtre d’une mansarde s’ouvrit violemment, un chat sauvage, en miaulant, se fraya un passage, grimpa sur un arbre et disparut. À l’intérieur, trois personnes apparurent : le vieux Juif avec sa petite-fille Noémie, et le vieux serviteur Joël.
– Enfoncez la porte ! crièrent quelques voix, et on appliqua l’échelle contre le mur.
La fumée épaisse et noire tourbillonnait autour de la fenêtre, les tuiles du toit éclataient de chaleur.
– Joël ! crièrent tous, au moment où le vieux serviteur bondit hors de la porte, ses membres jaunes et maigres enveloppés d’une vieille robe de chambre, ses longs doigts serrant une cassette qu’il avait, d’instinct, emportée dans sa fuite.
– Le grand-père et l’enfant ! murmura-t-il, anéanti de fatigue et de frayeur, en s’appuyant contre le mur et en montrant du doigt la fenêtre.
Alors celle-ci s’ouvrit et le vieux Juif à moitié nu apparut, tenant dans ses bras la petite Noémie. L’enfant se blottissait, peureuse, contre lui. Quelques assistants se précipitèrent pour tenir l’échelle.
Le vieillard avait déjà mis ses deux pieds sur les barreaux et le haut de son corps allait suivre avec l’enfant, quand il fit tout à coup entendre un sourd gémissement, entra de nouveau par la fenêtre et disparut. La fumée noire et les étincelles voilèrent un instant la fenêtre.
– Seigneur Jésus ! cria-t-on en bas, où va-t-il ? Il va brûler avec l’enfant. Il a dû oublier son argent.
– Place ! fit une voix forte.
Et un homme au visage sombre et expressif s’avança et monta à l’échelle, s’agrippa à l’appui de la fenêtre, dont la partie supérieure était déjà noircie par les flammes. Tout l’intérieur de la pièce était illuminé, les langues de feu glissaient sous le plafond bossué.
L’homme entra.
– N’est-ce pas le Norvégien de la rue du Trou ? demanda quelqu’un.
– Si c’est lui, c’est un fameux gaillard !
Les flammes éclairaient chaque coin de la pièce. Noémie était couchée par terre. On ne voyait plus le grand-père... Une fumée épaisse et suffocante arrivait de la chambre voisine par une porte nouvellement ouverte. L’homme saisit l’enfant et sauta sur l’échelle vacillante. Noémie était sauvée, mais le grand-père était déjà tombé dans la chambre enfumée où se trouvait son coffre-fort.
Le toit s’effondra bruyamment. Une fumée d’étincelles innombrables comme les étoiles de la voie lactée s’éleva dans l’air.
– Jésus, aie pitié de lui ! fut le court miserere jeté sur cette âme qui, en cet instant, à travers les flammes, rejoignait le royaume des morts.
Maria avait fait rentrer chez elle Joël et Noémie.
– La cigogne ! la pauvre cigogne ! crièrent-ils tous.
Le nid était éclairé par les flammes qui l’enveloppaient. La mère cigogne, là-haut, étendait ses ailes au-dessus des petits pour essayer de les protéger contre la terrible chaleur. Le père, au contraire, avait disparu ; il avait dû s’envoler auparavant. Et comme les petits s’enfonçaient dans le nid, n’ayant pas le courage de partir, la mère agitait ses ailes et tendait la tête et le cou en avant.
– Ma cigogne, mon cher oiseau, disait le tailleur, il ne faut pas que cette pauvre bête soit brûlée.
Mais la flamme atteignit bientôt les herbes sèches qui formaient le nid, et, au milieu du feu, la mère resta debout et mourut avec ses petits.
Quand le jour se leva, l’incendie était éteint. La maison du Juif n’était plus qu’un amas de cendres et de charbons où l’on retrouva son cadavre mutilé.
Vers le soir, le tailleur et son petit garçon se tenaient près du lieu de l’incendie ; la chaleur et la fumée qui s’élevaient indiquaient que dans le fond le feu durait encore. Le beau jardin n’était plus qu’un désert piétiné. Des poutres calcinées gisaient de-ci de-là. Les belles giroflées avaient disparu et les haies de roses étaient brisées et souillées de terre. La moitié de l’acacia avait flambé, et, au lieu du frais et délicieux parfum de fleurs, on respirait une odeur de fumée et de roussi. Le pavillon s’était effondré. Un petit morceau du vitrail rouge fut tout ce que Christian retrouva de ses anciens souvenirs, et, quand il regarda au travers, l’air flamboya, comme lorsqu’il avait regardé par la fenêtre avec Noémie. Sur le toit de ses parents, il vit le mâle des cigognes qui était revenu et n’avait trouvé ni son nid, ni la maison qui le soutenait. Il tournait la tête et le cou, comme s’il cherchait quelque chose.
– Pauvre bête ! dit le tailleur. Tout le jour, depuis l’instant de son retour, il n’a fait que voler autour des ruines. Maintenant il se repose un peu. Il a beau chercher la mère et les petits, jamais plus ils ne s’envoleront vers les pays chauds.
Dans la maison de derrière, où l’on avait troué le mur pour atteindre le jardin saccagé, le vieux Joël se tenait appuyé contre une rampe de fer rouillé, ses yeux noirs et tristes fixés sur un objet que cachait un vieux tablier sale et fripé. Ses lèvres blêmes remuaient et il se disait à lui-même : « Toi, le fils fortuné de la race de Salomon, le tablier d’une pauvre femme sera ton riche linceul. Hélas ! nulle fille d’Israël ne lavera tes membres, les flammes rouges s’en sont chargées. Le feu est plus sec que les herbes, plus rouge que les roses que nous mettons dans le bain de nos morts. Mais c’est dans Betachaïm 1 tout de même que sera ta tombe. Le pauvre Joël sera tout ton cortège, mais tu reposeras dans la terre rituelle, et le fleuve sombre qui coule sous la terre te conduira un jour à Jérusalem ! » Il souleva le tablier, enleva le couvercle du cercueil où reposaient les membres brûlés du Juif. Et alors ses lèvres tremblèrent davantage, des larmes lui montèrent aux yeux et ses paroles devinrent incompréhensibles.
– Que notre Seigneur Jésus lui soit clément ! dit Maria en entrant.
Mais aussitôt une rougeur envahit son visage : il lui semblait que de prononcer le saint nom de celui que Joël ne reconnaissait pas pour Dieu devait blesser le pauvre homme en deuil.
– Notre Seigneur ! reprit-elle aussitôt et avec force, notre Seigneur lui soit clément !
– Sa pierre tombale sera érigée près de celle de sa fille, fit Joël, tandis qu’il recouvrait les restes brûlés.
– Mais elle est enterrée à Fredericia, reprit Maria. Il vous faut aller bien loin pour trouver une sépulture. Je me rappelle la nuit où on a emmené la pauvre dame en voiture. Le cercueil était posé dans la paille et le foin. Son père, qui maintenant n’est que cendres et poussière, et vous-même, l’accompagnâtes. Il pleuvait à torrent... Et cette pauvre enfant qui reste ! Elle n’avait plus que son grand-père.
– Sa mère était des nôtres, dit Joël. Et il ajouta avec un peu de fierté : Nous autres, nous ne laissons pas les nôtres souffrir de la faim. Moi, je suis vieux, mais je gagnerai mon pain, et si elle ne trouve pas place à plus riche table, je le partagerai avec elle. Dans la maison des chrétiens on ne tolère que l’enfant des chrétiens, ajouta-t-il si bas qu’on ne l’entendit pas.
– L’enfant est chez nous, dit Maria, qu’elle y reste jusqu’à ce qu’elle trouve mieux. Si la marmite cuit pour trois bouches, elle cuira bien pour quatre !
Le soir suivant, très tard, alors que les rues étaient sombres et silencieuses, une petite caravane traversait la ville pour atteindre l’embarcadère : c’était le tailleur avec sa lanterne, suivi de Joël portant un paquet sur le dos et la boîte sous le bras. Maria marchait derrière avec Christian et Noémie. La petite fille pleurait, Joël l’embrassa sur la main et le front, puis il monta à bord du bateau. Les autres restaient maintenant sur le quai, tandis qu’on détachait les cordages.
Et Christian vit à la lune montante que les voiles blanches s’ouvraient, que le bateau glissait au long du courant, tandis que Joël était debout avec la boîte sous le bras. Toute la campagne apparaissait sous la lumière incertaine.
– Comme ceci ressemble au Rhin, près de Mayence ! dit le tailleur en montrant du doigt une île toute proche, Thorseng.
– Grands dieux ! s’écria Maria, comment peux-tu penser à des choses pareilles ! Nous ne devrions pas avoir le cœur à ce genre de conversation. Pauvres gens ! même dans la mort ils n’ont pas de repos. Il faut qu’ils voyagent pour aller en terre !
Et tristement elle suivit des yeux le bateau sur le fjord.
IV
UNE CALÈCHE SURVINT
Demain, hélas ! ne vaudra jamais aujourd’hui.
Maintenant, ma poupée, c’est l’heure dorée,
(Berceuse.)
Comme un enfant oublie vite ses peines ! Peut-être aussi vite que nous oublions notre existence terrestre quand nous entrons dans une vie nouvelle.
Noémie avait d’abord pleuré beaucoup son grand-père ; maintenant le sourire avait remplacé les larmes.
La grande terre fleurie avait une fois déjà tourné sur son axe, et cet intervalle est pour le chagrin d’un enfant ce que les semaines, et les mois sont pour celui d’un adulte. Son foyer, c’était maintenant la chambre du tailleur avec son petit camarade de jeux. On lui avait mis une robe de deuil jolie et presque neuve, et Noémie s’en trouvait très heureuse.
– Est-ce que je la mettrai tous les jours ? demandait-elle ; ne faut-il pas l’économiser ? autrement, je ne l’aurai plus quand je serai encore en deuil.
Elle réclamait, bien plus que son grand-père, ses beaux jouets, la maison de poupées avec la cuisine et la chambre.
Parfois elle s’asseyait sur le seuil de la porte, tenant dans ses mains une grande feuille de bardane : c’était un éventail, une tonnelle, un jardin ; oui, tout le grand jardin fleuri plein de couleurs et de parfums renaissait dans cette feuille verte.
Des pierres des champs représentaient un grand escalier, les ouvertures entre les pierres étaient son moulin et le sable que Christian cherchait en bas était le blé à moudre. Ses jouets se réduisaient à une toupie ronflante avec un clou de cuivre au centre.
– C’est une fleur qui danse, disait Maria.
– Non, répondait Christian, c’est notre âne qui travaille au moulin. Il ne veut pas tourner sans qu’on le fouette, écoute comme il brait, vois comme il saute !
– Maintenant, il faut qu’il meure, dit Noémie, puis nous l’enterrerons, comme grand-papa, et puis on jouera au deuil, ce sera très amusant.
Et Christian fut en même temps l’enfant de chœur et le sacristain.
Les enfants placèrent la toupie dans un trou de l’escalier et mirent de l’herbe dessus. Ensuite, ils jouèrent à l’incendie, les cloches sonnaient, les gens fuyaient, quelques enfants du voisinage se joignirent à eux et le jeu prit un autre aspect ; on se comprenait si bien, on était tout de suite amis, bien que Noémie n’eût jamais joué avec ces enfants. On enleva ses souliers, on les rangea le long du mur et on marcha de long en large. On regardait l’illumination.
Une fois, à Svendborg, les invités d’une noce avaient accompagné les époux avec des torches et des flambeaux depuis la maison de la mariée jusqu’à celle du marié. Pour faire comme eux, chaque enfant prit son soulier, qui était un flambeau, et tous accompagnèrent Christian et Noémie, les soi-disant époux. Jamais la petite n’avait si bien joué. Qu’était-ce que l’armoire de poupées, les images et les fleurs en comparaison de vrais camarades ! Elle s’appuyait tendrement sur Christian, il lui jetait son bras autour du cou et l’embrassait. Elle lui donna le médaillon qu’elle portait sur sa poitrine, afin qu’il s’en parât et devint un comte, puis elle l’embrassa de nouveau, tandis que les autres les éclairaient de leurs souliers.
Le jeu des enfants fut subitement interrompu. Une sorte de calèche comme on en avait il y a quelque vingt ans, une lourde machine de bois peinte en bleu et tapissée à l’intérieur de molleton gris, avec un cocher digne et important, un de ces attelages qui semblent se survivre à eux-mêmes, roulait sur le pavé inégal. Cette calèche s’arrêta devant la pharmacie, où l’on porta une quantité de petites boîtes, de cruches et de flacons, le tout en grande hâte. Puis la voiture repartit pour s’arrêter devant la porte où jouaient les enfants.
Il y avait dans la voiture deux dames dont la plus jeune, de maintien modeste, semblait une femme de chambre ; l’aînée, grande et distinguée, à l’apparence maladive, enveloppée frileusement de châles et de manteaux, respirait un flacon de sels en argent. En un clin d’œil, Maria fut près de la voiture. S’inclinant, elle baisa la main de la grande dame, l’assurant que ses volontés seraient exécutées à la minute.

Tout le voisinage accourait aux fenêtres ; quelques marchandes sortirent sur le pas de leur porte, vêtues, non pas comme on le voit aujourd’hui, de soie et de crêpe, mais, comme il était de mode en ce temps, de jaquettes de laine rouge et coiffées de bonnets. Les enfants, qui s’étaient arrêtés de jouer, regardaient en se tenant par le cou, debout le long du mur. Christian vit que l’on mit un foulard à Noémie, qu’on la fit monter dans la voiture auprès des dames et que personne n’avait l’air de trouver cela inattendu. Maria faisait la révérence et le tailleur était debout à la porte, le bonnet à la main.
– Je ne veux pas partir ! dit Noémie.
Mais il le fallait, bon gré mal gré. Aussi se mit-elle à pleurer en tendant les bras, tandis que la voiture s’éloignait. Alors le garçon éclata en sanglots. La séparation avait été si soudaine, si inattendue.
– Tu vas te taire, dit Maria, autrement je te donnerai de bonnes raisons de pleurer.
– Où va ma femme ? demanda-t-il.
– Elle s’en va voir le monde. Remercie le ciel d’avoir ton père et ta mère, tu t’en rendras compte un jour. S’il fallait te voir partir comme cela chez des étrangers...
Elle le regarda pensivement, puis l’attira violemment contre sa poitrine.
– Écoute, je te permets d’aller voir ton parrain à la rue du Trou. Prends tes jambes à ton cou.
Et elle l’entraîna avec elle dans la boutique.
V
LE VIOLON DU PARRAIN
Svendborg a encore l’aspect des petites villes du siècle dernier. Des bâtiments irréguliers dont l’étage supérieur avance parfois sur les autres et repose seulement sur une poutre indépendante, des balcons qui coupent la vue aux voisins, de larges escaliers d’entrée avec des bancs de bois ou de pierre pour s’asseoir au dehors. Sur les portes, des inscriptions mi-danoises mi-latines sont encore gravées dans le bois. Les rues inégales semblent des collines pavées. L’une d’elles était si escarpée que de la grande rue on apercevait, par-dessus ses toits, une partie du fjord, la côte ouverte de bois et les îles Langeland et Thur.
C’est dans cette rue qu’habitait le parrain de Christian.
Le garçon était au coin de la rue et regardait la mer par-dessus la maison. Elle lui semblait si haute qu’un trois-mâts au large paraissait naviguer par-dessus la cheminée.
Comme d’habitude, la porte de la maison était fermée, mais on entendait, venant de l’intérieur, le son d’un violon. Toute oreille familiarisée avec le royaume des sons eût été surprise par cette musique. Elle rappelait d’abord ce thème de Paganini qui a fait dire que le virtuose avait tué sa mère et que l’âme de la victime venait frissonner dans les cordes. Puis la mélodie devint mélancolique et fit penser au thème d’Ole Bull appelé la Douleur d’une mère après la mort de son enfant. Naturellement on n’y trouvait pas la perfection de ces deux maîtres, mais cette musique les rappelait, comme le rameau vert rappelle l’arbre dont il est issu.
L’auteur de cette mélodie ne nous est pas inconnu. Nous l’avons entendu nommer lors de l’incendie où il sauva Noémie. C’est dans les montagnes de Norvège, parmi les cascades et les glaciers, qu’il avait été bercé.
Il parlait souvent à Christian de sa patrie, de l’elfe qui habitait la rivière et qui, au clair de lune, était assis, avec sa grande barbe blanche, dans la cascade et jouait si divinement qu’on avait envie d’aller s’y jeter. Pauvre elfe, alors qu’il jouait le plus merveilleusement du monde, les garçons se moquaient de lui : « Tu sais bien que ton âme n’est pas immortelle », lui disaient-ils. Alors l’elfe pleurait de grosses larmes et disparaissait dans la rivière.
– C’est sans doute l’elfe qui a appris à jouer à ton parrain ? dit un jour un voisin à Christian.
Et, depuis ce moment, lorsque l’enfant entendait le violon, il pensait à l’elfe dans la cascade bruissante et il devenait muet et rêveur.
C’est pourquoi il s’assit, ce jour-là, devant la porte fermée, appuya la tête contre elle et écouta les sons étranges. Ce n’est que lorsque le violon se fut tu qu’il frappa, avec son pied.
Un homme ouvrit. Son visage brun, ses cheveux noirs et brillants révélaient une origine méridionale ou juive, quelque chose que démentaient les étranges yeux bleu clair, totalement nordiques. Leur couleur limpide faisait un bizarre contraste avec les sourcils broussailleux et sombres.
L’enfant le regarda avec un mélange de terreur et d’attachement, car son voisinage avait ce je ne sais quoi que l’on attribue au jeu des elfes et au regard des serpents.
Lorsque Christian était à la maison, son vœu le plus cher était de voir son parrain, et cependant il n’éprouvait près de nul autre au monde ce sentiment désagréable qui vous étreint, lorsqu’on est seul dans une étroite chapelle funéraire ou dans une grande forêt où l’on a perdu son chemin.
À chaque visite, Christian avait ses deux piécettes de monnaie, mais ce n’était pas ce qui l’attirait, non, c’étaient les étranges histoires des sombres forêts de pins, des glaciers et des elfes, et, par-dessus tout, la musique. Le violon racontait, à sa manière, des choses aussi extraordinaires que la bouche du parrain.
La porte se referma aussitôt que Christian fut entré.
Sur le mur pendaient quelques images qui intéressaient particulièrement le petit garçon. C’étaient cinq fragments colorés de la danse macabre d’après le tableau de l’église Sainte-Marie de Lubeck. Tous doivent entrer dans la danse, le pape et l’empereur, tous, jusqu’au petit enfant dans son berceau qui s’étonne et chante :
Oh ! mort, comment puis-je comprendre cela ?
Je dois danser, moi qui ne sais pas marcher.
Christian regarda les images et vit qu’elles étaient retournées. Il demanda :
– Pourquoi ?
– Elles se sont retournées en dansant, dit le parrain. Es-tu resté longtemps assis dehors ?
– Non, pas longtemps. Tu jouais et j’écoutais ! Si j’avais été ici, j’aurais pu voir comment la mort dansait et comment les images se sont retournées. Car c’est vrai, ce que tu me racontes, n’est-ce pas, parrain ?
– Elles sont à toi, dit le parrain. Et il les décrocha. Dis à ton père que je te les ai données. Je garde le verre et les cadres. Ce sont de belles images ! M’aimes-tu maintenant ? N’est-ce pas que je suis bon ? Dis-le-moi !
Le petit le lui dit, mais le regard du parrain l’inquiétait.
– Pourquoi ta petite camarade n’est-elle pas avec toi ? Elle s’appelle Noémie, n’est-ce pas ? Vous auriez pu venir tous les deux !
– Elle est partie, dit Christian, partie en voiture avec un cocher si distingué.
Et il expliqua aussi bien qu’il le put son rapide départ. Le parrain écoutait ce récit avec un bizarre sourire. L’archet glissait sur les cordes, et si les plus secrètes pensées du parrain chantaient en elles, on pouvait juger de la fièvre qui consumait son âme.
– Tu apprendras aussi à jouer, dit-il. Cela fera peut-être ta fortune. Ton jeu pourra te rapporter de l’argent et chasser tes chagrins lorsque tu en auras. Voici mon vieux violon, tu n’auras pas encore le meilleur. Mets tes mains comme ça !
Il les plaçait sur les cordes et dirigeait lui-même l’archet dans les mains de l’enfant.
Cette première leçon dura presque une heure, puis le parrain s’empara lui-même du violon et joua. Il jonglait avec les sons comme le jongleur avec des oranges ou des couteaux tranchants.
– Oh ! jouez la danse des morts ! demanda le petit.
Le parrain donna quelques coups d’archet vigoureux, et, tandis que la basse vibrait encore, la quinte sifflait.
– Entends-tu l’empereur ? Il vient, précédé du son des trompettes, mais voilà la mort qui souffle comme le vent aigre. Entends-tu le pape ? Il chante des psaumes et la mort ricane. Il faut qu’il cède, qu’il entre dans le tourbillon de la valse. Entends-tu la mort ? C’est comme si le grillon sifflait.
Et le parrain fermait les yeux, tandis que de grosses gouttes de sueur perlaient sur son front.
Enfin il posa son violon et ouvrit la porte du jardin, qui donnait sur le fjord. Les îles, couvertes de forêts, nageaient dans la mer immobile. Le soleil se couchait. Tout le petit jardin était planté de choux. Christian regardait surtout ceux qui commençaient à montrer leur tête.
– Le bourreau serait content de les avoir, dit Christian.
– Que dis-tu, mon enfant ? demanda brusquement le parrain.
– Je disais que le bourreau serait content d’avoir ces choux, répondit Christian. Maman m’a raconté l’année dernière, comme nous passions devant la maison du bourreau où il pousse des choux comme ça, maman m’a raconté que si je voulais être bourreau, il faudrait que j’entre en apprentissage chez lui et que, chaque fois que nous mangerions des choux, on m’apprendrait à en couper la tige avec une hache, là où le maître aurait marqué la place.
– Tais-toi ! cria le parrain avec une violence inaccoutumée.
Et il poussa le gamin, qui tomba dans les plants de choux. Le petit médaillon que Noémie lui avait mis au cou glissa et tomba.
– Qu’as-tu là ? demanda le parrain avec une étrange expression sur le visage, lorsqu’en ramassant l’enfant il vit le médaillon. Il regarda la boucle de cheveux et sourit.
Subitement il entra dans la maison, mais revint aussitôt avec les dessins roulés ensemble et les piécettes d’argent bien enveloppées dans un papier. Il ouvrit la porte de la rue, car la visite était terminée pour ce jour-là. Mais Christian entendit de l’extérieur le violon jouer à nouveau, et les cordes traduisaient une gaieté semblable à celle qui se répand sur un navire chargé d’esclaves lorsqu’on les oblige, par manière d’exercice, à danser sur le pont.
Le lendemain, le parrain rendit visite aux parents de Christian. Il apportait une feuille de chou fraîche et du mouron pour le canari, dont la cage se transforma en une maison verte. Il glissa les brins souples et mûrs entre les barreaux, et le petit oiseau chanta sa joie et sa reconnaissance. Le parrain écoutait avec une attention particulière les notes monter, joyeuses et hardies ; ‘on eût dit qu’il voulait les prendre à l’oiseau pour en nourrir l’âme de son violon.
Le tailleur écoutait volontiers le jeu du parrain parce qu’il éveillait en lui des souvenirs des pays lointains. Maria, au contraire, lui trouvait une apparence de sortilège, et nous sommes presque obligés de lui donner raison.
L’enseignement, commencé la veille, devait être continué plusieurs fois par semaine, car l’enfant avait les doigts et la tête pour faire un violoniste.
– Ça lui permettra peut-être de gagner sa vie, dit Maria.
– Ça pourrait l’aider à courir le monde, dit le père.
– Ah ! bon, tu veux en faire un vagabond, s’exclama Maria, tu aurais pu aussi le conduire au danseur de corde qui était là et il aurait pu vagabonder tout à son aise.
– Ça, c’est une idée ! répliqua le père. Ça aurait peut-être été très heureux pour lui. Christian, n’aimerais-tu pas être léger comme l’oiseau et danser sur la corde raide, tandis que la foule battrait des mains ? Puis tu voyagerais de pays en pays et entendrais du nouveau.
– Et il recevrait aussi des coups, dit Maria. Et dans sa nourriture on lui verserait cette horrible huile grasse qui rend le corps souple. Non, non, pas de ça ! Qu’il apprenne le violon, puisqu’il a des dispositions.
– Il se fera aimer de tous par son jeu, dit le parrain, je crois qu’il sera un fameux luron.
– Qu’il devienne ce qu’il voudra, dit Maria, pourvu qu’il ne soit ni voleur ni menteur. Ce n’est toujours pas sa beauté qui l’aidera ; Dieu sait où il a pris cette figure !
Tous les enfants sont beaux pour leurs parents. Maria cependant était une exception. Elle savait que son enfant n’était pas beau ; mais on ne pouvait pas dire non plus, pensait-elle, qu’il fût vilain. On peut en juger encore aujourd’hui, du reste, par certain portrait de l’église Saint-Nicolas de Svendborg. Il y a là, dans la nef principale, à gauche, un grand tableau offert par Christen Morsing, pasteur à Thorseng. Il le donna à l’église à la mort de sa femme et on le voit avec elle, leurs deux filles et leurs sept fils, tous de grandeur naturelle. Trois bébés dans leur linceul sont couchés à leurs pieds.
Il y a donc là douze enfants et tous ont un joli visage, sauf l’un d’eux qui semble être le plus jeune et qui, en comparaison des autres, n’est pas joli du tout. Le peintre lui a mis une rose dans la main, comme s’il avait voulu lui donner tout de même quelque chose de gracieux. Le visage de cet enfant était exactement le même que celui de Christian. La ressemblance avait frappé jusqu’à ses propres parents. Et c’est à ce portrait que se rapportait le mot du parrain :
– Son violon sera la rose dans sa main, comme sur le tableau de l’église.
VI
LES CLOCHES DE THORSENG
– Quand j’irai à Thorseng, avait dit le parrain, Christian viendra avec moi.
On était alors au milieu d’août et la fête devait avoir lieu le lendemain. Le temps serait certainement beau, car le soleil s’était couché sans un nuage à l’ouest.
– C’est long encore jusqu’à demain ? demanda le petit en se couchant.
– Ferme seulement les yeux et endors-toi, et demain viendra sans que tu t’en aperçoives, répondit la mère.
Mais au milieu de la nuit, il l’appela encore pour lui demander quand demain viendrait.
– Veux-tu que je me lève et te donne une fessée ? fut la réponse, et Christian n’osa plus poser de question.
Au matin on le leva, on lui mit sa plus belle chemise, ses habits du dimanche et ses bottes neuves à lacets.
Le parrain était à la porte et ils partirent.
La rosée était tombée abondamment, le marché étincelait comme un lac, les oiseaux chantaient et le parrain, avec un sifflet, s’efforçait de les imiter. On n’avait pas le temps de cueillir des fleurs, Christian arracha seulement une branche de liseron d’une haie et la mit en couronne sur son chapeau.
Dans un chemin creux, un joyeux groupe de moissonneurs était assis. Le pot de bière circulait.
Mon amoureux a une plume au chapeau
Et travaille dans le Copenhague du roi.
chanta une fille en tendant les mains vers Christian.
À travers le petit bois qui appartient au presbytère, ils atteignirent la vieille église et le cimetière qui s’élève à la partie la plus méridionale de l’île de Fagen, près du fjord profond. Les flets étaient étendus parmi les saules. Une barque de pêche se balançait près de la petite jetée de pierre. Il y avait deux hommes dans la barque, l’un vidait l’eau de pluie du bateau, l’autre fixait la voile, ils attendaient les arrivants.
Le parrain prit lui-même une des rames, car le vent était trop faible pour naviguer à la voile. La barque glissait sur l’eau claire et verte en laissant un sillon bouillonnant derrière elle. Christian était assis à l’arrière, près du pilote. Les méduses gélatineuses flottaient à la surface comme de grandes fleurs transparentes et, de leurs mouvements lents, trahissaient la vie sur l’eau immobile. Le fond vert, jusque-là visible, disparut, et l’enfant ne vit plus que l’image de la barque et son propre visage qui répondait à ses signes. Ils traversèrent le courant et entrèrent dans l’ombre des falaises que le pays de Thorseng jetait dans l’eau. Le parrain toucha son chapeau comme par hasard, mais c’était là une vieille superstition de sa patrie, un salut au dieu de la mer, dont la souveraineté est plus forte là où s’étend l’ombre des rochers.
Ils allongèrent les rames dans la barque et abordèrent à Thorseng.
Le parrain et les pêcheurs causèrent mystérieusement, sans qu’il fût possible à Christian de saisir de quoi il s’agissait. Tout ce qu’il voyait de neuf et les splendeurs qui l’environnaient captivaient son attention.
Ils marchaient toujours entre des maisons et des jardins.
Les arbres fléchissaient sous le poids des fruits ; de grands tuteurs soutenaient leurs branches. Les roses trémières, avec leurs fleurs roses et jaunes, s’élevaient jusqu’à la moitié des maisons. Un étranger, subitement conduit dans cet air doux et cette magnifique nature, se serait cru transporté dans un pays méridional. Le Sund à Svendborg lui eût rappelé le Danube. Oui, ici, c’était l’été, le délicieux été. La menthe sauvage embaumait dans les fossés, ombragés par l’épine-vinette rouge et le sureau couvert de fruits.
– Il fera chaud, dit le parrain, mais il ajouta qu’on trouverait bien une voiture.
Pas un nuage au ciel. Un oiseau de proie volait lourdement avec des mouvements engourdis au-dessus du bois. On eût dit que toute la chaleur du jour reposait sur les ailes de l’oiseau. Le parrain était particulièrement exubérant. Il tailla une trompette pour Christian dans une tige de ciguë, enleva la moelle d’une branche de sureau et en fit un superbe sifflet, tout ceci en marchant et bavardant sur tout ce qu’ils voyaient. Une voiture passa et la poussière s’éleva ; comme la fumée quand on a tiré le canon, elle semblait se reposer dans l’air tranquille.
La voiture s’arrêta, ils y montèrent, et Christian reçut une feuille de chou pleine de cerises rouges et bien mûres, cadeau du paysan qui semblait fort bien connaître le parrain.
Aussitôt après, leur vinrent des compagnons de route ; deux hommes se joignirent à eux.
Il n’y a pas de voleurs sur nos paisibles petites îles, et pourtant ces deux-là n’étaient guère rassurants. Chacun d’eux avait un pistolet dans la poche et un fusil sous le bras. Ils ordonnèrent au paysan de s’arrêter, avec un étrange regard pénétrant. Ils fouillèrent la paille de la voiture et, comme ils n’y trouvèrent rien, ils bredouillèrent de vagues excuses et s’en allèrent bien vite comme ils étaient venus.
Durant toute cette formalité, le parrain était resté passif. Le paysan, au contraire, riait d’un rire plein de confiance.
– Cette fois, ils n’ont rien pêché, dit-il.
– Quelle sale vie tout de même ! dit le parrain ; l’été ça va bien, mais quand le vent siffle sur la mer, ce doit être dur de rester toute la nuit dehors et puis d’être mis dedans par des gars plus malins. Mais faites attention, Anders Hansen, car ils ont bon œil. Et il ajouta avec un sourire : Je pourrais presque avoir des ennuis à aller en voiture avec vous.
Quels étaient ces hommes ? Que cherchaient-ils ? Tous ces détails préoccupaient beaucoup Christian, mais ils devaient peu à peu s’effacer devant les évènements de la journée. Il revit le vieux château de Thorseng où il était allé une fois avec ses parents, c’était le plus grand bâtiment qu’il eût jamais vu, plus grand que l’église de Svendborg. Il n’en connaissait que l’extérieur et avait seulement regardé un peu par les fenêtres. Il se trouva, par bonheur, qu’il y avait des voyageurs, et c’est pourquoi il monta avec le parrain le grand escalier et parcourut les longs couloirs et les immenses salles. Les nombreux portraits d’autrefois, les images de ceux que le temps avait réduits en poussière, le regardaient.
À chacune d’elles se rattachait une légende qui leur donnait un relief particulier, comme en prennent les statues de marbre quand nous les éclairons d’un flambeau.
Ainsi, le portrait d’une femme resplendissante de santé qui sourit dans la certitude de sa beauté nous remplit de tristesse, quand nous nous souvenons qu’il y a des centaines d’années qu’elle a vécu.
Pour tout l’or du monde, Christian n’aurait voulu coucher dans ce grand lit aux rideaux de soie froufroutante ; il était sûr que les portraits descendaient, le soir, de leur cadre ; Niels Juel, avec son grand sabre en main, prendrait place dans le fauteuil bariolé au grand dossier. Les hautes glaces elles-mêmes, où il pouvait se mirer de la tête aux pieds, avaient pour lui quelque chose d’inquiétant, car il était habitué seulement à voir son petit visage dans la glace devant laquelle son parrain se rasait.
C’est pourquoi il respira plus librement, lorsqu’il fut de nouveau à l’air libre, sur la grève, près de la cabane des pêcheurs.
La mer était tranquille, le soleil brûlant.
– Il faut quand même une fois que tu ailles à l’eau, dit le parrain. Aujourd’hui on a oublié de nous le défendre.
Christian sourit, il ne demandait pas mieux que de flotter dans l’eau claire et fraîche. Chez lui on ne lui permettait que d’enlever ses bas et d’entrer dans l’eau jusqu’aux genoux.
– C’est autre chose que d’être debout dans le baquet de ta mère et de recevoir de l’eau froide sur la tête. Allons, déshabille-toi !
Ce fut vite fait. Lui-même était debout, silhouette athlétique. Il fit grimper le petit sur ses épaules et lui fit passer ses jambes sous ses bras. C’était l’image de saint Christophe portant l’enfant Jésus. Un grand bruit, et l’eau, qui se referma sur eux, forma de larges ronds en bouillonnant à l’endroit où ils avaient disparu. Un instant après, le visage sombre du parrain se montrait à nouveau, ses cheveux noirs et brillants pendaient sur son front et ses joues, mais Christian n’était plus là, il avait glissé pendant le saut. Le parrain s’en aperçut immédiatement et plongeant à nouveau au fond, saisit le garçon et le ramena à la surface.
L’eau salée coulait de la bouche du petit et il commençait à pleurer.
– Quelle honte ! dit le parrain, et il prit un visage calme comme si tout était pour le mieux, mais son pouls battait plus vite qu’à l’ordinaire.
Il était heureux que l’aventure se terminât ainsi et ne se doutait pas qu’un évènement plus important marquerait la soirée.
Du clocher de l’église de Breining on jouit de la vue la plus étendue du pays. C’était durant la guerre et on avait installé là-haut un télégraphe dont le sombre tableau projetait à travers l’espace son langage muet, et pourtant plein de sens.
Le soleil n’était pas encore couché lorsque le parrain et l’enfant montèrent dans la tour pour rendre visite au nouveau directeur de ce poste télégraphique.
Le fjord, les îles et la mer s’étendaient en bas comme une carte étalée. Par-dessus Thorq et posée dans l’eau comme des parterres de fleurs, on apercevait Langeland. Quelques voiliers passaient, d’autres bateaux étaient à l’ancre et les barques de pêche glissaient en rond dans le fjord. Mais, bien plus que ce spectacle, les tableaux noirs attirèrent l’attention de Christian. Il savait qu’ils pouvaient parler comme les muets, il les avait souvent vus s’abaisser ou s’élever et prendre des positions diverses.
Christian entreprit bientôt un jeu avec les fils du directeur du télégraphe, deux garçons pleins de santé. Ils abandonnèrent la pièce et organisèrent une partie de cache-cache.
Christian s’insinua à travers une ouverture du mur qui donnait accès aux deux grandes cloches ; entre elles, une grosse poutre permettait d’atteindre l’excavation donnant passage au son, qui se trouvait dans le mur opposé. Le soleil y jetait ses rayons et les atomes de poussière y dansaient. Quelle tentation de regarder en bas, par le trou ! Ce serait pour Christian un amusement de plus, tandis qu’on le chercherait. Il entendit bientôt l’un des garçons qui montait l’escalier et qui, passant la tête par le trou où lui-même s’était glissé, cria :
– Es-tu là ? Nous n’avons pas le droit d’aller jusque-là, les cloches pourraient nous tuer.
Christian ne répondit pas. Allait-il se laisser effrayer alors que les cloches étaient aussi solides que si elles avaient été scellées là ? Le garçon qui le cherchait s’en alla.
Le soleil était tout près de l’horizon et semblait maintenant se dépêcher de disparaître. Christian voyait clairement l’astre s’évanouir et les vapeurs du soir se répandre. Tout d’un coup il sentit la cloche qui était le plus près de lui faire un léger mouvement. Il voulut s’en aller, mais au même moment, la cloche se souleva davantage, tout son côté creux levé vers lui. Effrayé, il se rejeta en arrière contre le mur. Le premier son de cloche résonna à son oreille.
Ici, comme dans toutes les églises de campagne, on sonnait la cloche au coucher du soleil. Nul ne se doutait qu’il pût y avoir là-haut quelque être vivant.
Instinctivement, il comprit que s’il faisait un pas en avant, la cloche lui écraserait la tête. Les coups du métal creux résonnaient de plus en plus fort. Les vibrations de l’air et la frayeur le bouleversaient, la sueur coulait sur tous ses membres. Il n’osait se retourner, il regardait fixement le fond de la cloche chaque fois qu’elle s’élançait vers lui. Il poussa un grand cri d’appel, mais personne ne pouvait l’entendre.
La cloche lui semblait la gueule d’un serpent, le battant en était le dard qu’il lançait contre lui.
D’horribles images s’emparaient de son cerveau, il éprouvait à peu près la même sensation que lorsque le parrain avait plongé avec lui, mais cela bruissait plus fort à ses oreilles, les couleurs qui passaient devant ses yeux affectaient des silhouettes effrayantes. Les vieux tableaux du château tourbillonnaient, mais avec des mines déformées, des formes longues et anguleuses, gélatineuses et frissonnantes, qui disparaissaient soudain dans l’air enflammé où tout semblait rouge comme le jour où, près de Noémie, il avait regardé à travers le vitrail. Tout brûlait, il nageait dans une île de feu et toujours le serpent ouvrait devant lui sa gueule avec son dard sifflant. Il avait une étrange envie de saisir le battant. Brusquement, tout s’arrêta, le bruit s’était tu, mais il continuait dans sa tête. Il sentait que ses habits collaient sur son corps et que ses deux mains, étaient comme scellées au mur. Devant lui, la tête du serpent pendait, morte. Il ferma les yeux et s’évanouit.
Sa première sensation de vie fut un rêve affreux. Tout était noir et devait l’être, car il se trouvait dans le ventre du serpent. Celui-ci l’avait avalé ; il n’était pas mort puisqu’il sentait ses mouvements ; le serpent jouait avec lui, serrait ses membres, l’élevait très haut, puis le laissait retomber. C’était un affreux combat.
– Mettez-lui la clé de l’église dans la bouche ! entendit-il dire, de très loin.
Enfin le bruit mourut et avec lui l’horrible rêve. Il s’éveilla et se sentit très faible. Une femme inconnue et son parrain étaient près de lui, il était couché sur un lit. Il ressentait des crampes violentes ou plutôt des courbatures comme à la suite de coups, ses yeux lui faisaient mal.
– Que le Seigneur lui garde la raison ! murmura la femme.
– Des coups, voilà ce qu’il mérite ! dit le parrain.
– Ce sont les miens qui en ont eu ! assura la femme, et pourtant Dieu sait qu’ils n’y pouvaient rien.
On donna à Christian, pour se remonter, un croissant avec un peu de miel. Le parrain le prit sur le dos et il descendit la côte, car il fallait rentrer le soir même.
Les lumières de Svendborg glissaient sur l’eau, il n’y avait pas un souffle dans la molle nuit d’été.
VII
VOYAGE À PIED
Tandis que le sculpteur pétrit l’argile molle, nous ne voyons pas tout de suite ce qu’il veut faire. Il faut du temps et du travail pour qu’éclose l’œuvre en plâtre et pour que, d’après elle, le marbre s’anime sous les coups du ciseau !
Ainsi en est-il du marbre du Divin Sculpteur, c’est un impénétrable mystère de savoir quel homme un enfant deviendra.
Voici un pauvre garçon de Svendborg. Son instinct et les influences extérieures le conduisent, comme par une aiguille magnétique, dans deux directions tout à fait opposées l’une à l’autre. Ou il sera un grand artiste ou un pauvre être dévoyé et misérable. Le dieu du Son l’a baisé dans son berceau, mais le chant de la déesse du Temps lui apportera-t-il l’enthousiasme ou la folie ? Il n’y a entre les deux qu’une très faible muraille. Notre musicien pourra éveiller des milliers d’admirations ou, au contraire, dans un pauvre cabaret, avec son violon sous le bras, déjà vieux, jouer pour une jeunesse sauvage et grossière, qui se moquera de lui, comme d’un innocent avec ses rêves, lui dont l’âme reçut le baptême céleste de l’harmonie.
Depuis son aventure du clocher, Christian tombait souvent dans un état convulsif qui lui laissait des vibrations sous les paupières et lui faisait apparaître toute chose avec des couleurs hallucinantes. Son corps végétait, mais son âme se complaisait dans la fantaisie et le rêve. La nostalgie de voyages de son père et les étrangetés du parrain devaient produire sur une telle nature une impression profonde. La vie de l’école seule aurait pu apporter quelque raison dans son âme, mais il n’y avait pas à cette époque d’école organisée dans toute la ville.
La véritable école de Christian, c’était l’église. Il y demeurait étrangement tranquille et pensif et cependant aucun lieu ne lui était plus cher. Il y trouvait un aliment à ses rêveries et il lui semblait y approcher du monde des légendes. Il fixait les images jusqu’à ce que leurs yeux lui parussent remuer, il restait agenouillé si longtemps sur les dalles funéraires à déchiffrer les inscriptions, qu’il croyait entendre les morts frapper au-dessous pour le chasser. Son corps souffrait, les crises devenaient plus fréquentes. On ne consultait pas le médecin parce que le pauvre n’a guère foi en lui et que cela coûte de l’argent. Maria croyait aussi que les ordonnances peuvent rendre malade au lieu de guérir ; elle avait, de plus, contre toutes les maladies, un remède infaillible : des gouttes de genièvre prises dans de l’eau-de-vie. Ça, c’était fortifiant. Régulièrement elle administrait à Christian sa médecine. Mais le temps passait sans apporter d’amélioration à son état. Le mieux, pensait la mère, était d’en parler à la rebouteuse de Qvoendrup. Celle-ci ordonna plusieurs excellents remèdes : on lui mesura avec un fil de laine les jambes et les bras et on lui donna de la terre bénite et un cœur de taupe à se mettre au creux de l’estomac. Cependant, malgré ces moyens infaillibles, les jours et les semaines s’écoulèrent sans changement durant presque deux années. La rebouteuse conseilla alors une visite à la fontaine miraculeuse de Frorup, qui avait guéri bien des malades abandonnés par les médecins. Combien souvent, par la suite, Maria devait-elle dire : « Si nous n’étions pas allés alors à la source, qui sait, tout eût peut-être été autrement. » Peut-être, mais sommes-nous libres de nos actes ? Or, en ce temps-là, Maria était persuadée qu’il fallait aller à la fontaine pour le bien de l’enfant.
Son mari n’avait pas une foi aussi forte, mais cette visite lui était une bonne occasion de prendre l’air. Son ami, le sergent-major, qui se trouvait justement en ville et leur faisait une visite de quelques jours, les accompagnerait. Son régiment était maintenant à Odense.
Il y avait quatre lieues de chez eux à la fontaine, mais la grand-route passait tout près, de sorte que la mère et l’enfant pourraient prendre la diligence qui va à Nyborg, tandis que les deux amis iraient à pied, ce qui leur permettrait de se promener à travers bois.
Certes, un peintre peut rendre les effets de couleurs d’un beau jour, il peut même nous faire sentir la douceur de l’atmosphère, il est incapable pourtant d’exprimer cette beauté aromatique qui contribue tout aussi puissamment à notre joie que les formes et les couleurs : le parfum du houblon et des fleurs d’églantine.
Le moineau chantait et le tailleur l’accompagnait :
Voyage à pied, voyage à pied,
Tu comprendras l’humanité !
Voyage à pied.
chantait-il joyeusement et bientôt il se sentit transporté dans les souvenirs de sa vie d’aventures, de l’autre côté du Danube et du Pô.
– Eh ! regardez donc voler la cigogne ! cria-t-il. Hélas ! l’oiseau de notre toit n’est plus jamais revenu. Il est mort de chagrin de la perte de sa femme et de ses petits, ou bien il est encore en voyage pour oublier. Dieu me pardonne ! je crois qu’on peut, en voyageant, oublier n’importe quel malheur.
– Je le crois aussi, dit le sergent-major. Écoutez, je n’ai jamais osé vous dire mon opinion, quand votre femme nous entendait, elle aurait pu m’en vouloir. Mais vous devriez vous faire offrir quelque mille écus par un fils de paysan qui n’aurait pas envie de quitter son foyer confortable pour le service militaire. Ces gens-là, il faut bien que quelqu’un les remplace. Avec l’argent-, votre femme et l’enfant vivraient bien. Vous seriez sous-officier et verriez du pays puisqu’en somme vous n’aimez vivre que pour ça ! Les temps sont incertains, nul soldat ne sait où il est envoyé. La France nous est aussi proche que l’Allemagne...
Le tailleur secoua la tête :
– Maria ne me le pardonnerait jamais. Et il ajouta un peu tristement : Je ne crois pas non plus que je pourrais me passer d’elle. Non, non, n’y pensons plus !
Ils marchaient, alertes, vers le château de Broholm. Les feuilles de la forêt étaient transparentes, les violettes poussaient sous-tous les buissons, le muguet des bois était en fleurs et, à travers les arbres, on voyait la mer et l’île de Langeland avec ses bois et ses moulins à vent.
Dans la grande salle voûtée de la ferme, nos deux voyageurs s’assirent près de la table de bois où chaque passant avait gravé son nom. Il y avait avec eux un troisième personnage, un jeune paysan d’Œrebek, frère du premier prétendant de Maria.
– Je devrais, dans un mois, mettre l’uniforme rouge, dit le jeune paysan, mais j’ai les moyens de m’acheter un remplaçant. Je le paierai mille riksdaler, billets sur table. Cela vous plairait-il ?
Mille riksdaler en billets ! Quel parfum exhalaient ces blanches feuilles, un parfum qui remplissait le cœur de rêves de richesse. Le pauvre tailleur regarda au dehors et vit, à travers les vitres, les couronnes vertes des tilleuls. Lesquelles, des feuilles vertes ou des feuilles blanches, agirent le plus fortement sur son cœur ?
– Avez-vous jamais entendu parler, pensa-t-il tout haut, de la montagne de Vénus ? D’imposants chevaliers, et même de pauvres vagabonds avec leur baluchon sur le dos, entrèrent dans ce royaume enchanté et n’en revinrent jamais, ou si, par hasard, l’un d’eux en sortait et revenait parmi les siens, il fallait qu’il y retournât ou qu’il mourût de nostalgie. Ce n’est qu’une histoire, bien sûr, mais elle a sûrement été écrite par quelqu’un qui avait roulé sa bosse à l’étranger et avait dû ensuite abandonner ces merveilles pour rentrer chez lui. Durant les cinq années de mes voyages j’étais, moi aussi, dans la montagne de Vénus. Maintenant je suis rentré et c’est la cause de ma tristesse. La nostalgie est le travail de mes jours, le désir des voyages mon oreiller et si Maria voulait... Mais il faut qu’elle veuille.
Son œil brillait, il saisit la main du sergent-major :
– Je serai soldat !
VIII
LA FONTAINE MIRACULEUSE
Une fontaine miraculeuse vers laquelle
les paysans de toute la campagne se pressent.
Je les ai vus boire l’eau.
Était-ce le reflet du soleil,
ou la force de l’eau ?
Mais le rose montait à leurs joues.
ŒHLENSCHLŒGER.
À deux lieues à peu près de Nyborg, se trouve la fontaine de Sainte-Régisse, laquelle, selon la légende populaire, doit son nom à une femme très dévote. Cette femme était persécutée par des hommes méchants qui allèrent jusqu’à tuer ses enfants. Mais à l’endroit même où le crime fut commis, une fontaine délicieuse jaillit aussitôt. Longtemps après la mort de sainte Régisse, de pieux pèlerins vinrent de loin pour boire l’eau de la source et ils bâtirent une chapelle toute proche, où ils accrochèrent son portrait.
Pour n’être pas vus par la foule, sans doute, les malades ont pris l’habitude de se rendre à la source dans la nuit qui précède la Saint-Jean. Au coucher du soleil, ils se baignent et s’installent là pour la nuit. Au matin, ils se lèvent, les plus malades sont ramenés chez eux ; ceux à qui leur état le permet restent et prennent part aux plaisirs de la foire.
Maria arriva d’abord, tenant l’enfant par la main. Elle portait une vieille couverture et le pardessus de son mari, qu’elle se proposait de mettre si la nuit était froide, la couverture étant pour Christian.
– Je resterai près de toi, lui dit-elle ; si je dors, tant mieux, sinon ce ne sera pas la première fois que j’aurai veillé à cause de toi. Oui, mon petit, tu ne peux pas imaginer par où j’ai passé. Les enfants ne pensent pas à l’inquiétude et à la fatigue d’une mère jusqu’à ce qu’eux-mêmes aient des enfants. Quand je te portais dans mon sein, que n’ai-je pas enduré ? J’ai risqué ma vie pour toi ! Ensuite, durant de longues nuits, je n’ai pas fermé l’œil, mais je me suis promenée de long en large avec toi, guettant ta respiration. Je travaillais le jour et je veillais la nuit. Voilà notre lot à nous autres, mères ! Oui, j’ai fait tout cela et le referais encore si seulement tu guérissais ! Je n’ai que toi au monde ; puisque ton père veut voyager, on ne peut pas l’en empêcher !
Elle éclata en sanglots violents qui ne durèrent pas. Bien vite elle baisa l’enfant sur les yeux et la bouche et s’approcha de la fontaine. Mille pensées agitaient son âme. À Œrebek elle avait trouvé son mari avec le sergent-major et le jeune paysan, frère de son premier prétendant. On l’avait plaisantée en lui disant que toute cette ferme pourrait être à elle ; on lui avait fait boire de la forte bière et manger du pain blanc fait à la maison et, d’abord en riant, puis sérieusement, on lui avait annoncé le désir de son mari de remplacer le jeune paysan.
– Et puis, il n’est pas sûr de partir, répétait le sergent.
Et il reparla à plusieurs reprises des mille riksdaler.
– Il est libre, avait dit Maria, je ne tiens nullement à lui.
Mais il lui semblait, en disant cela, que son cour se brisait en mille morceaux.
Elle ne voulut pas rester longtemps à la ferme.
– Le goûter me tiendra lieu de dîner, dit-elle.
Les deux hommes, au contraire, restèrent à la ferme pour y passer la nuit.
Maria et Christian étaient maintenant près de la source. Quelques malades se baignaient déjà ou s’occupaient de préparer leur couche pour la nuit. Les uns avaient apporté un vieux bois de lit qu’on avait dressé là parmi les noisetiers ; d’autres, simplement, remplissaient de paille ou de foin leurs carrioles.
Du feu flambait derrière de petits remblais de gazon, la bouilloire chantait et quelques vieilles gens se chauffaient les mains.
Tout ceci formait un tableau de plus en plus exceptionnel dans notre vie populaire d’aujourd’hui, et l’on aurait pu se croire retourné à plusieurs siècles en arrière. Si les morts, sur la tombe desquels les moines chantaient dans le Danemark catholique, s’étaient levés au coucher du soleil, s’ils avaient flotté au-dessus de l’herbe comme la brume sur l’étang, il leur eût semblé que rien n’avait changé depuis qu’ils avaient fermé les yeux. Le peuple se pressait avec la même foi religieuse autour de la fontaine sainte, les cloches de l’église sonnaient au soleil couchant, comme si elles appelaient les fidèles à l’Ave Maria et, dans la petite église, l’image de la Vierge et de l’Enfant souriait comme autrefois.
Le château le plus proche, celui d’Œrebækkelunde, était toujours pareil, avec son faîte à créneaux, sa haute tour et toute son architecture gothique.
Non loin de l’endroit où l’on baignait Christian, se tenaient deux femmes avec une fillette d’environ treize ans. On ne voyait à son corps aucune imperfection, sa longue chevelure noire tombait sur ses épaules blanches et pleines, le soleil vespéral inondait de ses rayons un visage riant et heureux de vivre. La plus jeune des deux femmes était la mère de la fillette, elle versait sur la tête de celle-ci une coupe d’eau tandis que l’enfant chantait d’une voix claire :
Celui que j’ai entendu, celui que je vois
Portait une couronne d’épines.
La femme la plus âgée était la grand-mère, elle était à genoux et priait à voix basse.
Quand le malheur et l’espoir réunissent les personnes, elles lient vite connaissance. Chacun parla de ses malades et de la vertu de la fontaine. Elle ne pouvait rien contre les convulsions, pensait une vieille femme, mais si Dieu le voulait, la source guérirait certainement aussi cette maladie. « Il n’y a qu’un moyen, ajoutait-elle, qui n’ait jamais déçu. » Et elle exposait le remède barbare que les générations nouvelles accuseront d’avoir germé dans la cervelle d’un Eugène Sue et qui s’employait autrefois couramment au Danemark. On amenait l’enfant au lieu du supplice et là, on demandait au condamné de permettre que le petit boive de son sang chaud, lorsque la tête serait tombée.
Maria frissonna d’horreur. Non ! cela c’était impossible, elle ne le ferait jamais.
Bientôt, les préparatifs pour la nuit furent terminés. La fillette et la grand-mère devaient coucher dans la voiture ; on offrit à Christian la petite place qui restait à leurs pieds. La mère de la fillette et Maria s’assirent, leurs jupes sur leurs têtes et le dos appuyé contre la voiture.
Puis, tout fut tranquille. On entendait seulement le murmure de la source et la profonde respiration des dormeuses. Christian disait à voix basse sa prière du soir, telle que sa mère la lui avait apprise, et fermait les yeux pour s’endormir, mais sans y parvenir. Il songeait avec angoisse à la fille « innocente » dont il touchait les pieds ; elle dormait profondément. Il regarda le ciel, très haut, très bleu, semé d’innombrables étoiles, la grande ourse était juste au-dessus de sa tête. Bientôt il fut dans un état de demi-conscience, il rêvait et se rendait pourtant compte que c’était un rêve. Il savait où il était, car il entendait le murmure de la source, mais à mesure qu’il regardait autour de lui, les choses prenaient une singulière ressemblance avec le jardin du Juif, où il avait joué avec Noémie : L’air devenait plus limpide, il lui semblait entendre sa voix, elle l’appelait même par son nom, mais il n’osait répondre, de peur d’éveiller la pauvre fille sans raison qui dormait à ses pieds. Toute l’atmosphère se faisait plus douce et plus familière ; la cigogne elle-même volait au-dessus de sa tête, en claquant du bec comme lorsqu’elle apportait leur nourriture à ses petits. Noémie lui sembla bientôt assise auprès de lui ; il la regarda jusqu’au fond de ses grands yeux noirs, elle jetait sur lui les fleurs les plus délicieuses en lui disant que c’était de l’argent. Ils jouaient comme autrefois et il lui donnait en gage sa bouche et ses yeux, mais elle les lui prenait réellement et il en ressentait une vive douleur. À cet instant, tout ne fut autour de lui que nuit et ténèbres ; Christian entendait seulement une voiture qui s’éloignait. Il voulait se lever pour la suivre, mais la fillette innocente le retenait par les jambes, elle le tenait serré, serré, et la voiture roulait plus loin, toujours plus loin. Alors, il rassemblait toutes ses forces pour lui échapper... et il s’éveillait, s’apercevant que ce n’était qu’un rêve.
Des roulements de tonnerre grondaient au loin, l’air était étouffant. Soudain un éclair lui montra debout, comme une fée blanche et étincelante, la jeune fille innocente, les épaules nues, la poitrine nue, enveloppée dans ses cheveux noirs.
– Je brûle ! disait-elle, on dirait que tout le sang de mes veines est parti et que du feu le remplace. Dors-tu, petit garçon ?
Elle avait arraché ses vêtements et tenait ses bras nus levés vers le ciel.
Christian n’osait répondre.
– Entends-tu rugir les démons, là-haut ? demandait-elle.
Un éclair fulgurant, suivi d’un coup de tonnerre, brilla et réveilla tous les dormeurs. Les femmes se levèrent, affolées. La vieille femme saisit sa petite-fille à moitié nue. Le vent jouait avec ses longues boucles et la légère couverture qui pendait autour de ses jambes et les élevait très haut dans l’air.
Chacun cherchait de son mieux à couvrir ses malades. On cacha Christian sous la grande couverture du cheval, mais le coup de vent suivant fut si violent qu’il l’eût jetée bien loin, si Maria ne s’était appuyée sur lui. Les arbres et les buissons se tordaient comme des joncs creux, les feuilles volaient et, au milieu de la tempête, on entendait la fillette chanter et les femmes prier.
Vers le matin seulement Christian s’endormit d’un sommeil réparateur. L’orage était passé aussi vite qu’il était venu.
IX
AH ! QUEL PLAISIR D’ÊTRE SOLDAT !
Ah ! quel plaisir d’être soldat !
E. SCRIBE.
Le lendemain, près de la fontaine, tout avait repris un air de fête. Sur la prairie où, durant la nuit, les malades avaient gémi et prié, les villageois dansèrent.
Un violon et une clarinette jouaient une danse anglaise, les filles et les garçons buvaient.
Dans le bourg, le marché battait son plein. Les baraques offraient des bottines, des poteries, de la mercerie. Christian avait fait ses emplettes ; il portait à la main son vieux chapeau et avait mis le nouveau sur sa tête, encore enveloppé de papier journal et de ficelle. Il contemplait avec ses parents une boutique où pendaient des bonnets brodés de paillettes. On y voyait aussi de superbes images de Nuremberg avec des soldats prussiens et des Turcs dans leur sérail, qui avait l’air d’une école de filles. Plus loin, un Italien montrait sur une planche des figurines de plâtre fort grossières, des perroquets peints en vert et un buste de Napoléon. Le tailleur commença aussitôt à parler italien avec lui, du mieux qu’il put, de la bouche et des yeux, et Maria comprit seulement que ce langage mystérieux n’était pas de l’allemand.
La langue maternelle entendue en pays étranger a le charme qu’a pour nous, adultes, une chanson enfantine, même chantée par une voix discordante.
L’Italien rit, salua et bavarda ; il alla même jusqu’à offrir à Christian un perroquet de plâtre dont la queue était cassée.
Des rubans de soie et des mouchoirs bariolés volaient autour d’un bâton attaché à une table derrière laquelle une voix familière criait : « Bonjour ! » C’était le vieux Joël qui avait servi chez le Juif et ramené au tombeau de famille les restes de son maître.
– Oui, la petite fille va bien, dit-il, la petite Noémie ne souffre de rien ! Elle est vêtue de soie et de mousseline, elle aura certainement des bagues d’or aux doigts et des diamants sur la poitrine. Ce sera une beauté comme la reine Esther.
– Avez-vous été récemment au château ? demanda Maria.
– Non, je n’y vais jamais ! Je n’y ai pas été depuis le jour où mon maître fut réduit en cendres et où j’allais en messager leur dire combien la pauvre enfant était abandonnée.
– Avec ce foulard, tu serais belle comme un astre, dit le tailleur à sa femme en montrant une cotonnade bleue avec de grandes fleurs rouges et jaunes. Prends-le donc, maintenant nous sommes riches !
Et il frappait sur la poche où il avait mis la moitié de la somme promise : cinq cents riksdaler et l’engagement de remplacer le jeune paysan.
Maria secouait la tête et soupirait profondément, mais ses yeux se tournaient tout de même vers le foulard dont les couleurs étaient si brillantes, le modèle si original.
– Si je suis votre premier client aujourd’hui, dit le tailleur, vous ferez une bonne journée, car je porte chance ! Ne sois pas si pensive, Maria. Dieu sait quand nous reviendrons au marché de Kilde et si nous aurons un aussi beau soleil et autant d’argent en poche !
Il lui jeta le beau foulard autour du cou et elle sourit avec les yeux pleins de larmes, comme elle devait sourire plus tard, lorsque rentré à la maison, il étala les billets sur la table et s’écria d’un air satisfait :
– Regarde, ton mari vaut le double de ça ! Ne pleure pas. Si tes larmes salées tombaient sur cet argent, il ne nous apporterait ni bonheur ni bien-être. Je suis déjà sous-officier, sur le chemin d’être officier, et toi, tu es bien près d’être une bourgeoise.
– Dans une quinzaine tu partiras pour Odense à l’instruction, répondit Maria. Tu dis que cela ne durera qu’un mois et qu’après je t’aurai de nouveau. Mais comme tu ne tiens pas en place, Dieu sait ce que tu inventeras encore.
Elle ajouta :
– Souvent, la nuit, je t’entendais soupirer et parler de pays lointains. Tu pleurais comme un enfant et cela me brisait le cœur. Ce vieil almanach où tu marquais dans tes voyages le lieu où tu te trouvais tel jour de telle année, ce carnet que tu sors si souvent pour le lire et me raconter ta vie, tu pourras y inscrire maintenant la date où tu abandonneras ta femme et ton enfant. Si je ne te connaissais pas comme je te connais, je croirais que tu ne nous aimes plus. Pourtant tu sais bien que personne ne t’aimera jamais comme je t’aime...
– J’ai la conscience tranquille, Maria, dit l’homme, tu ne veux pas m’attrister, n’est-ce pas ? Si j’ai mal fait, il n’est plus temps de gémir. Voyons plutôt les choses du bon côté. Ce soir nous avons le sergent-major et le parrain. Invite le gantier et fais-nous un bon bol de punch comme au soir de notre mariage.
Jamais Christian n’avait vu autant d’étrangers dans leur petite chambre. Le parrain avait apporté son violon et raconta des histoires. On rit et chanta jusque fort tard dans la soirée.
Le lendemain fut triste, moins triste pourtant que le jour où le père partit pour Odense. Maria et Christian l’accompagnèrent jusqu’à Kvoerndrup et, lorsque la voiture s’ébranla, ils montèrent tous deux sur le banc près de l’église pour voir aussi longtemps qu’ils le pourraient le père agitant son chapeau. Mais lorsque le chemin fit un coude et qu’on ne le vit plus, Maria tourna la tête contre le mur de l’église et pleura. Puis elle erra parmi les tombes, enleva les couronnes fanées et arracha de-ci, de-là, les herbes folles.
– Il faut parcourir un dur chemin, murmura-t-elle, avant d’être couché là.
Autour de l’église, sur les coteaux verts, de vieux arbres formaient un cercle. Sur chacun d’eux le pasteur avait mis une petite plaque avec une inscription pieuse pour l’édification et la consolation des fidèles.
– Ce ne sont pas des lettres imprimées, dit Maria, autrement je saurais les lire. Sais-tu, mon enfant ?
Christian lut les mots pieux et ce fut pour la mère comme si, sur chaque arbre, chaque petite plaque prêchait un sermon de consolation.
– Notre Seigneur peut tout arranger, affirma-t-elle. Si je savais seulement ce que nous réserve l’avenir !
Elle redescendit en ville et s’arrêta à une des premières maisons, chez la rebouteuse. On fit bouillir le café et dans le marc elle lut l’espoir et le désespoir, mais l’espoir fut le plus fort, l’espoir qui garnit de velours les chaînes des esclaves, l’espoir qui inscrit le mot de grâce sur le glaive du bourreau, l’espoir dont la voix chante les chants délicieux du mensonge...
Maria pouvait espérer. De chaque lettre de son mari coulait l’huile de consolation.
Le temps passa.

– Il revient la semaine prochaine ! racontait-elle aux voisines. Il n’y en a plus que pour six jours !
Et puis il vint ce jour-là et ce fut une joie et une surprise. Le pauvre Christian était couché, il était malade, la fontaine miraculeuse ne l’avait pas encore guéri. Mais la joie de Maria fut de courte durée. Son mari ne pouvait passer que cette nuit auprès d’elle, on la lui avait accordée comme une grâce ; le régiment partait pour le Holstein où il devait rejoindre les troupes françaises. L’armée de l’Allemagne du Nord, renforcée par des troupes suédoises, avait envahi la frontière.
– Ne sois pas triste, Maria, tu seras fière de moi, et lorsqu’il y aura du butin à prendre, je penserai à toi, nous serons peut-être riches un jour. Ne pleure pas, puisque c’est comme ça. Nous allons passer une bonne soirée, après je dormirai deux ou trois heures et en route pour Odense ! C’est une pitié de te voir en larmes et le garçon malade. Le dernier soir doit-il me laisser un aussi triste souvenir ?
– Non, dit Maria, il ne le faut pas.
Et les dernières larmes furent arrêtées par les cils noirs. Le couvert fut mis. Le parrain vint, vanta la vie militaire, disant qu’il se pourrait bien que lui-même y allât sans crier gare.
Le pauvre Christian était couché dans son petit lit et souffrait. Il s’était endormi quand, au matin, le baiser d’adieu du père le réveilla. Une larme brûlante tomba sur les lèvres du petit, et le père sortit précipitamment, suivi de Maria.
– Tu as perdu ton père, fut tout ce qu’elle dit à l’enfant.
Un corps d’armée danois de six mille hommes devait s’amalgamer avec l’armée française sous les ordres de Davoust.
En avant ! disait le tambour, et les hommes suivaient. Mais les cigognes fuyaient encore plus vite, pressentant au cœur de l’été les froids mortels de l’hiver.
Des semaines passèrent sans nouvelles du tailleur. Où était-il le père de Christian, que la nostalgie de la montagne de Vénus avait attiré loin de son foyer ?
Enfin, un jour, une lettre du sergent-major à Maria lui annonçait, avec bien des ménagements, qu’elle était veuve. Son mari avait disparu dans le premier combat.
X
UN NOUVEAU PÈRE ?
Mort ! Quel monde de douleurs réside dans ce petit mot.
C’est une épée à deux tranchants qui, en même temps qu’elle frappe ce qui nous est cher, s’enfonce dans notre poitrine. Tout s’assombrit à nos yeux et le monde nous semble noir, même si le soleil éclaire des milliers de gens heureux. Un seul mot nous permet de rester debout et nous donne le secours nécessaire : Dieu.
– J’y étais bien préparée, dit Maria, mais elle ne l’était nullement.
– Ne pleure pas, disait Christian, tu tomberais malade et me quitterais aussi. Tu sais laver et repasser, et moi je sais jouer du violon. Nous gagnerons notre vie.
– Petit ange du ciel ! dit Maria, laisse-moi baiser tes yeux et ta bouche. Oui, je vivrai pour toi, que deviendrais-tu sans moi ?
Le temps passait. La Noël ne s’était jamais annoncée aussi tristement que cet hiver-là.
– Le fermier d’Œrebek est un brave homme, dit Maria, il m’a envoyé un pain et du beurre et une oie pour la Noël. Penserait-il encore à moi ? Non, je ne referai jamais ça. J’inviterai le parrain pour la Noël quoique je ne l’aime guère, mais je le ferai pour toi. Peut-être pensera-t-il à toi quand tu seras grand.
La veille de Noël était arrivée et Christian était tout joyeux. Maria prit le livre de cantiques.
– Vous avez de la voix, dit-elle au parrain, vous me soutiendrez.
– Je ne connais pas de cantiques, répondit-il. Si vous voulez utiliser ce livre, ouvrons-le plutôt au hasard, pour voir ce que le sort nous réserve, car j’y crois fermement. Ce qui doit arriver est écrit dans ce grand livre, comme dans notre sang et notre âme.
Maria ouvrit le livre :
– Un cantique de mariage ! dit-elle ça ne va pas du tout, je ne changerai jamais ma situation. Si je pouvais voir seulement le garçon guéri, et fort, et bien arrivé dans la vie !
– Cela dépend de son étoile, dit le parrain. On y peut quelque chose, mais pas beaucoup. S’il doit être un voleur, il le sera, s’il doit être coureur, rien n’y fera ; il aura beau être élevé dans les meilleurs principes, s’il a en lui de mauvais esprits, il faut qu’ils sortent. J’ai étudié beaucoup d’auteurs, j’ai lu maintes descriptions de pays étrangers. Il y a beaucoup de races sur la terre, ce qui est erreur chez les unes s’appelle vérité chez les autres. Le sauvage mange son ennemi, et son prêtre lui dit : « Tu monteras directement au ciel. » Le Turc a beaucoup de femmes, et son Dieu lui en promet encore davantage dans le paradis. Un général reçoit une distinction et la renommée pour ce qu’il fait dans la guerre royale, même injuste ; un autre qui montre la même adresse dans la vie civile monte sur la roue. Tout dépend de la coutume et de l’usage, et qui nous dit que nous sommes dans le vrai parce que nous faisons comme le plus grand nombre ? N’est-il pas vrai, Maria ?
– Peut-être, mais c’est un péché de penser à de telles choses, répondit-elle.
Puis, changeant de conversation, elle reprit :
– Si mon pauvre petit Christian pouvait seulement se remettre. Je sais bien un remède que plusieurs personnes m’ont indiqué, mais il est trop terrible. Boire le sang...
– Taisez-vous ! cria le parrain, je ne puis supporter de voir couper le cou à une poule. Je connais un moyen plus inoffensif : je dirai quelques mots mystérieux et il boira de l’eau glacée dans le creux de ma main.
– Jésus ! cria Maria en reculant sa chaise. Avez-vous été à la guerre, avez-vous tué quelqu’un ?
Une pâleur de mort se répandit sur le visage du parrain.
– Que dites-vous ? demanda-t-il.
– Oh ! mon Dieu, rien. Mais vos paroles me font penser à celles d’un Suédois qui vint nous voir un jour. Je lui parlai de la maladie de l’enfant et de ce qu’on pourrait y faire. Je lui racontais ce que tout le monde sait chez nous, qu’il faut mendier un pot d’argile et recueillir, sur un lieu d’exécution, le sang d’un criminel, que le malade doit boire. Alors il me dit qu’on avait la même croyance à Skaane, mais que si c’était pour un enfant, il n’était besoin que de lui faire boire de l’eau froide d’une main qui avait fait couler le sang humain. Il me conseillait d’aller chez un soldat ou chez le bourreau. Ces mots et ce que vous venez de dire...
– ... Se ressemblent, c’est vrai, répondit le parrain. Mais que diriez-vous si je vous donnais une poignée de graines de fleurs, si vous la preniez et la laissiez de côté jusqu’à ce qu’elle ait perdu sa vitalité ? Ne serait-ce pas comme si vous aviez abîmé tout un parterre de fleurs ? Chez nous, en Norvège, on raconte l’histoire d’une jeune fille qui avait la terreur d’être mère. Le soir de son mariage elle alla, avec sa couronne et son voile, au moulin où habite la sorcière. Elle lui demanda son aide pour n’avoir pas de progéniture, et la sorcière lui donna douze grains de blé qu’elle devait jeter sous les roues du moulin. Elle n’y trouva rien d’extraordinaire, mais, à chaque grain qui tombait, on entendait un étrange soupir. C’était un cœur d’enfant qui se brisait. Elle devint épouse, épouse sans enfants, et ce n’est que dans sa vieillesse, lorsque ses cheveux furent blancs, qu’une crainte lui vint. Ses mains étaient nettes de sang, et pourtant elle était une meurtrière et souffrait dans son âme comme quelqu’un qui a tué. Elle entra à minuit dans l’église pour demander le pardon de ses fautes et elle vit, debout près de l’autel, ses douze fils qui n’étaient pas nés et derrière eux leurs enfants, toute leur descendance. Ils remplissaient l’église et elle s’agenouilla et pria, elle, la meurtrière de toute sa race. Et vous comprenez l’histoire ? Il y a beaucoup de criminels de ce genre sur terre, assassins d’une race avant sa naissance. J’en suis un et je le resterai toujours.
– Vous devez être malade, dit Maria.
Et elle le regarda avec inquiétude.
– Je ne demanderai plus jamais à ton parrain de venir, dit-elle à son fils lorsqu’il fut parti et qu’ils se mirent au lit. Il me semblait, quand il était là, qu’un mauvais esprit soufflait dans la pièce. Joins tes mains et fais ta prière du soir. Je t’en apprendrai même une autre que je sais.
Il y eut beaucoup de jours froids et sombres dans la nouvelle année. Il fallut ouvrir les fenêtres avec de l’eau bouillante, tant la glace les scellait durement.
– Les chemins sont comme des parquets, la gelée blanche a bien travaillé, dit le fermier d’Œrebek un jour qu’il rendait visite à Maria. Il faut vous remonter ! Rendez-moi visite, je vous attends avec le garçon par la voiture du commissionnaire.
– Je veux bien donner ce plaisir au petit, dit-elle.
... Oui, si jamais elle faisait la bêtise de se remarier, ce serait aussi pour lui, mais elle ne la ferait certainement pas...
Et pourtant, l’année suivante, l’herbe n’avait pas encore poussé que Maria hésitait à dire oui ou non.
– Ce serait pour toi, mon cher enfant, soupirait-elle.
Mais Christian pleurait. Son nouveau père ne serait ni doux ni gai. Il détestait le violon et disait que c’était un grincement désagréable.
– Maria, tu sais bien que j’ai toujours eu des vues sur toi, lui disait le paysan. Tu en as tout de même pris un autre, moi aussi, maintenant nous sommes libres tous deux. J’ai besoin d’une femme dans ma maison et d’une mère pour mon fils. Je connais bien une veuve qui a deux enfants, et même que pour chacun d’eux on lui assure dix écus par an pendant six ans... c’est un capital, ça, et qui peut donner à réfléchir. Toi, tu n’as rien et, de plus, tu es chargée d’un garçon, mais je t’aime, et si tes sentiments sont d’accord avec les miens...
Maria lui donna sa main.
XI
LES POUPÉES DE FLEURS
Les rêves sont finis.
SCHILLER
(Don Carlos).
La veille des noces est un jour de supplice pour la paysanne. Il faut qu’elle se fasse belle, c’est-à-dire pour la première et peut-être la dernière fois de sa vie, qu’elle montre ses cheveux en public. Aussi doivent-ils être soumis à une lessive qui les fait tenir raides et droits, ce qui les rend plus difficiles encore à coiffer. La mariée s’évanouit souvent au cours de cette opération. Mais ceci n’était pas le cas pour Maria. « Ses cheveux sont comme la soie la plus fine », dit quelqu’un du cortège qui se dirigeait vers l’église. Qu’elle n’ait pas voulu, elle, veuve, se couvrir la tête, mais au contraire parader avec ses beaux cheveux, cela montrait de la fierté, pensait-on. Pourtant toute la famille du marié lui était hostile puisqu’elle n’apportait rien dans la maison, qu’un grand garçon.
Un arc de triomphe était dressé sur la route, les chemins qu’ils devaient suivre étaient jonchés de verdure. Les jeunes gens chargés de la décoration passaient à cheval devant le cortège. D’abord venait la mariée, avec ses demoiselles d’honneur ; elles tenaient leurs gros bouquets hors de la voiture comme des bâtons de maréchaux.
À l’église, parmi les invités, se trouvaient la mère et la grand’mère que nous avons rencontrées à la fontaine avec leur fille Lucie. Il n’y avait plus rien d’inquiet dans ses yeux expressifs et bleus. Elle était assise près des siens, pieuse et tranquille. De même que la tempête en cette fameuse nuit, les combats de son esprit étaient apaisés. Christian, qui était placé du côté des hommes, la reconnut tout de suite ; elle, au contraire, le regarda bien face et chanta d’une voix claire les psaumes saints.
La cérémonie terminée, les trompettes résonnèrent comme au jour du Jugement dernier. Le marié s’en fut en voiture, à toute allure, pour pouvoir recevoir sa femme dans leur maison. Les musiciens jouaient dans le vestibule. Chaque invité, en passant, posait son présent sur un plateau derrière lequel se tenaient les mariés. Si quelqu’un donnait un gros billet, on ne manquait pas de l’étaler, : car le paysan n’oublie jamais de rendre à son tour un important cadeau au donateur ou à sa proche famille, lorsqu’ils viennent à se marier.
On mangea, on chanta des psaumes, et les garçons d’honneur conduisirent la mariée dans les bras du marié.
Lucie, un peu plus âgée que Christian, s’occupa constamment de lui. Ils dansèrent et se promenèrent ensemble, ils regardèrent un livre d’images que le parrain avait donné à Christian, mais Niels, le fils du mari de Maria, leur faisait mille misères. Il était sournois et détestait le nouveau venu.
Le seul point commun entre les deux garçons était l’amour du livre d’images. Les bêtes intéressaient vivement Niels, mais il trouvait ridicule de ne les avoir faites que noires et blanches. Ce ne fut donc pas cette fois par méchanceté, mais plutôt dans une bonne intention, qu’un jour que Christian était sorti, il se saisit du livre et peignit toutes les gravures en rouge et en jaune. Il passait, aux yeux de son père et des valets, pour avoir un joli coup de crayon. Ses silhouettes d’hommes et de bêtes ornaient les portes de la ferme, et c’était précisément la platitude et la vulgarité de leur expression qui leur donnait du prestige auprès d’un tel public. Niels, avec quelques coups de crayon, avait ainsi banalisé les gravures du livre de Christian et il riait tout seul, content de son ingéniosité.
– Regarde ! dit-il à Christian lorsque celui-ci arriva, maintenant, ça brille !
– Tu as abîmé tout le livre, dit Christian.
Et son chagrin et sa colère lui donnèrent une violence qui ne lui était pas coutumière. Il se précipita sur Niels, mais celui-ci le jeta à terre.
– Vous devriez être battus tous les deux, dit Maria. Je ne battrai pas Niels, mais toi, tu es à moi, j’ai le droit de te frapper.
Et il reçut des coups pour les deux.
Le père trouvait aussi que le livre était bien plus beau maintenant, et les traits vulgaires que son fils y avait ajoutés lui firent dire avec bonne humeur :
– Sacré garçon, il sait y faire !
Christian errait tristement, abandonné de plus en plus à lui-même et à ses propres pensées. Quelquefois il descendait le violon et il jouait les morceaux du livre à musique ; c’était son trésor : pour rien au monde il n’aurait voulu s’en séparer et cependant il fallut qu’il s’en séparât.
On vit un jour un magnifique cerf-volant survoler la maison. Il avait été confectionné par Niels à l’aide de vieux journaux et du livre de musique, qui n’avait aucune valeur à ses yeux. Le cerf-volant s’envola bien haut dans les airs, on ne put plus le retenir, et le vent plus violent l’entraîna vers la tourbière.
L’hiver arriva et passa. Ce fut l’été. Christian devait se rendre utile. Dans la prairie où le ruisseau coulait entre les aunes, à tour de rôle avec Niels il allait garder les oies. Mais cette solitude lui plaisait. Un jour qu’il était assis tout seul dans un champ, il imagina de réunir, à l’aide d’épines, des fleurs et des feuilles pour en faire des silhouettes humaines. Une petite feuille de bardane représentait la robe bouffante de la dame, de longues fleurs rouges formaient ses bras et une églantine, son visage. Les hommes avaient les bras et les jambes faits de feuilles de plantain.
Il les mit debout contre une racine d’arbre et contempla cette petite société, quand il vit venir à lui la voyante de Kvoerndrup, qui coupait des racines d’angéliques. Elle regarda les poupées.
– Que fais-tu là ? demanda-t-elle. Ce sont des fantômes d’humains, mais tu ne peux tout de même pas leur donner une âme. Que répondras-tu au jour du Jugement dernier lorsqu’ils se plaindront à toi de n’être que des corps ?
Elle secoua la tête et le quitta. Mais ces mots : « Ils te demanderont une âme » s’étaient ancrés profondément dans l’imagination de Christian. Plus il regardait les poupées, plus il devenait inquiet. Il n’osait les déchirer. Alors il arracha une touffe d’herbes, fit un trou, les mit tous dedans et les recouvrit de la touffe d’herbe. Ils étaient enterrés. Toute la nuit Christian rêva de ses compagnons irréels et il lui semblait que les petits personnages venaient près de son lit, dansaient dessus en lui disant : « Donne-nous une âme ! »
Le lendemain il retourna à sa touffe d’herbes, la souleva : les fleurs étaient fanées et ratatinées. Il les ramassa, les étendit autant qu’il le put sur une grande feuille de plantain, récita un Pater et mit la feuille sur le ruisseau qui entraîna le navire des morts.
XII
LA NUIT DANS LA FORÊT
Le plus souvent, la foule ne sent pas la supériorité qui voue l’âme d’élite aux sarcasmes et à la solitude. L’âne marche souvent sur la plus belle fleur, l’homme sur le cœur de son frère.
Toi, dont l’œil parcourt ces lignes, t’est-il jamais arrivé de te trouver solitaire ? Sais-tu ce que c’est que de n’avoir aucun cœur à qui se confier, pas un ami, pas un frère, d’être seul au milieu du fourmillement des hommes ? Tu pourras alors comprendre ce qui germait dans l’âme de Christian, cette amertume qui mûrit la pensée et jette dans l’esprit les racines de la sagesse.
Sa consolation était son violon, mais comme le beau- père disait que le violon le conduirait à l’échafaud, il fut vendu à un musicien ambulant pour quelques sous.
– Comme ça, nous n’aurons plus d’histoires à ce sujet, dit Maria.
Sans un mot, Christian se glissa dehors, se coucha dans le foin et pleura jusqu’à ce que le sommeil lui donnât le baiser consolateur ; et il rêva des jours passés où son père lui parlait des beaux pays lointains et où son parrain disait que le violon serait une rose dans sa main et ferait son bonheur.
La réalité était la négation de ces beaux rêves présents et futurs. L’automne vint et, dehors comme dedans, tout devint triste.
– Il y a de quoi pleurer avec cet enfant, dit sa mère ; il tient ça de son père. Mais je ne veux pas qu’on puisse dire que je le gâte.
Et pour être bonne belle-mère avec l’autre, elle devint moins affectueuse avec le sien.
– Écoute un peu ça, dit un jour son mari en revenant de Svendborg, le Norvégien de la rue du Trou, celui qui venait chez ton premier mari, il est arrêté. Il a commis un crime terrible. Il y a de longues années, en Norvège, il a tué une femme, et à Svendborg même ; tu te rappelles Sarah, la fille du Juif, la mère de la petite Noémie qui est si riche maintenant, il paraît qu’il l’aurait aidée à passer dans l’autre monde.
– Seigneur Jésus ! dit Maria.
– Oui, il est sous les verrous. Et c’est tout à fait bizarre comme on l’a su. Il est tombé gravement malade et, le médecin ayant dit qu’il n’en réchapperait pas, il voulut libérer sa conscience et sauver son âme. Mais à partir de ce moment, un grand changement survint dans son état : la santé lui revint et il passa de son lit en prison. Ah ! il n’y échappera pas, il a commis pour ainsi dire deux meurtres et de plus il était contrebandier. C’est pour ça qu’il allait si souvent à Thorseng.
– Ah ! oui, gémit Maria, ça se voyait bien à ce qu’il disait, qu’il était possédé du démon. Je tremble encore en pensant à sa conversation de ce soir de Noël. Son violon était comme la voix de Caïn, c’était hideux à entendre.
Elle tremblait de tous ses membres.
Le couvert fut mis pour le repas du soir. Niels vint, mais on ne trouva Christian nulle part. On l’attendit, on le chercha jusqu’à onze heures.
– Il viendra quand il aura faim, dit le beau-père.
– Je suis sa mère, dit Maria, et je sais combien il est près de mon cœur. Il faut que je le trouve, mais après il me le paiera.
Elle ne le trouva pas.
Peu après le déjeuner, il était assis à sa place de prédilection, près du ruisseau. Les rayons du soleil étaient pâles et froids. Les oiseaux de passage étaient partis depuis plusieurs jours, c’est pourquoi il fut étonné de voir tout près de lui une cigogne retardataire. Elle sautait autour de Christian et ne semblait nullement effrayée. Alors, l’enfant pensa aux cigognes de la maison du Juif, il lui sembla que cet oiseau était le mâle qui s’était enfui la nuit de l’incendie et tous ses chers souvenirs d’enfance lui revinrent en mémoire. « Si on pouvait seulement s’asseoir sur l’aile de la cigogne et s’envoler avec elle vers les pays étrangers », avait dit si souvent son père ! Et jamais cette nostalgie n’avait saisi le petit comme en cet instant.
– Si je pouvais seulement aller à Svendborg voir mon parrain, pensait-il et, mi-rêvassant, il traversait le pré.
La cigogne s’envola par-dessus la forêt et Christian la suivit sur l’herbe, joyeux comme il ne l’avait jamais été, jusqu’à la grand-route qui va à Svendborg.
Ce n’est que lorsqu’il fit sombre et que l’appétit vint qu’il pensa à la maison, tout effrayé d’en être si éloigné et d’avoir abandonné les oies. Il se mit à pleurer en pensant qu’il serait battu en rentrant. « Doux Jésus, sois mon ami ! » pria-t-il avec ferveur. Et il se remit à marcher.
La nuit venait de plus en plus, il ne voyait presque plus devant lui. Alors il grimpa sur le talus, appuya sa petite tête sur le tronc d’un saule et se confia à son destin. Tout à coup, il lui sembla qu’une grande lumière brillait entre les arbres et qu’il entendait au loin une musique. Les sons lointains lui arrivaient chargés d’une exquise harmonie ; il l’écoutait avec l’attention que doivent apporter les saints à la musique divine. Tantôt il lui semblait que cela descendait du sommet des arbres, tantôt du ciel lui-même. Les nuages apparurent plus lumineux, tout devint plus clair, il regardait vers la lumière grandissante, il vit la lune, de sa pâle clarté, appeler hors de l’ombre les buissons et les arbres.
Il se trouvait devant le château de Glorup sur le talus qui entoure l’ancien jardin. La musique qu’il entendait venait de la maison seigneuriale, de là aussi venait la lumière. Il s’approcha irrésistiblement, se laissa glisser parmi les buissons, il était dans le jardin. Une grande allée ornée de statues de chaque côté conduisait au château. Il la suivit, il monta l’escalier de pierre, il vit l’étoile de lumière qui pendait du plafond et des femmes qui dansaient, légères comme des bulles de savon. Il ne se hasarda pas à entrer et se contenta seulement de boire les sons qui étaient source de vie à son cœur alangui.
L’escalier avait été couvert d’une sorte de tapis de laine pour que les chiens des maîtres ne fussent pas couchés sur la pierre nue. Il s’en enveloppa, sa tête fatiguée s’inclina, et il s’endormit. Le vent répandit sur le dormeur le feuillage roux et il ne fut bientôt plus sur la terre qu’une parcelle d’elle-même.
Lorsque le froid le réveilla, la musique s’était tue, tout était désert dans le château. Il se leva, fit quelques pas dans le jardin. Tout le bâtiment, les grandes allées avec leurs monuments blancs avaient quelque chose de lugubre. Il claquait des dents. Pour trouver un refuge contre le vent, il entra dans un taillis ; il y avait là un creux, une sorte de carrière de sable dans laquelle il entra.
Tout à coup, une grande silhouette d’homme se dressa devant lui.
– Qui est là ? Que veux-tu ? demanda une voix brusque.
– Seigneur Jésus ! gémit Christian en tombant à genoux.
– Mais c’est un enfant ! demanda l’homme.
Christian dit qui il était, combien il était seul et en même temps deux bras l’entouraient.
– Ne me reconnais-tu pas ? murmurait l’homme. Ne reconnais-tu pas ton parrain ? Parle bas, tout bas.
Et Christian parla en se serrant contre son parrain et en mettant un baiser sur sa joue.
– Comme tu as une grande barbe, dit l’enfant.
– Mais je ne suis pas pour cela le loup qui mangea la grand-mère et la petite-fille, répondit-il.
– Ah ! oui, tu m’as raconté cette histoire, voilà bien longtemps que je n’en ai entendu. Ils ont vendu mon violon, Niels a fait un cerf-volant avec le livre de musique, mais cela me serait égal si je pouvais rester toujours avec toi.
Le parrain mit son bras autour de son cou, le câlina à sa manière, et le fait de se rencontrer là, à cette heure, parut tout naturel à l’enfant quand le parrain eut expliqué : « Je suis en voyage. »
La lune qui montait éclaira le petit groupe. Le parrain était blême, sa barbe et ses cheveux épais étaient désordonnés. Christian se tenait sur ses genoux. Il écoutait une histoire sans se douter que c’était la propre vie du Norvégien :
– Un jour naquit un homme vertueux. Tu vas voir quel drôle de gaillard c’était. Lorsqu’il était couché dans son berceau, il était rose et blanc, et tout le monde disait que c’était un ange du Bon Dieu. On l’avait élevé dans l’innocence, mais une nuit le diable vint et fit téter à l’enfant du lait de sa chèvre noire et la méchanceté lui entra dans le sang, mais personne ne le remarqua car il avait toutes les apparences de la vertu. Il devint un gamin qui rougissait au moindre mot léger. Personne ne savait ce qu’il pensait. Ses paroles coulaient pures comme la neige inviolée. L’homme vertueux était très fier de sa sagesse et il eût volontiers fait le tour du monde dans une cage de fer pour que tous les hommes vinssent admirer un objet aussi rare.
« Mais un jour il partit dans la forêt et là il vit la reine des bois, une femme fine, fraîche et belle. Alors l’homme vertueux devint une brute sauvage et voulut la tuer. Elle appela au secours, mais comme toute cette aventure était une invention du démon, l’homme vertueux serra le cou de la femme jusqu’à ce que la voix se tût et elle devint blême et froide, et il la poussa dans le taillis.
« Cependant, de son corps sortirent des serpents et des lézards, ils sifflaient autour de lui, puis il leur poussa des ailes et ils chantaient sur les arbres et dans les buissons : « Tu es un homme pécheur, comme les autres. » Et les grands pins inclinaient la tête en disant : « Tu es un assassin ! »
« Alors, l’homme vertueux s’enfuit à l’étranger où les arbres n’en savaient rien et se taisaient, mais les lézards ailés l’avaient accompagné et chantaient dans les buissons et crissaient comme les grillons dans les coins, derrière le poêle. Et l’homme prit son violon et joua pour eux et fit des grimaces jusqu’à ce qu’ils s’endormissent... Mais tu ne m’écoutes pas, mon garçon, dit-il.
Et il murmura devant lui :
– Il dort ; si l’on pouvait dormir comme lui, pour l’éternité, sans rêves, ce serait un bienfait.
Il passa ses doigts sur le visage et le cou de l’enfant, effleura le larynx.
– La mort passe maintenant par-dessus le fil de ta vie, ton âme est pure et blanche ; existe-t-il une félicité éternelle ? Tu pourrais la connaître aussitôt si je t’envoyais dans l’autre monde. Qu’il faut peu de choses pour chasser une âme de cette terre. Mais je ne le veux pas. Petit Christian, souffre et pleure à ton tour comme je l’ai fait, que les hommes posent leurs langues acérées sur ton cœur sensible jusqu’à ce que tu aies la peau dure ; que leurs yeux te regardent avec méchanceté afin que tes pensées se remplissent de fiel. L’homme est méchant, même le meilleur a des instants où le venin dégoutte de sa langue. Si le destin t’a fait son esclave, il te faut baiser sa main, le cœur plein de haine.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Au matin, Christian s’éveilla. Ses yeux cherchèrent son parrain et ne le trouvèrent pas, mais, en levant la tête, il vit dans les branches vertes un cadavre se balancer, la bouche et les yeux grands ouverts, des cheveux noirs au vent et le visage bleu. Christian poussa un cri : c’était le parrain. L’horreur et la peur le clouèrent sur place un instant, puis il s’élança comme un fou à travers les buissons froufroutants, atteignit la haie de clôture et la grand-route. La forêt était derrière lui comme un mauvais rêve et l’épouvantail y flottait.
XIII
LE BATEAU DE PETER WIK
Sur la route, devant lui, Christian vit une femme et une jeune fille qui marchaient. C’étaient Lucie et sa mère qui, à cette heure matinale, allaient rendre visite au frère de la mère, Peter Wik, se trouvant avec son bateau à Svendborg. Christian leur raconta en termes confus l’histoire du parrain dans la forêt, et la mère de Lucie, mi par terreur populaire devant le suicide, mi par crainte d’être mêlée à quelque affaire de police, marcha plus vite, sans que la conversation s’arrêtât.
– On doit être bien inquiet de toi, disait-elle à l’enfant, il ne faut pas venir avec nous. Ils te gronderont, te battront peut-être, mais après ce sera fini.
– Oh ! non, gémit Christian, permettez-moi de rester avec vous ! Ne me repoussez pas, je garderai les poules et les canards si vous le voulez. Ne m’obligez pas à rentrer.
Et il éclata en sanglots.
Alors, les larmes vinrent aussi aux yeux de Lucie et elle plaida pour lui.
– Laisse-le rester avec nous ; son demi-frère est trop méchant pour lui.
– Mais je n’ai aucun droit sur lui ! Je ne peux pas l’enlever à ses parents.
– Il pourrait nous accompagner jusqu’à Svendborg ; mon oncle lui permettrait de passer la nuit sur le bateau et demain matin il rentrerait avec nous. Tu irais d’abord parler à ses parents et lorsqu’ils ne seraient plus fâchés, il rentrerait. Tu veux bien ?
Christian la regarda avec reconnaissance. Elle lui prit la main.
– Ne sois pas triste, ma mère t’aime bien.
Et elle jeta à sa mère un regard de prière.
– Puisque le Seigneur t’a conduit jusqu’à nous, reste. Il ne t’arrivera rien de mal à Svendborg cette nuit et demain tu reviendras avec nous.
– Oui, dit Christian avec un profond soupir.
Puis elle lui posa des questions sur son parrain et il répondit aussi bien qu’il le put. Lucie parla de son oncle, du bateau sur lequel ils iraient, de la jolie petite cabine aux fenêtres garnies de rideaux rouges dans laquelle on voyait le portrait d’une femme défunte de l’oncle, une Suédoise de Malmö. Puis elle lui parla du rayon avec la Bible, du livre des psaumes, d’Albert Julius, et du vieux violon. Les yeux de Christian pétillaient à ce mot : « un violon ».
Ils atteignirent Svendborg dans la matinée. Avec quel bonheur il revit Thorseng, la baie et toute la chère petite ville. Il avait envie de saluer toutes les maisons comme de vieilles connaissances. En passant devant la rue du Trou, il regarda vers la maison du parrain. Les volets en étaient fermés et la porte ouverte, lis arrivaient à l’embarcadère.
– Voilà Lucie, dit la mère en montrant le bateau.
– Et voilà l’oncle, dit Lucie.
Un gros petit homme à la figure rouge et joviale apparut : c’était l’oncle Peter Wik.
– Ah ! c’est vous ! dit-il, Lisbeth et ma chère petite navigatrice. Allons, embarquez.
– Est-ce que ça pourra nous porter ? demanda Lisbeth inquiète.
– S’il porte un poids comme le mien, il portera aussi des poulets comme vous. Comme tu as grandi, Lucie ! Presque en âge d’avoir des amoureux. Est-ce ton futur mari, ce petit homme que tu as amené ? dit-il en montrant Christian. Petit poisson deviendra grand, mais fais attention, mon petit, qu’elle ne s’échappe pas avant que tu ne lui offres l’alliance.
– Oh ! comme tout est propre et bien rangé, disait Lucie.
– Est-ce que tu prends mon bateau pour une porcherie ? Non, ma Lucie de mer est lavée tous les matins comme les autres enfants gâtés, et quand nous traversons la mer, sa toilette est encore meilleure. Il faut bien que le pont soit propre, c’est mon lieu de promenade tous les jours et mon église le dimanche. Mais du diable si je m’attendais à votre visite ! c’est une bonne idée, Lisbeth.
– À vrai dire, répondit-elle, c’est Lucie qui y a pensé la première. Elle ne m’a pas laissée tranquille que nous ne soyons venues.
– Je ne t’avais pas vu depuis plus d’un an, dit la jeune fille.
– Si j’avais vingt ans de moins, Lucie, et toi quelques années de plus, je ne jurerais pas que tu ne deviendrais pas la seconde Mme Peter Wik. Quel malheur d’être un vieux loup de mer, quand les plus belles filles grandissent !
Ils descendirent dans la cabine.
Tout était comme Lucie l’avait décrit. Les courts rideaux rouges flottaient aux petites fenêtres entre lesquelles pendait le portrait de Mme Wik. Au-dessus, sur la planche, il y avait les livres et le violon qui attira aussitôt l’attention de Christian.
– Si les fenêtres descendaient plus bas, il ferait plus clair, dit Lucie.
– Plus bas ! répondit Peter Wik, alors l’eau entrerait dans le corps de notre équipage. Tu n’as pas plus de compréhension des choses de la mer qu’une oie, et encore elle sait ramer des pattes. Ces terriens...
Puis il demanda qui était Christian ; on lui raconta l’histoire de sa fuite, mais pour ce qui était du parrain, il valait mieux, comme disait l’oncle, que cette histoire suive son chemin sans qu’ils aillent se mettre dans son sillage. Pour la nuit, Lisbeth et Lucie dormiraient dans sa maison, en ville, lui resterait à bord, où Christian aurait aussi une couchette.
Ce n’est que lorsqu’ils furent seuls tous deux qu’ils firent plus ample connaissance.
– Maintenant, mon petit, nous deux nous allons nous battre avec le marchand de sable. Je vais prendre mon grog et ma pipe et toi, puisque tu m’as dit que tu savais jouer du violon, fais-moi entendre comment tu grattes.
Christian tremblait de joie en touchant les cordes ; il exécuta quelques-uns des traits savants que son parrain lui avait enseignés.
– Mais oui, dit Peter Wik, c’est une très jolie mélodie, si seulement elle était prise sur un autre ton. Ce sont des arabesques norvégiennes que tu joues, elles montent à la tête comme du vieux cognac.
Puis il se renseigna sur la maison de Christian et sur son demi-frère.
– Mais pourquoi te laissais-tu faire ? dit-il, quelques bons coups sur la « cafetière » à ce garnement lui auraient fait tourner le bec d’un autre côté. Vendre ton violon ! ça c’était dommage. Mais qui était donc ton propre père ?
Christian le nomma.
– Je l’ai connu, dit Peter Wik, il avait voyagé et avait été jusqu’à Livourne. Ce n’était pas une poule mouillée quoiqu’il fût tailleur.
– Si seulement je pouvais aussi voyager à l’étranger ! soupira Christian. Oh ! si je pouvais rester sur ce bateau !
Il prit la main du marin et ses yeux étaient aussi éloquents que ses lèvres.
– Si ta mère le voulait, tu pourrais bien rester, car je cherche un gamin. Mais il faut que tu saches que nous ne sommes pas toujours dans le port, quelquefois nous allons en haute mer où Lucie danse et là tu sentirais un bon coup de roulis. Quelquefois aussi il pourra m’arriver de te donner une bonne taloche et alors tu ne pourras pas te sauver, mon garçon. Maintenant, couche-toi dans ta petite couchette, tu y seras comme dans le tiroir de la commode de ta mère.
Peter Wik alla s’asseoir sur le pont avec son grog et sa pipe et Christian gagna son petit lit. Il était plein de confiance pieuse en Dieu. Il lui semblait que le ciel était plus proche.
Il se leva aux premières lueurs du jour comme il en avait coutume. Cela fit bonne impression au marin.
– Tu es comme les poulets, tu te lèves de bonne heure. J’aime ça. Mais il vaut mieux que tu navigues vers l’intérieur jusqu’à ce que tes papiers soient en règle et que ta mère dise que tu peux flotter. Mais Dieu me pardonne, le voilà qui pleurniche !
– Il restera avec toi ? pria Lucie lorsqu’elle vint et connut le chagrin de Christian. Maman va aller ce soir chez ses parents et tout leur raconter. Il n’a pas de foyer et tu seras pour lui un bon oncle comme pour moi !
Elle caressait de sa petite main la joue ridée de l’oncle.
– Voyez-vous cela ! voilà que tu prends les manières de Mm Wik quand elle voulait m’amener à ses fins. Les femmes sont de drôles d’instruments...
Le lendemain après-midi, Maria vint à Svendborg. Elle était seule et alla tout de suite au bateau. Elle embrassa l’enfant et le gronda en même temps.
– Seigneur Dieu ! s’enfuir comme ça de chez nous. Ah ! tu es bien comme ton père ! lui aussi m’a fait faire bien du souci. Va-t’en avec ton bateau puisque tu le veux, et quand il aura disparu corps et âme, ce sera un nouveau chagrin pour moi !
Et Christian devint matelot.
XIV
VERS LE COPENHAGUE DU ROI
Le 18 octobre, tout était prêt à bord pour le départ. En dehors de Peter Wik, l’équipage se composait de trois matelots et il y avait deux passagers. L’un était une gouvernante entre deux âges qui, dans son jeune temps, avait fait partie de la troupe du comte de Trampes, à Odense, mais elle avait dû l’abandonner à cause de ses principes moraux, disait-elle. Elle écrivait des vers, mais seulement en allemand, car on ne pouvait, à son avis, exprimer des sentiments élevés que dans cette langue. Elle allait rejoindre une famille distinguée à Copenhague. L’autre passager était installé dans cette ville. Il était membre du Conseil de guerre, titre qu’il avait sollicité sur le conseil de sa femme.
Le bateau passa, les voiles gonflées, devant Saint-Jôrgens-Gaard et le marché aux poissons ; il semblait à Christian qu’il partait dans le vaste monde : la Chine ou Copenhague étaient pour lui aussi lointains, aussi nouveaux.
Les deux passagers avaient rapidement fait connaissance et, avant que le bateau n’eût atteint Œrô, le membre du Conseil de guerre avait, avec une brusquerie distinguée, exposé ses joies et ses peines. Il était poète aussi et avait écrit dans sa jeunesse dans le Courrier du Soir et les Présents du Jour de l’An, mais sous un pseudonyme. Le vers élégiaque était sa véritable vocation, bien qu’il fît aussi de la critique d’art, des catalogues de ventes et diverses autres choses.
– C’est agaçant, disait-il, les gens veulent écrire alors qu’ils ne savent par l’orthographe, c’est comme si on voulait faire un discours sans avoir de dents.
« Il faut que je note cette idée, se dit-il à lui-même, et il l’inscrivit aussitôt sur un carnet.
« Voyez-vous, mademoiselle, je ne laisse jamais une bonne idée se perdre. »
Dans la lumière de midi, le bateau passa de la baie du fjord dans la grande mer, le bateau, cette autruche de la mer qui parcourt le grand steppe, trop lourd pour voler dans l’air mais qui a cependant le vol de l’oiseau. Les voiles gonflées étaient comme des ailes au-dessus de la petite caravane. Christian voyait les côtes de chez lui transformer de plus en plus leur apparence coutumière ; la course rapide, l’air vif et toutes ces choses nouvelles l’emplissaient d’étranges pensées.
Le lendemain, vers le soir, Copenhague, ses tours et Christianborg devinrent nettement visibles ; l’œil en saisit tous les contours avant que de nouveau ils ne disparussent dans l’obscurité. C’est ainsi que monte souvent dans nos âmes le souvenir d’un rêve étrange et, au moment où nous allons en saisir l’image, l’ombre l’enveloppe à nouveau.
Bientôt les bateaux furent de plus en plus nombreux, on voyait briller les lumières de Copenhague et d’Amager. Christian entendit le gouvernail tourner, l’ancre tomba, des voix résonnèrent, Peter Wik monta dans la barque, le membre du Conseil de guerre et la gouvernante le suivirent, après que cette dernière eut glissé quelques sous dans la main du mousse.
Ils devaient coucher cette nuit dans la grande ville que Christian ne verrait que le lendemain. Était-elle bien plus grande que Svendborg ? Est-ce que les maisons y ressemblaient au château de Thorseng, et surtout, est-ce qu’il y avait de la musique ? Comme il retournait ces pensées dans son esprit, le cor du chasseur résonna au château ; le vent lui en apporta par-dessus la mer les sons doux et tristes. Christian joignit les mains pour prier.
XV
TU ES SANS DOUTE UN GÉNIE
Lorsque le jour se leva, Christian se précipita sur le pont. S’il avait vu devant lui une ville de marbre et des châteaux aux toits d’or, il n’en eût pas été surpris, son imagination l’avait préparé à tout. Il pensait être bouleversé par la vue de Copenhague, mais il ne vit rien qui lui parût extraordinaire : beaucoup de bateaux, quelques maisons et, sur une languette de terré, à gauche, des bâtiments qui avaient l’air de nager dans l’eau. Enfin le soleil éclaira les bateaux en construction dans les chantiers, on vit le peuple des ouvriers s’agiter, et le bateau glissa dans le large passage entre le chantier de la marine royale et Copenhague. Alors les maisons, les tours et les ponts apparurent, ils naviguèrent même dans une rue qui était le port neuf. Aucune maison de Svendborg n’avait autant d’étages que celles-ci. De grands et de petits bateaux se balançaient les uns à côté des autres dans le large canal et chacun d’eux était garni de drapeaux multicolores, comme pour fêter un mariage. Dans les ruelles, de chaque côté du canal, passaient des calèches et des voitures plus simples, les gens s’appelaient et criaient. Des messieurs et des dames très élégantes passaient les uns près des autres, sans se saluer. On approcha Lucie du parapet et on l’y fixa solidement. Les deux matelots avaient la permission d’aller en ville ; Christian demanda à les accompagner. Ils foulèrent la terre ferme, ils traversèrent la grand-place. Un roi de bronze s’y dressait à cheval entre deux guerriers.
Les maisons lui semblaient toutes des châteaux et ils passaient devant des magasins plus superbes les uns que les autres. Il y avait foule constamment, comme en un jour de marché, les voitures étaient plus nombreuses que pour aller au bal du Conseil de Svendborg. Puis ils pénétrèrent dans dé plus petites rues, mais les maisons y étaient aussi hautes, et des femmes très distinguées, vêtues comme pour. aller au bal, saluaient par les fenêtres comme si elles connaissaient tout le monde. Au coin de la rue, sur les marches froides et sales, était assise une jeune femme en haillons, pâle comme une morte ; un petit garçon à moitié nu pleurnichait, la figure enfouie dans sa jupe, un bébé jaune et maladif tétait le sein tari. La femme renversait la tête en arrière et criait, ne semblant prêter attention ni au plus grand, ni au plus petit des enfants.
– Elle est malade, dit Christian, ne faudrait-il pas le dire à ces dames ?
Les matelots rirent et l’amenèrent dans une rue de traverse où des sons de violon et de flûte sortaient d’une maison basse et sombre. Ils y entrèrent.
L’âme de l’enfant était délicieusement bercée par la musique, de nombreuses lumières faisaient cligner ses yeux, mais une fumée grise et épaisse le prenait à la gorge. Ils étaient dans un cabaret de matelots.
Le chapeau à la main, il salua poliment de tous les côtés, mais personne n’y fit attention. Un gaillard dansait, la pipe à la bouche, et envoyait la fumée en grands nuages par-dessus l’épaule de sa danseuse.
Puis vint une jeune femme tenant une bouteille de bière à la main. On l’appelait Steffen-Kareth. Elle connaissait bien les marins et était sans doute la femme de l’un d’eux. C’était une très aimable dame ; elle parla si gentiment à Christian et lui donna du punch ; il lui baisa la main et elle lui repoussa gentiment les cheveux hors du front. Elle devait être foncièrement bonne, assurément.
Il quitta sa maison avec le plus grand respect et la plus grande reconnaissance. Se souvenant de l’histoire du fils de paysan qui devint empereur, il pensa que si cette dame voulait s’occuper de lui, il pourrait jouer du violon et s’asseoir au milieu des autres musiciens, peut-être même quelque chose de mieux, mais où la musique jouerait toujours le rôle principal.
Bouleversé par les impressions des derniers jours et de cette nuit, il n’arrivait pas à s’endormir, mais une pensée dominait les autres : « Si je pouvais rester ici ! » La dame chez laquelle il était allé lui semblait si pieuse et si puissante ! Oui ! il se confierait à elle, elle pourrait faire beaucoup pour lui et le ferait certainement lorsqu’il lui exprimerait son vœu le plus cher : être musicien. Il la comprit dans sa prière à Dieu et s’endormit avec la ferme intention d’aller la voir un jour en cachette.
Lorsqu’il eut, le jour suivant, grimpé bien haut dans les cordages, ses yeux embrassèrent les environs ; à droite, la grande place avec la statue de bronze ; à gauche, pardessus le chantier, la grande mer bleu foncé et la côte de Suède, mais ce qui surtout attirait les regards, c’était un jardin tout près du mur bas où était fixé le bateau. D’étranges plantes rares y poussaient et aussi un grand peuplier qui lui rappela le jardin du Juif qu’il avait vu dans son enfance. Des serres garnies, à l’intérieur, de grandes verdures apparaissaient à travers les haies et les fleurs d’automne. Décidément, tout ce qu’il voyait à Copenhague était merveilleux et il n’avait encore rien vu, disaient les matelots.
Oui, il fallait rester ici, le Bon Dieu l’aiderait. Dès qu’il aurait une autre fois la permission de sortir dans les rues, il chercherait la bonne dame en qui il mettait tout son espoir.
Le dimanche matin, il demanda à aller à l’église la plus proche, chanta avec l’orgue, car il n’avait pas de livre de psaumes, puis il chercha la rue et la maison de la bonne dame. Il entra sous la voûte sombre, trouva la porte, mais avant d’y frapper, il s’agenouilla, dit son Pater et pria Dieu d’influer sur le cœur de la dame afin qu’il puisse apprendre la musique.
Une vieille femme aux vêtements sales ouvrit la porte et demanda ce qu’il voulait. Comme son explication lui parut insuffisante, elle était sur le point de refermer la porte lorsque Steffen-Kareth apparut.
– C’est toi ? dit-elle en le reconnaissant.
La vieille se retira, Christian saisit la main de la dame, l’embrassa et lui raconta de façon un peu naïve sa grande nostalgie de musique, combien il avait été malheureux chez lui et comment il était arrivé à courir le monde. La dame commença par rire, mais l’écouta ensuite sérieusement et lorsque des larmes amères lui montèrent aux yeux, elle les essuya.
– Mon gentil garçon, dit-elle, mais je n’ai rien à voir avec la musique.
Elle l’attira vers l’armoire ouverte, lui donna du punch et des pommes et éclata d’un rire joyeux :
– Tu es sans doute un génie, comme ils disent !
Que pouvait-il espérer, que lui avait-elle promis ? Il était plein de joie en quittant la maison ; elle lui avait tendu la main, l’avait appelé un génie, il pouvait être tranquille, il irait loin.
Au fond, il avait fait comme n’importe quel génie qui confie son destin à un autre homme ou à une autre femme. Ils sont en général aussi capables de le juger que l’humble servante de café, Steffen-Kareth.
XVI
GARÇON MALPROPRE !
Margot,
c’était elle
Louison.
Et elle ne nous a pas reconnues.
SCHILLER.
(La Pucelle d’Orléans.)
– Ce soir nous allons à l’Opéra, dit Peter Wik en emmenant Christian.
On raconte qu’un paysan se rendant pour la première fois de sa vie au théâtre marcha droit au guichet des billets, passa sa tête à travers le trou carré et resta là, muet, pensant que c’était à travers cette perspective qu’il devait voir la comédie. Christian en aurait bien fait autant, car il n’était jamais encore allé au théâtre. Tout était pour lui spectacle, depuis les soldats debout dans le hall jusqu’à la foule qui montait les escaliers.
– Tu vas voir dans quelle commode nous allons nous introduire, dit Peter Wik. Nous allons nous mettre dans le tiroir supérieur. Vois-tu, les derniers sont un peu ouverts pour que les dames ne chiffonnent pas leur toilette.
Ils montèrent très haut et s’assirent au premier rang. Christian était muet. Il lui semblait être dans une grande église ; le roi et la reine prirent place dans leur loge. La lumière inondait les loges dorées où étaient assises les belles dames richement vêtues. Christian ressentit une peur étrange, mais aussi une grande joie ; il se trouvait dans la même maison que le roi et il n’aurait eu qu’à crier fort pour que le roi l’entende et dise sans doute : « Quel est donc ce garçon qui crie ? »
Mais il restait bien tranquille parce qu’un océan de sons traversait l’édifice. La pièce commença et il entendit chanter comme jamais il ne l’avait entendu. Les pleurs jaillirent de ses yeux ; il s’en cacha, car on eût sans doute ri de lui. Les joies célestes ne pouvaient être plus grandes, lui semblait-il, que celle d’être toujours assis là et pourtant, disait-on autour de lui, cette pièce était ennuyeuse et ne valait que par son merveilleux ballet.
La musique résonnait comme des voix humaines, comme la nature tout entière. Il lui semblait entendre l’orage de la nuit près de la source, lorsque les arbres se courbaient comme des roseaux et que les feuilles volaient autour de lui. Il entendait le vent comme lorsqu’il soufflait autour du mât et des voiles, mais plus mélodieusement... C’était bien plus beau que le violon du parrain, et pourtant c’était à cela qu’il pensait.
Le rideau se leva. Barbe-Bleue avait tué des femmes qui voltigeaient en voiles blancs autour de leur meurtrier. Christian suivait, haletant, cette intrigue romantique. Qu’ils étaient heureux, ces petits enfants qui dansaient devant Isaure ! comme il aurait voulu être parmi eux ! Il ne pouvait pas y avoir sur terre un sort plus privilégié. S’il avait seulement le courage de crier son désir au roi, il l’entendrait sans doute et l’aiderait. Mais il ne l’osa pas. La vie de théâtre lui apparaissait pourtant comme l’image enchanteresse du bonheur et de la beauté.
– Voilà Noémie ! cria-t-il tout d’un coup au milieu de sa joie. Oui, c’est elle !
Et ses yeux abandonnèrent le monde des rêves, et la lutte d’Isaure, et la petite clé d’or tentatrice, il ne vit plus que la jolie fillette aux yeux noirs de gazelle et au teint méridional. Elle était assise au premier étage, parmi les dames élégantes.
– Nous avons joué ensemble, dit-il à Peter Wik.
Et son intérêt se partagea entre le ballet et Noémie.
Cette représentation splendide ne fut que trop tôt terminée. Tous sortirent avec hâte comme s’ils fuyaient quelque chose de désagréable. Vainement Christian chercha Noémie dans la foule ; peut-être était-ce elle qui passait dans cette rapide calèche...
Les sons vibraient encore à son oreille, toute la pièce était présente à son esprit. Il comprenait maintenant qu’il y avait quelque chose de plus élevé, de plus noble que la tâche et la vie quotidienne des hommes. Il devina la perle dans son âme, la perle sainte de l’artiste, mais il ne savait pas que celle-là, comme la perle de la mer, doit attendre le scaphandrier qui l’amène à la lumière.
– Eh bien, tu aurais aimé être de la partie ! dit Peter Wik.
– Oui, répondit l’enfant très surexcité.
– C’est un mauvais gagne-pain, mon garçon. Lorsque nous avons donné notre argent, ils sont obligés de faire les pitres devant nous.
Mais Christian ne pouvait partager le sentiment de Peter Wik. Est-ce que le roi et la reine et des milliers de personnes n’avaient pas écouté l’opéra comme on écoute les prêtres à l’église ? Lui n’oubliait et n’oublierait jamais aucun détail du spectacle et, au milieu de ces merveilles, flottait l’image de Noémie, sa chère petite camarade.
Durant les soirées qui suivirent, assis dans la petite cabine sombre, – dans le port les navires n’ont pas le droit d’avoir de lumière à bord, – Christian essayait de retrouver sur son violon les airs de Barbe-Bleue ou de reproduire les sons du vent dans la voilure. Il se souvenait de tous les airs qu’il entendait exécuter quotidiennement par la garde royale et il en faisait sur son instrument de brillants pots pourris. Il espérait souvent que la dame distinguée, la fée de son bonheur, apparaîtrait subitement à bord et opérerait son changement d’existence. Il pensait à Noémie ; elle l’aimait sûrement puisqu’elle avait pleuré en le quittant.
Comme il était assis un soir, seul sur le bateau, des lumières surgirent d’une maison toute proche et il entendit de la musique de danse qui lui rappela celle du château de Glorup.
Tout à coup il eut une idée : il grimpa dans les cordages et se trouva ainsi à la hauteur de la salle où l’on dansait. L’une des fenêtres était ouverte, ce qui lui permettait de voir toute l’élégante société de petits, car c’était un charmant bal d’enfants. Ils étaient tous joyeux et parés pour la fête. De grands tableaux pendaient aux murs, deux statues de marbre ornaient une magnifique console, tout ce décor était multiplié par de nombreuses glaces. Une jolie petite fille glissait sur le parquet, ses cheveux noirs bouclaient autour de ses épaules enfantines et ses yeux sombres brillaient de vie et.de plaisir.
– Noémie ! cria le petit garçon à haute voix.

Et il la vit s’arrêter, regarder de tous côtés et rire. Ses yeux étaient fixés sur elle, ses pensées étaient près d’elle. Il glissa au bas du mât, sauta du bateau, alla vers la maison, monta l’escalier, ouvrit la porte et se trouva au milieu de la salle, au milieu des enfants parés qui regardaient, surpris, ce petit mousse ébloui par la lumière et le luxe et qui restait embarrassé au milieu de la pièce.
– Que veux-tu ? demandèrent quelques garçonnets dans les yeux desquels on voyait clairement que leur père avait une grosse fortune ou une situation en vue.
Noémie s’était approchée aussi et le regardait. Curieuse, elle souriait, oui, elle le reconnaissait sûrement. Christian lui prit la main et balbutia :
– Noémie !
Le sang monta aux joues de la petite fille.
– Garçon malpropre ! dit-elle en s’arrachant de lui. Un domestique arriva au même instant.
– Que veux-tu ? demanda-t-il en le poussant vers la porte.
Christian, l’âme ulcérée, descendit l’escalier et courut au bateau. Il s’accrocha au mât et pleura de lourdes larmes tandis que la musique jouait de joyeux airs de danse.
Un chagrin d’enfant est aussi grand que les plus lourds chagrins des hommes. L’enfant n’a, dans sa douleur, aucun espoir, la raison ne lui tend pas sa main secourable. Elle n’avait pas voulu le reconnaître, elle qu’il aimait comme une sœur ! Ses camarades s’étaient moqués de lui, l’avaient traité de fou. Noémie qui autrefois le comprenait l’avait appelé : « Garçon malpropre ». Une minute comme celle-là suffit pour donner l’expérience de la vie. Christian entendit alors un cri joyeux provoqué par un superbe feu de Bengale qui éclairait ainsi la scène finale du drame de son enfance. Il remonta dans les voiles et, à travers la fenêtre ouverte, regarda la salle magnifique où Noémie et les enfants heureux dansaient aux bras les uns des autres. Des domestiques passaient avec des boissons exquises dans des coupes de cristal. Noémie était debout au milieu de la salle et elle riait et tapait des mains. Mais au dehors tombait la neige, et le brouillard gris enveloppait comme un voile le « garçon malpropre » qui se cramponnait aux cordages.
XVII
LA VACHE MARINE
L’hiver fut rude cette année-là ; la glace était épaisse entre Sjælland et Skaane. Le paysan suédois, qui est toujours le premier à oser passer sur ce pont construit par le froid, alla en traîneau jusqu’au Danemark. Là, où quelques mois auparavant les grands trois-mâts se balançaient dans l’eau profonde, de vieilles femmes étaient assises avec leurs tables garnies et vendaient du pain de froment et des boissons ; on avait dressé des tentes au sommet desquelles le drapeau danois flottait dans l’air glacé et, durant tout le jour, la foule s’agitait comme une fourmilière gigantesque. Les grands bateaux demeuraient pris dans la glace comme de vieilles carcasses de navire restent enfoncées dans le sable. Près de la côte suédoise, on voyait, du Danemark, des points noirs s’agiter de-ci de-là : c’étaient des promeneurs en voiture, en traîneau ou à pied qui visitaient les environs.
Une étendue de quatre lieues de neige et de glace n’empêche pas de songer quand même à l’eau profonde qui roule au-dessous. Une tempête amenant un changement de direction du courant peut, en quelques minutes, briser la glace. Mais de même que le vigneron plante sa vigne sur la lave encore chaude et dort au bord du gouffre, de même le paysan traverse bravement la glace en se disant qu’il est entre les mains de Dieu.
Comme on le sait, la femme que Peter Wik avait perdue était une Suédoise, née à Malmö, où habitait encore sa famille. Un marin dont le bateau est pris dans les glaces par l’hivernage n’a pas grand-chose à faire. Puisqu’il y avait un chemin pour aller en Suède, que bien des gens y allaient et en revenaient, Peter Wik avait décidé de faire cette excursion et que Christian l’accompagnerait.
– Il s’agit de savoir, dit Peter Wik, si le couvercle tiendra et si nous ne coulerons pas au fond du pot où il n’y a ni lumière ni soleil. Mais nous sommes des gens de la mer et nous n’avons pas peur d’aller sur elle, qu’elle se présente sous la forme solide ou liquide.
Ils se mirent en route. À une lieue de la côte du Sjaelland, il commença de venter très fort, de lourds nuages s’amoncelaient, mais Peter Wik était la gaieté en personne. Ils rencontrèrent un troupeau de bétail dont le conducteur affirmait que la glace était solide et sûre, mais que le temps changerait au cours de la journée.
– Ce serait charmant si la mer devenait libre tandis que nous serions là-bas, dit Peter Wik. Eh bien, nous épargnerions nos jambes au retour, il nous faudrait naviguer. Mais non, nous marchons là-dessus aussi légèrement qu’une mouche sur un bâton de goudron.
L’air devenait plus sombre, des flocons de neige tombèrent quand nos voyageurs n’étaient pas encore à mi-chemin. Puis, tout à coup, les nuages déchaînèrent la pluie en tourbillons.
– Monte ton foulard au-dessus de tes oreilles, dit Peter Wik, ce n’est qu’un petit coup de roulis.
Ils allèrent, tête baissée, contre la tempête de neige ; au-dessus d’eux le vent sifflait comme une corde qui cingle.
– Eh bien, ça ne va donc pas cesser, dit Peter Wik en levant la tête et en s’arrêtant un instant.
Alors ils entendirent au-dessous d’eux un fracas comme un coup de canon.
– Tant qu’elle craque elle tient, dit-il, et, prenant la main de Christian, il se mit à marcher rapidement. Il nous faut aller tout droit, alors nous tomberons droit sur la jetée de Malmö. Non, ce qu’elle écume, aujourd’hui ! dit-il en soufflant sur les flocons de neige.
Alors résonna encore au-dessous d’eux ce bruit de tonnerre provoqué par les courants qui font dans la glace de profondes fentes non encore visibles à la surface.
– Ils ont de bien charmants canons, là-dessous, dit Peter Wik, ils auraient bien dû tirer avec, à la fête de la reine.
Durant un instant, les flocons de neige tombèrent moins épais. Au-dessous d’eux le bruit devenait un gémissement. On eût dit que l’eau recouverte cherchait sa respiration. Peter Wik s’arrêta, ses yeux fixèrent l’horizon.
– Nous ne sommes pas à mi-chemin, dit-il, je crois que pour aujourd’hui nous ferons bien de laisser les Suédois être Suédois et de nous en retourner.
Il écouta encore.
Le vieux marin n’ignorait pas que l’épaisse glace pouvait, sous l’influence des changements de direction des courants et du vent du sud, être très rapidement brisée et entraînée vers le nord. C’est là une des scènes de la nature les plus impressionnantes de nos pays. La force de la glace et la puissance des courants sont grandes toutes deux, principalement autour de Helsingor, où le Sund n’a qu’une demi-lieue de large entre les deux côtes. D’immenses morceaux de glace sont brisés par les courants, pressés les uns contre les autres, élevés très haut dans l’air où, comme serrés par une vis, ils se dressent en rochers de glace aux formes baroques. Le Sund ressemble alors à un glacier qui passe.
Certes, rien de visible n’annonçait encore un tel cataclysme, mais l’impulsion était donnée, les profondeurs de la mer avaient hurlé à la mort de ceux qui étaient au-dessus. La neige tombait toujours. Peter Wik rebroussa chemin et la marche leur sembla plus facile maintenant qu’ils avaient le vent et la neige dans le dos. Tout à coup ils entendirent derrière eux un cri d’angoisse faible, mais perçant, et se retournèrent juste à temps pour éviter un petit traîneau léger où se trouvaient quatre personnes. Peter Wik cria : « Halte-là ! » et l’attelage s’arrêta.
Un monsieur danois fort distingué était assis sur le siège auprès de son domestique, une dame d’un certain âge et une jeune fille avaient les meilleures places. La jeune fille pleurait tout haut, la vieille dame serrait son manteau autour d’elle.
– De combien croyez-vous que nous soyons éloignés du Sjaelland ? demanda le monsieur.
– Environ deux lieues, répondit Peter Wik. Mais si vous continuez du côté où vous allez, ce sera long ; vous pointez droit sur la Prusse. Voici la Suède, voici Sjaelland, et il montra les deux directions.
– Est-ce bien sûr ? demanda le monsieur.
– J’ai le compas dans la tête, répondit Peter Wik.
– Sacré temps ! dit l’étranger, il faisait si beau quand nous avons quitté la Suède. Nous devons être près de Hœen.
– Non, c’est bien plus haut. Permettez-moi d’être votre guide. Il ne faudrait pas non plus aller à cette allure, il pourrait y avoir une crevasse dans la glace.
– Ah ! mon cher marin, est-ce vous ? demanda la dame d’un certain âge. Arriverons-nous vivantes à terre ?
Peter Wik la regarda et la reconnut.
– Oh ! oui, petite madame, dit-il, on ne sombre pas aussi vite, à condition de faire attention. Puis le temps s’éclaircit.
La dame soupira profondément. C’était la gouvernante qu’il avait conduite à Copenhague. Il prit les guides en mains, le domestique descendit et Christian se mit à sa place. L’étranger était un homme de trente et quelques années et toute sa manière d’être indiquait qu’il appartenait à la haute société. Il était parti deux jours auparavant avec sa filleule, comme il appelait la jeune fille, et sa gouvernante. Ils étaient allés en traîneau à Skaane et la glace était solide. Aujourd’hui, au moment de rentrer, le temps avait brusquement changé et, sous la tempête de neige, ils allaient, au lieu de gagner Hœen, droit sur Amager.
Ils repartirent, mais au-dessous d’eux résonnait toujours le bruit de gémissements et de déchirements, ils furent soulevés puis retombèrent. Les chevaux s’arrêtèrent et Christian dit sa prière.
– Nous sommes entre les mains de Dieu.
La jeune fille jeta ses bras autour de son parrain.
– Il vaudrait mieux que je descende, dit celui-ci.
– Oh ! non, supplia-t-elle, nous allons mourir, la glace se brise.
Elle arracha son manteau, regarda devant elle, pâle comme une morte, ses longs cheveux noirs tombaient autour de ses joues blanches. Christian la regarda, c’était Noémie. Il la voyait, mais n’osait prononcer son nom, la surprise lui faisait oublier le danger. De-ci de-là, dans l’air gris, quelques plaques de glace nette apparaissaient encore, mais derrière elles, à moins de cent pas, la glace était soulevée et laissait apparaître une traînée sombre avec d’étranges excroissances. Personne ne parlait. Alors ils entendirent devant eux un bruit étrange qui ne venait pas de la mer et ne venait pas non plus de l’air. Il sonnait creux et triste ainsi que la voix de la vache marine qui, dit-on, appuie ses pattes de devant sur les rochers et mugit vers la terre où paissent les bêtes de sa race, mais où il ne lui sera jamais donné d’aborder.
– Qu’est-ce donc ? demanda l’étranger en essayant de voir devant lui.
Peter Wik ne disait rien.
De nouveau la glace craqua sous eux et la neige devint grise à cause de l’eau qui apparaissait.
– Qu’y a-t-il par bâbord droit ? demanda Peter Wik en tournant les chevaux.
– On dirait qu’on voit une maison, dit le domestique.
– Il est impossible que nous soyons près de la terre, dit Peter Wik à voix basse.
« Hoc ! » entendirent-ils tout près d’eux, puis encore ce bruit de mugissement qui avait frappé leurs oreilles.
Non loin, devant eux, on apercevait une sorte de cabane à demi-couverte de neige. Ils y trouvèrent un bouvier avec quelque bétail qui mugissait dans l’air froid.
– Qu’est-ce que c’est que cette caisse qui est ouverte ? dit Peter Wik. Est-ce que vous campez ici ?
– Mais oui, c’est sans doute ce qu’il y a de plus sage, répondit le bouvier. Ici on a la terre ferme sous soi et Dieu au-dessus. Ces messieurs et dames feraient bien de rester ici. Voilà la ferme.
Il montrait une construction qui ressemblait à une maison de paysans, à quelques pas de là.
Ils étaient sur la petite île plate appelée Saltholm, dont les points les plus élevés sont seuls, durant l’hiver, au-dessus du niveau de l’eau ; les chasseurs ont coutume de les visiter à cause des nombreux lièvres qu’ils y prennent. L’été, au contraire, les pâturages y sont si riches que les gens d’Amager y conduisent leurs bêtes.
Le bouvier expliqua aux voyageurs qu’il devait toujours y avoir un homme dans la maison l’hiver, mais on ne trouva personne ; sans doute le gardien était-il allé en visite à Amager ou en Suède et n’était-il pas rentré. La maison était vide.
Notre caravane fit halte, la petite île abandonnée devenait leur port de salut.
À l’intérieur ils trouvèrent quatre murs nus, brillants d’humidité glacée. La cuisine et la salle formaient une seule pièce. Dans un coin, sur le parquet carrelé, il y avait un mauvais lit qu’ils enlevèrent rapidement. Dans la pièce à côté il y avait un tas de tourbe dont Peter Wik prit une partie pour faire un feu avec quelques vieilles planches. Les coussins du traîneau devinrent de magnifiques divans. Tout cela ressemblait aux relais isolés sur la route du Simplon, quand la neige et le brouillard obligent les voyageurs à chercher un abri. Le froid était assez intense pour qu’on pût s’imaginer être dans la haute montagne et si l’on regardait au dehors, on voyait se mouvoir dans l’atmosphère neigeuse et grise, des masses de glace qui, en d’étranges silhouettes mouvantes, glissaient sur l’eau et n’étaient pas sans ressembler aux nuages qui flottent sur les pentes des montagnes.
Peter Wik était fort gai, et l’étranger, – M. le comte, comme l’appelait la gouvernante, – semblait aussi enjoué que le brave marin. La gouvernante tâcha de rendre tout aussi confortable que possible. Il y avait, très haut sur une planche, deux vieux plats. Elle les nettoya dans la neige et ils servirent à la fois de pot à traire et de marmite. Le bouvier apporta du lait frais et, dans les réserves du traîneau, on trouva de la viande froide et deux bouteilles de vin. Le feu pétillait et répandait une chaleur joyeuse, tandis que le vent secouait les vitres et que la neige tourbillonnait au dehors.
Christian s’approcha avec de grandes précautions et rassembla mieux la couverture et le manteau autour de Noémie. Elle n’était pas encore revenue de sa frayeur et le fixait de ses grands yeux noirs.
Peter Wik, assis devant la cheminée, faisait des gestes d’amitié à la gouvernante.
– Allons, ma petite dame, ça va mieux, disait-il, je n’aurais jamais pensé que nous nous retrouverions si vite sur mer.
– Mais savez-vous que sur terre nous ne sommes pas loin les uns des autres ? répondit-elle ; votre bateau est juste sous nos fenêtres, je vous ai souvent vu le matin sur le pont et le soir j’entends votre violon.
– C’est votre violon que j’entends ? demanda le comte. Vous êtes un musicien très original. J’ai souvent écouté vos fantaisies.
– Oui, c’est mon violon, dit Peter Wik, mais je ne me suis jamais spécialisé dans les fantaisies. C’est ce garçon-là que vous entendez. Il ne sait aucun morceau convenablement, alors il passe de l’un à l’autre. Je lui dis parfois que c’est comme un repas de samedi composé de tous les restes de la semaine.
– Ah ! c’est lui ! dit le comte, il a du talent. Tu aurais dû te consacrer à la musique, tu y aurais peut-être trouvé le bonheur.
– Peut-être, dit Peter Wik, mais voyez-vous, monsieur, quand on n’a que du sel et du pain à la maison, il ne sert de rien de rester là à se demander quel rôti on préférerait.
Et puis il raconta à sa façon l’odyssée de son mousse.
– Mais tu es un petit aventurier, dit le comte avec un sourire.
Christian sentait battre son cœur tandis que le comte l’examinait, mais il lui eût été impossible de prononcer une parole. Si seulement Noémie avait dit : « Je le connais aussi, nous avons joué ensemble », mais elle restait muette et le fixait de ses yeux sombres.
Le soleil se couchait, il enflammait de rouge les nuages déchirés.
La vue de la mer avait quelque chose de tragique. Vers Sjaelland la grande surface de glace blanche était brisée et dispersée dans toutes les directions, on eût dit une grande carte illuminée dont les fleuves, les montagnes et les frontières, étaient indiqués par des traits sombres.
De continuels craquements faisaient flotter du côté de la Suède d’immenses blocs de glace qui semblaient du verre fondu, se choquaient les uns contre les autres, et naviguaient ensuite sur l’eau verte et tumultueuse.
Dans la maison on apprêtait tout pour la nuit. Noémie et la gouvernante avaient les coussins de la voiture pour se coucher, les hommes durent se débrouiller comme ils le purent.
Lorsque le comte revint de sa promenade nocturne, il les trouva tous endormis, sauf Christian qui entretenait le feu.
– Ne vas-tu pas dormir, mon enfant, dit le comte.
– Je ne peux pas, répondit Christian.
Le comte s’approcha de lui.
– Alors c’est toi qui joues le soir dans la cabine sombre. Aimes-tu mieux la mer ou la musique ?
– La musique, dit-il les yeux brillants.
– Eh bien, si tu as du talent comme tu le crois, il se montrera bien un jour. Ne te désole pas parce que tu es pauvre : la plupart des grands musiciens l’ont été, mais ne deviens pas orgueilleux, si plus tard tu t’élèves au-dessus de la masse des hommes.
Et il parla longtemps du sort des artistes, sans se douter qu’il venait d’attacher les ailes d’Icare aux épaules du génie, des ailes hardies, mais des ailes de plomb. Il n’avait fait qu’éveiller plus ardemment le désir de Christian d’apprendre la musique.
Christian ne s’endormit que vers le matin et il fut réveillé peu après par Peter Wik qui lui apprit que le vent avait tourné, que la glace s’était reformée et qu’il fallait profiter du moment pour rejoindre Amager. Le traîneau fut attelé et on fit les préparatifs de départ. Le bouvier poussa son troupeau devant lui, car si la glace portait le troupeau, elle porterait aussi le léger traîneau avec Noémie et la gouvernante.
Le convoi s’ébranla. La glace craquait autour d’eux. À plusieurs endroits ils durent faire un détour pour éviter les crevasses ouvertes. Noémie tremblait et fermait les yeux de terreur.
– Nous sombrons, disait-elle à Christian qui avait pris place à l’arrière du traîneau.
Et elle passa son bras sous le sien.
– Ne te souviens-tu pas du tout de moi ? dit-il à Noémie, lorsque l’église d’Amager sembla se rapprocher, car là il faudrait se quitter.
– Si, dit Noémie, mais bas aussi et ses joues pâles devinrent roses. Tu es entré dans le salon le jour de ma fête !
– Mais à Svendborg ?... commença-t-il.
– Ah ! oui, dit-elle, mais il y a longtemps. Et se tournant vers la gouvernante
– Nous voilà bientôt à terre ! – tu ne parleras pas ! – Comme il fait froid !
Et elle attacha son foulard plus étroitement.
Christian descendit et suivit le traîneau. Sans savoir au juste pourquoi, il se sentait si triste qu’il eût voulu se coucher sur la neige et dormir durant des années comme dans les contes de fées.
XVIII
ADIEU, PETER WIK
– Dans quinze jours nous serons partis, dit Peter Wik. On en a assez comme ça des plaisirs de Copenhague.
Ils devaient retourner à Svendborg le 1er mars. Christian avait un étrange sentiment d’angoisse, un déplaisir brûlant à la pensée de revoir son foyer. Le souvenir lui en semblait un vilain rêve. Il aurait voulu rester à Copenhague où le bonheur lui sourirait sûrement un jour.
– Si je me perdais dans le tourbillon des rues, pensait-il, comment m’y retrouverait-on ?... Il faut que je le fasse le dernier jour pour qu’on n’ait pas le temps de me chercher. Mais, qui s’occupera de moi ? Pourtant, si je suis tout à fait abandonné, on ne me laissera pas mourir ! Dieu ne le voudrait pas.
À mesure que cette résolution mûrissait de plus en plus dans son âme, il sentait combien elle était ingrate envers Peter Wik qui avait été si bon et charitable envers lui. Mais il songeait : « Peut-être le comte n’attend-il qu’un pareil geste pour être entièrement- persuadé de la profondeur de ma vocation. Si j’ose, il m’aidera sans doute. » Exalté par cette pensée, il prit la résolution de quitter le bateau dans la nuit qui précéderait lé matin où il devait lever l’ancre. Notre Seigneur aviserait pour le reste.
Or, le dernier après-midi que le bateau était dans le port, Christian était assis près de l’ancre et regardait la maison de Noémie. Les plus magnifiques fleurs du printemps garnissaient les fenêtres. Les plantes du Midi n’ont pas, aux yeux de l’étranger, de plus riches couleurs que celles-ci n’en avaient pour le petit mousse. Au milieu de sa misère, à la veille d’être plus abandonné encore, il se représentait le magnifique château qu’il se construirait quand il serait riche ; il imaginait chaque fenêtre, comme celle-ci, garnie de fleurs et Noémie assise sur l’or et la soie au milieu de ces merveilles. Puis il pensa à Peter Wik : ce soir était le dernier qu’ils passaient ensemble. Et ceci lui pesait comme une pierre sur le cœur.
– Tu vas rentrer à Svendborg, lui dit Peter Wik, et Lucie te reverra avec plaisir. Tu l’aimes bien, n’est-ce pas ?
– Oui, beaucoup, répondit Christian.
Et la tension de ses nerfs se donna libre cours dans des larmes.
– Pourquoi diable pleures-tu ? demanda Peter Wik. Tu es sans doute rassasié d’eau salée et moi je ne veux plus te garder sur mon bateau.
Christian se sentit envahi d’une sueur brûlante. Il avait bien pensé quitter Peter Wik, mais l’idée que celui-ci pût l’abandonner ne lui avait jamais traversé l’esprit. Ces mots lui causèrent une grande frayeur.
– Je ne te jette pas par-dessus bord, dit Peter Wik en l’attirant amicalement contre lui. Tu es un bon garçon, je me suis pris d’affection pour toi, mais tu n’aimes pas beaucoup la mer, cela je l’ai bien remarqué.
Christian aurait voulu pouvoir dire le contraire. Est-ce que Peter Wik savait tout ? Savait-il que Christian, cette nuit, voulait s’enfuir du bateau ? Le pêcheur, la conscience lourde, regardait à terre.
– Cette nuit que nous avons passée à Saltholm, reprit Peter Wik, cette nuit où tes regards fixaient le feu et où tu confiais au comte ton rêve de devenir un serviteur du diable, Peter Wik ne dormait pas parce qu’il avait les yeux fermés. J’ai entendu toutes ces sottises qu’il t’a fourrées dans la tête et que tu étais assez bête pour croire. J’ai entendu aussi comment tu faisais ta confession et comment tu le suppliais. C’était bien stupide de ta part. Et c’est pourquoi je te donne congé. Je ne peux plus t’employer. Mais comme je n’ai tout de même pas le courage de t’envoyer à tes parents, je vais te mettre chez M. Knepus, à Odense, ça c’est un homme qui pourra t’apprendre quelque chose, il s’y connaît, en musique, et nous verrons ce que tu deviendras.
Christian lui pressa les mains.
– Si seulement tu pouvais t’arrêter de pleurnicher, dit Peter Wik, si tu pouvais faire quelque chose de bien dans la vie, j’en serais content. Mais matelot, tu ne le seras jamais.
Christian avait envie de pleurer à la pensée de ce qu’il avait projeté dans la nuit. Cela lui pesait sur le cœur, mais il n’osait libérer sa conscience en avouant sa faute. Il allait apprendre la musique, il allait vivre pour la musique ! Son plus cher désir allait être réalisé et l’aide lui venait de Peter Wik dont il n’avait jamais rien espéré.
Il s’agenouilla dans le coin sombre, jeta un baiser dans l’air et remercia le Dieu compatissant.
Au petit jour la corde glissa le long du quai : Lucie prenait la mer. Christian regarda d’un œil joyeux et pourtant avec regret les fenêtres de Noémie.
– Sans doute aujourd’hui parlera-t-elle à M. le comte et à tout le monde, là-haut, de son départ.
Et le navire sortit du port.
– Le bateau est parti, dit la gouvernante lorsqu’elle regarda par la fenêtre.
– Tant mieux ! dit Noémie ; alors, le garçon est parti aussi. Il était si indiscret, si insolent ! Quand j’étais petite, je l’ai vu, ses parents- habitaient près de chez nous et il a joué une fois avec moi. Un grand nombre d’années ont passé et le voilà qui entre en coup de vent dans notre salon ! Il n’a sûrement pas toute sa raison. Tu ne peux savoir ce qu’il m’a tourmentée sur la glace lorsque nous revenions de Skaane. Cela m’a vivement peinée d’être si peu aimable pour lui, mais je n’ai pu faire autrement.
– Ce serait pourtant intéressant s’il avait du génie et s’il arrivait à percer. Claus Schall, qui a composé la jolie musique du ballet de Galcotti, était un pauvre garçon lui aussi, il entra à l’école de danse du théâtre, devint figurant et il est maintenant un célèbre compositeur.
– C’est comme dans un roman, dit Noémie. Mais j’espère que ces gens seront malheureux dans leur vieillesse. Ce serait bien plus amusant !
DEUXIÈME PARTIE
I
L’EXTRAORDINAIRE M. KNEPUS
Transportons-nous maintenant à Odense, la ville capitale de l’île de Fyen ; elle était alors plus curieuse qu’aujourd’hui. Il y avait plusieurs vieux châteaux aux murs épais avec des bas-reliefs au-dessus des fenêtres et de solides escaliers aux rampes de granit. Des maisons ornées de sculptures offraient aux dames de la bourgeoisie la grâce de leurs terrasses.
Dans une de ces maisons habitait M. Knepus. Un habit roux composé d’une culotte, d’une veste et d’une redingote ornée de grands boutons de métal qu’il était défendu de brosser, formait son accoutrement habituel. Une perruque à catogan, un chapeau marquis et une grande canne à pommeau d’ambre complétaient cet ensemble.
Un jour d’avril, Christian, muni d’une lettre de recommandation de Peter Wik, son petit baluchon sous le bras, frappait avec le marteau de fer à cette porte toujours close.
Une dame mince, aux rubans flottants mais un peu sales, vint ouvrir. C’était Mme Knepus.
– C’est le petit protégé de Peter Wik, dit-elle.
Elle lui serra la main et avec un flot de paroles de bienvenue, le conduisit le long d’un couloir où l’on avait laissé tomber des fragments de nourriture que l’on n’avait pas ramassés, mais sur lesquels on avait jeté de la sciure fraîche. Deux vieilles gravures achetées lors de la démolition de l’église des frères gris et quelques pierres tombales ornaient les murs nus ; on ne savait pas bien si l’on entrait dans une chapelle ou dans une maison d’habitation.
– Nous vivons une vie tranquille, dit-elle, la fête du tir et l’anniversaire du roi sont les deux seules fêtes auxquelles Knepus prend part.
L’homme vint alors. Il avait un sale bonnet de nuit sur sa tête complètement chauve et portait autour de la taille une ceinture de cuir. Un caleçon couvrait ses jambes maigres.
Les époux se disaient ostensiblement a vous ».
Mme Knepus avait préparé pour Christian la mansarde donnant sur le jardin. C’était, au fond, la bibliothèque et la chambre aux provisions, mais il fallait savoir s’arranger et la digne femme avait trouvé que c’était là qu’il serait le mieux.
– J’ai tout arrangé à ravir, dit Mme Knepus en le conduisant à sa chambre. Dans le tiroir vous pourrez mettre votre linge propre et, sous le lit, se trouve un sac où vous mettrez le linge sale. M. Knepus descend toujours à la pompe pour faire sa toilette, mais un jeune homme doit avoir ce qui est d’usage. Voici une bouteille à bière avec de l’eau, vous pourrez vous la verser sur les mains par la fenêtre. Plus tard, nous aurons une cuvette. Nos glaces sont trop grandes pour la chambre, il faudra vous contenter de cette boîte qui a un verre sur le couvercle.
À partir du lendemain, les journées de Christian furent divisées de façon judicieuse. On lui avait monté dans sa chambre un vieux clavecin dans le couvercle duquel on voyait des bergers et des bergères danser au son de la flûte et du hautbois. Oh ! comme il aurait voulu, ne fût-ce que d’une main, jouer une rapide et joyeuse mélodie, mais les notes du cahier montraient leurs grosses têtes et disaient comme M. Knepus : « toujours lentement ! toujours lentement ! » Les noms de Bach et Haendel, qu’il ignorait auparavant, résonnaient maintenant fréquemment à ses oreilles comme des noms de saints. Ah ! comme il avait beaucoup de choses à apprendre et à entendre sur la terre !
Le mois de juin amena la fameuse fête du tir qui conserve encore de nos jours à Odense tout son caractère. Au matin, les honorables bourgeois sortent de la ville au son d’une musique turque. On dresse des arcs de triomphe, la porte est de la ville est ornée de fleurs et d’inscriptions. Toutes les écoles et les ateliers sont fermés et au soir, quand revient le cortège, toutes les fenêtres de la grande rue sont remplies de spectateurs.
Ce fut ce jour-là justement que Peter Wik vint en ville pour rendre visite à Mme Knepus ou plutôt voir comment Christian se comportait.
– Knepus est à la fête du tir, dit Madame, il faut que vous y veniez avec moi. Christian aussi y est. Vous verrez comme le nœud vert à sa casquette lui sied bien. C’est lui qui portera la coupe d’argent du gagnant en avant du cortège.
À cet instant, la bonne apparut tout essoufflée : le petit garçon de la blanchisseuse était venu dire que sa mère savait, par le gardien qui maintenait les cordes, que M. Knepus avait tiré juste à côté du point central et que personne autre que l’armurier n’aurait pu l’égaler, et comme l’armurier avait déjà tiré, M. Knepus serait le gagnant, le roi.
– Oh ! non, dit Madame remplie de joie, j’aime mieux qu’il ne soit que kronprinz, car c’est si cher d’être roi ; il faut offrir à boire à tous. Le kronprinz reçoit une louche et nous en avons justement, besoin.
– Il faut y aller, dit Peter Wik, je conduis la reine. Et il prit Madame sous le bras.
– Allons tout doucement, car mes jambes ne sont plus faites que pour suivre les processions.
Lorsque le tir fut terminé, la cible fut, selon la coutume, vendue aux enchères, puis portée en ville par les gamins des rues. Six des plus grands et des plus forts, après avoir bu un bon coup, la prirent sur leurs épaules ; deux hardis camarades sautèrent sur elle et furent portés en triomphe à travers la ville, suivis par tout le reste de la troupe qui jubilait.
Le roi du tir et les deux autres gagnants, le kronprinz et le prince cadet, marchaient devant avec de grandes bannières garnies de plaques d’argent. Christian portait fièrement la coupe devant M. Knepus.
– C’est mon mari ! fut tout ce que Mme Knepus put dire.
– Oui, il a la coupe, dit Peter Wik, il faudra qu’il paye à boire à tout le monde.
Christian regardait joyeux vers les fenêtres et vers la foule mouvante.
Sur les marches de pierre, le peuple se tenait serré comme des têtes de houblon et tous les visages rayonnaient de plaisir. Dans un coin où la foule était particulièrement dense, un homme au visage pâle et maladif fixait les yeux sur Christian et lui faisait des signes d’amitié.
– Seigneur Jésus ! soupira le garçon en baissant les yeux vers la terre.
C’était sou père qu’il venait de voir, son père qui était mort à la guerre. Christian regarda encore une fois de ce côté. Oui, tout là-haut, sur l’escalier, il y avait bien son père dont on avait pleuré la mort. Les mains de l’enfant tremblaient, la coupe lui échappa presque. La joie autour de lui lui paraissait abominable.
Le cortège s’avançait vers le club où la fête devait se terminer par un immense banquet. On y boirait à la santé de tous et les trompettes résonneraient à travers les fenêtres ouvertes tandis que l’un des plus pauvres, habillé en arlequin, le visage noir et le hochet à la main, ferait de son mieux pour entretenir la gaieté.
Dès que le cortège fut arrivé au club, les garçons portant la cible sur laquelle étaient encore perchés les deux gamins, traversèrent les rues jusqu’à la maison du roi des tireurs où Madame s’inclina devant eux, puis ils allèrent chez le bourgmestre et chez le chef de la garde nationale, suivis de la foule qui agitait des branches vertes.
Christian était au cour de la fête : le salon du club. Des centaines d’enfants de son âge. lui enviaient son bonheur, mais lui restait étranger à cette joie. Il revoyait toujours, pétrifié comme une tête de méduse, le visage pâle et souriant qu’il avait aperçu tout à l’heure.
– C’est mon père que j’ai vu, et cependant il est mort et ma mère est remariée. Ce n’était pas une ressemblance de hasard, non, c’était lui, il me regardait et me faisait signe. Oh ! c’est terrible !
Onze heures étaient passées lorsqu’il rentra dans sa petite chambre solitaire. Il regardait dans chaque coin de la pièce avec une crainte inaccoutumée. Il ne pouvait dormir et il entendit chaque quart d’heure sonner à la tour de l’église jusqu’à ce qu’il fût minuit.
II
TROIS OUVRIERS QUITTENT LA VILLE
Il faisait grand jour lorsque Christian s’éveilla en s’entendant appeler par son nom. Il ouvrit les yeux. Peter Wik était devant lui et il reconnut la silhouette qui était derrière : oui, c’était son père, son père qui était mort.
– C’est moi, dit Peter Wik, et où tu me vois il ne peut y avoir de fantômes. Ton père n’est pas mort, le voilà bien vivant. Je n’osais pas le laisser entrer seul chez toi, tu n’es pas un héros, il y a du sang de tailleur en toi. Je vous demande pardon, dit-il au tailleur en lui prenant la main.
Le père pressa son fils sur son cœur et pleura comme le matin où ils s’étaient quittés.
À midi seulement, à table, on apprit comment les choses s’étaient passées.
– Personne ne savait, dit le tailleur, que dans la mêlée je fus arraché de ma place et pressé contre un cheval suédois qui avait perdu son cavalier. J’étais tellement serré que je pouvais seulement remuer les doigts près de la sangle. Tout- commençait à s’assombrir pour moi, lorsque les Suédois essayèrent d’obtenir un peu d’air par un mouvement en arrière. J’étais sur le point de tomber à genoux et j’aurais été alors piétiné ; j’usai de toute ma force et réussis à grimper sur le cheval. Je fus fait prisonnier et moi qui voulais aller dans le Midi, je dus éprouver les froids d’hiver du steppe russe, des froids comme nous n’en connaissons pas au Danemark. On pourrait écrire toute une histoire là-dessus, mais je raconterai seulement comment j’en suis sorti et comment j’ai pu revenir. J’ai appris là-bas combien il fait bon ici, oui, on trouve le Danemark un pays d’éternel printemps, quand on a gelé dans les bois de pins de la Russie.
« À la fin de la guerre on m’a remis en liberté, j’ai écrit à la maison, mais ma lettre n’a pas dû arriver. J’ai recommencé à vagabonder, puis la fièvre s’étant emparée de mon corps pendant neuf mois, je suis resté à l’hôpital de Mitau. De là j’envoyai par un compagnon une lettre à Libau, pour qu’elle prenne le premier bateau danois, mais elle a dû s’égarer aussi. Je pensais à la campagne de Fyen, je pensais aux heures de bonheur que j’y avais vécues, Maria me manquait, et toi aussi mon garçon. Je ressentis un amer chagrin de vous avoir quittés. Durant presque trois ans je n’avais eu de vos nouvelles. J’allais à pied de Mitau à Libau et n’y trouvais pas de bateau. Je me rendis à Memel et ensuite à Königsberg.
Alors, m’embarquant sur le premier bateau, j’arrivai à Helsingor, traversai le Sjaelland et atteignis Fyen. Ah ! j’étais heureux comme un enfant. J’arrivai à Œrebœk, j’avais faim. Je comptais me reposer chez le riche paysan dont j’avais remplacé le frère au régiment et qui me donnerait toutes les nouvelles de Svendborg. J’entrai dans la salle, le paysan était là, berçant un tout petit bébé.
« – Seigneur Jésus ! dit-il en me voyant, et cela sur un ton si étrange que j’en fus moi-même saisi.
« – Ma femme est-elle morte ? demandai-je.
« Alors il me prit la main, me pria de quitter immédiatement la maison, d’aller dans la campagne.
« – Voilà de l’argent, me dit-il, comment pouvait-on supposer que tu étais vivant ? Maria est ma femme, l’enfant que tu vois là est le sien et le mien. La voilà qui vient, qu’elle ne te voie pas !
« Et il me tira vers le jardin. Elle ne vit pas mon visage, malgré que je ne me fusse pas retourné.
« Qu’elle ait pu se marier aussi vite ! Je sais ce que je ressentis, mais de cela je ne dis rien. Je demandai après toi, mon garçon, et j’appris que Dieu t’avait rendu en bien ce que j’avais souffert. J’allai trouver Peter Wik et vins ici avec lui.
– Il faut prendre la vie telle qu’elle est et pas telle qu’elle devrait être, dit Peter Wik. Je veux faire de Christian un brave homme qui puisse épouser plus tard Lucie si elle le veut. Elle a appris de son père l’allemand et. l’histoire et elle est maintenant en apprentissage à Odense pour apprendre la coupe.
Le soir, le père fit ses adieux à Christian qui l’accompagna jusque dans la rue où était son auberge.
– Au revoir ! mon garçon ; quand tu verras la cigogne s’en aller ou venir, pense à moi. Chaque fois que je vois cet oiseau, moi je pense à notre petite chambre de Svendborg d’où nos regards s’élevaient vers le nid. Adieu ! mon cher enfant.
Et il l’embrassa sur les yeux pleins de larmes.
Le lendemain, au lever du soleil, trois ouvriers quittèrent la ville par la porte de l’est. Ils allaient à Assens pour gagner par le bac le Slesvig et l’Allemagne. L’un de ces trois ouvriers était le père de Christian.
III
LA FÊTE AU CHÂTEAU
Autour du château d’Odense il y a un sentier qui conduit d’un bout de la ville à l’autre. Christian et Lucie prenaient souvent ce sentier lorsqu’ils se rendaient visite.
– On croirait, dit un jour Lucie, alors qu’à l’horizon, là-bas, apparaissait déjà le soleil, on croirait qu’il descend sur la campagne tout exprès pour nous. S’il venait vraiment et n’était pas plus grand qu’il n’en a l’air, j’irais bien lui rendre visite.
– Et moi je ferais des lieues pour aller le voir, reprit Christian. Mais je voudrais être le premier et il ne faudrait pas que d’autres s’y hasardassent après moi. Toute la terre en parlerait et mon nom serait dans les journaux.
– Qu’est-ce que cela pourrait te faire ? dit Lucie. Au fond, tu es très vaniteux.
– Non, ce n’est pas de la vanité, comment peux-tu t’y tromper ? Si j’avais un ballon et que je puisse voler plus haut que nul homme ne l’a fait, je ferais des découvertes. Si j’étais marin et si j’avais le pouvoir de décider moi-même où j’irais, j’aurais fait des sondages dans la grande mer ou j’aurais navigué jusqu’au pôle par-dessus la glace éternelle.
– Quand tes doigts auraient été bleus de froid, tu serais bien revenu, dit Lucie.
– Tu ne me connais pas du tout. Je ne suis pas un héros pour les petites choses, certes, mais s’il arrivait un évènement important, tu peux être sûre que j’aurais du courage. J’ai peur de traverser le canal dans un petit bateau plat, mais je ne craindrais pas de traverser dans ce bateau les grands océans du monde si c’était pour quelque chose d’utile. J’ai peur d’une vache qui pourrait me donner un coup de corne, mais si j’allais en Afrique, j’irais avec les autres à la chasse au tigre, car cela vaut la peine d’y risquer sa vie ! Qu’on dise : il s’est noyé dans le canal d’Odense ! Une vache l’a tué d’un coup de corne ! Il n’y a là rien de glorieux. Je ne voudrais risquer ma vie que pour quelque chose d’exceptionnel.
– Mais pourquoi veux-tu être autrement que les autres ? répondit Lucie, remercions Dieu pour ce qu’il nous a donné. Prions-le, pour que nous ne perdions jamais ce bien. C’est plus important que de voler vers le soleil ou d’aller au pôle Nord. Notre Seigneur nous a tant bénis que c’est certainement pécher que de désirer plus que ses bontés habituelles.
– Mais j’ai de plus grandes ambitions quand même, dit Christian dans l’ardeur de la jeunesse. Je veux être célèbre, sans cela la vie ne vaut pas la peine d’être vécue.
– Comme tu es enfant ! dit Lucie.
Et ils se dirent au revoir.
Après une conversation de ce genre, Christian la quittait toujours avec des sentiments moins favorables, mais au bout de quelque temps il n’y pensait plus. Il sentait bien qu’elle avait un peu raison et cela le vexait. Chaque parole orgueilleuse qu’il avait prononcée pesait lourdement sur son cœur. Dans la solitude il demandait pardon à Dieu et trouvait par là quelque apaisement, mais ensuite, comme beaucoup de catholiques après l’absolution, il recommençait à pécher.
. Durant tout un mois, cet hiver-là, il fut question d’une fête qui devait avoir lieu au château du comte, situé à quelques lieues de la demeure de M. et Mme Knepus. Depuis cinq années, le maître n’avait pas passé un hiver dans sa propriété de Fyen et par conséquent aussi, il y avait cinq années que les artistes et les notabilités de la région n’avaient célébré son anniversaire dans le magnifique château.
M. et Mme Knepus étaient tous deux très économes, ils louèrent un vieux carrosse dans lequel ils fourrèrent les provisions et la boîte à violon, puis ils prirent place dans le fond, ayant Christian entre eux deux, et, en face, un officier et sa femme, leur enfant et la bonne d’enfant, et par-dessus le tout, pour leur tenir chaud, un édredon de plumes. On accrocha une petite lanterne, juste au-dessus de la tête de Christian.
On voyageait la nuit afin d’être au château le matin et comme on en repartait le soir, il n’était pas nécessaire de coucher en route ; on louait la voiture pour douze heures de moins et on réalisait ainsi une grande économie. Dans une voiture fermée on dort à ravir, et cette promenade nocturne rappelait à M. Knepus ses voyages en chaise de poste à travers l’Allemagne du Nord, il y avait bien longtemps.
Ils roulaient rapidement dans la nuit. Christian était aux anges. On s’arrêta plusieurs heures à un cabaret de village, à quelque distance du château afin de ne pas arriver de trop matin.
Les nuages roses de l’aube, la neige et les pins, composaient un magnifique spectacle. Près d’une forge, au sommet d’un peuplier, il y avait un nid de cigogne vide. À cette heure, le propriétaire de ce nid prenait peut-être son déjeuner du matin dans les eaux du Nil, sous le soleil brûlant. Christian regardait le nid avec un sentiment mélancolique, comme celui que nous éprouvons à retrouver dans un livre de cantiques une fleur séchée que nous avons cueillie des années auparavant, dans un endroit aimé.
Ils arrivèrent enfin au château. Tout ce qui appartient au protocole des plaisirs d’hiver d’un château danois, on le trouvait ici. Dans les fossés les canards nageaient autour d’un mât supportant le drapeau danois. Dans la petite allée de noisetiers qui descendait des remparts, il y avait une glissade et, sur la grande pelouse, se tenaient deux grands bonshommes de neige aux yeux de charbon et aux boucliers de glace. Une baguette de houblon arrosée d’eau était leur lance. Entre les deux on avait placé le canon qui devait tirer au moment où l’on boirait la coupe de bienvenue.
Des amateurs, parmi lesquels étaient des prêtres et un bourgmestre, jouaient sous la direction de M. Knepus dans une pièce voisine de la grande salle et séparée d’elle par une draperie. De riches présents se trouvaient sur la table et, au milieu d’eux, on voyait un tableau de fleurs exécuté par Noémie, non d’après nature, mais d’après trois autres tableaux de fleurs.
Noémie elle-même, au milieu de la cour, formait la figure centrale d’un tableau plus intéressant encore.
La fine jeune fille, ni enfant, ni femme, ayant la grâce de l’une et la beauté de l’autre, se tenait debout près d’un des chiens de garde, grande bête féroce qu’elle aimait particulièrement. L’animal posait ses grosses pattes noires sur l’épaule blanche, sa langue rouge pendait hors de sa gueule. La jeune fille n’aurait fait pour lui qu’une bouchée, mais il se contentait de remuer la queue tandis qu’elle riait. Ils étaient les meilleurs amis du monde.
– Quelle sauvage enfant ! dit la vieille comtesse, elle me fera mourir de peur un jour, car ma vie ne tient qu’à un fil ! Tantôt elle lâche cette bête sauvage qui pourrait manger les gens, tantôt elle monte sans selle le cheval le plus difficile et parcourt les champs et les prés. Notre Seigneur est bon pour elle, sans cela elle serait depuis longtemps estropiée. Si j’avais seulement le quart de son exubérance, cela me vaudrait mieux que toutes ces drogues et ces mixtures.
Cependant, un violon solo joua, et le coup d’archet étrangement hardi attira l’attention générale.
– Charmant ! cria la vieille comtesse, oubliant combien elle se croyait malade.
Noémie écarta la draperie et juste devant eux, près du pupitre bas, se tenait l’élève de M. Knepus, Christian.
– Nous nous sommes déjà vus, je crois ? dit le comte. Mais où ?
– À Copenhague, répondit Christian d’une voix basse.
– On me l’a confié, dit M. Knepus.
Les applaudissements et les encouragements furent immenses. Noémie elle-même souriait de la façon la plus ensorcelante et elle parla longtemps avec lui, mais pas des heures passées.
Quel jour de joie et de bonheur ce fut pour lui ! On alla jusqu’à la glissade du jardin avec Noémie, elle était hardie comme un garçon. Christian se tenait à l’écart.
– Vous n’osez pas ? dit Noémie ; et il s’aventura sur la glissade, mais il tomba aussitôt, sans que sa chute eût d’autres suites que d’entendre Noémie dire à son voisin : « Qu’il est lourdaud ! » Cela le rendit muet, il n’osait parler, mais ses yeux étaient fixés sur elle.
Il lui fallut jouer encore une fois avant le dîner et cela le remit dans son élément. La vieille comtesse s’entretint avec lui et lorsqu’elle sut qui il était, elle lui parla de sa maladie passée et de Lucie. Il semblait même que son intérêt pour lui était plus grand à cause de son ancien mal qu’à cause de son violon. Elle insista pour qu’il restât trois jours au château, ajoutant qu’il retournerait à Odense avec le comte qui devait y passer en allant en Angleterre.
Au dîner, la table était ornée de fleurs, les serviettes, d’une éblouissante blancheur, se dressaient comme des éventails dans les flûtes à champagne. Les lumières jaillissaient de magnifiques candélabres d’argent. À l’instant où chacun des convives choisit sa dame, Noémie s’envola d’eux comme un oiseau et s’approcha de Christian.
– L’artiste veut-il être mon cavalier ? dit-elle en glissant son bras sous le sien.
Et elle le conduisit à table. Le sang lui monta aux joues, il se sentait tout gauche. Noémie murmura à la gouvernante :
– C’est comme cela que nous serons assis dans l’autre monde, l’oiseau de paradis et la corneille, côte à côte. Mais il faut distraire votre dame, dit-elle à Christian, autrement, vous serez la dame et moi le cavalier.
Et elle lui versa à boire.
Il la sentait supérieure à lui comme aisance et gaieté, supérieure en tout. Il y avait de la moquerie, mais tout de même une sorte d’amitié dans tout ce. qu’elle lui disait. Il était à elle de toute son âme et cela lui apparaissait de plus en plus. Elle lui versait constamment à boire et il buvait verre après verre sans y faire attention. Le sang coulait plus rapide dans ses artères, il prit un peu d’aisance, il se secoua, comme disait Noémie.
Près d’eux était assis un jeune homme blond, Louis, le fils du chef de la police. Au milieu des douleurs de la jalousie, il mangeait comme quatre, moyen le plus efficace pour combattre un amour malheureux. Noémie lui faisait bien voir comme elle soignait Christian.
– À ta santé ! murmura-t-elle en choquant son verre contre le sien.
– À la vôtre ! dit Christian. Le vin avait délié sa langue.
On se leva, Noémie lui échappa. Abandonné, il se mit à l’écart, il n’osait s’approcher d’elle, il sentait profondément qu’il lui manquait bien des choses pour être un homme du monde. On dansa, il ne pouvait prendre part à la danse car il ne savait pas faire un pas. Noémie volait comme un papillon à travers le salon, le mouvement la rendait encore plus jolie, le sang colorait ses joues fines, l’éclairage faisait valoir son teint sombre. Elle était très belle, seulement trop finement bâtie pour une enfant du Nord.
– Elle se rendra malade à danser, dit la vieille dame. Le sourire doucereux, de M. Patermann, le pasteur, disait qu’il était de l’avis de la dame.
Noémie ne semblait plus faire attention à Christian, Louis le blond était son heureux élu ; mais il est vrai que Christian ne savait pas danser. Tout à coup, elle arriva devant lui, elle lui mit les mains sur les épaules et l’entraîna dans une valse tourbillonnante. Tout tournait autour de lui, mais il ne pouvait la lâcher. Il lui marchait sur les pieds, il cognait ses genoux contre les siens.
– Cela me fait trop mal ! soupira-t-il.
Et elle le laissa tomber sur une chaise, rit de lui et voltigea avec un autre danseur à travers le salon.
Un écrivain américain raconte que lorsque l’élan se sent blessé à mort par le chasseur, il abandonne les siens pour mourir solitaire, un pareil instinct fit s’éloigner Christian ; tandis que les autres volaient, l’oiseau blessé repliait ses ailes.
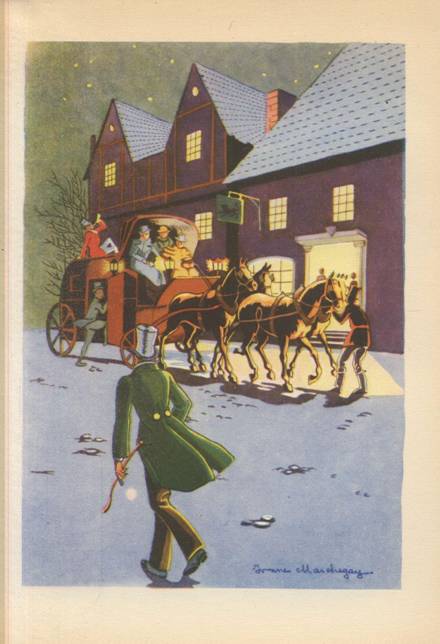
Le domestique le conduisit avec une chandelle allumée à travers la cour vers les anciens bâtiments : dans les nouveaux, toutes les chambres d’amis étaient prises. À travers un porche étroit, ils arrivèrent par l’escalier en colimaçon à une petite pièce aménagée en hâte pour passer la nuit.
– Voici la chambre à coucher, dit le valet. Et voici la dame du logis qui veillera sur vous durant votre sommeil, ajouta-t-il en riant et il éclaira au-dessus de la porte le portrait d’une dame en costume moyenâgeux portant autour du cou une chaîne de fer qui lui pendait sur la poitrine.
– C’était une maîtresse femme, dit le valet, elle n’avait certainement pas une pharmacie aussi importante que celle de la vieille comtesse. Elle était en guerre avec un seigneur voisin et il la fit prisonnière ; il lui mit une chaîne au cou et la fit attacher au chenil. C’était comme ça qu’on faisait dans ce temps-là, ajouta-t-il. Puis le seigneur but et se livra à toutes les débauches. Mais la dame trouva moyen de s’échapper. Elle rentra chez elle, rassembla son peuple et revint sur l’ennemi. C’est pourquoi elle s’est fait peindre avec une chaîne de chien.
Le valet s’en fut et Christian resta seul avec le portrait de la vaillante dame.
Le soleil rayonnait sur le portrait de l’ancienne maîtresse du logis, quand Christian s’éveilla. La lourde chaîne de fer, attachée autour du cou de la dame, occupait ses pensées.
– Moi aussi, soupira-t-il, je porte une chaîne semblable ; je ne suis guère mieux qu’attaché au chenil, tandis que les autres sont joyeux au salon. Mais je briserai aussi la chaîne et me présenterai un jour en grand artiste devant eux et ils s’inclineront devant la puissance de mon génie. Alors, à mon tour, je commanderai mon portrait, mais non avec un insigne marquant le joug que j’ai porté, non, la main dans celle de Noémie. Elle est si belle, aussi belle que les anges du Seigneur, mais pas aussi bonne. Mais qui peut l’être sur cette terre, en vérité ?
Et il se mit à genoux, fit sa prière et demanda à Dieu que son rêve s’exauçât.
Au cours de la matinée, la comtesse voulut revoir tous les hôtes qui étaient restés. Le chocolat les attendait dans l’aile du château où seuls vivaient encore la vieille dame et ses domestiques.
On accédait à sa chambre à travers la tour et par l’escalier en. colimaçon. Une tapisserie verte représentant une forêt, où des têtes de cerf se montraient de-ci de-là entre les arbres, garnissait les murs. Un grand poêle s’élevait devant la cheminée garnie de sphinx taillés dans la pierre. À travers un immense placard caché par des draperies, on descendait aux chambres de l’étage au-dessous. Les chaises et le divan avaient conservé une allure ancienne ; le seul bibelot moderne était un Napoléon en plâtre qui se trouvait dans une vieille pyramide dont chaque rayon portait des flacons de mixtures, des boîtes de pilules et autres trophées des maladies que la noble dame avait pu surmonter. Et le héros ne semblait pas se trouver là plus mal qu’ailleurs.
Les invités n’étaient pas encore arrivés. Noémie, debout sur une chaise, fouillait le tiroir supérieur d’une vieille armoire sculptée.
– Que tu es espiègle ! disait la vieille femme, descends, les invités vont venir.
– Ce n’est pas tous les jours que les choses les plus précieuses ont l’occasion de voir la lumière. Et puis tu m’as permis de regarder.
– Ce sont des vieilleries, dit la dame, des souvenirs d’un demi-siècle.
– Et ce portrait de femme, demanda Noémie, pourquoi est-il ici ? Elle est délicieuse, mais elle a l’air Juive ?
La vieille dame fixa un instant le portrait, puis se tourna sérieusement vers Noémie et dit :
– C’est ta mère défunte.
Toutes deux se turent, mais Noémie reprit la première :
– Ma mère ! Il ne faut pas qu’elle reste parmi les vieilleries.
Et elle glissa le portrait contre sa poitrine.
– Descends, voyons, et ferme ce tiroir. Les invités vont venir ! dit la dame, tu me mets le sang en mouvement et tu sais que je ne peux le supporter.
– Parle-moi de ma mère, dit Noémie sérieusement.
– À quoi penses-tu, mon enfant ? dit la vieille dame, ce ne serait guère amusant pour toi.
Elle lui tourna le dos, les invités entraient. Christian, en l’absence de M. Knepus, joua pour eux une fantaisie de son cru. Noémie le regardait, songeuse. Il ne l’avait jamais vue ainsi et il s’exaltait à l’idée qu’elle l’admirait.
Toute la société se rendit dans la grande salle des nouveaux bâtiments afin d’y jouer au volant. Noémie resta près de la vieille dame, s’empara de sa main et dit avec une autorité au-dessus de son âge :
– Parle-moi de ma mère, il faut que je sache, je veux savoir.
– Tu me feras mourir de peur avec ta violence, dit la vieille dame. Je ne sais rien, va avec les autres jouer au volant.
– Tu me traites toujours en enfant et je ne le suis plus. Aussi je veux savoir qui je suis. Je ne suis pas une étrangère à qui vous avez fait du bien par charité. Je suis ce que j’ai l’air d’être, la fille de ton fils, tu es ma grand-mère. Je suis étourdie et c’est pourquoi j’ai oublié jusqu’ici de demander après ma mère. Je n’en ai parlé que deux fois devant mon père et chaque fois il s’est éloigné d’un air fâché. Mais puisque j’ai trouvé le portrait de ma mère, je veux en savoir davantage et tu dois me parler.
– Noémie, tu sais que je suis faible, dit la dame, ne me tourmente pas, je ne puis ni ne veux te céder. De plus, ce ne sont pas du tout des histoires pour ton âge. Non, dans quelques années, quand je n’y serai plus, mon fils te dira tout. Va maintenant dans l’entrée et cherche-moi mon manteau marron.
– Tu veux me faire sortir, dit Noémie, et après tu fermeras la porte à clé pour que je ne puisse rentrer, tu me l’as déjà fait. Mais tu sais comme je suis têtue, on a fait un trou dans la glace des fossés, je m’y jetterai si tu ne me dis pas tout de suite ce que je veux savoir.
– Terrible enfant ! dit la vieille comtesse. Tu es méchante envers moi, faible femme. Je t’obéis, mais c’est toi qui enfonces l’épine dans ton cœur.
Les joues de la vieille dame, habituellement d’une pâleur maladive, avaient une rougeur de fièvre. Elle parlait vite :
– Tu n’es pas de mon sang ni de celui de mon fils. Le vieux Juif de Svendborg était ton grand-père, sa fille était belle, plus belle que tu ne le seras. Elle était gouvernante ici au château, elle servait ici, tu comprends, elle servait... Mais elle était intelligente et cultivée et nous la traitions comme notre égale. Mon Fritz devint amoureux d’elle, son père le sut et renvoya ta mère chez ton grand-père. Nous envoyâmes Fritz en voyage, mais ils s’écrivaient et s’adoraient toujours malgré que bien des gens nous aient dit du mal de ta mère.
« Il y avait à Svendborg un musicien, un Norvégien, qui allait dans la maison de ton grand-père et devint un de leurs intimes, même très intime. Fritz rentra, nous pensions que tout était oublié, il allait souvent à la chasse et la chasse était une visite à Svendborg. Je dis à Fritz ce que je savais, mais il croyait à la fidélité de ta mère jusqu’au jour où il fut en présence de son prétendant norvégien qu’elle épousa. Fritz fut convaincu et devint raisonnable. Lorsque tu naquis, ta mère écrivit sur toi des lettres élégiaques et finalement se tua de regrets de n’avoir pas fait le mariage qu’elle rêvait. Son suicide réussit, puisque mon fils m’ordonna d’aller moi-même te chercher à Svendborg.
– Merci de vos renseignements, dit Noémie tranquillement, mais pâle comme elle ne l’avait jamais été. Je suis donc de noblesse norvégienne et non danoise. C’est fort heureux, cela m’a toujours paru plus distingué. Allons maintenant jouer au volant.
– Enfant ! dit la comtesse. Voilà tout l’effet de mes confidences. Un jour viendra où tu pleureras des larmes de sang en pensant à ce que tu as entendu aujourd’hui.
– J’ai entendu que ma mère était belle, dit Noémie. J’ai entendu qu’elle était intelligente, qu’elle a eu le courage de mourir lorsqu’on l’a trop fait souffrir. Je vais accrocher son portrait dans ma chambre, je l’ornerai de fleurs et tous mes baisers seront pour elle. Maintenant, je vais jouer au volant.
Elle quitta la comtesse le visage souriant, mais dans l’escalier de la tour elle fondit en larmes amères.
Cinq minutes après, on voyait Noémie joyeuse jouant au volant. Son instinct lui disait que les pleurs ne trouvent de sympathie que chez ceux qui croient que l’on souffre comme eux.
IV
LE MYSTÈRE DE NOÉMIE
– La vieille comtesse m’a trompée, pensait Noémie. Elle a voulu me blesser. Toute cette histoire est inventée ou elle repose sur de faux bruits. Je veux savoir et je saurai.
Elle se suspendait, séduisante, au bras du comte qui lui disait qu’ils allaient bientôt se quitter.
– Nous resterons deux ans sans nous voir, disait-il, mais quand nous nous reverrons, tu viendras avec moi à Paris et à Londres, Londres l’éblouissante, la magnifique !
– Tu es bon pour moi, dit Noémie. Tu es aussi le seul qui me domine et à qui j’obéisse. Les autres personnes que j’aime, je ne les aime que pour moi-même, pour l’agrément qu’elles m’apportent ou parce que je ne puis les éviter. Quelquefois elles me sont insupportables.
– Elles ne te comprennent pas comme moi, dit le comte.
– Toi ! répondit-elle, toi, tu me comprends ! Ah ! non, pas le moins du monde. Et c’est pourquoi je souffre des douleurs que je n’ose te dire parce que tu deviens tout de suite dur et méchant.
Elle posait sa joue contre celle du comte, roulait ses cheveux autour de son doigt et retenait sa respiration.
– Tu as honte parce que tout le monde dit que je suis ta fille. Si je ne le suis pas, dis-moi au moins qui je dois aimer comme mon père ?
– Un homme dont tu n’entendras jamais parler, répondit le comte. Il était de Norvège. Il est mort de la façon qu’il méritait.
– Oh ! raconte-moi ! supplia Noémie.
– Non, dit le comte en s’éloignant.
– Lui aussi est cruel, dit Noémie. Les hommes se font souffrir les uns les autres. Normann seul est fidèle et bon pour moi et ils l’ont enchaîné.
Elle sortit dans la cour, embrassa et caressa le chien, défit sa chaîne et le mena promener. La bête se roulait de plaisir, agitait la queue et sa langue rose et fumante pendait de sa gueule.
Christian terminait juste sa promenade solitaire à travers le jardin. L’un des magnifiques bonshommes de neige qui se dressait fièrement la veille était tombé sur les genoux en raison du dégel et sa lance s’échappait de ses mains. La sonnette du déjeuner résonnait, Christian sortait du jardin ; il venait d’ouvrir la grille lorsqu’il vit Noémie avec le chien qui aboyait et montrait ses dents pointues. Noémie rit très haut de la frayeur de Christian, mais au même instant, le chien s’arrachant d’elle s’élançait sur le jeune homme qui poussa un cri et essaya instinctivement de grimper sur le bonhomme de neige, s’accrochant des deux mains à la lance tombante. Mais le chien l’avait déjà mordu. Le bloc de neige s’effondra avec fracas et ce fut un bonheur car le vacarme et la neige chassèrent l’animal.
Quelques domestiques accoururent et relevèrent Christian qui saignait. Noémie restait muette près de la grille.
– Voilà le résultat de tes fantaisies, dit le comte sévèrement à Noémie. Le chien sera abattu.
Alors la jeune fille se précipita en pleurant, le suppliant de n’en rien faire. Elle saisit la main de Christian et le pria avec un regard plein d’angoisse d’intervenir aussi pour la pauvre bête. Ses lèvres touchaient la joue du jeune garçon et il demanda tout ce qu’elle voulut.
Un médecin fut mandé de la ville la plus proche. La morsure était profonde, Christian fut soigné avec dévouement. Noémie lui rendait visite dans la chambre, elle s’asseyait près de son lit, tranquille et sérieuse, il lui tendait une main qui pardonnait et, pour lui faire plaisir, il renouvelait son vœu que le chien vécût.
Le comte allait partir, mais il n’était pas question que Christian pût l’accompagner. Une lettre expliqua à M. Knepus ce qui s’était passé.
Noémie restait des heures dans la chambre de Christian. Tout lui disait combien elle lui était chère et cela lit que, pour la première fois, elle prit quelque intérêt à lui.
Elle lui demanda qui lui avait appris à jouer.
– Mon parrain, le Norvégien de Svendborg.
Et il lui parla de cet homme. Noémie écoutait, les yeux brillants ; le sang brûlait ses belles joues. Toujours elle voulait en savoir davantage car c’était de son père qu’elle entendait parler. Christian ne voyait là que l’intérêt qu’elle prenait à son sort et c’est pourquoi il reprenait volontiers, à chaque visite, le fil de leur entretien. Il lui contait l’histoire de leur voyage à Thorseng, de leur rencontre à Glorup et de sa fin tragique dans les arbres. Et Noémie souriait étrangement en portant la main à son front.
– Ce fut un homme extraordinaire, mais bien malheureux, dit-elle, et c’est plus intéressant que d’être un homme ordinaire heureux. Toi aussi, dans ton jeune âge, tu as vécu dans une ennuyeuse quiétude et chaque jour suit automatiquement le précédent. L’on ne devient rien de remarquable sur cette route étroite et lisse. Si j’étais toi, je nouerais mon violon dans mon baluchon et je quitterais tous ces gens fastidieux qui se ressemblent depuis le nœud de leurs souliers jusqu’au ruban de leur cou.
– Mais qu’adviendrait-il de moi ? dit Christian, je suis pauvre...
– Oh ! tu l’étais encore davantage en quittant la maison de tes parents. Tu ne savais même pas jouer comme aujourd’hui et pourtant tu marchais vers le bonheur. Si tu partais à la conquête du monde, pense combien tu serais fier, après être devenu un grand homme, de repenser à tout cela ! Le monde admirerait ta rapide ascension, et moi, oui, moi, je crois que je pourrais t’aimer. Mais sans cela, non ! non ! jamais. Il faut que tu sois quelque chose de remarquable.
Elle lui saisit les mains et lui parla longtemps encore, développant sa vision romanesque de la vie dont elle ignorait tout. Cette enfant volontaire et fière était flattée de pouvoir en guider un autre. Christian remplaçait sa poupée. Un grand sentiment naissait en elle qui était pourtant bien loin d’être de l’affection. Elle lui parla d’hommes et de femmes célèbres et elle soupirait d’être une simple jeune aille.
– Mais au moins, disait-elle, je ne serai pas comme les autres.
Christian de plus en plus vivait dans ce rêve qu’elle avait créé : toutes ses pensées n’étaient pleines que d’aventures, de gloire et de Noémie.
– Dimanche, tu nous quittes, dit Noémie. Le docteur dit que tu seras bientôt guéri. Je sais que tu m’aimes, mais moi je ne puis aimer un homme ordinaire et tu ne t’élèveras jamais dans cette bourgeoisie d’Odense, près de ce ridicule M. Knepus. Saute hardiment dans la vie, personne ne sait et ne saura jamais que je te donne cent riksdaler de mes économies. Rappelle-toi cette première rencontre dans le jardin quand je pris tes yeux et ta bouche en gage. Tu m’appartiens encore, j’ai des droits sur toi. Dès que tu te sentiras tout à fait bien, préviens-moi, et la nuit où tu partiras à l’aventure, je veillerai et penserai à toi.
– Je ferai tout ce que tu veux, cria-t-il en jetant ses bras autour de son cou.
Noémie, fière et tranquille, lui laissait baiser sa joue brûlante.
V
LES CENDRES D’UN FOYER
Les passions sont les vents
qui font aller notre vaisseau,
et la raison est le pilote qui le conduit.
Le vaisseau n’irait point sans les vents
et se perdrait sans le pilote.
(Esprit des Esprits.)
Par un beau jour d’hiver, quand la gelée couvre les arbres, que les corbeaux noirs volent sur la neige blanche au clair soleil, on peut avoir envie de voyager, mais c’est par un temps tout différent que Christian roulait vers Odense. Un brouillard humide couvrait les prairies, des haies noires et pelées auxquelles pendaient de lourdes gouttes d’eau pointaient à travers la neige et tout cela éveillait justement le désir du jeune homme de s’éloigner pour aller vers le soleil et la chaleur.
– Mon bonheur ici, pensait-il, ne viendrait que lentement, comme l’été. Il faut que je quitte la maison pour voler au-devant du bonheur.
Le retour au logis des Knepus n’avait apporté aucun repos à son cœur. Il pensait à Peter Wik et à tout ce que cet homme avait fait pour lui et il entrevoyait combien mal il l’en récompenserait.
– Mais lorsque je reviendrai et que je serai un grand homme, quelle surprise, quelle joie !
M. Knepus ne se doutait guère de ce qui préoccupait son élève, tandis qu’il l’interrogeait sur l’histoire ou la musique. Après de mûres réflexions, Christian écrivit à Noémie pour lui dire le jour où il partirait et il lui donna rendez-vous dans un cabaret à une demi-lieue du château du comte. Ils devaient s’y retrouver une dernière fois et se dire au revoir. La lettre partie, il était aussi décidé à partir que César à franchir le Rubicon. S’il avait pu seulement se confier à Lucie ! Mais elle ne planait pas si haut, elle rirait de lui ou essaierait de l’empêcher de partir.
Le grand jour approchait, il fit et refit son petit baluchon plusieurs fois. II aurait voulu tout emporter.
Lorsqu’il songeait à tout ce que Peter Wik avait fait pour lui, il était rempli de gratitude et de remords.
Les larmes aux yeux, il prit un papier et une plume et lui fit ses adieux ; il lui demanda pardon de la peine qu’il allait lui faire. Mais à peine sa lettre écrite, il la déchira. Une nouvelle idée lui était venue tout à coup. Ses mains se joignirent, sa résolution était prise. Il écrivit rapidement une longue lettre, la relut et s’écria joyeux
– Oui, comme ça c’est bien, maintenant j’ai l’âme tranquille. Noémie sera contente de moi, C’est Dieu qui m’a inspiré cela.
Il alla se coucher content et dormit sans rêves.
Aux premières lueurs du matin, il était en route. Noémie avait reçu la lettre et était tout émue de cette rapide aventure dont elle était l’instigatrice. C’est pourquoi elle voulait aller à la rencontre de Christian au cabaret. Cela lui était facile : elle n’avait qu’à prétexter une promenade à cheval, mais comme il lui eût été désagréable d’être reconnue au cabaret, elle emprunta un costume au jardinier, petit homme fluet fort bien habillé pour sa condition.
Elle se glissa dans l’écurie, sella elle-même son cheval et un quart d’heure après, un hardi petit cavalier trottait dans l’allée des peupliers.
– Soignez mon cheval et donnez-moi la chambre d’honneur, dit-elle en arrivant à l’auberge.
Puis elle regarda la route pour voir s’il venait, elle étudia tous les noms crayonnés sur l’ardoise, durant trois heures elle le guetta.
– Il ne viendra pas, il n’a pas de courage, pensait-elle.
Et pourtant le héros vint, tard, très tard, fatigué et échauffé de la longue route.
– Enfin, te voilà ! lui dit-elle.
Il s’étonna de voir le déguisement de la jeune fille, mais bientôt il se mit à tout lui raconter. Il dit ce qui l’avait tourmenté et lui tendit la lettre destinée à Peter Wik. Ce n’était pas un adieu, c’était un compte rendu exact de son plan, mais sans nommer Noémie. Il y exprimait sa conception fantastique de la vie et sa certitude de devenir un grand homme. Il demandait à Peter Wik la permission de voyager sans laquelle sa conscience n’aurait pas de repos.
– Es-tu sérieux ? demanda Noémie. Du reste, j’aurais pu m’y attendre, tu ne seras jamais un grand homme. Elle sortit de la chambre, refusa de lui parler davantage, demanda la note et reprit précipitamment le chemin du retour.
Christian était atterré ; elle l’avait quitté sans un adieu !
Malgré cela il reprit sa route. Au loin, une lumière s’élevait à l’horizon ; mais ce n’était pas celle du soleil, c’était celle d’un incendie. Il y avait le feu à Œrebœk, le feu à la ferme de son beau-père. Et comme tout le monde y dormait, la flamme rouge étendait toujours davantage ses bras de polype. L’air et la neige en étaient rougis, les chevaux enfermés hennissaient et les bestiaux meuglaient dans le silence du matin.
Lorsque le jour se leva, la maison était brûlée, le bétail était brûlé, le fermier gisait la tête écrasée sous les murs écroulés. Quand Christian arriva à la ferme, son baluchon à la main, son violon enveloppé suspendu à son cou, il se trouva devant les cendres du foyer maternel.
VI
LE VIEUX JOËL EST MORT
C’était le révérend M. Patermann qui, sur le désir de la vieille comtesse, devait baptiser Noémie, l’instruire dans le catéchisme et diriger sa confirmation. Dans sa parole mielleuse passaient des sifflements de serpent ; quelque chose de dégoûtant, de sucré, d’insinuant, se mêlait à son éternel sourire. La gouvernante trouvait qu’il avait un visage d’apôtre et qu’il laissait sur son passage un parfum de sainteté. Il nous est impossible d’être de l’avis de cette trop indulgente personne. Comment ce prêtre aurait-il pu taire naître chez les autres de bonnes actions, alors qu’elles ne lui venaient jamais à l’esprit ?
Cet homme ne plaisait pas à Noémie. « C’est donc M. Patermann qui fera de moi un être humain », disait-elle en se remémorant ses particularités essentielles. Il lui semblait ridicule et elle ne pouvait le respecter, ni accepter sans révolte l’enseignement qu’il lui donnait. La préparation à la confirmation donnait lieu à d’interminables discussions au cours desquelles le prêtre affectait une grande humilité vis-à-vis de la jeune fille riche, tandis que sa sévérité était grande envers la jeunesse paysanne et coupable. Il se conduisait comme ce maître qui faisait travailler le fils du riche et son propre enfant, et quand le premier faisait mal, il battait le second, disant :
– Toi, tu es ma chair et mon sang, aussi j’ose te battre.
D’ordinaire Noémie se rendait à cheval au presbytère et son respectable maître l’aidait lui-même à descendre. Ce jour-là, le fils du bouvier se précipita pour l’aider car il avait une commission à lui faire de la part d’une femme du village qui priait la demoiselle d’entrer chez elle où un homme se mourait.
– Qu’est-ce que c’est ? dit le prêtre, cette personne est veuve, il ne peut donc s’agir que de mendicité, de mensonges et d’inventions.
Et il conduisit tout de suite Noémie dans la salle principale. Il se trouva qu’ils lurent l’histoire du bon Samaritain.
– C’était une belle action que nous devrions imiter, dit le prêtre.
– Alors, j’aurais dû aller tout de suite chez cette pauvre femme, dit Noémie.
– Il ne faut pas le prendre ainsi, dit-il. Dans ces pays-ci, les pauvres sont de la racaille en haillons, un mélange de mensonge et de ruse. On ne peut pas agir ici comme dans les pays orientaux.
Et il rit comme s’il avait dit quelque chose de drôle.
– La demoiselle ne veut pas venir, disait dans la chaumière la pauvre femme au mourant, et le prêtre était furieux. Cela me retombera encore dessus !
Le mourant soupira profondément. Subitement ses yeux s’éclairèrent, il tendit les mains en avant : Noémie venait d’entrer.
– Je t’ai déjà vu, dit-elle ; toujours quand nous nous rencontrons tu me salues respectueusement, toujours tu me regardes d’un air étrange. Est-ce de l’eau que tu lui donnes ? demanda-t-elle à la femme. Donne-lui quelque chose de meilleur.
– Oui, un peu d’alcool lui ferait du bien, répondit la paysanne, mais il n’y en a pas dans la maison depuis quinze jours.
– Achète du vin, dit Noémie en lui donnant de l’argent.
La pauvresse resta médusée quelques instant avant de sortir.
Il semblait que le mourant revenait à la vie, il put parler.
– Laisse-moi te regarder, Noémie.
– Tu sais mon nom ?
– Je le savais avant que tu ne le connusses toi-même. Je t’ai portée dans mes bras, mais tu ne peux te souvenir du vieux Joël.
– Je t’ai déjà vu, dit Noémie, mais tu ne venais jamais au château.
– Je ne devais pas, dit-il, et je ne voulais pas.
– Qu’as-tu à me dire ? demanda-t-elle.
Il montra une cassette ouverte auprès de lui. Que cherchait-il là-dedans ? Qu’avait-il à dire ? Si vous compreniez le gazouillement du pierrot, vous entendriez ce que Noémie entendit ; si vous saisissiez les sons que le vent printanier souffle dans sa flûte, vous sauriez ce qui rendit Noémie si pensive et fit qu’elle ne s’en retourna que pas à pas à travers le petit bois, vers le château.
« La race juive n’est-elle pas mère de la chrétienté ? Mais comme Œdipe, errant, elle est l’objet des moqueries de la jeunesse. » Était-ce cette pensée qu’elle ruminait, ou bien la conférence du prêtre sur le bon Samaritain ?
– Est-ce une honte que d’appartenir à un peuple immense ! songeait-elle. Le père de ma mère était riche, Joël était son vieux domestique fidèle. Quand j’étais abandonnée, quant tout n’était plus que cendres, il me fit donner un foyer ici. Quel bon vieux cœur était le sien !
Les larmes lui montaient aux yeux, mais elle les écrasa de ses cils noirs, la pauvre femme courait derrière elle.
– Mademoiselle, il est mort ! criait-elle.
– Est-il mort ? dit Noémie. Dites-moi, que vous avait-il dit quand il me fit demander ?
– Il avait dit seulement qu’il fallait vous chercher, qu’il ne pouvait mourir sans vous avoir vue. Je savais que vous étiez aujourd’hui chez le prêtre...
– Vous ne l’avez pas compris, dit Noémie froidement. C’est pourquoi vous vous êtes conduite avec tant d’étourderie. Vous m’envoyez chercher, moi qui ne l’ai jamais vu. Vous en seriez sérieusement blâmée au château si on l’apprenait. Mais voyez, je suis bonne, je n’en dirai rien, je vous le promets. Vous de votre côté, n’en parlez à personne.
– Seigneur Dieu ! vous ne le connaissiez pas !
– Mais non, dit Noémie. Et la regardant d’un air glacé, elle ajouta : Comment connaîtrai-je ce vieux Juif ?
Elle partit à cheval, le cœur battant. « Pauvre Joël ! Dieu a renié ton peuple, je peux aussi te renier. » Et elle prit un livre que Joël lui avait remis et où était racontée l’histoire de sa mère. Tout en lisant elle éperonnait son cheval pour gagner la maison.
VII
LA ROUE DU DESTIN
Le soir du 4 septembre 1819, Noémie arriva à Copenhague. Elle devait passer l’hiver dans une famille alliée au comte, une maison noble où tout était richesse et magnificence.
– Enfin, je vais commencer à vivre, se disait-elle. Enfin, je m’évade de la Bastille et je quitterai une chambre de malade pour un salon somptueux et la conversation de M. Patermann pour une représentation à l’Opéra.
La maison du baron où Noémie était invitée pouvait être considérée comme le type de la maison riche. On y lisait beaucoup et pourtant la connaissance de la littérature danoise s’y bornait à la lecture des journaux et aux pièces de théâtre que la famille voyait représenter à son jour d’abonnement. Toute l’admiration des hôtes de la maison allait à un roman anglais quelconque décrété « chef-d’œuvre », alors qu’il était généralement bien inférieur à la production danoise. C’est que tout ici-bas est assujetti aux lois de la nature et la renommée d’un poète ne dépend pas de l’excellence de ses vers, mais de la grandeur de sa patrie.
La famille du baron était très religieuse, tout au moins elle allait volontiers à l’église et se conformait strictement aux sentiments de la Cour. Noémie, au contraire, était tout à fait hérétique. Elle faisait entrer dans son temple religieux, Socrate à côté de saint Paul et Mohammed près de Zoroastre. On trouvait Noémie belle, mais les zéros manquaient derrière la cote de son nom. Tout autour d’elle n’était pourtant que politesse, politesse si glaciale et si blanche qu’elle rendait impossible la moindre contradiction.
En février arriva de Suède un cirque qui devait, en mai, se rendre à Vienne. Un chambellan de la Cour qui faisait à Noémie une cour assidue, prit une loge et invita toutes les jeunes filles de la famille. Parmi elles, M` Emma éprouvait pour les chevaux une passion particulière, tous les quinze jours elle donnait ses deux écus pour faire un tour avec un piqueur royal. À toutes cependant l’invitation fit grand plaisir. Le gentilhomme avait convié, pour servir de duègne à ce bataillon de jeunes filles, une de ses tantes, la comtesse Hohn. On eût pu mettre en légende sous son portrait, le mot de Lesage : « C’est la perle des duègnes, un vrai dragon, pour garder la pudeur du beau sexe 2. »
La voiture s’éloignait rapidement à travers les rues hivernales. Ses roues tournaient, et, comme elles, la grande roue du destin. Il eût bien mieux valu pour Noémie que la voiture versât, que les dames eussent une grande frayeur et qu’elle-même se cassât le bras, ce malheur en eût évité pour elle un plus grand, mais y a-t-il un exemple que la voiture du criminel verse, tandis qu’on le conduit au supplice ?
La salle de spectacle était assez pleine. L’orchestre jouait une musique légère et entraînante. On amena des chevaux superbes. Une dame, le chef orné d’une plume flottante, se tenait debout sur un cheval, agitant des drapeaux qu’elle serrait dans ses deux mains. Noémie pensait à la vie agréable que devait mener l’écuyère en voyageant de pays en pays sans jamais revenir pour se fixer définitivement nulle part.
Les trompettes sonnèrent et le premier de la troupe arriva à toute vitesse sur un cheval noir et altier. Il salua comme un chef salue ses vassaux. Il portait le costume polonais, un liséré de fourrure d’ours ceignait son béret mais ses cheveux tranchaient encore en noir sur la fourrure. Sur son visage aux traits altiers planait une couleur de bronze. Ses yeux sombres étaient pénétrants.
Dès qu’il se montra, le beau jeune homme attira toute l’attention du public, un murmure admiratif l’accueillit. Mais lui n’avait de regards que pour son cheval, pas une fois il ne fit attention aux spectateurs. Il parcourait la piste à une allure fougueuse, jonglait en pleine course avec des sabres aiguisés ; tout semblait un jeu pour lui. On eût dit que son cheval et lui-même ne faisaient ces exercices que pour se divertir mutuellement, et pourtant il y avait chez le cavalier une témérité qui donnait le frisson à plus d’une femme et fit passer plus d’une main fine devant de beaux yeux ; Noémie s’appuyait au bord de la loge, ses prunelles brillaient ; c’était le premier homme qu’elle regardait avec admiration, le premier qu’elle considérait comme supérieur à elle-même en quelque chose.
Après Ladislas, d’autres cavaliers montrèrent leur talent, mais aucun n’avait sa hardiesse ni sa beauté ; il clôtura la représentation en figurant Mazeppa étendu sur le dos du cheval, la tête en bas, volant en une course rapide.
Quelques jours après, Mlle Emma raconta que plusieurs dames de la bonne société allaient prendre des leçons d’équitation avec Ladislas. « J’en suis ! » dit Noémie. Et comme la fille de la maison en était, on né pouvait guère refuser ce plaisir à la jeune invitée.
Durant les heures de cours, Ladislas se montrait le plus chevaleresque, mais aussi le plus muet des professeurs ; il ne prononçait que les phrases strictement nécessaires à son enseignement. Une seule fois on vit un sourire jouer sur sa belle bouche qu’ombrageait une moustache sombre, et alors son œil noir brilla. Emma trouva que cela lui donnait une expression méchante ; Noémie, au contraire, pensa que son attitude exprimait une douleur contenue. Quoi qu’il en soit, sa réserve le rendit beaucoup plus intéressant pour sa clientèle féminine que s’il avait eu l’éloquence d’un Mirabeau.
De toutes les élèves, Noémie était celle qui montrait le plus de dispositions pour devenir une parfaite cavalière, mais nulle autre sans doute n’avait comme elle couru les champs et les bois, à cheval, et souvent même sans selle.
Par un beau soir du mois d’avril, le cirque donnait sa dernière représentation ; la famille du baron occupait deux loges. Il devait y avoir un tournoi. Ladislas richement vêtu entra dans l’arène, il salua de sa lance et justement dans la direction de la loge où Noémie et Emma étaient assises. Emma rougit, Noémie sourit seulement.
Oh ! quelle nuit pleine de rêves connut Emma après avoir quitté le cirque ! Noémie, au contraire, ne dut rêver que la nuit d’après, et cela longuement, car à dix heures du matin elle n’était pas encore descendue pour le thé. La femme de chambre la chercha mais ne trouva qu’une lettre contenant une excuse ou plutôt une prière de ne pas s’effrayer si elle était partie brusquement pour Fyen ; ce n’était pas un caprice mais une absolue nécessité qui le lui commandait.
Tout le monde fut très surpris, on écrivit le soir même à la vieille comtesse en lui annonçant cet étrange voyage. Au fond, on n’était pas inquiet, cette manière de faire était bien dans le caractère de Noémie. Mais la surprise fut plus grande encore lorsqu’on reçut la réponse de la comtesse fort effrayée. Noémie n’était nullement arrivée chez elle et l’on n’avait même pas eu de lettre de cette terrible enfant.
Puisque Noémie prit ainsi la liberté de voyager subitement, nous ferons de même. Nous quitterons aussi Copenhague.
Dans le port, le vapeur est prêt au départ, mais il ne va pas à Fyen, nous ne pourrons pas rendre visite à Christian ou à Lucie ou à quelque autre connaissance. Le bateau navigue sur la mer Baltique et l’onde est toute déchirée de ses roues.
Si l’eau qui s’est refermée derrière la quille du bateau gardait l’image de ceux qui se sont mirés en elle, elle nous montrerait Ladislas avec son fier et beau visage et près de lui un gamin danois qui ne paraît pas plus de quinze ans mais dont les membres fins et agiles, dont l’œil exprime la force et la volonté, dont les lèvres fraîches sont surmontées de fines moustaches et qu’on appelle M. Christian.
Noémie s’était ainsi déguisée pour suivre le cirque à l’étranger et devenir une écuyère. Ne soyons pas trop sévère pour elle, souvenons-nous de son éducation, de son entourage et surtout de ses idées.
Après le débarquement en Allemagne, la petite troupe descendit dans une auberge à Mohn. Noémie avait bien conscience de la gravité de son escapade, mais sa nature fière lui défendait de s’avouer à elle-même qu’elle avait peut-être déjà quelque regret.
VIII
LADISLAS
Connaissez-vous la patrie des Hindous ? Là-bas, le soleil brûle mais l’air apporte la fraîcheur des glaciers de l’Himalaya ; les bois odorants invitent au repos, les figuiers inclinent jusqu’à terre leurs branches qui forment des huttes, les noix de coco offrent leur lait, les dattiers tendent leurs fruits, des oiseaux aux mille bariolages vous environnent, des perroquets rouge pourpre, des canaris jaunes. C’est le royaume des couleurs. On le voit aux ailes des insectes, aux pétales des fleurs géantes. Le flot mouvant où pousse le lotus est saint comme l’eau du baptême.
Ô patrie des Hindous ! que possèdes-tu de plus clair, de plus transparent ? Ton ciel et les petits lacs où l’antilope et le léopard apaisent leur soif ?
C’est en cette contrée, dit la légende, que se trouvait le paradis d’où furent chassés Adam et Ève. Et ce paradis, pourtant, est la patrie du paria. Les hordes mongoles l’ont chassé de chez lui et il erre à travers le monde sans trêve ni repos. Les champs de blé sont sa tente l’été, les fossés profonds l’abritent l’hiver. Les enfants des parias n’ont même pas un trou comme les loups, un nid comme les oiseaux.
Sur les landes du Jutland comme sous les murs de l’Alhambra, on trouve des représentants de la tribu des parias, mais ils sont, le plus grand nombre d’entre eux, campés dans les grands bois de Hongrie et sur les vastes steppes. Le trône du roi des tziganes est la pierre couverte de mousse près de la marmite où cuit le mouton volé. Fatiguée de la course, la tribu s’étend dans l’herbe haute où les enfants aux yeux noirs jouent avec les fleurs.
Aucune bande ne se hasarde dans Vienne, la ville impériale, et cependant on y voit parfois des tziganes dans les rues, qui se glissent isolés.
Le plus souvent ils errent dans les faubourgs qui entourent la ville et dont chacun forme une vraie ville plus grande que le vieux Vienne.
Or, en cette année 1820 qui fut celle où Noémie commença ce qu’elle pouvait appeler justement son calvaire, dans le faubourg de Mariahilff, d’où part le chemin conduisant à Schönbrunn, deux tziganes marchaient dans leur costume blanc. L’un était un tout jeune homme portant un large chapeau dont l’ombre tombait sur son dos et ses épaules ; l’autre était beaucoup plus âgé, grand et maigre et il allait nu-tête. Des cheveux épais et noirs, mélangés de quelques mèches grises, le protégeaient contre l’ardeur du soleil. Ils allaient dans une des nombreuses petites rues qui conduisent de Mariahilff au belvédère.
– Les faubourgs pourraient bien écraser la ville s’ils voulaient, dit le plus jeune. J’ai fait cette nuit un drôle de rêve. Il me semblait que Mariahilff, Josephstadt et tous les autres faubourgs étaient vivants et s’avançaient vers la ville qui était commandée par la tour de l’église Saint-Étienne. Ils se battaient et il tombait de l’argent blanc et jaune dans le Danube.
– Tu avais trop bu, dit le vieux. Fais attention, Czekles, ne raconte pas des rêves comme celui-là, la police a l’oreille fine. Comment un jeune garçon peut-il occuper son esprit à de pareilles choses ? Rêve à la danse et à l’amour, que diable !
– Non, je rêve plutôt de guerre, reprit Czekles. Je voudrais être soldat et pouvoir présenter les armes à l’empereur François, ce bon empereur ! L’autre jour, quand je me suis découvert devant lui, il a touché son chapeau, et c’était pour moi seul, il n’y avait personne d’autre sur la route. L’empereur m’a salué ! Pour ce qui est de mon rêve, il était assez drôle. L’église Saint-Etienne, avec son bonnet pointu était un général, la statue de l’empereur Joseph caracolait sur son cheval à travers Kohlmarkt et Kœrnthnerstrasse. Il appelait à son aide toutes les images des enseignes et elles le suivaient. Le lutteur de marbre du jardin public se mit à la tête de toutes les statues de marbre de l’église des Capucins et ils montèrent sur le toit du château impérial et regardèrent comment les faubourgs avançaient. La foule était plus dense que dans le jardin public ou le Prater un jour de fête.
Durant cette conversation, les deux hommes marchaient rapidement et ils ne ralentirent leur allure qu’en atteignant la « Heugasse », d’où ils pouvaient voir le château de Schönbrunn.
– Tu veux être soldat, Czekles ? reprit le vieux.
– Oui, c’est ici, à Vienne, devant le château impérial que je voudrais porter le fusil.
– Ce serait une vie de contrainte, Czekles, tu aspirerais vite à partir. L’inquiétude est dans nos jambes comme le désir de voler dans nos bras. Si tu t’enfuyais tu serais pendu !
– Tant pis ! dit le jeune homme, finir dans l’estomac d’un ver ou dans celui d’un oiseau, cela ne doit guère faire de différence ! Et puis, pourquoi supposer le pire ?
– Dans l’estomac d’un oiseau ! reprit le vieux, c’est un cercueil bien magnifique, toujours en mouvement comme notre peuple. La jeunesse peut parfois vous apprendre quelque chose. Je penserai à tes paroles lorsque j’irai dans les bois de Hongrie et que j’entendrai chanter les oiseaux. Peut-être ai-je entendu le chant de celui qui avait dans son gésier les yeux de celui que j’ai le plus aimé, les yeux de mon fils, de mon Bela. Tu connais son enfant, mon petit-fils, Ladilas ; c’est le portrait de son père en plus altier, avec le sang plus sombre. Bela était meilleur. quoiqu’ils l’aient pendu. À son fils ils réservent pourtant leurs bravos quand il monte à cheval, la haine et le mépris au cœur.
– Mais il a renié son origine, dit le plus jeune.
– Pourtant il n’a pas de domicile fixe, dit le vieux. Il fait de plus grands voyages que nous, il a traversé la grande mer qui est large comme toute la Hongrie. Tous les empereurs et les rois que nous avons vus rassemblés pour le Congrès, ils les a vus dans leur propre pays. Il s’envole aussi vite que les oiseaux migrateurs et il réussit tout ce qu’il entreprend.
Tout en causant ils étaient arrivés au château, devant la façade qui regarde la plaine ouverte ; les soldats étaient assis par groupes et causaient ; des étrangers et des Viennois visitaient les salles ou quittaient la magnifique galerie de peinture.
Les tziganes restèrent muets et considérèrent le bâtiment qui n’est pas spécialement remarquable, mais ceux qui auraient bien observé le regard du vieux auraient compris qu’il cherchait quelque chose aux fenêtres.
Un jeune homme à moustaches, aux traits fins et aux yeux intelligents considérait très rapidement une toile après une autre, puis il admirait, comme il sied, la magnifique vue sur le parc, la ville impériale et les montagnes de Hongrie. Ceux qui le voyaient disaient que c’était un artiste de cirque. Nous dirons que c’était Noémie.
En s’approchant davantage de la fenêtre, elle vit les tziganes. Elle quitta rapidement la salle et descendit l’escalier. Eux la voyaient venir, mais ils ne firent pas un signe. Ils s’éloignèrent lentement et elle les suivit.
Près d’une maison basse où le sentier se perdait dans les champs, le vieux s’arrêta et se baissa comme pour attacher le lacet de son soulier ; le jeune homme continua sa route.
Noémie s’approcha du vieillard, ils parlèrent de Ladislas ; le vieux jugeait sévèrement l’écuyer.
– Il est ma chair et mon sang, disait-il, mais c’est une plaie qui me fait souffrir. Son père était mon fils. Ladislas méprise son père et toute sa race et cependant il hait ceux qui haïssent les siens. Je lui ai dit ce que je pensais et son fouet m’a marqué l’épaule. Ladislas est un orgueilleux qui te rendra la vie au cirque impossible. Je sais que tu n’es pas un garçon et que tu es d’une honorable famille qui doit te chercher partout. Méfie-toi de lui, car si tu ne lui montres pas que ton caractère est assorti à tes vêtements, il te fera cruellement souffrir. C’est pour te dire cela que je t’ai donné rendez-vous ici.
– Je ne suis pas une jeune fille, dit Noémie. Tu t’es trompé.
– Et pourtant le sang te monte aux joues, dit le vieux, mon œil ne se trompe pas et mes mots ont su trouver ton cœur.
Il salua et partit.
Noémie ne savait si elle devait le suivre ou rester là, elle réfléchit un instant puis, ayant pris son parti, elle marcha vers la ville.
Un service de voitures était établi entre la Petersplatz et les faubourgs de Schönbrunn et de Hitzing. Noémie monta dans l’une d’elles. Elle s’efforçait de sourire comme les autres. Les bons Viennois parlaient avec admiration de leur bon empereur, de saucisses, de commerce et des frères Schuster, tout cela pêle-mêle dans le tohu-bohu de la conversation.
Près de Schönbrunn se trouve la petite ville marchande de Hitzing avec son église et ses fameux petits restaurants. La musique résonnait gaiement au casino qui était alors aussi fréquenté qu’aujourd’hui, mais pas encore célèbre par l’orchestre de Strauss et de Lanner. Dans le petit jardin serré entre les maisons, au bord du ruisseau boueux, il y avait autant de tables et de tonnelles qu’aujourd’hui.
Ladislas était assis à une table avec deux amis.
Noémie s’approcha, elle aurait voulu s’asseoir à leur table, mais Ladislas faisait semblant de ne pas la voir. Depuis quelque temps, il ne témoignait plus aucun égard à Noémie qu’il avait entraînée pourtant en cette périlleuse escapade, tantôt lui cherchant querelle, tantôt affectant à son égard un insolent mépris. La jeune fille sentit la colère la gagner. Les joyeuses mélodies n’avaient pour elle rien d’apaisant, elles lui semblaient des soupirs de moquerie, elle croyait sentir passer tour à tour sur elle l’air froid des humides prisons du Spiegelberg et la chaleur accablante des chambres de plomb de Venise.
Ladislas la regarda de son œil fier et arrogant et elle le regarda aussi ; ils firent semblant de ne pas se connaître, mais ils se suivirent comme l’ombre suit le corps.
Quand on abandonna le plein air pour les salons éclairés, Noémie rencontra Ladislas à la danse. Le travesti obligea la jeune fille à danser avec une femme, et les lèvres de Ladislas lui exprimaient à ce sujet leur ironie, mais il ne lui parla pas et elle non plus ; elle tournait aux sons joyeux de la musique, elle tournait comme l’axe d’une roue, sa poitrine se soulevait, ses yeux brillaient.
Ladislas disparut dans la foule, elle le chercha en vain.
Une demi-heure après elle était chez elle, au Prater. Ladislas n’était pas encore rentré, elle se jeta tout habillée sur son lit, mais il n’y avait pas de larmes dans ses yeux, il ne monta pas de soupirs à ses lèvres. On entendit des pas. C’était lui. Elle se leva pour aller à sa rencontre dans la partie du logement réservée aux écuyers.
Ils se regardèrent d’abord en silence, puis l’homme parla le premier.
– Tu as dû bien t’amuser, dit-il avec un mauvais sourire.
Elle se taisait toujours et le regardait fièrement et tristement.
– N’as-tu pas vu, dit-il, que si je vais dans l’écurie et si mon cheval est en liberté, il hennit et me suit ? C’est par pure amitié, et c’est pourquoi je le flatte sur la crinière. Toi aussi tu me suis, mais avec des sentiments moins amicaux. J’aurais envie de te flatter, mais de la manière, que tu mérites ! et il saisit le fouet qui était sur la table, le fit claquer dans l’air dans la direction de Noémie de façon que la lanière effleurât son cou.
– Ladislas ! cria-t-elle seulement, et elle quitta la pièce.
Dehors tout était noir et tranquille. Seul le bruit d’une voiture roulant devant le Prater atteignit son oreille. Il y avait des étoiles au ciel, la grande ourse pointait vers le nord.
Au même moment, dans la même nuit, Christian roulait en voiture vers Copenhague. Il était arrivé à la certitude qu’il n’apprendrait pas grand-chose chez M. Knepus et qu’il lui fallait courir le monde. Peter Wik en était fâché et lui avait signifié qu’il lui faudrait désormais conduire lui-même sa barque. Lucie avait pleuré, mais Christian avait tenu bon. Il portait dans sa poche quelques lettres de recommandation dont l’une pour un laquais du roi. La nuit d’été était tranquille et douce, le postillon soufflait dans sa corne et l’écho répondait des hauteurs du bois d’Antoor.
Christian pensait à Noémie ; elle, au contraire, laissait sa pensée s’envoler comme l’abeille, et, dans chaque fleur d’amertume qui en ces derniers mois avait germé dans son cœur, elle butinait du poison.
IX
PARTIR !
– Je veux partir, disait le lendemain Noémie à Joséphine, l’écuyère qui tenait en pleine course des drapeaux flottants dans ses mains, je veux partir, autrement cela finira mal. Ladislas est trop méchant !
Joséphine rit :
– Nous irons d’abord en voiture ce matin à Josephsdorf et au couvent de Neubourg dans le petit tonneau traîné par le cheval tacheté. Et au retour tu ne penseras plus à la mauvaise humeur de Ladislas et tu lui pardonneras son mouvement de colère.
– Jamais ! dit Noémie. Procure-moi un passeport, je veux aller en Hongrie ou en Bavière, où tu voudras, mais je veux partir, je ne veux plus le voir.
– D’abord nous allons faire un tour, répéta Joséphine, nous prendrons du chocolat à Josephsdorf et de la montagne nous regarderons si le beau Danube bleu ne t’incite pas à rester. Il ne faut jamais se hâter, ne pas faire de trop grands pas, cela ne sied pas à une femme.
– Ce n’est pas la première fois qu’il a versé le poison dans mon cœur, dit Noémie. À Toplitz, quinze jours après que j’eus quitté mon foyer, je lisais en lui comme en un livre ouvert. Ma détermination est prise.
La voiture était prête, elles partirent. Dans les grandes allées du faubourg, elles rencontrèrent nombre de voitures et de cavaliers. Les jeunes, gens saluaient Joséphine, quelques dames sourirent à Noémie. La route grimpait le long de la montagne d’où on a la vue la plus étendue sur la plaine verte et luxuriante où coule le Danube.
Le petit cheval partit au trot pour gagner le couvent dont la haute coupole avec la couronne impériale se détachait magnifiquement dans l’air bleu.
Elles entrèrent toutes deux dans les couloirs voûtés. Un étranger s’y tenait. Noémie trembla en l’apercevant. Celui-là moins que tout autre, elle n’eût voulu le rencontrer : c’était le comte, celui qu’elle appelait son père.
Il salua, parla rapidement à Joséphine et passa sans regarder Noémie davantage.
– Ce n’est pas aussi riche et magnifique ici que dans le couvent de Molcz, dit Joséphine, mais j’aime cette vieille bâtisse, elle m’est chère depuis l’enfance. Combien souvent ai-je couru d’ici au château de Léopold ! On raconte que de là-haut le voile de la duchesse flotta jusqu’à cette place et s’enroula autour d’un buisson d’épines où s’élève aujourd’hui le couvent.
– Que m’importent tes histoires ! dit Noémie, dont la voix tremblait. Viens, mais vite, vite, nous ne pouvons rester ici. Cet étranger est de ma famille.
Elle entraînait Joséphine vers la voiture qui attendait au dehors. Elles allaient y monter, quand le comte sortit de l’église.
– Pardon, dit-il, le couvent est célèbre par son cellier, il paraît qu’il y a ici un tonneau extraordinaire ?
– J’en ai entendu parler, dit Joséphine, mais je ne l’ai jamais vu.
– Par ici, Votre Grâce, cria tout près d’eux le tonnelier qui était là avec ses aides.
– N’avez-vous pas envie d’admirer cette curiosité ? demanda le comte.
Joséphine, avec embarras, regarda Noémie. Elle s’inclina devant le comte et entra avec Joséphine dans le cellier. C’était une grande voûte murée, autour de laquelle étaient rangés des tonneaux grands et petits dont l’un était assez grand pour que plusieurs personnes puissent danser une ronde dessus en se tenant par la main. Noémie dansa autour du comte, « tandis que ses pensées couraient au loin », comme dit la chanson.
Bientôt elle était de nouveau assise avec Joséphine dans la légère voiture et elles s’éloignaient.
– Connaissez-vous ces deux personnes ? demanda le comte au tonnelier.
Celui-ci secoua la tête.
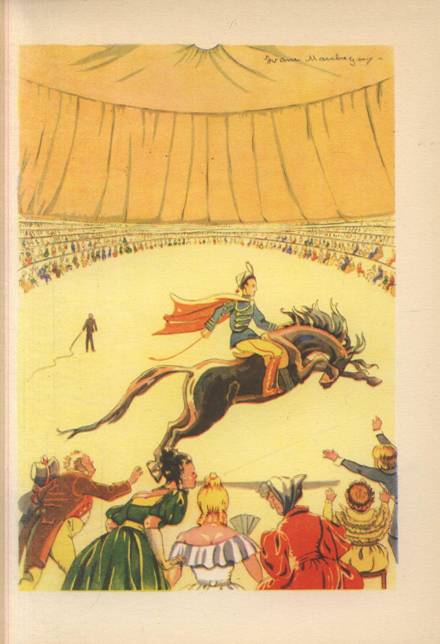
– Ce sont les écuyers du Prater, dit l’un des compagnons. Mlle Joséphine et le petit jockey. Oui, il monte à cheval et fait des tours, mais il ne s’y connaît guère.
La légère voiture suivait le chemin qui descend de la montagne au Danube.
– Il faut que je parte, disait Noémie. Tu as de la famille à Munich, Joséphine. Donne-moi une lettre pour elle ; j’ai encore quelques objets de valeur ; durant les premiers huit jours je ne serai pas réduite à la mendicité, et en huit jours il peut arriver bien des choses.
On a tout dit sur l’amour, tous les degrés, toutes les nuances en ont été décrites, mais on a très peu dépeint la haine et elle est aussi riche, aussi forte. On a plaisir à haïr avec fureur celui qui écrase vos meilleurs sentiments, vos désirs les plus innocents. Noémie haïssait Ladislas, depuis qu’il avait levé son fouet sur elle.
– Je me sentais tellement au-dessus des autres, pensait-elle, et voilà comme il m’a traitée. Je le hais, il m’est odieux comme un serpent venimeux.
– Tu ressembles plus à un homme qu’à une femme, disait Joséphine.
– Aussi vais-je sans doute me tirer d’affaires toute seule dans la vie, comme un homme. Ladislas croit probablement que je suis comme les autres femmes, qui durant deux ou trois jours ont le cœur plein de haine et puis oublient et pardonnent. Moi, je ne le ferai pas. J’ai toujours méprisé le fils prodigue, non parce qu’il mangeait avec les cochons, mais parce qu’il est rentré à la maison. Plutôt mourir que s’abaisser. Je veux partir.
Le même soir, durant la représentation, Ladislas réfléchissait. Il savait que Noémie devait partir, il en était prévenu, il savait qu’elle avait un passeport pour Munich. Elle était la première femme qui osât ainsi le braver et il voulait qu’elle en fût châtiée. Comme il supposait qu’elle était déjà partie à cheval sur la route de Linz, il avait retenu une place dans la diligence allant dans cette direction ; il pensait la retrouver, non pour la ramener au cirque, mais pour lui faire une scène terrible et l’effrayer, elle qui, femme, voyageait avec un passeport d’homme.
Noémie, de son côté, avait considéré la diligence comme le moyen d’évasion le plus pratique. Au moment d’y monter dans la cour de la poste, elle vit Ladislas, elle monta précipitamment, mais il fit de même et s’assit en face d’elle. Elle tremblait de tous ses membres et tandis que la voiture roulait dans la nuit, elle ruminait sa troublante situation. Elle pourrait facilement, pensait-elle, passer la nuit dans la voiture. Elle n’avait qu’à faire semblant de dormir. Mais le lendemain matin, quand ils se rencontreraient au café de la ville de Saint-Polten qu’adviendrait-il d’elle ?
Ils roulaient depuis une heure et étaient arrivés à la petite ville de Hütteldorf qui est, comme Hitzing, une résidence d’été des Viennois. La diligence s’arrêta quelques instants à l’auberge, des messieurs descendirent. Noémie prit une brusque résolution, elle descendit aussi et courut à toutes jambes dans la première ruelle. Elle se jeta dans le fossé du jardin, son cœur battait. La corne du postillon résonna, elle entendit la voiture s’éloigner et dit en son cœur comme la femme de Riquebourg, mais avec une tout autre intonation : « Il est parti ! » Au même instant, des rires et des conversations éclatèrent dans le jardin tout proche. Des dames et des messieurs sortirent par une petite grille dans le pré. C’était toute une joyeuse société, et tous les noms qu’elle entendait lui étaient connus : Mme de Weissenthur, la spirituelle poétesse et l’acteur Costenoble était de la partie.
– Grillparzer, vous lisez votre Sapho demain chez moi, n’est-ce pas ? dit la dame, et tous parlaient gaiement et vivement.
– Bonsoir, bonsoir ! dormez bien, entendait-on.
L’un des messieurs revint sur ses pas, sans doute l’hôte. Il avait un chien qui tout à coup se précipita vers le fossé où était couchée Noémie ; il dressa les oreilles et se mit à aboyer.
– Qui est là ? demanda l’homme.
Noémie se leva.
– C’est une bien mauvaise couche, dit-il, la rosée est tombée, vous n’allez pas dormir ici.
– Pardonnez-moi, dit Noémie, à qui ai-je l’honneur de parler ?
L’homme sourit.
– Je suis Castelli. Et toi, mon ami ?
– Je vous connais depuis des années, vos vers m’ont fait tant de plaisir, dit-elle, mais je ne pensais pas que nous nous rencontrerions ainsi. J’ai confiance en vous : il m’a toujours semblé qu’un poète devait sentir plus intensément, plus noblement que les autres hommes. Le hasard me conduit vers vous, il faut que vous me conseilliez, que vous m’aidiez.
Et elle lui conta toute son histoire.
Le bon, l’excellent homme se sentit, comme tout le monde l’eût été, un peu gêné de cette confidence. Que pouvait-il penser de cette femme ? Le mieux serait pour elle, pensait-il, de s’adresser, à la légation de Danemark. Mais il était nuit, elle était seule, elle était belle, elle semblait sincère. Il appela sa gouvernante et l’on conduisit Noémie à la petite chambre d’amis donnant sur la montagne.
X
VERS L’ITALIE
Le lendemain matin, lorsque Noémie descendit pour le thé, le poète lui tendit aimablement la main, le chien agita la queue et elle le caressa : les aboiements de la brave bête ne leur avaient-ils pas, la veille au soir, servi d’introduction ?
– C’est une bête dévouée et affectueuse, dit le poète ; s’il mourait, j’en aurais du chagrin.
Un cabriolet passait au même instant dans la ruelle et s’arrêtait à l’entrée du jardin. C’était une visite matinale : un jeune docteur danois et un de ses amis qui voulait faire la connaissance du poète. Noémie tressaillit, c’était le comte, celui qu’elle appelait son père. Il fixait étrangement son regard sur Noémie.
Au jardin, durant la promenade, ils purent marcher seuls un instant et converser dans leur langue.
– Noémie, disait le comte, comment as-tu pu t’oublier à ce point ?
– Ma naissance même m’y invitait, répondit-elle. On peut me blâmer, mais j’ai beaucoup de circonstances atténuantes. Ma conduite est une erreur de jeunesse et puis le fruit ne dépend-il pas de la fleur ?
– Quel sera ton avenir ? demanda-t-il.
– Celui des milliers de gens, il ne vaudra pas la peine d’être vécu, mais au moins je me suis sentie vivre pendant quelques jours, je me suis sentie libre. Maintenant cependant votre regard fixé sur moi paralyse ma volonté. Mais je ne suis pas votre fille, je ne suis qu’une étrangère à qui vous avez fait du bien et dont vous pouvez exiger l’obéissance. Comme je ne vous ai pas obéi, vous m’abandonnez, c’est votre droit. Nos chemins se séparent. Tout faux-pas, toute faute porte son châtiment, laissez-moi donc endurer le mien.
– On vient ! dit le comte.
Le poète et le docteur approchaient.
– Nous discutions, dit Noémie avec un visage souriant. M. le comte appelle cette petite fleur pâle une violette et moi je dis que c’est une pensée sauvage ; elle désignait une fleur qui poussait près de l’allée.
Moins de cinq jours après cette conversation, une voiture de voyage roulait sur la route, emportant le comte à demi somnolent et une jeune fille en costume de voyage, tenant sur ses genoux la carte d’Italie et le Mariane starke, le célèbre guide pour l’Italie.
Noémie est en train de rêver de ce pays, c’est pourquoi elle s’abstrait de son entourage immédiat ; ses pensées volent vers le Fata Morgana de la vérité, l’Italie, le foyer sacré de l’Art.
XI
LES ARTISTES LOGENT PRÈS DU CIEL
Il y a, dans la littérature française, une géniale dissertation sur les mansardes, dans laquelle l’écrivain dit : « Chez l’homme, l’esprit et le génie sont logés le plus haut, c’est-à-dire dans la tête ; de même, à Paris, les écrivains et les artistes logent le plus haut, c’est-à-dire dans les mansardes. » Lorsque Scribe nous a donné un vaudeville sur la vie des artistes à Paris, il l’a appelé la Mansarde des artistes. Dans toutes les grandes villes, c’est le lot des pauvres artistes d’être placés très haut... en ce qui concerne l’habitation.
Christian habitait à Copenhague, au cinquième étage, dans une petite mansarde que lui louait une veuve. La vue s’étendait par-dessus les cheminées et les toits jusqu’à la haute tour de l’église où marche le veilleur. Il avait au-dessous de lui des gens riches, qui avaient des salons et des chambres, et toute la rue grouillante et vivante. Mais il avait pour lui le ciel où s’allument les étoiles dans les soirs clairs.
Pour ce qui était de sa chambre, elle était bien plus petite que celle qu’il avait chez M. Knepus : elle formait un triangle avec le plafond, car, depuis la porte, le toit descendait jusqu’à la fenêtre proéminente ; le lit était dans une sorte d’alcôve, dans le toit, et juste en face il y avait une vitre à travers laquelle Christian pouvait, dans la nuit, regarder les étoiles et la lune.
Cependant, d’un cœur reconnaissant, il remerciait Dieu de son rare bonheur. Il donnait quatre leçons de musique par semaine ; pour deux d’entre elles il recevait un mark l’heure, pour les deux autres, qui étaient chacune de deux heures, il avait le repas de midi pendant quatre jours, il ne restait donc que trois jours à se nourrir de pain et de beurre, mais il fallait être économe et c’est pourquoi il brossait et raccommodait lui-même ses vêtements. Si un fil blanc apparaissait, il le teignait tout de suite avec un peu d’encre ; il raccommodait ses bottines avec une aiguille et du fil, cela ne faisait rien que les semelles fussent trouées, pourvu que le dessus eût l’air intact. Ses attitudes étaient naturellement un peu gauches, et elles l’étaient encore bien davantage, parce qu’il y avait tantôt un trou à cacher, tantôt le souvenir que ses vêtements ne supporteraient pas des mouvements hardis. Il aimait mieux avoir l’air de manquer de personnalité que de laisser apparaître sa misère. Il cachait à son hôtesse que, trois jours par semaine, il ne déjeunait pas, il sortait comme s’il allait manger et il allait se promener le long de la mer en grignotant un petit pain ou bien il s’asseyait dans le jardin public près des nourrices et des enfants.
Le vendredi et le dimanche, il mangeait chez le conseiller d’État qui avait navigué jadis sur le bateau de Peter Wik. En cette maison, distinguée entre toutes, le plus élégant de ses hôtes était le fils aîné, jeune étudiant si bien habillé qu’il en semblait presque beau. Il ne parlait jamais à Christian, mais sa mère vantait ses vertus et l’ouvrière en journée renchérissait. Lorsqu’on attendait du monde à déjeuner, on décommandait Christian, cela ne pouvait pas l’amuser de se rencontrer avec des gens qu’il ne connaissait pas... et puis, il n’était pas assez bien habillé.
Le mardi et le jeudi, il mangeait chez le laquais du roi, relation dont il espérait tirer grand profit puisque cet homme pouvait parler de lui chez les grands, – ce que sa femme ne manquait pas de rappeler à chaque instant. – Le laquais pénétrait là où le conseiller d’État et d’autres gens de qualité devaient attendre à la porte. Au reste, sa femme n’avait garde de dire qu’il était laquais, il était dans l’entourage de très hauts personnages.
Christian apprenait la musique à leur petite Hile qui portait le nom de toutes les personnes royales et s’appelait : Marie-Caroline-Wilhelmine-Charlotte-Amélie-Juliane-Frederikke ; pour tous les jours on l’appelait Mikke.
Christian ne se trouvait bien que dans son étroite petite chambre, quoiqu’il y fît froid l’hiver. Il n’achetait le combustible que par infimes quantités, et des fleurs de glace poussaient sur ses carreaux. Il n’avait pas tous les soirs droit à un bout de chandelle, mais cela n’est pas indispensable non plus pour laisser, sur le violon, aller sa fantaisie. Il y avait bien des soirs où l’harmonie des sons était sa seule nourriture, et quoique son jeu révélât un réel talent et une âme originale, personne ne les entendait. Le bonheur ne voulait pas monter tant d’étages pour aller chercher un génie dans une mansarde.
Le conseiller d’État avait des bontés pour Christian, et c’est par son entremise qu’il fut admis un soir à se faire entendre durant un entr’acte à une représentation d’une compagnie dramatique dont il était un des co-directeurs.
C’était un vendredi soir, on avait prêté des vêtements noirs à Christian et son hôtesse l’avait frisé avec des pincettes. Ses joues brûlaient, son cœur battait lorsque le rideau se leva et qu’il sentit sur lui les regards du public.
Il joua bien : le directeur le reçut dans la coulisse et le félicita ; un apprenti coiffeur, qui, lui-même, pratiquait le violon, le remercia et vanta son merveilleux coup d’archet.
– Mon bonheur est assuré, pensait Christian. Ce soir, tout ce monde parlera de moi, ne pensera qu’à moi.
Il ne se doutait guère que tous les acteurs, que tous les figurants pensaient de même.
Rentré dans sa petite chambre, Christian ne pouvait dormir : il pensait à son bonheur, à Lucie, à Peter Wik, mais surtout à Noémie et aux chaudes journées d’été passées avec elle.
Les lettres qu’il écrivait à sa mère ne respiraient que la joie, la jeunesse et l’espoir. Sa mère pensait qu’il était à mi-route de la gloire, puisqu’il allait dans les grandes maisons et qu’il avait joué sur un théâtre. Dans sa pauvreté, elle lui supposait une vie brillante et comme le Bon Dieu lui avait enlevé son petit enfant et qu’elle connaissait le bon cœur de Christian, elle prit place un beau jour dans la diligence qui devait la mener à Copenhague. Elle comptait vivre avec son fils dont elle avait raconté le bonheur aux voisins et aux amis. Elle réservait au cher garçon la surprise de sa venue.
Mais la mère et le fils se retrouvèrent assis dans la mansarde, la neige tombait sur le carreau et l’hôtesse avait l’air vexée.
Tandis que la mère sommeillait sur le lit, Christian pleurait près de la vitre gelée et priait : « Dieu bon, prends pitié de nous ! »
XII
LE BAL CHEZ LA DUCHESSE TORLONIA
Il y avait bal à Rome chez la duchesse Torlonia ; les colonnades étaient brillamment illuminées, les bustes et les statues semblaient vivants dans la lumière des torches. L’escalier d’honneur était décoré d’arbres en fleurs et de tapis multicolores, la galerie de tableaux servait de promenade. Dans les deux plus grandes salles on dansait sur les parquets lisses comme des glaces. Les pièces de côté étaient réservées aux tables de jeux et à la conversation. Des journaux anglais et français parsemaient les tables du cabinet de lecture.
Le comte était en conversation avec un bel Italien aux nobles traits : c’était le sculpteur Canova, fierté de l’Italie. Il montrait Noémie qui dansait avec un jeune officier français.
– Une beauté rare, disait-il, tout à fait un type romain, et pourtant j’apprends qu’elle est du Nord.
– C’est ma fille adoptive, répondit le comte. Le jeune officier qui danse avec elle est un fils du marquis Rebard, l’une des plus brillantes maisons de Paris. C’est un jeune homme spirituel et doué. Je le connais depuis qu’il a seize ans.
Noémie, heureuse de vivre et dans tout l’épanouissement de sa jeunesse, semblait une jeune sœur de la Flore du Titien ou de la Fornarina de Raphaël. Son bras ferme et rond reposait sur l’épaule du marquis. Celui-ci était grand et mince, le regard plein d’esprit et de vie. Il avait à peine passé la trentaine. L’abus de la vie avait quelque peu pâli en lui les couleurs de la santé, mais accru la passion des yeux. Il conduisit Noémie à un superbe divan et lui apporta des rafraîchissements.
À la même heure, dans le nord, où la neige tombait, le pauvre Christian dans sa mansarde, rêvait que Noémie était assise sur le bord du lit, qu’elle lui jetait les bras autour du cou et le baisait sur le front.
Au Prater, Ladislas dormait dans sa baraque, le fouet près de son lit ; lui aussi rêvait d’elle et riait haineusement dans ses rêves.
Mais Noémie les avait oubliés tous les deux dans l’heureuse réalité.
– On se croirait encore à Paris, dit le marquis. Tout ceci rappelle nos salons. Si l’on veut, dans Rome, se faire une idée des fêtes des anciens Romains, de leurs joyeuses bacchanales entre quatre murs, il faut prendre part aux banquets des artistes. Ils boivent, couronnés de lierre et se rafraîchissent le front avec des roses. La plupart des artistes qui sont ici sont Allemands et c’est pourquoi leurs réjouissances rappellent quelque peu les fêtes d’étudiants allemands. Des Français, des Anglais et des Danois se joignent à eux, ils forment en tant qu’artistes une grande nation, celle de l’esprit. À mon premier séjour ici, ou plutôt à mon premier passage, j’ai assisté à une de ces bacchanales modernes. Tous les convives étaient déguisés et dans les costumes les plus baroques. Montés sur des chevaux ou des ânes, ils sortirent dans le matin commençant, par la Porta maggiore. Mes amis et moi avions des lions imités de Zoroastre qui n’étaient en réalité que de pauvres ânes affublés de masques en papier et de crinières en laine. Don Quichotte et Sancho Pança faisaient partie de la bande. C’était tout un cortège de carnaval armé de lances et de sabres de bois. Des chansons en toutes langues résonnaient dans l’air frais. Dans la campagne, au dehors des portes, se tenait le Cerbère à trois têtes, de petits lutins dansaient sur l’herbe verte, les pistolets partirent et Baal brûla. Bien des cavaliers furent jetés à terre par leur monture. Le Chinois Tschang-Tsching-Tschu tomba près de Sa Majesté la reine de Saba. Je n’oublierai jamais cette fête.
Le lendemain après-midi, le marquis, en cabriolet, s’arrêtait sur la place d’Espagne devant l’hôtel où était descendu le comte. Il avait invité Noémie à une promenade en voiture dans les jardins de la villa Pamphilia. Malgré qu’elle fût aux portes de Rome, on pouvait se croire très loin dans la campagne. On ne voit rien de la ville, et une vue étendue s’ouvre sur la plaine où un aqueduc de six lieues, reposant sur des arcs immenses, amène l’eau des montagnes qui, en des courbes harmonieuses, masquent l’horizon.
Quoiqu’on fût en janvier, le soleil était chaud ; on eût dit un beau jour de septembre dans le Nord. Les pins altiers dressaient leur faite de verdure éternelle dans l’atmosphère pure et bleue, des buissons de lauriers donnaient à tout un aspect estival, les oranges pendaient, jaunes, au milieu des feuilles ; les roses et les anémones étaient en fleurs et autour des allées l’eau jaillissait des vases et des statues.
Ils avaient traversé le jardin et se trouvaient de nouveau à la grille qui ouvre sur la grand-route. Sur un chapiteau effondré était assis un moine en robe brune, un chapeau de paille blanc ombrageait sa tête, il portait des sandales à ses pieds nus.
Le marquis le salua comme une connaissance et raconta à Noémie qu’il avait quelquefois la visite du moine.
– Je le vois, dit-il, quand il quête pour le couvent. Lorsqu’il est content de mon aumône, il prend une prise de tabac. Il faut de plus que vous sachiez qu’il est votre compatriote.
– Mon compatriote ! dit Noémie.
Et elle regarda l’homme qui se leva au même instant, mit son sac sur son épaule se préparant à poursuivre sa route.
– Vous êtes Danois ? demanda-t-elle dans sa langue.
– Oh ! Dieu, vous parlez danois ! s’écria-t-il, et ses yeux brillèrent. Je n’en entends jamais, je ne puis, dans ma situation, rencontrer un compatriote. Et vous venez du cher Danemark ?
– Vous y êtes né ? demanda Noémie.
– Oui, né et élevé. J’y ai vécu des jours heureux, mais depuis j’ai eu beaucoup à souffrir avant de me voir ici, dans ce costume.
– Quand vous quêtez pour le couvent, dit Noémie, venez aussi à mon hôtel sur la place d’Espagne.
Et elle donna le nom de son père adoptif.
– Vous êtes sa fille ? s’écria-t-il. Ne me reconnaissez-vous pas ? Je vivais à Svendborg, j’avais une femme et un fils. Oh ! j’ai eu tant de malheur. Je serais mort de faim si le couvent ne m’avait pas recueilli comme frère servant.
Noémie le reconnut : c’était le père de Christian.
XIII
À L’OPERA
Faisons maintenant un grand saut dans l’histoire de Noémie et dans celle de Christian. Douze années ont passé, depuis que la première visitait l’Italie et que le second soignait sa pauvre maman dans la mansarde où elle finit par mourir.
Nous sommes à Paris, au commencement de l’année 1833, le drapeau tricolore flotte sur la colonne Vendôme ; devant les boutiques sont exposées les caricatures de Louis-Philippe, le roi bourgeois choisi par le peuple.
À l’Opéra on donnait ce soir-là, non une pièce complète, mais plusieurs actes d’œuvres différentes. Le second acte de Guillaume Tell était terminé, on était à la fin du Comte d’Ory et on allait jouer le second acte du ballet la Tentation. Deux Danois montaient les larges escaliers, traversaient les foyers brillamment illuminés où les lumières se reflétaient dans les glaces des murs, puis les longs couloirs qui menaient jusqu’à la loge du marquis Rebard. Plusieurs messieurs élégants semblant échappés de gravures de mode, se tenaient, le chapeau et les gants à la main, derrière des dames en robe de bal. Le dernier chœur du Comte d’Ory venait de finir, le rideau tombait et le vendeur de programmes parcourait le parterre et les loges criant d’une voix retentissante : « Lorgnettes... programme officiel et complet... la pièce... »
Le marquis, de douze ans plus vieux que nous l’avions vu en Italie, reçut, avec une galanterie bien française les deux Danois dont l’un était de ses amis et l’autre une nouvelle connaissance amenée par cet ami. Une belle femme, un peu forte, avec des yeux sombres et intelligents, un port de reine, et qui n’était autre que Noémie devenue marquise Rebard, salua de l’éventail le nouvel étranger qui se présenta comme chef d’un régiment danois ; il était Holsteinois de naissance ; la marquise le connaissait, il avait été, au Danemark, un de ses prétendants. Un tremblement de la paupière fut l’unique mouvement de surprise de Noémie ; immédiatement elle fut de nouveau la marquise, la femme du monde ; peut-être même que ce tremblement n’était que l’effet du hasard, mais le prétendant d’autrefois le remarqua. Il demanda à Noémie de lui expliquer le ballet qui allait commencer.
– Le principal est le coup d’œil, dit-elle. L’intrigue est sans intérêt. C’est une histoire de la tentation de saint Antoine. On jouera le second et le troisième acte, vous verrez Taglioni. Le premier acte se passe dans les montagnes sauvages choisies par saint Antoine pour sa résidence, une natte de jonc lui sert de couche. Tout en haut de la montagne passe une noce, saint Antoine écoute et pense aux félicités de la terre. Une femme lui apporte des fruits et du vin, il les refuse, mais la faim et la soif l’obligent à y goûter ; le vin réchauffe son sang, il boit encore, il vide gobelet sur gobelet. À moitié ivre, il veut frapper la femme qui lui a porté à boire, mais la Vierge retient son bras et la foudre frappe saint Antoine. Alors, sur des nuages noirs et rouges, les esprits du mal s’élèvent des bas-fonds pour saisir son âme, mais du ciel descendent des nuages d’argent avec des anges agenouillés au milieu desquels se tient saint Michel armé de son bouclier. Un combat s’engage entre les bons et les mauvais esprits ; saint Michel lève son bouclier, ordonne la paix et permet à l’âme du mort de rejoindre son corps.
Le rideau se leva sur le second acte. On était dans un cratère tout au fond d’un volcan éteint, un immense escalier de toute la hauteur de la scène formait la toile de fond et plusieurs centaines de démons dans les costumes les plus fantaisistes le descendaient. La fumée s’élevait en figures démoniaques et de celle-ci surgit soudain une belle femme destinée à porter le mal sur la terre. Les démons paraient leur enfant, lui apprenaient l’usage de ses sens. Une boucle de cheveux noirs, sur sa poitrine, indiquait seule son origine. Guidée par les démons, la fille du mal s’éleva jusqu’à la terre.
Noémie était assise comme en un rêve et fixait le spectacle. Le sang lui monta brusquement aux joues, puis elle pâlit, ses yeux se fermèrent.
– Mais vous vous trouvez mal ! murmura le Danois.
Elle ouvrit les yeux et respira profondément.
– Oh ! ce n’est rien, dit-elle, j’ai senti un vertige, mais c’est passé. On ne peut supporter la fantaisie de ce sabbat démoniaque. On dirait un vrai cauchemar.
Lorsque le rideau tomba, il était plus de minuit, et à la maison du marquis des invités attendaient l’hôte et l’hôtesse.
– Vous trouverez chez nous Alexandre Dumas et quelques-uns des jeunes peintres qui se sont distingués dans les décors de la Tentation, dit Noémie au Danois nouvellement venu.
Ils gagnèrent en voiture l’hôtel du marquis où les invités les attendaient dans des salles magnifiques.
Un jeune homme commença une conversation avec le Holsteinois et lorsqu’il sut qu’il était Danois, il lui parla de l’opéra Gustave, qui devait l’intéresser comme l’œuvre d’un compatriote, puis de Bernadotte, le roi suédois qui avait été un général français. Ses notions de la Scandinavie semblaient quelque peu apocalyptiques. Il paraissait, au contraire, fort bien connaître les littératures anglaise, italienne et allemande.
Noémie, qui se tenait près d’eux, sourit en affirmant qu’elle admirait également Faust.
– Ses fragments me font l’effet, disait-elle, d’une prodigieuse comète qui se terminerait en une lamentable queue.
Puis elle parla du Danemark et de la Scandinavie qui était, à son avis, le vrai pays romantique, elle loua la mélancolie des fjords, des torrents mugissants, comparables à ceux de Suisse, et des grands bois sombres.
Un monsieur décoré donna à la conversation un tour politique et Noémie se montra sur ce terrain aussi à l’aise que sur d’autres. La marquise était fort admirée et méritait de l’être. L’esprit et la joie de vivre brillaient dans ses yeux noirs.
Il était trois heures du matin lorsqu’on éteignit les lumières dans l’hôtel.
Seule, assise sur son lit en robe de nuit, un de ses bras ronds sous le menton, ses longs cheveux tombant sur ses épaules, Noémie songeait. Ses joues brûlaient, comme fiévreuses, elle but un grand verre d’eau.
– Comme je suis malheureuse ! soupira-t-elle, et pourquoi dois-je tant souffrir ? Pourquoi toujours flotter dans cet imaginaire tourment qui augmente tous les ans ? Elle pensa aux démons de la Tentation. Oh ! si son passé pouvait sombrer dans le néant comme nous-mêmes sombrerons dans la mort. La vue de mes compatriotes m’est un supplice et de plus je sais que mon bourreau se trouve à Paris. Ladislas me surveille. Je voudrais que son cadavre fût au fond de la Seine. Je ne veux plus me torturer. Non, mieux vaut respirer le parfum de cette vie facile. Elle regarda le portrait du marquis suspendu au mur.
– Il sourit, pensa-t-elle, oui, moi aussi je devrais sourire, mes péchés de jeunesse ne sont pas plus grands que les siens... et pourtant...
Le jour filtrait à travers les rideaux lorsqu’elle se jeta sur son lit et s’endormit d’un sommeil profond.
XIV
DEVANT LA COLONNE VENDÔME
Louis-Philippe avait fait construire, tout autour de Paris, des forts pour défendre la ville, mais les Parisiens disaient qu’ils ne serviraient qu’à les bombarder. Les adversaires du roi bourgeois commençaient à élever la voix. À mesure que les fêtes de juillet approchaient, paraissaient des caricatures de plus en plus hardies et des allusions significatives aux révoltes de demain.
On avait pensée, pour ces journées historiques, pouvoir dresser sur la place Louis XV la pyramide d’Égypte, mais comme elle n’était pas encore arrivée, on se contenta d’élever une copie du monument en bois pour la remplacer. Les trois journées de fête devaient être splendides ; le couronnement serait l’inauguration du monument de Napoléon sur la place Vendôme. Des ouvriers fort affairés travaillaient sur les échafaudages ; à la nuit on hissa la statue de l’Empereur sur la colonne, on la couvrit d’un voile bleu à abeilles d’or en attendant l’instant convenu.
Noémie prévoyait bien que ces trois jours de fêtes seraient l’occasion d’un orage politique. Elle avait hâte d’y assister, d’abord parce que son âme inquiète avait besoin de mouvement, ensuite parce qu’elle espérait que Ladislas, qu’elle savait à Paris, pourrait se trouver parmi les meneurs ou les victimes.
Les trois jours approchaient et apportaient un peu de joie sous forme d’un magnifique trousseau aux filles des héros morts. Au lever du soleil, l’air résonnait du bruit des canons de l’Hôtel de Ville et des Invalides. La bannière tricolore flottait sur le Pont-Neuf et au sommet des tours de toutes les églises. L’Hôtel de Ville et le pont d’Arcole étaient ornés de trophées et de guirlandes.
Sur la place de la Bastille, à la Fontaine des Innocents et devant le Louvre, on avait érigé des autels de deuil, ornés de crêpe, de drapeaux et de couronnes d’immortelles où revivaient des noms glorieux, la musique funèbre s’élevait et chaque quart d’heure était marqué d’un coup de canon. Un étrange silence planait sur Paris, d’ordinaire si bruyant. Les voitures marchaient au pas comme pour un cortège de deuil ; lentement les passants traversaient la ville et allaient jeter des fleurs sur des tombes.
Noémie, parcourant les rues en voiture découverte, au milieu des piétons pressés jusque contre les roues, sentit une main effleurer la sienne et lui glisser un billet. Il était de Ladislas ; il avait essayé de l’atteindre dans son hôtel, mais on l’avait renvoyé. Il lui demandait une entrevue et menaçait de faire connaître à son mari son escapade de jeune fille aventureuse.
– Combien de personnes a-t-on trouvées la nuit dernière, tuées dans Paris et les faubourgs ? demanda Noémie à sa femme de chambre.
– Vingt-trois, madame, tuées et jetées à la Seine. C’est terrible, n’est-ce pas ?
– Les Parisiens ont le sang chaud ! dit Noémie. Tout est-il tranquille ?
– Oui, mais j’ai peur pour la fête de demain.
– Moi aussi, dit Noémie.
Et sa pensée était auprès de Ladislas.
Durant le second jour de fête, le boulevard était noir de monde, les gardes nationaux faisaient la haie sur les avenues, aux fenêtres et aux balcons des milliers de personnes se penchaient, les gamins étaient suspendus aux arbres.
Louis-Philippe se montra entouré de ses fils et de ses généraux. Il leva la main et salua ses sujets. Un « Vive le roi ! » retentit qui se mêla au cri de « À bas les forts ! » Le voile bleu semé d’abeilles d’argent couvrait encore la statue de Napoléon sur la colonne Vendôme. Le roi et les plus grands hommes d’État étaient debout devant la colonne ; le signal résonna, le voile tomba. « Vive la mémoire de Napoléon ! » cria-t-on avec admiration.
Noémie laissa tomber les yeux sur la- foule mouvante, et, sous la fenêtre, au milieu des tonneaux dressés sur lesquels certains étaient grimpés, elle aperçut Ladislas, malade et amaigri. Il la regardait fixement et souriait comme le démon du ballet ; il étendit la main et fit semblant d’écrire en l’air.
Noémie s’éloigna de la fenêtre. La revue devait durer plusieurs heures ; le moment le plus solennel était passé ; elle prit le bras du marquis et manifesta le désir de partir. Ils ne purent sortir que par le derrière des maisons ; dans un couloir ils croisèrent une vieille femme qui mit un billet dans la main du marquis. Celui-ci le cacha immédiatement, mais Noémie avait vu le geste.
Dans la soirée, il devait y avoir un grand concert populaire aux Tuileries avec cinq cents musiciens et trois cents tambours. Sur la Seine des bateaux illuminés se livraient à des batailles ; les tours des églises et des coupoles étaient cernées de flammes ; dans l’air bleu crépitait un magnifique feu d’artifice.
– La vie est bruyante comme cette musique et brillante comme cette lumière artificielle, pensait Noémie, mais pourquoi donc me torturer ? mon mari n’apprendra jamais que j’ai été écuyère de cirque.
– Je ne te montrerai pas le billet, avait-il dit quand elle lui en avait parlé, il pourrait troubler ta tranquillité.
Durant le troisième jour de fête, Noémie et le marquis allèrent en voiture aux Champs-Élysées où deux cirques donnaient à tour de rôle des représentations. Il y avait des années que Noémie n’avait vu des écuyers et elle n’y tenait pas du tout, mais le marquis en avait envie, et il ne voulait pas dire pourquoi. Noémie en fut blessée ; elle rit et fit allusion, en le taquinant, au billet de la veille.
– Les époux, dit-elle, ne doivent rien se cacher l’un à l’autre, même s’il ne s’agit que d’un petit secret.
Il la regarda fixement ; elle sourit et trouva qu’il était troublé. Autour d’eux, tout était fête et plaisir, quatre orchestres jouaient en même temps, les gens du peuple grimpaient au mât de cocagne. Un tournoi sur la Seine attirait la foule : des bateaux allaient et venaient ; sur chacun d’eux se tenait un marin bleu ou rouge qui brandissait une lance munie d’un disque avec lequel il frappait son adversaire. Celui qui tombait à l’eau devait gagner la rive à la nage au milieu des acclamations qui saluaient le vainqueur.
Le regard de Noémie errait avec inquiétude dans la foule ; son esprit n’était pas à tous ces spectacles. Le marquis, au contraire, semblait y prendre grand plaisir.
Le soir, tandis qu’elle s’apprêtait à mettre sa superbe toilette, que les brins de paradis flottaient dans son magnifique turban, que les pierres précieuses étincelaient sur sa poitrine agitée, elle se regardait dans la glace avec fierté.
On frappa à la porte, la femme de chambre lui remit une lettre. Elle était du marquis et ne contenait que deux lignes, les propres paroles de Noémie ce matin-là : « Les époux ne se doivent rien cacher l’un à l’autre, même s’il ne s’agit que d’un petit secret. » Le marquis avait joint à ce laconique billet une longue lettre de Ladislas. Tout y était raconté, depuis le départ de Copenhague, toute sa vie d’écuyer de cirque, jusqu’au coup de fouet. Noémie blêmit.
– La voiture de Mme la marquise est avancée, annonça-t-on au même instant, M. le marquis attend.
Elle faillit se trouver mal. Le satin bruissait, les diamants étincelaient. Le marquis la conduisit à la voiture ; deux messieurs, amis de la maison, les accompagnaient. La conversation était fort animée.
Au milieu des chants et des illuminations, la voiture s’arrêta et on descendit devant l’Hôtel de Ville.
Les escaliers étaient ornés de tapis aux riches couleurs et de fleurs odorantes, et l’on avait relié les deux salles de danse au premier étage par un jardin suspendu garni d’orangers et de lumières vives, où jaillissait une fontaine d’eau de Cologne. Dans la plus grande salle, on avait dressé le trône royal et des deux côtés s’élevaient des estrades avec des fauteuils en gradins sur lesquels les dames prenaient place. Bien que Noémie n’appartint plus à la prime jeunesse, sa beauté, en harmonie avec sa parure, lui valait les compliments de tous. Elle souriait et semblait heureuse, éblouissante comme le papillon sur son épingle.
Lorsqu’à deux heures du matin le marquis et Noémie partirent, les rues étaient encore animées, l’illumination continuait.
– Tu m’as envoyé une lettre, dit-elle à son mari, dont chaque mot était vrai. Quelle est ta décision ?
– De te la lire quand tu prétendras t’interposer entre moi et mes plaisirs qui sont connus de tout Paris. Je veillerai pour ma part à ce que cette histoire ne s’ébruite pas dans le monde. L’été prochain nous visiterons le Nord ; je veux voir cette verdure odorante dont toi et tes compatriotes m’avez si souvent parlé. Ce sera un voyage fort intéressant pour nous deux, mais lie manque pas d’emporter la lettre ; elle pourra te servir un jour.
XV
RIEN QU’UN VIOLONEUX
Au Danemark, dans la propriété du comte, la comtesse était entourée de ses flacons et de ses poudres, aussi près de la mort que douze ans auparavant. « Elle a la vie dure, disaient les gens, même les drogues n’arrivent pas à la tuer. » L’église de campagne était douée d’un nouveau clocher ; dans l’école reconstruite, les rideaux blancs derrière les carreaux avaient bon air. Deux petits garçons jouaient devant la porte : avec des aiguilles de pins desséchées ils avaient fait tout un jardin fleuri. Une femme d’une trentaine d’années était assise auprès d’eux et les regardait d’un air tendre ; chaque fois qu’ils demandaient quelque chose, elle leur faisait signe de se taire, car le père lisait le journal à haute voix. C’était Lucie et son mari, le maître d’école du village.
– C’est demain dimanche, dit le plus jeune enfant, dont le joli visage, les yeux bruns et vifs contrastaient avec le visage ingrat de l’aîné. C’est demain dimanche, alors le violoneux va venir avec du pain blanc et des images, il n’est pas venu dimanche dernier.
– Oui, demain Christian viendra, dit l’homme en posant son journal. Il pourrait bien venir tous les dimanches assister aux offices ici, au lieu de fréquenter ces assemblées secrètes. M. Patermann interdit ces réunions, où l’on discute les saintes Écritures.
– Cela ne peut pas être mal, dit Lucie. Il vaut mieux croire trop que trop peu. Celui que le monde repousse est toujours éloigné de la voie droite et il est encore bien heureux s’il vient à s’égarer dans la direction de la Bible et sur les chemins du Seigneur.
– Mais Christian n’a pas eu de la malchance, dit l’homme, au contraire ; il était un enfant pauvre, ton oncle a été très bon pour lui. Il a un peu souffert à Copenhague, mais bien d’autres ont été dans son cas ! Et puis, quelle idée insensée d’avoir pris sa mère avec lui ! Ton oncle m’a raconté comment il l’avait trouvé dans le dénuement le plus complet et comment il le fit venir ici, où on le réclame dans les fermes à chaque fête, à chaque mariage, pour diriger la musique. En somme, ce garçon a bien réussi.
– C’est qu’il ne rêvait pas d’être un violoneux de campagne. Il voulait courir le monde et se faire un nom célèbre, seulement il n’avait personne pour le pousser, et cela est nécessaire sans doute. Mais je crois qu’il est calme maintenant ; quand son espoir sur terre s’est évanoui, il s’est tourné vers le ciel.
– Oui, mais avec les mêmes illusions aveugles, dit l’homme ; il devrait se marier, il s’en trouverait bien. Un célibataire est une chose bien triste ! Une brave femme comme toi, Lucie, le rendrait plus heureux. À un moment, je lui en voulais même, parce que je croyais qu’il avait tourné autour de toi. Peter Wik regardait cela d’un bon œil ; il aurait aimé vous voir mariés.
– Les pensées de Christian ont toujours été bien loin de moi, dit Lucie ; tout petit, il aimait Noémie et il l’a toujours aimée. Mais ils n’étaient guère faits l’un pour l’autre ; elle était trop belle, c’est cela qui le tourmentait. Je lui ai raconté ce qu’on disait, qu’elle s’était sauvée de chez elle pour être écuyère de cirque et cela lui a fait une impression si cruelle que, depuis ce moment, je n’ai jamais prononcé son nom devant lui, mais je suis sûre qu’il y pense toujours.
– Maintenant, reprit le mari, on dit qu’elle est une grande dame en France. Il paraît qu’elle viendra au Danemark l’été prochain. Toutes ces histoires étaient peut-être fausses ou alors elle a peut-être eu l’occasion de rencontrer au cirque quelque noble de ces grandes familles qui s’enfuirent sous la Révolution et qui sont maintenant revenues à l’honneur.
Le lendemain, Christian apparut et il embrassa les enfants, le plus jeune surtout, parce qu’il était le plus beau.
– Si j’avais été beau comme toi, pensait-il, tout aurait été autrement. Quel bienfait du ciel que la beauté ! chacun lui sourit, on l’entoure, mais le visage peut tromper, il y a aussi l’esprit, il y a l’âme ! Et pourtant la beauté est un plus grand bien que l’intelligence ou le génie.
Cela ne l’empêcha pas d’embrasser plus tendrement le plus beau des enfants de Lucie et de lui donner la plus belle image et la plus grosse part de gâteau.
La table était servie pour le déjeuner. La nappe était d’une étincelante blancheur et les enfants savaient qu’il y aurait un plat supplémentaire, comme tous les dimanches où Christian venait. Ils trouvaient même qu’il pourrait bien venir tous les dimanches, puisqu’il n’avait que deux lieues à faire.
Christian était enfant avec les enfants et écoutait avec patience les taquineries du maître d’école.
– Tu seras riche, lui disait-il, il faut seulement que tu te maries. Il n’est pas bon que l’homme soit seul. Prends une femme, sinon pour qui serait donc tout ce que tu as dans ton coffre ? Et surtout ne fréquente pas ces réunions qui nous amèneront le catholicisme.
Quand il en arrivait là de la conversation, il était dans son élément, fulminant contre le pape et l’Église.
– Le catholicisme a fait beaucoup de bien, disait Christian. Sa semence a levé maintenant et nous a apporté de la nourriture et de la force ; l’Église veillait seule, dans les temps barbares, sur les sciences et les arts ; elle a protégé l’esprit contre la force brutale.
– Mais maintenant elle a dégénéré, criait le maître d’école. Elle est devenue le tyran de l’esprit et de la liberté.
– Est-ce que vous vous disputez encore ? demanda Lucie en se moquant.
– Il tient aux catholiques, dit son mari, il n’y a rien à espérer de lui.
– Je veux seulement que l’amour se répande sur toutes les sectes religieuses, répondit Christian.
Le soleil et les enfants étaient couchés avant que Christian ne songeât à se remettre en route pour rentrer chez lui. Il faisait un beau clair de lune et l’âme du musicien en était tout amollie. En de semblables instants il sentait comme un grand trésor spirituel enfoui en lui-même et qu’il n’arrivait pas à amener au jour.
Mais l’instant d’après il redevenait lui-même, et l’espoir seul demeurait que dans l’autre vie, – celle des âmes, – son rêve se réaliserait. Il n’avait pas fait encore la moitié de son chemin que déjà il n’était plus gai, comme la belle nature exigeait qu’on le fût. Et pourtant, n’aurait-il pas dû être heureux ? Il n’avait pas eu dans sa vie de grand malheur ; le prêtre dirait sur sa tombe : « Ses jours ont coulé calmes et heureux, aucun orage ne passa lourdement sur sa tête. » Non, il faisait gris, toujours gris, mais il aurait pu s’hypnotiser sur ce gris jusqu’à le transformer en azur.
Personne à son foyer pour lui souhaiter la bienvenue, il était là, seul, comme nous le serons tous dans la tombe. Il alluma, ferma les volets de bois devant les carreaux et ouvrit la porte pour que la cigogne, qui vivait avec lui comme animal domestique, pût entrer. Puis il ouvrit un grand coffre peint en bleu dans lequel il prit deux lourds sacs d’argent. Il les secoua, les vida sur la table, compta les pièces, les mit en piles et sourit comme il avait souri aux enfants de Lucie.
– J’en ai tant que ça ! pensait-il. Quel trésor pour elle ! Dans la détresse elle reviendra un jour, les autres la renieront, mais moi je serai pour elle un frère, elle ne souffrira plus.
Et sa pensée volait au loin vers Noémie. Une fantaisie de jeunesse l’avait jetée à travers le monde, cela ne pouvait que mal finir. Une troupe ambulante la ramènerait, pauvre et malade ; alors il serait son soutien.
Combien de fois n’était-il pas allé à la ville voisine lorsque passaient des cirques, avec l’espoir d’y trouver Noémie !
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L’hiver n’apporta que la boue, la neige fondue et les jours gris. Les branches étaient mouillées dans la forêt, et la verdure éternelle des pins paraissait, au milieu du brouillard, prise sous une immense toile d’araignée. La nature semblait une chrysalide qui ne se développerait en papillon que quelques mois après, au soleil.
Bien que la santé de Christian fût éprouvée, il ne manquait pas, tous les quinze jours, le dimanche, l’invitation de Lucie. Elle fut fort étonnée, un jour de semaine, de le voir arriver et plus pâle que d’habitude.
– Tout va bien, dit-il, mais je n’ai pas grand-chose à faire et je m’ennuyais après les enfants.
Il n’avoua que fort longtemps après, qu’il avait appris du nouveau ; le jardinier du château lui avait raconté qu’on attendait, au printemps, des étrangers, un marquis français et sa femme qui n’était autre que Noémie, mariée avec lui depuis de longues années. Christian avait les larmes aux yeux.
– Oui, je ne suis pas bien, disait-il, un rien me bouleverse.
C’était l’effondrement du dernier rêve de sa vie. li n’ouvrirait plus le coffre, il ne compterait plus le trésor amassé pour Noémie.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L’hiver fut long, gris et triste. Le mois de mai seulement amena les premiers beaux jours. Les enfants de Lucie, en larmes, entouraient le lit où Christian, malade, était soigné par leur mère.
– Merci pour toute ton affection, Lucie, dit-il, il fait tout de même bon sur terre. Je me souviens de ce que tu m’as appris il y a des années : « Les dons ordinaires de Dieu sont si grands que c’est pécher que d’en demander davantage. » Celui qui est très haut reçoit toute la tempête qui ne nous atteint pas, nous qui sommes en bas. L’homme de génie vit dans les rayons, mais les rayons le brûlent.
« Donnez aux enfants, lorsque je serai mort, ma Bible ; ils y trouveront la clé d’un trésor que la rouille n’attaque pas. Je verrai Noémie avant de mourir, je la verrai, je le sens.
– Ne parle pas de mourir, dit Lucie. Tu ne mourras pas encore, nous vivrons de longues années ensemble.
*
* *
L’hirondelle était revenue, la cigogne était dans son nid et les Danois étaient fiers de leurs forêts vertes, lorsque Lucie joignit les mains du mort, lui ferma les yeux et montra pour la dernière fois aux enfants le cher Christian. Les petits pleuraient.
– Il est bien mieux qu’il n’a jamais été, fit-elle.
On ferma le cercueil et les paysans le portèrent sur leurs épaules, hors de la maison. Lucie suivait avec son mari et les deux enfants. Le chemin était étroit jusqu’au cimetière, ils croisèrent en route une voiture de maître attelée de quatre chevaux qui amenait au château des invités de marqué : le marquis et Noémie.
Les paysans descendirent dans le fossé avec le cercueil pour permettre à la voiture de passer ; ils se découvrirent et la grande dame, Noémie, au regard fier et au sourire séduisant, passa la tête à la portière et salua.
C’était un pauvre homme qu’on enterrait, un petit musicien seulement, rien qu’un violoneux.
Hans Christian ANDERSEN,
Rien qu’un violoneux,
traduit du danois et présenté
par Anne-Mathilde et Pierre Paraf.
Illustrations de Ivane Marchegay.
Librairie Gedalge, 1951.