La « liberté » des communistes
POLICE, PRISONS ET CAMPS SOVIÉTIQUES
par
Sylvestre M. et Pierre Z.
1945
(Réimpression en 1975.)
AVERTISSEMENT DE L’ÉDITEUR
Le document que nous publions a paru en français, tel que nous le reproduisons, à Rome, en 1945, chez un éditeur dont nous n’avons pu retrouver le nom sur la liste des éditeurs italiens. La présentation du volume, le format, la typographie, la pagination, les gaucheries de la mise en page font penser que le livre fut publié par les auteurs eux-mêmes. Trente ans avant Soljenitsyne, Sylvestre M. et Pierre Z. avaient décrit les procédés de la justice soviétique, les articles du code qui permettent d’éliminer les ennemis du régime, les interrogatoires, les jugements en l’absence des accusés, les convois de déportés, les camps du Goulag. Depuis trente ans, cet acte d’accusation existait et personne dans la presse française ne prit la peine d’en signaler l’existence.
C’est pour garder à ce témoignage toute son authenticité que nous avons fait une édition photographique reproduisant sans aucune altération possible le texte qu’on pouvait lire en 1945 et qu’on refusa de connaître. La mauvaise qualité de l’impression originelle explique l’apparente imperfection du présent volume. Cette imperfection est volontaire. Nous avons voulu mettre sous les yeux du lecteur, telle qu’elle était, l’accablante déposition qui accuse à la fois la barbarie du communisme soviétique et l’hypocrisie des « grandes consciences » qui se sont tues.
INTRODUCTION
La Russie Soviétique, consciemment et dans un but bien défini, a créé autour d’elle une atmosphère de mystère, grâce à laquelle elle a caché jusqu’à présent et cachera sûrement encore dans l’avenir les nombreuses surprises gui nous attendent
Un vaste ensemble de fables les plus diverses, de théories, d’espoirs, de désillusions et de craintes s’est formé sur son compte.
Ce qui a été dit au sujet de l’URSS peut âtre comparé à un gigantesque pendule d’une grandeur extraordinaire. L’un de ses points extrêmes est la foi irraisonnée des masses, formée par la propagande communiste et par de nombreux bourgeois intellectuels découragés ; l’autre, la conviction de ceux qui ont traversé la Russie et qui ont connu de près sa vie dans presque tous les domaines, que le Moscou de Lénine et de Staline a créé uniquement une forme nouvelle de l’ancien absolutisme. La position centrale plus basse du pendule correspondrait à un troisième groupe d’observateurs, ceux qui sont persuadés que la Russie est sur la voie de changements intérieurs démocratiques et qu’elle a abandonné l’idée d’une révolution mondiale.
À l’époque de la lutte des nations contre le totalitarisme allemand et alors que la Russie appartenait formellement à l’union des nations démocratiques, le pendule oscillait non loin de la médiane. L’attention anxieuse du monde se trouve à présent en face du triple dilemme russe : la Russie continue-t-elle à marcher dans la voie de la révolution mondiale, ou, au contraire, est-elle entrée dans le champ des réformes intérieures démocratiques ? Ou bien faut-il donner raison à ceux qui ne cessent de prétendre que le nouvel absolutisme bolchévique réserve une autre surprise catastrophique à la civilisation occidentale ?
Ceux qui croient à la « Russie démocratique » et à son arrêt dans l’expansion révolutionnaire, compte tenu de la force militaire russe, attachent la plus grande importance aux réformes intérieures déjà initiées en Russie et ont confiance, pour l’avenir, en leurs résultats.
La dissolution du Komintern, le rétablissement de l’Église orthodoxe, les épaulettes tsaristes sur les uniformes des officiers bolchéviques, l’indépendance plus grande en apparence des Républiques fédérées, par rapport à Moscou (toutes choses bien présentées par la propagande), confirment à l’étranger l’espérance que « la nation russe, aimante de la paix » se limitera, après avoir repoussé l’invasion allemande, à reconstruire son propre pays et entrera dans la voie des changements intérieurs dans un esprit démocratique.
La conception de la paix future se base sur cet espoir et sur la conviction que la « mission russe » saura s’arrêter aux limites établies et ne pas entrer en conflit avec les intérêts des autres grandes puissances du monde.
Dans les mêmes publications où les hommes d’État et les publicistes développent les plans-bases de la paix sur la suprématie de trois grandes puissances, sont énumérées, en longues colonnes, des récriminations et des observations, à l’adresse de ceux qui firent l’accord de Versailles, accusés d’avoir commis une série d’erreurs dans la rédaction du traité de paix conclu après la 1re guerre mondiale. Mais seront-elles exemptes d’erreurs, les appréciations de la réalité actuelle et les directives à prendre pour le futur, surtout en ce qui regarde la Russie et son avenir ?
En cherchant une réponse à cette question, nous nous arrêterons tout d’abord à considérer la nature et la valeur pratique des réformes intérieures soviétiques qui, en toute occasion, sont soulignées.
Une connaissance plus profonde de l’essence de l’État soviétique dans sa structure judiciaire et ce qui se pratique actuellement nous autorisent à affirmer que le remaniement vanté de la ligne de conduite temporaire communiste en ce qui concerne la nationalisation et la démocratisation du régime, n’est qu’une manifestation de la nature élastique de la révolution bolchévique fondée sur une éthique pour laquelle les moyens sont complètement indifférents. Aucune réforme ne touche et ne change en quoi que ce soit le système bolchévique, de parti unique et absolu, tel qu’il a toujours été. Nous avons affaire ici à un voile épais de fumée, cherchant à détourner l’attention du monde des vraies et plus caractéristiques institutions d’un État basé sur la dictature du prolétariat.
Le fait d’avoir remis les épaulettes aux uniformes des officiers et d’avoir rétabli le Saint Synode de l’Église orthodoxe n’a pas été précédé de l’abolition du premier et du second article de la Constitution de l’URSS, qui déclarent que l’Union Soviétique est un « État socialiste d’ouvriers et de paysans ».
Le système du parti unique, qui trouve son expression dans le privilège constitutionnel du parti communiste, n’ai pas été modifié ; l’athéisme n’a pas été exclu du programme du parti et, ce qui est encore plus important, il n’a été réalisé aucune réforme pouvant justifier la confiance en une évolution quelconque de l’URSS vers la démocratie : jusqu’à présent, on n’a pas su ni entendu que, dans un avenir prochain, il dût être réalisé en Russie une séparation des pouvoirs et plus précisément l’indépendance de l’administration de la justice du gouvernement, ce qui est fondamental pour tout régime démocratique. La justice, en Russie soviétique, n’a pas cessé d’être, jusqu’à ce jour, « un instrument du pouvoir prolétaire des ouvriers et des paysans ».
Sans la liquidation du système du parti unique et sans l’indépendance de l’administration de la justice, on ne pourra parler en Russie de démocratie ou de liberté d’action d’une institution sociale quelconque. Sans ces deux changements, toute institution, dans l’Union Soviétique, que ce soit l’Église ou un asile pour l’enfance, ne sera jamais « qu’un instrument du pouvoir prolétaire des ouvriers et paysans », encore un soutien de la dictature totalitaire rouge.
C’est seulement après avoir pris connaissance des principes de la justice bolchévique, de l’esprit des lois soviétiques et de leur mise en pratique, qu’on peut comprendre l’abîme profond qui pare le monde de la culture occidentale européenne et l’idéologie eurasiatique bolchévique.
C’est, en effet, dans le champ de la justice, dans les principes et les théories du droit en vigueur dans un territoire déterminé, que se révèle peut-être, dans sa forme la plus essentielle, l’appartenance de ses habitants à telles ou telles culture et civilisation.
Dans le Droit de l’Europe occidentale dominent deux caractères fondamentaux de notre civilisation : la tendance à baser les activités humaines sur les valeurs objectives et la recherche de la vérité. La manière européenne de voir, basée sur ces deux principes, a ouvert la voie à la force créative individuelle et à un régime démocratique, qui lui est indissolublement lié. De fait, on trouve, dans les sources les plus profondes et éloignées de la pensée européenne, le respect de la personnalité humaine, de l’individu, dont la dignité a été relevée par le christianisme.
À cette manière de voir s’opposent des tendances d’esprit qui basent l’activité de l’homme sur des concepts relativistes et sur l’éthique de l’indifférence des moyens de lutte et, en général, sur le mépris complet du droit individuel, ce qui est le caractère propre de la culture eurasiatique. Tels sont les principes sur lesquels repose tout régime à parti unique et terroriste et sur lesquels est basé l’entier système de l’administration de la justice dans ce régime. Or, dans aucun champ ne se manifestent avec autant de force le brutal et réel renversement et la dégradation de la dignité et de la personnalité humaine, que dans les conséquences du système pénal soviétique. L’individu n’est plus qu’un coefficient dans le nombre, occupant une place insignifiante dans la masse, sacrifié aux intérêts du Moloch de la révolution des classes et de la dictature du prolétariat.
Si donc nous voulons avoir un aperçu exact des possibilités d’évolution de l’Union Soviétique et du caractère de son influence sur le monde après la guerre, nous devons connaître les principes de l’administration de la justice dans ce pays et tout l’appareil des prisons et des « laguer » bolchéviques. Nous trouverons là une échelle de comparaison correspondant à l’évolution du système bolchévique depuis les premiers jours de la terreur jusqu’à ceux de la marche victorieuse de l’année rouge vers l’Occident. C’est seulement alors que nous comprendrons ce qui, dans la terreur bolchévique, a été causé par la fureur de la révolution victorieuse et ce qui est devenu l’élément inséparable et fondamental du système déjà organisé et mis en œuvre pour révolutionner et conquérir le monde entier.
Là, derrière les barreaux des prisons et les fils de fer barbelés des « laguer », se cache le mystère le plus important de la puissance et de la compacité de l’Union Soviétique : le facteur de la peur.
Chose très significative : dans ses diverses publications, Moscou n’envoie que très à regret, an dehors de ses frontières, des exemplaires des codes et des règlements de sa procédure judiciaire. La propagande soviétique parle le moins possible des prisons ou des tribunaux bolchéviques et, comme nous l’avons déjà dit et plusieurs fois souligné, la justice soviétique est le meilleur soutien de l’absolutisme bolchévique et de la technique soviétique de la révolution mondiale. Partout où le pied du soldat rouge se pose, les institutions soviétiques de justice et d’administration font irruption, s’appuyant sur les paragraphes des codes et des statuts soviétiques, comprenant, pratiquement, le monde entier dans leur rayon et commençant à « faire la révolution ».
Donner aux gens l’éducation des idées prolétaires, « adapter » les citoyens, pour user des termes du code pénal soviétique, aux conditions de vie sociale dans l’État des ouvriers et des paysans, anéantir en masse les ennemis du prolétariat, telle est l’œuvre opérée par l’administration de la justice bolchévique. En Russie, l’administration de la justice est, avec l’école, l’institution la plus générale d’éducation publique ; les prisons n’ont pas dans ce pays, comme en Occident, un caractère diffamant.
Peu de personnes au monde connaissent le mécanisme de la justice et celui des prisons de l’Union Soviétique. Très peu, en dehors des spécialistes en matière de droit, peuvent saisir les différences fondamentales qui existent entre le droit démocratique et le droit soviétique. Comprendre ce problème n’est pas aisé, parce qu’il ne suffit pas de connaître les prescriptions du droit, il faut encore en connaître directement tout le système. En effet, pour celui qui vit sous un régime européen occidental, passer sous les autorités rouges de Moscou équivaut à changer de planète. Toutes les personnes de culture occidentale qui, par un décret tragique du destin, se sont trouvées dans les prisons de la Russie bolchévique durant les années 1939-41, se sont rendu compte de ce contraste si frappant.
Une chose très caractéristique, qui sautait aux yeux de quiconque observait objectivement ses compagnons de prison, est la manière dont ils s’adaptaient plutôt facilement aux pertes matérielles, et savaient en prendre leur parti, alors qu’ils n’acceptaient qu’à grand-peine et avec indignation les infractions à leur propre conception de la vie sociale et l’imposition du concept de la justice bolchévique.
Ceux qui vivaient déjà dans toute la réalité de la justice soviétique et de sa juridiction criminelle ne pouvaient pas comprendre le sens de toutes les demandes et plaintes qui leur étaient adressées. « Pourquoi ? », « De quel droit ? », « Quelle justice ? », telles étaient les questions qui s’échangeaient le plus fréquemment dans les cellules des prisons après chaque interrogatoire et sur lesquelles réfléchissaient les personnes les plus simples et les plus pauvres.
Ces questions qui résonnaient, il y a quatre ans, dans les cellules des prisons bolchéviques, n’ont pas encore perdu, aujourd’hui, leur actualité ; celle-ci s’est même extraordinairement accrue.
La crainte, la terreur menacent actuellement la partie de l’Europe qui se trouve en face de l’occupation bolchévique ou qui rentre dans la sphère de l’influence bolchévique. Chaque habitant de ces régions tombera tout d’abord dans l’engrenage de la machine de la justice bolchévique, qui commencera par le « libérer de la manière de penser bourgeoise-capitaliste ».
Une réponse à ces questions est, en même temps, une réponse à tous ceux qui croient à l’évolution démocratique du régime bolchévique.
Les auteurs de l’ouvrage « La justice soviétique » se sont imposés la tache de fournir à tous les peuples épuisés de l’Europe sur lesquels se lève l’étoile, aux lueurs de sang, du protectorat russe, les éléments d’une étude sur les « trois possibilités russes » – formulées au début de l’introduction – étude plus profonde, plus complète et plus documentée que les déclarations verbales de propagande des dirigeants russes et de leurs agents dans tous les États.
Le livre se compose de deux parties :
La première constitue une analyse du droit pénal bolchévique et de la procédure judiciaire et traite des principes de l’organisation des prisons et des « laguer ». Elle donne aussi une vaste description du droit bolchévique dans la pratique.
La seconde forme un recueil de récits et de souvenirs sur la réalité soviétique, écrits par ceux qui, durant les années de 1939-1941, se sont trouvés dans les mains de la justice soviétique, en prison et dans les « laguer » et qui, par une intervention miraculeuse de la Providence, ont pu s’enfuir en 1942.
Ces renseignements ont été recueillis auprès des citoyens polonais : Polonais, de nationalité Hébraïque, Ukrainienne, habitants de la Russie Blanche et de nationalité Lithuanienne. Si nous les comparons à tout ce qui a été écrit sur la terreur bolchévique dans les premières années du régime et aux informations diverses venant des régions occupées par la Russie depuis que les Allemands s’en sont retirés, nous pourrons comprendre que la Russie poursuit, durement et sans hésitation, son système de dictature totalitaire, qui a pour but de dominer et de bolchéviser le monde entier.
Les documents joints à cette publication pour l’illustrer se composent de photographies.
Celles-ci furent prises dans les centres de formation de l’armée polonaise sur le territoire de l’URSS. en 1941 (après le décret d’amnistie pour les citoyens polonais). Dans ces localités se réunirent aussitôt les personnes libérées des camps de travail, ce qui permit de fixer, par la photographie, leur aspect extérieur. En outre, une série de clichés appartient à la période de l’évacuation de la Russie par les citoyens polonais en 1942 ; ils ont été pris dans les centres d’évacuation de Perse et surtout dans la ville de Pahlévi.
PREMIÈRE PARTIE
CHAPITRE I
CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES
DE LA JUSTICE DÉMOCRATIQUE
Avant de répondre aux questions posées dans l’Introduction au sujet de la vraie nature du système bolchévique en ce qui concerne la justice, il est nécessaire de rappeler brièvement les caractéristiques essentielles de la justice démocratique dans l’Europe Occidentale. Ce court examen est indispensable pour avoir une base de comparaison.
Dans l’Occident européen, on reconnaît de plus en plus que, pour atteindre son but, l’action de la justice doit reposer sur deux conditions essentielles :
1. Elle doit s’inspirer de principes généraux déterminés et s’appuyer sur des raisons indépendantes des intérêts et des sentiments de groupes particuliers ou d’individus.
2. Elle doit être indépendante, dans sa structure et son activité, de la volonté du gouvernant.
Ces conditions proviennent des principes que nous devons au christianisme et aux traditions de la civilisation romaine.
Pendant les siècles de la lutte pour le raffermissement des droits de l’individu et pour la libération de l’organisation sociale de la suprématie du pouvoir gouvernemental, une tâche très importante a été remplie par l’Église Catholique. L’obligation pour chaque individu de veiller à son salut est une des bases fondamentales de la doctrine chrétienne. Tout homme doit prendre soin, indépendamment des conditions sociales et des systèmes politiques, de la formation de son âme, et chacun répond personnellement devant Dieu de son activité terrestre. Ces idées chrétiennes influencèrent directement le développement des principes généraux du droit européen et trouvèrent leur expression dans le droit canonique, influençant, en même temps, par ce dernier, la formation de la juridiction laïque.
D’autre part, en ce qui concerne en particulier la première condition, elle a été réalisée dans l’Europe Occidentale grâce aussi à l’apparition du droit romain, sur lequel était basé tout le développement de la philosophie du droit et son application dans la pratique.
La consolidation du principe de l’indépendance de l’administration judiciaire du pouvoir gouvernemental, contenu dans la deuxième condition, s’est achevée avec la lutte soutenue contre la doctrine de la suprématie du pouvoir gouvernemental sur cette administration (doctrine qui est, d’ailleurs, la véritable marque du droit romain). Cette lutte, née indirectement de l’esprit chrétien, avait été entreprise au nom des droits de l’individu ou du groupe social représentés par les États du moyen-âge.
Le résultat définitif de cette lutte a été, après la révolution française, l’adoption, comme base du système démocratique libéral, du principe de Montesquieu proclamant l’indépendance du pouvoir législatif et judiciaire à l’égard du pouvoir exécutif.
Les peuples de civilisation européenne ont hérité de la Rome antique et depuis transmis le principe de la souveraineté et de l’unité intérieure du pouvoir de l’État. Dans le cadre de ce principe, ils ont donc reconnu universellement que les tribunaux doivent être indépendants du gouvernement et émettre leurs sentences uniquement sur la base des principes objectifs formulés par les lois.
Le principe de Montesquieu a trouvé son expression la plus complète et en même temps la plus formelle dans la Constitution des États-Unis, qui sépare complètement le pouvoir judiciaire et législatif du pouvoir exécutif. La Common Law anglaise est fondée sur le même principe, qui garantit la pleine liberté du citoyen par l’égalité, devant le tribunal, des droits des gouvernants et de leurs sujets.
Dans son ensemble, l’indépendance de la magistrature et de la justice se révèle en particulier dans les élections et le choix des juges et dans la séparation bien nette entre les délits à poursuivre d’office et ceux qui sont déférés aux tribunaux à la suite de plainte privée. En cela apparaît la tendance des législateurs à limiter le plus possible l’ingérence des pouvoirs publics dans la vie privée des citoyens
Une justice indépendante exige la plus grande limitation possible des sanctions à caractère administratif.
Ce principe est aussi clairement exprimé dans l’Adresse du Doyen de la Rote romaine, oct. 1910 :
« L’indépendance des tribunaux, qui est un suprême intérêt public, exige la nette distinction entre le pouvoir administratif et le pouvoir judiciaire. »
En Angleterre, par exemple, un « juge unique », qui n’est pas licencié en droit, ne peut juger que les causes prévoyant un emprisonnement ne dépassant pas quatorze jours et une amende d’au maximum vingt shillings. Les causes plus graves doivent être jugées par au moins deux fonctionnaires appartenant à la même catégorie.
Le tribunal indépendant d’Europe Occidentale a comme tâche de s’assurer de la vérité objective : il doit donner à l’accusé la preuve de son délit, lequel aura été indiqué dans l’acte d’accusation dûment notifié avant le procès. Ce principe est essentiel pour la magistrature européenne, spécialement en Angleterre, ainsi que le démontre, de la manière la plus évidente, par exemple, la déclaration suivante du Lord Chancelier faite en 1934 au cours d’une cause en appel concernant un cas d’homicide fortuit.
« Dans le réseau de la législation pénale anglaise, se trouve tissé le fil d’or de ce principe ; l’accusation a le devoir de prouver sa faute à l’accusé. Si, au terme du débat, il subsiste encore un doute fondé, cela signifie que le plaignant n’a pas réussi à fournir la preuve de la culpabilité du prévenu et celui-ci a droit à une sentence d’absolution. Ce principe, d’après lequel l’accusation est tenue à prouver le délit, fait partie de la loi universelle et l’on doit rejeter toute affirmation tendant à l’affaiblir. »
Une autre tendance caractéristique, dans le développement de la législation en Europe occidentale est sa nature manifestement humanitaire. Cette propension se manifeste dans tous les domaines de la législation pénale et on peut l’observer, entre autres, dans le traitement réservé aux femmes et aux mineurs, dans celui qui est en usage vis-à-vis des détenus politiques, dans les méthodes pour l’instruction des procès, l’organisation du système pénitencier, dans la limitation des cas où est infligée la peine de mort ; enfin dans la procédure pour l’exécution de la peine capitale.
La législation de l’Europe occidentale n’admet pas le principe de la responsabilité collective ; c’est la conséquence naturelle du concept selon lequel le tribunal doit prouver sa faute à l’accusé et, par suite, seul celui qui a exécuté une action coupable qui dispose d’une volonté libre, peut répondre individuellement de son délit. Puis, bien entendu, sont prises en considération, dans l’application de la peine, les conditions de vie de l’accusé, l’influence exercée sur lui par le milieu, et les circonstances atténuantes.
D’autre part, la sanction dite d’intimidation n’est pas non plus admise. L’accusé ne peut être jugé que dans les limites des règles fixées pour un délit déterminé.
Dans la théorie du droit pénal, la législation de l’Europe occidentale a admis en partie le principe de la sanction de revanche de la société (vengeance – pœna vindicativa) contre le coupable d’un méfait ; la peine est alors considérée comme un moyen de défense sociale revêtant le caractère préventif et éducatif (pœna medicinalis).
D’après le droit de l’Europe occidentale, aucune personne ne peut être punie pour des faits non prévus dans le code pénal ou pour des faits qui ne sont pas bien précisés. Cette disposition se base sur l’ancien principe romain, qu’il n’y a pas.de délit s’il n’y a pas violation de la loi (nullum crimen sine lege). L’analogie dans le jugement n’est admise en Occident qu’en matière de droit civil.
Enfin, le principe que la loi n’a pas d’effet rétroactif (lex retro non agit) est généralement reconnu. Personne ne peut être puni pour des fautes commises à une époque où la loi ne les considérait pas comme telles, ou encore pour des actes accomplis là où cette même loi n’était ou n’est pas en vigueur.
D’autre part, personne n’a à répondre d’actions qui, selon la loi, étaient coupables quand elles furent accomplies, mais qui ont perdu ce caractère en vertu d’une loi successive. Par exemple, une action commise en 1935 était un délit d’après la loi en vigueur à cette époque ; en 1937, une loi est promulguée aux termes de laquelle la même action cesse d’être coupable ; après l’entrée en vigueur de cette loi de 1937, personne ne peut plus être puni pour ce qui était une faute en 1935.
On ne peut être puni deux fois pour le même acte (res judicata – ne bis in idem).
Après avoir brièvement ébauché les principes généraux sur lesquels est basée la justice en Europe occidentale, considérons maintenant les règles du Code pénal et la procédure judiciaire dans l’URSS.
Pour base de notre analyse, nous prendrons le Code pénal (« Ugolovni Kodeks ») de la République Fédérative Russe Socialiste Soviétique (R.F.R.S.S.) « Iuriditcheskoie Izdatielstvo N. K. Iu Soiusza S.S.R. Moskwa 1941 g » et le Code de Procédure pénale – « Ugolovno Prozessualni Kodeks R.S.F.S.R. ».
Le code de la R.F.R.S.S. est en vigueur dans tout le territoire de l’Union Soviétique ; si, cependant, une des Républiques possède un code propre, celui-ci se distingue de l’autre uniquement par le numérotage des articles.
Il existe aussi quelques Républiques où le code de la R.F.R.S.S. est directement en vigueur.
CHAPITRE II
LES PRINCIPES DE LA JUSTICE
SOVIÉTIQUE
I. RELATIVISME ET TERRORISME
Le fondement de la justice soviétique, comme de l’ordre social bolchévique tout entier, est le relativisme. Il se manifeste d’une part dans cette formule de Lénine : « Le tribunal est un instrument de pouvoir du prolétariat et de la classe rurale travailleuse » ; d’autre part, dans la variation continuelle des normes sur l’application de la peine, suivant les exigences multiples de la tactique et de la politique du parti.
Dans le champ juridique, ceci est surtout démontré par l’énumération des principes constitutionnels de l’État soviétique. Les deux premiers articles de la Constitution s’expriment en effet en ces termes :
Art. 1. – « L’Union des Républiques Socialistes Soviétiques est l’État socialiste des ouvriers et des paysans. »
Art. 2. – « La base politique de l’URSS. est formée des Conseils des députés des travailleurs, qui sont nés et se sont affermis par suite de la dépossession des propriétaires fonciers et des capitalistes, et de la conquête de la dictature du prolétariat. »
Les conséquences dues à une telle interprétation des principes relatifs à la structure de l’État de l’Union soviétique et de la formule générale de Lénine que nous avons citée, sur la fonction de la justice, se trouvent dans la citation suivante de l’art. I du code pénal en vigueur dans l’URSS. :
« La législation pénale de la R.F.R.S.S. a pour tâche la défense de l’État socialiste des ouvriers et paysans et de l’organisation légale établie, contre les actions (délits) dangereuses à l’ordre social ; cette tâche s’exécute par l’application des moyens de défense sociale indiqués en ce code contre les personnes coupables de telles actions. »
Le résultat non équivoque des articles de la Constitution et du code pénal cités ci-dessus est que la Russie bolchévique a complètement abandonné le principe de l’indépendance de la justice en faveur du principe de la suprématie des classes ouvrières et paysannes (en pratique du parti bolchévique) sur l’application de la justice.
Le relativisme du droit soviétique se révèle de manière plus claire dans le libellé de l’article 6 du code pénal, qui apparemment a en outre des effets favorables pour l’accusé :
« Si un fait donné, qui, au moment de son accomplissement, est délit dans le sens de l’article 6 du code même, perd, au cours de l’enquête ou des débats juridiques, le caractère de fait socialement dangereux soit à la suite du changement de la loi pénale, soit À LA SUITE DU FAIT SEUL QUE LA SITUATION (OBSTANOVKA) SOCIALE POLITIQUE S’EST MODIFIÉE, ou bien que la personne prévenue ne peut être point considérée dans l’opinion du tribunal comme socialement dangereuse, EN CE MOMENT PRÉCIS, ce fait ne comporte pas les moyens de défense sociale vis-à-vis de la susdite personne. »
Il ressort clairement de ces dispositions à quel point la justice soviétique est un instrument de lutte politique et l’un des moyens d’en réaliser les buts. Dans la pratique de l’instruction soviétique, la disposition de l’art. 8 ouvre exceptionnellement et conditionnellement à l’accusé le chemin de la liberté. Cependant, d’habitude, elle n’est dans les mains du juge qu’un instrument de « chantage » dans le procès de persuasion pour amener l’accusé à confesser sa propre faute.
La Russie bolchévique n’a pas basé son droit sur les principes et la technique du droit romain, elle a rompu tout rapport avec le concept universellement adopté, qui s’exprime dans le culte des valeurs objectives, indépendantes des intérêts ou des évaluations des différents groupes ou individus. La justice bolchévique n’a donc rien de commun avec la justice indépendante des autres pays, et la découverte de la vérité objective n’est point son but.
Au tribunal soviétique, on n’a recours à personne pour prouver la vérité. En Russie, la technique de l’enquête et de l’instruction judiciaire est fondée sur le principe de l’aveu et du repentir de l’accusé.
À la demande de l’inculpé « De quoi suis-je accusé ? » on répond invariablement : « Nous ne te le dirons pas ; toi-même tu dois avouer ta faute, tu dois t’accuser et te repentir toi-même. »
Le tribunal bolchévique est l’instrument du prolétariat ouvrier et paysan dans la lutte contre la bourgeoisie à l’intérieur de l’État et contre le système capitaliste-bourgeois dans le reste du monde. En Russie, le gouvernement des ouvriers et paysans se sert du tribunal comme moyen de terreur contre les autres classes sociales. Tout l’appareil judiciaire et pénitencier en URSS. tend uniquement à l’élimination des ennemis du prolétariat, et avant tout de la Russie. De là son caractère terroriste.
Ces principes idéologiques et juridiques se manifestent dans toute la technique judiciaire, en premier lieu dans le mode de nomination des juges bolchéviques. Le juge du tribunal du peuple est aussi choisi ou désigné pour une période de temps limitée. Sont également nommés juges les fonctionnaires de l’NKVD, c’est-à-dire de l’organe investigateur. Dans ces conditions, il est évident que n’importe quelle requête du procureur a, pour de tels juges, un caractère péremptoire.
Le caractère relativiste et terroriste de la justice bolchévique se révèle plus d’évidence encore dans la définition, donnée par le législateur, du « crime contre-révolutionnaire ». Cette espèce de crime est prévu par l’article le plus menaçant du code pénal soviétique, l’art. 58, qui commence par la formule générale suivante :
« Est considéré comme action contre-révolutionnaire tout acte tendant à renverser, saper ou affaiblir le pouvoir des Conseils des ouvriers et paysans et des gouvernements des ouvriers et paysans de l’URSS, des républiques fédérées et autonomes élues par ces Conseils sur la base de la Constitution de l’URSS. et des Constitutions des républiques fédérées ; ou tendant à désorganiser ou affaiblir la sûreté extérieure de l’URSS. et les conquêtes fondamentales économiques, politiques, et nationales de la révolution prolétaire.
« Conformément au principe de la solidarité internationale des intérêts de tous les travailleurs, les actes susmentionnés sont considérés comme contre révolutionnaires même lorsqu’ils sont dirigés contre un autre État de travailleurs, quel qu’il soit, ne fît-il pas partie de l’URSS. »
Après cette introduction, sont énumérés en quatorze paragraphes (dont le premier est, à son tour, subdivisé en alinéas allant du n. 1a au n. 1d) divers aspects des activités contre-révolutionnaires, parmi lesquelles la trahison de la patrie et l’espionnage ne peuvent naturellement pas donner lieu à des réserves. Le paragraphe 14, au contraire, contient quelques normes extraordinaires du code pénal bolchévique pouvant, en tout temps et à chaque occasion, être appliquées à n’importe quel citoyen. Voici le contenu de ce paragraphe :
Art, 58 § 14 : « Le sabotage contre-révolutionnaire, c’est-à-dire l’omission consciente, par qui que ce soit, des devoirs déterminés, ou l’exécution volontairement négligente de ces mêmes devoirs, dans le but spécifique d’affaiblir le pouvoir du gouvernement et l’activité de l’appareil de l’État, comporte une peine restrictive de la liberté personnelle pour une période non inférieure à une année et la confiscation partielle ou totale des biens ; dans les cas particulièrement graves, on emploiera envers le coupable des peines plus sévères, sans exclure le moyen suprême de défense sociale – le fusillement – ainsi que la confiscation des biens. »
Si Von considère que toutes les activités, en Russie, sont soumises au contrôle de l’État, il s’ensuit que toute erreur ou imprécision dans l’accomplissement du devoir personnel peut être, et est considérée pratiquement, comme un acte de sabotage et est jugée selon le paragraphe 14 de l’art. 58.
En ce qui concerne l’application de la peine, le code bolchévique abonde dans la confiscation des biens. Si l’on tient compte de la grande difficulté, en Russie, de réussir à se faire un complet modeste, à acquérir une montre ou un stylo, sans parler même d’une maisonnette habitable ou de meubles, on peut comprendre que la confiscation du bien modeste d’un condamné ayant une famille n’est autre que l’application, sur une vaste échelle et dans sa forme la moins sévère, du principe de la responsabilité collective.
2. LE PRINCIPE DES MOYENS DE DÉFENSE SOCIALE
Quelques théoriciens du droit pénal, se basant sur la tendance, innée en l’homme, à se venger, considèrent la peine comme une revanche de la société contre celui qui a commis un crime.
Au contraire, d’autres théoriciens appartenant à l’école des « pénalistes » italiens, en particulier Ferri, partent du concept que la société n’a pas le droit de menacer le coupable de châtiment par pure rétorsion. D’après eux, la société est responsable du crime, au moins en partie, à cause des déficiences existant dans la structure actuelle de la société et des lacunes dans l’éducation des citoyens. Au lieu de la peine infligée à titre de vengeance, ces techniciens proposent à la justice d’adopter, envers le coupable, les moyens dits de défense sociale, à caractère préventif et éducatif.
L’interprétation au sens large de cette théorie des moyens de défense sociale, appelée aussi, dans le droit pénal, « théorie de Ferri », admet l’adoption de moyens préventifs, lors même qu’il s’agit de citoyens n’ayant commis aucun crime, mais suspects de devenir « socialement dangereux », comme aussi envers ceux qui, ayant déjà commis une action nuisible à la société, sont reconnus susceptibles de commettre un nouveau délit.
Une entière application, poussée jusqu’à l’absurde, de la théorie Ferri, a été prévue par la législation pénale de la Russie bolchévique.
L’article premier, déjà cité, du code pénal soviétique (partie générale), dit que « les moyens de défense sociale s’appliquent au coupable », et l’article 9 du même code précise que les moyens en question sont adoptés en vue d’atteindre les buts suivants :
« a) prévenir de nouveaux délits qui pourraient être commis par celui qui s’en serait déjà rendu coupable ;
b) AGIR SUR D’AUTRES MEMBRES PEU SORS DE LA SOCIÉTÉ ;
c) ADAPTER LES AUTEURS DES ACTES CRIMINELS AUX CONDITIONS DE VIE COMMUNE. DANS L’ÉTAT DES TRAVAILLEURS. »
Les moyens préventifs, qui, selon le code soviétique, doivent être appliqués en infligeant la peine, sont indiqués dans les articles 20, 23, 24 et 25 du code pénal. Ils se divisent en trois groupes :
1o) Moyens de défense sociale de caractère judiciaire correctif ;
2o) Moyens de caractère curatif ;
3o) Moyens de caractère curatif-éducatif.
Parmi les principaux moyens de défense sociale de caractère judiciaire correctif, on compte :
1o) La qualification d’« ennemi des travailleurs » entraînant la perte du droit de cité dans la République fédérée et, en même temps, dans l’URSS, avec expulsion hors de ses frontières ;
2o) La privation de la liberté par l’exil dans les camps correctionnels de travail situés dans des régions lointaines de l’URSS. ;
3o) La réclusion dans les maisons d’arrêt ;
4o) Les travaux correctionnels.
Outre ces règles fondamentales du code pénal, il en existe d’autres, rédigées pour la période dite transitoire, avant que la structure communiste de l’État n’eût été mise pleinement en œuvre.
La note de l’article 20 introduit la peine de réclusion :
« Le Tribunal Suprême de l’URSS, le Tribunal Suprême de la RFRSS, les tribunaux territoriaux et ceux des districts, les tribunaux pour les transports par chemin de fer et par eau et les tribunaux de guerre ont la faculté de décider, condamner, comminer des peines restrictives de la liberté personnelle avec réclusion, à l’égard des personnes coupables des plus graves délits. »
L’article 21 introduit la peine de mort :
« Afin de combattre les délits plus graves qui peuvent menacer les bases du pouvoir et de la structure soviétiques, pour les cas clairement indiqués dans les articles de ce code et jusqu’à décision contraire du Comité Central Exécutif de l’URSS, on applique la peine du fusillement comme moyen exceptionnel de défense de l’État des travailleurs. »
En pratique, l’application des mayens de défense sociale (ces moyens, dans l’énumération du code, constituent une longue série), se réduit à l’envoi des condamnés dans les « laguer » (camps de travail), ou à la peine de mort par fusillement.
En Europe occidentale, la justice, ayant pour but de s’assurer de la vérité objective, ne pouvait pas se baser, pour l’application de la peine, sur le seul principe de l’adoption des moyens préventifs. La théorie des moyens préventifs exige, en effet, que le tribunal ait la preuve que celui qui est accusé ou suspecté peut devenir dangereux pour la société. Cette preuve est évidemment possible, dans le cas de certaines manifestations psycho-pathologiques qui peuvent être certifiées par les experts appelés à se prononcer sur les aptitudes du sujet. En cette occurrence, la justice de l’Europe occidentale a trouvé le mode d’emploi de moyens préventifs, notamment pour le cas d’application d’une peine quand il s’agit d’un mineur.
L’application de la théorie des moyens préventifs contre les coupables de caractère idéologique ou politique est, au contraire, inadmissible dans le concept démocratique dont s’inspire la justice en Europe occidentale. De fait, elle ne pourrait se concilier ni avec le respect de l’objectivité de l’action judiciaire, ni avec celui de la liberté individuelle et, ce qui importe davantage, elle peut créer un obstacle à l’activité créatrice de l’individu.
C’est pourquoi la théorie des moyens de défense sociale ne peut avoir et n’a son entière application que dans un État totalitaire, où existe un parti unique et dans lequel la justice est définie comme étant un instrument du système social et politique dominant. La définition même de l’État totalitaire, dans lequel domine le parti unique, indique au tribunal quel élément doit être considéré comme étant dangereux pour la société, même en ne voulant pas s’arrêter à la définition de l’élément même, telle qu’elle est donnée à l’article 58 du code pénal de l’URSS.
Il s’ensuit qu’une aussi large application d’une semblable théorie dans l’exercice de la justice aboutit nécessairement à limiter la liberté religieuse, les recherches scientifiques, les convictions politiques, les créations de l’art, et oblige la société à suivre les directives du gouvernement, c’est-à-dire, pratiquement, à poursuivre les vues d’un assujettissement impérialiste ou la réalisation fanatique de programmes révolutionnaires.
Avec le système totalitaire, ainsi qu’il advient en Russie, le châtiment a pour but d’« agir sur les membres hésitants de la société 1 » cherchant à les convaincre que les seules décisions de qui gouverne sont justes ; et par suite la justice se charge d’amener les auteurs des actes coupables aux conditions de la vie commune 2. Elle devient ainsi non seulement un instrument de terreur, mais aussi le système le plus brutal, non objectif, d’éducation sociale.
Ces aspects de la justice soviétique sont bien mis en relief par un dicton populaire russe : « La prison n’est pas un déshonneur. »
On peut comparer ce proverbe, qui révèle l’opinion du citoyen moyen bolchévique sur la justice de son pays, avec la conclusion effrayante à laquelle arriva Léon Tolstoï après avoir médité, au point de vue évangélique, sur l’essence de l’État russe et du tsarisme : « La prison en Russie, écrit-il, est l’unique lieu d’habitation qui convienne au juste. »
Les révolutionnaires russes, y compris les dirigeants du mouvement bolchévique, en combattant le tsarisme, condamnèrent son système de la captivité en prison appliqué non seulement aux individus mais même encore aux peuples subjugués et annexés par la force à l’empire.
Tout le monde connaît le célèbre quatrain de Gorki :
« Au travers des barreaux,
Du haut du ciel, par les fenêtres, regardent les étoiles.
Ah, pourquoi, en Russie, même les étoiles
Regardent-elles, du ciel, au travers des barreaux ! »
Lénine a défini la méthode de l’empire des tsars à l’égard des populations subjuguées en une phrase magistrale : « Russie, prison des peuples ! »
L’empire a croulé, mais l’esprit de son système triomphe dans la Russie bolchévique avec une force centuplée. Aujourd’hui encore, en Russie, les étoiles « regardent du ciel à travers des barreaux ». Ce qui était une politique d’asservissement des peuples est devenu aujourd’hui une extermination en masse, sans précédent dans l’histoire de l’humanité. Une seule chose est changée par rapport au système des tsars : c’est la méthode d’éducation sociale par... la prison, basée sur la théorie des moyens préventifs et appliquée non à des dizaines ou à des centaines de milliers de citoyens, mais à des dizaines de millions.
Dans son dernier alinéa, l’article 9 du code pénal de l’Union soviétique (partie générale) ne contient rien qui soit inspiré par le concept de la peine comme moyen de vengeance de la société envers le délinquant. Cet alinéa dit textuellement :
« Les moyens de défense sociale ne peuvent avoir pour but de causer une souffrance physique ou d’abaisser la dignité humaine, comme ils ne sont pas non plus une œuvre de revanche ou de châtiment. »
Toutefois, ce que nous avons déjà relevé, en ce qui concerne l’application des moyens de défense sociale dans la lutte contre les adversaires politiques du régime, prouve que cette disposition du code soviétique reste lettre morte. En fait, ce principe, bien qu’inspiré par une pensée humanitaire profonde, s’est transformé en Russie, étant appliqué à la lutte politico-sociale, en une chose diamétralement opposée, c’est-à-dire en un instrument de vengeance collective.
Nous démontrerons la vérité de cette assertion dans le point suivant :
3. L’OBLIGATION DE LA DÉNONCIATION, LA RESPONSABILITÉ COLLECTIVE :
LE JUGEMENT PAR ANALOGIE ET EFFET RÉTROACTIF DE LA LOI ;
LA PORTÉE MONDIALE DE LA LÉGISLATION SOVIÉTIQUE.
Le paragraphe 1 c) de l’article 58 du code pénal de la R.F.R.S.S. dit :
« En cas de fuite d’un militaire ou de son passage par avion en dehors des frontières, les membres adultes de sa famille qui l’ont aidé de quelque manière à préparer ou à exécuter sa trahison, ou même qui, étant au courant, n’ont pas averti les autorités, sont punis d’une peine restrictive de la liberté personnelle allant de cinq à dix années, et par la confiscation de tous leurs biens.
« LES AUTRES MEMBRES ADULTES DE LA FAMILLE VIVANT AVEC LUI, OU ÉTANT À SA CHARGE AU MOMENT OÙ FUT COMMIS LE DÉLIT, SONT CONDAMNÉS À LA PERTE DES DROITS ÉLECTORAUX ET À LA DÉPORTATION DANS LES RÉGIONS LOINTAINES DE SIBÉRIE POUR UNE PÉRIODE DE CINQ ANNÉES. » (Souligné par l’auteur.)
Le paragraphe 1 d) de l’article 58 dit :
« L’omission de la dénonciation, de la part d’un militaire, quand il s’agit de la préparation ou de l’exécution d’une trahison, donne lieu à la perte de la liberté personnelle pour une période de dix années.
Semblable omission, de la part de citoyens non militaires, est punie conformément à l’article 58, paragraphe 12. »
Le paragraphe 12 de l’article 58 s’exprime ainsi :
« L’omission de la dénonciation s’il s’agit de la préparation dûment connue, ou de l’exécution d’un délit contre-révolutionnaire, comporte la peine de la privation de la liberté pour une période de temps qui ne sera pas inférieure à six mois. »
Les paragraphes de l’article 58 du code pénal soviétique, que nous avons cités, introduisent formellement le concept de la responsabilité collective et imposent au citoyen l’obligation de la dénonciation.
Il est naturel que les codes européens prévoient dans certains cas l’obligation de la dénonciation, mais son omission n’est pas punie avec autant de sévérité qu’en Russie et en outre ils considèrent les liens de famille comme des circonstances atténuantes et en degré supérieur, mais on ne peut imaginer des répressions envers des personnes qui ignoraient totalement le fait délictueux. Par contre, dans le code pénal soviétique, la responsabilité collective est attribuée non seulement aux personnes ayant connu, de manière certaine, l’acte contre-révolutionnaire qui se préparait, ou y ayant collaboré, comme il est dit au paragraphe 1 c) de l’article 58, mais encore aux membres adultes de la famille du coupable, qui, en vérité, ne savaient rien de ses plans, mais vivaient seulement avec lui ou étaient à sa charge. En d’autres termes, une telle disposition vise à l’entière destruction de la famille du contre-révolutionnaire, car, après l’emprisonnement des membres adultes, les mineurs et les enfants sont enfermés dans des refuges publics ; ou bien manquant de tutelle, ils deviennent des « besprizorni » et finissent fatalement en prison ou dans les « laguer ».
Dans les prisons et les « laguers », en Russie, on rencontre souvent des personnes qui, interrogées sur le genre de délit qu’elles ont commis, répondent uniquement : « mère, frère, fille », etc. ; ce qui signifie qu’elles-mêmes n’ont fait aucun mal et qu’elles sont en prison ou dans le camp en vertu du paragraphe 1 c) de l’article 58.
Si le principe de la responsabilité collective se limitait, dans son application, aux paragraphes de l’article 58 rapportés ci-dessus, il ne s’ensuivrait pas toutefois des conséquences atteignant aussi profondément l’ensemble de la société : aussi, en fait, la justice soviétique, dans la destruction en masse des ennemis de la classe, applique encore un autre principe.
En effet, le concept de la responsabilité collective et héréditaire est appliqué également dans les cas qui ne sont pas prévus par le code.
Pendant la période de la lutte contre les « koulaks », non seulement ceux-ci furent éliminés des « kolkhoz », mais encore leurs fils, leurs petits-enfants et leurs parents les plus éloignés. On arriva à ce point que, dans les journaux, le fils reniait publiquement son père et toute sa famille, essayant ainsi de retrouver la confiance des autorités. Toutefois, ces déclarations publiques, par lesquelles on reniait sa parenté, ne furent pas jugées suffisantes ; elles furent même dénoncées comme étant la manœuvre d’un « ennemi de la classe », et les annonces de ce genre, qui caractérisent si bien cette époque, disparurent tout à fait des colonnes des journaux russes.
Dans le périodique « La Terreur Rouge » du 1er Octobre 1918, le principe de la « responsabilité collective » que les bolchévistes entendaient appliquer fut expliqué ainsi :
« NOUS NE FAISONS PAS LA GUERRE AUX INDIVIDUS. NOUS ENTENDONS DÉTRUIRE L’ENTIÈRE BOURGEOISIE, EN TANT QUE CLASSE.
« La « Tcheka » (qui devint la « Guépéou » et est maintenant l’NKVD. – note de l’auteur) cherchait à établir régulièrement, dans chaque interrogatoire, à quelle classe sociale appartenait l’accusé, quels étaient son degré d’instruction, sa profession, son éducation. Le sort de l’inculpé dépendait des réponses à ces questions... Telle est l’essence de la terreur rouge. »
Une instruction supérieure, la connaissance des langues, les voyages à l’étranger, étaient et sont encore pratiquement, dans l’NKVD, des circonstances à charge pour l’inculpé.
À la cuite de l’application du principe de la « responsabilité collective », il s’est formé, dans la Russie bolchévique, une nouvelle classe sociale, celle des « lichéniez » (parias) héréditaires, privés des droits civils et exclus du service dans l’armée rouge. Aujourd’hui, cette minorité héréditaire n’existe plus, au moins sur le papier, mais dans tous les documents personnels figure encore la question : « Quelle est la profession du père ? » Cette question est posée dans toutes les enquêtes, tandis que la réponse influe peu sur la punition à infliger à l’accusé.
Le principe de la « responsabilité collective » a, de plus, dans le code soviétique, un aspect que l’on peut dire international.
Le dernier alinéa de l’introduction à l’article 58 du code pénal de la R.F.R.S.S. est rédigé dans les termes suivants :
« En conformité avec le principe de la solidarité internationale des intérêts de tous les travailleurs, les actions indiquées ci-dessus (ayant pour but de renverser, saper ou affaiblir le pouvoir des Soviets ouvriers et paysans – note de l’auteur) sont considérées comme contre-révolutionnaires, LORS MÊME QU’ELLES SONT DIRIGÉES CONTRE N’IMPORTE QUEL ÉTAT DE TRAVAILLEURS QUI NE FAIT PAS PARTIE DE L’URSS. » (Souligné par l’auteur.)
Le paragraphe 4 du même article stipule :
« L’aide apportée de quelque manière que ce soit dans un plan hostile à l’URSS, à cette partie de la bourgeoisie internationale qui ne reconnaît pas l’égalité de droits du système communiste (lequel devrait être substitué au système capitaliste) et qui vise à le renverser ; ou encore le secours prêté à des groupes ou organisations sociales directement formés ou influencés par cette bourgeoisie, est puni par la privation de la liberté personnelle pour au moins trois ans et par la confiscation de tout le patrimoine ou d’une partie. Dans des circonstances particulièrement aggravantes, des mesures plus sévères sont appliquées, sans en exclure le moyen suprême de défense sociale, le fusillement ou la déclaration d’« ennemi des travailleurs » et en conséquence la privation des droits de citoyen de l’URSS. et l’expulsion définitive de son territoire ainsi que l’entière confiscation des biens. »
En pratique, ces règles du code pénal de la R.F.R.S.S. regardent non seulement les citoyens soviétiques, mais encore ceux des autres États qui, pour un motif quelconque, se trouvent en territoire russe ou en un point situé dans la sphère d’influence au gouvernement de Moscou.
L’application de ces prescriptions du code pénal bolchévique, sur le terrain international, a aussi sa justification, évidemment d’après la logique russe-bolchévique, dans l’article 16 du code même de la RFRSS, qui introduit, dans le droit pénal, le principe d’analogie. La teneur de cet article est la suivante :
« Si un acte quelconque, dangereux pour la société, n’est pas spécifiquement signalé dans le code, sa nature et sa portée se trouvent définies par quelque article du code ayant trait au genre de délit qui lui est le plus semblable. »
Aucun code pénal des pays de l’Europe occidentale n’admet le jugement par analogie ; on respecte le principe du droit romain d’après lequel il n’y a pas de délit là où il n’y a pas d’infraction à la loi. La loi fixe les limites des sanctions pénales et décrète que celui-là est sujet à la responsabilité pénale, qui commet une action délictueuse pour laquelle est prévue une peine dans les dispositions en vigueur au moment où le délit a été commis.
Dans l’Occident européen, seule l’Allemagne hitlérienne, ayant pris exemple sur l’Union Soviétique, s’est détachée de ce principe cardinal, publiant une disposition d’après laquelle le juge a pleine faculté de condamner pour un fait qui n’est pas prévu dans le code pénal, pourvu qu’il le considère comme étant dirigé contre le salut du peuple allemand.
Pour une le système de la responsabilité collective, ayant en vue la destruction de la bourgeoisie, puisse avoir toute son efficacité, même sur le terrain mondial, la loi bolchévique n’admet pas, lorsqu’il s’agit de délits contre-révolutionnaires, l’ancien principe « lex retro non agit ». Cela se vérifie non seulement dans la pratique judiciaire bolchévique, mais aussi dans une norme législative spéciale contenue dans le paragraphe 13 de l’article 58 du code pénal :
« L’activité effective ou la lutte active contre la classe des travailleurs et contre le mouvement révolutionnaire, déployée par quiconque avait, durant la guerre civile, des charges entraînant une responsabilité, ou des offices réservés dans le système tsariste ou les gouvernements contre-révolutionnaires, sont punies par les moyens de défense sociale indiqués dans l’art. 58 § 2 de ce code. »
À savoir :
« par le moyen le plus sévère de défense sociale : fusillement ou déclaration d’ennemi des travailleurs avec la confiscation des biens et avec la privation du droit de cité dans la République fédérée et, en même temps, dans l’URSS, avec expulsion des frontières de l’URSS pour toujours. Dans les circonstances atténuantes, (on applique) la diminution de la peine avec la privation de la liberté pour une période non inférieure à trois ans et la confiscation totale ou partielle des biens ».
Cette méthode d’action judiciaire, tendant à la destruction en masse de la classe bourgeoise et capitaliste, a été suivie dès les premières années de la révolution russe ; elle s’est perfectionnée par la suite et a été ratifiée par des normes législatives.
Tout ce que nous avons dit à cet égard est confirmé par les faits qui se sont vérifiés en l’année 1920, durant la période initiale de la révolution russe, et par certains épisodes qui caractérisent le système de justice instauré par les Russes dans les territoires occupés par l’armée ronge pendant les années 1939-1941.
En automne 1920, se trouvait dans les prisons de Boutyrki un officier autrichien nommé Karolyi. Il avait été pris pour un comte hongrois, son homonyme. Le juge lui déclara : « Si tu es comte, c’est un motif suffisant pour t’emprisonner, car il est impossible que tu ne sois pas un ennemi mortel du prolétariat. »
L’officier suspecté de ce « délit » fit observer au juge qu’il était sujet d’un pays étranger et, en conséquence, ne pouvait être jugé par un tribunal russe ; il reçut la réponse suivante : « Le fait que tu sois étranger ne signifie rien, car notre révolution est une révolution mondiale. Laisser un comte retourner dans un pays bourgeois équivaudrait à mettre un brochet dans un étang. »
Il faut remarquer que le vrai comte Karolyi était un sympathisant bolchéviste, qui eut une part notable dans le « putsch » communiste de Bela Kuhn. Aujourd’hui que l’armée rouge est arrivée à Budapest, le comte Karolyi, qui réside à Londres, annonce sa volonté de collaborer avec les communistes.
Entre 1939 et 1941, après l’occupation des Pays Baltes, de la Pologne et de la Bessarabie, tous les citoyens de ces contrées furent accusés, par les autorités soviétiques, d’activité contre-révolutionnaire. D’après les accusateurs bolchéviques, cette activité avait consisté à donner une aide aux États bourgeois, à avoir des fonctions administratives dans ces États, et à appartenir aux « classes dites exploiteuses du prolétariat ».
En décembre 1939, un général de l’armée polonaise, Dabrowski, fut enfermé dans les prisons de Stanislawow pour un acte contre-révolutionnaire consistant à avoir élevé ses enfants pour en faire des officiers de l’armée bourgeoise polonaise.
Le commissaire soviétique des affaires de l’intérieur publia à Kaunas, le 28 Novembre 1910, un ordre portant le n. 0054, dans lequel « les éléments antisoviétiques » étaient divisés en quatorze catégories et de nombreuses subdivisions. Dans la dixième catégorie étaient comprises les personnes ayant des rapports personnels ou épistolaires avec des ambassades ou des consulats étrangers, ainsi que les philatélistes et les espérantistes.
Les fonctionnaires de l’NKVD ont déclaré du reste que le code soviétique s’applique au monde entier et que, partout où l’armée rouge arrive, les bourgeois sont immédiatement jugés sur leur passé et sur les actions accomplies par les générations précédentes.
Cette directive est justifiée par l’article 16 du code pénal soviétique (jugement par analogie), par l’article 58, paragraphe 13, appliqué lui aussi conformément au principe d’analogie, et par les autres paragraphes du même article 58 interprétés... selon le principe d’analogie et avec effet rétroactif.
Dans la pratique, les tribunaux soviétiques ne respectent pas même le principe « res indicata » (non bis in idem). On peut citer l’exemple des fameux bolchéviques Kamenev et Zinoviev, arrêtés en décembre 1934, condamnés à mort un mois après, pour le meurtre de Kirov et qui, après avoir été graciés, furent traduits une seconde fois en jugement, en août 1936, et de nouveau condamnés à mort, entre autres raisons, pour le même homicide.
4. LA JUSTICE SOVIÉTIQUE ET LES PRINCIPES HUMANITAIRES
Le caractère « humanitaire » de la justice soviétique se révèle :
a) dans ses procédés envers les mineurs, les femmes et les enfants ;
b) dans sa manière de traiter les prisonniers politiques ;
c) dans la séparation, d’avec sa famille, du prisonnier et du condamné à mort ;
d) dans la procédure relative à la demande en grâce des cor-damnés à mort ;
e) dans les méthodes d’instruction du procès ;
f) dans l’organisation des prisons et des « laguer ».
En ce qui concerne l’application de la peine, il n’est fait, en Russie soviétique, aucune exception spéciale pour les enfants et les adolescents. Sur ce point, le code pénal s’exprime brièvement et succinctement en deux articles contenus dans la partie générale.
L’article 12 du chapitre III, intitulé : « Principes généraux de la politique répressive », établit que :
« Les mineurs, ayant douze ans accomplis, qui sont inculpés de vol, violence, lésions temporaires ou permanentes, ou homicide, doivent être déférés au tribunal pénal, et sont sujets à toutes les espèces de peines. »
L’article 25 du chapitre IV du code pénal (partie générale) relatif à l’application des moyens de défense sociale, statue avant tout que le mineur doit être mis sous
« la tutelle des parents, éducateurs, tuteurs, curateurs, membres de la famille ayant la possibilité de l’entretenir, ou d’autres personnes ou institutions ».
Ces principes de la législation soviétique regardant les mineurs sont complétés par trois articles du code pénal (156, 157 et 158) relatifs aux délits contre la tutelle et la curatelle.
Telle est à la lettre la loi qui, comme on le voit, est très sévère pour les enfants. Mais la réalité est encore plus terrible.
Dans la Russie bolchévique, les enfants sont enfermés dans les prisons communes, où il existe des cellules spéciales pour eux.
En ce qui regarde l’égalité des droits de la femme bolchévique, elle se manifeste surtout dans la parité, par rapport à l’homme, du traitement dont la justice soviétique use envers elle.
De là l’effronterie et le cynisme avec lesquels les femmes sont traitées dans les prisons bolchéviques, ainsi que la brutalité des méthodes d’instruction des procès et la sévérité dans l’application de la peine. L’état de grossesse et la tutelle des enfants n’allègent en rien le châtiment.
De la même manière, les vieillards et les malades sont traités sans aucun égard.
Seules les femmes enceintes et les personnes âgées de moins de 18 ans font exception et uniquement dans le cas de la peine de mort, laquelle ne peut être appliquée sur ces personnes (art. 22 du code pénal).
Le prisonnier politique accusé de délit contre-révolutionnaire est traité, dans la prison soviétique, beaucoup plus mal qu’un délinquant ordinaire.
Le privilège accordé aux délinquants ordinaires fait partie non seulement de la pratique judiciaire soviétique, mais ressort de la théorie qui admet le principe de la responsabilité collective. Le criminel dont le père ne fut pas un propriétaire ni un « serviteur du tsar » est considéré, vu son origine prolétaire, comme une victime du système capitaliste-bourgeois et a droit, par suite, à une certaine indulgence de la part du tribunal du prolétariat.
En Russie, tout lien entre le prisonnier et sa famille est brisé, non seulement pendant l’enquête, mais souvent durant toute l’exécution de la peine. Il y a plus : souvent la personne arrêtée par la justice n’a ni le temps ni la possibilité d’en informer les siens et de faire savoir dans quelle prison elle se trouve.
Au temps du tsar, les femmes et les enfants des déportés pouvaient suivre ces derniers en Sibérie. Dans la Russie bolchevique, les énormes masses de déportés dans les « laguer », non seulement vivent loin de leurs plus proches parents, mais n’ont pas le droit de garder un contact de quelque genre que ce soit avec la famille.
Il est refusé au prisonnier soviétique toute possibilité de formuler des plaintes pour le traitement dont usent à son égard le personnel chargé de la surveillance de la prison ou les agents d’investigation. En effet, tout recours éventuel doit être présenté par l’entremise du directeur de la prison et le reclus ne peut, en aucune manière, s’assurer qu’il a été transmis. Et si parfois le procureur paraît dans la cellule, aucun prisonnier n’est assez ingénu pour lui exposer des plaintes que la direction de la prison n’ait précédemment contrôlées.
Dans la Russie soviétique, la perte des droits civils a lieu non pas au moment où est donnée lecture de la sentence de condamnation, mais ce qui est réel et encore plus tragique, à l’instant même où s’accomplit l’acte d’arrêt de la part des autorités de l’NKVD.
Au cours de l’enquête, les moyens les plus brutaux sont employés pour extorquer des aveux. Ces méthodes n’ont rien à envier à celles des cellules de torture tristement fameuses du Moyen Âge 3.
Le rôle de la défense, pendant l’enquête comme dans le cours du procès, est presque nul.
Cependant, la justice bolchévique révèle surtout son caractère inhumain dans sa manière de traiter les condamnés à mort. L’attente de l’éventuelle disposition sur le recours en grâce, ou de la confirmation de la sentence, dure parfois plusieurs mois. Pendant ce temps, le condamné est enfermé avec d’autres condamnés dans la « cellule de la mort », et plongé dans une atmosphère hallucinante qui peut le conduire à la folie.
Les camps de travail ou « laguer », sans parler du climat qui est très dur, sont ainsi organisés, et les règlements du travail y sont tels, que seuls les condamnés doués d’une constitution physique exceptionnelle peuvent survivre durant une période de temps relativement longue. Le but principal des camps de travail est l’extermination biologique des ennemis du parti communiste.
5. PRÉPONDÉRANCE DE L’ACTION JUDICIAIRE EN DEHORS DES TRIBUNAUX
L’article 112 de la constitution soviétique de l’année 1936 porte que :
« les juges sont indépendants et doivent seulement obtempérer à la loi ».
Nous avons déjà parlé dans les pages qui précèdent de l’indépendance de la justice bolchévique et nous avons constaté que la première partie de l’article 112, sans fondement, correspond à une réalité diamétralement opposée à sa teneur.
On pourrait peut-être se demander si la réalité correspond à la seconde partie de l’article 112, c’est-à-dire si la justice soviétique se conforme scrupuleusement au droit positif (si toutefois on peut parler d’une application précise du droit dans l’administration judiciaire qui admet, en matière pénale, le principe de l’analogie).
À cette demande, on doit répondre négativement, en ce sens qu’il existe, dans l’Union Soviétique, une institution qui détruit complètement la portée de la Constitution. Cette institution est un organe spécial auquel est confié le soin de la sécurité de l’État soviétique. Elle s’appelle « Commissariat du Peuple pour les Affaires Intérieures » ou NKVD, et n’est autre que la troisième incarnation de la « Tcheka ».
L’NKVD est la garde armée de la révolution communiste et du gouvernement soviétique ; elle veille sur la conduite politique des citoyens, sans en exclure les communistes eux-mêmes, les employés, les dignitaires et ceux qui sont préposés aux activités sociales.
Le Comité Central Exécutif de l’URSS. il accordé à l’NKVD, en préséance sur la Guépéou, des pouvoirs extra-constitutionnels. Il existe donc, dans la Russie bolchévique, une « justice extra-judiciaire », plus importante encore et plus largement appliquée que celle qui est ordinaire.
En Occident aussi, il existe évidemment, en dehors des tribunaux, une justice qui, en voie administrative, menace de peines. Mais tandis que, dans les pays occidentaux, la portée de cette justice est limitée et regarde seulement une catégorie restreinte de délits, dans la Russie bolchévique, les sanctions par voie administrative, de la part de l’NKVD, sont devenues le fondement de l’action judiciaire. L’NKVD, par voie extra-judiciaire, sans que l’imputé soit invité à comparaître, et sans un motif sérieux, condamne des millions d’hommes à la perte, pour longtemps, de la liberté personnelle, fusillant les personnes sans qu’il y ait eu de sentence de condamnation.
Dans les antichambres des chancelleries des prisons soviétiques, ou simplement dans les corridors des prisons, des fonctionnaires en uniforme lisent des sentences condamnant les détenus à 3, 5 ou 8 ans de travaux forcés dans les « laguer ».
L’action judiciaire de l’NKVD est basée sur des ordonnances et des règlements ignorés de la masse des citoyens. Tant le code pénal que le code de procédure pénale recourent, dans de nombreux cas, aux « règles spéciales » du procédé de l’enquête de l’NKVD et aux pouvoirs de cette institution, sans toutefois en citer le contenu. On devrait alors supposer que ces « règles spéciales » ne sont pas sujettes à être publiées pour qu’elles puissent être connues par le plus grand nombre de citoyens soviétiques.
La législation soviétique ne fait aucune distinction précise entre une loi et une ordonnance. Tout autrement, dans la législation occidentale, une ordonnance doit être basée sur une loi précédemment en vigueur et donc déjà publiée.
La conséquence pratique de ce principe de la législation soviétique est que l’entière activité administrative, y compris celle de la justice, est soumise à des normes ayant pour objet des buts politiques. Cette conséquence n’est pas opposée à la théorie du droit soviétique, elle en dérive directement.
Sur ces deux caractéristiques de la législation soviétique reposent toute la puissance de l’NKVD, son caractère occulte et la possibilité légale de modifier, d’après la situation politique, la qualification d’une action déterminée.
L’NKVD décide, en dépendance de la tactique politique du moment, si, en procédant à une affaire pénale, il y a lieu de traduire l’accusé devant le tribunal, si on doit lui lire une décision de la Commission Spéciale de l’NKVD. (« Osso ») ou s’il doit être « éliminé » en secret dans un cachot. D’après les directives politiques en vigueur on peut, pour le même délit, être libéré ou bien être directement fusillé.
D’après les conceptions juridiques de l’Europe occidentale, toute l’activité de l’NKVD est illégale et confère à la justice soviétique et au système de l’État de l’URSS un caractère absolutiste et réactionnaire.
Étant donné que les normes auxquelles l’NKVD est soumise ne sont pas connues de la masse des citoyens, il est nécessaire, pour comprendre le rôle de cette institution dans l’État soviétique, d’en connaître l’activité pratique. Nous en donnons une ample description dans le chapitre III ; nous nous bornons ici à faire la constatation suivante :
Ce sont les organes de l’NKVD et non les tribunaux qui constituent en Russie soviétique la principale institution judiciaire. La justice bolchévique a surtout un caractère extra-judiciaire.
L’article 112 de la Constitution de l’URSS n’a pratiquement aucune application.
6. L’ESPIONNAGE ET LE « TROTSKISME »
L’article 133 de la constitution de l’URSS (règlement constitutionnel de 1936) s’exprime ainsi :
« La trahison envers la Patrie – violation du serment, passage à l’ennemi, dommage causé à la puissance militaire de l’État, espionnage – est punie sévèrement par la loi, comme étant un terrible crime. »
Le code pénal, article 58, paragraphes I a) et I b), prévoit les plus graves sanctions pénales pour les délits énumérés dans l’article 133 de la Constitution :
« ... par le fusillement et la confiscation de l’entier patrimoine ou, s’il y a des circonstances atténuantes, par la privation de la liberté pour 10 ans et la confiscation totale des biens ».
On applique, aux coupables de cette catégorie, le principe de la responsabilité collective, comme nous l’avons déjà fait observer, lorsque nous avons voulu illustrer ce fameux principe.
Par suite de la condamnation de l’espionnage, statuée par la Constitution, et étant donné les peines très graves prévues pour les coupables de ce délit, l’espionnage est devenu un aspect particulier de la vie soviétique : le cauchemar qui pèse sans répit sur chaque citoyen.
La conception de l’espionnage est pratiquement Interprétée, en Russie, dans un sens très étendu. L’espionnage industriel est puni de la même manière que l’espionnage militaire. La tendance des autorités soviétiques, d’investigation ou judiciaires, à formuler des soupçons, est vraiment exceptionnelle : l’aptitude pour le dessin, la connaissance de langues étrangères ou les voyages à l’étranger constituent un fondement sérieux de soupçons, d’après lesquels on retient que, si l’individu n’est pas un espion, il peut le devenir ; d’où, par mesure de précaution, la nécessité de l’enfermer.
Les diplomates étrangers, les employés des ambassades, des légations et des consulats sont traités naturellement d’espions.
Pendant l’enquête menée contre des prévenus pour délits d’une nature complètement différente, il est de règle de formuler aussi l’imputation contenue dans les articles du code sur l’espionnage. C’est là un phénomène très commun, et même un moyen d’extorquer des aveux qui motive quelle atmosphère de peur a été créée en Russie relativement à cette catégorie de délits.
Ceux qui sont dits « trotskistes » sont traités, par la justice soviétique, de la même manière que les espions et les traîtres. En quoi consiste le trotskisme 4 ?
Selon l’interprétation de l’NKVD, le trotskisme est devenu quelque chose de très élastique. On compte comme en faisant partie, non seulement les partisans de Trotski, d’hier et d’aujourd’hui, mais encore de nombreuses catégories de communistes. En effet, tout communiste qui n’accepte pas sans réserves les directives de Staline devient, du fait même, un trotskiste.
Dans la catégorie des trotskistes sont compris les communistes étrangers qui, bien que suivant les directives politiques de Staline, n’adhèrent pas étroitement à l’organisation du Komintern. À part des exceptions peu nombreuses, les membres des partis communistes étrangers, en particulier les Tchèques, les Hongrois, les Polonais, les Autrichiens, ont été finir en prison sous l’accusation de trotskisme, quand ils se sont trouvés dans des territoires occupés par la Russie. Étant donné que, selon la définition officielle, les trotskistes se sont vendus à la bourgeoisie, ils doivent nécessairement être des espions.
Donc, il ne suffit pas d’être communistes, il faut encore être en même temps dépouillés de sens critique, instruments sans volonté dans les mains des représentants de Moscou à l’étranger.
La suspicion soviétique envers les espions et les trotskistes atteint un tel degré que des citoyens d’autres États, professant des idées communistes et se trouvant dans les dépendances du service soviétique d’informations, ont été arrêtés, jugés et condamnés comme espions quand ils sont venus à se trouver en territoire occupé par les Russes.
« Tu as été notre espion, mais tu peux aussi devenir l’espion de nos ennemis », disaient les fonctionnaires de l’NKVD, après lecture de la sentence aux collaborateurs roumains ou carpato-ruthènes surpris et interdits.
La crainte de l’espionnage et du trotskisme est une des raisons du rigoureux isolement de la Russie bolchévique par rapport à l’étranger.
Une vigilance aussi sévère aux frontières et les peines très graves infligées à ceux qui passent abusivement les confins sont inconnues dans n’importe quel autre pays du monde. Tandis que presque toutes les législations du monde prévoient, pour qui traverse clandestinement la frontière, une sanction administrative qui ne peut dépasser quatorze jours d’arrestation, dans la Russie de Staline le code pénal inflige, pour ce délit, une peine de trois ans de travaux forcés dans les « laguer ». Dans la pratique, ceux qui passaient les frontières des territoires occupés par la Russie en 1939-1941, se voyaient appliquer le système de l’« Osso », avec condamnation de cinq à huit années de travaux forcés dans les « laguer », condamnation qui, dans les conditions soviétiques, équivaut à la peine du bagne.
7. LA JUSTICE EST UN ÉLÉMENT DE GRANDE IMPORTANCE
DANS LE SYSTÈME ÉCONOMIQUE COMMUNISTE
Dans la Russie bolchévique, la condamnation aux travaux forcés dans les régions éloignées de l’Europe septentrionale ou de l’Asie, représente, dans son essence, un retour aux systèmes de travail de l’esclave, mais sur une échelle que l’histoire de l’humanité n’a pas connue.
Ce système de la déportation est un élément très important de la vie économique du pays. La justice soviétique se fait le fournisseur d’une main-d’œuvre gratuite pour les grandes entreprises de l’État dans les régions lointaines où le climat est très dur.
Par suite de la déportation de dizaines de millions d’hommes dans les « laguer », non seulement on ne rencontre pas de chômage dans les grands centres industriels, mais il existe une grande demande de main-d’œuvre. Il s’ensuit de graves difficultés qui contribuent à éliminer les influences négatives qu’exerce sur le marché du travail l’absorption en masse de la main-d’œuvre de la part des « laguer ». Une importante demande de main-d’œuvre aurait nécessairement donné lieu à l’émigration des travailleurs en quête de conditions de travail meilleures. En Russie, il s’agit non d’un salaire plus élevé, mais de conditions de nourriture, de logement et de climat plus favorables. Pour empêcher ce genre d’émigration, les travailleurs, et avec eux, du reste, tous les citoyens soviétiques, se virent interdire de changer, de par leur propre volonté, leur lieu de résidence.
De sévères sanctions sont en outre appliquées à qui est en retard ou s’absente de son travail sans motif reconnu. Nous avons déjà parlé de ce sujet dans la partie du chapitre intitulé : « Relativisme et terrorisme » (art. 58, § 14, du C.P. de la R.F.R.S.S.). Le 26 juin 1940, parut en Russie, relativement au « progoul », un décret menaçant de peines sévères qui change arbitrairement de résidence ou se présente en retard au travail. Ces deux infractions aux règlements sont considérées comme « progoul 5 ».
Les « laguer » servent de base au « dumping 6 » de la politique commerciale soviétique sur les marchés à l’étranger. De fait, ils fournissent les matières premières pour les échanges commerciaux avec les pays capitalistes. Le travail des esclaves des hommes dans les « laguer » procure à la Russie bolchévique la valeur extérieure nécessaire pour les échanges internationaux.
On entend dire aujourd’hui, de divers côtés, que les pays capitalistes peuvent fort bien collaborer, sur le terrain économique, avec la Russie, faire du commerce avec elle et réaliser de bonnes affaires.
Staline fait les mêmes assertions aux différentes délégations industrielles qui visitent la Russie. Il fait miroiter le mirage de l’équilibre mondial d’après-guerre. Dans ce « monde équilibré », la Russie bolchévique vendra, en échange de machines fournies par les États capitalistes, ses richesses naturelles, arrachées à la terre par le travail d’esclaves de dizaines de millions de victimes du système soviétique.
Ces assurances peu sincères du Kremlin, qui a élevé la jeune génération russe dans la conviction profondément enracinée qu’une collision décisive entre le communisme et le capitalisme est inévitable, car ils ne peuvent subsister l’un à côté de l’autre, sont publiées en toute bonne foi en première page des journaux des pays capitalistes. On oublie ainsi, ou l’on ne veut pas entendre parler de la tragédie de peuples entiers, qui, transférés de leur patrie dans les déserts asiatiques, doivent faciliter les échanges commerciaux par leur travail d’esclaves.
En Russie, à côté du système en vigueur pour la déportation dans les camps de travail par voie de sentence judiciaire, ou de l’« Osso », il existe encore une méthode administrative largement adoptée pour le transfert obligatoire d’hommes et de populations entières en Sibérie et dans l’Asie centrale. Ces émigrations forcées ont pour but de transformer la Russie, au moyen de la politique nationaliste et des plans économiques, en un État euro-asiatique compact, dont les confins méridionaux arrivent à la Perse et éventuellement à l’Océan Indien.
Pour la réalisation de ce plan grandiose de puissance de l’État russe, il faut coloniser les espaces sibériens et les territoires de l’Asie centrale. Les colonisateurs nécessaires devront surtout être fournis à la Russie par les pays de l’Europe centrale et des Balkans, qui déjà ont été ou seront dans l’avenir insérés dans la sphère de l’influence russe. Pendant les années 1939-1941, des millions d’esclaves blancs venant de la Pologne, de la Finlande, des Pays Baltes et de la Roumanie ont été déportés dans les steppes asiatiques.
Ce fut, pour ces nations, l’histoire renouvelée des invasions tartares et des populations réduites à l’esclavage et déportées en masse dans le centre de l’Asie. Aujourd’hui, semblable destin attend la Bulgarie, la Tchécoslovaquie, la Hongrie et peut-être l’Europe entière.
8. CONCLUSION
Notre analyse du code pénal bolchévique et des articles de la Constitution soviétique concernant l’organisation et l’action de la justice, nous autorise à exprimer les conclusions suivantes :
1) la justice en URSS n’a rien de commun avec les conceptions occidentales. Il s’agit d’une législation de caractère relativiste et qui, pratiquement, agit surtout par voie administrative.
Pourtant, la justice soviétique est, en réalité :
2) la technique de l’exercice du pouvoir ;
3) la technique de la réalisation de la révolution mondiale bolchévique ;
4) l’élément qui règle la demande de la main-d’œuvre indispensable à l’exécution des grands travaux de l’État (retour au système du travail d’esclaves) ;
5) l’élément éducatif et correctionnel visant à rendre « ceux qui ne professent pas les idées communistes » aptes aux conditions de vie dans l’État des travailleurs.
CHAPITRE III
ORGANES JUDICIAIRES TECHNIQUE DE L’ENQUÊTE
ET DE LA PROCÉDURE PÉNALE
1. ORGANISATION JUDICIAIRE
« Le Tribunal Suprême de l’URSS est l’organe judiciaire souverain. Il exerce sa vigilance sur l’activité de tous les organes judiciaires de l’URSS et des Républiques Fédérées » (art. 104 de la Const.).
« Le contrôle de l’activité de tous les tribunaux s’opère avec la participation des assesseurs populaires, exceptés les cas prévus par la loi » (art. 103 de la Const.).
« Les juges sont indépendants ; ils sont soumis uniquement à la loi » (art. 112 de la Const.).
Dans l’organisation de l’autorité judiciaire, l’autonomie des tribunaux des Républiques Fédérées est respectée. Cette loi ne regarde pas la nomination des procureurs, ainsi qu’en fait mention le projet ci-joint. La Constitution (art. 116) donne aux procureurs des républiques fédérées le droit de nommer les procureurs des districts inférieurs, toujours avec l’approbation du procureur en chef de l’URSS. Presque chaque République a un code pénal spécial. Mais cette diversité est purement pour la forme, car chaque code ne se distingue des autres que par la numération des articles.
Indépendamment des susdites institutions judiciaires (voir le schéma), entrent en question des tribunaux révolutionnaires (Rev-tribunaux) qui correspondent aux tribunaux sommaires et dont la Constitution ne parle pas.
L’art. 102 admet au contraire :
« les Tribunaux Spéciaux de l’URSS institués par disposition du Tribunal Suprême de l’URSS. »
(Un tribunal de ce genre a jugé le procès du maréchal Toukhatchevski et des 7 généraux).
D’après le contenu des observations à l’art. 23 du code de procédure pénale, les tribunaux spéciaux de l’URSS se divisent en : a) tribunaux de guerre, b) tribunaux des chemins de fer, c) tribunaux de transport fluvial et maritime.
Les tribunaux de guerre existent auprès des : a) districts de guerre, fronts et flotte maritime, b) armées, corps, autres unités militaires et institutions militarisées. Ils traitent des procès : 1) des personnes militaires et de celles qui font partie des organisations militarisées coupables de délits militaires, contre-révolutionnaires, dirigés contre l’avoir de l’État et de la société et d’assassinats, 2) des personnes non militaires si les délits accomplis par elles sont en rapport avec les procès militaires ou s’ils menacent l’existence et la puissance de l’armée rouge.
On dirait que cette façon de voir n’admet aucune exception, non seulement en ce qui concerne l’organisation de la justice soviétique, mais encore moins par rapport au texte de l’article 112 de la Constitution.
Mais ce n’est qu’une impression superficielle ; en lisant attentivement la Constitution soviétique, nous découvrons que l’autonomie des Républiques Fédérées et l’indépendance des juges sont fictives, car ces privilèges sont pratiquement annulés par d’autres dispositions de la Constitution.
L’article 104 de la Constitution porte :
« Le Tribunal Suprême de l’URSS exerce sa vigilance sur l’activité de tous les organes judiciaires de l’URSS et des Républiques Fédérées. »
Il résulte cependant, des articles 115 et 116, que les procureurs des Républiques Fédérées, des territoires, des régions et d’autres unités autonomes sont nommés par le Procureur en Chef de l’URSS.
Par ce qui précède, on voit clairement que l’autonomie des tribunaux des Républiques Fédérées n’est qu’apparente et n’existe pas pratiquement. Comme on le verra dans la suite, l’activité des tribunaux est centralisée au maximum.
Également illusoire est l’indépendance des juges qui sont élus (ou plus exactement nommés) pour une période de temps limitée (5 ans ; 3 ans pour les Tribunaux du Peuple).
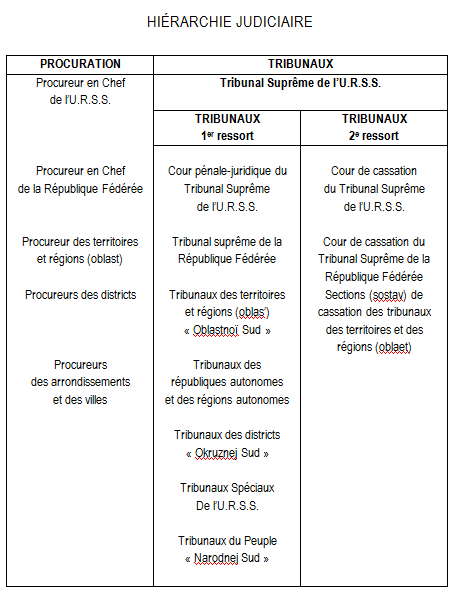

Nous avons dit que les juges sont nommés et non élus, car l’élection faite par le Conseil Suprême de l’URSS et, dans chaque République, par les organes qui dépendent de lui, n’est qu’une indication donnée par le parti communiste ayant partout voix décisive.
L’élection des juges populaires se fait d’après le système employé pour l’élection des membres des Soviets. Le vote est universel, direct, égal et secret, mais on ne peut voter que pour un candidat unique.
Ceci est inconcevable pour une mentalité occidentale ; en Russie, c’est tout ce qu’il y a de plus naturel. Les candidats au titre de juges populaires sont présentés par les fédérations et les organisations où, de nouveau, la voix décisive, pour ne pas dire unique, appartient au parti communiste. Celui-ci présente la candidature d’un seul individu ou d’un groupe d’individus, en sorte que les électeurs peuvent voter de la manière la plus universelle et secrète ; le triomphe du candidat du parti est assuré puisqu’il n’existe pas d’autres candidats.
Ce mode d’agir, bien qu’étrange, est employé partout en URSS. Dans les élections soviétiques, il n’y a pas d’élections ! C’est un fait que nous sommes obligés de constater.
On ferait donc preuve d’un optimisme exagéré en soutenant que, dans l’État révolutionnaire « des ouvriers et des paysans », les tribunaux sont indépendants.
Une autre circonstance déconseille l’optimisme. À côté du Commissariat du Peuple pour la Justice, une autre institution agit en URSS, avec les plus amples attributions judiciaires, qui lui sont concédées par le Comité Central Exécutif et le Conseil Suprême de l’URSS. Nous avons nommé l’NKVD.
Les droits de cette institution (comme nous le verrons par la suite) sont si vastes qu’ils annulent le texte de l’article 112 de la Constitution et démentent la raison d’être de tout l’organisme dépendant du Commissariat de la Justice.
Il faut donc constater que la justice soviétique est entièrement aux mains de deux institutions : le Commissariat du Peuple pour la Justice et le Commissariat du Peuple pour les Affaires de l’Intérieur (NKVD).
D’après la rédaction du code de procédure pénale soviétique et particulièrement d’après l’art. 108, on doit déduire que les organes de l’NKVD mènent l’enquête dans les procès des délits : contre-révolutionnaires (art. 58 c. p.), dirigés contre le fonctionnement régulier des organes du pouvoir gouvernemental (art. 59 c. p.), de sabotage et diversion économique (art. 128-132), délits militaires etc., bref les délits ayant un caractère politique.
Les tribunaux traitent, en principe, des procès pour les délits prévus dans le code pénal ; l’NKVD, au contraire, élimine de la société les individus et les groupes « socialement dangereux » et « socialement nuisibles ». Durant la période des grands procès de Moscou, les délits politiques furent jugés par le Tribunal Suprême de l’URSS, mais simultanément la « Troïka », commission extraordinaire de trois membres, sortie de l’NKVD, condamnait à mort ou envoyait dans les camps de travail d’autres prévenus politiques. Lorsqu’on vit que les procès de Moscou suscitaient des critiques à l’étranger et le mécontentement dans le pays, le Tribunal Suprême renonça en partie aux procès publics et chargea le Commissariat du Peuple pour les Affaires Intérieures de condamner une série d’accusés politiques.
Il résulte du texte de plusieurs suppléments aux articles du code de procédure pénale, qu’il existe des « règles spéciales » conférant des droits particuliers aux organes de l’NKVD. Ces règles traitent certainement des limites de la compétence du Commissariat pour les Affaires de l’Intérieur, mais comme elles sont entièrement secrètes, elles demeurent inconnues au public et à plus forte raison à l’opinion des juristes des puissances étrangères.
Dans ces conditions, il est impossible d’établir une vraie ligne de démarcation, d’autant plus que celle-ci est souvent une cause de discussion entre les intéressés eux-mêmes.
L’art. 108 du code de procédure pénale, que nous avons déjà mentionné, se termine comme suit :
« Lorsque l’enquête, dans les procès catalogués dans l’article même, est menée par les organes du Bureau Général de la Sûreté de l’État de l’NKVD les cas sont indiqués dans les règles spéciales (20 octobre 1929). »
Il convient plutôt d’observer le côté pratique de l’activité des organes de la justice soviétique et de baser son opinion sur des constatations, pour se faire ainsi une idée de ceux qui agissent, de quand et par quel motif ils arrêtent des individus contrevenant à la loi soviétique, les jugent et émettent leur verdict.
Étant donné que la loi soviétique est un des instruments de la révolution, il résulte qu’il existe une différence entre le délit commun et le délit politique.
L’article 46 du code pénal divise les délits en deux catégories :
a) ceux qui sont dirigés contre les bases du système soviétique introduit dans l’URSS par le pouvoir des ouvriers et paysans et donc considérés comme très dangereux ;
b) tous les autres délits.
Conséquemment, ils sont jugés par des organes divers.
Avant de passer à la description technique de la justice soviétique, nous devons observer que le délit le plus fréquent en URSS est celui de contre-révolution et donc le délit politique. Cela est indispensable pour nous rendre compte de la profondeur et de l’importance de la terreur politique qui constitue la base de la vie dans l’État Soviétique.
2. LE COMMISSARIAT DU PEUPLE
POUR LES AFFAIRES DE L’INTÉRIEUR (NKVD)
NKVD est, au fond, la 3e dénomination du même organe. Son père spirituel est Félix Djerzinsky, ancien chef de la Commission Extraordinaire (Tchéka). Son nom est donné en Russie à des villes (Djerzinsk), à des kolkhoz, à des prisons et des camps de travail. À l’étranger, en plus de la Tchéka, on connaît aussi la GPU ; les deux n’existent plus de nom, mais bien de fait, sous la forme nouvelle de l’NKVD.
Le champ d’action de l’NKVD est plus vaste que celui d’un ministère de l’intérieur dans les pays où le régime capitaliste est en vigueur. Le chef de l’NKVD jouit, comme nous l’avons déjà entrevu, non seulement des pouvoirs d’un ministre de l’intérieur, mais aussi d’autres prérogatives de caractère juridico-administratif. Le développement extraordinaire des agences de l’NKVD a donné lieu, en 1941, à la formation d’un Commissariat spécial du Peuple pour la sûreté de l’État (NKGB). Celui-ci est né de l’ancien office de sûreté de l’État qui était soumis au Commissaire du peuple pour l’intérieur.
Comme l’NKGB est peu connue, nous emploierons désormais les initiales NKVD pour désigner l’organe qui exerce le contrôle sur la vie intérieure, combat la contre-révolution et représente la dictature de Staline, le Parti et, selon la nomenclature officielle, le Prolétariat. Les citoyens russes ont aussi leur manière d’interpréter ces initiales : ils substituent, aux paroles du fameux dicton russe : « Tu ne peux débrouiller cette affaire sans vodka », celles-ci, bien significatives : « Tu ne peux la débrouiller sans l’NK-vodka 7 ».
Le chef de l’NKVD est le Commissaire du peuple Laurent Pavlovitch Beria ; il a hérité du portefeuille ministériel de Iagoda et de Iejov, fusillés tous les deux. Le but principal de l’NKVD est la guerre faite à la contre-révolution et, pour parler clairement, à toute manifestation hostile à l’absolutisme de Staline (« samodierjavie »). Déjà, André Gide, qui observa la Russie avec les yeux du communiste français, a souligné, dans son livre : « Retour de l’URSS. », la tendance à anéantir sans pitié ces manifestations.
« Mais aujourd’hui, écrit-il, c’est l’esprit de soumission, le conformisme qu’on exige. Seront considérés comme « trotskistes » tous ceux qui ne se déclarent pas satisfaits. De sorte que l’on vient à se demander si Lénine lui-même reviendrait sur la terre aujourd’hui...
Que Staline ait toujours raison, cela revient à dire que Staline a raison de tout.
DICTATURE DE PROLÉTARIAT, nous promettait-on. Nous sommes loin de compte. Oui : dictature, évidemment, mais celle d’un homme, non plus celle des prolétaires unis, des Soviets. Il importe de ne point se leurrer et force est de reconnaître tout net : ce n’est point là ce qu’on voulait. Un pas de plus et nous dirons même : c’est exactement ceci que l’on ne voulait pas 8. »
Nous entendons souvent poser la question : pourquoi le peuple russe ne se rebelle-t-il pas contre le parti bolchevique qui, après tout, ne compte que deux millions de membres 9 ?
En Russie, on n’entend pas semblable demande, seul un Occidental peut la faire : il ne se rend pas compte de l’éthique bolchévique et, ayant grandi dans un climat démocratique, il n’aborde qu’avec beaucoup de réserve les révélations de l’Union Soviétique.
Il faut se rendre compte que, dans sa guerre à la contre-révolution, l’NKVD ne peut que triompher, ayant à sa disposition :
la loi soviétique ;
une troupe de dénonciateurs ;
des sections spéciales de l’Armée Intérieure de l’NKVD ;
des lignes téléphoniques particulières fonctionnant indépendamment des lignes générales ;
des moyens particuliers de transport : maritimes, fluviaux et par chemins de fer (bannière blanche et verte).
Avec des moyens semblables à sa disposition, l’NKVD est un véritable État dans l’État, qui jouit de pouvoirs beaucoup plus vastes que n’en avait la fameuse « Okhrana » tsariste.
Le code pénal tout entier (en particulier les articles 58 et 7) est conçu de façon que tout citoyen de l’URSS peut être arrêté et emprisonné sous le prétexte que c’est un devoir d’empêcher un délit possible. En outre,
« la procédure qui confirme les arrestations faites par les organes de la GPU » et
« la procédure et la vigilance sur les enquêtes faites par les organes de la OGPU sont soumises à des règles spécialement établies dans ce but » (observations ajoutées aux articles 104 et 107 du CPP).
Un astérisque, dans la rédaction du code, précise que GPU et OGPIT signifient : « Office Général de la Sûreté de l’État NKVD URSS ».
Ainsi que nous l’avons dit plus haut, ces « règles spéciales » ne sont pas connues du public et doivent être secrètes, comme toute l’activité de l’NKVD reste secrète et cachée avec soin.
Indépendamment des tribunaux ordinaires, il existe dans la Russie Soviétique l’institution des tribunaux de contumace, qui agissent par voie administrative. Cette institution est dans les mains de l’NKVD.
En 1937, « sous Iejov », durant la période de la plus grande terreur (nommée Iejoviane par les Russes), naquit à Moscou le Tribunal des Trois, institué pour détruire « les ennemis du Peuple ». Ce tribunal avait le droit, par voie administrative, et par contumace, de condamner pour un temps indéterminé, à la déportation, aux camps de travail et à la peine de mort.
Après l’exécution de Iejov, la « Troïka 10 » fut liquidée et ses pouvoirs passèrent, dans une mesure plus restreinte, à la Commission Spéciale de l’NKVD 11 à Moscou. Ce comité extraordinaire de l’NKVD (Osso) a conservé le droit de condamner par voie administrative, ou par contumace, à un maximum de S ans dans « les camps correctionnels de travail ». Les condamnations de l’Osso ne sont jamais inférieures à trois ans et généralement elles atteignent jusqu’à 5 et 8 années. Toutes les informations sur la conduite plus ou moins légale des citoyens sont fournies à l’NKVD par la troupe des dénonciateurs. Dans la Russie tsariste, ceux-ci étaient appelés « donostchik » ; maintenant on les nomme « seksot », parole qui provient de « sek » (secret) et « sot – sotroudnik » (collaborateur).
L’article 91 du Code de Procédure Pénale dit :
Les bases pour formuler l’acte d’accusation sont :
1) les déclarations de citoyens ou de corporations ;
2) les dénonciations faites par des institutions d’État ou des personnages officiels ;
3) leurs accusations ;
4) la Proposition du procureur ;
5) le libre témoignage des organes de l’instruction, du juge instructeur ou du tribunal.
Comme on le voit, la dénonciation a la place d’honneur.
Dans l’histoire de la jurisprudence russe, la dénonciation a ses traditions. La loi moscovite 17e siècle obligeait le juge qui avait reçu une dénonciation, fût-elle anonyme, à faire le procès du dénoncé. Le but de ce procès était d’obliger l’accusé à confesser sa faute, à se repentir. Tels sont du moins les commentaires provenant de source soviétique.
La jurisprudence soviétique moderne n’a pas oublié l’ancienne loi moscovite dans l’application de ses moyens préventifs.
On part de ce fait : l’individu dénoncé, et par suite suspect, a les dispositions nécessaires pour commettre un délit, afin de conclure qu’il est dangereux pour la communauté. S’il n’a pas encore commis la faute, il pouvait en avoir le désir, il en avait l’intention.
Et comme l’intention et l’acte sont également punis (art. 19 du code pénal), le suspect devient automatiquement un accusé et, comme tel, les moyens préventifs de la défense sociale peuvent lui être appliqués.
Le juge d’instruction ne se préoccupe pas de chercher la preuve. Il demande la confession. Nous reviendrons plus tard sur cet argument. Constatons, pour le moment, que la dénonciation est la base non seulement de l’arrestation, mais encore de l’accusation.
L’école soviétique enseigne déjà la dénonciation. Les enfants grandissent avec la persuasion que dénoncer est une vertu du bon citoyen de l’URSS, et le code pénal (art. 58) condamne sévèrement l’omission de la dénonciation d’un délit projeté ou commis. En conséquence, le soviet considère la dénonciation comme une chose naturelle et juste. Elle est souvent le moyen de se ménager les bonnes grâces de l’NKVD. Mais c’est aussi une arme à double tranchant, car les dénoncés se vengent et les dénonciations se font pour des choses minimes.
L’armée des « seksots » compte de nombreux millions de membres. Elle est formée d’informateurs volontaires et d’informateurs obligés. Les volontaires sont : ou les fanatiques, ou ceux qui croient que la dénonciation est une vertu ; ou simplement les faibles. Les obligés sont tous gérants de maisons, garçons de restaurants, personnel dirigeant les fabriques, capitaines de navires, conseillers des syndicats, chaque troisième membre du Komsomol, chaque membre du parti, les agents politiques de l’armée, le personnel administratif des kolkhoz, des sovkhoz, etc.
L’NKVD dispose d’une armée intérieure indépendante de l’armée régulière ; elle est destinée à réduire toute tentative éventuelle et collective d’opposition. Les membres de cette troupe peuvent être comparés aux « opritchnik » d’Ivan le Terrible ou aux « okhrannik » tsaristes.
D’après les calculs des citoyens soviétiques, cette armée compte 2 millions d’hommes ; certains disent davantage, mais nous croyons la première évaluation plus juste. « Les troupes internes de l’NKVD », tel est leur nom officiel, sont en temps de paix une force plutôt latente car, depuis les tristes expériences du soulèvement de l’Ukraine et du Caucase (période de la famine de 1931-32 et émeute pour l’indépendance ukrainienne en 1936-37), le soviet ne se révolte pas et les tentatives de conspiration, surtout parmi les races de couleur, dans la Russie de l’Asie centrale, sont étouffées dès leur naissance.
En temps de guerre, l’armée de l’NKVD, dotée des meilleures armes mécaniques, de lance-flammes, de chars d’assaut, etc., a pour tâche d’empêcher la désertion du front et surtout d’arrêter le moindre indice de révolte dans l’armée ; elle est beaucoup mieux outillée que les sections combattant en première ligne. Ce n’est pas un mystère pour qui, étant allé en Russie, a eu l’occasion de parler en secret avec des blessés ; de même que ce n’est pas chose nouvelle que l’arrière-garde n’est pas armée. Elle reçoit des armes seulement pour les exercices ; elles sont apportées par les voitures de l’NKVD et remportées par elles quand les tirs sont finis.
Les divisions destinées au front partent souvent sans armes, toujours sans munitions ; elles ne sont complètement armées qu’après avoir dépassé les lignes défensives de l’armée interne NKVD 12.
Tout ceci est tenu jalousement secret par la propagande soviétique et les correspondants des journaux étrangers ne sont pas admis près de l’ensemble des lignes.
La troupe interne de l’NKVD surveille aussi les prisons et les camps de travail.
Une réaction immédiate, une parfaite liberté d’action indépendante de toute autre unité administrative et la cohérence dans le travail sont assurées aux organes de l’NKVD par des transports spéciaux, des lignes téléphoniques et des postes de radio particuliers.
L’NKVD administre les prisons (Direction Générale des Prisons), les camps de concentration et de travail (Direction Centrale des Camps – Goulag) et dirige les déportations en masse (l’exil et la déportation).
Du commissaire de l’intérieur dépend encore la Milice Rouge des paysans et des ouvriers (RKKM), chargée de maintenir l’ordre dans les villes et les campagnes de la Russie et d’arrêter les personnes suspectes d’avoir commis des délits communs. Cette Milice correspond à la police des pays démocrates. Elle fait l’instruction préliminaire (pour les délits communs seulement) et passe ensuite les causes au Tribunal du Peuple qui doit les juger. Tous les procès politiques passent par l’instruction de l’NKVD et 80 pour 100 au moins d’entre eux sont de la compétence de l’Osso.
Voici un exemple : des 2000 accusés politiques environ détenus en 1941 dans les prisons d’Odessa et arrêtés dans les pays occupés (Pologne et Roumanie), 16 Polonais et 10 Roumains reçurent leur sentence des tribunaux, tous les autres furent jugés par l’Osso, par voie administrative, et par contumace.
Jusqu’à la formation du Commissariat du Peuple pour la Sûreté de l’État, toute l’organisation des investigations militaires et politiques à l’étranger dépendait du Commissariat du Peuple pour les Affaires de l’Intérieur, institution plus vaste et mieux organisée que toute autre au monde.
Mais de qui dépend l’NKVD ?
Selon la lettre de la loi, le contrôle sur l’NKVD devait être exercé par le Conseil Suprême de l’URSS. Mais comment accorder ces fonctions avec le fait que les membres du Conseil sont l’objet de la surveillance la plus vigilante et la plus délicate de la part de l’organe qu’ils doivent contrôler ? En pratique donc, l’NKVD est un organe suprême soumis sans doute à Staline lui-même. Peut-être est-ce pour cela que les chefs de cette nouvelle « Okhrana » disparaissent dès que leurs ailes commencent à grandir et pour cela aussi que l’organe contrôlant tous les autres en n’étant pas surveillé à son tour exerce la violence la plus absolue.
3. MÉTHODE DES ARRESTATIONS
Il est de règle que les arrestations des personnes soupçonnées de délits communs soient exécutées par la milice. L’article 91 du code de procédure pénale parle, comme nous l’avons vu, de ce qui sert de base à ces arrestations.
La façon de procéder aux arrestations est la même que celle des pays à régime capitaliste.
Cette affaire est tout à fait différente des arrestations opérées par l’NKVD. Là des « règles spéciales » sont en vigueur.
Un ordre d’arrestation n’est pas indispensable pour l’arrestation même. Durant la période de 1939-1941, dans les pays occupés par les soviets (Pologne, Pays baltes, Bessarabie), on appliqua très souvent le système qui consistait à arrêter dans la rue des personnes absolument inconnues des autorités de l’NKVD. On faisait des rafles en masse dans les locaux publics et au dehors ; le tri avait lieu dans les postes de la milice ou les bureaux de l’NKVD. On retenait en général tous ceux qui n’avaient pas de papiers personnels munis du visa des autorités soviétiques et toutes les personnes de passage provenant de divers lieux. Un individu surpris seul était aussi arrêté. En ce cas, la manière de procéder était la suivante : deux passants qui parlaient ensemble étaient arrêtés par des soldats on des agents de l’NKVD ; séparés l’un de l’autre, on demandait à chacun d’eux quel était le sujet de leur conversation. Si les réponses étaient identiques, ils étaient mis en liberté, dans le cas contraire, on les arrêtait. L’arrestation était basée sur le soupçon d’une conversation « antirévolutionnaire », où l’on pouvait peut-être se plaindre de la discipline en vigueur, ou conspirer ! Aussi, quand les vrais conspirateurs se rencontraient, se mettaient-ils d’accord pour que la déposition fût la même et, interrogés par un agent de l’NKVD, ils affirmaient, par exemple, qu’ils parlaient d’un film.
Toutefois, celui qui arrête s’efforce en général de démontrer qu’il agit conformément à la loi ; il présente un ordre en règle signé du procureur. Souvent, la formalité en question est en retard de quelques semaines ; elle est parfois omise entièrement.
Nos observations sur l’activité de l’NKVD, tant en Russie que dans les pays occupés, nous ont convaincus que les arrestations sont faites dans chaque cas selon un plan prévu et par rapport à la situation politique (« obstanovka »). Tandis que dans les pays démocrates l’interprétation de la loi est toujours la même ou du moins, dans le monde entier, tend à l’être, en Russie la loi est élastique ; cette élasticité vient de l’article 16 du code pénal, qui admet le jugement par analogie, et l’art. 8, qui conditionne la qualification du fait délictueux à la situation politique.
L’NKVD a des listes toutes prêtes de personnes qui, selon la situation politique, devront être arrêtées.
Du temps de Iejov, les personnes désignées pour les arrestations étaient les suivantes : les trotskistes, les agents de sabotage, les espions, toutes les personnes ayant ou ayant eu des relations à l’étranger avec qui que ce fût, et leurs parents et connaissances. Le sens des mots trotskistes, saboteur, espion est très large en URSS. À la suite d’un trotskiste, on voit aller des dizaines de parents et des centaines de connaissances. Du point de vue de la loi soviétique, cela ne constitue pas un abus, car l’article 7 du code pénal admet la punition non seulement des personnes
« qui se sont rendues coupables d’activité constituant un danger pour la société »
mais aussi de
« celles qui représentent le danger d’un délit, par suite de leurs RELATIONS avec une ambiance favorable aux délits, ou par leur activité antérieure ».
Il est vrai que Iejov a été « liquidé », mais la pratique des arrestations en masse n’a pas varié, ainsi que nous avons pu l’observer dans les contrées occupées et également en Russie, dès avant l’ouverture des hostilités germano-soviétiques.
Le moment de l’arrestation dépend de la situation politique. Comme il est prévu que l’activité de l’NKVD doit être secrète, de même les arrestations doivent se faire autant que possible d’une manière cachée, ordinairement la nuit.
L’imagination des agents de l’NKVD est, dans le genre, suffisamment féconde. Dans les lieux connus pour l’attitude antisoviétique de la population, on évite, plus qu’ailleurs, les circonstances qui permettraient à la personne arrêtée ainsi qu’à son entourage de déduire ce qui a été fait. La personne que l’NKVD a l’intention d’arrêter est généralement appelée à se rendre dans quelque bureau, pour affaires de service, peut-elle présumer ; souvent elle est invitée à se présenter au siège du chef, où l’attendent les agents de l’NKVD. De la même manière, les diplomates sont, de leur poste à l’étranger, appelés à Moscou, ainsi que les personnes très connues dans le pays.
Quand l’arrestation a lieu au domicile de l’accusé, les agents de l’NKVD s’efforcent de tranquilliser la famille, promettant que le prévenu reviendra chez lui aussitôt rédigé le procès-verbal ou après éclaircissement d’une simple formalité quelconque et de peu d’importance. Naturellement, aucune des personnes présentes ne croit à cette promesse et cependant il n’en est pas non plus qui n’aient l’illusion ou l’espérance que peut-être, en cet unique cas, les agents de l’NKVD ont dit la vérité.
4. L’INSTRUCTION
Pour comprendre la technique de l’instruction du procès soviétique, il faut auparavant comparer ce qui dérive de l’esprit de la loi dans un pays démocrate et ce qu’il en est en Russie.
Nous avons déjà dit, au chapitre précédent, que dans tout pays démocratique qui respecte l’indépendance des tribunaux (ou tend en ce sens) de jure et de facto, le but de l’instruction est d’établir l’état des choses, cherchant soit à accumuler les preuves de la culpabilité de l’accusé, soit à éliminer ce qui serait suspect. Ce n’est qu’après avoir réuni des preuves suffisantes de la faute que l’instruction dresse l’acte d’accusation. Si les bases de cet acte manquent, le procès est annulé et l’accusé qui a été arrêté est remis en liberté.
Les débats juridiques font suite à l’acte d’accusation et doivent établir ce qui concerne le fait du délit. Le tribunal est libre dans l’appréciation des preuves de la faute et n’est en rien lié par le résultat de l’instruction, par l’acte d’accusation ou les documents recueillis au cours du débat juridique. La faute de l’accusé est prouvée par les matériaux réunis.
Nous retrouvons des principes semblables dans le code pénal soviétique et une manière d’agir identique dans les tribunaux soviétiques pour les délits communs.
Mais combien différente cependant est la pratique de la justice soviétique appliquée aux délits politiques contre la révolution !
Dans ces cas, l’instruction soviétique a pour but :
a) d’inventer le délit,
b) de l’attribuer à un individu qui déplaît au régime,
c) de persuader cet individu qu’il a commis le délit dont il est accusé,
d) de l’obliger à le confesser,
e) de rédiger l’acte d’accusation.
On connaît bien en Russie l’expression « attacher un article » (« pryzepith statiu »). L’article (du code pénal) atteint les coupables comme les innocents. Telle est la conséquence de la théorie largement appliquée, d’après laquelle « qui est arrêté est coupable ».
Si l’organe auquel est confiée l’instruction ne réussit pas à recueillir les preuves, il cherche le fondement d’un autre acte d’accusation, imputant un nouveau délit à l’accusé. Selon la décision libre de l’organe instructeur, la cause est envoyée au tribunal du district ou suprême ou bien à la Commission spéciale de l’NKVD (Ossoboie Soviestchanie).
Le tribunal du district se base sur l’acte d’accusations et cherche à prouver la culpabilité de l’accusé. La confession de la faute en est une preuve absolue et forme la base de la condamnation. « Ossoboie Soviestchanie » s’appuie toujours exclusivement sur les éléments recueillis durant l’interrogatoire et prononce la sentence par contumace, par voie administrative.
Cette institution a le droit d’émettre des verdicts condamnant aux camps correctionnels de travail pour une durée pouvant atteindre 8 années.
Si les preuves de la culpabilité manquent, l’accusé est obligé de fournir des contre-épreuves.
L’esprit de la jurisprudence soviétique est bien illustré par une série d’anecdotes connues en Russie. Un proverbe italien dit : « Arlequin plaisantant se confesse. » Rien ne peut mieux que l’anecdote caractériser la vie sociale et politique d’un pays. Nous nous permettrons d’en citer deux :
Dans un établissement de bains publics, le technicien d’une fabrique d’instruments électrotechniques de Léningrad a été volé ; en lui a pris ses vêtements, il ne lui reste que son gilet. La milice, accourue sur place, ne trouve pas les auteurs du vol, mais, pour ne pas en perdre l’habitude, elle perquisitionne ce qui est resté. Le résultat est bon. Dans le gousset du gilet, on trouve un fil de cuivre. Le raisonnement n’est pas long. L’électrotechnicien... travaille dans une fabrique... a volé le fil qui est propriété de l’État socialiste... saboteur ! Le technicien est arrêté (Des anecdotes de Zochtchenko).
Les habitants du Caucase parlent d’un lièvre échappé de Russie Soviétique. L’animal, après avoir traversé la Perse, ne s’arrête que dans le désert voisin de Kermânchâh.
– Pourquoi as-tu fui ? – lui demanda le chacal.
– Parce que là ils castrent les chameaux.
– Mais tu es un lièvre !
– Peu importe ! Ils vous prennent, vous castrent et puis... prouve que tu n’es pas un chameau !
Ces anecdotes ne sont pas l’illustration de cas sporadiques, de stupidité ou de mauvaise foi des organes instructeurs, ils reflètent plutôt le système en vigueur. Dans le système de l’instruction soviétique domine la tendance à l’auto-accusation. En règle générale, le juge d’instruction ne donne pas à l’individu les raisons de son arrestation, mais il exige que lui-même confesse sa faute.
L’auto-accusation équivaut à l’aveu du délit et c’est là ce que désire l’instruction. Dans sa phase initiale, on a cherché à persuader le prévenu que l’auto-accusation est nécessaire, que la confession spontanée peut seule adoucir le verdict et lui rendre peut-être la liberté.
L’éventuelle confession n’est point cependant la fin de l’instruction, l’acte d’accusation n’est pas rédigé alors. Il est possible que l’accusé ait d’autres délits sur la conscience ; il faut, par les mêmes méthodes, lui en arracher encore la confession.
Si ce dernier s’y refuse, le juge demande les preuves de son innocence... (prouve que tu n’es pas un chameau).
Exécutée de cette manière, l’enquête dure souvent pendant trois ou quatre ans, bien que le code de procédure pénale prévoie un mois comme terme de la durée de l’enquête faite par le juge instructeur auprès du tribunal du district et le terme de deux mois pour celle faite par le juge d’instruction de l’NKVD. Les procureurs ont droit au prolongement de ces limites de temps, et, comme il résulte de la pratique de la justice soviétique, ils profitent souvent et bien volontiers de ce droit.
La tendance à « attacher » un article du code pénal domine dans toute l’instruction. Quand il est impossible d’accuser la personne arrêtée d’avoir commis un délit, on l’accuse d’avoir tenté la chose ou seulement d’en avoir eu l’intention. Sur ce point, il est impossible de réunir les preuves de son innocence.
Quand il surgit une difficulté pour formuler l’accusation, l’NKVD a recours au système de l’interrogatoire « biographique ». Le prévenu est obligé de raconter sincèrement et en détail une certaine période de sa vie. Ce récit est répété plusieurs fois, à quelque distance de dates. Si ces divers récits ne s’accordent pas d’une façon absolue, l’instruction y voit la preuve certaine que l’on cherche à cacher un délit et que le moment est venu d’induire le prévenu à la « confession » (raskaianie).
En principe, l’instruction évite de montrer à l’accusé les preuves de sa faute. Souvent parce que ces preuves font défaut, mais surtout dans le but d’obtenir la « confession ». Briser le moral de l’individu, faire naître en lui la conviction qu’il a grandement offensé l’État socialiste, c’est à quoi tend l’instruction.
Pour arriver à cette fin, des moyens variés sont employés.
Art. 136 du code de procédure pénale :
« Le juge d’instruction n’a pas le droit d’exiger de l’accusé, par violences, menaces ou autres moyens semblables, des concessions ou confessions. »
Ceci ne regarde pas les accusés de délits politiques dont l’instruction est faite par les organes de l’NKVD et qui jouissent de « règles spéciales ».
Quand, en dépit de toutes les persuasions, des conseils et des promesses, le prévenu continue à soutenir qu’il est innocent, le juge d’instruction se met à fouiller dans le nombre de moyens défendus (ou peut-être indiqués) par l’article 136 du code pénal.
Et ceci pour appliquer le principe : « La personne arrêtée est coupable. »
Le prévenu doit avoir un article « attaché » et l’instruction se charge de l’obliger s’il ne veut pas le faire de lui-même. L’atmosphère de l’instruction soviétique est telle qu’on se rend compte que, dans la lutte, il ne s’agit pas du triomphe de la vérité, mais uniquement de la victoire du juge d’instruction.
Il existe des moyens variés pour obtenir les confessions désirées par l’instruction. Les juges observent une certaine gradation en les appliquant.
Si la peur et la terreur morale ne suffisent pas pour arracher au malheureux les confessions désirées, on passe aux tortures physiques, dont il est impossible d’énumérer les différents systèmes.
Beaucoup ont été décrits dans les publications traitant de la GPU. Nous pouvons seulement affirmer ici qu’aucune d’elles n’exagère ni n’épuise le répertoire de l’NKVD.
Les prisonniers russes citoyens de l’URSS parlent de griller sur une plaque embrasée ou d’arracher les ongles, comme nous parlons de la pluie et du beau temps. Nous ne faisons pas mention de la perte de quelques dents ou de rossées, ce qui est pour eux chose toute naturelle, inhérente à l’instruction et dont parlent seulement les importuns. Celui qui écrit ces lignes a été enfermé dans une prison avec un dignitaire soviétique qui avait vu autrefois le film russe « Barbaries de la Gestapo ». Interrogé à ce sujet pour savoir si les manières de faire de l’NKVD sont bien différentes de celles de la Gestapo, le dignitaire dit en riant : « C’est exactement pareil » (absoloutno totchno !).
« Les usages d’une époque quelconque sont liés à ce qui reste de ceux de l’époque antérieure. Ce fait leur assure une certaine continuité et souvent une stabilité de conditions produites sur leurs bases 13. »
Nous ne devons pas être surpris que les descendants d’Ivan le Terrible et de Pierre le Grand, si glorifiés de nos jours, emploient les systèmes des « opritchnik ».
« Le cruauté, la répression spirituelle et l’état de ruine morale d’un peuple peuvent s’expliquer en pensant aux moyens qui, pendant des siècles d’existence passés à l’histoire, ont fini par devenir une seconde nature. » (N. JEWREINOV, op. cit.)
La cause de la terreur qui règne aujourd’hui dans la Russie Soviétique, comme celle des cruautés de l’NKVD cachées avec soin, peut être attribuée non seulement à l’éthique spéciale bolchévique qui interdit la pitié mais aussi à tout le passé de la Russie des tsars et à des habitudes séculaires que ni les oukases des tsars plus libéraux, ni la jurisprudence soviétique n’ont pu détruire.
Les employés de l’NKVD, dont la mémoire est pleine des récits entendus, dès leur enfance, sur les cruautés des capitalistes, se représentent ces persécutions comme une série de sévices physiques au préjudice du prolétariat. Ils le croient pour avoir vu le dessin de la propagande soviétique qui représente le riche fermier avec le fouet en mains et le propriétaire d’usine avec la cravache. C’est pourquoi les sympathisants du capitalisme doivent être payés avec la même monnaie et, comme tels, soupçonnés, tous, de délits antirévolutionnaires, bu reste, comme dit Jewreinov,
« la possibilité d’ordonner une flagellation ou de l’exécuter est devenue souvent pour nous, Russes, une simple volupté de torture ».
L’emploi de la torture, comme nous l’avons dit plus haut, n’est pas une règle de l’instruction soviétique. C’est un système employé par l’instruction de l’NKVD, quand les moyens admis par le code pénal n’ont pas suffi. Il est appliqué sans pitié et presque toujours aux membres d’organisations secrètes ayant un caractère politique.
La préparation technique des juges d’instruction soviétiques ne demande pas, comme dans les pays capitalistes, de nombreuses années d’étude. Avec la rareté des gens spécialisés en Russie, la question professionnelle n’a pas une importance décisive. Appartenir au parti ou au Komsomol (Union de la jeunesse communiste) est un titre supérieur à celui de la science pour obtenir un poste impliquant une responsabilité. Les mêmes lois régissent la jurisprudence. En général cependant, les juges d’instruction et les avocats (plaidants) basent leur instruction sur dix années d’école élémentaire et moyenne et trois années d’institut juridique. Il existe en outre des cours juridiques de peu de durée (quelques mois) ; et il arrive que le juge d’instruction ne possède aucune préparation professionnelle.
Au point de vue de la culture professionnelle et de la capacité à conduire l’instruction, les juges d’instruction de l’NKVD peuvent être subdivisés en trois groupes distincts.
1) Ceux qui sont peu intelligents, présomptueux, vains et ignorants. Ils sont employés dans les causes de moindre importance. Ils cachent leur ignorance sous de longs procès-verbaux écrits et d’interminables rapports sur les mérites du système soviétique. Ce sont ordinairement des jeunes gens du Komsomol, prompts à passer de la plus douce amabilité à la plus vulgaire flagellation.
2) Les intelligents, d’une grande expérience professionnelle ; habiles surtout à trouver des preuves de culpabilité au moyen de l’indispensable persuasion de la victime, de ses déposition et confession ; plus patients et persévérants dans l’art de la persuasion. Ils cherchent à comprendre l’état d’âme du prévenu et, selon qu’ils le jugent bon, ils appliquent le système des tortures physiques et morales si la persuasion n’a pas réussi. Dans les deux cas, ils sont cruels et sans scrupules. Ils ne reculent pas devant les tortures les plus raffinées. Parmi eux, les femmes se distinguent par une cruauté spéciale.
3) Les exceptionnellement capables, qui sont souvent les anciens du parti. Ils ont fait de sérieuses études philosophiques (dans l’esprit de la dialectique matérialiste). Contrairement aux jeunes élèves des écoles soviétiques, ils connaissent les conditions de vie des pays capitalistes. Ils s’occupent des affaires ayant une importance particulière. Ils évitent d’appliquer la torture et cherchent, par les arguments de la dialectique, à amener le prévenu à se rendre. La caractéristique de ce groupe de juges a été bien définie par Arthur Koestler dans son livre « Darkness at Noon », Paris, octobre 1938 avril 1940.
Nous demandons : l’instruction soviétique atteint-elle son but ? Si nous jugeons d’après l’attitude des inculpés des célèbres procès de Moscou, nous pouvons répondre : oui. Par exemple, dans le procès du « bloc trotskiste de droite », 2-13 mars 1938, tous les prévenus se sont accusés de nombre de délits prémédités et durant les débats juridiques on vit clairement qu’ils tenaient à fournir au tribunal toutes les preuves de leur culpabilité.
L’auto-accusation et la confession (« raskaianie ») ont été complètes. L’accusateur était le procureur en chef de l’URSS Vychinski, le président de la cour était Vassilij Ulrich (qui a joué dernièrement le même rôle dans le procès de 16 personnalités polonaises, en juin 1945). Dix-huit accusés ont confessé des délits prévus dans six paragraphes de l’article 58 du code, trois se sont chargés de 7 paragraphes.
L’instruction soviétique a d’autres tâches encore à remplir, ainsi le groupement des informations de caractère militaire, social et politique (surtout pour les citoyens étrangers) ; on l’achèvement des listes de citoyens déloyaux et comme tels sont considérés tous les amis et parents de l’inculpé (responsabilité collective).
5. PRISON DE L’INSTRUCTION
Le tableau de l’instruction serait incomplet, si on n’y faisait figurer la prison de l’instruction. Au fond, du reste, il n’existe pas d’autres prisons en Russie. La prison a pour but de retenir l’accusé aussi longtemps que dure l’instruction et, bien que la peine « de l’emprisonnement » proprement dit soit admise par le code, elle n’est appliquée que dans des cas exceptionnels. Le châtiment habituel consiste à envoyer le prisonnier, une fois la sentence rendue, dans un camp correctionnel de travail. Et malgré cela, la Russie soviétique est couverte d’un très grand nombre de prisons. Près de chaque poste de ralliement de la milice, il y a une prison provisoire et dans chaque ville un peu grande, il existe une ou plusieurs prisons. En principe, la loi révolutionnaire a supprimé le mot « prison », le remplaçant par d’autres termes (par exemple : DOPR = maison de travail obligatoire), mais de nouveau il a réapparu dans le vocabulaire officiel et, sur les édifices appropriés à cet office, on voit clairement durant la nuit les tablettes lumineuses : « Tiurma NKVD » (prison de l’NKVD).
Il y a en Russie des prisons modèles ; par exemple, la « Loubianka » de Moscou, où le détenu ne peut pas se plaindre du manque de confort ou de la mauvaise nourriture. La « Loubianka » est meublée luxueusement. Les règles rigoureuses (« Pravila dla zaqlucionnikh ») sont observées avec un soin scrupuleux tant par les détenus que par les gardiens de la prison. Toutes les formalités inhérentes à l’arrestation et à l’emprisonnement sont exécutées exactement selon les prescriptions.
Les contraventions aux règles de la prison sont punies par : la séparation dans la cellule de rigueur, pour une période allant de 24 heures à 20 jours, selon le genre de transgression ; une amende, en réparation d’éventuels dommages causés au bien de l’État ; enfin la formule d’une nouvelle accusation, si la faute devient délit par suite de sa gravité.
Le délit le plus fréquent dans une cellule de prison est la propagande antirévolutionnaire (art. 58 § 10). La conception de la propagande hostile est très large dans l’interprétation soviétique. Toute constatation d’une imperfection dans la structure de l’URSS, ou une comparaison entre un pays capitaliste et la Russie soviétique, à l’avantage du premier, constitue un délit. La garde de la prison Loubianka est silencieuse. À part les paroles indispensables « Oui !... Bien !... À droite !... À gauche !... », elle n’entre pas en conversation avec les détenus. Si un détenu est appelé pour un interrogatoire, il est conduit par deux gardes qui lui tiennent les mains par derrière.
Entre les diverses cellules, l’isolement est complet. Le détenu que l’on emmène ne doit voir aucun compagnon des autres cellules. Pendant la promenade quotidienne (d’une demi-heure), les détenus circulent dans des cages entourées de murs très élevés. Le silence absolu qui règne dans cette prison rappelle l’atmosphère d’un couvent et seules les ombres qui passent en glissant d’un judas à l’autre révèlent au novice le vrai but de l’institution.
Dans les autres prisons soviétiques, qui se comptent par milliers, les conditions de vie des détenus sont complètement différentes.
Nonobstant la centralisation du pouvoir exécutif en Russie soviétique, les règles des prisons ne sont pas également obligatoires dans chaque prison, bien que leur texte soit identique. « Les règles pour les détenus » suspendues au mur des cellules des prisons de Kiev, de Vologda, de Vladivostok sont absolument les mêmes qu’à Loubianka. Mais leur interprétation est sujette aux conditions locales comme aussi à l’individualité du directeur de la prison et au bon plaisir de l’administration, qui se permet souvent des abus.
C’est pourquoi il ne faut pas s’étonner si la situation alimentaire était supportable en 1939 dans la prison d’Odessa, tandis qu’à Sverdlovsk, un détenu, ne pouvant résister plus longtemps au tourment d’une faim continue, se tuait en se jetant dans une chaudière de soupe bouillante (voir partie II, chap. IX).
Les prisons de l’instruction occupent les vieux bâtiments des prisons tsaristes, devenus insuffisants dans le nouveau système, d’anciens couvents et églises, et des édifices de l’NKVD construits dans ce but.
Les instruments plus que primitifs, l’insuffisance des égouts et des conduites d’eau, l’humidité, les punaises sont les caractéristiques de ces édifices, entourés de murs, munis de tourelles où des gardes armés font le service.
Les prisons tsaristes sont construites généralement en forme de nef immense, à 4 ou 5 étages, servant de corridor, le long de laquelle sont rangées les cellules. Entre un étage et l’autre, des réseaux de corde ou de fil de fer sont tendus, pour empêcher que les détenus ne se tuent en se jetant des étages supérieurs sur le pavé de pierre de la nef.
Le long des cellules se trouvent de petites galeries de fer unies au centre par de petits escaliers. Les cellules sont fermées par de fortes serrures et des cadenas. À l’intérieur, la règle veut qu’il y ait des petites tables de nuit, dans lesquelles les détenus rangent leurs cuillers et les assiettes de bois ou de terre ; un seau d’eau pour boire et le vase que l’on vide deux fois par jour, quand les détenus vont aux cabinets. Les lits et les chaises, quand il y en a, devraient correspondre au nombre des détenus. La petite fenêtre barricadée, située généralement très haut, est recouverte d’une planche de bois ou de fer ayant une seule ouverture dans la partie supérieure afin de rendre impossible une vue quelconque. Le détenu n’aperçoit qu’une petite ligne du ciel. Dans les cellules destinées aux détenus ayant moins de 16 ans (« maloletki »), les contrevents n’existent pas.
Étant donnée la manière dont les arrestations sont faites, il s’ensuit que la famille de l’accusé ignore souvent où il se trouve. S’il s’agit de détenus politiques, les organes de l’NKVD s’efforcent de mettre les familles dans l’impossibilité de retrouver le parent arrêté. Ils font en sorte de retarder la correspondance et d’envoyer les intéressés d’un bureau à l’autre.
Pendant l’instruction, le détenu reçoit 600 grammes de pain par jour, 20 grammes de sucre et trois repas : le matin, un verre de jus de fruits ; à midi, un demi-litre d’une soupe allongée d’eau et une cuillerée mal mesurée de « kacha » (gruau) ; le soir, un des aliments du dîner, c’est-à-dire la soupe ou le « kacha ».
Le verdict prononcé, le détenu a droit à une augmentation de 100 grammes de pain et de 5 grammes de sucre.
D’après le règlement, le détenu a droit journellement à une promenade d’une demi-heure, quand il n’en est pas privé par le directeur de la prison.
Le directeur peut limiter ou enlever complètement au prisonnier le privilège d’user des jeux, des livres et du magasin de la prison.
Chaque détenu doit prendre un bain tous les dix jours et donner ses vêtements à désinfecter. On lui coupe alors les cheveux et on le rase à la tondeuse. L’usage du rasoir est défendu. Chaque prisonnier devrait avoir sa buanderie et changer de linge tous les dix jours.
Le trait principal des prisons soviétiques est l’étroitesse. Le flot continuel des arrestations remplit les prisons en dépassant leur capacité prévue. Les cellules qui, au temps des tsars, étaient destinées à un seul prisonnier, en contiennent maintenant 20 ou plus. Dans ces conditions, les lits sont exclus. Les détenus dorment étendus à terre, serrés l’un contre l’autre et, si la place manque, une partie d’entre eux restent debout jusqu’à ce que leur tour vienne.
Le règlement des prisons ne mentionne pas l’espace prévu et concédé au détenu. Les réclamations sont vaines.
Au temps de Iejov, les prisons étaient tellement remplies que les détenus étaient debout jour et nuit, et la garde qui accompagnait un nouveau prisonnier était littéralement obligée de le pousser du genou, car non pas la mauvaise volonté des détenus, mais l’absence matérielle de place l’empêchait d’entrer.
Durant les années 1939-1942, la situation était améliorée de manière à permettre, sinon à tous les détenus, dû moins à une partie, de dormir à terre.
Dans ces conditions, ni les bains ni la lessive ne sont assurés régulièrement aux prisonniers ; ils peuvent prendre un bain une fois par mois ou moins encore ; le changement de linge se fait tous les six mois, quand il n’est pas aboli tout à fait. Quant à la promenade, si elle a lieu une fois par semaine, les détenus s’en réjouissent comme des enfants, à la pensée de respirer un peu d’air pur.
L’exiguïté des cellules et l’odeur infecte qui y règne continuellement donnent naissance à des myriades de poux et d’insectes divers. De là, de fréquentes épidémies de typhus ou de dysenterie.
Près de chaque prison il y a un hôpital, presque toujours propre, il faut l’admettre, mais dépourvu des produits pharmaceutiques nécessaires. Les médicaments le plus employés sont l’aspirine et l’iode.
Les rapports entre les détenus et les gardes ne sont pas toujours les mêmes. Indulgents à l’ordinaire pour les prisonniers communs, fermant à demi les yeux sur les bizarreries dénaturées des mineurs, les gardes sont sans pitié envers les « contre-révolutionnaires », c’est-à-dire les détenus politiques ; ils ne leur ménagent pas les insultes et les offenses. Dans les prisons d’instruction, les détenus sont répartis d’après le délit commis. L’isolement des « contre-révolutionnaires » des autres détenus est sévèrement observé par les autorités de la prison.
Il existe dans chaque prison, au service de l’NKVD, le piège tendu des confidents et des provocateurs qui informent exactement l’instruction sur la façon de penser, les opinions et les conversations de leurs compagnons. Ils sont rarement appelés comme témoins lors de l’accusation, mais leurs dépositions deviennent parfois la base d’une nouvelle instruction pour un délit accessoire.
La durée de l’internement dans la prison d’instruction est variable. Elle dépend du genre de procès et des progrès de l’instruction. Pour le délinquant commun, elle ne dépasse pas six mois ; pour le politique, elle va de un à trois ans. Il est des cas où l’instruction se poursuit pendant quatre ans.
La prison d’instruction est un des moyens employés pour briser la résistance du détenu ; si elle ne suffit pas, la cellule de rigueur est appliquée. Cette dernière (« kholodnaia ») est « une prison dans la prison », disent les gardes.
C’est une pièce semblable à une petite cellule pour une personne, située généralement dans le sous-sol de la prison. Les murs ruissellent d’humidité et sont encore plus couverts de punaises que dans les autres cellules. L’urique meuble est un grabat tout nu, fait de planches de bois. L’ouverture de la fenêtre est couverte d’un volet de fer avec des trous pour le passage de l’air. Le jour, c’est l’obscurité presque complète ; la nuit, une lampe électrique très forte est allumée. L’unique aliment du prisonnier consiste en 100 grammes de pain et trois verres d’eau par jour, qu’il doit boire en présence du gardien. Avant d’être enfermé dans la cellule de rigueur, le détenu subit une perquisition en règle, au cours de laquelle on lui enlève son tabac, tous les petits objets qu’il possède et, selon jugement du gardien, les vêtements superflus. On lui laisse seulement, en fait de linge, la chemise, le pantalon et les souliers. La camisole de force est mise à celui qui regimbe.
Cette cellule de rigueur est imposée en punition de contraventions au règlement de la prison ; et, sur la demande du juge d’instruction, comme représailles, pour un refus de confession ou pour d’autres raisons reconnues par l’instruction. Le juge d’instruction ordonne souvent, bien que cela constitue un abus, de réduire à 200 gr. la ration de pain du détenu et de diminuer sa quantité d’eau.
6. LES DÉBATS JURIDIQUES
Le détenu est informé de la fin de l’instruction (art. 26 du code de procédure pénale) au moyen d’un formulaire approprié, qu’il est obligé de signer, et dans lequel sont énumérés les articles du code auxquels il est accusé d’avoir contrevenu.
Dans une procédure normale, le résultat de la fin de l’instruction reproduit l’acte d’accusation qui a été présenté au prévenu quelques jours avant l’ouverture du procès. Une exception est faite pour les cas prévus dans les articles suivants du 4e chapitre du code pénal :
« Art. 466. – L’instruction de causes regardant les organisations et les actes de terrorisme dirigés contre les représentants du pouvoir soviétique (art. 58 § 8 et 58 § 11 du code pénal) doit être portée terme dans une période ne dépassant pas 10 jours.
Art. 467. – L’acte d’accusation est présenté au prévenu 24 heures avant le procès.
Art. 468. – LES CAUSES SONT DISCUTÉES SANS L’INTERVENTION DES PARTIES.
Art. 469. – L’appel après la sentence et le recours en grâce ne sont pas admis.
Art. 470. – La peine de mort est exécutée aussitôt après lecture de la sentence. »
Cette dernière disposition est basée sur une loi émise le 1er décembre 1934, immédiatement après l’assassinat de Sergius Kirov, perpétré ce même jour par un jeune homme du nom de Nikolaïev. Beaucoup de Russes pensent que ce crime fut adroitement combiné par Staline, qui cherchait un prétexte pour se défaire des deux groupes d’opposition dans le Parti : la droite et la gauche. Le fait est que Nikolaïev se tua, à peine eut-il accompli son coup, et que l’on ne sut jamais vraiment qui il était.
La monstruosité de l’article 468 est unique dans l’histoire du droit.
Seuls les législateurs soviétiques savent comment on pourrait l’accorder avec le contenu de l’art. 111 de la constitution soviétique, qui garantit à l’inculpé le droit à la défense.
L’acte d’accusation est dressé par le procureur. On laisse à l’inculpé la possibilité de se défendre en lui donnant un plaidant d’office. Il a le droit de choisir un défenseur privé, mais il faut naturellement que ses moyens le lui permettent.
Le plaidant prend connaissance des actes et obtient, sur demande, la permission de voir l’inculpé.
Des obstacles peuvent surgir aussi à ce sujet car d’après l’article 382 du code de procédure pénale :
« Le tribunal du territoire (oblastnoï) a le droit de ne pas admettre comme plaidant une personne formellement autorisée pour cela, dans le cas où il ne la considère pas propre à la participation dans la cause spécifique en dépendance de l’essence du caractère spécial de la cause. »
La compétence des divers tribunaux dépend du genre de délit et de la nature prévue de la peine. La procédure des tribunaux pour le peuple est relativement brève. Par exemple, en Mai et Juin 1941, beaucoup de procès se sont déroulés devant les tribunaux du peuple pour mauvaises mœurs (art. 74 du code pénal). Ce délit (« khuliganstvo ») se manifestait par une imprécation connue dans toute la Russie et qui offense la dignité de la mère. Depuis le moment de l’arrestation et de la déposition faite par le milicien, jusqu’à la condamnation à une année de réclusion, il ne s’écoulait pas en moyenne plus de 12 heures.
Les délits plus graves, et en particulier ceux qui touchent à la politique, sont jugés, selon la procédure normale, par le tribunal de district 14 (accusation, défense, sentence) et par la Commission spéciale de l’NKVD (Osso), qui rend ses sentences par contumace et par voie administrative. Le choix entre ces deux institutions relève du procureur.
Pratiquement tout dépend de l’issue de l’instruction. Le tribunal de district est uniquement chargé des procès dans lesquels la culpabilité de l’imputé ne laisse aucun doute. Tous les autres sont confiés à l’Osso. Un accusé pour délit politique est en face de ces deux seules solutions : être condamné par le tribunal de district ou par l’Osso. Tertium non datur. Il n’est jamais arrivé qu’un imputé d’« activité contre-révolutionnaire » ait été absous.
Étant donné ces conditions, l’action du plaidant dans un procès politique se réduit à : 1) faciliter les communications de l’accusé avec sa famille, 2) prononcer le discours de la défense, exprimant l’espoir que l’inculpé, bien que grandement coupable au regard de l’État des paysans et des ouvriers, réussira à s’amender, 3) faire appel en cassation contre la sentence, et éventuellement, 4) en cas de condamnation à mort, présenter le recours en grâce.
Tout le relativisme de la jurisprudence soviétique résulte de la maxime de Lénine, écrite en lettres d’or dans la salle du tribunal : « Le tribunal est l’instrument du pouvoir du prolétariat et du paysan travailleur » ; son empreinte se retrouve partout, jusque dans la technique des débats juridiques. Un simple profane, présent à un procès, peut se rendre compte que le tribunal, comme l’instruction, ne cherche pas la vérité mais veut seulement obtenir la confession de la faute. La confession est la preuve absolue du délit. On peut en juger par les célèbres procès de Moscou au cours desquels les inculpés s’accusaient d’actes matériellement impossibles ; ainsi l’accusé David indiquait comme lieu de sa rencontre avec Trotski, en Norvège, un hôtel inexistant ; Natan Lurie dit avoir reçu, en 1932, des instructions de la Gestapo, laquelle n’était pas encore née ; et Berman conspirait, en 1932, avec un émigrant russe mort 7 ans auparavant. Le prof. Ramsin dans des circonstances semblables eut une conversation analogue avec un défunt et Piatakov réalisa un vol de Berlin à Oslo dans un appareil imaginaire. Ces dépositions ne furent jamais discutées par la cour. Les débats traînent parfois durant de longs jours ; de nombreux témoins sont entendus pour l’accusation et la plaidoirie ; le procureur parle, puis le plaidant, mais la voix qui domine est toujours celle de l’accusateur public. « Le tribunal est l’instrument du pouvoir du prolétariat et du paysan travailleur », mais non de la justice.
Les procès les plus retentissants, pour délits importants et indubitables contre l’État (organisations armées contre-révolutionnaires, terreur, actes de sabotage) sont parfois mis en scène publiquement. Ils assument un caractère démonstratif et propagandiste et sont ordinairement organisés par des tribunaux de guerre ou des cours de district et d’appel. La voix du procureur y domine ; son discours qui a généralement un caractère politique et éducatif a pour but d’impressionner l’auditoire plutôt que les juges. Cependant, depuis l’expérience faite aux procès de Moscou, les tribunaux soviétiques cherchent à éviter les débats publics dans les cas où la culpabilité de l’accusé pourrait être mise en doute.
Nous pouvons nous faire une idée de la technique d’un procès propagandiste en observant les célèbres procès de Moscou qui durèrent de janvier 1933 à mars 1933 et en conséquence desquels l’ombre même d’une opposition fut détruite dans le Parti (Zinoviev, Kamenev, Boukharine, Rykov, Radek, Piatakov) et dans l’armée (Toukhatchevski, Iakir, Uborevitch, Kork, Eideman, Feldman, Primakov, Putna). Avant tout il faut se demander quel peut être le but d’un tel procès. Serait-ce seulement, comme l’explique l’art. 9 du code pénal, « d’agir sur d’autres membres hésitants de la société ? ». Et, s’il en est ainsi, en quel sens veut-on agir ?
Épouvanter les désobéissants est et a toujours été une maxime de la juridiction russe. Et c’est ainsi qu’on interprète les termes « agir sur d’autres membres hésitants de la société ». On ne doit pas oublier que si, pendant des siècles, le tribunal fut l’instrument du pouvoir des tsars, il est aujourd’hui l’instrument du pouvoir du prolétariat ou, plus justement, de Staline. Toutefois, le procès propagandiste a encore des buts secondaires. L’un d’eux est de montrer à l’opinion publique à qui il faut s’en prendre pour toutes les misères dont souffre l’URSS. Cette assertion sera peut-être mieux illustrée par un exemple concret pris au procès de Ranek (janvier 1937), durant lequel l’accusé Lifschütz débita tout d’un coup que, en 5 années, de 1932 à 1936, il avait provoqué 10.380 désastres de chemin de fer, c’est-à-dire une moyenne de 5 par jour. Le tribunal accepta cette confession comme preuve de repentir, mais le peuple sut enfin qui était le coupable des sabotages. On compte par centaines les auto-accusations de ce genre. Si elles étaient vraies, elles suffiraient pour détruire le monde entier 15.
Nous avons parlé des deux buts principaux du procès propagandiste. Voici maintenant l’aspect de sa technique.
Un beau jour, paraît dans les journaux un entrefilet insinuant qu’un certain hiérarque est en voie de répandre des idées trotskistes, ou que ses opinions s’éloignent du stalinisme, qui, connue on le sait, est l’unique et vraie expression de la philosophie bolchévique. Le lendemain, la radio et la presse annoncent que le hiérarque a été arrêté ; il est accusé de sabotage et d’espionnage. On donne le nom de ses complices également arrêtés. La presse, la radio, les films, les agitateurs, tous ensemble se mettent à là poursuite des ennemis du peuple et, dans leurs réunions, les ouvriers décident qu’il leur sera infligé les plus sévères punitions. Ce mouvement dure aussi longtemps que l’instruction n’a pas réussi à « préparer » les accusés à la confession publique de leurs fautes devant le tribunal. Alors seulement est publiée la fin des investigations publiques ; et, sous les fenêtres du tribunal, une foule d’ouvriers manifestent d’une façon hostile contre les accusés. Ceux-ci, dès l’ouverture du procès, demandent l’éloignement de leurs plaidants qui se bornent à se mettre au travers de la confession sincère de leurs délits. Le tribunal, après une brève délibération, adhère à la demande des accusés qui peuvent alors manifester leur contrition, ce qu’ils font dans les règles avec le plus grand zèle.
Les procès ont lieu à huis clos lorsqu’on craint que les inculpés ne se montrent pas repentants, comme cela a eu lieu dans le procès de Toukhatchevski et des généraux.
Il arrive parfois que, dans les accusations collectives, la cour de district ou la cour d’appel remette en liberté un des prévenus. S’il s’agit d’un délinquant politique, il retourne en prison et les actes sont passés à l’Osso. Il ne s’est jamais vu que l’Osso ait absous quelqu’un.
Parmi les juges, il y a beaucoup d’officiers de l’NKVD ; ceux-ci ne se donnent même pas la peine de sauver au moins les apparences, ils vont tout droit de l’instruction à la salle du tribunal, où ils arrivent en uniforme.
Quand les débats juridiques et les consultations des juges sont terminés, le verdict est communiqué à l’accusé.
Après la sentence, ce dernier fie retourne pas dans la cellule qu’il occupait auparavant. Il est interné dans la cellule des condamnés où il attend, malgré le recours en cassation, son transfert dans les camps correctionnels de travail.
Le condamné à mort (par fusillement) est enfermé dans la cellule de la mort. Trait caractéristique : si le condamné refuse de recourir en grâce, les autorités de la prison s’efforcent de lui faire faire cette démarche ; s’il persiste dans son refus, la demande est envoyée d’office par le plaidant. L’organe autorisé à accorder la grâce est le Conseil Suprême de l’URSS.
Le prisonnier attend pendant environ trois mois la décision sollicitée. Y a-t-il là une formalité, ou la volonté de briser la dernière et faible résistance du condamné à mort ?...
Bien différente est la manière juridique de procéder – si on peut la qualifier ainsi – dans les procès jugés par l’Osso. L’Osso, comme on l’a dit plus haut, est appelé à juger les détenus politiques dont la culpabilité, au jugement du tribunal du district, peut être considérée comme douteuse, et les prévenus remis en liberté par le tribunal de district (par exemple dans les procès collectifs). L’Osso décide dans les quatre cinquièmes des procès politiques et il a pour but de garantir la société contre les éléments socialement dangereux et socialement nuisibles. Ceci est un grand secours pour les tribunaux soviétiques et, en même temps, un excellent camouflage pour l’activité de l’NKVD, car les verdicts de l’Osso ne sont pas connus du public. La procédure est des plus simples.
L’instruction terminée et l’acte d’accusation rédigé, tous les actes passent à la commission spéciale de l’NKVD à Moscou. Après quelques semaines ou même quelques mois, l’accusé est appelé hors de sa cellule, dans le couloir ou dans le bureau de la prison, où un fonctionnaire de l’NKVD au grade de sous-officier, ou le chancelier civil, lui fait lire cette courte sentence :
« La Commission spéciale de l’NKVD à Moscou dans la séance du... a décidé de condamner X. Y. citoyen... coupable d’agitation contre-révolutionnaire – art. 58 § 10 (ou quelque autre délit) à... ans de camp correctionnel de travail à... »
Et c’est tout. Le détenu apprend que tel jour, à Moscou, a été instruit son procès, dont rien ne lui a été communiqué, pas même le terme.
L’expérience permet de constater que la peine le plus fréquemment appliquée est celle du camp correctionnel de travail. La peine de mort, bien que souvent décrétée par les tribunaux de guerre et les cours d’appel, est rarement appliquée ; elle est généralement commuée, par voie de grâce, en dix ou quinze ans de camp de travail.
Les tribunaux et l’Osso condamnent rarement à la peine de déportation dans les « régions lointaines de la Sibérie ». Mais cela ne veut pas dire que cette peine ne sera pas appliquée. Elle l’est, en effet, d’une manière plus simple. L’NKVD déporte des populations entières en se basant sur des listes d’éléments « socialement dangereux » (« sozialno opasni element ») ; de plus, avant de monter dans le train, ceux qui partent doivent signer une déclaration d’émigration volontaire. De cette manière, ont été déportés des milliers de Juifs de la Russie Blanche et de l’Ukraine, destinés à former une République juive autonome : Birobidjan.
CHAPITRE IV
L’EXÉCUTION DES SENTENCES
1. GENRES DE PEINE
Le terme de « moyen de défense sociale » dérive de l’extension du concept de faute, qui ne se base par sur la transgression d’une règle quelconque, mais sur l’action de toute une catégorie d’individus, nuisibles aux intérêts de l’État prolétaire, dont traite plus largement le chapitre II, 2 de la présente publication.
Dans la conception de la législation soviétique, le crime est le caractère spécifique d’une certaine catégorie de personnes qui, pour cela, rien que par leur existence, deviennent des « personnes socialement dangereuses ». Il est donc nécessaire d’appliquer, vis-à-vis d’elles, des « moyens de défense sociale ».
La définition des peines comme « moyen de défense sociale » dérive, en même temps, du désir de conférer au droit soviétique les apparences d’humanitarisme. L’adjectif «, social » se répète assez souvent dans le code pénal. La législation soviétique ne distingue pas infractions, crimes et transgressions, les nommant généralement « actions socialement dangereuses », quoique, après ces mots, soit placée, entre parenthèses, la définition « délit ».
L’élimination du mot « peine » dans la rédaction primitive du code avait également pour but de souligner le caractère d’éducation et de prévention, et donc humanitaire, des méthodes employées vis-à-vis des délinquants. Toutefois déjà
« dans les décrets du Comité Central Exécutif et du Conseil des Commissaires du Peuple de l’URSS, à partir du décret du 8 mai 1934, complétant la loi sur les délits contre l’État, dans les articles concernant la trahison de la Patrie, au lieu du terme « moyen, de défense sociale » caractère judiciaire-correctionnel, l’on emploie le terme « peine » (nakazanie) ».
Ainsi donc, la peine est un moyen de défense sociale.
Le code pénal soviétique présente quelques genres de moyens de défense sociale ayant un « caractère judiciaire-correctionnel » :
« a) déclaration d’ennemi des travailleurs avec privation du droit de cité de la République Fédérée et en même temps du droit de cité de l’URSS avec l’expulsion obligatoire de ses frontières,
b) privation de la liberté dans les camps correctionnels de travail dans les régions lointaines de l’URSS,
c) privation de liberté dans les lieux communs d’emprisonnement,
d) travaux correctionnels sans privation de liberté,
e) privation des droits politiques et d’autres droits de cité,
f) expulsion des frontières de l’URSS pendant un temps déterminé ;
g) expulsion des frontières de la RFRSS ou d’une localité déterminée soit avec obligation de s’établir dans les autres localités soit sans cette obligation, ou bien avec défense de séjourner dans certaines localités ou sans cette défense ;
h) exonération de l’emploi avec défense d’occuper cet emploi ou un autre ou sans cette défense,
i) défense de poursuivre telle ou telle activité ou bien quelque profession,
j) blâme public,
k) confiscation totale ou partielle des bien,
1) amende pécuniaire,
m) obligation de dédommagement,
n) avertissement ».
Outre cela, le code pénal (art. 20 et 21) prévoit les peines de réclusion et de fusillement, ainsi que nous l’avons déjà mentionné dans le IIe chapitre.
Il faudrait encore mentionner la peine de la « disparition ». Celle-ci n’est pas une peine prévue par le code pénal, il serait même invraisemblable que les « règles spéciales » sur les autorisations de l’NKVD en parlent. C’est une forme de jugement extrajudiciaire. Les personnes gênantes pour le régime et qui jouissent par contre d’une grande popularité parmi le peuple, disparaissent de l’horizon de la vie soviétique silencieusement et sans laisser de trace. Les citoyens de l’URSS se sont déjà habitués à cela. Lorsqu’en 1939 on cessa d’écrire et de parler de Litvinov, quelques Russes, interrogés au sujet des causes de ce silence, faisaient un geste caractéristique qui signifiait, sans équivoque, que ce fonctionnaire avait partagé le sort de la bale de blé emportée par le vent.
D’ailleurs, ce n’est un mystère pour personne qu’on ait « fait disparaître » de manière inconnue l’amiral Orlov, le maréchal Blücher et un certain nombre d’autres personnes.
Parmi toutes les peines, on emploie le plus souvent celle de la privation de la liberté par l’internement dans les camps correctionnels de travail.
Le code pénal soviétique ne prévoit pas la peine de la privation de la liberté pour une période de temps inférieure à un an. D’après l’art. 28 du code pénal, la peine de privation de la liberté est adoptée pour les termes de 1 à 10 ans, tandis que pour les délits de l’art. 58 § 1a, § 6, § 7, § 9, on l’applique jusqu’à 25 ans. La permission de prononcer des sentences de privation de la liberté pour une période de temps inférieure à un an ne fut accordée par le Plenum du Tribunal Suprême de l’URSS que le 4 Mai 1939.
La confiscation des biens, la privation des droits de cité et les peines notées aux points i, j, k et 1, sont appliquées comme peines principales ou accessoires. Par la privation « des autres droits de cité », il faut entendre la privation du droit de recevoir des subsides en cas de chômage, la rente des vieillards et la privation du droit de profiter des fonds de l’assurance sociale.
Telle est l’interprétation qui est donnée dans les observations à l’art. 20 du code pénal soviétique.
L’exécution est le moyen extrême de défense sociale ainsi que la déclaration d’ennemi des travailleurs et l’expulsion du territoire de l’Union Soviétique.
L’expulsion du territoire de l’Union Soviétique a été appliquée une seule fois dans l’histoire de l’URSS comme moyen de défense sociale, après l’expulsion de Trotski, en 1942, lorsque le tribunal soviétique dut accorder l’intérêt politique à l’esprit du droit. Il s’agissait des délégués du Ministère Polonais de la Prévoyance Sociale, qui, en organisant des centres de secours pour les populations polonaises déportées, se lancèrent, dans la persuasion de l’NKVD, dans une activité contre-révolutionnaire, à la suite de laquelle ils furent traduits en prison. Grâce à l’énergique intervention du gouvernement polonais, en ce temps-là encore lié à l’URSS, les délégués furent déclarés ennemis des travailleurs et expulsés des frontières de l’Union Soviétique. Toutefois, il ne s’agit là que d’un procédé isolé. Il est clair que, si on employait aujourd’hui la peine d’expulsion de l’Union Soviétique, elle serait accueillie par 90 % des délinquants non seulement politiques, mais aussi communs, comme le plus haut degré de grâce, plutôt que de peine.
Toutefois, le code pénal protège les frontières soviétiques par les ordonnances les plus sévères et la propagande assure que le complet isolement de l’État du reste du monde capitaliste est une des meilleures garanties de défense du pays. Ce principe est le motif dominant du film très fameux en Russie « Confins fermés au cadenas » (« Graniza na zamkiet »).
Dans les chapitres suivants, nous nous occuperons de plus près du plus haut degré de peine, c’est-à-dire de l’exécution et de la déportation dans les camps correctionnels de travail.
L’article 9 du code pénal stipule que :
« Les moyens de défense sociale ne peuvent pas avoir pour but de causer une souffrance physique ou d’abaisser la dignité humaine, comme ils ne sont pas non plus une œuvre de revanche ou de châtiment. »
Laissant de côté le fait que le moyen de défense sociale est appelé autre part, par le même code pénal, la peine, et que si la même terminologie était toujours employée il s’ensuivrait ce non-sens que « la peine n’a pas pour but la peine », occupons-nous de démontrer que l’article 9 du code pénal, que nous avons déjà cité, n’est qu’un son vide, quoique beau.
2. LA CELLULE DE LA MORT
Occupons-nous tout d’abord du dernier degré de peine, c’est-à-dire de l’exécution. Un prisonnier condamné à mort occupe la « cellule de la mort » : il y reste essentiellement en solitude. Des doubles serrures aux portes, la fenêtre solidement garantie et la garde renforcée, excluent tout rêve d’évasion. Malgré cela, une fois toutes les vingt-quatre heures, une perquisition soignée est faite chez le prisonnier, afin de voir s’il ne se prépare pas à une évasion éventuelle ou bien à un suicide. À peu près toutes les deux minutes, la petite fenêtre du judas est ouverte et la sentinelle promène un regard attentif dans la cellule.
Chaque fois que la porte craque, chaque fois que le prisonnier est emmené dans le couloir, cela peut signifier la mort. Surtout la nuit les nerfs sont exténués. La perquisition a lieu généralement dans la nuit, mais le condamné ne sait jamais si on va l’appeler pour exécuter la sentence de mort.
La réponse au recours en grâce vient de Moscou, généralement pas avant trois mois. La lente agonie psychique du prisonnier dure longtemps. Et s’il n’est pas gracié ? L’exécution a lieu dans les cellules souterraines de la prison. On met dans la bouche du condamné une poire en caoutchouc et on lui tire une balle dans la nuque, de très près. Le bâillonnement fut ensuite introduit, après les exécutions des procès de Moscou, pour ne pas permettre aux condamnés de crier. Les prisonniers soviétiques racontent que Toukhatchevski, au moment de l’exécution, cria : « Vive la Commune ! À bas le tyran ! »
Celui qui écrit ces mots a eu la possibilité de voir deux condamnés tout de suite après la lecture de l’arrêt de grâce.
Ils n’étaient pas à même de dire leurs noms ; leurs jambes et leurs mains tremblaient, ils claquaient des dents comme dans une attaque de malaria. Ils avaient attendu ou l’exécution ou la grâce pendant 95 jours.
3. EXIL
Parmi les « moyens de défense sociale » catalogués dans l’art. 20 du code pénal, nous ne trouvons pas le mot « exil ».
Nous lisons toutefois au point g) de l’« expulsion » et de l’« obligation de s’établir ». Seulement dans les observations, dans les commentaires et dans la liste alphabétique, nous trouvons les paroles « silka » (exil) et « visilka » (déportation). Le législateur soviétique ne réussit donc pas à masquer l’essence de l’exil en le baptisant d’un autre nom, car les commentateurs du code, et même le Tribunal Suprême de l’URSS, retournent à la nomenclature préférée de l’époque tsariste.
Quelle différence existe-t-il entre exil et déportation ? L’exil est l’expulsion des frontières de la RFRSS ou d’une autre localité avec l’obligation de s’établir pour une période de temps allant de 3 à 10 ans en un point fixé par l’NKVD. La déportation est une expulsion du même genre sans que soit toutefois indiqué le lieu où s’établir obligatoirement, et elle peut être appliquée comme peine principale ou accessoire, pour un terme de 1 jusqu’à 5 ans.
Cette différence est tout simplement théorique, tandis qu’en pratique le sort de la personne exilée ou déportée est le même.
Nous emploierons donc dans notre compte rendu sur la peine d’exil ce dernier terme, en sous-entendant la déportation.
La peine de la déportation est un reste du temps des tsars. Le gouvernement soviétique, en conservant ce genre de peine, n’avait pas seulement l’intention de séparer l’élément criminel (ou celui qui ne donnait pas de garanties de loyauté) des milieux vitaux de l’activité politique du pays, mais, en même temps, de coloniser la Sibérie. La déportation est une manière de résoudre le difficile problème de la nationalité. La Sibérie présente maintenant une mosaïque extraordinairement bariolée de nationalités, composée de groupes de déportés, des « nationalistes » ukrainiens, polonais, géorgiens, arméniens, kirghizes, etc. etc. Les Chinois non plus n’y manquent pas, les Coréens, les Japonais, bref une vraie tour de Babel s’y est constituée, qui n’est pas dangereuse pour l’URSS, car l’NKVD maintient et excite, non officiellement, l’antagonisme entre les races et les nationalités, tout à fait d’accord avec la devise – nous semble-t-il non prolétaire – « Divide et impera ». Au point de vue matériel, l’État en tire un double avantage : il se garantit contre l’influence négative des éléments non désirés et en fait usage en même temps dans le cadre de l’économie. En effet, la Sibérie, l’Arctique soviétique et les espaces sans limites de la partie soviétique de l’Asie Centrale recèlent d’énormes richesses naturelles et le peuplement de ces régions est le seul moyen nécessaire pour les exploiter. La seule chose certaine aujourd’hui est que la déportation ne réalise pas en proportion son but économique. Il est démontré, en effet, depuis les temps des tsars (lorsque le sort des déportés était bien plus tolérable), et les bolchéviques s’en rendent bien compte, que l’augmentation naturelle de la population déportée se traduit par un chiffre négatif. Étant donné le changement des conditions de climat et la vie infiniment dure et pénible, il s’ensuit une mortalité bien plus élevée de femmes et d’enfants, facteur décisif pour le bilan négatif de la population politique des régions lointaines de Russie.
Cette circonstance n’influe point dans le sens de la réduction du nombre des personnes déplacées, puisque le premier but de cette méthode est la séparation de celles-ci du reste du monde social au cours de l’application des moyens de défense sociale.
L’NKVD effectue la politique du transfert sur une échelle qui n’a jamais été atteinte au temps des tsars.
Les régions les plus lointaines de la Russie sont peuplées de masses transférées, d’exilés et de déportés. Leurs conditions matérielles sont identiques. En qualité de pionniers de la civilisation russe, ils sont condamnés à se créer au milieu de la forêt (taïga) l’espace pour construire les nouveaux villages, et à tout recommencer avec des instruments de travail primitifs qu’ils se sont procurés eux-mêmes.
Des tailleurs construisent les maisons, des mécaniciens cultivent les champs, et les femmes creusent des conduites d’écoulement. Voila l’aspect que présente l’économie du matériel humain en exil. Ceux qui, après quelques années, sont encore vivants, végètent dans de misérables taudis ou dans de grandes maisons collectives, travaillent dans les kolkhoz organisés par eux-mêmes, ou bien, si c’est en milieu industriel, dans les mines, et lorsque leur génération est exterminée, ils sont remplacés par un nouveau groupe de déportés bien plus heureux que leurs prédécesseurs, du moment qu’ils arrivent quand tout est déjà « prêt ».
L’existence de l’institution du commerce d’échange peut témoigner mieux que toute autre chose des conditions de leur vie. L’argent n’a pas de valeur. Une chemise est échangée avec un sac de pommes de terre, une jupe déchirée avec une mèche de lampes à pétrole. Si, dans le centre de la Russie européenne, à Moscou, on ressent constamment le manque des denrées de première nécessité, si la spéculation, quoique impitoyablement combattue, arrive à des degrés qui n’ont été atteints dans aucun pays capitaliste, figurons-nous quelle peut être la distribution de marchandises dans l’immense Sibérie sans rues. Afin d’éviter des malentendus, il faut faire remarquer que le réseau des chemins de fer soviétique est excellent au point de vue matériel, mais n’est pas suffisant pour servir les 21 millions de km2 de l’URSS. De plus, les régions des déportés sont oubliées et placées en dernier lieu dans le plan de ravitaillement du pays. Une seule chose s’y déroule régulièrement : la propagande. Les moyens de défense sociale ont pour but d’éduquer. Pour cela, soit dans les camps de travail, soit parmi les déportés, la propagande soviétique s’efforce de faire de ces hommes des enthousiastes du régime bolchévique et des croyants en l’évangile de Staline.
La comparaison suivante peut donner une idée de l’échelle sur laquelle est exécutée la politique bolchévique.
Le gouvernement des tsars, en l’espace de 55 ans (1823-1877), déporta en Sibérie 593.000 personnes, le gouvernement bolchévique dans les années 1939-1941, rien que des régions occupées de la Pologne orientale déporta 1.692.000 personnes, dont 990.000 furent destinées à l’exil 16.
Au temps de la construction d’un port sur la Mer Noire, l’NKVD déporta, pour des « raisons stratégiques », 40.000 personnes en l’espace de vingt-quatre heures.
4. TRANSPORTS PAR CHEMIN DE FER
Le « moyen de défense sociale » le plus fréquemment appliqué est le camp correctionnel de travail (« Ispravitielno Troudovoï Laguer »). Avant de parler de l’organisation et des conditions de vie dans les camps, il est nécessaire d’illustrer la technique du transport des condamnés, des prisons aux camps de travail.
Le transport a lieu, généralement, par chemin de fer. Les prisonniers sont emmenés des prisons aux gares de marchandises dans des voitures ou, faute d’un nombre suffisant de celles-ci, ils vont à pied.
Après avoir formé la colonne à pied dans la cour de la prison, le chef du transport (un officier de l’NKVD) avertit les prisonniers par la formule rituelle : « Un pas à droite, un pas à gauche, un pas en avant, un pas en arrière – l’escorte a l’ordre d’employer les armes. » Ce qui signifie qu’il suffit d’un pas imprudent hors des rangs pour que l’escorte emploie les armes. En tout cas, lorsque la colonne à pied s’arrête, les prisonniers sont obligés de s’asseoir par terre, dans la boue, dans la neige ou le sable. Sous peine de recevoir une balle, il est défendu aux prisonniers de rester debout dans ce cas. Outre que par la garde, la colonne est surveillée par des chiens policiers au poil à taches grises (espèce de chiens-loups). Ces moyens de sûreté sont obligatoires dans chaque transport à pied.
La Russie soviétique est peut-être le seul pays au monde qui possède des trains spéciaux pour les prisonniers, employés pour le transport vers les régions lointaines. La « stolypinka » – ainsi est nommé le wagon des prisonniers – provient d’un wagon de passagers ordinaire, aux fenêtres barrées, les vitres transparentes changées en vitres mates, les parois intérieures remplacées par des compartiments spéciaux avec des grilles en métal pour que le garde situé dans l’étroit couloir ait la possibilité de surveiller les prisonniers.
Étant donné que la quantité des « stolypinka » n’est pas suffisante, elles ne sont employées que pour le transport de petits groupes de prisonniers, en attachant des wagons aux trains de passagers ou aux trains de marchandises.
Les moyens communs de transport d’un grand nombre de prisonniers (800-2000) sont des wagons de marchandises fermés, adaptés de façon très primitive au transport des personnes. Deux ou trois rangs de couchettes à différentes hauteurs doivent donner l’illusion qu’il s’agit d’un wagon-lit, et une petite ouverture dans le plancher, dans laquelle un tube en fer est introduit, celle d’un vrai cabinet. Pendant l’hiver, un poêle en fer placé au milieu du wagon aurait dû en assurer le chauffage. Un homme de garde est dans le poste de chaque wagon. Dans un wagon spécial est placé le commandement du transport, à savoir le commandant, officier de l’armée intérieure de l’NKVD, son aide, un sous-officier qui s’occupe de la nourriture, le sanitaire et le restant de l’escorte, avec les chiens spécialement dressés à la poursuite des fugitifs.
Les divers postes de surveillance du convoi sont unis téléphoniquement avec le wagon du commandant et entre eux. Dans les cas où les fils du téléphone sont détachés ou endommagés, ils se servent du fil de la sonnette d’alarme qui passe le long des toits des wagons.
Durant la nuit, la ligne est éclairée par des fusées lancées à peu de minutes les unes des autres et, au cours du passage à travers les bois, à chaque instant.
Pendant les arrêts, les surveillants du convoi tapent avec soin sur les parois des wagons avec des marteaux en bois, afin de s’assurer ainsi que les prisonniers ne cherchent pas à fendre le bois pour s’enfuir.
Pendant tout le temps du transport, les détenus reçoivent près de 500 grammes de pain par jour, un poisson sec ou un hareng et devraient recevoir 23 grammes de sucre. Suivant le règlement, une gamelle chaude devrait être servie aux détenus tous les trois jours, chose qui arrive cependant bien rarement. La personne qui écrit ces pages a fait trois voyages comme prisonnier, voyage de trois, de sept et de dix jours, sans toutefois recevoir, pas même une fois, la gamelle chaude.
La soif est pour les prisonniers le tourment le plus grand.
Le garde donne une fois par jour, pour 40 ou 70 personnes pressées dans un seul wagon, un ou deux seaux d’eau, lesquels disparaissent immédiatement. Au cours des transports pendant l’hiver, les détenus soulagent leur soif en léchant la glace qui se forme sur les attaches en fer du wagon.
Dans ces conditions, on ne peut même pas parler de possibilité de se laver ou de principes d’hygiène.
C’est ainsi qu’a lieu le transport des prisonniers, dans des conditions normales. Au moment de l’« épuration » ou du plus grand flot d’arrestations pour d’autres causes (occupation des régions baltiques, d’une partie de la Pologne, de la Roumanie) le nombre des prisonniers par wagon est doublé et les cas de mort sont fréquents.
Avant d’être mis dans les wagons, les prisonniers ayant été condamnés sont groupés dans des cellules spéciales où ils attendent le transport. Au jour fixé, ils prennent tous un bain et sont soumis à une perquisition très soignée ; après quoi, ils sont emmenés à la gare dans les voitures des prisons 17.
5. PRISONS DE RÉPARTITION
L’étape la plus proche est la prison de répartition, c’est-à-dire le lieu de réunion où se groupe la masse des prisonniers et où précisément est organisé le transport aux différents camps. Plusieurs centres de répartition existent en Russie Soviétique, quelques dizaines environ. Comme nous ne possédons pas de données exactes à ce sujet, nous pouvons seulement affirmer que la prison de répartition de Kharkov avait comme nombre de série le n. 6 (Pérésilnaia Tiurma, n. 6). Ces prisons ont généralement une position centrale par rapport à un certain nombre de prisons et elles reçoivent et renvoient chaque jour quelques milliers de personnes.
Après être descendus à la gare, les prisonniers sont conduits, en voiture ou à pied, toujours sous une forte escorte, aux prisons de répartition. Là ont lieu le bain, la désinfection et la perquisition, après quoi le prisonnier a la possibilité de se retrouver dans une cellule, ou dans le couloir, ou bien dans l’escalier, ou dans les mansardes et même, si là aussi il n’y a plus de place, dans la cour de la prison. L’encombrement dans les prisons de répartition est chose normale ; en outre, il y règne toujours une énorme confusion, les gardes ne sont pas à même de dominer la masse des prisonniers qui se presse de chaque côté ; les malades sont couchés dans les cellules des prisons, l’hôpital étant déjà au complet, et les délinquants mineurs pervertis volent leurs camarades de réclusion.
Déjà au cours du transport au lieu de répartition, le prisonnier politique rencontre des délinquants dénommés « bytovik » (pour abus financiers, pots-de-vin, etc.), et l’élément criminel, ainsi que des voleurs et des bandits. Soit les « bytovik » soit les criminels appartiennent à la catégorie des délinquants communs et les condamnés politiques sont isolés d’eux dans les prisons d’instruction. On fait exception à cette règle seulement en cas de surpopulation de la prison ou par inadvertance.
À partir de la prison de répartition, où la loi de la jungle est en vigueur, le prisonnier se basera constamment sur celle-ci au cours du transport au lointain camp de distribution et même dans le camp de travail.
L’administration des prisons de répartition enregistre dans un dossier la destination des prisonniers et lorsqu’un groupe assez nombreux se réunit, elle organise le transport le plus éloigné. Par conséquent, le séjour d’un prisonnier au lieu de répartition dure parfois quelques heures, parfois quelques mois ; cela dépend du fait si, à ce moment-là, un transport part pour le lieu fixé ou si le groupe des prisonniers en partance est encore trop petit et attend d’autres arrivées.
Un long séjour dans les prisons de répartition dépend souvent des défauts de l’organisation ; on oublie quelqu’un, on perd quelque part ses papiers, ou bien on les remet, par erreur, à un autre transport. En effet, derrière chaque prisonnier voyage un dossier cacheté contenant la relation du procès, le duplicata de la sentence, les caractéristiques du délinquant. Dans ce dossier se trouve la photographie du détenu et sont inscrits les indications personnelles, l’article du code pénal et la condamnation en entier. Ce dossier n’est ouvert que par les autorités du camp de travail. Il peut donc arriver qu’il soit joint par erreur à un autre transport et le prisonnier reste au centre de répartition jusqu’à ce que les autorités aient éclairci l’erreur.
Les prisons de répartition représentent le commencement des véritables tortures réservées au prisonnier. Dormir sur le plancher ou sur l’escalier de pierre, souvent sous la pluie, en plein air (dans la cour), l’air méphitique, la foule, la complète ignorance de la part des autorités des prisons des principes d’hygiène élémentaires, la menace continuelle d’être dépouillés de tout par les effrontés criminels mineurs et la brutale conduite des gardes des prisons, tout cela est en contradiction avec les intentions de l’article 9 du code pénal.
Celui qui tombe gravement malade et trouve place dans un lit d’hôpital peut se dire heureux.
6. CAMPS DE DISTRIBUTION
De la prison de répartition, le prisonnier est emmené par le train au camp de distribution. Les conditions du voyage sont les mêmes que celles que nous venons de décrire. Au cas où le camp de distribution se trouve loin de la ligne de chemin de fer, le transport a lieu par voie fluviale, par mer, en voiture ou bien à pied, mais ces camps sont généralement placés le long du réseau de chemins de fer ou à la fin de celui-ci.
Le camp de distribution, comme les prisons de répartition, est un centre de rassemblement des prisonniers destinés au travail dans les camps d’une région particulière. Les camps de travail sont organisés en Russie Soviétique en des systèmes particuliers qui coïncident souvent avec les limites d’un territoire ou « oblast » (région). Le camp de distribution dessert ainsi un ou plusieurs systèmes.
Les diverses organisations des camps font connaître le nombre de travailleurs dont ils ont besoin et, selon l’afflux, le camp de distribution organise le transport aux divers points des camps ou aux colonnes de travailleurs, il s’agit en somme d’une espèce de commerce d’esclaves. Pour ne pas paraître sans fondement, nous spécifions qu’il arrive souvent que de l’administration des camps viennent des délégations spéciales ayant le but de choisir un contingent de prisonniers suffisamment sains et forts physiquement.
Le camp de distribution remplit donc les fonctions de bourse du travail, en réglant la demande de la main-d’œuvre.
Le nombre des prisonniers dans les camps de distribution est en moyenne de quelques dizaines de milliers. Le camp est divisé en un certain nombre de zones séparées entre elles par des fils de fer barbelés qui entourent aussi toute la superficie du camp. Des guérites en bois sont placées tous les 100 mètres ; les soldats de la Wokhra (« Woiennizirovania Okhrana »), soumise, logiquement, à l’NKVD, y montent la garde.
Toute la superficie du camp est éclairée, pendant la nuit, par de puissants réflecteurs et, de plus, elle est entourée de chiens. Il est défendu de s’approcher des fils barbelés de l’intérieur du camp. L’enceinte est exactement fixée et tout prisonnier qui la dépasse est fusillé sans avis préalable.
Les prisonniers vivent dans des baraques, sous des tentes ou à l’air libre, étant donné la continuelle affluence dans les camps de distribution qui ne permet pas d’abriter tout le monde. Ainsi tant en été qu’en hiver une partie des prisonniers vit en plein air, dormant par terre ou dans la neige autour d’un feu. L’élément des détenus y est déjà tellement mélangé qu’il n’est pas possible de distinguer les condamnés politiques des détenus de droit commun.
Le droit du plus fort règne indiscutablement dans ces camps. Les gardes, en rentrant dans le terrain du camp, s’arment souvent de longs bâtons, avec lesquels ils dispersent les bandes de criminels qui attaquent soudain les détenus les plus tranquilles, toutefois ils cherchent souvent à ne pas faire cas de beaucoup d’incidents.
Dans les camps de distribution, les poux deviennent les camarades inséparables des condamnés et par conséquent les épidémies commencent et la mortalité augmente.
Les prisonniers rêvent de réussir à s’évader le plus tôt possible et de pouvoir rejoindre le camp de travail désigné où l’organisation, la discipline et le contrôle des autorités sur l’élément perfide donnent une certaine garantie de sécurité personnelle et où les conditions de logement sont plus supportables.
7. TRANSPORTS PAR VOIE FLUVIALE
Le prisonnier fait les trajets suivants, selon les circonstances, en chemin de fer (souvent sur des plates-formes ouvertes), dans des autocars, à bord de chalands, de bateaux ou bien à pied. Particulièrement fatigants sont les trajets :
Cotlas – Vorkouta ;
Krasnoïarsk – Dudinka ;
Kharkov – Vladivostok ;
Boukhta Nakobodka – Kolyma.
Kotlas se trouve à la confluence du Vicegda avec la Dvina septentrionale. C’est un gigantesque centre de distribution, qui dessert plusieurs systèmes de camps placés entre la Dvina et les Ourals ; le plus oriental de ceux-ci, situé dans la partie orientale de la Russie, est Vorkoutstroï, avec son centre houiller de Vorkouta. Le trajet de Kotlas à Vorkouta se fait soit par voie terrestre soit le long du fleuve Vicegda, puis en traversant le Petchora le long de l’Oussa jusqu’aux sources, ou bien par voie fluviale par la Dvina jusqu’à Arkhangelsk et de là sur un bateau traversant la Mer de Barents jusqu’au port de Narian Mar, qui se trouve sur l’embouchure du Petchora et en remontant en barque le Petchora et l’Oussa.
En cas de transport par voie terrestre, les prisonniers vont sur les trains de marchandises, dans des wagons fermés ou sur des plates-formes ouvertes par la ligne de chemin de fer récemment construite qui conduit à Vorkouta, terminée dans le mois d’avril de 1943. Avant cette date, par la force des choses, le transport était combiné.
Suivant les progrès dans la construction des étapes du chemin de fer, on arrive toujours à des localités plus lointaines en direction nord-orientale, puis le voyage continue à pied ou par voie fluviale, à bord de chalands. Il faut préciser que le transport des prisonniers a lieu sans égards de saison et par suite les cas de congélation grave, et même mortelle sont assez fréquents. Plus d’une fois une tourmente de neige a recouvert tous les membres d’un groupe de prisonniers, soit plus de 1000 personnes, y compris les surveillants. Suivant le règlement, les autorités des camps devraient fournir aux prisonniers qui dépassent le cercle polaire des vêtements de protection, cependant en pratique ils les font voyager avec les vêtements personnels qu’ils portaient lors de leur arrestation et qui ont déjà été abîmés par le séjour en prison. Ainsi donc la mort blanche est leur camarade fidèle et chaque transport laisse sa trace de cadavres serrés et disséminés çà et là qui ne sont pas ensevelis parce que le long hiver en empêche la décomposition. Au moment du dégel, ils sont transportés jusqu’à la mer par quelque cours d’eau.
La voie fluviale Kotlas-Vorkouta est bien pire que la voie terrestre. Un chaland contient en moyenne 1000-2000 prisonniers, qui sont pressés dans la cale et ne peuvent se rendre sur le pont que pendant le jour pour leurs besoins, si le surveillant le permet. La quantité insuffisante de cabinets cause pour des journées entières des queues de prisonniers qui désirent y aller et attendent dans l’escalier venant de la cale. L’on observe ce phénomène même la nuit, lorsque les plus prudents prennent place dans la queue.
Ceux qui souffrent de l’estomac ou ceux qui ne se soucient guère des règles d’hygiène, satisfont leurs besoins dans la cale, ce qui augmente la puanteur créée par la masse des corps humains non lavés et couverts de sueur. Durant la nuit, des bandes de malfaiteurs dépouillent complètement les camarades plus tranquilles, tuant ceux qui résistent ou commettant sur eux des violences sexuelles... Les surveillants ne réagissent pas aux vols et aux crimes et parfois, pour leur indulgence envers les bandits, ils se font donner une partie du butin.
Pour arriver à croire une chose pareille, il faut se rendre compte du manque énorme de tissus en toile et pour vêtements en URSS, de la valeur d’une chemise même réduite en lambeaux ou d’une paire de chaussures abîmées.
Un prisonnier russe, et surtout un étranger suffisamment vêtu, ne peut pas compter sur la compassion des criminels et des malfaiteurs et pas même sur celle de l’administration des prisons et du camp.
Outre le fléau des voleurs qui suffoquent les prisonniers, la famille, la soif, les maladies et la température infernale de la cale se font sentir aussi dans les chalands.
Il semble paradoxal, mais cela est pourtant bien vrai, que sur les fleuves du nord, sur les eaux de l’Océan Glacial Arctique, les prisonniers meurent dans les chalands et sur les bateaux à cause de la soif et... de la chaleur.
La ligne fluviale Kotlas-Vorkouta, en tenant compte des arrêts aux lieux de débarquement, Arkhangelsk et Narïan-Mar, dure quelques mois. Quelques semaines d’arrêt sur le Petchora s’ajoutent souvent à ce délai au cas où le fleuve est gelé. Dans ce cas, la crainte de mourir de faim, s’il est impossible de prendre contact avec le lieu le plus proche de ravitaillement, oblige les surveillants à réduire aux prisonniers leurs rations déjà tellement maigres. Les délinquants déchaînés arrivent alors au paroxysme, enlevant les vivres à leurs camarades qui meurent de faim. Les cadavres sont jetés dans le fleuve.
Le transport par mer d’Arkhangelsk à Narïan-Mar ne se présente pas mieux : la différence consiste uniquement dans un nombre plus grand de prisonniers. Plus d’une embarcation coule soit par suite d’une tempête, ou pour s’être heurtée contre une banquise.
Le trajet Krasnoïarsk-Doudinka présente le même tableau de l’embarcation et du bateau ; cette fois-ci sur le fleuve Ienisseï ; sa longueur atteint plus de 2000 kilomètres.
Le transport des prisonniers de Kharkov (ou Kiev) à Vladivostok a lieu par chemin de fer dans les conditions que nous avons décrites. Le voyage dure cinq ou six semaines avec des courts arrêts dans les prisons situées le long du chemin de fer (par exemple, Sisran, Novossibirsk, Irkoutsk) ou bien sans intervalles.
Dans le premier cas, le prisonnier s’arrête deux ou trois fois pas plus que trois jours dans les lieux déterminés et reçoit dans les prisons une gamelle chaude ; dans le second cas, si le voyage a lieu sans arrêts, on donne au prisonnier un repas cuisiné une ou deux fois au cours de tout le trajet. Durant les années 1940 et 1941, une série de convois alla de la Russie d’Europe à Vladivostok et les prisonniers ne reçurent pas une seule fois un repas chand ; on ne leur fit même pas prendre un bain et on ne leur désinfecta pas les vêtements.
Boukhta Nakhodka (près de Vladivostok) est, ainsi que Kotlas, un énorme centre de distribution, qui dessert les systèmes des camps situés entre l’Amour, le Kolyma, le Kamtchatka, Sakhalin, dans la région de Iakutsk, de Verkhoïansk, et sur la péninsule de Tchouktchi. Un certain nombre de navires sont réservés au transport des prisonniers et font un service régulier sur les divers trajets maritimes, deux desquels restent particulièrement gravés dans leur mémoire : le trajet Boukhta-Nakhodka – Magadan (au bord de la mer Okhotsk) et Boukhta-Nakhodka – détroit de Béring – Océan Glacial Arctique – péninsule de Tchouktchi ou Nizne Kolimsk.
Après Boukhta Nakhodka, Magadan est le deuxième centre de distribution d’Extrême-Orient et constitue la porte de l’énorme zone des camps de travail placés très serrés dans le bassin du fleuve Kolyma. Étant donné les caractéristiques du climat (Verkhoïansk est la ville la plus froide), on envoie là-bas les délinquants particulièrement dangereux, vis-à-vis desquels l’intention de la justice soviétique équivaut à une sentence de mort. Les détenus font le trajet de Boukhta Nakhodka sur bateaux, traversant la mer du Japon et d’Okhotsk. Au cours du passage du détroit de La Pérouse, des centaines de prisonniers meurent chaque fois, par étouffement. Ce détroit se trouve, en effet, entre la partie septentrionale de Sakhalin (en possession des Japonais) et l’île de Hokkaido ; le service de renseignement Japonais a, de telle sorte, la possibilité de photographier les navires des détenus soviétiques, étant d’ailleurs bien informé au sujet de leur nombre et de leur destination ; par contre les autorités de l’NKVD ont tout intérêt à garder le plus grand secret sur la politique de massacre biologique des « éléments contre-révolutionnaires ». Avant de rentrer dans les eaux du détroit, on ferme donc hermétiquement toutes les issues sur le pont et toutes les fenêtres, cherchant de telle façon à cacher le caractère du transport et à empêcher une fuite éventuelle des prisonniers. En effet, les prisonniers emmenés aux cabinets sur le pont, voyant que le rivage japonais est proche, se jetaient parfois à la mer, où ils étaient consciencieusement repêchés par les bateaux pêcheurs japonais, chose qui n’était absolument pas dans les intentions de l’NKVD. À cause de cela, des mesures de précaution furent prises qui, en vérité, coûtent bien des vies humaines, mais empêchent, en même temps, que des nouvelles défavorables à la Russie Soviétique franchissent les frontières.
Le reste du trajet de Magadan au fleuve Kolyma se fait sur des voitures le long d’un itinéraire de 300-700 kilomètres. Les prisonniers sont entassés sur les plates-formes des autocars et obligés de faire tout le voyage assis. Il ne leur est permis ni de parler ni de bouger. La moindre infraction aux dispositions pénales est immédiatement punie de la peine de mort exécutée par le surveillant. Le sévère « droit du Kolyma », en effet, est déjà en vigueur dans ce territoire ; il admet une réaction immédiate de la part des surveillants, lesquels ne connaissent pas d’autre moyen pour obliger les condamnés à obéir que celui de tirer, et touchent le but. Il est inutile d’ajouter que le voyage dans ce climat et en de telles conditions se termine souvent par de graves congélations et même par la mort. Une fois arrivés au fleuve Kolyma, les détenus sont transportés en chaland, pendant l’été, ou à pied, pendant l’hiver qui, dans ces régions-là, dure neuf mois.
Le transport de Boukhta Nakhodka à la péninsule de Tchouktchi ou au Nizne Kolimsk diffère par la longueur de l’étendue de mer (les bateaux passent, en effet, le détroit de Béring et pénètrent au milieu des glaces de l’Océan Glacial Arctique) et par le manque de route intérieure pour les voitures.
Les prisonniers font à pied et par étapes le voyage des ports à l’intérieur de la région, souvent quelques centaines de kilomètres. Comme d’habitude, le chemin à parcourir est semé de cadavres.
8. CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL DANS LES CAMPS
Le camp correctionnel de travail, suivant les principes de la législation pénale soviétique, a un caractère éducatif. Les moyens d’éducation doivent être le travail et la propagande. Le travail est le devoir sublime de tout citoyen et contient des valeurs qui ennoblissent ; chaque prisonnier donc est aussi obligé de travailler physiquement ou mentalement, d’après, toujours en théorie, ses compétences ou son état de capacité physique.
Chaque détenu, une fois arrivé au camp qui lui a été assigné, est visité par une commission médicale qui a pour but d’établir son degré d’habileté au travail. Officiellement, il existe cinq classes d’habileté au travail (« troud ») :
1. Habile pour n’importe quel travail – « wsiaky troud » ;
2. Habile pour le travail moyen – « sredny troud » ;
3. Habile rien que pour les travaux légers – « lohky troud » ;
4. Invalide du Ier degré ;
5. Invalide du IIe degré.
Des règlements spéciaux déterminent le genre de travail qui doit être assigné aux classes différentes.
Une autre commission examine la capacité professionnelle des prisonniers qui occupaient un emploi dans quelque spécialité.
Mais les résultats des deux visites des commissions, quoique consignés dans les papiers personnels du prisonnier, ne sont pratiquement pas pris en considération et on ne fait aucune différence entre les diverses catégories de travail ; les spécialistes (ingénieurs, docteurs, comptables, etc.) effectuent, avec les autres, les travaux, qu’on appelle « travaux communs 18 ». La mesure d’utilité du prisonnier et le genre de travail sont établis suivant le genre du délit et non pas d’après les décisions des commissions, ce qui est une simple formalité. Aucune fonction dans l’administration des camps n’est généralement confiée aux prisonniers politiques. Toutes les fonctions, d’ailleurs, – sauf celle de la direction – appartiennent aux prisonniers, à savoir aux criminels de métier.
Seul le fait d’appartenir aux catégories des invalides a une signification particulière, l’invalide du Ier degré devant travailler seulement à l’intérieur du camp (dans la « zone »), tandis que celui du IIe degré peut ne pas travailler.
Cette disposition à ne pas respecter les règlements et la grande différence entre la théorie et la pratique que l’on voit à chaque instant dans la vie du camp de travail proviennent :
a) de l’atmosphère particulière de la vie soviétique dont le principe « tout l’État socialiste des ouvriers et des paysans » annule le droit et le respect pour l’individu et sert, en même temps, de prétexte à des abus universels ;
b) des exigences des plans économiques soviétiques, dont l’exécution, sans égard pour le choix des moyens, a le rôle principal.
Les autorités des camps, pour chaque degré de l’organisation, ont un plan établi à achever si elles veulent éviter le sort des prisonniers dont elles disposent. Étant donné que le plan dépasse leurs possibilités, elles ont adopté le système universellement toléré d’épuiser les forces des ouvriers au maximum sans égards pour les conséquences d’assassinat du matériel humain, sans égards pour les pertes.
Les « règles » dérivent du plan économique ; pour exécuter ce plan excessif, il est nécessaire d’établir une règle de travail soit pour un seul détenu soit pour une brigade ou un « lagpounkt 19 » (colonne de travailleurs) afin de garantir non seulement l’exécution du plan, mais aussi une certaine marge.
Personne ne se préoccupe du fait que ces règles sont au-dessus des forces et des possibilités humaines ni que l’organisme d’un homme a une provision d’énergie limitée, et que cette mesure de travail le tue.
Tant la presse soviétique que toute la propagande visent à l’exécution du plan économique dans le cadre de l’État. Les directeurs des fabriques et des entreprises de l’État décident, par l’intermédiaire des unions professionnelles des travailleurs, d’accepter l’obligation d’exécuter le plan avec une marge (« perewipolnienie »). La même chose arrive dans les camps de travail. Le système de voter ces décisions importantes a été établi pour qu’après le délai fixé on puisse aisément justifier la promesse non tenue. Mais seul le directeur ou l’entrepreneur qui fait travailler des hommes libres (« volnonaiomnie ») peut faire de justifications pareilles et non pas certainement le chef d’un camp de travail de prisonniers où le plan établi doit être exécuté.
Lorsque, malgré l’assassinat du matériel humain, le plan n’est pas exécuté, l’on falsifie les rapports pour éviter les responsabilités pénales du sabotage (art. 58, § 14, code pénal).
Le chef du camp n’emploie ce moyen que lorsque la mortalité parmi les prisonniers atteint des proportions telles, qu’il pourrait, à son tour, être soupçonné de « conscient sabotage contre-révolutionnaire ». Sa situation est particulièrement difficile : il se trouve continuellement, comme d’ailleurs tout citoyen soviétique, entre l’enclume et le marteau ; il reste à la surface aussi longtemps qu’il réussit à manœuvrer sa barque. La commission de Moscou vient rarement. On peut toujours connaître l’époque de cette arrivée par des amis fidèles qui travaillent à de plus hauts degrés de l’organisation, et on peut organiser la vie du camp pour cette période, de façon à satisfaire les exigences des fonctionnaires, qui ne remarquent pas ou ne veulent pas remarquer bien des choses.
Le poids de l’exécution du plan retombe, ainsi, sur les prisonniers. Le matériel humain est largement gaspillé en URSS et avec prodigalité dans les camps de travail. Les règles de travail sont strictement établies ; les tableaux enregistrent particulièrement la moindre activité et sont continuellement changés au désavantage des travailleurs, s’élevant à des limites irréalisables dans la mesure-record des exploits des « stakhanovistes ». Ces limites (record) sont fixées artificiellement. Les volontaires forts physiquement et dans les conditions préparées au préalable par les autorités du camp (instruments meilleurs, matériel plus facile à forger, aides convenablement choisis), atteignent, en un seul jour, les normes du travail prescrites pour plusieurs jours, ce qui crée un motif pour les augmenter à tout le monde, obligatoirement.
Pour obliger les prisonniers au travail, on conditionne la quantité et la qualité de la nourriture au pourcentage de travail exécuté d’après les règles établies.
La nourriture n’est pas la même dans les différents camps. Elle dépend des conditions de temps et de lieu ; dans le passé, elle était parfois terriblement mauvaise et des centaines d’hommes mouraient d’inanition.
En 1938-39, une amélioration eut lieu. Les détenus qui étaient dans les camps en ce temps-là racontent qu’à cette époque personne n’y mourait de faim. Même ceux qui avaient des rations alimentaires pénales végétaient en se nourrissant de ce qui tombait de la table des « stakhanovistes ». Mais, déjà en 1940, un empirement rapidement aggravé se vérifia et, en 1941, le fait de mourir de faim ou, plus exactement, de mourir à cause de la continuelle inanition et à cause de la pellagre, était devenu un phénomène de tous les jours.
Un principe de politique pénale alimentaire consiste à garder les personnes dans une demi-inanition, tout en leur faisant espérer une amélioration quelconque de la nourriture et, de cette manière, on pousse l’ouvrier à un effort toujours plus grand.
La faim est, dans ce cas-là, un moyen très convaincant.
Le paragraphe 1 de la disposition en date 27.V.1937 au su jet de l’approvisionnement du camp correctionnel de travail de l’NKVD de Ukhto-Petchora déclare que :
« la tâche de l’administration économique alimentaire est la suivante :
a) assurer aux prisonniers l’alimentation normale ;
b) donner aux prisonniers l’impulsion pour l’amélioration du travail et contribuer à l’augmentation de la productivité.
D’accord avec cette tâche, l’alimentation des prisonniers du camp s’organise de façon que les groupes suivants de prisonniers aient le droit indiscuté d’obtenir une alimentation de meilleure qualité et en plus grande quantité :
a) les travailleurs « stakhanovistes » et les « oudarnik »,
b) ceux qui s’appliquent aux travaux physiques lourds,
c) les travailleurs spécialisés. »
Les règles d’alimentation mensuelle de l’« Ukhto-Petchora » et les paragraphes suivants de la disposition en question peuvent toutefois nous convaincre que la gradation de la quantité et de la qualité de l’alimentation est bien différente. Les travailleurs « stakhanovistes », les « oudarnik » et « ceux qui s’appliquent aux travaux physiques lourds » reçoivent une nourriture plus mauvaise que celle du personnel administratif.
« Le personnel administratif-technique qui remplit honnêtement les obligations imposées est nourri selon les règles spéciales de la cuisine technique » (§ 14).
Le nombre des personnes nourries de cette manière atteint 10 % du nombre total des prisonniers.
« Le personnel ingénieur technique et administratif-économique particulièrement spécialisé qui observe continuellement une attitude volontaire et productive dans les tâches imposées reçoit, comme encouragement, l’alimentation selon les règles ITP et ATP. »
Le tableau de l’alimentation des différentes catégories de prisonniers et de travailleurs de l’administration établit comme suit le prix de la nourriture :

Le lecteur se demandera certainement ce que font les enfants dans le camp de travail. La réponse se trouve dans le paragraphe 31 de la disposition en question :
« Les nouveaux nés et les enfants jusqu’à l’âge de 13 ans inclusivement, fils de prisonniers, demeurant dans le camp, et ceux aussi qui sont arrivés au camp à la suite d’une permission du chef de l’administration (du système des camps) auprès des parents emprisonnés... »
et dans le par. 35, par lequel nous apprenons officiellement que, dans les camps de travail soviétiques se trouvent, en qualité de prisonniers, des enfants à partir de l’âge de 14 ans.
« Les enfants de 14 à 17 ans inclusivement se trouvant dans le camp comme prisonniers (zakloutchonni) ou demeurant chez les parents emprisonnés... »
La disposition de l’approvisionnement des prisonniers est conçue d’une manière particulière. Parmi plusieurs tableaux, nous en trouvons un qui est très intéressant au sujet des règles d’alimentation des chiens policiers.
Après avoir fait une comparaison entre ce tableau et celui de l’alimentation des prisonniers, nous nous apercevons qu’un chien policier reçoit 400 gr. de viande par jour, tandis qu’un prisonnier qui est nourri d’après la IVe ration (très bonne pour les travailleurs physiques) en reçoit 890 gr. par mois, à savoir un peu moins de 30 gr. par jour ; au contraire, un prisonnier nourri d’après la Ire ration en reçoit 21 gr. par jour.
Une observation au tableau de l’alimentation des chiens policiers établit que la pâtée d’avoine peut être remplacée par une pâtée de maïs ou de mil et, suivant la santé du tout jeune chien, par du riz ou du gruau. Les observations aux règles d’alimentation des enfants ne présentent point un traitement pareil.
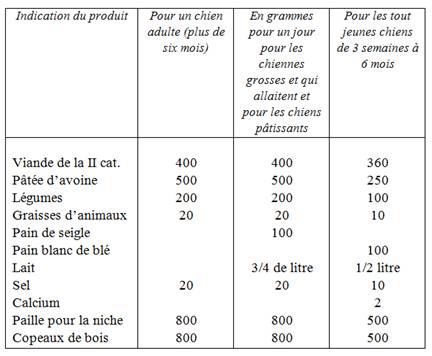
Tous les tableaux indiqués de l’alimentation ne prévoient pas une circonstance très importante c’est-à-dire le vol. Avant que les produits alimentaires destinés aux prisonniers ne leur parviennent, ils sont parfois soumis à des réductions. Dans la base centrale d’approvisionnement du système du camp, l’administration vole de 4 à 5 % ; dans celle de distribution 7-8 % ; et le long du chemin de cette dernière jusqu’au point du camp de travail, le charretier vole 2-3 % des produits alimentaires.
Un ex-prisonnier soviétique, auquel nous devons la possibilité de connaître le texte original de « la disposition de l’approvisionnement », a fait la remarque suivante à la première page :
« Non seulement les hommes, mais aussi les animaux étaient grandement dérobés de leur ration, en recevant au maximum 40-50 % des quantités qui leur étaient dues en avoine et en son. On les nourrissait avec des rameaux de bouleau coupés au moment de leur feuillage le plus abondant. »
Nous ne devons donc point nous étonner que la famine règne dans les camps de travail.
Au point de vue pratique, l’augmentation de force dérivant d’une ration alimentaire meilleure n’égale pas l’augmentation de l’effort, et le bilan des calories consommées en travaillant se conclut toujours par un total supérieur à la valeur du repas en calories. Ceci conduit par conséquent à un affaiblissement de l’organisme et finalement à un épuisement complet. Les détenus les plus raisonnables ne s’efforcent donc pas d’améliorer la nourriture à un prix tellement cher et, s’ils ne peuvent atteindre une amélioration dans les conditions de vie par quelque protection ou subterfuge, ils ne travaillent que le nécessaire pour ne pas être accusés de sabotage. Dans ce cas, ils partent du principe légitime que, indépendamment du fait d’être ou ne pas être des « stakhanovistes », un sort unique leur est réservé : un lent dépérissement.
Les prisonniers qui s’abstiennent de travailler (« otkaz ») sont punis de la cellule de rigueur. Un refus systématique de travailler entraîne la condamnation pour sabotage et la peine de mort.
Dans ces conditions, les prisonniers arrivent rapidement à un état de complet épuisement physique. Outre la famine, ils sont sujets aux maladies septentrionales (scorbut 20, aveuglement partiel 21) causées par le manque de vitamines et par la rigueur du climat (froid).
Les prisonniers sont généralement persuadés qu’ils ne peuvent supporter la vie dans le camp qu’en arrivant à obtenir une place quelconque à l’intérieur de la « zone », où, par un « blat 22 » bien organisé, les conditions de vie sont supportables.
Les autres, par contre, finissent presque toujours de la même façon : faute de nourriture, ils meurent, ce qui arrive tôt ou tard selon la constitution du prisonnier et selon la réserve de forces qu’il avait à son arrivée dans le camp. Lorsque l’épuisement est déjà tellement avancé que le prisonnier n’a plus la force de se rendre au travail (on travaille généralement à quelques kilomètres du camp et il faut s’y rendre à pied), il lui est tout à fait indifférent d’être envoyé ou non dans la cellule de rigueur 23. Son rêve est celui d’être couché tranquillement dans un coin chaud de la couchette, si possible en sentant peu à peu ses forces diminuer lentement et la vie s’éteindre.
Une personne dans ces conditions s’appelle dans le langage des camps de travail « dokhodiaga » (celui qui arrive à la fin) d’après le verbe « dokhodith » (arriver).
La question des vêtements a une importance particulière dans le nord.
Le par. 96 de la disposition d’approvisionnement des prisonniers dit :
« Aux prisonniers qui arrivent dans le camp, on distribue des vêtements seulement en cas de nécessité extrême, car ils doivent user au maximum les habits personnels encore passables (godnie), avec lesquels ils sont arrivés au camp même.
Le manque de vêtements pour le camp ne peut représenter en aucun cas un obstacle pour emmener le prisonnier au travail, s’il possède des habits personnels. »
En cas de manque d’habits personnels, le prisonnier reçoit pour l’hiver une casaque et des pantalons ouatés, qui protègent généralement du froid. Par contre, la question des chaussures et des gants est terrible. Les gants en toile ou en tissu ne protègent pas du froid et les chaussures en cuir n’existent point dans les camps, ou du moins les prisonniers n’en ont pas. Seuls les membres de l’NKVD et le personnel dirigeant portent des chaussures en peau de porc qui laissent passer l’humidité et des « watonki », de hautes bottes faites d’un mélange de laine ou de poils de mouton, chèvre ou cheval.
Les prisonniers reçoivent des « tchetczety », c’est-à-dire de grossiers sabots en caoutchouc faits avec des housses de vieilles voitures, qui estropient les jambes et ne tiennent nullement chaud, ou bien des « iapti », sorte de chaussures en écorce de tilleul. La manière normale de se protéger du froid est constituée par les chiffons dont les prisonniers s’enveloppent les jambes, mais qui se mouillent, naturellement, à cause des croûtes de glace qui se forment dessus ; en conséquence, beaucoup de prisonniers doivent subir des amputations pour congélation des doigts ou bien pour gangrène des jambes.
L’habitation dépend du degré de « colonisation » du lieu où les prisonniers travaillent ; ils sont généralement logés dans des baraques en bois ou sous des tentes insuffisamment réchauffées en hiver (c’est un paradoxe, du moment que tout autour il n’y a que des forêts) et parfois ceux qui travaillent à des tronçons en construction de chemin de fer ou de routes, bivouaquent à l’air libre ou sous les tentes.
La façon d’installer les nouveaux camps est très primitive ; un groupe de prisonniers est emmené à l’intérieur de la forêt et au début on place tout simplement une enseigne avec le nom et le numéro du camp. « Construisez votre vie » est l’ordre du chef de l’escorte, et les prisonniers abattent les arbres pour les édifices, construisent des baraques, dormant la nuit à l’air libre près des feux ou, en des cas plus heureux, sous les tentes.
Le sort des colonnes mobiles des travailleurs est particulièrement dur. La vie, toujours nomade, empêche l’organisation du camp, le transport des provisions laisse à désirer, la cuisine mobile n’a souvent pas la possibilité de servir la gamelle chaude, le prisonnier est privé d’une habitation réchauffée lorsqu’il peut se reposer après la fatigue exténuante de la journée. Dans ces conditions, on ne peut rêver d’installations hygiéniques ou de n’importe quelle prophylaxie sanitaire.
Les prisonniers qui dorment près du feu sont facilement sujets aux inflammations pulmonaires à la suite d’échauffements irréguliers du corps (d’un côté le feu, de l’autre côté le vent glané) et l’organisme affaibli n’est pas à même de se défendre contre cette maladie. Pendant l’hiver 1941-42 les inflammations pulmonaires ont causé 90 % des cas de mort.
Durant l’été, les prisonniers sont tourmentés (outre le scorbut la pellagre) par l’hémocolite par suite d’affaiblissement, et par ces maladies d’estomac causées par des champignons vénéneux et des graines de bois qu’ils mangent avec avidité, au cours du travail, sans avoir la possibilité de les trier.
Les soins médicaux aux prisonniers sont établis par le « sautchast », un commandement sanitaire qui a ses détachements dans presque tous les camps. L’organisation du service sanitaire dans les camps de travail est bien organisée, mais comme les nécessités des prisonniers et toute la vie du camp doivent être subordonnées à l’accomplissement du plan économique, les autorités de l’NKVD limitent la compétence du médecin et relèguent à la deuxième ou à la dernière place les approvisionnements des moyens thérapeutiques de l’hôpital. Les médecins sont, dans la plupart des cas, des prisonniers, qui s’efforcent en général de maintenir les bonnes traditions des médecins des prisons et des pénitenciers du temps des tsars, ce qui toutefois ne leur est pas toujours consenti. Le remède thérapeutique capital est, ainsi que dans les prisons, l’aspirine et la teinture d’iode, outre la possibilité de loger les malades à l’hôpital où ils seront du moins au chaud et relativement propres.
En pratique, un prisonnier, pour qu’il puisse se rendre à l’hôpital, doit être gravement malade au point de ne pas pouvoir bouger et, même dans, ce cas, il doit souvent rester dans les baraques en bois, l’hôpital étant, en général, toujours surpeuplé.
Les chefs du camp limitent à leur gré le contingent journalier des malades, fixant un pourcentage de malades pouvant être exemptés du travail, ou bien ils transmettent au médecin l’ordonnance suivant laquelle le prisonnier doit être considéré malade seulement s’il a 38 degrés de température et, dans quelques camps, même 38,5. Les médecins qui ne s’adaptent pas à ce règlement sont sévèrement traités ou envoyés dans la cellule de rigueur ou bien temporairement privés de leur place et destinés aux travaux communs.
Nous avons déjà dit que le but théorique des camps de travail est l’éducation des prisonniers par le travail et la propagande.
Le travail est obligatoire pour tout le monde, mais seuls les élus peuvent jouir des bienfaits de la propagande. Une distinction nette est faite dans ce domaine entre les délinquants communs et les condamnés politiques. Les conversations de propagande tenues dans les camps de travail seulement pour les délinquants communs peuvent démontrer que les autorités soviétiques ne croient pas en la possibilité de corriger les condamnés politiques, les considérant à priori comme des individus perdus pour l’État, qui ont, tout au plus, le droit de mourir dans les camps. En effet, il ne se vérifie jamais qu’un « kontrik » – expression qui définit les condamnés politiques – retourne à la liberté, une fois sa peine subie. La veille de sa libération, il reçoit la communication que l’Osso a pris une décision nouvelle, à la suite de laquelle il doit rester encore 5 ou 8 ans dans le camp. Par conséquent, toute la conduite envers les « contre-révolutionnaires », le système de persécution et la limitation des droits garantissent, en général, de manière suffisante la mort du prisonnier avant la fin de la première période de châtiment, et seuls des individus doués d’une force extraordinaire peuvent compter sur la satisfaction particulière de vivre jusqu’à entendre la sentence nouvelle.
La propagande dans les camps de travail est confiée à la KVC (« Koultourno-Vospitatielnaia Tchasth ») – bureau cultural éducatif. Le travail de la KVC peut être subdivisé dans les spécialités suivantes :
1) agitation pour pousser à un plus grand effort ouvrier ;
2) activités éducatives et de propagande envers les délinquants communs ;
3) organisation de spectacles de théâtre et d’amusements.
Chaque camp de travail est rempli d’énormes affiches de propagande reproduisant des paroles et des précieuses pensées de Marx, Engels, Lénine, Staline. Ces affiches poussent à une plus grande contribution au travail, à la « rivalité socialiste », au développement du mouvement « stakhanoviste », et ainsi de suite, et parlent du bonheur et de la liberté du citoyen soviétique (même en de tels lieux). Sur des ardoises énormes, on note le pourcentage de travail obligatoire exécuté par les différentes brigades et par les « stakhanovistes ». Dans le journal du camp, le prisonnier a la possibilité de lire les noms de tous ceux qui se sont abstenus du travail ou de prendre vision des conditions épouvantables de vie et d’exploitation des travailleurs anglais et américains de la part des capitalistes. Cette activité de propagande est accessible à tout le monde.
L’éducation des délinquants communs consiste à leur expliquer le caractère distinctif de leur délit, que la KVC s’efforce de présenter comme un débandement momentané par rapport à l’activité « contre-révolutionnaire » des délinquants politiques.
De la même façon, elle dépeint d’une manière démagogique le tableau des crimes monstrueux des « kontrik 24 » et pousse l’élément grossier des criminels contre ce groupe de prisonniers. La KVC, qui est entièrement au service du « secteur secret » de l’NKVD, recrute, parmi les délinquants communs, une bande de mouchards, auxquels elle promet des conditions de vie meilleure et une atténuation de la peine.
Étant donné, du point de vue de l’NKVD, que le citoyen est loyal et bon membre de la société lorsqu’il sait adorer Staline, est aveugle vis-à-vis des défauts du régime et, chose la plus importante, est un délateur, il arrive, quoique très rarement, qu’un délinquant commun sorte du camp de travail bien avant la fin de la peine et devienne un citoyen soviétique de « valeur complète », ayant reçu désormais une éducation qui lui garantit d’avoir acquis les vertus que nous avons citées.
Quant à la dernière activité de la KVC, elle reste au plus bas niveau, comme l’on peut bien imaginer. Les spectacles de théâtre consistent en des représentations vulgaires composées par des propagandistes ignorants. Si la représentation est donnée dans le « club », qui, à cause de l’affluence est habité par les prisonniers, le seul bénéfice qu’un délinquant peut obtenir de cette entreprise est une part des vêtements volés dans l’obscurité à ses compagnons d’esclavage. Outre cela, la KVC organise des fêtes dansantes, les jours libres du travail (tous les dix jours et, depuis 1941, une par mois), auxquelles prennent part les criminels de profession avec leurs amies, une certaine quantité de femmes se trouvant dans chaque camp : la vie sexuelle, quoique défendue, est répandue sous une forme dégénérée. Les femmes deviennent maîtresses de voleurs et de bandits, occupant une place avantageuse dans l’administration du camp, qui leur assure une vie meilleure matériellement par l’aide du tout-puissant « blat ».
Le tableau de la vie dans un camp serait incomplet si on négligeait la part des « ourki », terme qui comprend les voleurs et les bandits entraînés au délit dès leur enfance ; ces mêmes éléments, mais parmi les femmes, qui se livrent en outre à la prostitution, se nomment « chalman ».
Les « ourki » sont le châtiment de chaque prison, de chaque camp ; nous les avons déjà mentionnés en décrivant le transport aux divers centres de distribution. Bien que dans les camps de travail ils soient encadrés dans des brigades « pénales » de travailleurs spéciales, ils jouissent à l’intérieur de la zone d’une certaine liberté, volant et dépouillant les prisonniers les plus tranquilles (les détenus politiques).
Toute l’administration du camp est dans leurs mains, à commencer par le chef de la troupe des ouvriers (« brygadir »), des fonctions administratives jusqu’à celles de remplacement du commandant du camp. Convenablement éduqués par la KVC, à laquelle ils doivent les meilleures places, ils terrorisent les autres prisonniers, ils s’attaquent aux détenus politiques, arrivant jusqu’aux pires excès. Celui qui n’adhère pas à la chaîne du « blat », ne réussit pas à gagner les bonnes grâces des « ourki » et pourrait en vain demander justice aux autorités du camp. Cette tâche seule des « ourki » convient à l’NKVD car ils constituent toujours un « memento » inquiétant pour la masse des nombreux millions de « contre-révolutionnaires », lesquels, en cas de révolte, pourraient être anéantis par eux sans le moindre scrupule.
Les « ourki » sont donc, dans les camps, la « longa manus » de l’NKVD. Ce qui prouve l’étrange paradoxe que des assassins sont chargés de défendre la justice soviétique.
CHAPITRE V
URSS – PRISON DES PEUPLES
1. C’EST SEULEMENT UNE DIFFÉRENCE DE TERMES
Les paroles de Lénine : « La Russie est une prison des peuples » n’ont rien perdu de leur actualité après un quart de siècle de domination des « conseils des ouvriers et paysans ».
Tandis qu’elle élargissait son empire, la Russie tsariste rencontra la résistance des peuples qui se trouvaient sur la ligne de son expansion ; cette résistance fut éliminée par les armées russes et l’administration tsariste gouverna ainsi ces territoires. Elle maintint les peuples vaincus dans un état certain de soumission par l’application de méthodes sûres d’emprisonnement et de déportation.
En parlant d’une « prison des peuples », Lénine avait en vue l’oppression des minorités ethniques par l’empire russe, oppression qui se manifestait précisément en ces emprisonnements et déportations.
Si, aujourd’hui, nous pouvons trouver une différence, c’est peut-être dans le degré de terreur et dans le développement des systèmes pénitentiaires à l’ombre de la lutte de classe. Si le régime tsariste n’avait aucun égard pour les dizaines de milliers d’adversaires politiques qui menaçaient l’autocratie, le régime de Staline en anéantit des millions.
Et ceci n’est pas une affirmation de rhétorique. Par adversaires politiques on entend, non seulement les adversaires du régime social, mais aussi les représentants des diverses nationalités opposées à la domination de la Russie. En traitant de la peine de la déportation (ch. IV, 3), nous avons indiqué le système qui résout le problème des nationalités dans l’URSS. Dans la seconde partie de la présente publication (ch. IV, 5), le lecteur trouvera une énumération partielle des diverses nationalités auxquelles appartenaient ceux qui se trouvent en prison et, dans le ch. IX, 6, celle des populations qui sont dans les « camps correctionnels de travail ». Le contenu de ces chapitres pourra donner un tableau assez clair de la « fraternité des peuples », tant vantée par la propagande soviétique.
Il nous est difficile d’établir un rapport proportionnel du nombre de prisonniers appartenant aux divers groupes ethniques. La chose serait certainement possible en étudiant attentivement les données sur la base des documents qui se trouvent entre nos mains, mais elle demanderait trop de temps. Nous nous limiterons donc à une évaluation globale du nombre des prisonniers, nous basant sur la connaissance de l’organisation du système soviétique des camps de travail, en précisant que les chiffres que nous allons donner ne comprennent pas les déportés dans les « régions extrêmes de la Sibérie », mais seulement ceux qui se trouvent dans les prisons ou les « camps correctionnels de travail ».
Nous venons de rappeler que le régime soviétique anéantit par milliers les adversaires politiques. Une simple confrontation des différents chiffres suffira à persuader le lecteur que nous n’avons nullement exagéré, confrontation qui pourra être faite plus loin dans le texte.
La Russie est restée fidèle à ses traditions. Cette observation fut faite déjà en 1920 par Joseph Conrad, qui, à ce sujet, écrit dans la préface de son ouvrage « Dans les yeux de l’Orient » :
« Ces perturbateurs ne sont pas capables de s’apercevoir que l’unique résultat qu’ils puissent obtenir est de changer les noms. Les oppresseurs et les oppressés, ce sont les Russes ; le monde se trouve une fois de plus en face de cette vérité, qu’un tigre ne peut changer ses striures ni un léopard ses taches. »
N. Jewreinow, marxiste russe, dans son grand travail intitulé : « Punitions corporelles dans l’application de la justice et dans l’administration russes » affirme :
« Le Russe est trop conservateur pour se défaire d’un seul coup d’un résidu spirituel enraciné depuis longtemps et pour la seule raison que l’opinion politique a changé de route dans l’évaluation des peines. »
Aussitôt après la révolution, le gouvernement soviétique déplora solennellement la méthode tsariste d’emprisonnement. Les chaînes furent abolies et, au lieu des prisons, on institua les maisons de correction ; mais l’idylle ne dura pas longtemps. Un attentat contre Lénine suffit pour qu’à la « terreur blanche » succédât une « terreur rouge » sur une échelle multiple. La Tcheka, la GPU et enfin l’NKVD se développèrent d’une manière absurde et quand les divers ennemis de la révolution, complètement détruits après dix années de vie de l’Union Soviétique, vinrent à disparaître, la lourde machine bureaucratique du « samodierjavie » de Staline prit dans ses engrenages de prétendus ennemis, de la « gauche » et de la « droite », personnes sincèrement enthousiastes du régime communiste, dont l’unique crime consistait dans le fait qu’ils pouvaient s’apercevoir de la perversité des idées pour lesquelles ils souffraient.
La psychose de l’« encerclement capitaliste », la crainte continuelle d’une croisade armée de la « bourgeoisie » contre l’URSS, la manie de la persécution par l’espionnage, la rapide reconstruction du système social et la résistance passive que lui opposèrent les « moujik » (paysans) russes tout dévoués à leur terre, obligeaient à chercher et à exterminer sans cesse de nouveaux « ennemis du peuple ». Des flots d’arrestations en masse, tel un ouragan, bouleversèrent la région, remplirent les prisons, firent déborder les « laguer ».
Le gouvernement soviétique ne créa jamais de nouveaux systèmes pénitentiaires ; il adopta la ligne de moindre résistance, développa, en perfectionnant seulement leur organisation, les institutions de la Russie tsariste dont il avait hérité, et, chose plus importante, il en changea le nom.
Les établissements pénitentiaires furent appelés « camps correctionnels de travail » et la prison « maison de travail obligatoire ». Avec le temps, on revint aux anciennes dénominations et aujourd’hui, comme au temps des tsars, existent les noms de « prison » et d’« exil ». On a maintenu le terme de « camp correctionnel de travail » mais tout cela ne change rien au but qui est resté le même : l’extermination ; extermination entendue selon la mesure du colosse soviétique.
En effet :
« La cruauté, la répression spirituelle et l’état de ruine morale d’un peuple peuvent s’expliquer en pensant aux moyens qui, pendant des siècles d’existence passés à l’histoire, ont fini par devenir une seconde nature. » (N. JEWREINOW, Op. cit.)
2. ORGANISATION DES CAMPS
Les « camps correctionnels de travail » couvrent plus d’un quart de la superficie de l’URSS. On entend dire très souvent qu’ils ont, en Russie, une utilité économique importante. En réalité, on leur doit la construction de routes, de voies ferrées, de canaux ; l’extraction du charbon, du naphte, des métaux bruts ; l’installation de fabriques, etc. C’est un fait qu’il n’existe aucun domaine de la vie économique dans lequel les prisonniers n’aient travaillé. D’énormes entreprises reposent sur le travail de ces esclaves, comme dans l’ancienne Égypte les travaux d’irrigation. D’autre part, ces faits sont étroitement unis et dérivent de la politique pénitentiaire qui met à la disposition des organes économiques de l’État un énorme matériel humain. La rapide reconstruction sociale de l’URSS prévue et réalisée dans le cadre des plans quinquennaux, implique l’entassement des prisons et des camps de travail. Au point de vue de la vie politique soviétique, cela offre l’avantage que l’élément douteux demeure isolé, n’ayant aucun contact avec le reste de la société. Mais par rapport à l’économie de l’État, c’est un coefficient plutôt négatif provoquant une grave instabilité dans l’exécution des plans, du fait qu’une série de centres industriels sont dépourvus de main-d’œuvre. Il est vrai qu’en disposant ainsi du matériel humain, on résout le problème de la désoccupation (les désoccupés éventuels étaient les prisonniers), mais le transfert des centres de travail, loin des centres les plus importants de la région, par la création de camps dans l’extrême nord, provoque de grandes complications de transport. Dans ces conditions, toute la charge d’équilibrer le déficit du plan économique retombe sur les prisonniers. Il est hors de doute que, dans l’économie soviétique, les camps de travail constituent un coefficient négatif, mais ceci ne change rien au fait que leur œuvre principale est de reconstruire la structure sociale de l’URSS, c’est-à-dire l’extermination biologique complète des éléments indésirables.
En observant le développement dans l’État soviétique du travail forcé des prisonniers, nous avons acquis la conviction que, malgré l’usage de méthodes d’éducation si radicales, le nombre des prisonniers en Russie, loin de diminuer, augmente et que la politique pénitentiaire ne manifeste aucune tendance, mais elle tend plutôt à limiter les arrestations en masse.
Nous trouvons en Russie ce fait caractéristique : les camps ne se développent pas en dehors des centres ; mais vers le cœur même de l’URSS. Le processus de séparation des « contre-révolutionnaires » commença par les îles de Soloviezkiy et la nouvelle Zemble. À mesure que le nombre des prisonniers augmentait, on créa de nouveaux camps toujours en descendant du nord vers le midi et en resserrant leur cercle autour des centres vitaux de l’URSS. Il existe aujourd’hui des camps de travail jusqu’à l’entour de Moscou, Léningrad et de formidables systèmes de camps se sont développés au dessous de Kuibyshev et de Bakou. Cette direction centripète dans l’extension des camps est causée également par des motifs économiques. Le manque d’énergie pour le travail, dans le centre du pays, a rendu nécessaire la substitution du travail forcé des prisonniers à celui des hommes libres. Aujourd’hui le plan économique pèse déjà sur la politique d’installation des camps, de la même manière que l’atmosphère des prisons, des déportations et des « laguer » pèse sur la vie privée des citoyens libres, étant donné qu’il est rare de rencontrer en Russie une famille dont un membre au moins ne soit soumis aux traitements éducatifs de la justice soviétique.
L’institution la plus importante dans les systèmes des camps soviétiques de travail est le « Goulag 25 » qui fonctionne à Moscou. Étant donné qu’il est impossible de traduire dans une autre langue toutes les abréviations particulières à la langue soviétique, nous devrons nous servir, dans la description de l’organisation, de noms abrégés. Parmi ces expressions, on trouvera plus fréquemment répétés « lag », qui signifie « laguer », c’est-à-dire camp, et ITL = « Isprawitielno Troudowoï Laguer » (camp correctionnel de travail).
Le « Goulag » est une institution connexe du Commissariat du Peuple pour les Affaires Intérieures dont il dépend ; il est divisé en une quantité de sections qui doivent s’occuper de tâches bien définies, comme sont les projets, l’économie du matériel humain, la sûreté, l’administration, les soins sanitaires, la culture et l’éducation, etc. La même subdivision existe dans chaque branche de l’organisation des camps.
Le « Goulag » n’est pas uniquement une institution pénitentiaire – c’est aussi une entreprise industrielle et commerciale se basant, comme c’est normal pour des organismes de ce genre-là – sur des contrats, préliminaires budgétaires, crédits, etc. Le « Goulag » dans des cas nombreux assume le rôle d’entrepreneur qui s’engage à exécuter les commandes qui lui sont confiées par des diverses institutions comme les commissariats du peuple (c.-à-d. ministères) des communications, des affaires militaires, des forêts, de l’industrie et pareils. Le « Goulag » exécute en vertu des contrats appropriés tous les travaux prévus par le plan national des travaux publics comme : construction des voies ferrées, fortifications, exploitation des mines (y compris les mines d’or), des forêts, etc. Le contrôle pendant la durée des travaux ainsi que le versement des sommes nécessaires est effectué par la Banque d’Industrie (Prombank). Tous les contrats et préliminaires budgétaires sont élaborés sur la base des prix normaux de la main-d’œuvre, comme s’il s’agissait d’une entreprise employant des travailleurs libres. Comme le travail des prisonniers revient très bon marché, le surplus sert à entretenir l’immense et coûteux appareil de contrôle de l’NKVD et aussi tous les prisonniers qui pour une raison quelconque ne travaillent pas momentanément. Il en reste pourtant encore un excédent considérable qui dans les recettes de l’NKVD occupe une place importante.
Toute l’organisation des camps est divisée en divers systèmes qui couvrent une certaine zone, avec des tâches économiques strictement définies. Ainsi, par exemple, le système des camps « Bezimienlag » dans la région de Kuibyshev est chargé de construire un centre gigantesque d’industries de guerre.
Un système de camps se divise en régions, « otdielenie », dans lesquelles sont groupés plusieurs dizaines de camps de travail ou, s’il s’agit de camps mobiles devant construire les lignes de chemin de fer, de colonnes de travailleurs. Un camp compte de quelques centaines à plusieurs milliers de prisonniers ; une colonne de 600 à 800.
Les camps plus grands ont, en outre, leurs succursales ou sous-camps.
Les prisonniers sont divisés en brigades de travailleurs comptant de 25 à 40 personnes ; à la tête de chaque brigade est le brigadier, prisonnier dirigeant l’organisation du travail avec un « diesiatnik » qui calcule le pourcentage de travail obligatoire qui a été exécuté ; chaque brigade travaille sous la surveillance d’un soldat armé, qui a le droit de vie et de mort sur les prisonniers.
Il faut tenir compte que les camps de travail souffrent, comme l’ensemble de la vie soviétique, de l’excès de bureaucratie. Depuis chaque camp en particulier, jusqu’aux régions et aux administrations des systèmes, une foule de « faiseurs de projets », de teneurs de livres, de comptables, d’employés, etc. (voir schéma) travaillent dans les bureaux.
Les fonctions administratives sont remplies dans les camps par des prisonniers. Seul le commandant est un homme libre ; ses substituts eux-mêmes peuvent être des prisonniers. Depuis 1941, il a été également décidé que dans l’établissement nommé « wospitatel », l’éducateur doit être un homme libre. Il va de soi que les délinquants communs ont la préséance dans les fonctions administratives des camps, ainsi que nous l’avons fait observer plus haut.
En plus de l’administration économique, il existe parallèlement un personnel nombreux de l’NKVD exerçant les fonctions de sûreté et d’autorité judiciaire pour le cas où de nouveaux délits seraient commis dans les camps par les prisonniers. Sur la carte de dislocation des divers systèmes de camps dans l’URSS, sont indiqués seulement les systèmes dont nous avons pu réussir à fixer le nom et ceux sur lesquels nous disposons d’informations particulières. Nous répétons que ce sont des systèmes et non des camps distincts. Chaque système est constitué par plusieurs centaines de camps. La limite de la zone occupée par les divers systèmes n’empêche pas qu’il y ait, dans le même lieu, des colonies de personnes libres. Vers le sud, en particulier, l’échiquier des camps est relié plus étroitement avec les villes et les villages habités par les populations libres qui y résident normalement. Dans ces villes et ces colonies, il existe un curieux mélange entre les simples cabanes des « wolnonaiomni 26 » et les baraques ou tentes des prisonniers qui vivent dans les « zones » derrière les fils barbelés.
La carte a été exécutée d’après les documents soviétiques originaux et les relations d’ex-prisonniers qui travaillaient entre 1939 et 1942 dans les camps « correctionnels » de travail en URSS.
Autour de la carte même, il y a les documents originaux soviétiques (intitulations, cachets et signatures) publiés par les autorités des systèmes de camps. Le schéma de l’organisation est reproduit dans le fond à gauche, semblable au schéma no 2, qui a été joint à la publication dont nous traitons.
La carte n’est pas complète ; elle a été exécutée d’après les seuls documents disponibles. Tous les camps de travail ne faisant pas partie des systèmes de camps et disséminés sur les territoires de l’Ukraine soviétique, de la Russie Blanche, du Caucase et des républiques de l’Asie Centrale, ne figurent pas sur elle. Nous avons omis Moscou, par exemple, où il existe bien des camps ; la voie ferrée qui court à l’est de la localité Taichet parallèlement à la voie Irkoutsk-Tchita-Vladivostok n’est non plus indiquée. La carte n’indique point enfin les camps de travail dans les régions occupées par la Russie Soviétique pendant les années 1939-1941. Deux cercles concentriques indiquent les localités où il existe des camps de travail ne faisant pas partie de systèmes particuliers, et soumis – probablement – aux autorités locales de l’NKVD.
Dans la partie européenne de la Russie, nous trouvons les systèmes de camps suivants :
1. « SOROKLAG » – Tirant son nom de la localité de Soroki, qui se trouve sur la Mer Blanche. Mines de métaux légers et leur remaniement, construction de voies ferrées, canaux, centrales électriques, et aérodromes. Fabriques de briques, carrières de pierre, industrie du bois, pêche.
2. « SEVERONICKEL » – Au sud de Mourmansk (voir Soroklag, cercle indiqué N. 1). Mines d’aluminium, nickel, cuivre, plomb et zinc. « Kombinat » (groupe d’entreprises industrielles) de métallurgie légère.
3. « B.B.K. » – Canal Baltique – Mer Blanche (voir Soroklag, bande N. 2). Construction et entretien du canal.
4. « VOLGOSTROI » – Construction et entretien du canal qui relie la Volga à la Mer Baltique. Construction de voies ferrées, carrières de pierre, industrie du bois. Travaux pour la construction de la mer artificielle (mer de Rybinsk) entre les fleuves Mologa et Seksna.
5. « ONEGLAG » – Industrie du bois, agriculture, construction d’aérodromes.
6. « CARGOPOLLAG » – Comme « Oneglag ».
7. « SEVDINLAG » – Industrie du bois et du papier. Construction de villes (Molotovsk) et de villages, de voies ferrées, de canaux et d’aérodromes. Carrières de pierre.
8. « COULOILAG » – Industrie du bois.
9. « UKHTIJMLAG » – Mines de pétrole, de fer et de charbon. Production de ciment, extraction de radium du fleuve Ukhta. Construction de rues, carrières de pierre, fabriques de briques, industrie du bois, agriculture (sovkhoz).
10. « OUSTVIMLAG » – Industrie du bois, fabriques de briques, construction de routes.
11. « PETCHORLAG » – Construction de voies ferrées et d’aérodromes. Industrie du bois. Carrières de pierre. Agriculture.
12. « VORCOUTSTROI » – Centre industriel carbonifère de Vor conta. Construction de voies ferrées, de routes et d’aérodromes.
13. « SEVJELDORLAG » – Champ de construction de la voie ferrée qui relie Kotlas à Vorkouta.
14. « UNJLAG » – Construction de voies ferrées, industrie du bois, fabriques de briques.
15. « TEMNIKOVSKIE ITL » – Grand groupe de camps de travail pour femmes (Pothma). Industrie du bois, agriculture (sovkhoz), ateliers de tailleurs pour confection d’uniformes et de lingerie. Fabrique d’objets de fantaisie (sacs, boutons, ceintures, etc.) et de jouets en bois, transformée pendant la guerre en fabrique de caisses de munitions.
16. « SAMARLAG » ou « BEZIMIENLAG » – Construction de la ville de Bezimianka, qui doit être le cœur d’un grandiose centre d’industrie de guerre. Construction d’aérodromes souterrains, de digues sur la Volga et de routes. Carrières de pierre, fabriques de briques, agriculture.
17. « OSOBSTROI » – Construction de fortifications et de fabriques d’industrie de guerre. L’organisation de ce système de camps témoigne des prévisions exactes de l’État Major soviétique (défense de Stalingrad).
18. « IUJLAG » – Littéralement, camp du sud (au sud de Bakou). Construction de la voie ferrée stratégique Lenkoran-Salani, qui doit relier Bakou à la Perse. Construction d’aérodromes et de fortifications.
19. « VIATLAG » – Industrie du bois, construction de voies ferrées et d’aérodromes.
20. « OUSOLLAG » – De la ville de Oufa et de Solikamsk. Industrie du bois, construction de routes.
Outre les systèmes que nous venons d’énumérer, il existe, dans le territoire de l’Union Soviétique, de la Russie Blanche et de la Russie proprement dite, une série de camps dont le nombre dépasse plusieurs centaines, ainsi que nous l’avons déjà dit.
Ainsi, dans la région du Donbass, par exemple, dans chaque centre industriel, dans presque chaque mine, travaillent des prisonniers groupés en divers camps (nous ne parlons pas encore de prisonniers de guerre). Sur tout le territoire de l’URSS les prisonniers travaillent dans les carrières, à la construction des aérodromes, des routes, des fortifications, etc. Près des prisons plus importantes fonctionnent des usines dans lesquelles travaillent les détenus, ainsi par exemple les fabriques de meubles en métal à Odessa. Il existe en outre une quantité de « colonies de travail » pour les délinquants mineurs, qui, après avoir été dans les prisons durant le temps de l’instruction et avoir reçu leur sentence, sont soumis À des règlements éducatifs spéciaux conformément aux Méthodes fixées dans les « colonies correctionnelles de travail pour les mineurs 27 ».
Sur la carte annexée, nous n’avons pas marqué ces points, nous limitant à indiquer les systèmes que nous connaissons. Nous n’avons donc pas de données exactes sur le nombre de prisonniers groupés dans les camps de la Terre de François Joseph, et dans les îles de l’Océan Glacial ; nous sommes donc dans l’impossibilité de fournir des renseignements précis sur les prisonniers et les détenus – en particulier sur les hommes de science – qui travaillent au réseau de stations de radio et météorologiques tout le long de la côte de l’Océan Glacial, de Mourmansk au détroit de Béring.
Parmi les systèmes des camps déjà énumérés, nous devons mentionner plus de trente camps de femmes, réunis dans la région de Pothma, dans la République S.S. Autonome de Mari.
Un autre groupement de camps de femmes dont nous avons connaissance existe dans la région de Akmolinsk (Kazakhstan). Il compte quelques dizaines de camps organisés en unités au moyen de zones appelées « épouses ». Le terme d’« épouses » indique le genre des malfaitrices. Dans ces camps se trouvent les femmes appartenant aux familles de trotskistes (surtout les épouses) condamnées aux termes du paragraphe 1 c. de l’article 58 (sur les responsabilités collectives) ou de l’article 16 (analogies). Étant donné que, pour la plupart, ces personnes appartiennent aux milieux intellectuels (docteurs, ingénieurs diplômés, etc.), les conditions de vie sont beaucoup plus supportables que dans les autres camps de femmes, où les « chalman » ont le même rôle que les « ourki » dans les camps d’hommes.
Dans la zone asiatique de l’URSS, nous connaissons 18 systèmes de camps. Notre énumération commencera avec le n. 21, puisque nous avons compté déjà 20 systèmes dans la Russie d’Europe.
21. « SEVOURALLAG » – Mines de fer, de métaux légers, de métaux précieux et de charbon. Industrie métallurgique, fabriques d’avions, construction d’aérodromes. Carrières de pierre, fabriques de briques, industrie du bois.
22. « IVDIELLAG » – Industrie du bois, construction de routes.
23. « CARLAG » – Mines de charbon et de métaux légers. Construction de fabriques et de villages. Carrières de pierre, fabriques de briques, construction de toutes, agriculture.
24. « TOBOLSKIE ITL » – Mines de charbon et de métaux. Carrières de pierre, fabriques de briques, construction de routes.
25. « SIBLAG » – Mines de fer. Carrières de pierre, fabriques de briques, construction de routes, industrie du bois. Fabriques de tissus et ateliers. Industrie de corroi et distilleries.
26. « TOMASSINLAG » – Industrie du bois, construction de routes.
27. « CRASLAG » – Mines de charbon, industrie du bois, construction de voies ferrées.
28. « NORILLAG » – Comme « Craslag ».
29. « IUJSIBLAG » – Construction de routes et de voies ferrées. Carrières de pierre, industrie du bois.
30. « NOUVELLE ZEMBLE » – Mines de charbon. Pêche.
31. « BOURLAG » – Dans le bassin du fleuve Boureia. Construction de routes, mines, carrières de pierre. Fortifications sur la frontière de la Mandchourie.
32. « NIJNE AMOURSKIE ITL » – Travaux dans les ports, construction de routes et de voies ferrées. Fortifications. Construction d’aérodromes, de magasins militaires, de villages et de villes (Komsomolsk).
33. « DALNIEVOSTOTCNIE ITL » – Construction de routes et de voies ferrées. Fortifications. Construction d’aérodromes, de magasins militaires, de villages et de villes.
34. « IACUTSKIE ITL » – Mines d’or (fameuse Kolyma), de platine et de plomb. Construction de routes et d’aérodromes. Industrie du bois. Carrières de pierre. Pêche et fabriques de conserves de poisson.
35. « SIEVOSTOTCNIE ITL » – Mines d’or (fameuse Kolyma), de platine et de plomb. Construction de routes et d’aérodromes. Industrie du bois. Carrières de pierre. Pêche et fabriques de conserves de poisson.
36. « TCHIUKOTSKIE ITL » – Mines d’or (fameuse Kolyma), de platine et de plomb. Construction de routes et d’aérodromes. Industrie du bois. Carrières de pierre. Pêche et fabriques de conserves de poisson.
37. « CAMTCHIATSKIE ITL » – Mines d’or (fameuse Kolyma), de platine et de plomb. Construction de routes et d’aérodromes. Industrie du bois. Carrières de pierre. Pêche et fabriques de conserves de poisson.
38. « SAKHALINSKIE ITL » – Mines d’or (fameuse Kolyma), de platine et de plomb. Construction de routes et d’aérodromes. Industrie du bois. Carrières de pierre. Pêche et fabriques de conserves de poisson.
Les systèmes des camps n. 31-38 font partie du complexe grandiose nommé l’« alstroï ». L’NKVD destine à ces camps les délinquants communs et les détenus politiques condamnés à des peines de longue durée.
Nous nous sommes bornés à indiquer la tâche économique la plus importante des camps que nous avons énumérés. Chaque système a en outre certaines tâches connexes à son autarchie propre, à savoir : la production des moyens de conservation et d’élevage du bétail ; la construction de baraques pour les prisonniers et d’habitations pour les fonctionnaires de l’armée et de l’administration, l’organisation et la manutention de magasins, de dépôts, etc. Il n’est pas facile de tracer le réseau des camps de l’Asie soviétique, surtout dans la partie septentrionale. On sait, par exemple, qu’il est défendu d’entrer dans la zone nord de la Sibérie et les chasseurs indigènes qui l’habitent ne peuvent eux-mêmes se mouvoir que dans des limites restreintes strictement tracées. Nous sommes loin de vouloir avancer des inventions fantastiques sur ce qui se fait dans ces zones ; nous avons marqué cette surface d’un point d’interrogation. Nous pouvons seulement rappeler que, d’après les assertions de prisonniers soviétiques, cette zone n’est pas aussi dépeuplée qu’elle pouvait sembler l’être et que, de 1939 à 1941 (les dernières nouvelles datent de cette époque), on construisait une voie ferrée devant relier Mourmansk avec le détroit de Béring en passant par Arkhangelsk et Vorkouta. Ceci est très probable. Après avoir échoué dans ses tentatives d’organiser une navigation régulière dans l’Océan Glacial Arctique, le gouvernement soviétique peut avoir décidé la construction d’une ligne de chemin de fer qui, en même temps, ne manque pas de valeur stratégique : ceci pouvait être encouragé par le plan de construction du tronçon de la ligne transsibérienne Iakutsk, Magadan, péninsule de Tchouktchi, détroit de Béring.
Outre ces camps, il en existe encore toute une série que nous n’avons pas mis en évidence sur la carte, ainsi par exemple les systèmes : « VITERGORLAG » et « NOVOTAMBOVSKI ITL », au sujet desquels nous ne possédons pas de données exactes, mais de l’existence desquels le lecteur qui connaît la langue russe peut facilement se convaincre, après avoir relu attentivement les documents reproduits sur la carte.
Un peintre polonais, Joseph Czapski, eut en 1942 la possibilité de voir la carte des camps de travail lorsqu’il fut envoyé par les autorités militaires polonaises pour traiter la question des officiers disparus (tués, comme on l’a vu, à Katyn), auprès du général Nasiedkin, alors commandant du « Goulag », qui lui accorda audience. Dans ses « Souvenirs de Starobielsk » Czapski décrit ainsi cette audience :
« J’eus deux entretiens avec le général Nasiedkin et un autre avec le chef de l’NKVD de la région de Tchkalovsk, Mr. Bsyrov. Notre première conversation frappa Nasiedkin de surprise et, pour cette raison peut-être, il fut plus courtois. Il était assis devant une grande carte de l’URSS sur laquelle étaient marqués tous les plus importants camps de concentration dont il était le chef ; la majeure partie des étoiles, des cercles et des autres signes qui indiquaient les plus grands groupes de camps étaient sur le territoire de la République Soviétique de Komi, sur la péninsule de Kola et à Kolyma. Parmi les autres, je m’aperçus qu’il y avait à Verkhoïansk un ensemble de camps grand comme celui de Magadan. Magadan est un point à travers lequel passent les masses des prisonniers politiques qui sont embarqués sur des bateaux contenant de cinq à dix mille personnes et transportés à Verkhoïansk, du Golfe de Nakhodka, sous Vladivostok. Près de Magadan se trouve une petite ville d’environ vingt mille habitants estropiés ou mutilés, ayant le nez, la bouche, les mains ou les pieds gelés, dont nous ont parlé des témoins oculaires. Verkhoïansk est le point le plus froid de la terre ; à ma connaissance aucun des prisonniers ou des détenus n’en est jamais revenu. »
La carte des systèmes des camps correctionnels de travail dans l’URSS jointe à cette publication est en même temps une illustration intéressante de l’effort économico-politique de l’Union Soviétique visant à la reconstruction de la Russie dans un solide État euro-asiatique. La frontière orientale des systèmes des camps centre-asiatiques et sibériens correspond à la même frontière du territoire qui a été défini par les géopolitiques comme « espace vital » du monde. Les territoires euro-asiatiques limités à l’Orient par le fleuve Ienisseï et à l’Occident par la ligne qui va plus ou moins de la Baltique à la Mer Noire font partie de cet espace. Dominer cet « espace vital » – selon les géopolitiques – donne la possibilité de s’emparer de trois continents : Asie, Europe et Afrique, ce qui signifie hégémonie sur le monde entier. Avec le travail d’esclave des prisonniers politiques et des exilés, les bolchéviques transforment cet espace en une base fondamentale de leur expansion mondiale.
3. NOMBRE DES PRISONNIERS
Ici se pose la question : combien de citoyens de l’Union Soviétique sont prisonniers dans les camps de travail ? Le « Goulag » seul pourrait en fournir le chiffre exact et nous devons recourir à des calculs approximatifs. Les prisonniers russes racontent qu’en 1937, durant la « période de Iejov », il y avait en Russie plus de 40 millions de prisonniers. Ce chiffre est indubitablement exagéré ; il est cependant caractéristique que des prisonniers polonais, déportés en Russie en 1939 et plus tard, aient entendu souvent des gardiens de prisons leur dire, pour célébrer la puissance et la grandeur de l’URSS : « La Pologne a à peine trente-cinq millions d’habitants. Qu’est-ce que cela ? Chez nous, les prisonniers atteignent ce nombre ! »
Nous essaierons seulement d’évaluer le nombre global des prisonniers, en nous approchant le plus possible de la vérité, au moyen d’un simple calcul de chiffres. En général, chaque camp compte 1.200 prisonniers : chaque région (« otdielenie ») a, d’ordinaire, 10 camps, et chaque système, 20 régions.
1.200 x 10 x 20 = 240.000.
Ce calcul est très modeste. Nous savons, par exemple, que le système « Bezimienleg » occupait, en 1941, 300.000 prisonniers ; dans le « Iujlag » 200.000 prisonniers construisaient la voie ferrée, et il y en a au moins 2 millions à Kolyma. Admettons, par mesure de précaution, que la population normale d’un système soit de 250.000 personnes. Nous avons compté 38 systèmes. Donc le chiffre global des seuls systèmes énumérés arrive à 9.500.000 prisonniers.
Il faut ajouter à cela les centaines de camps non compris dans les systèmes et toutes les personnes arrêtées et retenues dans les prisons d’instruction.
Nous avons la conviction que le chiffre de 15 millions de prisonniers, pour les années 1940-42, est plutôt modeste.
Ce chiffre est extrêmement élevé et grandement disproportionné si on le compare avec les pays européens. Si nous devions prêter foi aux affirmations des prisonniers russes qui évaluent à 40 millions les personnes se trouvant dans les prisons et les camps soviétiques en 1937, au plus fort de la terreur de Iejov, ce chiffre constituerait 25 % de la population de l’URSS, c’est-à-dire le quart.
Voyons les statistiques des pays « bourgeois » de l’Europe :
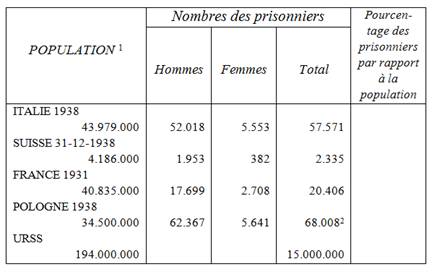
(1) Sources :
Annuario Statistico Italiano 1939, Istituto Centrale di Statistica del Regno d’Italia ;
Statistisches Jahrbuch der Schweiz (1938) herausgegeben von Eidgenossischen Statistischen Amt ;
Annuaire Statistique, Cinquantième Volume, 1934 ;
Présidence du Conseil Statistique Général de la France ;
Concise Statistical Year-Book of Poland, 1938, published the Chief Bureau of Statistics.
(2) Sur ce nombre 10.498 individus sont condamnés à des peines de trois ans et plus ; 665 pour la vie.
Les statistiques soviétiques donnaient, en 1938, comme chiffre total de la population, 173 millions de personnes ; étant donné que, en conséquence de l’alliance avec les Allemands, la Russie s’enrichit d’environ 21 millions d’habitants 28, nous pouvons calculer que la population de la Russie Soviétique, en 1940, était d’environ 194 millions. Concédant à la propagande soviétique le chiffre de 200 millions dont elle se vante, nous le prendrons comme base pour calculer le pourcentage des prisonniers.
Quinze millions de prisonniers sur 200 millions d’habitants, cela représente le 7,50 %, c’est-à-dire un prisonnier pour treize habitants de l’Union Soviétique. À la lumière de ces chiffres, peut-on douter qu’il existe dans le territoire de l’Union Soviétique une seule famille dont un membre au moins n’ait été prisonnier ?
En tout cela, nous n’avons pas calculé jusqu’ici les nombreux millions de déportés.
Aussi, combien ne sont-elles pas pleines d’une amère ironie les paroles du chant national soviétique :
« Je ne connais pas de pays semblable à celui-ci,
« Où un homme puisse aussi librement respirer. »
Et ne correspond-elle pas mieux à la vérité la paraphrase de ce chant des prisonniers soviétiques :
« Je ne connais pas de pays semblable à celui-ci,
« Où il y ait tant de prisons et de laguer. »
4. LA JUSTICE SOVIÉTIQUE ENTRE EN EUROPE
De nos jours, le nombre des prisonniers s’est certainement accru du fait que la Russie a agrandi son territoire en « libérant » plusieurs contrées de la domination hitlérienne et a soumis ces populations à l’arrestation en masse et à la déportation.
La machine écrasante de la justice soviétique s’est déplacée vers l’occident sur la ligne Elbe-Trieste. Le système des arrestations et le plan de la « reconstruction sociale » des pays occupés par l’armée rouge sont invariables. Les terriens sont arrêtés ainsi que les capitalistes, les activistes politiques, les fonctionnaires et les travailleurs de l’État et autonomes, le clergé et la classe intellectuelle, les activistes des syndicats, les socialistes et communistes (ces derniers sous l’accusation de trotskisme), tous ceux enfin, à l’aveuglette, qui pour une raison ou autre sont considérés par l’NKVD comme des éléments « socialement dangereux ». Des centaines de trains de prisonniers transportent dans le centre de la Russie aux prisons, aux laguer et à l’exil des centaines de milliers d’« ennemis du peuple ». Des agitateurs bolchéviques venant de l’URSS prennent leur place, ainsi que des familles d’officiers de l’armée rouge, et la jeunesse du Komsomol, qui ne connaît pas la langue du pays occupé, n’a pas de préparation professionnelle et est toutefois désignée pour occuper des postes de direction et des positions clefs dans la vie d’une société soviétisée.
La soviétisation dirigée suivant les plans est exécutée sans pitié dans les territoires occupés. La première étape en est la révolution, non spontanée cependant, non semblable à la Commune parisienne ni à l’Octobre russe, mais une révolution imposée par l’occupant, une révolution administrée. Il appartient à la justice soviétique, dont l’NKVD est la véritable et essentielle expression, de la réaliser.
Les noms seuls ont été changés. La presse et la radio soviétiques n’emploient pas à l’égard des pays occupés les expressions « contre-révolution » ou « contre-révolutionnaire ». Ceci démasquerait les véritables intentions de la Russie vis-à-vis de ces pays, dans lesquels elle pense garder les apparences de la démocratie. Ils deviendront partie intégrale de l’Union Soviétique après la « reconstruction sociale », après la « révolution administrée ». Au moment politiquement opportun, les « parlements » de ces pays demanderont au Conseil Suprême de l’URSS d’être reçus dans l’assemblée des Républiques soviétiques. Mais ceci est prévu comme étape future. C’est pour cela qu’on parle aujourd’hui des fascistes, du fascisme et de la défascistisation. Le concept de fasciste dans l’interprétation de la justice soviétique est très élastique. Ce concept comprend maintenant non seulement les membres des partis fasciste et naziste et leurs partisans, mais aussi ceux qui s’opposent au programme bolchévique. La presse soviétique et communiste affirme aujourd’hui à l’unanimité que l’anticommunisme est fascisme. Il faut donc arrêter et anéantir les « fascistes ». Nous écrivons le mot « fasciste » entre guillemets afin d’éviter des équivoques. Nous ne nous attendrissons pas sur le sort des vrais fascistes, délinquants de guerre, et de leurs partisans ; nous ne pouvons toutefois pas approuver l’extension du concept de fasciste à tous ceux qui ne sont pas des enthousiastes de la soviétisation de l’Europe. Chaque personne peut malheureusement devenir fasciste dans l’interprétation des tribunaux soviétiques.
L’affirmation de nombreux citoyens polonais et des pays baltes, « libérés » en 1939, nous semble juste : quiconque se trouve dans le rayon d’action de l’NKVD, disent-ils, doit s’attendre à tout moment à être arrêté. Et elle n’a rien de plaisant cette recommandation : chaque personne, même jouissant encore de la liberté, doit avoir avec elle une petite valise (sans serrure de fer) contenant les accessoires de toilette, du linge de rechange et une couverture. De fait, nul n’est certain que son arrestation ne puisse se produire quand il est au restaurant ou au théâtre, aussi cette recommandation concerne-t-elle tous ceux qui habitent les territoires « délivrés » par l’Union Soviétique.
Si ceux qui, aujourd’hui, adhèrent au parti communiste dans les divers pays d’Europe, croient qu’ils pourront gouverner, ils se trompent. Après une ivresse momentanée, ils iront en prison et dans les camps de travail, comme cela est arrivé aux communistes polonais, lithuaniens, estoniens et roumains. La dogmatique bolchévique, bien qu’elle ait recours à des tactiques bien diverses pour beaucoup de questions, est inflexible pour celle-ci. La répulsion à l’égard de ce qui a quelque relation avec l’Occident est trop forte dans toute la société russe et plus encore parmi les éléments gouvernementaux, pour que l’NKVD puisse faire une exception à la règle en faveur des communistes de l’Europe occidentale.
Seuls les chefs des partis communistes des différents pays, précédemment instruits à Moscou et que cette ville a conquis à sa cause, peuvent compter sur quelques égards momentanés, membres du comité exécutif de la IIIe Internationale, du « Politbureau » et d’autres organes suprêmes de la révolution bolchéviques.
L’éthique bolchévique est différente de l’éthique des communistes non russes, et c’est justement sur cela que se fondent les malentendus qui deviennent la cause d’éloignement de la tactique bolchévique loyale, accusation ayant toujours pour terme l’emprisonnement. Une personne communiste par ses idées est incapable d’éviter de semblables déviations à moins d’adopter une manière de penser cent pour cent bolchévique ; il lui faudrait, en ce cas, renoncer au rêve de la dictature du prolétariat et à tous les attributs nécessaires à un régime communiste ; pour en arriver là, elle devrait auparavant s’être bien avilie.
Il est vrai qu’il est inutile de répéter que tout régime russe, qu’il soit rouge ou blanc, continue fidèlement la politique impérialiste du colosse russe, politique qui ne tient compte de rien. Comme autrefois la soldatesque tsariste, ainsi aujourd’hui les bolchéviques sont imbus d’une foi barbare en leur cause qu’ils ont été capables de présenter, à l’aide d’une propagande fort bien organisée, comme une mission libératrice de l’Europe et du monde entier.
Le panslavisme, que Lénine et Staline ont tant de fois déclaré être un élément de la plus obscure réaction tsariste, est devenu aujourd’hui l’enseigne de la politique soviétique dans l’Europe sud-orientale. On commence déjà à former le projet de la création d’une république des Dardanelles et les agents de Moscou, pareillement au Maréchal Tito, font entendre de bruyantes revendications.
La tyrannie euro-asiatique s’avance à grands pas vers l’Occident ; elle a pour instrument et symbole la verge au moyen de laquelle elle maintient, avec plein succès, une masse d’esclaves sous son obéissance aveugle : les Russes se divisent, en effet, en esclaves et en tyrans ; il n’y a pas d’hommes libres ou, s’il s’en trouve, ils sont haïs et anéantis.
L’administration soviétique, c’est-à-dire russe, étouffe d’une manière définitive tout mouvement tendant à maintenir un simulacre au moins d’indépendance des peuples « libérés ». Sa politique d’arrestations et de déportations prouve combien est vraie cette thèse de Lénine : « La Russie est une prison des peuples. » D’après les rares nouvelles qui parviennent des pays occupés par l’armée rouge : Pologne, Roumanie, Hongrie et Yougoslavie, il résulte que la thèse de Lénine est encore actuellement en vigueur.
Le procès de la préparation de la société à la révolution, à la lutte en général contre les ennemis du communisme, se fait en même temps dans les pays de l’Europe occidentale. Le concept de « fasciste » est déjà défini, la manière pour l’anéantir déjà indiquée. Les définitions juridiques de la justice soviétique pénètrent dans la conscience des peuples de l’Europe non encore occupée matériellement. La presse et la radio des pays de l’Occident se sont habituées à la terminologie bolchévique employant toujours plus largement les expressions : « élément socialement dangereux », « tribunal du peuple », « épuration », etc. Le procès de l’intimidation des personnes contraires au communisme dure et se renforce. Tout essai de défense de la démocratie et de la liberté humaine est condamné : ainsi que toute critique défavorable au totalitarisme russe. Celui qui ose la faire est nommé fasciste et est excommunié dans l’opinion non seulement des bolchéviques et des communistes, mais aussi de la société tout entière. Même si quelqu’un s’aperçoit que le bolchévisme est le système de gouvernement le plus totalitaire, qui ne respecte pas l’idée de la liberté et de la dignité humaines, il craint de le déclarer publiquement, pour ne pas tomber dans l’accusation de fasciste de la part de ceux qui l’ont méritée les premiers.
Cet élément particulier et essentiel de la terreur et de l’intimidation paralyse la volonté des peuples, en train d’observer passivement les phénomènes nouveaux, incompris et inquiétants.
C’est pour cela donc que tous ceux qui sincèrement désirent que les libertés démocratiques règnent dans le monde, doivent en premier lieu se libérer de cette crainte, briser cette terreur morale, et avec pleine conscience et compréhension de l’essence de la catastrophe nouvelle qui menace l’humanité, s’opposer au totalitarisme rouge avec la même force avec laquelle ils se sont opposés à la puissance du fascisme et du nazisme.
DEUXIÈME PARTIE
REMARQUES PRÉLIMINAIRES
Nous avons réuni dans cette partie de notre publication la documentation servant à illustrer et à confirmer la thèse que nous avons présentée dans la première partie. La variété et la richesse du matériel en notre possession comblent les lacunes que le lecteur peut avoir notées précédemment.
Nous présentons des descriptions de faits survenus à des personnes de nationalités différentes, de professions diverses, d’âges différents, femmes et hommes, vieillards et enfants. Les chiffres au bas de ces descriptions correspondent aux chiffres du dossier des relations réunies spontanément par ceux qui, déportés et prisonniers des Russes entre 1939 et 1941, ont eu la possibilité de sortir de Russie.
Il va de soi que nous ne pouvons pas toujours citer le nom ou l’état civil exact des auteurs des récits. Nous avons été obligés de recourir dans certains cas à des pseudonymes et nous avons souvent dû omettre des passages essentiels à la clarté du tableau car l’ennemi, qui occupe nos territoires, pourrait se venger sur les parents et les amis de ceux qui ont osé écrire la vérité.
Nous avons fait tout notre possible pour réunir le matériel suivant les problèmes définis, mais étant donné la variété des faits décrits dans les divers récits, nous n’avons pas toujours réussi.
Il se peut que les auteurs des relations citent plusieurs chiffres des articles du code pénal concernant le même délit : nous rappelons à ce propos que presque chaque république confédérée possède, formellement, un code pénal différent et cette différence consiste en une numération différente des mêmes articles. C’est pourquoi, si l’auteur de la relation a été jugé comme contre-révolutionnaire dans le territoire de la République Ukrainienne, on lira l’article 54 ; si, par contre, il est accusé du même délit dans le territoire de la République Fédérale Russe, il est soumis à l’article 58, et ainsi de suite.
La langue et le style employés par les auteurs des divers récits laissent probablement bien à désirer. Nous jugeons bon toutefois de reproduire fidèlement ces relations et de nous borner à éliminer les fautes les plus grossières, notamment les fautes d’orthographe. Nous avons cherché aussi à conserver les caractéristiques du style des narrateurs dans les traductions en langues étrangères. C’est pourquoi on trouvera des irrégularités dans la concordance des temps et dans la construction des phrases.
Les auteurs des récits sont des agriculteurs, des mécaniciens, des docteurs, des avocats, des journalistes, etc. ; chacun écrit selon ses capacités.
Certains termes originaux russes se répètent souvent dans les relations. Il ne nous a pas été possible de les éliminer. Nombre d’expressions concernant les conditions particulières de la vie en URSS ne peuvent être traduites. Nous les reproduisons donc phonétiquement ; pour les lecteurs les plus scrupuleux, nous donnerons ensuite une liste alphabétique de ces mots étrangers.
Tout ce qui a été souligné dans le texte des relations l’a été par les auteurs de l’ouvrage complet.
CHAPITRE I
CARACTÈRE GÉNÉRAL DU DROIT BOLCHÉVIQUE
I. CONSIDÉRATIONS D’UN EX-PRISONNIER
« On peut se faire une idée de l’administration de la justice en observant le cours de l’instruction, en analysant les sentences, en examinant les camps de concentration et toutes leurs conséquences.
En ce qui concerne l’instruction, la méthode est extrêmement primitive : les preuves sont principalement réunies auprès de l’accusé même, qui, soit dit entre parenthèses, est traité comme s’il avait déjà été jugé. Les preuves de circonstances extérieures, et donc les témoignages, les preuves matérielles, etc., ne sont généralement pas pris en considération. Il s’agit tout simplement d’une confession de faute qui, selon les systèmes pénaux modernes, n’a pas de sens en elle-même, n’étant pas matériellement confirmée par les circonstances extérieures.
Le fonctionnaire qui s’occupe de l’instruction cherche à obtenir une confession par tous les moyens : par des pièges, par la terreur (cellules de rigueur situées dans des caves très basses avec de l’eau), par des coups et par toutes les tortures physiques et morales les plus raffinées. Il cherche à produire un affaiblissement de la volonté par n’importe quel moyen : par l’isolement pendant plusieurs jours, par des interrogatoires, généralement durant les heures nocturnes, réveillant exprès, plusieurs fois pendant la même nuit, pour l’instruction et répétant cent fois la même question : « Avoues-tu être un espion ? » La Russie est obsédée par le complexe d’espionnage.
Avant de m’habituer à ce système, je ne pouvais pas me résigner au fait qu’ils ne voulaient pas entendre parler de témoins pour ma défense, c’est-à-dire de témoins à décharge. Cela me paraissait une violation des principes qui sont à la base des procès dans les États modernes, où on examine la position du prisonnier dans toutes les circonstances qui sont soit contre, soit en faveur de l’accusé.
Au principe romain « In dubium, pro reo » (en cas de doute on décide en faveur de l’accusé), il ne faut pas même songer : pire encore est la question de la défense de ses droits devant le juge.
Après avoir signé, pour la sixième fois, le procès-verbal des conclusions de l’instruction (dans chaque lieu où j’étais déplacé, on commençait une instruction nouvelle), j’attendais la sentence ; je fus par contre informé que la loi admettait l’intervention d’un avocat d’État en faveur de l’accusé. Je m’adressai alors au directeur de prison, pour qu’il me mît en contact avec cet avocat, mais il me répondit : « Après la sentence. » Je m’étonnai évidemment, mais comme le directeur parlait sérieusement, je dus me contenter de cela.
Le 9 juillet 1940 la sentence me fut communiquée : 5 ans de bagne pénal pour avoir tenté de franchir la frontière, ce qu’ils n’avaient pas prouvé.
Ayant de nouveau demandé l’intervention de l’avocat, on me répondit qu’elle ne serait possible qu’après mon arrivée au lieu désigné pour subir la peine. Il ne me semblait pas très juste de commencer à subir un châtiment avant la confirmation de la sentence et avant d’obtenir n’importe quelle possibilité de défendre ma position, chose qui, au contraire, était pour les Russes tout à fait naturelle.
Le transport vers le nord commença une semaine après. Vers la fin du mois d’août nous arrivâmes près de Petchora et, après une marche de deux jours à travers la toundra, nous atteignîmes des bois marécageux ; c’était le lieu désigné comme bagne pénal, mais il n’y avait aucun fonctionnaire, ni aucune colonie. Les oiseaux, très rares, causaient en général de l’étonnement lorsque, parfois, ils donnaient signe de vie. La fable de l’avocat d’office se termina. Quelques-uns, encore obstinés, ayant réussi par miracle à s’emparer de quelque feuille de papier, écrivirent un recours, mais quelques jours après trouvèrent leurs lettres dans le cabinet comme papier hygiénique. Le papier manque terriblement en Russie et le chef du camp, lui-même, avait parfois des gestes bourgeois.
Mon expérience personnelle et les observations que j’ai faites me permettent de présenter brièvement dans le tableau suivant le système pénal pratiqué dans l’État bolchévique.
Tandis que les systèmes pénitenciers actuels de l’Europe occidentale se basent sur le principe de l’éducation et de la garantie sociale, le système soviétique par contre réalise les plus mauvais principes d’intimidation.
On ne peut parler, en pratique, d’aucun but indirect, mais dans les prisons et dans les bagnes pénaux il n’y a pas d’institution d’éducateurs, à caractère didactique ou de préparation à la vie.
À dire vrai, l’institution de l’« éducateur » existe, mais seulement comme instrument de l’administration des prisons et son rôle consiste à augmenter le rendement de travail des prisonniers. Les prisons et les bagnes pénaux n’éduquent pas moralement, mais démoralisent en général et déshabituent en particulier du travail honnête.
Le principe de la sincérité dans l’instruction et le jugement sont appliqués seulement dans l’instruction et rien que par nécessité.
Dans la phase suivante du procès, la procédure est faite par contumace et par écrit. Ceux qui ne connaissent pas le droit soviétique, par exemple les citoyens polonais, lettons, estoniens, tchèques et autres, étaient privés de la défense professionnelle et de n’importe quelle aide légale. On ne leur montrait pas même le code et ils ne pouvaient donc pas se constituer une défense juridique tout seuls. Pour une personne de civilisation occidentale, une punition infligée dans un pays étranger pour des actions légales effectuées dans son propre pays et pour avoir accompli son devoir est tout à fait inconcevable. Un agent de police polonais, par exemple, fut condamné sous l’accusation de contre-révolution, pour avoir combattu les communistes dans le territoire de l’État où il était défendu par la loi d’appartenir au parti communiste. On peut dire la même chose par rapport aux juges de l’État et aux autres fonctionnaires.
Le système terroriste, appliqué dans toute son étendue, se manifeste non seulement par des peines sévères, comme dix ans de bagne pénal pour commerce illégal, revente de marchandises lucratives ; non seulement par le traitement inhumain des personnes jugées et par les délictueuses conditions de vie des bagnes pénaux, mais aussi par la très large application du principe de responsabilité collective des familles ou des pays pour des fautes commises par leurs membres ou leurs habitants. L’exil et l’envoi aux camps de concentration des familles pour une faute ou pour des idées non orthodoxes d’un parent, le déplacement forcé de toute une nation sont à l’ordre du jour. Comme prétexte on prend, par exemple, une prétendue aide à des fugitifs.
Dans le droit pénal moderne, le lien de sang est au dessus des droits sociaux ; dans la Russie actuelle, il est une circonstance défavorable ou bien une faute irrécusable. Par conséquent, il n’existe pas de famille qui n’ait de proches parents aux travaux forcés ; il n’y a presque pas de personnes qui n’y soient passées. L’évaluation de l’individu dans le régime soviétique est uniquement une évaluation statistique. » (10748 – P. « Réflexions sur le séjour en Russie ».)
2. FEMMES ET ENFANTS
« ... Tandis que je subissais une peine de trois ans de travail à Pothma, Rép. aut. des Mordvins, je fus de nouveau arrêtée à la suite d’une délation. Le 28 juillet 1941, c’est-à-dire quelques jours avant l’amnistie, les Russes m’isolèrent sous l’accusation d’avoir discrédité le régime et ses représentants, de propagande antisoviétique et de conduite hostile vis-à-vis de personnes fidèles au gouvernement.
Après une première instruction à l’NKVD et des perquisitions soignées, je fus emmenée dans une petite cellule où je rencontrai trois Polonaises et trois Russes. Deux de ces dernières, d’origine mongole, étaient complètement crétines, elles ne savaient ni lire ni écrire et pas même parler russe, et elles croyaient en l’existence d’un tsar Nicolas qui aurait dû les délivrer du châtiment des maudits enkavudistes. Ces vieilles femmes aux cheveux blancs, étant chefs d’une organisation religieuse, étaient accusées de « refus de travail ».
Les premiers jours de septembre 1941, elles furent toutes les deux emmenées au jugement et, après des débats de deux jours, elles furent condamnées à mort. Elles ne retournèrent pas dans notre cellule, mais furent placées dans une « cellule de la mort », près de nous.
Une nuit, nous fûmes réveillées par des cris et par un tumulte dans le couloir ; nous regardâmes ce qui se passait : ils conduisaient les condamnées à l’exécution.
Après quelques interrogatoires, ils me donnèrent l’acte d’accusation ; ma faute était enregistrée sous l’article 58, par. 10, deuxième partie, qui prévoit une peine allant de trois ans jusqu’à l’exécution. Les débats furent fixés au 18 septembre 1941 ; c’était une journée de pluie et il y avait un vent terrible.
Vêtue d’une légère jaquette, d’une robe de soie, et sans bas, (ils m’avaient défendu de rien emporter du camp) je tremblais de froid en attendant mon tour ; pendant ce temps, ils jugeaient une femme peintre qui se trouvait déjà depuis plusieurs années, sans sentence, au bagne pénal à cause de son mari.
Ces femmes n’ayant pas une sentence personnelle, mais qui avaient été arrêtées par rapport à la condamnation de quelques membres de la famille, étaient nombreuses et avaient aussi un nom spécial : « spez-contingent » (contingent spécial).
Ce jour-là, la femme peintre eut « sa » sentence, à savoir dix ans de prison ; elle s’était plainte des horribles conditions sanitaires existant dans le camp.
Mes débats commencèrent après les siens : ils m’emmenèrent dans la salle du « jugement » qui se trouvait dans un taudis en bois. J’observais tout autour le local : sur une estrade, il y avait une longue table recouverte d’un drap rouge et quelques chaises ; des bancs pour les accusés, et les témoins remplissaient le restant de la pièce. Les portraits des libérateurs du genre humain, Lénine et Staline, figuraient sur les murs. L’ensemble produisait une impression désagréable. Le tribunal était composé de trois personnes : le juge président à l’aspect de berger, l’assesseur qui semblait une grasse cuisinière et un enkavudiste en uniforme.
Après avoir écouté le seul témoin à charge (quoique les Polonaises fussent déjà en liberté, les autres témoins vinrent trop tard aux débats et leurs dépositions furent simplement lues), on me demanda si j’admettais les accusations qui m’étaient faites, puis la cour se retira pour délibérer. Lorsqu’on me communiqua la sentence de cinq ans de prison et qu’on me demanda si je voulais faire appel, je répondis par un refus : la condamnation me paraissait extrêmement légère par rapport aux bolchéviques.
Je retournai dans la cellule et, quelques jours plus tard, on m’envoya là où je devais subir ma peine : j’ai éprouvé dans ce lieu toute l’horreur de la vie soviétique. Dans des baraques basses et étroites, un nombre épouvantable de femmes s’amassait, surtout des criminelles, scélérates, voleuses, et prostituées, les nommées « chalman ». Un vacarme indescriptible y régnait et on entendait des injures très grossières dont l’Europe occidentale n’a pas la moindre idée. Les prisonnières politiques n’étaient pas nombreuses ; parmi elles se trouvaient quelques Polonaises, auxquelles, ainsi qu’à moi, on avait renouvelé la sentence.
On travaillait jusqu’à onze heures sur vingt-quatre exécutant des travaux différents : couper le bois dans les forêts ou bien coudre dans les fabriques des matelas en ouate, des bas peluchés et des enveloppes pour bidons. Le travail à exécuter chaque jour était trop long pour pouvoir le terminer et la nourriture était très mauvaise ; celle qui n’arrivait pas à achever tout son travail recevait 300 grammes de pain mouillé et un dégoûtant potage d’eau ; des scènes scandaleuses avaient lieu à table, avant la distribution des repas ; les femmes s’arrachaient réciproquement les aliments et en arrivaient souvent à se battre.
Un jour, une femme prit une souris qui avait été dénichée par un chat et la mangea.
Le 11 décembre 1941 me trouva dans ces conditions, lorsqu’il me fut annoncé que j’étais libre et je fus remise temporairement en « liberté surveillée ». Je rencontrai ce jour-là des mineures russes, qui, après avoir subi leur peine d’un an et six mois, étaient mises en liberté en même temps que moi.
Avec un bon sens incompréhensible pour des personnes normales, les règles du droit soviétique défendent en pratique à ceux qui sont remis en liberté de retourner au lieu où ils vivaient auparavant et privent ainsi même ces enfants d’une maison et de toute assistance familiale.
Leur ayant accordé la faculté de choisir une résidence dans une des provinces désignées, on leur donnait quelques roubles pour le billet de chemin de fer en rapport avec la durée du voyage, pour un maximum de deux semaines.
Une de ces jeunes filles, d’environ 12 ans, me montrant une paire de ciseaux consciencieusement cachés dans ses bas, me dit avec orgueil : « Regarde le trésor que je possède ! Avec ceux-là je gagnerai ma vie. » Je lui demandai étonnée ce qu’elle voulait faire ; elle fit alors un geste expressif des mains et dit : « Je couperai les sacs dans les wagons : je dois, de quelque façon, gagner de l’argent pour pouvoir manger. » Je la rencontrai plus tard, à la gare, en train d’acheter des petits pains. Évidemment il ne lui était pas trop difficile de gagner de l’argent ; elle avait reçu une instruction convenable dans les « Ispravitielno-trudovie lagheria » et, à sa sortie, elle était une voleuse expérimentée.
De cette manière j’ai pu moi-même constater que les méthodes d’éducation soviétique jettent des milliers d’enfants dans les camps de travail, où elles sont mises en contact avec les pires criminelles ; soumises à l’influence délétère de ces dernières, elles créent ainsi des générations nouvelles de délinquantes. » (11660 – Relation d’une déportée et ex-prisonnière ; Sophie K.)
3. QUI EST ARRÊTÉ EN URSS ET POURQUOI
a) Catégories de délinquants – Anéantissement en masse des ennemis.
« ... Je fus arrêté par les autorités soviétiques à Wilna le 2 août 1940, trois semaines après l’entrée de l’armée soviétique en Lithuanie, Lettonie et Estonie.
À Wilna, les autorités soviétiques se consacrèrent tout d’abord, durant les premiers jours de leur gouvernement, à l’organisation et à la remise en ordre des prisons. Les beaux édifices de l’État et communaux, les édifices des chemins de fer furent transformés en prisons ainsi que les écoles ; ceci rendait en même temps inutile toute l’organisation judiciaire.
Qui était arrêté ? Peur quel genre de faute ? Celui qui se pose ces questions ne possède aucune idée de la réalité soviétique.
Lorsque, une fois confiné, je demandai à un vieux geôlier, type de citoyen des camps de concentration, en lui montrant une femme, si c’était une prisonnière politique ou une criminelle, il me répondit : « Une demande pareille n’a pas de sens en URSS, car la raison de l’arrestation n’est pas ce délit ou un autre accompli par une personne, mais plutôt le désir de la liquider. De quel droit ceci est fait, cela a peu d’importance. »
Après l’arrestation, on s’occupe des raisons de l’arrestation et de l’auto-accusation. Il arrive ainsi qu’au cours des soi-disant enquêtes, le texte même de l’accusation soit plusieurs fois modifié. Les témoins et les preuves matérielles sont choisis seulement après l’arrestation de l’accusé.
Le désir de liquider tous les éléments actifs dans la vie de l’État et dans l’économie de la Pologne était le motif des arrestations en territoire polonais. Citons, par exemple, Wilna ; les habitants de chaque immeuble furent minutieusement examinés au sujet de l’ensemble de leur passé, et les individus à arrêter et liquider furent particulièrement désignés.
Les personnes arrêtées appartenaient aux catégories suivantes :
1) fonctionnaires de l’État et de la commune, officiers de tous grades, hommes politiques de tous genres, comités directifs de toutes les associations et organisations qui n’avaient rien à voir avec la politique, chefs et membres actifs des organisations socialistes et des syndicats professionnels ;
2) personnes de classes rentières qui avaient et remplissaient des fonctions plus ou moins importantes dans l’économie. Le problème marxiste est la reconstruction sociale et l’expropriation des moyens de production et des propriétés ; les autorités soviétiques ont simplifié ce problème au point de liquider biologiquement la classe des rentiers ;
3) personnes de formation professionnelle et d’esprit contraire à l’idéologie soviétique ; en outre, toutes les personnes chez lesquelles on remarquait des symptômes de quelque individualité.
À Wilna, j’ai été témoin des faits suivants :
Au cours des premiers mois les autorités soviétiques ont employé la politique du flirt avec le monde artistique polonais, elles ont donné des subsides aux théâtres, ont offert de somptueux banquets, elles ont entouré d’une protection « paternelle » les artistes, les peintres, et ainsi, de suite. Elles s’appropriaient en même temps certaines personnes très influentes de ce milieu, en inventant lâchement des accusations. Douze personnes parmi les artistes de Wilna étaient avec moi à Loukishki : je ne me souviens malheureusement pas de leurs noms.
Il y eut aussi parmi nous des personnes qui croyaient pouvoir trouver quelque « modus vivendi » avec les nouvelles autorités et qui ont même présenté dans ce sens des propositions concrètes en bonne foi, prouvant leur pauvreté spirituelle et se compromettant. En effet, pendant vingt ans, les Soviets n’ont certainement pas liquidé tout le monde éduqué dans la culture pré-soviétique, n’ont pas automatisé et mécanisé les esprits et l’intelligence du citoyen faisant de lui une marionnette de la clique gouvernementale, pour laisser en des territoires récemment occupés des hommes imbus de culture anticommuniste. Sous les Soviets, tout homme capable de dire « cogito » (je pense) est destiné à être liquidé, à être arrêté, comme ils disent par euphémisme ;
4) même les activistes communistes. Les autorités soviétiques emploient à leur égard une tactique et une façon d’agir tout particulières. Les chefs communistes étaient certainement persuadés qu’ils deviendraient les autorités du pays après l’entrée des Soviets. En réalité, ces derniers se sont conduits envers eux de la manière suivante : au début, ils ont profité de toute l’organisation communiste, se servant d’espions et de provocateurs pour les arrestations en masse ; dans la suite, les personnes les plus actives ont été liquidées par des condamnations aux travaux forcés ou de longs séjours en prison.
5) À Tcheliabinsk, ayant déjà été remis en liberté, je rencontrai un fameux agitateur communiste de Wilna qui, après l’entrée des Soviets, avait été nommé juge-procureur. Heureux de notre rencontre, il me raconta beaucoup de choses sur la réalité soviétique, soulignant qu’il l’avait imaginée de façon bien différente. Comme conclusion de notre conversation, il me pria gentiment d’intervenir auprès de notre délégation pour qu’on lui délivre un passeport polonais. Tout en étant depuis nombre d’années communiste et « patriote soviétique », il me dit, d’un ton de parfaite résignation : « Savez-vous, Monsieur, qu’ici pendant toute la vie, l’homme est menacé par l’épouvantail de la liquidation indépendamment de ses idées favorables ou hostiles. Je suis déjà au seuil de la folie à force de ne savoir jamais ce qui pourra m’arriver demain. » Et il n’y a pas de quoi s’étonner : dans le régime soviétique, tout homme qui pense est de trop.
Dans la « katorga » de Vorkouta Komi RSS, je parlai assez longuement avec un monsieur de trente ans, un prisonnier naturellement, fils de L., ex-membre du « Gouvernement temporaire communiste polonais à Bialystok en 1920 ». Lorsque je lui demandai : « Frère, qu’en penses-tu donc à présent ? Est-ce que nous n’avons pas eu raison, nous socialistes, dans nos jugements sur le communisme ? », il me répondit, d’un ton d’homme las : « Qui donc pouvait prévoir que cette idée aurait engendré un monstre pareil ? » ;
6) criminels. Les Soviets ont élargi la signification du mot délinquant commun en le nommant « bytovik » (ce qui signifie : de la vie quotidienne). Ce mot comprend tous les délits communs à partir du vol de cigarettes jusqu’au brigandage professionnel.
Il vaut la peine de faire remarquer qu’il n’existe pas d’État où le vol soit puni aussi sévèrement qu’en Russie soviétique et, en même temps, qu’il n’existe pas d’État où le vol et les tromperies soient aussi largement répandus. Mais personne ne s’en étonne : tant que la société profite de ce vol systématique par l’échange de choses illégalement appropriées, personne ne réagit. Dans la vie soviétique, il existe une espèce d’échange qui s’appelle « blat » ; ce genre de commerce remplit toutes les cellules de la vie soviétique, l’argent ne représentant pas une grande valeur et ayant un faible pouvoir d’achat. La plus grande partie des articles s’obtient par ce « blat ». Puisque chez les Soviets il y a de tout, mais pas pour tout le monde.
La classe supérieure privilégiée est composée en Russie des rangs gouvernementaux qui ont accès aux richesses du pays, et des rangs de ceux qui exercent cette espèce de « blat ». Il peut arriver qu’une personne, pour une raison ou une autre, perde ce droit : « les amis » alors, désirant montrer avec peu d’effort leur droiture, simulent une affaire et cette personne est liquidée. Les prisonniers de cette espèce constituent la plus grande partie des « bytovik ». À cette catégorie appartiennent aussi des voleurs et des bandits qui s’appellent « ourki » et forment presque une classe fermée avec leurs idéologies de prisonniers et avec une psychologie qu’on ne peut trouver qu’auprès des Soviets.
En ce qui concerne les citoyens polonais, militaires ou politiques, nous pouvons résumer comme suit les raisons de leur emprisonnement.
En 1918, d’après le point de vue bolchévique, la marche communiste vers le centre de l’Europe a été ralentie par la résurrection de la Pologne, qui profita de la faiblesse provoquée en Russie par la guerre civile. L’État polonais est une organisation contre-révolutionnaire ayant pour but la lutte contre la Russie soviétique. La Russie soviétique est un état anti-territorial de prolétariat international et elle a donc le droit de juger chaque citoyen de notre pays étant contre le communisme.
Ainsi tous les citoyens polonais qui s’occupaient de questions sociales, politiques, économiques, ont dû signer, lors de leur arrestation, un avis par lequel ils étaient informés qu’ils étaient jugés pour activité contre l’État et ceci tout en étant des citoyens d’un autre pays.
J’ai rencontré dans un pénitencier un nombreux groupe de personnes du Schutzbund autrichien qui avaient cherché leur salut dans la Russie soviétique contre la terreur de Dollfuss. Elles avaient été reçues par de grands banquets et des comices et, après avoir été introduites dans les différents clubs de travailleurs, petit à petit elles furent emprisonnées et condamnées pour espionnage en faveur de l’hitlérisme. Elles furent tellement maltraitées qu’elles signèrent à la fin une déclaration par laquelle elles avouaient être des espions, en qualité de citoyens soviétiques.
Comme la guerre continuait encore, on n’osa pas commencer le procès contre nos hommes, qui furent toutefois condamnés par contumace par l’« Ossoboie Soviestchanie ». Par contre, dans les cas où ils ont réussi à avoir des éléments pour les accuser d’appartenir à quelque organisation fondée déjà pendant l’occupation, les Russes ont commencé le procès judiciaire dont le résultat a été une condamnation pareille à celle qui fut infligée par l’« Ossoboie Soviestchanie » ou encore plus grave.
Les membres de plusieurs organisations secrètes furent battus sans miséricorde, torturés, affamés, et enfermés dans des caves où il était impossible de ne pas tomber malade. Pour réussir à extorquer d’eux les fausses déclarations nécessaires à la sentence, les autorités soviétiques se servaient des moyens de tortures. Les interrogatoires avaient lieu pendant la nuit, jusqu’à l’épuisement physique et psychique des interrogés.
Le fait suivant permet de juger de la valeur morale du personnel judiciaire même dans les grades de capitaine à colonel : une femme, juge d’instruction, interroge un jeune homme de dix-sept ans de notre cellule et lui dit : « Si tu ne révèles pas les noms de tous les membres de ton organisation, tu ne verras jamais plus de tes yeux. » Les femmes s’occupant de l’instruction ne se distinguaient pas des hommes dans l’usage des plus vilains mots.
Seule une personne qui a passé par les jugements de l’autorité soviétique peut se rendre compte des déclarations qu’elle réussit à extorquer aux condamnés.
Quelques exemples :
1) Je demandai au médecin en chef du pénitencier (prisonnier lui aussi) pourquoi il avait été condamné ; il me répondit tranquillement : « Parce que je suis un espion. » Comme je m’étonnais et le priais de ne pas se moquer de moi, il me dit « qu’il avait signé lui aussi cette déclaration », en ajoutant : « J’ai essayé de ne pas la signer, mais ils ont torturé ma femme pendant si longtemps qu’ils lui ont cassé l’épine dorsale et elle a signé la déclaration comme quoi j’étais un espion allemand ; moi-même j’ai été tellement battu sur la nuque avec les revolvers que tout ce qui arrivait m’était indifférent.
2) Le deuxième médecin du camp (un Juif allemand), qui avait cherché asile dans le paradis soviétique, fut arrêté à Moscou au temps où Iejov était commissaire pour les Affaires intérieures. Il fut moins battu parce qu’il avait déjà su en prison que tout étranger devait signer la déclaration d’être un espion et que, s’il refusait cette signature, il serait tué au cours du procès. Il vaut la peine de souligner à ce propos que rarement en Russie on mettait en liberté un étranger ; les réfugiés, dans le meilleur des cas, étaient naturellement envoyés dans le nord, pour « posielenie » (l’exil).
3) Un professeur de l’école polytechnique de Moscou au temps des tsars, homme de 62 ans, spécialiste en expériences sur le charbon, fut condamné a 25 ans de prison parce que, soi-disant, il avait vendu les secrets des expériences scientifiques aux industriels des États-Unis et il dut signer lui-même cette déclaration. À la suite des tortures subies pendant le procès, il était arrivé à un tel point d’épuisement qu’il dit au juge : « Je signerai tout ce que vous voudrez. »
4) Le médecin en chef d’un autre camp reçut en 1933 le 1er prix pour l’organisation de l’hygiène scolaire. Ayant été arrêté quelques jours après, il signa la déclaration suivante : « Le travail exécuté par moi et qui a été récompensé par le 1er prix a servi à cacher mon activité trotskiste. »
La masse ne fait pas grand cas en Russie soviétique des déclarations et ne fait pas de différence entre les condamnations à cinq ans ou à trente. Tout dépend du jugement par lequel on envoie les gens en prison. Un « bytovik », c’est-à-dire un criminel commun, garde encore l’espoir de revoir le monde hors de la prison, tandis qu’un condamné politique, suivant l’article 58, ne réussira plus à retourner dans le monde, pas même s’il a eu une sentence de trois ans seulement. Voici un exemple caractéristique. Un Russe, remplissant ma fiche (lors de mon arrivée au pénitencier), me dit : « Quel dommage que vous ne soyez pas un criminel ! Vous auriez pu faire ici une bonne carrière, mais avec l’art. 58 vous n’irez pas très loin. »
Tout ceci démontre clairement combien les autorités soviétiques tiennent à l’anéantissement de toute la génération qui a consciencieusement commencé sa vie avant la révolution bolchévique.
Quarante millions de personnes sont en prison en Russie soviétique et ou elles sont tuées ou bien elles finissent leur vie comme des esclaves employés pour coloniser des terrains inhabitables, pour construire des conduites et des chemins de fer ; à cause des conditions très mauvaises du climat, tôt ou tard elles finissent par mourir.
Le niveau de préparation et d’intelligence des juges eux-mêmes est très bas. Ils n’ont qu’un seul schéma pour chaque projet de loi, toujours pareil : les mêmes questions, les mêmes remarques et les mêmes invectives désagréables. Mais, ce qui est encore plus important, on ne sent pas même en eux la conviction profonde de ce qu’ils font. Pendant un de mes interrogatoires, ayant déjà remarqué l’indifférence complète du juge d’instruction, je lui demandai : « Dites-moi sincèrement : croyez-vous qu’un officier remplissant ses devoirs de citoyen soit un contre-révolutionnaire, et que les accusations qui me sont adressées soient basées sur la vérité ? » Je reçus la réponse suivante : « Si j’étais une personne privée, je traiterai autrement cette question, mais à présent vous êtes un prisonnier et je suis le juge. » (1636 – L. J, 48 ans, médecin dentiste.)
« ... Je rencontrai à Arkhangelsk pour la première fois des délinquants russes et je vis parmi eux plusieurs Juifs, surtout des personnes âgées et cultivées, recrutées parmi les professionnels, rappelant, par leur piété et leur formation, les vieux temps pré-soviétiques. Ils avaient été tous condamnés pour contre-révolution. Les raisons suivant lesquelles les gens sont arrêtés sont absolument ridicules et ingénues, ainsi que le démontre le fait suivant : dans un camp de travail je rencontrai une femme qui avait été condamnée à 10 ans parce qu’en cousant, elle avait dit : « Quel fil horrible ! ». Cela avait suffi pour définir ses fautes comme contre-révolutionnaires. » (10586 – G. H, Juif, né en 1918.)
b) Si des photographies de personnes emprisonnées sont trouvées auprès d’un individu, on l’arrête de nouveau.
« ... Pour comprendre la réalité russe et la société en Russie soviétique, il faut se rappeler qu’il existe là-bas un groupe de personnes qui mènent, relativement, une très bonne vie. Ce sont les personnes fidèles au parti communiste : deux millions de membres et environ le même nombre de candidats. Le fait d’appartenir au parti assure, dans la plupart des cas, le plus haut rang social. Il n’existe presque pas de bureau dans lequel ne travaille un membre du parti en position de contrôle, qu’il ait ou non des certificats professionnels. Dans les hôpitaux, par exemple, où des dizaines de médecins travaillent, le directeur est un jeune homme ou une jeune fille qui vient de sortir de l’organisation du Komsomol. Les chefs des différents instituts sont, sans exception, des membres du parti qui ont le plus grand souci de leurs associés. Leur rétribution est relativement élevée ; ils ont des maisons spéciales, des magasins réservés à eux, et ainsi de suite. Seuls les membres de l’NKVD jouissent d’une vie meilleure que la leur. Sans un certificat de l’NKVD il n’est pas possible, comme on le sait, d’être admis dans le Parti. L’organisation de l’NKVD est parfaite, elle observe et travaille partout.
Les nécessités matérielles sont très grandes, mais il y a aussi des nécessités spirituelles : une personne venant de l’étranger ne trouve pas d’air pour respirer. Si vous avez reçu de Russie des lettres signées par des noms inventés, il ne s’agit pas d’une chose faite par plaisanterie ; mais plutôt par crainte. Une femme, à laquelle je pouvais me fier, me dit un jour : « N’apporte pas avec toi des photographies ; s’ils trouvent parmi elles la photographie d’une personne emprisonnée, ils t’arrêteront de nouveau. » (12465 – Notes d’un Juif exilé.)
c) Il envoya une pétition à Staline et fut déclaré irresponsable.
« ... Nous décidâmes d’envoyer un télégramme à Staline le priant de bien vouloir changer notre résidence à cause du climat et de modifier nos conditions de travail.
Le télégramme parvint à la poste d’Aldan : il fut expédié par Monsieur Wassernarth de Vienne, qui se rendait à l’hôpital et qui avait déjà derrière soi le camp de concentration allemand de Orchen.
Peu de temps après, ils ouvrent une enquête pour savoir qui avait envoyé le télégramme, qui avait donné l’argent nécessaire, si la décision avait été prise dans quelque réunion, et ainsi de suite. Il fut alors évident que le télégramme avait été arrêté par l’NKVD local – Wassernarth prit toute la faute sur lui et fut déclaré irresponsable, je ne sais pourquoi. » (10593 – K. M., fonctionnaire de l’État).
d) « ... ils travaillent un peu pendant quelques années, ils meurent ensuite tout seuls. »
« ... Chez nous, dans la société culturale soviétique, il n’y a pas de prisons, de pénitenciers, ni de chaînes, comme dans l’Occident pourri. » Et voici une impérieuse déclaration, cyniquement sincère, d’un des plus grands chefs enkavudistes : « Pourquoi les fusiller improductivement du moment qu’avec une légère coaction ils travaillent quelques années et meurent ensuite tout seuls ? »
Nous avons pu nous convaincre par nous-mêmes et en peu de temps, dans les tenailles d’un régime fou, que les limites les plus proches de la bonté d’âme (« dobroduscie ») orthodoxe sont depuis des siècles le sadisme et la cruauté ; à cause de cette « légère » coaction, des millions d’hommes sont morts.
Ils exploitent l’énergie potentielle des personnes jusqu’au dernier effort et jusqu’au dernier souffle. On commença « culturellement » depuis l’assignation d’un pain blanc jusqu’au bain, aux « sanobrabotka 29 » et au linge propre : comme début c’est beaucoup. Par une sorte de coquetterie, présentée avec la grâce d’un ours, les bolchéviques ont aussi créé, au début, des commodités et une espèce de confort, suivant leur point de vue. Suivant notre mentalité et par rapport aux conforts que nous avions laissés chez nous, tout ceci était tout simplement pitoyable. » (13476 – J. S., 41 ans, ingénieur du génie).
e) « Condamnations sans code » – Responsabilité collective.
« ... Composition hétérogène des prisonniers et différences remarquables entre eux à tous les points de vue. Nationalité : polonaise, russe, ruthène, tartare, ouzbek, allemande, anglaise, finlandaise, lithuanienne, roumaine, et je crois qu’il n’y en a pas d’autres.
Délits : à partir des plus terribles reprises de justice (des cas d’assassinats réciproques avaient lieu la nuit) jusqu’aux nommées « tchlen siemi », c’est-à-dire femmes, mères et filles de personnes arrêtées et condamnées parce que accusées du délit prévu aux paragraphes 58 et 54, comme parents de prisonniers politiques.
Quelques prisonnières politiques avaient été condamnées à dix ans de travaux forcés pour avoir entretenu une correspondance avec leurs familles résidant en Pologne. Des femmes de diplomates avaient été emprisonnées rien que pour avoir été à l’étranger (avec leurs maris). » (353 – N. W., née en 1909, institutrice).
f) Chacun a le droit de refuser de servir son pays. (Caractère international du droit bolchévique.)
« ... La question de notre arrestation était traitée comme un acte de défense légitime sociale et de l’État contre des parasites, combattants pour le régime bourgeois, contre-révolutionnaire et exploiteurs du peuple.
Un discours de ce genre-ci était généralement tenu aux personnes arrêtées : « L’Union Soviétique n’est pas comme votre régime brutal qui torture les gens en prison ou les enferme pendant de longues années ou les condamne à mort. L’État des Soviets a une culture, ne tue pas les personnes, mais les fait, par un travail honnête, devenir des éléments utiles ; pour nous, en effet, la prison n’est pas une peine, mais nous y enfermons les accusés seulement pour l’instruction et envoyons les condamnés (nous ne tuons pas, en général : les peines de mort sont rares ; quoique notre code les prévoie, notre sage X. accorde la grâce) aux beaux camps de travail où ils travaillent et gagnent et ceux qui produisent mieux sont remis en liberté avant les autres. » On entendait toujours et partout de tels discours stéréotypés. Ils apprenaient par cœur les petites formules et les répétaient tous à chaque occasion, à partir des dirigeants jusqu’aux gardiens de prisons des rangs les plus bas. Puis, « notre constitution », « notre culture », « notre bonté », « notre mission historique de libération du monde », étaient répétées sur les tons les plus différents.
Les interrogatoires avaient lieu de façons bien différentes ; parfois affables d’une manière exagérée, parfois avec des menaces, et assez souvent avec des coups et des tortures. Ils interrogeaient souvent deux ou trois personnes en même temps pour que celle qui devait répondre n’ait pas le temps de réfléchir au moment où les réponses respectives étaient consignées.
Les sujets sur lesquels ils interrogeaient étaient : le service militaire, la connaissance de personnes et de familles de militaires, la participation à la guerre contre les bolchéviques, et à d’autres guerres, les décorations reçues, le travail civil, l’appartenance au LOPP 30, à la Société des Combattants de réserve, des Fusiliers 31, et ainsi de suite ; toutes ces choses étaient rigoureusement considérées comme une menaçante activité politique contre-révolutionnaire. Ils entrevoyaient une inquiétante activité politique dans le champ international rien que dans l’appartenance à l’Union Internationale des Congrès des Communications.
Si, par-dessus le marché, l’accusé avait été souvent à l’étranger et avait des amis et des connaissances étrangères, il n’y avait plus de doute qu’il ne fût un dangereux espion international ; d’ailleurs, quelle autre chose en dehors de l’espionnage aurait pu attirer cette personne au delà de la frontière ? Les juges d’instruction étaient profondément convaincus ne pouvait y avoir d’autre raison de voyager en dehors de celle de l’espionnage et au cours des interrogatoires ils insistaient avec acharnement pour avoir les adresses des amis et des connaissances à l’étranger, car il était aussi très important d’acquérir des mérites en s’emparant d’un grand nombre d’adresses de citoyens destinés à être emprisonnés le jour où la « victorieuse révolution des travailleurs et des agriculteurs » se serait finalement emparée du reste de l’Europe.
Ce système, et la prévoyance de ce genre de travail préparatoire, évidemment dictée par les chefs de l’NKVD se révélaient dans presque tous les interrogatoires par lesquels je suis passé, une vingtaine environ. Ayant dans mon dossier divers documents personnels, ainsi que des lettres, des photographies, etc., les différents juges d’instruction et procureurs qui ont traité mon cas rivalisaient entre eux pour inventer toujours de nouvelles questions insidieuses sur toute ma vie passée jusqu’au moment de l’arrestation. Bien qu’il soit difficile de décrire exactement tout dans la courte relation présente, je résumerai quelques passages de l’accusation dont je fus l’objet.
1) Espionnage : effectué on ne sait pour quelle raison ni contre qui. Je fus soumis à plusieurs interrogatoires pour élucider cette question ; par conséquent, de très longues questions : où avions-nous étudié les langues étrangères, moi et mes amis, pendant combien de temps, avec qui, etc., etc. Finalement, en formulant l’accusation finale, ils ne maintinrent pas l’incrimination d’espionnage qui m’avait été faite.
2) Lutte active par les armes contre le régime soviétique : la participation à la guerre 1919-21. Ils me posèrent des questions sur les combats, sur les décorations, et revinrent sur le nombre des Russes que j’avais tués : un juge parla pendant deux heures sur ce sujet. Puis, il déclara tout d’un coup : « Mais nous avons des preuves qu’en 1939 tu as tué à Léopol quelques-uns des nôtres ; te souviens-tu du « monastir » d’Élisabeth ? » Étonné, je garde le silence pendant un moment et lui, soudain : « Est-ce que tu avoues ? » et il commence à écrire le procès-verbal. Ma réponse fut : « Si vous avez des preuves, montrez-les et dites-moi qui a été témoin. » Une fois la digression close, on ne me demanda plus rien à ce sujet.
3) Appartenance à des organisations hostiles : par exemple, la Ligue de la Défense Antiaérienne (LOPP), la Ligue Navale et Coloniale, l’Union des Fusiliers, l’Association des membres polonais du Congrès des Communications, le Syndicat Professionnel des Travailleurs intellectuels, des Industriels du Pétrole, etc.
Ils faisaient des enquêtes sur le but de ces associations pour connaître « la raison pour laquelle elles combattent », « les moyens dont elles se servent pour opprimer les gens », et, par rapport à cela, ils se mettaient à m’interroger sur des questions de service de ce genre : « Combien de personnes avais-je ordonné d’arrêter », « à combien de personnes avais-je enlevé le pain », « si j’avais été à la démonstration du premier mai » et « pourquoi pas » ; « pourquoi ne travaillais-je pas dans l’union des travailleurs » et « pourquoi n’avais-je pas promis de prendre part aux grèves et avais-je activement combattu cette tendance ». Mes réponses ne donnèrent évidemment pas satisfaction, car soudain, ayant terminé l’acte d’accusation, ils qualifièrent mon activité comme étant socialement dangereuse et nuisible.
4) Avoir servi dans des organisations ennemies, en qualité d’officier de l’armée polonaise et de « serviteur du capitalisme ».
Un juge d’instruction m’expliqua d’un ton grave que chacun a le droit de refuser de servir son pays. À ma demande, si un citoyen soviétique avait aussi ce droit, et si leur constitution le prévoyait, il me répondit : « Chez nous, c’est bien différent ; ceci est l’Union Soviétique et chacun est heureux dans notre famille populaire : tais-toi d’ailleurs, canaille fasciste, ça ne te regarde pas. »
5) Un sujet spécial était celui de mes opinions et mes conceptions politiques. Je faisais semblant de ne pas comprendre ce qu’ils voulaient savoir et ainsi ils n’ont pas réussi à tirer des conclusions à ce sujet. Jusqu’à la fin de l’instruction (août 1940), les rapports sur les procès-verbaux ne donnaient évidemment pas des résultats satisfaisants, puisqu’ils revenaient toujours au même sujet, mais ils n’ont rien pu savoir en plus de ma déclaration que « je serai toujours Polonais tant que je vivrai, je ne peux pas me déguiser en communiste et je crache sur mes camarades, qui ont mis l’étoile rouge par opportunisme ». À la fin, un vieux procureur de Poltava s’est mis à m’interroger :
« Lisais-tu les journaux ? » Réponse : « Oui. »
« Quelle idée t’es-tu faite de la situation politique européenne ? »
« Aucune. »
Avec dépit : « Comment est-il possible qu’un homme intelligent soit aussi bouché ; ceci est punissable ; nous vous apprendrons à respecter l’autorité ; tu cesseras de te moquer de nous ; dis-moi quelles sont tes convictions politiques. »
« Aucune. »
Après cette réponse, il me renvoya en prison pour quatre heures (dans les sous-sols de l’édifice de l’NKVD). Vers minuit ils m’emmenèrent de nouveau devant lui.
« Est-ce que tu parleras ? »
« De quoi ? »
« De la politique. »
« Non. »
Un long moment de silence ; puis :
« Connais-tu l’Espagne ? »
« Oui. »
« Qu’est-il arrivé là-bas ? »
« Je n’y ai pas été. »
« N’as-tu pas lu les journaux ? »
« Je ne me rappelle pas. »
« Quoi ? Tu ne te souviens pas de l’Espagne et de la guerre qui y a eu lieu ? »
« Quoi ? Oui. »
« Alors, qu’est-il arrivé là-bas ? »
« Ah, oui, là-bas aussi les Allemands ont combattu contre vous ! »
Réaction terrible : il devint rouge comme une betterave, les yeux hors de la tête. Il s’approcha de moi, menaçant, les poings levés, gémissant : « Les Allemands sont à présent nos alliés. Nous avons les mêmes buts et sommes unis par l’amitié. »
Depuis ce jour ils terminèrent l’instruction ; je crois leur avoir beaucoup gâté l’humeur. Dans les audiences suivantes ils ne touchèrent plus aux sujets politiques et ne m’interrogèrent plus sur ces questions. ». (6032 – M. K., né en 900.)
g) La loi recule.
« Qui étais-tu et de quoi t’occupais-tu ? » Espionnage et trotskisme.
J’ai été accusé d’après les articles 72, 74, 76, 80 « b » du code pénal de la RSS de la Russie Blanche pour les raisons suivantes :
1) j’étais propriétaire d’une ferme assez grande, c’est-à-dire « pomiechtchik » ;
2) pour action anticommuniste ;
3) en qualité d’organisateur et de membre d’organisations fascistes ;
4) parce qu’appartenant à l’administration autonome et en qualité de chef d’une commune, et enfin,
5) parce que j’étais légalement en possession d’armes de chasse et de petit calibre.
La sentence me fut lue le 6.XII.1910 à Vitebsk. Voici le texte : « L’Ossoboie Soviestchanie de Moscou, après une suffisante preuve de faute, arrête : d’après l’art. 71 du code de l’URSS, C., né en 1903 de famille de fermiers, propriétaire, doit être condamné pour activité anticommuniste, adhésion au mouvement fasciste, pour avoir pris part à l’association autonome territoriale et pour exploitation de la classe ouvrière, en qualité de propriétaire fermier, à huit ans de camp correctionnel de travail dans les régions lointaines de l’URSS. »
À ma demande si je pouvais en appeler à un tribunal supérieur, ils me répondirent que je pourrais le faire seulement du camp de travail et pas avant qu’un an se soit écoulé.
Pendant tout le temps de ma captivité, c’est-à-dire du 26.X.1939 au 31.I.1941, je n’eus aucune relation avec ma famille, cela n’étant pas permis. » (1380 – Ch. J.)
« ... Je fus arrêté à S. le 21 mars 1940 sous les accusations suivantes :
a) Organisation POW 32 (des insurgés, d’après la terminologie de l’NKVD) ;
b) Diffusion et propagande antisoviétique dans le domaine scolaire ;
c) Exercice des fonctions de président du district de la commission électorale à « Sejm 33 » en 1938 ;
d) Service volontaire dans la campagne de 1920 ;
e) Exercice des fonctions d’instructeur dans l’LOPP dans le champ des Entreprises industrielles à H. ;
f) Pour le discours tenu le 3 mai 1939 à S. sur un ton nettement antisoviétique ;
f) Pour m’être moqué de l’Union Soviétique en interprétant le sigle SSSR de la manière suivante : « Le sucre coûte cent roubles » (Sakhar Stoit Sto Rublei). »
(1317 – P. R., 42 ans, directeur d’école.)
« ... L’expropriation et l’anéantissement de la propriété privée recommencèrent, ainsi que la nationalisation et la fermeture des églises. Les individus dangereux furent arrêtés ; il suffisait d’être un membre des « Fusiliers » ou bien que le père fût un officier polonais, ou qu’il appartint à la classe des commerçants. La mentalité soviétique était faite de telle manière que lorsqu’on occupait trois pièces on était considéré comme appartenant à la « bourgeoisie ». Pour être engagé dans n’importe quel travail, il était nécessaire d’avoir des origines prolétaires.
J’ai rencontré plusieurs Juifs exilés et déportés par les Soviets aux camps de concentration. Un de ceux-là, un dentiste qui travailla avec moi, fut condamné à dix ans parce qu’il avait été en Mandchourie avant la guerre. Un autre parce qu’il correspondait avec sa sœur au Japon. La raison pour laquelle les Juifs polonais ne recevaient pas de lettres de leurs parents ou connaissances en Russie est donc très évidente. » (10562.)
« ... Je fus témoin d’une véritable tragédie de quelques familles juives qui furent persécutées seulement parce que le père, paraît-il, avait un tout petit débit de tabac avant la guerre ; de là les enkavudistes étaient parvenus à la conclusion que c’était mi invalide de guerre et avait donc combattu en 1920 contre les bolchéviques 34. Non seulement le père fut condamné, mais avec lui sa femme, ses enfants et aussi les parents les plus éloignés. » (10583 – L. W, né en 1916, étudiant en médecine – Juif.)
« ... Le système initial de l’enquête était très simple. Un officier, un lieutenant-major 35, demandait où j’étais né, ce que je faisais, de quoi s’occupait mon père, si j’appartenais à l’OZN 36, au BBWR 37, à la Démocratie Nationale, etc. S’ils arrivaient par hasard à trouver quelqu’un appartenant au PPS 38 ou bien, dans le cas des Juifs, au « Bund 39 », pour ces personnes les choses se passaient bien mal. » (6118 – M. T., né en 1904, employé de banque – Juif.)
« ... Dans les prisons judiciaires d’Akmolinsk ils isolaient généralement les Polonais entre eux et envoyaient le moins possible de prisonniers dans les cellules, lesquelles étaient d’ailleurs très nombreuses. Toutes les nationalités existant en Russie étaient représentées dans ces prisons, mais comme les Soviets employaient des méthodes de délation et de renseignement, les prisonniers se méfiaient uns des autres, gardant le silence et ne parlant pas entre eux.
Dans les prisons judiciaires, les hommes étaient traités comme des gamins de rue ; on déversait des torrents entiers de mots russes, on employait les méthodes les plus variées pour les faire fléchir physiquement et moralement. J’ai passé là-bas les jours et les nuits les plus épouvantables de ma vie en contact avec le libertinage rouge-asiatique, étant donné surtout que mon vieux père et mon frère étaient enfermés dans d’autres cellules. Nous étions accusés d’espionnage pour la Pologne et la Grande-Bretagne, d’activité antirévolutionnaire et d’avoir préparé des insurrections armées en cas de guerre contre la Grande-Bretagne. Ils nous battaient souvent dans les prisons pour que nous ne fussions pas à même de sortir de là avec toutes nos forces et ils continuaient à nous enchanter par les formules de Marx et de Lénine. » (355 – J. L., 33 ans.)
« ... Une femme, Démétria Dobrenko ; originaire de Bucovine, en prison déjà depuis 1936, était avec moi, dans la cellule. Dans l’espoir d’un avenir meilleur, étant communiste, elle avait franchi la frontière de la Bessarabie, désirant travailler en URSS comme idéaliste. Elle s’était enfuie parce qu’elle avait déjà été condamnée quelques fois en Roumanie pour activité communiste. Lorsqu’en 1910, les bolchéviques occupèrent la Bessarabie, ils arrêtèrent une de ses collègues qui était passée avec elle de Roumanie en Bessarabie, pour servir l’URSS. Les deux amies se rencontrèrent en prison. L’étonnement et le désappointement de la collègue furent énormes, car elle avait entendu, de ses propres oreilles, une transmission de radio Moscou dans laquelle on annonçait que Démétria Dobrenko avait été décorée pour son activité et avait obtenu une charge importante en URSS. Par contre, il résultait maintenant que la Dobrenko avait été arrêtée immédiatement après avoir franchi la frontière et n’avait jamais été remise en liberté. » (11660 – G. J.)
h) « Progoul » – Sabotage du travail. – (Aspect économique de la justice bolchévique).
« ... Le chef de la propriété collective nous emmena un jour dans une forge voisine et nous demanda combien nous voulions pour la lambrisser et la badigeonner. Il fallait extraire de l’argile, porter de l’eau, faire un gros lambrissage sur les murs et les niveler. Nous étions six femmes ; en calculant que le travail aurait duré pendant une semaine, nous demandâmes 200 roubles. Le chef ne voulait en donner que cent ; nous arrivâmes jusqu’à 150, mais il ne voulut pas s’engager et nous refusâmes le travail. On nous envoya toutes devant le juge, sauf moi, qui avais un doigt en suppuration, et je me rendis à d’autres travaux. Nous n’avons pas réussi à comprendre notre faute ; du moment qu’il nous avait été demandé combien nous voulions, nous pouvions le dire tranquillement. Ma fille et d’autres femmes furent condamnées au payement des 15 % de leur rétribution mensuelle au profit de l’association artisane. La pauvre H., qui parfois ne pouvait pas se contenir et avait prononcé quelques mots bien vrais, eut un traitement spécial et fut condamnée à deux mois de prison. Comme les prisons n’existaient pas dans le lieu où nous étions, elle fut envoyée comme une grande délinquante à Petropavlovsk. Ce fut bien pénible et triste car elle laissait trois petits enfants. » (11711 – Sz. M., propriétaire.)
« ... Assistance médicale, hôpitaux, mortalité ; j’ai déjà parlé de l’assistance médicale : elle était fournie gratuitement en principe, mais les médicaments étaient très chers et chacun devait se les procurer tout seul. Ceux qui avaient de la fièvre pouvaient être exemptés du travail, mais comme la femme médecin et l’hôpital étaient à Aja 40, celui qui tombait malade à la ferme, ne pouvant pas être exempté du travail, était puni pour « progoul » et beaucoup de femmes allèrent en prison pour cette raison pour deux ou trois mois. » (78 – B. W. T, né en 1908, employé.)
« ... Les ateliers artisans furent incorporés dans l’« artel » et chaque propriétaire, bon gré mal gré, fut obligé d’entrer dans cette association avec ses outils de travail et de travailler, comme cela se passe, toujours chez les Soviets, suivant les règles. Les règles étaient de ce genre : on fixait pour chaque ouvrier un minimum de travail à exécuter, sans cela l’NKVD, s’occupait de lui, l’accusant de sabotage au travail. » (10557 – G. H., né en 1915.)
« ... Nous recevions pour ce travail 100 grammes de pain noir ; on nous racontait que si nous travaillions bien, nous recevrions des vaches à lait et des chevaux. Pour des moutons perdus ou pour quelque chose qui était propriété de l’État, nous étions menacés de prison ou d’incrimination de « progoul ».
Ils commencèrent à arrêter les jeunes garçons, les emmenant avec eux et torturant encore davantage leurs familles, les emmenant travailler à 140 kilomètres au loin. Les enfants furent mis dans des orphelinats où on leur arracha leurs petites médailles et où ils furent battus et torturés.
... Il semblait que personne ne nous eut défendu de nous arrêter en groupe devant les baraques et de lire les journaux, mais l’NKVD arrivait à s’apercevoir aussi si quelqu’un disait un mot de plus. Les délateurs fuyaient notre compagnie et allaient, comme des loups, loin du troupeau. On nous fit observation et rapport. Une nuit, soudain, deux hommes furent pris et emmenés eu prison. Félix Mrugalski, colon de la région de Sarny, fut appelé en justice pour refus de travail et parce qu’il « simulait toujours d’être malade ». Il fut jugé et immédiatement emmené à Gorki. Il partit en juillet 1911 et ne retourna pas même le jour où toute la population polonaise du pays s’en alla vers la liberté.
Le garde-forestier S., ayant refusé de travailler, fut battu par un milicien et si quelques ouvriers ruthènes n’étaient intervenus, il l’aurait a son tour fort frappé quoiqu’il fût un homme résigné et nerveux. Il fut arrêté pendant trois jours. Ce milicien ne se fit pas scrupule de gifler une femme enceinte seulement parce qu’elle retournait du « kolkhoz 41 » au lieu de travailler. » (10719 – J. P., 30 ans, garde-forestier.)
« ... Mes frères aînés commencèrent à travailler non pas dans le kolkhoz mais aux élévateurs. Ils devaient parcourir sept kilomètres par jour à l’aller, sept au retour et faire huit heures de travail. Mon frère aîné s’enrhuma et n’alla pas travailler ; le chef du kolkhoz ne voulut pas lui délivrer la justification. Deux semaines plus tard, ils le condamnèrent à six mois de prison et depuis on n’eut plus de ses nouvelles. « Comme une pierre dans la mer. » La même chose arriva à ma mère, mais pire encore, car je crois qu’elle ne vit plus désormais. L’été suivant, nous eûmes une cabane meilleure, mais il fut bien plus dur pour nous car mon frère aîné Édouard manquait parmi nous ». (11532 – né en 1927, fils d’artisan.)
« ... Le 23 juillet 1940, c’est-à-dire peu de temps après notre arrivée, fut publié un arrêté suivant lequel on ne consentait à aucun travailleur de prendre congé de sa propre initiative ; la chose n’était possible qu’au moyen d’un certificat de la commission médicale qui craignait de le délivrer ; car l’NKVD l’en rendait responsable. La loi du « progoul » était terrible. Si quelqu’un arrivait en retard au travail, de cinq minutes seulement, il était puni la première fois par une retenue de 25 % sur sa rétribution pendant quelques mois, la seconde fois par la prison.
Je travaillais avec une femme de huit mois de grossesse, à peine sortie de la prison où elle avait été enfermée pour « progoul » ; son mari était tombé malade, elle l’avait emmené à l’hôpital (où il était mort) et n’ayant pu retourner à temps au travail dans les mines, elle avait été condamnée à quelques mois de prison. À présent, bien que la naissance de l’enfant fût proche, elle était obligée de travailler pour ne pas être de nouveau accusée de « progoul ».
Les « bulletins », exemption du travail, pendant un jour ou deux, étaient la seule aide. On se faisait venir une forte température en buvant de l’essence (s’il n’y avait pas de fièvre il n’y avait pas de maladie) afin de pouvoir un peu se reposer du travail.
La chose la plus terrible était la sensation d’esclavage ; il fallait travailler là où l’NKVD le voulait. C’était encore assez facile pour nous de le supporter, car nous gardions toujours l’espoir de la fin de la guerre et du retour chez nous, mais les Russes et les Tartares se consumaient là-bas déjà depuis vingt ans, sans espoir d’un sort meilleur. À force de raconter dans les réunions que tout serait amélioré, personne n’y croyait plus. Ils se conduisaient en général envers nous avec pitié, disant : « Vous êtes tombés, vous aussi, dans le piège de l’Union Soviétique. » (10741 – W. A.)
CHAPITRE II
COMMISSARIAT DU PEUPLE POUR LES AFFAIRES INTÉRIEURES
1. NKVD ET GESTAPO
« ... Des visites fréquentes de la part de la Gestapo qui demandait des renseignements sur mon compte me firent comprendre qu’il était nécessaire de me sauver, je décidai donc de m’enfuir.
Je projetai de rejoindre Wilna, ville dans laquelle j’avais beaucoup de connaissances parmi les commerçants et les collègues industriels, étant donné qu’à ce moment-là elle était occupée par les Lithuaniens. Je jugeais opportun de m’établir à Wilna temporairement, jusqu’à la fin de la guerre.
Le 22 novembre 1939, je m’enfuis avec ma sœur et mon beau-frère, emportant avec moi des restes de marchandises enlevées aux Allemands, marchandises que je remis ensuite à trois agriculteurs de la campagne près de Malkinia pour qu’ils les transportent.
De quelle façon je réussis à parcourir les quatre kilomètres de la gare de Malkinia à la frontière, c’est une histoire d’enfer difficile à raconter, mais la vraie géhenne commença quand je fus arrivé à la terre de personne.
La « terre de personne » ! Ce territoire était un secteur de 600-700 mètres où 700-800 personnes environ étaient amassées, depuis quelques semaines déjà ; 90 % de Juifs, échappés à la surveillance allemande. Ces gens étaient condamnés à mourir de faim et de froid, car ils ne pouvaient pas songer à retourner ni à pénétrer davantage à l’intérieur, à cause du cordon militaire soviétique qui, à tout instant, tirait pour intimider.
Nous étions malades, tout mouillés sur ce territoire rendu humide par les pluies d’automne, nous serrant les uns contre les autres sans que les Soviets « humanitaires » daignassent nous donner un petit morceau de pain ou de l’eau chaude. Ils ne laissaient pas même passer les gens de la campagne environnante qui désiraient faire quelque chose pour nous maintenir en vie. En conséquence, nous laissâmes de nombreuses tombes sur ce territoire.
Une délégation de détenus s’adressa pour cette raison aux Soviets ; ceux-ci répondirent : « Nous avons l’ordre de la part des autorités supérieures de ne pas permettre que quelqu’un vienne chez nous et nous n’avons aucun droit, pas même celui de vous donner un peu d’eau ! »...
« ... Je peux affirmer que les personnes qui retournèrent chez elles du côté des Allemands avaient raison car l’NKVD, à aucun point de vue, n’était meilleure que la Gestapo allemande, avec la différence que la Gestapo abrège le temps en tuant les gens, tandis que l’NKVD tue et torture d’une manière bien plus terrible que la mort, de sorte que celui qui réussit par miracle à fuir ses griffes reste invalide pendant toute sa vie... » (11015 – L. C., Juif, né en 1906, commerçant en vêtements.)
« ... Je ne vois aujourd’hui aucune sorte de différence entre les buts des Allemands et ceux des bolchéviques. Les méthodes de nos deux voisins sont toutefois bien différentes. Les bolchéviques sont hypocrites et rusés et il est plus difficile de se défendre contre eux dans l’opinion de tout le monde. Ils ont essayé et élaboré leurs méthodes et ils auront toujours le même but. Aucun d’eux n’y renonce, car ils veulent construire un grand État unitaire et ils savent parfaitement tout ce qui manque encore pour en arriver là. Ils ont de la volonté, de la fermeté et du talent politique, un manque de scrupules et une foi barbare en leur raison. Quand cela faisait leur affaire, ils firent semblant de défendre les Polonais et les Ukrainiens contre les Allemands ; ils lancèrent plus tard les Ukrainiens et les Juifs contre les Polonais qui les inquiétaient ; ils armèrent ensuite les Polonais contre les Ukrainiens, les pauvres contre les violences des riches, qui n’existaient déjà plus, et ainsi de suite, puis encore tout le monde contre les mensonges de la religion, etc.
Les fonctionnaires de l’NKVD, les plus stupides et les plus fanatiques, devenaient furibonds si on leur rappelait qu’un État polonais « avait existé ». Ils disaient que rien de pareil n’avait jamais existé, seule l’ancienne Russie des tsars avait existé, ainsi que l’Allemagne et l’Autriche. Ils s’efforçaient de détruire la foi et la religion, sans toutefois y réussir. Ils anéantirent complètement la propriété privée, les organisations sociales philanthropiques et tout ce qui aurait pu entraver l’État dans ses efforts de russification, par le contrôle et la terreur la plus épouvantable sous les aspects les plus différents. Toute leur conception en ce qui concerne l’organisation sociale russe est un faux ; chacun peut facilement se rendre compte qu’il s’agit du nivellement de toutes les différentes populations de l’Union Soviétique. Là où ils commandent, la propagande de l’idéal communiste est faible et stupide, car ils font tout seuls la contre-propagande, chose dont tout le monde peut se rendre compte, et eux les premiers. Tout cela n’a aucune importance pour eux, car ils recourent à la terreur. Se méfier des gens, même des enfants, de sa femme, des amis, est une condition nécessaire de vie pour chacun, et elle paralyse tout. » (1645 – M. S. S., ingénieur, né en 1897.)
2. L’NKVD DANS LES TERRITOIRES OCCUPÉS.
LA RÉVOLUTION ADMINISTRÉE
« ... Le travail nocturne est une caractéristique des Soviets. L’NKVD agit beaucoup plus activement sous le voile de l’obscurité. Toutes les déportations et les arrestations avaient lieu la nuit et, quand il s’agissait aussi de nous transporter ailleurs, on nous déplaçait et on nous réunissait la nuit. Dès que nous fermions les yeux, épuisés par les difficultés de la journée et par le voyage, un commandement odieux retentissait : « Rassemblez-vous. » Nous devions alors nous lever à regret du grabat que nous avions préparé péniblement et de nouveau marcher ou être transportés ailleurs et nous asseoir sans espoir sur les sacs, ignorant tout de notre sort futur. » (6080 – B. W., 24 ans, étudiant de l’Académie des Beaux Arts.)
« ... L’appareil de l’administration soviétique avançait tout de suite derrière les lignes de l’armée rouge pour organiser le nouvel ordre social, politique et gouvernemental dans les territoires occupés. Il y a des conceptions, des phénomènes qu’aucun esprit élevé dans les traditions de la culture européenne occidentale ne pourra jamais comprendre.
La vie soviétique a beaucoup de ces phénomènes ; l’NKVD en est un ; c’est une institution encore peu connue par le monde civilisé ou, plus exactement, connue sous d’autres noms. L’NKVD est le Commissariat du Peuple pour les Affaires Intérieures (Narodni Kommissariat Vnutriennykh Diel) héritier de la Tcheka et de la GPU.
L’NKVD s’occupe en réalité de faire la révolution dans les territoires occupés. Elle est aidée dans ce rôle par les organes de la propagande soviétique : autres phénomènes également étranges et insolites. L’originalité de cette propagande se base sur des tromperies sans précédents, sur d’impudentes altérations de faits, sur des mensonges énormes.
Ces organes, l’NKVD et la propagande, commençaient tous deux leur travail sur un ordre de Moscou. Ils établissaient l’autorité soviétique dans les territoires récemment occupés : l’armée rouge ne jouait que le rôle de facteur de la force à l’ombre de laquelle l’NKVD effectuait ses crimes.
La politique des autorités d’occupation (lois NKVD) visait à mettre le plus tôt possible les territoires occupés au niveau de la sombre réalité de la Russie Soviétique.
Les autorités soviétiques se rendaient compte que le citoyen polonais n’est pas un petit agneau docile, que les expressions de « Gleichschaltung » ou d’uniformisme lui sont étrangères, qu’il connaît ses devoirs de bon citoyen et ne renonce pas aux lois, qu’il ne veut pas de l’atmosphère de domination et de terreur, qui règne en Russie Soviétique, et qui est tout à fait naturelle au point de vue des Russes.
Cet attachement profond de la société polonaise à la vraie démocratie, à la liberté des citoyens, cachait un grand danger pour les occupants et surtout pour l’armée rouge.
Les soldats de cette armée, nourris de ridicules enfantillages de la propagande soviétique qui leur représentait la Pologne comme le pays de la misère la plus épouvantable et des répressions les plus brutales, voyaient, une fois la frontière polonaise franchie, quelque chose de bien différent, perdaient le reste de confiance qu’ils avaient encore à l’égard de la propagande et des autorités de leur pays, et la Pologne leur semblait, en comparaison de leur lugubre patrie, le pays des fées. Un officier de l’NKVD téléphonant de Wilna à sa femme, résidant à Moscou, lui disait : « Viens, ici ce n’est pas une vie, mais tout simplement un beau conte. »
Dans un autre cas, la femme d’un officier de l’armée rouge, en allant rejoindre son mari, acheta à Moscou sept kilos de pommes de terre, car elle avait entendu par radio que la famine et la disette sévissaient dans les régions occupées. Quel ne fut son étonnement lorsqu’arrivant à Léopol elle put acheter 100 kilos de pommes de terre au prix de 11 roubles, tandis qu’à Moscou elle les avait payées, quelques jours avant, 5 roubles le kilo, au marché public.
Les jeunes officiers de l’armée rouge commençaient à s’enfuir avec des habits bourgeois au delà du Bug, vers l’Allemagne.
Il était donc très important, dans l’esprit des autorités soviétiques, d’abaisser le plus tôt possible les territoires occupés au niveau de la misère soviétique et de serrer dans une puissante tenaille l’esprit des citoyens « libérés ». Ils décidèrent de détruire tout élément dangereux qui donnerait lieu à la moindre suspicion dans sa façon d’agir vis-à-vis des autorités soviétiques.
Le détruire, ainsi qu’ont été biologiquement anéanties en URSS la classe intellectuelle tsariste et la classe des propriétaires, ainsi qu’ont été anéantis les minimistes et les trotskistes.
L’NKVD, immédiatement après son entrée en Pologne, commença son « service » d’arrestation en masse de tous ceux qui avaient dans leur milieu quelque influence défavorable pour les occupants. Ainsi furent arrêtés les fonctionnaires de police, les juges, les procureurs, les officiers, les employés de l’administration civile, les membres actifs de tous les comités et associations ou des partis politiques, sans excepter ceux de gauche (c’est-à-dire le « Blind » et le Parti Socialiste Polonais), des colons, militaires, gardes forestiers, etc. On arrêta des Ukrainiens, Juifs, Russes blancs et Polonais, n’épargnant que les Allemands à cause du flirt rouge-brun momentané.
Ces arrestations se suivaient sans interruption. Les cellules des vieilles et des nouvelles prisons regorgeaient de monde ; des convois de prisonniers partaient continuellement vers le centre de la Russie et, quand les uns étaient arrivés à la péninsule de Kola ou de Kamtchatka, d’autres avaient déjà pris leur place dans les cellules.
Trente ou quarante personnes étaient entassées dans des cellules de 3 × 4 m. : elles dormaient tour à tour, faute de place pour s’allonger. Malgré l’isolement rigoureux des prisonniers, les gens savaient ce qui se passait et tremblaient en attendant du matin au soir que l’NKVD frappât à leur porte.
Pour ne pas être seule dans son œuvre de destruction, l’NKVD engagea des aides en créant la milice rouge ouvrière et paysanne, formée d’un petit nombre de pseudo-communistes de l’endroit et – la fin justifie les moyens – d’éléments criminels voleurs communs et gens de mauvaise vie.
Pour gagner temporairement les individus indécis, indifférents ou hostiles par rapport à l’État polonais, la propagande bolchévique diffamait tout ce qui était polonais, éveillait le chauvinisme des minorités populaires, excitait la haine de classe et l’NKVD ne soulevait pas d’objections contre les violations de la loi et l’arbitrage des éléments irresponsables.
On ne peut certainement pas douter qu’il ne s’agît d’un travail conscient et dans un but bien déterminé car, déjà pendant l’hiver de 1939-1940, commencèrent les véritables arrestations de ces « communisttes », membres de la milice.
En 1940, les déportations en masse de la population commencèrent dans des proportions encore inconnues dans l’histoire du monde. Les dates du 10/11, 13/IV, 29/VI-1910 et la semaine du 14 au 22 juin 1941 (juste avant le début de la guerre germano-russe) furent des dates tragiques pour les populations résidant en Pologne orientale.
La raison de ces déportations était que la population déportée avait auparavant connu une autre vie et une organisation différente de celle des Soviets, qu’elle avait été élevée dans la liberté au lieu de la tyrannie, et que la comparaison entre la démocratie et le bolchevisme était nettement défavorable. Mais les personnes ayant des idées pareilles sont supprimées par le stalinisme.
Tout le monde fut emmené : paysans ukrainiens et Russes-Blancs, classe instruite polonaise, Juifs enfuis de l’Allemagne, Tchèques, Autrichiens, clergé catholique et rabbins juifs, hommes, femmes, enfants, aussi la jeunesse universitaire, des écoles moyennes et préparatoires, enfants encore trop jeunes pour fréquenter l’école, les enfants au maillot, les bébés encore au sein de leur mère.
Même cette terreur folle ne réussit pas à briser la compacité et la résistance nationale polonaise. Les organisations secrètes polonaises et ukrainiennes, agissant souvent en collaboration, furent actives pendant tout le temps de l’occupation, malgré les vides épouvantables formés dans leurs rangs par de nombreuses arrestations et malgré les cris inhumains des victimes enfermées derrière les barreaux des prisons.
Le 21 janvier 1940, une révolte de Polonais éclata à Czortkov ; le 10 novembre 1940, une révolte d’Ukrainiens à Zbaraz. Elles furent toutes deux réprimées dans le sang par l’NKVD et la population arrêtée dans les deux districts fut, presque tout entière, déportée au cœur de la Russie.
De nombreux actes de sabotage, des attaques à main armée contre les occupants, le mépris général et les sourires de commisération à l’égard de ces Russes asiatiques sauvages, qui se conduisaient en territoire polonais comme l’éléphant du proverbe dans un magasin de porcelaine, révélèrent admirablement l’esprit des « peuples fraternels libérés de la Russie-Blanche occidentale et de l’Ukraine occidentale ».
Les paysans ukrainiens et russes-blancs avaient compris, comme l’avait compris le prolétariat juif, quelle sorte de liberté apportaient ceux qui se nommaient libérateurs.
Ce que disaient les Ukrainiens, « les Polonais, pendant vingt ans, ont cherché à nous apprendre à être Polonais et n’y ont pas réussi ; les bolchéviques, par contre, nous ont faits Polonais en deux mois », se comprend parfaitement comme résultat de cette tyrannie et de cette constriction, inconnues dans tout autre pays ». (15077 – K. Z., étudiant universitaire.)
« ... Le 22 novembre 1039, je fus arrêté par le garde-frontière soviétique parce que j’avais cherché à traverser le San non loin de la ville de Sanok. Je fus emmené dans la prison de Lesko où je restai deux semaines environ. Puis les Russes me déplacèrent de Lesko à Sambor dans les vieilles prisons polonaises. Comme en ce moment-là ils effectuaient des arrestations en masse tant de personnes cherchant à franchir la frontière que parmi les populations des villes, en peu de temps les prisons furent bondées.
Environ 80 % des prisonniers étaient des fugitifs des territoires occupés par les Allemands. Le motif de leur arrestation était l’accusation de passage illégal de la frontière. Le restant des prisonniers était constitué de personnes de l’endroit arrêtées parce que considérées par l’NKVD comme éléments dangereux pour le régime socialiste.
Les prisons étaient pleines de personnes de toutes nationalités : Polonais, Juifs polonais, Allemands, Tchèques, Ukrainiens, Romains, Ituzules, paysans de la Russie Carpatique. Ces derniers, comme il résulta des conversations que j’eus avec eux, étaient venus dans le territoire polonais occupé par l’URSS lorsque s’était répandue parmi eux la nouvelle que les autorités soviétiques partageaient, au profit de la population indigente, la terre et le bétail des plus grandes fermes des zones occupées. Tous furent ensuite déportés dans le centre de la Russie et travaillèrent durement dans les camps de concentration. » (6847 – R. R., né en 1913, docteur en droit, employé de l’État.)
« ... En ce qui concerne la nationalité des prisonniers, il y avait des Ukrainiens, des Juifs, des Russes et des Tchèques à côté des Polonais...
« ... Les délits des prisonniers étaient généralement bien différents : avoir exercé quelque fonction dans l’administration polonaise, avoir employé ou, dans le langage des bolchéviques, avoir exploité la classe des travailleurs (par exemple : un propriétaire de restaurant était arrêté pour avoir engagé des garçons), avoir prononcé une parole imprudente (par exemple : « nous trairons les filateurs »), huit ans de camp de travail. » (1717 – K. W., 42 ans, inspecteur d’école.)
« ... Je fus arrêté le 14 juin 1941, à Wilna, au moment des arrestations en masse, pour avoir refusé de prendre la nationalité soviétique. Ils arrêtèrent en même temps ma femme, mon enfant de trois ans et mon beau-père. À la gare, ma famille fut mise dans un autre train et envoyée vers le Kazakhstan septentrional, où ma femme fut obligée de travailler dans les « kolkhoz ». (1243 – B. P., né en 1901, ingénieur.)
3. DIVIDE ET IMPERA
« ... Nous souffrions tous littéralement la faim, le froid et la misère. Ils n’épargnèrent ni les vieillards, ni les femmes, ni les enfants.
Au début, ils m’emmenèrent à Léopol, Poltava, Kharkov. À Poltava, 280 personnes environ se trouvaient dans la cellule, parmi lesquelles des Polonais, des Juifs, des Ukrainiens de la Pologne et Ukrainiens de la Ruthénie transcarpatique : toutes ces personnes avaient quitté leurs résidences dans les campagnes pour venir profiter du prétendu partage des propriétés polonaises.
Dans la cellule, ils ne faisaient que voler ou tâcher d’enlever par la force les vêtements aux Juifs et aux Polonais. Vu que les protestations n’aboutissaient à rien, les Juifs se mirent d’accord avec les Polonais pour ne pas rentrer de la promenade et protester ainsi contre la non-intervention des autorités des prisons dans tout ce qui était en train d’arriver. La garde de la prison en fut avertie et fit rentrer tout le monde dans la cellule, par la force. Les Russes des Carpates continuèrent toutefois leur activité (encouragée, évidemment, par les Soviets). D’autre part, pour mettre fin à ces incidents qui augmentaient chaque jour en proportion, les Juifs et les Polonais décidèrent de s’opposer par la force, jusqu’à la fin. L’occasion se présenta le jour suivant et il y eut une bagarre qui se termina par une victoire nette et décisive pour nous.
Les Soviets furent satisfaits de cet incident ; ils recherchèrent les coupables et ils les tranchèrent enfin.
Les Juifs et les Polonais sont coupables, car ils possèdent plus que le nécessaire en vêtements, tandis que les Ukrainiens sont nus et sans rien. « Chez nous, tout le monde doit être égal. »
« Vous avez l’obligation de donner une part de vos affaires à vos camarades pauvres. » (10576 – S. J., né en 1919, employé privé.)
« ... Quoique le régime soviétique tende à la liquidation complète de tout nationalisme intérieur et de tout ce qui a un rapport quelconque avec celui-ci, il y a encore aujourd’hui, vingt ans après l’incorporation du Kazakhstan et de l’Émirat de Boukhara (l’Ouzbékistan actuel), de forts courants en faveur de la liberté. Après les fameuses batailles de Korsak et les défenses héroïques de chaque « aoul » (bourgade) que les rouges ne purent occuper que grâce à leur supériorité numérique, l’Union réussit à venir à bout de ce difficile problème politique. Les steppes sans limites des Kirghizes, l’Ouzbékistan montagneux, avec ses populations vivant de leur culture, de leur religion imprégnée d’islamisme, habituées à servir le bey, s’étendaient devant eux. La population de ces régions est constituée de pasteurs tagitiens et kirghizes. Comme d’habitude, dans ce cas aussi, l’Union chercha par la ruse à exciter ces populations et à les opposer entre elles pour qu’elles s’affaiblissent d’elles-mêmes et qu’il en résulte un chaos général. Grisés de vodka soviétique, avec la perspective de butins de guerre, les gens sauvages et affamés du Kazakhstan septentrional, plus exactement les Kirghizes, se lancèrent contre les campements, les villages, les villes méridionales, en brûlant et en détruisant tout ce qu’ils pouvaient ; ce qui facilita énormément la conquête de ces régions. L’Union, voulant souligner les services rendus par les Kirghizes du Nord, les nomma Kazakh « pour les combats héroïques », et nomma toute la région « Kazakhstan ».
« Avec le temps, on gagne en expérience », dit un vieux proverbe. S’il s’agit des Kazakh, ils l’ont évidemment déjà acquise. Lorsque je revenais du travail commun pendant les journées suffocantes du mois de juillet, sans eau et avec le « repas soviétique », j’entendais des chansons orientales tristes et plaintives, qui s’harmonisaient drôlement avec les maigres chameaux et avec les « kenfaika » déchirées, qui rappelaient les temps passés, où les Kirghizes étaient libres et qui comparaient ces temps-là avec les temps présents.
Voici un passage d’une de ces chansons :
Quand j’étais Kirghize, j’avais du bétail, de foin et de l’eau ;
Tous les chemins de la steppe m’appartenaient ;
Des temps mauvais et de disette sont maintenant arrivés.
Oh ! Allah, toi seul change ceci ! Allah, reviens !...
Leur sort était certainement terrible ; libres en apparence, ils ne pouvaient pas changer de résidence ni vivre comme des nomades. Les conditions les plus mauvaises pour les Kirghizes étaient dans les mines. Près de notre sovkhoz, il y avait des mines d’or, où surtout les Kirguises et les Polonais étaient employés dans les travaux souterrains. La plupart des indigènes, après avoir travaillé pendant quelques mois, tombaient malades, atteints de tuberculose. Les conditions de vie du mineur étaient mortelles : nombre de cas le démontrait. Le paiement était moindre, et dépendait de la quantité d’or extraite. Quoiqu’aujourd’hui tout le monde semble être rouge et qu’il n’y ait aucune ligie, il y a toutefois, en plusieurs endroits, des ligues contre les envahisseurs qui ont enlevé la liberté, chère et nécessaire pour vivre ». (11750 – J. M.)
4. LA DÉLATION COMMENCE DÉJÀ À L’ÉCOLE
« ... À mon avis, les faits suivants ont un effet très négatif dans l’école soviétique :
L’ingérence continuelle des agents du parti dans la vie de l’école. Dans chaque école soviétique travaillent deux personnes qui ne doivent pas être des maîtres, mais qui représentent le parti. Ce sont les chefs de l’organisation des jeunes pionniers, pour les classes inférieures, et de l’union des Komsomols pour les classes supérieures. Ces personnes travaillent théoriquement en collaboration avec les professeurs, mais en réalité elles travaillent derrière leur dos. Il suffit de se rappeler qu’une qualité nécessaire pour le travail du Komsomol scolaire (Union de la Jeunesse Communiste) est le coffre-fort pour les actes secrets, qui se trouve dans le bureau du directeur de l’école, mais dont la clé est gardée par le chef du Komsomol. Il y a aussi souvent des réunions secrètes des étudiants présidées par le chef du Komsomol, sans que les professeurs le sachent ni y assistent. Les Komsomols sont ceux qui décident du sort des professeurs. »
« ... La délation et l’espionnage constituent chez les Soviets un organisme qui travaille habilement et vite. Déjà dans les salles d’asile, les éducateurs incitent les enfants à observer et écouter en cachette leurs parents, en leur promettant des récompenses. Ils trouvent généralement un terrain très facile à travailler, car les enfants, pour un petit morceau de viande ou de sucre ou pour une jolie petite robe, sont prêts à tout, et de plus ils sont tellement affamés, tellement mal habillés que la moindre bêtise représente pour eux le plus merveilleux cadeau du bon Dieu (excusez-moi, j’ai été trop loin : le cadeau de bat’ko (papa) Staline). Il ne faut donc pas s’étonner que chacun ait peur de son ombre... » (11710 – S. I., étudiante.)
« ... Les Juifs doivent souffrir en Russie soviétique comme toutes les autres personnes ; ils sont tourmentés par la même faim ; ils doivent, eux aussi, travailler pendant toute la journée et pendant la nuit, faire la queue pour le pain...
Propagande antireligieuse parmi la jeunesse et les enfants. Il arrive parfois que les enfants mêmes se moquent des pratiques ou du sentiment religieux de leurs parents. Ils sont d’ailleurs formés à cela dans les écoles et incités à dénoncer leurs parents, puisque la religion est considérée comme une arme anticommuniste... » (10561 – G. I., né en 1905, assistant dentiste.)
« ... Les conditions de travail dans les écoles deviennent de jour en jour plus insupportables. Les jeunes gens ont compris que le maître dépend en grande partie des élèves, de leurs accusations. Toute parole maladroite peut perdre l’instituteur. Les élèves commencent à chercher à surprendre les conversations confidentielles entre les professeurs pendant les intervalles entre les leçons. Ces jeunes gens agissent surtout sur l’instigation des occupants... (10719 – P. R., instituteur dans les écoles publiques.)
5. ENGAGEMENT DE MOUCHARDS
« ... Pendant mon séjour dans le camp de concentration, je fus emmené, à peu près vers la mi-août de l’an 1941, chez le commandant de l’NKVD. Celui-ci m’expliqua les fonctions et l’autorité que l’NKVD exerce chez les Soviets, m’informant que non seulement l’État Soviétique, mais même au dehors la vie de chaque homme est dans ses mains. Après m’avoir répété que nous devions effacer à jamais de notre esprit la bourgeoisie de la Pologne et ses tuteurs qui seraient morts avec elle, après m’avoir menacé de m’envoyer à des travaux encore plus durs et de me supprimer, il m’offrit de faire partie des collaborateurs des autorités de l’NKVD. Ayant catégoriquement refusé, il m’ordonna de signer une déclaration comme quoi je n’aurais jamais répété à personne notre conversation. À partir de ce moment-là, je fus appelé chaque nuit ou toutes les deux nuits et je passai de trois à cinq heures environ dans le bureau du commandant ; le sujet était toujours le même ; ils m’accordaient quelques minutes pour réfléchir et je recevais ensuite des malédictions et la déclaration à signer. Vers le 10 février 1941, complètement épuisé par les durs travaux dans les bois pendant le jour et par les interrogatoires pendant la nuit, je déclarai ne pas être à même de continuer le travail, ne pas vouloir accepter, à aucune condition, de collaborer avec les autorités de l’NKVD, ajoutant qu’en ma qualité de soldat, de citoyen polonais et de citoyen étranger arrêté par les autorités soviétiques, je n’aurais pas même dû entendre des propositions pareilles. On me répondit qu’un travail comme le mien n’avait pas de sens, que chez les Soviets chacun doit travailler politiquement et on me donna deux autres déclarations à signer, l’une exprimant mon acquiescement à la collaboration, l’autre dénonçant une forte lutte contre-révolutionnaire. Je ne signai aucune des deux déclarations, je fus mis à la porte et emmené eu prison.
Après avoir été détenu pendant deux jours, je fus envoyé au lieu nommé « kordon », où je fus assigné aux travaux nocturnes de chargement des arbres. Je me trouvai là le jour du décret d’amnistie, c’est-à-dire le 5 novembre 1941 : à la suite de ce décret, je retournai au camp de travail où je me trouvais auparavant, avec l’intention d’entrer dans l’armée polonaise... » (6932 – C. M., 42 ans, contrôleur du Monopole Polonais des Tabacs, à K.)
« ... Les autorités de la prison et de l’NKVD de Rowne, après m’avoir gracié – ce que je n’avais pas demandé et qu’elles ont fait d’elles-mêmes – me proposèrent le 2 mai 1941 et à d’autres dates encore, de « travailler » pour les Soviets, sous réserve toutefois (attention bien gentille et délicate !) que ce « travail » serait dirigé uniquement contre les Ukrainiens. Comme je refusai catégoriquement, ils me cassèrent les dents, me lançant avec violence hors de la porte ; ils me défendirent de voir ma femme et me séparèrent des autres prisonniers, à la compagnie desquels je m’étais habitué, m’enfermant dans une cellule séparée. » (1717, K. W., inspecteur d’école, marié, prisonnier soviétique, condamné à la peine de mort et « gracié » par la commutation de la peine de mort à dix ans de réclusion.)
« ... Les délations étaient la plus grande plaie. Les Russes réussissaient naturellement à trouver des délateurs même parmi les déportés, surtout à la suite de pressions et de menaces. Les autorités s’adressèrent à une femme de Varsovie, déportée, qui travaillait dans le bureau, et la chargèrent de rapporter les réponses et les conversations des déportés aux autorités soviétiques compétentes. La femme répondit que les déportés se rendaient chez elle rien que pour des traductions, pour se faire rédiger des télégrammes, etc., etc., et, comme elle travaillait dans le bureau, ils évitaient de causer en sa présence. D’autres personnes acceptèrent toutefois d’écouter et de rapporter.
La délation était normale en Russie, même parmi les citoyens soviétiques. Un médecin, directeur d’hôpital, me raconta une fois qu’on s’était adressé à lui de la part de l’NKVD et qu’on lui avait ordonné de rapporter tout ce qu’il entendrait dans son institut. Il accepta, tâchant toutefois de ne jamais travailler tout seul dans une pièce, sachant qu’en la présence de deux témoins personne n’aurait eu le courage d’exprimer à haute voix ses idées et que, de cette manière, aucun provocateur ne viendrait le voir. Les délations commencent déjà dans la première classe de l’école. Dans le « comité de classe », qui s’occupe de différentes questions, on nomme à l’insu de tous les élèves de la classe un étudiant qui a la tâche de surveiller exactement ce qui se passe dans la classe et de rapporter au directeur de l’école tout ce qu’on fait ou dont on parle dans le comité... ». (J. B. D. – Extraits des « Notes d’un Juif fugitif ».)
« ... Deux semaines après, on m’appela de nouveau. Ils me placèrent dans la voiture des prisons et m’emmenèrent à l’NKVD. Une fois arrivé, ils me firent entrer dans une chambre bien meublée, dans laquelle un employé (avec le losange sur le col 42) était assis à un bureau. Celui-ci, à mon grand étonnement, me reçut d’une manière extraordinairement aimable, me fit asseoir sur le divan (au lieu de la chaise spéciale), m’offrit des cigarettes et commença à causer sur un ton « amical ».
Il me demanda si j’étais au courant de ce qui se passait dans le monde. Je crus nécessaire de ne pas lui cacher que j’avais connaissance de l’amnistie (nouvelle qui avait été apportée dans la prison par toute une bande de nouveaux détenus), je lui en parlai donc, me montrant étonné d’être encore gardé en prison.
L’employé sourit, appela par téléphone un civil et lui dit : « Notre ami (comme s’il s’agissait de moi) réclame la liberté. » Puis, s’adressant à moi : « Mais vous n’êtes pas militaire, pour entrer dans l’année polonaise ! » Je répondis que l’amnistie ne concernait pas seulement les militaires et que j’avais intention d’entrer dans l’armée en qualité de spécialiste.
Il me fit alors une leçon complète au sujet de l’importance du service de renseignements dans chaque État, au sujet de la nécessité de renseigner l’autorité sur ses amis et ses connaissances, ce qui se pratique couramment chez les Soviets et dont le manque fut la cause de la défaite de la Pologne (!).
Après cette leçon, il commença à faire allusion à une éventuelle collaboration de ma part avec les Soviets (voir NKVD). Je fis remarquer que j’ignorais de quoi il s’agissait, et je lui dis que bientôt le gouvernement polonais signerait un traité d’après lequel mois aussi, en ma qualité de Polonais, je considérerais l’URSS comme une alliée, avec laquelle je collaborerais loyalement.
« Mais vous pourriez peut-être travailler spécialement avec nous ? » me demanda le vieillard. « Cela dépend de la permission de mes Autorités. » « Quelles autorités », dit-il. « Le général Sikorski. » Il devint furieux à cause de ma réponse et ordonna de me reconduire en prison. » (12581 – P. J., 47 ans, ingénieur.)
6. LA TOILE D’ARAIGNÉE DES DÉNONCIATIONS
« ... L’NKVD ne s’occupait point de nous en ce qui concernait les conditions matérielles. À nos protestations, lorsque quelqu’un était trompé, sinistré ou expulsé du travail, ils répondaient par un sourire ironique : « Ce n’est rien, tu t’y habitueras ! (Nitchewo, prywykniesh !) » Par contre, ils s’intéressaient beaucoup à notre vie privée. Une fois, par exemple, un Russe fit un rapport au sujet d’une femme écrivain polonaise bien connue, Mme M. R., disant qu’elle était extraordinairement intelligente et qu’elle avait toujours « quelque chose à écrire » (des mémoires probablement ou quelque livre). Ils l’arrêtèrent immédiatement et on ne sut plus rien à son sujet. En outre, ils cherchèrent parmi les Polonais des acolytes pour en faire des mouchards de l’NKVD, mais naturellement ils n’en trouvèrent pas... » (290 – C. N., 19 ans, étudiant, célibataire.)
« ... La vie dans les territoires occupés par les Soviets était très dure et insupportable. L’homme se sentait une bête traquée. Personne ne pouvait jamais jouir d’un peu de tranquillité. Lorsque j’étais chez moi, je sursautais toutes les fois que la porte s’ouvrait et que quelqu’un entrait. Au travail, il fallait veiller à se conduire avec beaucoup de prudence en causant avec des collègues, car, de tout côté, on nous épiait et écoutait ; toute conversation avec un Russe était un interrogatoire, un jugement. Même dans les rues on n’avait pas de liberté. Au début de la journée, le premier sujet de conversation était de savoir si, pendant la nuit, on avait emmené des détenus, etc., etc. Il arrivait souvent qu’en sortant le soir avec un ami, quelques individus nous suivaient de près, d’une manière très évidente... » (11016 – E. C., professeur libre de musique.)
« ... Les rapports réciproques de solidarité et de collaboration n’étaient pas des meilleurs car, à cause de la terreur de l’NKVD, l’un se méfiait de l’autre. L’NKVD était renseigné sur tout le monde. C’est au cours de la nuit que les enquêtes avaient lieu ; elles se terminaient par la déportation des hommes au loin, dans le nord... » (10701 – M. W., 41 ans, paysan.)
« ... Pendant tout ce temps, l’NKVD ne restait pas inactive. Nous étions souvent convoqués chez les chefs, qui nous informaient que l’amélioration de nos conditions ne dépendait que de nous, qu’il suffisait seulement de devenir de loyaux citoyens de l’URSS. Étant donné que je faisais part du Komsomol, j’aurais eu aussi la possibilité d’aller à l’école de Moscou, par contre, je ne pouvais compter sur aucune amélioration, puisque notre séjour dans cet endroit était prévu pour au moins cinquante ans (les arbres dans les bois suffisaient pour longtemps).
Ils nous incitaient et cherchaient même à nous obliger, en nous menaçant de nous faire perdre notre place, à aller au club soviétique, aux réunions et à d’autres organisations de propagande, soit pour des fêtes soit pour des choses sérieuses. Ce qui, évidemment, aurait dû remplacer les vêtements et les aliments pour notre peuple... » (6079 – B. H., née en 1921, étudiante de l’Institut de l’État d’Arts plastiques.)
« ... Par rapport aux autres prisonniers, les médecins vivaient certainement mieux. Ils habitaient des logements séparés et ils avaient notamment des draps de lit et la possibilité de bien se laver et de donner leur linge à la lessive.
Ils profitaient de la nourriture de l’hôpital et ils étaient suffisamment estimés par les autorités des camps de travail.
Les patients « en liberté » leur faisaient souvent des facilités.
Naturellement, chacun de nous avait son tuteur en la personne d’un fonctionnaire de l’NKVD qui, ne comprenant absolument rien à la médecine, s’occupait cependant continuellement à ce que l’on ne donnât pas de soins aux prisonniers, nous entourait toujours d’un filet de mouchards, intentait des accusations et envoyait en prison ou dénonçait même au tribunal militaire, où les sentences les plus fréquentes étaient celles de la peine de mort... » (11196 – E. M., médecin.)
« ... Je fis connaissance, un jour, au cours de mon travail, d’une « zakloutchonna » c’est-à-dire une prisonnière soviétique. Elle comprit, en me regardant, qu’elle avait rencontré une bonne amie dont elle n’avait rien à craindre ; elle put donc exprimer toute sa haine et son chagrin.
Elle me dit : « Mon mari aussi fut arrêté, il y a huit ans. » « Pourquoi ? » lui demandais-je. « Parce qu’il refusait d’appartenir au parti communiste. »
« J’étais dans des conditions très difficiles, un de mes enfants était malade : dans un moment de désespoir, je m’écriai : « Si au moins la Russie pouvait se casser le cou et avec elle Staline le premier. » Ma voisine m’entendit ; je n’aurais jamais pensé pouvoir causer un pareil malheur. Ma voisine « destructrice » me fit emprisonner ; dans le cours de vingt-quatre heures, je fus arrêtée et emmenée par l’NKVD dans les prisons du pays.
Mes enfants sont restés là-bas à la maison, tout seuls, privés de leur mère, qu’ils ne reverront certainement plus, je crois ; je n’ai désormais plus de force et je travaille encore durement ; je n’ai plus de force et je ne peux plus travailler... » (11679. – C. I.)
« ... Le modeste salaire ne suffisait pas pour les nécessités plus élémentaires de chaque jour et l’enfant voulait encore manger. Par crainte de ce qui aurait pu lui arriver, elle décida d’accepter de travailler en qualité de femme de ménage à la poste. Sa constitution faible et maladive, le travail excessif (nettoyer 12 pièces), la très mauvaise paye (80 roubles par mois) ne lui donnaient pas de satisfaction.
Accablée par son sort, elle confie à une amie ses peines et ses préoccupations, lui exprimant sa crainte que le sort de son fils unique ne ressemble au sien et qu’il ne doive un jour mourir de faim, comme sa mère. Les paroles de plainte silencieuse se répètent toujours plus facilement, surtout auprès d’une personne de même classe, qui sent et pense de la même manière, et ces paroles ont des conséquences terribles. La lâcheté de la voisine pénètre sa conscience ; elle a peur d’elle-même, car elle se considère semblable à elle. Toutefois Tatiana agit contre l’Union ! Elle se rappelait souvent le temps des tsars et la Russie de ce temps-là, qui était un pays d’abondance. Elle s’étonnait de voir tant d’affamés alors que les champs de blé de l’Ukraine pouvaient produire une quantité de pain suffisante pour la Russie tout entière. Elle parlait des temps de misère extrême, lorsque les gens étaient arrivés à agir par famine d’une façon horrible, allant même jusqu’à tuer les enfants pour avoir de la viande.
Tatiana avait été témoin oculaire de la dégénération d’un père de famille, qui, mourant de faim et voulant survivre, avait tué son fils cadet. Ce spectacle était resté profondément gravé dans sa mémoire et elle le raconta à sa voisine.
Tatiana disait vrai, mais une vérité pareille ne devait pas être répétée sans peine de prison. L’amie l’accusa auprès de son mari, qui travaillait comme chauffeur dans la milice. Celui-ci la dénonça à son tour à son chef, pour propagande dangereuse de mécontentement, pour manque de confiance en l’Union Soviétique et parce qu’elle suscitait la terreur de la faim.
Ils effectuèrent une perquisition chez Tatiana, chez qui ils trouvèrent 8 kilos de farine, 3 kilos environ de sucre et de sarrasin et 2 kilos de lard. Ces provisions furent confisquées, tandis que Tatiana Ivanovna fut condamnée, par sentence du tribunal, à 10 ans de prison, peine qui fut ensuite commuée en 10 ans de travaux forcés... » (11706 – W. A., institutrice.)
« Une personne qui connaissait bien la Russie me dit un jour, il y a très longtemps, encore avant la guerre, que la Russie était le pays d’une sombre anecdote. J’ai pu le constater moi-même. Des prisonniers de la colonie travaillaient dans notre kolkhoz à la récolte du foin. La population du kolkhoz s’adressa à eux pour leur demander du pain et du pétrole ; elle leur enviait ce qui leur était donné à manger, tandis que nous ne recevions absolument rien.
Dans les kolkhoz, il n’y avait pas de pain, par contre, les chefs de l’NKVD et les autres dignitaires mangeaient des sandwichs au caviar. À des prix très élevés et en cachette, on pouvait acheter bien des choses dans ce pays de communistes luttant contre le capitalisme.
Les espions de l’NKVD surveillent partout les citoyens soviétiques. C’est le système qui s’appuie sur la terreur et sur la délation. Une de mes camarades, une Polonaise, déclara, en travaillant dans les camps, qu’il vaut mieux se pendre que d’être citoyen soviétique. Ses paroles furent rapportées, elle fut arrêtée et passa onze mois en prison. Elle travaillait à une machine qui lui arracha une main ; après l’amnistie, elle retourna chez elle, infirme ; c’était la meilleure et la plus active de nos ouvrières. » (11694 – M. M.).
« ... Date de l’arrestation : 23/I/1940, à Lubaczow, province de Léopol ; motif de l’arrestation : j’avais connaissance que des soldats soviétiques, une fois sortis de l’hôpital de Lubaczow, passaient du côté des Allemands, voulant ainsi éviter d’être envoyés sur le front finlandais. Parce que je n’en avais pas informé l’NKVD, je fus condamnée à dix ans de prison. Au cours du jugement, qui dura sans interruption pendant 48 heures, je fus plusieurs fois frappée au visage et, en conséquence, je perdis mes dents... » (11190 – W. H.)
7. PASSIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ
« ... Ayant été libéré par l’amnistie, je me rendis au sud, en chemin de fer. Je tombai par hasard dans un train où avaient pris place des soldats soviétiques : je les priai de m’emmener avec eux ; lorsqu’ils apprirent que j’étais Polonais, leur méfiance se dissipa. Ils me placèrent dans un wagon, parmi les chevaux qu’ils emmenaient avec eux. Assis sur une botte de foin, j’entamai une conversation avec ces soldats : je possédais trois paquets de tabac et deux pains, que « j’avais réussi à me procurer ». Je commençai à manger ; ils fixaient leurs yeux sur moi d’une manière tellement étrange que, malgré moi, je dus les inviter à manger quelque chose. Ils délièrent alors leurs langues. Ils étaient plus affamés que moi, plus affamés que les gens libres, car ceux-ci volaient, tandis qu’eux ne pouvaient pas le faire, portant l’uniforme et menacés d’une balle pour le moindre mouvement. On leur donnait 25 roubles par mois, 800 grammes de pain par jour, trois fois la soupe, pour le dîner un autre plat, l’uniforme, voilà tout. Ils servaient dans ces conditions pendant un certain temps ; ils étaient ensuite congédiés (je parle du service actif normal) et, en qualité de civils, ils allaient au kolkhoz, propriété collective administrée par un chef choisi parmi eux.
L’État donnait à un groupe de personnes, par exemple 300 familles, une pièce de terre qu’elles cultivaient ainsi que d’habitude, avec les travaux ordinaires de la campagne. L’État établit pour eux des règlements nouveaux. Le kolkhoz devait donner de chaque hectare de terrain une certaine quantité de pommes de terre, de blé, de grains, de viande, de champignons et de graines comme tribut (vu que les impôts n’existent généralement pas en Russie, ce qui est continuellement souligné par la propagande), et la quantité de ces produits était fixée par les autorités. L’imposition était faite de la manière suivante : si le terrain donnait une récolte de 100 kg., la contribution de l’État était de 150 kg., c’est-à-dire qu’il fallait ajouter 50 kg. à ce que le terrain produisait. Où les prendre ? Personne ne s’occupait des produits dont devaient se nourrir ceux qui travaillaient. Il s’agit là d’une chose dont personne ne se soucie. Il faut rester calme, sinon (des révoltes ont lieu dans les kolkhoz) un détachement de l’NKVD vient faire place nette.
Les soldats de l’NKVD sont obéissants, car ils sont bien payés et les prix sont pour eux particulièrement modérés. Le sucre, dont le prix normal est de quelques dizaines de roubles, coûte dans les magasins (si quelqu’un arrive à en avoir, après avoir fait la queue) 6 roubles et 20 kopecks, tandis que pour les enkavudistes il coûte 1 rouble et 50 kopecks : et le reste à l’avenant. Conclusion : il ne vaut pas la peine de travailler dans le kolkhoz. Personne ne gagne, puisqu’après avoir travaillé toute la journée, il est encore nécessaire d’ajouter les différences qui manquent pour atteindre la limite fixée, car la terre ne veut pas produire tout ce que Staline commande.
Liberté. Quel aspect avaient les réunions des travailleurs, c’est-à-dire les « meetings » ? Un fonctionnaire de l’NKVD nommé « koultrabotnik » ouvrait généralement la séance. Après lui deux ou trois travailleurs participant à la réunion prononçaient des discours, précédemment censurés par des fonctionnaires de l’NKVD ; puis, la résolution au cent pour cent (à l’unanimité), car celui qui aurait osé s’opposer aurait été emprisonné immédiatement. Un travailleur qui se serait permis de ne pas aller à la réunion aurait été privé du travail ou arrêté. » (10690 – J. T.)
« ... D’autres observations encore assez caractéristiques. Pendant mon séjour d’environ deux ans en Russie, je n’ai jamais rencontré un seul visage souriant, et ne parlons pas de chants, de jeux et d’amusements de ce genre qui se trouvent chez nous en Pologne, même dans les taudis les plus misérables. La population, lorsqu’elle aperçoit les enkavudistes, se cache ; on n’entend même plus un seul mot prononcé à haute voix. Je doute qu’il soit possible de dépeindre le désespoir, la tristesse, la désolation qui règnent dans ce « paradis ». Je m’étonnerai seulement si toute la population peut supporter encore pendant des années un enfer pareil, sans perdre la raison. Je m’explique ainsi sa patience : elle ne connaît pas une autre vie, car sinon un mouvement de désespoir se produirait certainement... » (10716 – B., sergent.)
« ... Les Ukrainiennes aimaient généralement leurs enfants et les élevaient dans l’esprit ukrainien. Le petit Ukrainien se rendait compte qu’il souffrait, comme ses parents, sans raison. L’esprit des Ukrainiens est triste et désespéré. Les gens parlent tout bas même de leurs affaires et vivent dans une atmosphère de conspiration continuelle. Je me rappelle que, me rendant dans une chambre ukrainienne, la propriétaire fermait chaque fois hermétiquement la porte et, me parlant à l’oreille, elle me demandait des nouvelles, sans cesser de regarder continuellement la porte, pour voir si quelqu’un allait entrer. Tout le monde est généralement empreint d’une résignation terrible faite d’apathie et de découragement. Nous nous disputions à chaque instant et nous ne pouvions pas admettre qu’il en serait toujours ainsi. Nous leur demandions comment ils avaient pu supporter une chose pareille pendant des années, et ils nous répondaient toujours de la même façon : « Vous aussi, vous vous y habituerez et vous crèverez aussi misérablement que nous. »
Une fois, tandis que je préparais la soupe sur des briques (nous préparions de cette manière notre repas) entre lesquelles brûlaient des broussailles, un déguenillé de la baraque s’approcha de moi et commença à me parler de ses malheurs, en disant pour finir : « Nous ne sommes plus des hommes : nous sommes devenus des animaux. »
Il y a généralement dans chaque baraque un mouchard payé par l’NKVD. Une jeune fille venait chaque jour dans notre baraque et s’asseyait, regardant de tout côté ce que nous faisions, ce que nous possédions ; mous fûmes avertis qu’il s’agissait d’une moucharde de l’NKVD. Par contre, si nous lui glissions dans la main quelques roubles, elle nous racontait en échange tout ce qu’ils combinaient, si une inspection devait avoir lieu, ou bien une visite de ces chers hôtes de l’NKVD. » (10745 L. K., étudiante.)
CHAPITRE III
SYSTÈMES D’ARRESTATION
1. ARRESTATION DANS LES HABITATIONS
« ... À 1 h. 30 de la nuit, entre le 13 et le 14 janvier 1941, je fus violemment réveillé dans ma demeure par l’irruption de deux fonctionnaires civils de l’NKVD, accompagnés d’un officier de l’NKVD même et d’un soldat de l’armée soviétique. Ils avaient tous des armes au poing.
Ils me placèrent droit contre le mur, les mains levées, tout nu, ne portant que ma chemise. Les deux fonctionnaires firent la perquisition, mettant tout sens dessus dessous et jetant mes affaires sur le plancher. Les ayant priés de me laisser mettre un manteau sur mes épaules et mes chaussures aux pieds, car j’avais froid, non seulement ils me répondirent par un refus, mais ils le firent suivre par des railleries et des injures de tout genre à mon adresse et à celle de la population polonaise toute entière.
La perquisition terminée, ils me concédèrent cinq minutes de temps pour m’habiller et pour rassembler mes affaires personnelles (un garde, montre en main, me disait continuellement de me dépêcher). Il me fut naturellement impossible, dans ces conditions, de prendre avec moi certaines choses personnelles, car j’eus à peine le temps de m’habiller... ». (6822 – L. S., 52 ans, mécanicien, marié.)
« ... À 5 heures 45, ce jour-là, un officier et un soldat de l’NKVD, accompagnés d’un membre de la milice ouvrière, un Juif polonais, arrivèrent dans la maison où j’habitais. Ils étaient tous armés. Après m’avoir fouillé, l’officier de l’NKVD prit les 60 roubles de mon portefeuille ; la perquisition terminée, ils emportèrent ma capote du régiment de montagne et la selle du cheval que je possédais en ma qualité d’officier.
Ils ne me permirent pas de prendre avec moi quoi que ce soit.
Ils m’arrêtèrent sans toutefois me dire pourquoi et sans me montrer un ordre d’arrestation édicté contre moi par le procureur.
Mon propriétaire fut arrêté avec moi, et ils avaient même l’intention d’arrêter le concierge de l’immeuble. Mais à la suite de mon intervention, lorsque je déclarai que le concierge n’était point coupable puisque je n’habitais l’immeuble que depuis le matin, ils le remirent en liberté. Par contre, le propriétaire et moi, nous fûmes emmenés en état d’arrestation.
En chemin, j’offris ma selle à l’officier de l’NKVD pour qu’il remît en liberté, en échange, le propriétaire. La transaction eut lieu par un milicien, et je réussis enfin dans mon but.
La situation de Léopol était tragique : des centaines d’autocars avec des vieillards, femmes, petits enfants, nourrissons et orphelins arrêtés étaient conduits par l’NKVD vers la gare. Par les rues Grodezka et Léon Sapieha passait un cordon de voitures chargées de prisonniers. Ils tendaient les bras vers moi en pleurant et parfois ils me saluaient, les larmes aux yeux. On m’emmena au commissariat de Marie Madeleine, puis au commissariat de la gare, dans la rue du Tribunal et, de là, aux prisons « Bryghidki », situées dans la rue Casimir le Grand, n. 24. » (0913 – J. K., major, 44 ans.)
« Je fus arrêté peur la première fois à Przemysl, dans les derniers jours du mois de novembre 1939. Étant assis à table, au restaurant « De la Tour », je remarquai, lorsque le local commença à se vider, un officier de l’NKVD qui était assis en face de moi. Mon repas achevé, je sortis de ma poche un carnet et je commençai à l’examiner. À un moment donné, l’officier en question me prit par la main, s’appropria de mon carnet et m’ordonna de le suivre. Il m’emmena à la caserne de la rue Mickiewicz, où il me confia à un serviteur avec lequel il parla pendant quelques minutes et qui, en me poussant, m’introduisit ensuite dans une petite pièce complètement vide, et ferma la porte derrière moi. De la même manière mystérieuse dont j’avais été arrêté, le lendemain soir je fus libéré, sans aucun interrogatoire ni aucune explication.
Je fus arrêté une deuxième fois à Léopol le 24-25 juillet 1940 dans l’habitation de la rue K., 35. Je dois faire remarquer qu’après le 13 avril 1940, c’est-à-dire le jour après l’emprisonnement des familles des officiers arrêtés entre le 8 et le 12 décembre 1939, avec les collègues nous surveillions bien de près les mouvements des bolchéviques et nous étions arrivés à la conclusion que, les jours où ils devaient faire des arrestations, ils entassaient des voitures dans la rue Zielona, devant l’édifice de l’NKVD (autrefois Assurances Sociales).
Ces jours-là, nous nous cachions et ne dormions pas dans les habitations où nous étions enregistrés, étant donné surtout que des bruits d’arrestations en masse dans la province circulaient à Léopol.
Le 24 juin, vers 9 heures du soir, j’étais passé près de l’édifice de l’NKVD pour observer, mais, comme il n’y avait aucune voiture, je me décidai à dormir chez moi. Vers 1 heure de la nuit, je fus réveillé par quelqu’un qui tapait violemment à la porte, en prononçant des injures en russe, pour que j’ouvrisse. Un collègue, qui vivait avec moi, alla ouvrir la porte et un officier de un « boïez 43 » et un milicien entrèrent avec des lampes et des revolvers à la main, accompagnés par le concierge. Ils nous ordonnèrent d’allumer l’électricité, vérifièrent ensuite nos noms de famille et commencèrent enfin les perquisitions. Ils examinèrent d’abord attentivement mes vêtements, qu’ils me firent endosser, puis ils fouillèrent dans toutes mes affaires, dans les valises et entre les draps de lit. Pendant la perquisition, je restai dans un coin, surveillé par le milicien, qui, parlant polonais, me disait ce que je devais emporter avec moi et de quelle manière je devais m’habiller. Tandis qu’ils perquisitionnaient, ils trouvèrent un monocle, qui les intéressa plus que toute autre chose et qui fut ensuite, pendant les interrogatoires, la cause de toute une série de questions et de soupçons divers. Ils enlevèrent en même temps tous mes documents personnels, plusieurs papiers, différentes notes et 340 zloty. La perquisition terminée, ils rédigèrent un procès-verbal et m’ordonnèrent de les suivre. Au dernier moment, le milicien me donna la valise qui était toujours prête pour toute éventualité, le manteau, et je fus emmené dans la rue. Le collègue avec lequel je vivais fut laissé tranquille, ils ne lui firent point de perquisition, et ne l’arrêtèrent pas. Ils ne le menacèrent même pas, mais la nuit suivante ils l’emportèrent aussi. Je le rencontrai dans l’armée, après avoir été libéré des « laguer ». (1214 – K. W., né un 1908, employé.)
2. COUPS DE FILET
« ... Le 18 septembre 1939 (après l’entrée de l’armée bolchévique à Ternopol, le 17.IX.1939), les autorités de l’NKVD postèrent dans les rues de la ville plusieurs patrouilles, qui arrêtaient tous les passants, les groupaient en des lieux préalablement déterminés, d’où elles les conduisaient ensuite au « Collège Ukrainien »...
Dans le courant de l’après-midi, 800 personnes environ furent rassemblées et conduites ensuite hors de la ville. Nous passâmes plus de 48 heures dans les camps sans manger ni boire. Le troisième jour, ils nous emmenèrent dans la cour des prisons de Ternopol, où ils nous laissèrent pendant 36 heures. Lorsqu’une pluie diluvienne commença à tomber, ils nous envoyèrent dans les cellules des prisons. Le jour suivant, ils nous donnèrent de l’eau chaude et un morceau de pain... » (1172 – K. S., 39 ans, employé.)
« ... Le 14 janvier 1940, tandis que j’étais au « Café Théâtral » (Léopol) pour le petit déjeuner, j’aperçus par la fenêtre deux automobiles avec des miliciens et des soldats de l’NKVD. Avant que l’automobile n’arrivât, ils avaient déjà bloqué la sortie. Dès qu’ils furent entrés dans le café, ils commencèrent à vérifier les documents. Parmi les 150 personnes environ qui se trouvaient dans le café, ils en emmenèrent près de 92. Nous fûmes tous conduits au commandement de la milice et, le lendemain matin, 23 personnes, moi compris, furent mises à la disposition de l’NKVD. » (1702 – H. A., marchand, Juif.)
3. EMBÛCHES
« ... Le lendemain matin, lorsque je partis de la ville de Krewo pour aller vers Smorgonie, à l’intérieur, avec l’intention de me cacher chez des amis, je fus arrêté dans le bois près de Krewo ; je fus entouré par quelques fonctionnaires armés de l’NKVD, parmi lesquels se trouvait aussi celui qui était arrivé la veille et qui montra clairement qu’il était un espion, car il parlait parfaitement la langue polonaise et connaissait très bien la région orientale de la province de Wilna. Une voiture, expressément préparée pour les « captures », était dans le bois. Ils me jetèrent d’abord sous la voiture et cherchèrent à m’extorquer quelques aveux. Après quelques vaines tentatives, ils me lièrent les jambes, craignant que je ne cherche à m’évader, me jetèrent dans l’automobile et m’emmenèrent au chef-lieu de Vileika, où je fus enfermé dans l’immeuble dans lequel travaillaient les autorités de l’NKVD de la région.
Là, sous mes yeux, ils sortirent un dossier contenant une liste de noms, parmi lesquels ils effacèrent le mien. Il s’agissait évidemment de la liste de ceux qui devaient être arrêtés. Au cours du jugement suivant j’appris que les membres mêmes de l’NKVD créaient les noyaux des organisations clandestines, pour attirer les gens qui auraient dû être arrêtés. » (1551 – D. J., 34 ans, employé du Trésor.)
« ... Au cours de la seconde moitié du mois de mai 1910 une commission allemande pour le rapatriement arriva à Léopol, occupée par les Soviets. Des centaines de milliers de personnes qui sentaient que le terrain n’était plus sûr, qui n’avaient pas de quoi vivre, faisaient la queue, jour et nuit, devant la villa située dans la rue Orzeskowa, attendant l’autorisation de rentrer dans l’autre paradis, où de meilleures conditions de vie leur étaient promises et, chose bien plus importante encore, où elles pourraient rejoindre leurs familles.
Poussé par la nostalgie de ma famille, que j’avais laissée dans le « Protectorat », et inquiet sur son sort, ne pouvant et ne voulant plus d’ailleurs être à la charge des amis chez lesquels j’habitais et qui vivaient dans des conditions épouvantables, je décidai d’aller, moi aussi, dans ce « Protectorat ». Je pourrais là-bas me rendre compte de l’état de ma famille, me rassurer sur son sort, puis je franchirais la frontière hongroise et j’arriverais en France pour me présenter aux groupes qui étaient en formation. Je savais, d’autre part, que j’étais recherché dans mon pays et qu’un sort pire pouvait m’être réservé ; des raisons supérieures décidèrent enfin de mon sort.
Le 1er juin 1940, journée lourde et étouffante, je me présentai devant la commission allemande et, après avoir montré ma carte d’officier, j’obtins la permission demandée ; il restait encore à avoir le visa de la commission soviétique. Le président de cette commission, après m’avoir posé quelques questions banales, me conseilla d’attendre sur la véranda de la villa. Je compris que j’étais arrêté : la maison était entourée de sentinelles.
Après une longue attente, un agent soviétique vint sur la véranda et m’assura que je devais simplement me rendre avec lui à l’NKVD où je serais écroué pour le procès-verbal ; je serais ensuite mis en liberté, je recevrais le sauf-conduit et il me serait possible de partir.
À une certaine distance de la villa, une voiture était arrêtée ; elle nous emmena au palais de la direction des tramways, actuellement siège de l’NKVD.
Cela se passa vers dix heures du matin. Toute la scène, mon attente sur la véranda et mon enlèvement, avait été observée par une de mes connaissances, qui avait déjà reçu la permission ; je pouvais donc compter qu’elle avertirait les propriétaires de ma maison ainsi que ma famille, puisqu’elle serait partie le lendemain pour mon pays.
À l’NKVD je fus conduit devant un fonctionnaire noir comme un corbeau, aux yeux de chat sauvage et aux mains de panthère, qui, avec une habileté de félin, me fouilla complètement et enleva tout ce qui était dans mes poches. Souriant ironiquement, et avec une grande satisfaction, filtrant ses mots entre ses dents blanches comme des défenses d’éléphant, il me dit enfin : « Ainsi donc, monsieur le Colonel L. y est tombé lui aussi ! Mais où se cachait monsieur le Colonel pendant tout ce temps-là ? » (1638 – A. L., lieutenant-colonel.)
« ... Je fus arrêté le 28.IV.1940 à la frontière polono-roumaine, dans la localité de Popielniki, à 12 kilomètres de Zablotow, avec cinq camarades, trahis par le guide qui nous avait conduits dans une embûche préparée à l’avance.
L’officier soviétique du poste de frontière nous dit clairement qu’ils nous attendaient là depuis une semaine. Ce qui était une véritable provocation. À ce moment-là, à Léopol, on avait fait croire qu’il n’était pas possible de franchir la frontière sans guides, qu’on arrêtait tout le monde, que la population locale trahissait, qu’on se perdait dans les montagnes, car on ne connaissait point le terrain. On exagérait les difficultés, et les soi-disant « touristes » qui franchissaient la frontière cherchaient des guides connaissant le terrain de la frontière, les lieux où les gardes étaient postés et les heures du passage des patrouilles. Les bolchéviques en profitèrent. Ils commencèrent à placer des hommes, soit dit entre parenthèses, très rusés, parlant bien le polonais, qui, se servant des lettres de recommandation habituelles, gagnaient la confiance de nombre de personnes qui désiraient franchir la frontière et, faisant croire qu’il était facile de passer la frontière, avaient pour but d’encourager cette intention ou de la provoquer chez ceux qui hésitaient encore. Ils trouvaient parfois des collaborateurs parmi les Polonais vendus, qui étaient les plus dangereux. À Léopol et à Stanislawow, les noms « Rozek », « Michel », « Dubienczuk » sont bien connus. Ce sont les Ukrainiens au service de l’NKVD, qui envoyèrent des centaines de personnes au delà des Ourals, à Kolyma ou sur le chemin sans retour.
Ces guides étaient payés par l’NKVD et, de plus, ils gardaient tout ce qu’ils réussissaient à extorquer à leurs victimes. Ils travaillaient sans être dérangés, car personne ne pouvait les dénoncer. Celui qui était pris une fois par l’NKVD disparaissait comme derrière une muraille de Chine et aucune nouvelle pouvant mettre en garde les autres personnes contre les traîtres ne pouvait atteindre le monde extérieur. Ces guides étaient considérablement aidés par les systèmes des « avis de passage » envoyés aux familles par ceux qui tentaient de franchir la frontière.
Peu avant la frontière, le guide réunissait le groupe, montrait la ligne de la frontière et disait : « Donnez-moi les signes conventionnels, car vous voyez déjà la limite » (la rivière Czeremosz). La frontière était de fait à quelques pas.
Chacun écrivait deux lignes ou même une lettre et... cinq minutes après tombait dans l’embûche prédisposée. La proportion entre les assaillants et les assaillis était toujours au moins de cinq à un (nous six, par exemple, nous fûmes pris par 35 enkavudistes). Le guide s’éclipsait avec les lettres, les portait aux maisons de ses victimes et tendait les filets à d’autres personnes, qui, voyant ces billets, avaient confiance en lui. Les familles de ceux qui avaient « heureusement traversé » faisaient l’éloge de ces canailles et les payaient souvent une deuxième fois.
Lorsqu’en 1940 on découvrit l’organisation à laquelle j’appartenais, à Léopol, occupée par les bolchéviques, le terrain commença à brûler sous mes pieds, je commençai à envisager l’opportunité de me rendre en Roumanie et, de là, eu Grande Bretagne. Un collègue m’assura qu’il connaissait un guide sûr, recommandé par des lettres de connaissances. Je me rendis chez lui et trouvai trois de mes collègues et deux officiers en train de converser avec lui. C’était un homme extraordinairement rusé, qui éveillait la confiance chez tout le monde. Dans sa conversation, il n’y avait absolument rien qui prêtât à suspicion et, voyant la familiarité de mes collègues avec lui, je pris confiance à mon tour. Il prit de l’argent et quelques choses en nature (un appareil de T.S.F., un appareil photographique, un complet), nous promettant de nous accompagner. Il nous présenta le passage de la frontière sous des couleurs tellement merveilleuses que chacun de nous le crut et s’enthousiasma. Je peux maintenant me rendre bien compte de ma crédulité : à ce moment-là j’étais aveugle. On se mit d’accord pour qu’il portât des nouvelles à nos familles et nous partîmes. Il nous emmena à Zablotow, de là à pied à Popielniki, et, tout près de Czeremosz, il prit nos billets. Deux gardes se présentèrent aussitôt après ; l’un d’eux tira en l’air et immédiatement, avec un terrible tapage, une troupe complète de gardes-frontières, armés de la tête aux pieds, se précipita sur nous, qui avions la certitude de pouvoir être, deux minutes après, en Roumanie. Nous nous rendîmes compte qu’il n’y avait pas de voie d’issue : nous étions encerclés. Le guide s’éclipsa et le commandant de la troupe nous avoua cyniquement, plus tard, que le guide était d’accord avec lui et qu’il nous attendait déjà depuis une semaine. » (768 – S. T., né en 1920, sans profession.)
« ... Après nous avoir arrêtés devant la caserne, ils nous obligèrent à retourner à la maison P... Ils ne nous permirent pas de nous promener dans les chambres ; la sentinelle bolchévique s’installa dans la cuisine. À ma demande : « Que signifie tout cela ? », l’officier soviétique répondit poliment et avec empressement : « Nous attendons quelqu’un. » Il s’agissait d’un piège dressé à R. L. et au groupe qui devait arriver avec lui et, en même temps, à T. Sz, fils de H., revenu de Hongrie, retour que nous ignorions. Pour la capture de l’« explorateur » L., une prime de cinquante mille roubles avait déjà été fixée par les autorités de l’NKVD.
... À la tombée de la nuit un ouvrier des mines vint avec un rapport pour P. Il entra dans l’appartement, mais il ne lui fut pas permis d’en sortir. Quelque temps après, un autre arriva avec le même rapport et la scène se répéta. Un jeune homme ukrainien, Michel, notre aide, arriva le matin suivant, puis un enfant avec du lait et du beurre, puis la nièce de mon mari, une institutrice, les amies de mes filles, environ vingt personnes en tout. Le petit appartement était plein de monde. Parmi les soldats soviétiques, il y avait deux officiers de l’NKVD, dont un alla demander des instructions. Il revint et nous restâmes là jusqu’au soir. Pendant ce temps-là, ils mirent en liberté un ouvrier qui signa une déclaration suivant laquelle, sous peine de mort, il garderait le silence et ne rapporterait à personne ce qui était en train de se passer dans la maison P. » (10623 – S. E., femme d’un ingénieur.)
4. PIÈGES
« ... Le 24 août 1940, à 13 heures 15, deux enkavudistes entrèrent chez moi. L’entrevue porta sur la question de M. Le camarade le plus jeune reçut l’ordre de m’interroger à ce sujet et le chef s’en alla. Ce qui fut seulement clair, c’est que l’interrogatoire n’aurait pas lieu sur place, mais que je devais me rendre « pour un tout petit moment » au commissariat. Je jetai un manteau sur mes épaules. J’éloignai froidement ma mère, qui était près de moi avec une expression effrayée et les yeux pleins de larmes et, ne saluant aucun de mes parents, je m’en allai. La rue était déserte ; il n’y avait qu’une élégante limousine noire à l’entrée de celle-ci et, devant la portière, le chef de l’NKVD, qui, avec un geste poli, m’invita à m’asseoir... » (10722 – B. A., née en 1903, employée indépendante.)
« ... Je fus arrêté le 16 février 1940 dans le village de Nur, commune de Nur, arrondissement d’Ostrov en Mazowie. Deux enkavudistes frappèrent à la porte ; je leur ouvris ; ils demandèrent si la maison était habitée par J. K. ; je leur répondis que oui, les invitant à entrer. Ils m’ordonnèrent de les précéder et entrèrent après moi. Ma femme et les enfants commencèrent à pleurer quand ils m’adressèrent la parole : « Tu possèdes des armes, comme nous en ont informés de braves gens. » Je leur dis qu’ils pouvaient faire une perquisition ; ils acceptèrent et fouillèrent aussitôt les petits lits des enfants. Les enfants pleuraient terriblement et je ne pouvais pas bouger : « Si tu bouges, je tire sur toi immédiatement ; assieds-toi. » Ils tranquillisèrent ma femme et mes enfants pour qu’ils ne pleurent pas et leur dirent : « Papa sort pour une heure ; il se rend tout simplement au comité, afin de déclarer s’il possède des armes ; s’il n’en a pas, l’NKVD arrêtera le dénonciateur. » Ils m’ordonnèrent de sortir ; je demandai la permission de mettre d’autres vêtements, mais ils ne me l’accordèrent pas, disant : « Tu retourneras immédiatement, il n’est pas nécessaire que tu t’habilles. » La température était de 25 degrés au-dessous de zéro. Une fois hors de chez moi, un enkavudiste sortit un revolver et en mit le canon contre ma tête, me disant : « Marche ! » Un autre était devant la maison, et celui qui m’emmenait me frappa à la nuque, disant : « Dépêche-toi, sinon je te tue et tu n’arriveras pas au comité » et il pressait le pas, me frappant sur la tête. Quand je lui dis : « Voilà, le comité est ici », il me frappa de nouveau et me dit : « Je te tuerai avec ton comité, cochon parasite. » Il m’emmena au presbytère 44 où il me livra aux soldats ; ces derniers me fouillèrent et m’emmenèrent dans les caves sous le presbytère. L’un d’eux ouvrit la porte, me poussa à coups de pied et me dit : « Tu ne verras pas très clairement le monde. » J’entrai dans ce lieu où étaient déjà des voisins, et ils continuèrent à y amener d’autres personnes. Nous étions 42 personnes de Nur. » (447 – K. J., caporal.)
« ... Mon arrestation eut lieu dans les circonstances suivantes. Après mon arrivée à Sarney, je fus appelé par le chef de gare. « Monsieur D., rendez-vous dans le bureau du télégraphiste. » Une minute après un lieutenant entra et me dit : « Haut les mains ! Où est ton revolver ? » puis il me fouilla. Ils m’enlevèrent une carte de la province de Polésie, sur laquelle j’avais noté des wagons et une médaille du Maréchal Pilsudski, frappée par la Monnaie de l’État à l’occasion de l’anniversaire de sa mort. À cause de cet objet, je fus condamné à huit ans de camp correctionnel de travail dans les « laguer » lointains de la péninsule de Kola... » (D. S., cheminot.)
« ... Lorsque des parents demandaient où se trouvaient le mari, le père, le frère, qui avaient été arrêtés, les fonctionnaires de l’NKVD se montraient étonnés, assurant qu’aucun d’eux n’avait ordonné leur arrestation et qu’ils n’en savaient absolument rien. Ils cherchaient aussi à convaincre ceux qui s’intéressaient au sort de leurs chers parents que, sous l’autorité soviétique, quelques éléments hostiles, anticommunistes, faisaient des arrestations, pour miner la confiance de la masse à l’égard des autorités d’occupation. » (10719 – P. R., 43 ans, institutrice.)
CHAPITRE IV
LES PRISONS
1. LES PRISONS DE PASSAGE
« ... Nadworna (Localité climatique des Carpates). Trois étages de couchettes séparées par un étroit passage dans lequel deux personnes pouvaient difficilement se tenir. Il était impossible de s’asseoir sur une de ces couchettes, l’espace entre un grabat et l’autre ou entre la dernière couchette et le plafond étant trop étroit. Nous nous couchions sur un seul côté et, à la suite d’un ordre, nous nous tournions sur l’autre côté. Les prisonniers qui occupaient l’étage inférieur avaient les membres gelés, ceux de l’étage du milieu pouvaient rester de temps en temps avec les manches de la chemise retroussées, étant donné que la température était mitigée ; les derniers de l’étage supérieur, sans air et complètement nus..., asphyxiaient. Les cas d’évanouissement étaient fréquents. Après un interrogatoire préliminaire, ils me transportèrent de cet endroit dans une cave de la prison qui servait autrefois, au temps du gouvernement polonais, comme dépôt de charbon et de pommes de terre. Ils plaçaient dans le couloir (2 × 10 m.) de 10 à 80 personnes, suivant le nombre des nouveaux prisonniers. Des conditions horribles. Pendant mon séjour dans ce lieu (11 jours), pas une seule fois je ne suis arrivé à m’allonger. Jour et nuit, la moitié des personnes restaient debout, les unes près des autres, tandis que les autres dormaient assises en attendant de se faire remplacer. L’ordre était respecté par nous mêmes. Plancher en glaise. Parois recouvertes de gelée, une petite fenêtre mesurant 25 × 70 cm. près des escaliers, où était un seau sans couvercle, lequel était vidé deux fois par jour, le matin et le soir. Ce seau, naturellement trop petit, ne répondait pas aux besoins et par conséquent, le matin surtout, près de celui-ci s’élevaient des monceaux d’excréments et se formaient des flaques qui, dégouttant des escaliers, recouvraient un tiers de la cellule... » (7861 – W. Ch., journaliste.)
« ... Je fus arrêté le 7 mai 1919 pour avoir franchi le territoire paternel à travers leur soi-disant frontière, pour avoir « blessé » leur frontière près du fleuve Bug près de Zareby Koscielne, leur frontière provisoire. Le 7 mai 1910 pendant la nuit après m’avoir arrêté ils me firent coucher par terre de minuit au matin ; ils me gardèrent couché sans me permettre de bouger ; pendant tout ce temps-là je restai couché et je m’enrhumais le matin ils me transportèrent à la Cabane de la Ferme dans cette Cabane je restai trois jours sans manger, ni dormir ni boire de l’eau les conditions étaient terribles la paille bougeait à cause des poux et on ne pouvait pas dormir...
De cette cabane, nous fumes transportés dans le Cloître à Zareby Koscielne où habitaient auparavant les sœurs de la Miséricorde dans ce cloître ils firent les cellules j’y restai pendant un mois les conditions furent les mêmes que dans la Cabane précédente poux, faim et misère ils nous prirent plusieurs fois pour nous interroger ils m’accusèrent : « Toi espion Allemand ». Ils m’accusèrent de ceci car je voulais me rendre chez ma famille dans le territoire occupé par les allemands où j’allai parce que j’y habitai avec la famille dans l’arrondissement de Wolkowysk sur l’aérodrome en province de Bialystok et alors après l’arrivée des Libérateurs du pain et de la liberté je devais fuir chez moi. Mais il ne me réussit pas et je tombai dans les mains des Libérateurs lesquels me firent travailler à Vorkouta. (Vorkouta est le camp correctionnel de travail près de la Mer de Kara – Océan Glacial.)
Du Cloître ils nous poussèrent vers la gare de Zareby Koscielne et une femme s’évanouit et deux hommes s’évanouirent pour le manque d’eau et pour la fatigue nos Libérateurs au lieu de les aider leur dirent attendez-nous nous allons vous relever et ils léchèrent sur eux les chiens-Loups sur cette femme et ces hommes et les chiens lacérèrent leurs chairs d’une manière épouvantable...
... et de là à la prison de Lomza...
... je restai à Lornza pendant quatre mois et après quatre mois de martyre, de coups sur la gaule et de coups de pied car je ne voulais leur parler de rien ils m’ont donné tant de coups de poing jusqu’à me faire tomber plusieurs dents de la bouche, ils m’ont enlevé beaucoup de santé et pendant l’enquête la femme soviétique... (nous préférons ne point décrire la torture raffinée subie par le pauvre homme), qui voulait m’obliger à parler des Allemands, après ces quatre mois de torture j’ai reçu une paperasse avec la sentence : 3 ans de prison pour leur avoir « blessé » la frontière Comme si c’était la leur... » (3560 – S. E., né en 1912, travailleur agricole 45.)
« ... De la guérite près de la frontière, où ils nous avaient arrêtés, ils nous emmenèrent en autocar à la petite ville de Lubiatyn. Nous étions vingt personnes environ à bord de l’autocar. Il y avait des hommes âgés, des femmes avec de petits enfants, des jeunes gens de 16-17 ans et, naturellement, les inséparables gardiens avec les baïonnettes.
... Elle était bien curieuse notre prison ! Une vraie maison de paysans : une pièce et l’antichambre, laquelle remplaçait le couloir de la véritable prison et où résidait le gardien. La chambre était divisée par des planches : d’un côté les hommes, de l’autre côté les femmes et les enfants. Quoique la cabane fût polonaise, les fenêtres étaient déjà, d’après la coutume soviétique, recouvertes de panneaux de bois, de sorte que, si même un filet d’air arrivait à pénétrer, on ne pouvait point voir ce qui se passait au dehors. Les vitres manquaient, elles étaient cependant remplacées par des grillages. L’unique fenêtre d’où l’on pouvait apercevoir le monde était un petit trou dans la porte par lequel, si le gardien n’était pas si méchant et ne fermait pas la porte de l’antichambre, on pouvait voir une partie de la cour et quelques rayons de soleil ou bien la tête du camarade d’infortune qui se trouvait dans l’autre section et qui regardait le monde à travers un deuxième trou.
Le plancher de la chambre était en bois et on pouvait y dormir en mettant une couverture. Il y avait de plus un poêle à demi détruit, qui remplaçait très bien la table. Nous ne nous plaignions point du manque d’amusements dans cet appartement : même si le gardien, dans un moment de colère, bouchait le trou de la porte, c’était pour nous une grande distraction d’observer à travers les fentes des planches ce que faisaient les hommes de l’autre côté. En vérité, leurs occupations n’étaient pas très intéressantes, car presque tous étaient assis immobiles et méditaient sur leur malheur.
L’étape suivante se fit jusqu’à la petite ville de Szepietow où les conditions étaient meilleures car un garage servait de prison. Sur la porte, les grilles étaient en bois et permettaient d’apercevoir ce qui se passait dans la cour. Si toutefois il y avait vraiment quelque chose à voir, la porte était immédiatement fermée et on asphyxiait alors par manque d’air.
La seule chose intéressante que je pus apercevoir à travers les grilles fut une femme soviétique qui, au lieu d’une robe, portait une chemise de nuit.
Les fenêtres non recouvertes de bois étaient cependant très petites (30 × 10 cm.) et à la hauteur d’un mètre et demi. Le pavé en pierre était recouvert (quelle joie !) de paille. Après quelque temps cette paille devenait malheureusement moins agréable. Je vis là pour la première fois de ma vie les poux, heureusement encore pas sur moi.
La vie dans le garage était bien plus variée que dans la ville de Lubiatyn. Avant tout nous étions plus nombreuses – 30 ou 40 femmes environ. Il y avait parmi nous depuis de vulgaires contrebandières jusqu’aux détenues politiques. Un nombre considérable était constitué par les Juifs fugitifs qui s’étaient enfuis de l’oppresseur Hitler vers les « tovarichtchi ». Les camarades soviétiques les avaient reçus vraiment avec une grande hospitalité : ils obtinrent immédiatement un logement, de la nourriture et... un corps de garde. Malgré cela, bien des personnes arrêtées n’arrivaient pas à croire qu’il pût leur arriver quelque chose de mal et considéraient leur séjour dans ce lieu renfermé plutôt comme une aventure.
Un autre évènement de mon séjour dans la petite ville de Szepietow est resté profondément gravé dans ma mémoire : il s’agit d’une chose de peu d’importance, mais qui prend une importance énorme dans la vie d’un prisonnier : c’est la question du cabinet. L’alimentation dans la prison était différente de celle que nous avions autrefois chez nous (on nous donnait seulement du pain gluant, de l’eau bouillante et un peu de sarrasin brûlé) ; cette nourriture causait de graves dérangements gastriques. Pendant toute la journée on entendait le cri « do oubornoï » (au cabinet). Si le gardien était gentil, il permettait de sortir aux femmes qui le demandaient. La cérémonie était très compliquée. Trois soldats avec les baïonnettes et les fusils prêts à tirer se trouvaient dans la petite cour et surveillaient les personnes qui se rendaient de la cellule au cabinet. La distance était d’un mètre et demi. Sur le seuil de la grille, il y avait un autre gardien qui permettait aux femmes de sortir une à la fois. Dans le garage, les femmes indisposées faisaient la queue. Me trouvant dans leurs rangs un jour, je m’évanouis pour la première fois de ma vie. » (11638 – U. A., lycéenne.)
« ... Je me trouve dans la cour et j’attends du matin au soir que les places soient libres. À la fin du jour, ils font sortir du garage tous ceux du même compartiment, femmes et enfants, ils les emmènent en toute bâte vers le train... Ils me poussent à l’intérieur. D’après le nombre des personnes sorties, je suppose que le garage est vide. Lorsque je rentre, je vois toutefois une foule de femmes en train de faire des commentaires au sujet de la sortie des compagnes d’infortune. J’examine le local : le garage ne pourrait pas contenir plus de deux voitures. En haut, une tuile enlevée laisse un trou qui doit servir de fenêtre ; à gauche il y a les escaliers qui conduisent au toit ; sur chaque marche une femme est assise, comme une poule dans le poulailler. Pourquoi ces femmes s’assoient-elles de cette manière ? Ce n’est que le lendemain matin que j’ai pu résoudre l’énigme.
J’observe encore : sous l’escalier il y a un monceau d’ordures, et tout près un seau. J’ai mal aux jambes, je désire m’asseoir.
Je jette un regard sur les visages des femmes : elles sourient ironiquement m’invitant à m’asseoir.
« Pourquoi n’avez-vous pas balayé ces rebuts ? » demandé-je.
« Parce que nous devons dormir dessus ; nous préparons de cette manière notre couche pour la nuit ; nous vivons ainsi depuis deux semaines ! »
Quelle horreur ! Deux semaines ! Et on m’a dit qu’il n’est question que de quelques jours et que je serai ensuite mise en liberté !...
La première nuit s’est écoulée et... les premiers rayons de soleil pénètrent dans ce garage plein d’obscurité et d’horreur, ils entrent par la moindre fissure pour mieux nous montrer notre saleté et notre misère... Je sais maintenant pourquoi ces femmes restaient assises pendant toute la nuit sur l’escalier : il y avait là plus de lumière et elles se cherchaient les poux, comme les singes dans le Jardin Zoologique. Elles prenaient place dans la queue dès le soir précédent et elles attendaient chaque jour leur tour.
Je m’habitue petit à petit à cette vie. J’apprends à chercher mes poux comme toutes les autres femmes, avec indifférence, sans réagir. Cette occupation devient une nécessité tout naturelle comme la misérable nourriture qu’ils nous passent, composée d’avoine et d’eau.
... Un soir seulement la porte du garage fut ouverte, car de nombreuses femmes parmi nous s’étaient évanouies par manque d’air. » (10691 – Z. S. M., née en 1919.)
2. LES PRISONS MODÈLES
« ... Outre les prisons communes, ainsi que je l’ai déjà dit, il y avait des prisons spéciales près du bureau de l’NKVD, appelées « Vnutriennie tiurmy ». Une de ces prisons était située dans la rue Korolenko dans la ville de Kiev. Son nom officiel est : « Vnutriennaia tiurma NKVD prix Narkomatie Ukraïny » (La prison intérieure de l’NKVD auprès du commissariat du peuple pour l’Ukraine). Elle se trouve dans les édifices de l’ancien institut et collège pour jeunes filles de la bourgeoisie.
Deux, trois, quatre, cinq détenus se trouvaient dans chaque cellule de cette prison. Il n’y avait pas de cellules collectives. Les cellules étaient chauffées par le chauffage central. Chaque prisonnier possédait un lit, un matelas, un coussin, des couvertures et du linge. Toutes les deux semaines, ils prenaient un bain et recevaient du linge propre. Dans la cellule, il y avait même des tables de nuit ; l’infirmière visitait chaque jour les détenus et on avait tous les jours la possibilité d’être reçu par le médecin, pas trop sympathique. Le coiffeur coupait les cheveux toutes les deux semaines. Il y avait des livres et même en différentes langues. La nourriture était savoureuse, mais pas très abondante ; celui qui ne recevait pas de paquets souffrait la faim. Auprès du débit, suffisamment pourvu, on pouvait acheter en une seule fois 1000 ou 2000 cigarettes, du beurre, des saucisses, du sucre et parfois du lard. Tous les deux dimanches, on apportait dans la cellule du papier à écrire et de l’encre et on permettait aux prisonniers d’écrire des lettres ou des demandes et des requêtes.
La garde était composée de sous-officiers, qui observaient strictement le règlement. Les demandes et les réclamations des détenus étaient signalées dans le rapport quotidien. Le règlement était sévère ; dans la cellule il fallait parler à demi-voix, il était défendu de dormir pendant le jour et il fallait, pendant la nuit, garder la tête découverte et tournée vers la porte. Le couloir était recouvert d’un tapis qui atténuait le bruit des pas... » (15073 – P. Z.)
« ... Du 13 octobre 1940 jusqu’à la fin de mars 1941, je fus dans la prison de Kiev dans la rue Korolenko. Elle était nommée la Prison Intérieure de l’NKVD ukrainienne, ou, suivant notre façon de parler, du Ministère ukrainien. Elle était bien drôle cette Ukraine ! Dans la capitale de la République et dans son Ministère il n’y avait presque pas d’Ukrainiens et personne ne parlait la langue ukrainienne. La prison se trouvait juste derrière l’édifice du Ministère et elle était entourée de chaque côté par d’autre constructions en sorte que la cour sale et vilaine où l’on se promenait était enclose de tous les côtés par trois ou quatre étages de maisons. La prison était épouvantable ! Malgré l’ordre et l’hygiène, bien que dans les petites cellules pour une seule personne il n’y eût vraiment qu’une seule personne ou deux au maximum, bien que chacun de nous eût son lit, je me sentais ici pire que dans les sales prisons communes où il y avait plus de liberté : plus de vie, de contact avec des personnes différentes, surtout avec des compatriotes en général. À Korolenko, chaque mot, chaque geste était surveillé. Ils étaient capables de réveiller plusieurs fois dans la nuit une personne pour qu’elle se découvrît la tête qui ne paraissait pas découverte au surveillant, ainsi que les règlements des prisons l’exigeaient. Quand je n’étais pas seul, un « kapus » était toujours avec moi ; ainsi sont nommés dans les prisons les mouchards, c’est-à-dire les prisonniers au service des autorités des prisons.
Tout ce qui est dit dans les cellules est rapporté par ce moyen aux autorités. De quelle façon lugubre et horrible les citoyens soviétiques jugent cette prison, nous l’apprîmes le jour où ils emmenèrent dans la cellule un citoyen de Kiev, le Juif Faïbichenko ; il était transféré des prisons communes de Lukianovka. Il fut terrifié à en perdre connaissance en apprenant qu’il se trouvait à Korolenko. Comme nous lui demandions pourquoi il se désespérait ainsi, il répondit que nous n’avions peut-être pas compris dans quelle prison nous nous trouvions ; que c’était une prison de l’NKVD d’où l’on ne sort plus. L’atmosphère était certainement très lugubre et accablante. La lumière du jour pénétrait à peine dans la petite cellule, de sorte que, pendant l’hiver, l’électricité était allumée pendant toute la journée et, comme dans les prisons soviétiques l’électricité est allumée aussi pendant la nuit, le jour et la nuit ne se différenciaient pas entre eux. La garde des prisons vigilante et nombreuse surveillait continuellement les prisonniers, ce qui causait une continuelle tension nerveuse. La nourriture était hygiénique, mais tellement insuffisante que dans aucune des autres treize prisons où j’ai été enfermé, je n’ai autant souffert la faim ni tellement maigri. » (A. R., né en 1901 à Léopol.)
3. LA « TIURMA » SOVIÉTIQUE COMMUNE
« ... Ce qui est le plus difficile, en parlant de cette prison, c’est de garder une parfaite objectivité. Il y a une énorme différence entre l’aimable journaliste d’une revue, auquel on fait voir, en Russie, tout ce que l’on veut, et la personne qui doit connaître les prisons et les camps de travail, en l’expérimentant sur sa propre peau. Une des rares choses que les Russes savent faire à merveille, c’est faire connaître leur pays et les institutions le mieux réussies. Pour cette raison il est difficile à l’étranger de se rendre compte des conditions malheureuses, des lois, de la vie des prisons soviétiques.
La tradition historique de la Russie démontre que la question de l’isolement de l’homme est toujours bien résolue. Après la révolution de l’année 1917, et avant, il fallait isoler des millions de citoyens et d’étrangers. La Russie tsariste a construit des milliers de prisons, de Mourmansk jusqu’à Arkhangelsk, de Moscou jusqu’à Vologda et Saint-Pétersbourg, de Minsk jusqu’à Varsovie. Je connais les prisons russes d’avant la révolution, d’après les livres de Sieroszewski, Pilsudski. On y vivait très mal, les gens étaient battus, la nourriture était mauvaise, on vivait complètement isolés.
La Russie de Lénine et de Staline, qui tient tellement à se défaire des souvenirs des Alexandres et des Nicolas, a vraiment fait des progrès et des innovations. Après les expériences, non réussies, avec des maisons de correction, les bolchéviques ont recommencé à appeler la prison « tiurma » et à employer les méthodes qui leur sont propres pour l’organiser. Les prisons en Russie bolchévique sont sous le contrôle de l’NKVD. C’est la dénomination abrégée de « Narodni Kommissariat Vnutriennykh Diel » (Commissariat du peuple pour les affaires intérieures). Il y a les prisons communes et les prisons isolées. Ces dernières sont destinées aux condamnés politiques. La prison commune est par contre destinée aux prisonniers qui sont mieux traités, c’est-à-dire aux criminels de toute espèce. Cette ségrégation n’existe cependant qu’en théorie, puisqu’en réalité la saleté, le désordre et l’immangeable sarrasin règnent dans toutes les prisons, sans exception ; voilà les choses sans lesquelles on ne peut vraiment pas se figurer la Russie bolchévique.
C’est le propre des bolchéviques de nier par les faits les idées proclamées par eux-mêmes ; les prisons en Russie sont donc tenues dans un état de profonde misère et de saleté épouvantable. Le nombre des prisonniers dans les cellules est généralement 5 à 10 fois plus grand que celui fixé. J’ai connu une dizaine environ de ces paradis russes et, dans tous, les conditions étaient à peu près pareilles. Je me suis trouvé dans la prison de Baranowicze, où j’ai dormi pendant 6 mois à 20 centimètres du seau destiné aux nécessités physiologiques, qui sentait terriblement mauvais, et j’ai dû subir tout ce à quoi on peut s’attendre près du pot en question, jusqu’à avoir le visage mouillé par son contenu. Je me suis trouvé aussi dans la prison de Leningrad et quoique le premier ministre d’Estonieétait couché près de moi d’un côté et un colonel soviétique, congédié du front finnois, de l’autre, la quantité des poux n’était pas moindre. » (1419 – J. B., né en 1917, journaliste.)
« ... Odessa. Le bloc no 4 (une aile de l’édifice des prisons) est composé de 108 cellules pour une seule personne, chacune mesurant 2 × 2 m. 6. Dans chaque cellule il y a 6-7 personnes. Ensuite la situation empira. On arriva à placer dans les cellules de 10 à 12 personnes. Les cellules sont assez propres et hautes ; la fenêtre est à la hauteur d’environ deux mètres. Elle est recouverte d’une espèce de caisse en métal qui permet de voir seulement un petit bout de ciel. Pendant l’hiver il y avait dans la cellule 3 lits (pour 6 à 12 personnes) avec les matelas respectifs et les couvertures. Mais ils avaient été emportés pendant l’été et les détenus dormaient par terre sur le béton par couples, dans une position opposée, l’un avec les pieds sous les aisselles de l’autre. Le nombre des punaises était épouvantable, la lutte contre elle était vaine. On prenait un bain tous les dix jours. Il n’y avait presque pas de poux. Le linge n’était pas changé. Le secours médical consistait en ceci : une infirmière visitait chaque jour les cellules. Dans l’hôpital, assez propre, on ressentait le manque de médicaments. Nourriture assez bonne. Promenade tous les jours.
Odessa. Prison d’instruction, sous le contrôle de l’NKVD 46. L’édifice, ultramoderne, est composé de quelques étages. Cellules pour une seule personne, spacieuses, hautes, mesurant 240 × 180 cm. Le lit était caché dans le mur, la table et la chaise étaient en métal. Par terre le parquet (!). Pas de vermine. Nourriture bonne. Secours médical sur demande (!). Distribution de tabac suffisante. Traitement très sévère, mais aimable. Dans chaque cellule on passait 2 livres par semaine. À part les gardiens, le prisonnier n’était point en contact avec d’autres personnes (à partir du mois de février jusqu’au mois de septembre).
La prison « peresilnoïe » (de transit) dans la ville de Kharkov. Une foule incroyable. Dans la cellule pour une seule personne 15 à 20 détenus étaient gardés pendant des semaines entières. Faute de place je logeai dans la cour avec 500 autres personnes et pendant 5 semaines environ. La promenade habituelle était naturellement inutile. » (7681 – W. Ch., journaliste.)
« ... La prison dans la ville de Verkhno-Uralsk. Pas une seule fois il ne fut possible ni à moi ni à mon camarade, l’ingénieur G. M. de Léopol, pendant deux mois de séjour dans cette prison, de prendre un bain. Les poux se promenaient tranquillement sur les murs. Le linge n’était pas changé et il n’était pas permis de le laver. Nous dormions sur le pavé en pierre, les uns contre les autres. Quelques personnes devaient même dormir près du seau d’aisance. » (489 – sans profession.)
« ... La prison dans la ville de Vologda est située dans le vieil immeuble construit jadis au temps de Catherine. Cette prison est en partie une prison de transit. Ce fut là que je pris contact pour la première fois avec les gamins russes. Ils étaient capables, pour n’importe quel chiffon, de vendre leur frère ou de trahir leur meilleur ami. Cette prison, à la différence des autres que je connaissais, était propre. La nourriture aussi était meilleure. On pouvait avoir des livres et des journaux à lire. Les gardiens n’étaient point vulgaires, mais sensés et sérieux. Bain tous les 5 jours. Assistance médicale adéquate. » (10687 – A. J.)
« ... La prison centrale de Riga est un bloc composé de sept édifices en pierre, de quatre étages chacun, avec des planchers en ciment. Nous dormions par terre, sans matelas, rien qu’avec nos vêtements. Les fenêtres avaient été murées par le commandement soviétique et un rayon de lumière et un peu d’air pénétraient à travers une fente à l’extrémité de la fenêtre. » (458 – O. L., matelot de la marine de guerre.)
« ... La prison dans la ville de Riazan. Nous étions nombreux comme dans la prison de Wilejka. Nous dormions par terre. Propreté passable. Tout essai d’élever le niveau de la vie et tout désir d’une vie intellectuelle étaient brusquement arrêtés par les autorités compétentes. Les réunions et les exercices religieux étaient sévèrement défendus. » (10719 – P. R.)
« Les prisonniers russes étaient parfaitement au courant des conditions de vie dans toutes les prisons soviétiques. La prison centrale d’Odessa était connue comme une très bonne prison au point de vue de la nourriture, la prison de décentralisation de Kharkov, passable, toutefois ils étaient tous d’accord sur le fait que dans celle de Sverdlovsk les détenus mouraient de faim. Ils racontaient même qu’en 1939 un prisonnier, ne pouvant supporter plus longtemps la faim continuelle, plongea sa tête dans une marmite de soupe bouillante et mourut de ses brûlures.
Chose très intéressante, malgré le parfait isolement, les nouvelles s’ébruitent quand même d’une prison à l’autre, d’une cellule à l’autre. Par exemple, la nouvelle du fait de Sverdlovsk est parvenue à la prison centrale en avril 1940 à travers la Loubianka moscovite, la prison de Pierwomajsk et la prison d’instruction de l’NKVD à Odessa. Ceci s’explique facilement car les prisonniers mêmes sont les porteurs de ces nouvelles, puisque, transférés d’une prison à l’autre pour les interrogatoires supplémentaires, des confrontations ou de nouveaux procès, ils racontent ce qui se passe dans les nombreuses « tiurma » de la vaste URSS. » (15072 – K. Z., étudiant universitaire.)
4. L’AFFLUENCE DANS LES PRISONS
« ... La prison de la ville de Bialystok, construite aux temps des tsars, est destinée à contenir 1500 personnes. Dans la cellule prévue pour 28 ou 30 personnes, les bolchéviques en avaient placé 68. Le nombre augmentait toujours, au point qu’au mois de juin 1910 il était de 102 détenus. La foule était incroyable, les détenus dormaient sur des lits en fer sans matelas, sur des grabats on tout simplement sur le plancher en asphalte, serrés comme des sardines en boîte... Les prisonniers, arrêtés avec leurs vêtements d’été pour le travail et sans chaussures, étaient maintenant couchés par terre presque nus. » (550 – L. J., sous-officier.)
« ... La prison de Minsk. Lorsqu’ils ouvrirent tout grande la porte de la cellule, une masse de corps nus, luisants de sueur, se présenta à mes yeux. Je crus tout d’abord que ces personnes prenaient un bain de vapeur. Mon illusion cessa cependant au moment où ils fermèrent la porte derrière moi et me donnèrent le numéro 219. Le sol était en asphalte. La cellule, prévue pour 40 personnes environ, en contenait 219. Dix-huit écuelles et 11 cuillères qui n’étaient jamais lavées devaient suffire pour toutes et il y avait malheureusement parmi nous beaucoup de malades de tuberculose et d’autres maladies. Deux petites fenêtres et un modeste ventilateur ne donnaient pas suffisamment d’air. Des bandits et des malfaiteurs soviétiques qui nous volaient et nous battaient en présence même des autorités de l’NKVD étaient nos compagnons. Aux protestations ils répondaient par des injures. » (10699 – W. A., fonctionnaire d’État.)
« ... À 17 heures 30, ils m’emmenèrent en voiture, en faisant un détour par les rues afin de me faire perdre l’orientation, dans la prison de Zamarstynow. Nous nous arrêtâmes devant un édifice obscur et pour entrer nous fûmes obligés de passer par un couloir presque souterrain. Après quelques sons de clakson du chauffeur devant la porte, celle-ci s’ouvrit tout grande et nous nous trouvâmes dans un vestibule sombre et de là nous passâmes dans une chambrette sale qui servait à recevoir les prisonniers. Dans ce lieu, en présence de quelques femmes, ils me déshabillèrent complètement, pour une perquisition. Ils emportèrent les dernières petites choses que j’avais avec moi : canne, écharpe, bretelles, canif, briquet, stylo, montre, et après avoir demandé mon nom et prénom, le nom de mon père, etc., à travers des longs couloirs, ils m’emmenèrent dans une cellule située au premier étage.
La porte de la cellule était lourde ; elle était recouverte de fer-blanc très épais et portait une puissante serrure et un verrou massif, employé au cas où la serrure ne fonctionne pas. Sur la porte il y avait une planchette où, toujours en polonais, était écrit : cellule n. 66, de 24 m2 de surface, capacité 48 m3.
Le gardien ouvrit la porte de la cellule, j’entrai, je restai étonné. Le long des parois, sur de simples paillasses que les Russes appelaient avec orgueil matelas, étaient assises 22 personnes en caleçons. Leurs corps étaient couverts de sueur ; l’air était lourd et chaud. Les yeux de tous se tournèrent vers moi avec une expression d’étonnement et d’interrogation. Je parlai le premier pour me présenter : « Je suis le lieutenant-colonel L. A. » Un gentil jeune homme, en entendant ces mots, se leva de sous la fenêtre et dit à son tour : « Je suis le lieutenant médecin doct. Z. L., chef de la cellule. » Notre présentation et notre salut eurent lieu avec toute la cérémonie et d’après les règles en usage dans le monde civil. » (1638 – A. L., lieutenant-colonel.)
5. LA MOSAÏQUE DES PRISONNIERS
« ... À Moscou ils nous répartirent en plusieurs cellules suivant la catégorie des crimes. Huit d’entre nous, moi y compris, tombèrent dans la catégorie la plus dangereuse et la plus maltraitée en Russie, celle des condamnés politiques ; K.R. (contre-révolutionnaire) A.S.A. (agitateurs antisoviétiques) S.O.E. (éléments socialement dangereux) etc. Le groupe, en général, était cependant composé de personnes comme il faut, honnêtes, et, souvent, de citoyens soviétiques d’intelligence non commune ; nous étions donc contents. Le deuxième groupe était bien plus privilégié et plus nombreux. Ceux qui appartenaient à ce groupe étaient nommés « bytovik » et étaient au fond des infracteurs de différents genres, bandits de profession, assassins, voleurs de toute espèce, en un seul mot des criminels qui, en dehors de leur aspect, ne possédaient rien d’humain, et qui, par leur cruauté dépassaient les bêtes les plus sauvages. » (1662 – B. J., né en 1891 – garde forestier.)
« ... Dans la cellule commune où je me trouvai dernièrement et qui était appelée par l’NKVD la « chambre des intellectuels » nous étions deux Polonais (Stanislas R. de Léopol et moi). Il y avait aussi un Italien (Edmond Petrowitc de Komintern de l’année 1905) ; un Finlandais, deux Lettons, deux Allemands (russifiés) ; tous les autres étaient des Russes ; parmi eux, un certain Arcadii Siemionovitc Siemionov, Sacharov, autrefois Attaché militaire soviétique en France, et secrétaire, particulier de Kalinine, arrêté comme contre-révolutionnaire, deux autres officiers, trois médecins, quelques employés et un jeune homme de seize ans, qui avait tiré sur le portrait de Staline publié dans un journal. Nous étions tous considérés comme des condamnés politiques suivant les articles 58 et 59 du code RFRSS.
Les rapports étaient aimables avec tout le monde, surtout avec l’Italien et l’Attaché ; quelques-uns seulement se montraient ironiques et nous adressaient des menaces, même après l’amnistie ; ils essayaient de nous accuser auprès de l’NKVD et de nous faire mettre au cachot par punition. » (6117.)
« ... Voici quelques personnages caractéristiques parmi les prisonniers qui furent nos compagnons dans la prison de Loubianka :
a) général soviétique vice-commandant de l’Armée de l’Extrême Orient (du maréchal Bluecher), professeur de l’Académie Militaire Frunze, accusé de trahison, faute avouée par lui-même, malgré son innocence, à la suite des terribles tortures auxquelles il fut soumis. Membre du parti depuis l’année 1917, lorsqu’il prit part comme « praporstchik » à l’insurrection contre Kerenski. Il provenait d’une famille de paysans ukrainiens ; il n’était pas doué d’une intelligence supérieure, était bourré de différentes « sciences » particulières, surtout de philosophie, et il citait volontiers en toute occasion des morceaux choisis. Bien qu’il fût poursuivi, il affirmait sa fidélité à l’idée communiste. Au sujet de l’armée polonaise et de ses combats en 1939, il s’exprimait en termes assez flatteurs et ne prenait pas garde d’aller, avec ces affirmations, à l’encontre de la propagande soviétique.
b) directeur du séminaire orthodoxe dans la ville de Chelm (institution russificatrice), l’archevêque Père Szmaragd (nom russe : Lotyn-Lotyczenko).
En 1923, pendant la lutte pour l’indépendance de l’Église orthodoxe en Pologne, il tua l’évêque Georges et fut condamné 10 ans de prison et enfermé dans celle de Mokotow 47 qu’il apprécia beaucoup. C’était une personne d’une vaste intelligence (il termina ses études dans l’académie ecclésiastique ; il étudia la jurisprudence, l’archéologie), c’était un impérialiste type du temps des tsars et un excellent propagandiste qui exaltait la Russie puissante et libre, ne pouvait pas souffrir les communistes ; il ne s’en cachait pas, en discutant avec le général, et avec un certain humour il se moquait du système communiste... Mais en parlant de la lutte contre la Pologne orientale il se tenait du côté des Soviets. Il écrivait de son initiative de longs mémoires, dans lesquels il enseignait aux Soviets les méthodes efficaces pour gagner la population de la Pologne Orientale. Il recommandait la liberté dans l’exécution des fonctions religieuses célébrées dans les églises ouvertes et sous la direction des « popes 48 » pour que la population ne sentît pas la différence entre le gouvernement polonais et le gouvernement soviétique. C’était un représentant de l’impérialisme russe qui, lui, est indépendant de toute forme de gouvernement et de système.
c) soldat allemand déserteur, un jeune homme de vingt ans. Au mois de mai de l’année 1941 il s’enfuit de la ville de Pilau (Prusse Orientale) où il servait dans l’artillerie anti-aérienne. Il se faisait passer pour communiste poursuivi par les partisans de Hitler et échappé à eux. La prison de Kovno et de Loubianka furent pour lui une grande désillusion au sujet du système soviétique ; il s’était fait des illusions, il croyait être reçu les bras ouverts, mais, au contraire, ils l’accusèrent d’espionnage. Le général, qui était un véritable optimiste, voyait en ce jeune homme le symptôme de la décomposition de l’armée allemande et de sa proche bolchévisation. C’est pourquoi il avait une grande sympathie pour le jeune Allemand, et l’entourait d’une protection spéciale. L’Allemand disait qu’il y avait dans le Reich près de 10 millions de communistes et que la population (allemande) ne pouvait plus voir Hitler. À la demande si un conflit germano-russe était probable, il répondit que, pendant la guerre, il n’existe pas de partis en Allemagne, mais seulement des Allemands qui remplissent leur devoir.
Cette réponse étouffa complètement l’enthousiasme du général.
Je rencontrai l’Allemand encore une fois, au cours du transport, lorsque les baïonnettes nous firent courir dans les rues de Saratov. Il marchait en compagnie de quelques jeunes gens qui portaient des uniformes allemands. Il me fit un signe de la main et me dit avec amertume : « Das ist Russland ! » (Cela est la Russie !)
d) Dans la prison de Boutyrki (Moscou) je connus un officier anglais originaire d’Écosse (je ne me souviens pas de son nom). Il fut fait prisonnier à Dunkerque et avec quelques Anglais et Français il s’évada du camp. De l’Allemagne ils passèrent en Pologne où la population, malgré le danger, les cacha, les nourrit, leur fournit des vêtements civils et les conduisit jusqu’à la frontière russe. Ils y allèrent dans l’espoir d’être internés, suivant la loi internationale, jusqu’à la fin de la guerre. Cependant, après avoir franchi la frontière, ils furent mis en prison et accusés d’espionnage !
Il faut relever que lorsque mon ami polonais fut mis en liberté après moi, le 27.X11.1911, ces Anglais étaient encore emprisonnés.
Lorsque, me trouvant encore à Moscou, je dis à l’Écossais que Churchill, dans son discours prononcé à l’occasion de la déclaration de guerre germano-russe, avait promis à la Russie, comme nation alliée, tous les secours possibles, il cracha et dit que, s’il rentrait dans sa patrie, il quitterait immédiatement l’armée qui avait fait un pacte d’alliance avec des bandits tels que les bolchéviques.
... Dans la prison de Saratov, il y avait encore d’autres compagnons d’infortune :
e) un représentant d’autrefois auprès de la cour de l’émir de Boukhara. Il était accusé d’espionnage en faveur... de la Russie alors qu’il exerçait sa profession.
f) un officier du Quartier Général de l’armée roumaine, accusé d’espionnage. Il avait été fait prisonnier au cours de la guerre (année 1941) dans le territoire soviétique occupé par l’« Axe ».
Outre ces catégories de prisonniers, pendant mon séjour en prison, j’en connus d’autres :
Les soi-disant déserteurs. La plupart étaient des soldats qui, se dirigeant vers le front, avaient perdu le train alors qu’ils voulurent, au cours d’un arrêt, s’approvisionner de « kipiatok » (eau bouillante 49).
Des Allemands provenant de la République des Allemands du Volga ; parmi eux, de nombreux soldats licenciés après la campagne contre la Finlande, jusqu’à un héros de l’URSS, décoré de la médaille de Lénine. De hauts dignitaires et militaires soviétiques (arrêtés après le début de la guerre) ; parmi eux, un commissaire du peuple de l’URSS, fournisseur d’armes, le chef d’État Major d’une province de l’Ukraine, le chef d’aviation de cette région, quelques généraux, etc. (pour trahison contre l’État).
Les « Kolkhoznik » accusés de sabotage, de contre-révolution, de propagande antisoviétique etc. en nombre très élevé.
Les travailleurs temporaires des légations allemande, hongroise et autres, citoyens soviétiques (concierges, chauffeurs, cuisiniers) accusés d’espionnage, de trahison, etc.
Les coupables politiques étaient scrupuleusement séparés des criminels. Seulement dans la prison de Saratov, où je me trouvai après celle de Moscou, je rencontrai dans ma cellule quelques détenus criminels, qui cependant, quelques jours après, furent emportés. Un d’entre eux, un beau type de jeune homme, était le voleur le plus connu d’URSS. Sa spécialité était de voler dans les représentations étrangères et dans les habitations des diplomates. On dit qu’il fut interrogé par le commissaire de l’NKVD, Béria, lui-même. Bien habillé, instruit, admirateur du théâtre, dont il parlait souvent.
Dans une cellule de la prison de Boutyrki je rencontrai l’ex-Premier Ministre polonais Alexandre Prystor : nous restâmes ensemble une semaine environ. Il était respecté par tous ceux qui étaient dans sa cellule ; ils ne lui permettaient pas de prendre part au travail quotidien (par ex., nettoyage du plancher), puisqu’il était déjà faible physiquement, souffrant d’une angine de poitrine. Il y avait dans sa manière de se conduire un air de dignité, qui augmentait davantage l’estime qu’on lui portait. A. Prystor se plaignait d’avoir été traité très rudement par les autorités au cours de l’instruction. Dans la prison, malgré toutes ses instances, Prystor ne réussit pas à se faire visiter par le médecin, et n’obtint pas les médicaments nécessaires. Ils le traitaient très mal, mais il ne se décourageait ni se plaignait. Il fut arrêté en été chez d’autres personnes ; il n’avait avec lui aucun vêtement chaud. Ses compagnons de cellule, des Polonais, lui offrirent un manteau, un pull-over et d’autres choses. Lors de mon départ pour Saratov, il était encore dans la prison de Boutyrki ; quelques mois après, j’appris qu’il était mort, après avoir souffert, les derniers temps, de dysenterie.
Le niveau intellectuel des prisonniers était très différent : à côté de quelques-uns très intelligents et instruits, on remarquait beaucoup d’éléments primaires, sans aucune culture ni moralité. Il y avait doux groupes. La mésentente entre eux allait jusqu’à des luttes brutales. L’injure la plus grande, après celle de « fasciste », était celle d’« intellectuel ». Je parlai parfois de ce sujet avec des communistes intelligents. Ils ne me cachaient pas, qu’en cas de désordres intérieurs, un terrible massacre des intellectuels aurait lieu, cette fois-ci ce serait le tour des intellectuels soviétiques. » (12581 – P. J., 47 ans, ingénieur.)
6. LA FEMME EN PRISON
« ... Ils nous emmenèrent dans la prison de Brzesc. Ils poussèrent dans la cave 44 femmes ; d’après nos calculs chacune ne pouvait occuper plus de 1/3 de m3...
L’air parvenait à travers une petite fenêtre, mesurant 1 m. × 0,50. Celle-ci nous fit défaut par la suite, car elle fut recouverte de planches. Nous ne pouvions pas respirer, nous nous évanouissions. Il arrivait souvent qu’on ne nous emmenât pas au cabinet pendant deux jours de suite. Nous sortions tour à tour, car il n’y avait pas de place. Tout ceci nous poussait à la révolte et à ne pas accepter la nourriture en signe de protestation. J’eus aussi la possibilité de connaître les cellules de rigueur. Ils enfermaient chacune de nous dans une petite cave, pendant quelques jours. Nous n’avions que la chemise sur nous ; 14 ou 20 jours dans ce lieu suffisaient pour abattre l’organisme même le plus fort et pour ne pas faire revenir parmi les vivants la personne qui y avait été enfermée.
Ou versait de l’eau sur le plancher, ainsi l’humidité meurtrière régnait dans la cellule. On tremblait de froid et de faim. Il était matériellement impossible de s’asseoir, ni le jour ni la nuit. Pris de désespoir, nous mesurions de nos pas la longueur de la cellule : 1 m. de long et 2 de large. Les coups de pied brutaux du gardien faisaient revenir à soi le malheureux qui s’était évanoui de fatigue. Je me souviens d’un vieillard de la cellule voisine, qui devint fou à la suite d’un si mauvais traitement. Il croyait entendre des coups de canons, et l’armée polonaise qui approchait. Il implorait du secours. Ils le calmèrent bientôt et à jamais. » (7252 – L. W., née en 1919.)
« ... Ils m’envoyèrent directement à Baranowicze. Je restai là, dans la prison d’instruction de l’NKVD, jusqu’au 22.6.1940.
Dans cette prison, il y avait seulement une cellule pour les femmes. Elles étaient toutes Polonaises. La plupart était de celles qui avaient été arrêtées au passage de la frontière soviéto-lithuanienne. Les raisons de ces tentatives désespérées étaient diverses : le vif désir de rejoindre la famille, la crainte d’être arrêtées et emmenées à l’intérieur de la Russie, la collaboration aux organisations secrètes. Le plus petit nombre des détenues était composé de « spéculatrices ». Leurs actions étaient complètement justifiées par le manque total de ressources indispensables pour soutenir leurs familles.
Il y avait aussi 20 prisonnières qui avaient été obligées de quitter la ville de Wilna parce qu’elles ne possédaient pas de documents prouvant qu’elles résidaient dans cette ville depuis un temps déterminé.
Quelques-unes furent arrêtées pour avoir chanté l’hymne national, après les fonctions sacrées du mois consacré à la Sainte Vierge. Celles qui avaient été arrêtées pour avoir essayé de franchir la frontière étaient souvent soumises à l’interrogatoire, dirigé par les gardes-frontière. Dans la prison de l’NKVD à Baranowicze, les enquêtes, étant déjà à la phase finale, étaient moins pénibles. Quelques lycéennes de Lida, Stolpce, Grodno enfermées parce qu’appartenant aux organisations secrètes, étaient parmi les prisonnières. Elles étaient soumises à un interrogatoire plus sévère. Quand elles ne voulaient pas trahir les autres membres des organisations, elles étaient punies par le complet isolement de leurs familles (elles ne pouvaient recevoir ni paquets ni lettres, et il ne leur était pas permis d’écrire) ; on leur faisait lire les dépositions de quelques membres des organisations secrètes, qui n’étaient pas arrêtés et donnaient de fausses nouvelles au sujet des familles. Les interrogatoires avaient lieu souvent, le jour et la nuit ; ils pouvaient durer même une vingtaine d’heures environ, sans interruption. Dans ce cas, les juges se remplaçaient ; on appliquait souvent la cellule de rigueur. » (1950 – I. M., née en 1907, institutrice.)
« ... Ils emmenèrent un jour dans la cellule des femmes une nouvelle prisonnière. Elle s’appelait Marylka. Il près avoir dit son nom, elle ne voulut rien dire d’autre. Le gardien disait qu’elle avait mis le feu au village. De petite taille, maigre, elle donnait plutôt l’impression d’une enfant. De grands yeux bleus, toujours grands ouverts, avec une expression d’étonnement et de naïveté. Elle était de Russie Blanche. Le premier jour, elle observa seulement la vie de la cellule. Puis elle commença à crier, s’assit au milieu de la cellule, la tête cachée entre les bras et, s’agitant, elle commença à gémir. Les compagnes crurent que la crise passerait et que la première impression en était la cause, au contraire elle ne cessa point. Les nuits étaient épouvantables ; personne ne pouvait dormir. On ne savait pas si cette jeune fille était vraiment devenue folle ou si elle feignait de l’être. Elle ne se souciait pas de sa propreté personnelle et n’acceptait aucune nourriture. Elle criait, disant qu’elle était dans un enfer. Elle chantait une chanson mélancolique pour ses enfants. Elle jetait les poux sur ses camarades. Les femmes occupant cette terrible cellule imploraient l’aide des gardes ; aucun ne daignait répondre. Dix jours et dix nuits s’écoulèrent de la sorte. Marylka ne mangeait pas. De son corps émanait une odeur épouvantable ; il devint noir, le visage était cadavérique. Elle agonisait. Les prisonnières l’entouraient perplexes, puis elles décidèrent de se révolter. On emmena enfin la malheureuse. » (10691 – Z. S.)
7. L’HYGIÈNE ET LE SECOURS MÉDICAL
« ... Le linge personnel et la literie qui furent laissés, en quantité considérable, dans les prisons polonaises, ne nous furent pas distribués, parce qu’ils étaient destinés à l’armée rouge. Ils trouvaient parfois une vieille couverture en lambeaux, qui devait servir pour trois personnes. L’armée rouge avait emporté les couvertures neuves. Les vêtements avec lesquels nous dormions n’étaient jamais nettoyés. Poux et punaises en grand nombre. Pendant les chaleurs d’été (1940), la plupart des prisonniers s’évanouissaient faute d’air. Bain jusqu’au commencement de l’épidémie de typhus, toutes les deux ou trois semaines. La désinfection à la vapeur des vêtements ne donnait pas les résultats voulus, car le travail était exécuté à la hâte. La chasse aux poux était faite journellement par les prisonniers eux-mêmes... avec les mains ». (749 – K. A., officier, prison de Bryghidki à Léopol.)
« ... Le secours médical était peut-être un peu mieux organisé ; chaque jour l’infirmière visitait toutes les cellules. Cette visite constituait une partie du programme de toute la journée, ainsi que les appels du matin et du soir, le déjeuner, le dîner, le souper et l’heure à laquelle on se rendait au cabinet. Médicaments : pommades contre la gale, ichtiol, rivanol, sorte de macéré pour les furoncles, aspirine streptacite, l’immortel « calihypermanganicum » (permanganate de potassium) et la célèbre « marganzovka » pour désinfecter les blessures ou pour calmer les douleurs d’estomac.
J’eus en prison une très forte angine. Le secours médical se réduisit dans ce cas-là, après que j’eusse frappé à la porte de la cellule pendant une heure, à la visite de l’infirmière qui me prit la température, me donna de l’aspirine et apporta le lendemain matin la solution de calthypermanganicum, pour me rincer la gorge. Le surlendemain, elle oublia cependant que j’avais besoin de la solution pour me faire les gargarismes, je passai donc la période de la maladie dans la cellule, exposée aux courants d’air, sans aucun secours ; pour voir le médecin, il fallait au moins agoniser. J’eus ensuite la gale, épidémie comme l’avitaminose 50 qui produisait sur le corps des ulcères douloureux. Les furoncles furent particulière-nient douloureux. Je me trouvais alors dans la cellule 99, mesurant 6 x 10 ni, et avec 100 autres personnes. Les personnes les plus privilégiées étaient couchées sur les lits ; les nouveaux venus occupaient les places sur le plancher ; les derniers étaient obligés de se mettre près de la porte où était le fameux seau ; au fur et à mesure que d’autres arrivaient, tout le monde se déplaçait vers la fenêtre 51.
... Je dormais par terre près de la source odorante, et mes camarades, se dirigeant là pendant la nuit, marchaient sur les parties douloureuses de mon corps. Il ne s’agissait pas d’étourderie de leur part : nous étions tellement serrées qu’il était impossible de poser le pied par terre sans toucher personne.
Nous voyions les infirmières aussi pendant les perquisitions qui étaient très minutieuses et fréquentes. Elles ne fouillaient pas seulement les vêtements, le linge, les cheveux ; les personnes suspectes étaient examinées gynécologiquement. La perquisition était faite par des femmes... » (11638 – U. S., étudiante.)
« ... Pendant la nuit du 11 au 12 juillet, le grincement de la serrure me réveilla :
Lettre S... 52
« Szewczuk Michel ».
« Dawaj wykhadi » (Sors !).
Szewczuk se leva, s’habilla et sortit. Il retourna le matin, le visage pale, épuisé.
Le matin du 12 juillet le dort. Z. me dit : « Quelque chose est arrivée à Szewczuk. J’ai fait un mauvais rêve. J’ai rêvé que la porte de la cellule s’est ouverte et ils ont poussé à l’intérieur Szewczuk, qui tenait à peine debout, et ils l’ont appuyé contre le mur. Il est resté ainsi pendant quelque temps, regardant tout autour de lui ; ses jambes ont flanché et il est tombé par terre. » Le même jour, à 23 heures, ils appelèrent Szewczuk pour l’interrogatoire. Il se préparait lentement, comme s’il voulait retarder sa sortie de la cellule. Vers 4 ou 5 h. du matin, ils ouvrirent la porte de la cellule. Nous nous réveillâmes tous... Oh mon Dieu ! Le rêve du doct. Z. se réalisa dans les moindres détails.
Nous étions 29 à connaître le rêve et nous regardions avec grand étonnement sa répétition traduite en réalité. Les gardiens poussèrent le malheureux dans la cellule et l’appuyèrent contre la muraille. Szewczuk respirant avec peine et regardant autour de lui, comme pour chercher du secours, tomba le visage par terre, aux pieds des prisonniers couchés. Le doct. Z. accourut immédiatement, et après lui un Ukrainien, M., et moi ; nous relevâmes le malheureux et le plaçâmes sur son grabat. Le doct. Z. commença à l’examiner. Nous déshabillâmes le pauvre malheureux. Un tableau terrible se présenta à nos yeux. Tout le Corps de Szewczuk, le cou, les épaules, les bras, les talons étaient recouverts d’énormes taches vertes et violacées, produites par l’afflux du sang dans les muscles. L’examen de l’abdomen découvrit de graves lésions au foie ; ils devaient évidemment lui avoir sauté dessus. Szewczuk avait très soif, s’emportait, sentait la nécessité d’aller au cabinet, gémissait et il souffrit beaucoup quand on le transporta près du seau. Le doct. Z. n’ayant pas de médicaments à sa disposition et, ne sachant point comment aider le pauvre malheureux, décida d’appeler le médecin de la prison. Nous frappâmes longtemps à la porte ; elle s’ouvrit finalement. Comme réponse, ils nous dirent que le médecin n’était pas là et que rien n’arriverait à Szewczuk (« nichewo nie boudiet »).
Le doct. Z. l’observait infatigablement et l’examinait. Puis il nous annonça que les battements du pouls s’affaiblissaient, que la respiration devenait plus faible et que le malade agonisait.
Nous nous lançâmes de nouveau contre la porte, frappant non seulement avec nos poings, mais avec les chaussures, et, quand ils nous ouvrirent, nous criâmes : « Un homme meurt et vous, gardiens, vous ne voulez pas lui envoyer du secours ? » Le gardien se mit à rire et répondit : « Nichewo swolotchy nie boudiet » (il n’arrivera rien à la canaille).
Agenouillé près de Szewczuk, j’observais son agonie. Il cherchait à chaque instant à respirer de l’air, ouvrant la bouche ; les poumons, n’étant plus soutenus par le cœur, ne fonctionnaient pas. À un moment donné, Szewczuk ouvrit encore une fois les yeux, puis la bouche, comme s’il voulait parler. Mais on voyait que l’effort était vain désormais et que le moribond tâchait inutilement de retenir la dernière étincelle de la vie qui s’en allait. Le regard commença à se voiler, les paupières à se fermer ; la bouche se ferma avec une expression d’indifférence. Le doct. Z. approcha encore une fois l’oreille au cœur, puis il releva la tête et nous dit : « Il est mort. »
Nous récitâmes des prières pour son âme ; nos yeux étaient pleins de larmes et chacun de nous se demandait intérieurement : « Est-ce que je ferai une fin pareille ? »
Nous frappâmes à la porte pour la troisième fois, en criant : « Un homme est mort. »
Une heure après, l’officier de garde arriva ; il rentra dans la cellule, donna un coup de pied au cadavre, en s’écriant avec joie : « Lève-toi, Szewczuk » ; il nous demanda ensuite : « Pourquoi est-il mort ? Une enquête aura lieu... »
Les mots manquent pour qualifier cette effronterie et ce manque de respect envers un mort. Quelqu’un cria : « Vous savez mieux que tous pourquoi Szewczuk est mort. Nous n’avons pas été témoins de ses tortures... »
« Je sais pourquoi il est mort », dit le doct. Z.
« Et comment le sais-tu ? »
« Je suis médecin. »
L’officier de garde sortit, sans dire un mot. L’Ukrainien M. s’approcha du mort, s’agenouilla et, prenant la main froide du cadavre, prononça ces mots : « Michel, je le jure, je te vengerai ! »
Peu de temps après, ils portèrent dans la cellule le brancard, sur lequel nous posâmes le mort, qui fut ensuite emmené. Ce fut là l’enterrement de Szewczuk.
Pendant la matinée, ils appelèrent le technicien B. comme témoin de la mort de Szewczuk ; ils prirent toutes les indications personnelles et le renvoyèrent dans la cellule. Le médecin Z. ne fut point appelé. Telle fut la fin de Szewczuk sous le gouvernement de ceux qui proclament dans le monde entier la défense des droits humains... Quelle ironie ! » (163S – L. A., lieutenant-colonel.)
« ... Lorsque l’épidémie de typhus éclata dans la prison de Baranowicze, à la fin d’octobre et au début de novembre 1940, la cellule no 34 dans laquelle je me trouvais, était tellement pleine de poux, qu’il y en avait partout : dans le linge, dans les vêtements, dans le lit ; ils marchaient même par terre. On nous avait refusé le bain et la désinfection. À nos demandes incessantes, le gardien répondait : « Tu n’en crèveras pas. »
Après le début de l’épidémie, quand de nombreux malades étaient couchés dans la cellule, je demandais en ma qualité de médecin que les malades fussent transportés à l’hôpital et que les autres pussent profiter du bain, que leur linge fût changé et qu’ils fussent désinfectés. Après diverses tentatives, l’infirmière vint enfin et, restant sur la porte de la cellule, répondit que je n’étais pas un médecin, mais un détenu politique, un ennemi de l’Union Soviétique, et que le diagnostic ne me regardait pas. Après cette déclaration, elle sortit de la cellule sans visiter les autres malades, et je fus transporté dans la cellule de rigueur.
Ils enfermèrent avec moi le caporal L. W., qui cria aux gardiens : « C’est une injustice. Le docteur a raison. »
Lorsque je rentrai dans la cellule, je trouvai plus de vingt personnes déjà atteintes du typhus. À la suite de mes démarches réitérées auprès du directeur de la prison, une doctoresse vint enfin, visita tous les malades et ordonna de les transporter à l’hôpital de la prison ; pour les autres : le bain, la désinfection et le changement de linge.
Malgré cela, 80 % des détenus de notre cellule eurent le typhus. Je ne connais pas le nombre des morts. » (11206 – P. J., médecin.)
« ... L’autre malade, qui étouffait, commença à crier. Nous frappâmes énergiquement à la porte, disant qu’un homme était en train de mourir. Personne ne vint. Le malade cria pendant toute la nuit et tout le jour suivant. Finalement, vers le soir, ils le transportèrent dans la chambre des malades. Le médecin, en l’emmenant, m’avertit que si le lendemain mon état de santé n’était pas meilleur, il s’occuperait aussi de moi. En effet, le matin suivant, ils me transférèrent dans la chambre des malades, où, faute de place, ils me couchèrent par terre près de mon compagnon de cellule, qui continuait encore à crier. Il était gravement malade. Ils ne lui donnèrent aucun secours et le malheureux, toujours criant, mourut au cours de la nuit... Le soldat vint peu de temps après, prit par les coins la couverture qui renfermait le corps inerte et, le traînant par terre, le jeta dehors comme une charogne. Ce spectacle nous impressionna fort. Le pauvre Dorosiewicz Marius, c’était son nom, laissait sa femme avec laquelle il n’avait vécu qu’un an, et un enfant, qui était né tandis qu’il était en prison. Il avait 40 ans et provenait de la ville de Luboml. Il était employé dans le magasin du monopole de l’alcool. Je peux dire que sa mort me sauva. Les bolchéviques comprirent enfin que l’épidémie de typhus sévissait sérieusement. Beaucoup d’autres personnes tombèrent malades après moi, de sorte qu’ils furent enfin obligés de m’envoyer à l’hôpital, dans la ville de Kowel ; là grâce aux soins des médecins qui me connaissaient déjà, je surmontai fort bien le typhus et ses conséquences, parmi lesquelles la surdité. L’épidémie causa plusieurs dizaines de morts. Ce que je viens de dire peut être confirmé par les compagnons suivants : lieutenant P. J., sergent B. J., caporal S., caporal B., caporal S. » (2402 – G. M.)
8. LES PERQUISITIONS
« ... Le tourment le plus pénible pour les habitants de la cellule étaient les nombreuses perquisitions, inattendues, faites pendant le jour, mais le plus souvent la nuit. Voici comment cela se passait :
La porte de la cellule s’ouvrait tout à coup, avec cet ordre : « Sortez dans le couloir ! » Quelques gardiens entraient en même temps dans la cellule, tandis que les prisonniers sortaient en hâte et en désordre. Une fois dans le couloir, ils s’alignaient le long du mur, et la perquisition commençait. Les détenus s’approchaient des dirigeants, chacun à son tour, se déshabillaient complètement, et présentaient chaque pièce d’habillement qui était scrupuleusement examinée. Le gardien fouillait dans les moindres coins ; avec une satisfaction particulière, il détachait la doublure, les boutons, les jetait par terre, déchirant volontairement leurs effets qui étaient déjà en très mauvais état. Dans certains cas, ils décousaient même les chaussures, détachaient les cols, les manches, les manchettes, etc.
Après avoir soigneusement examiné les vêtements, ils nous commandaient de faire quelques flexions des jambes, quelques tours : ils regardaient sous la langue, derrière les oreilles, et dans les parties les plus intimes. Après quoi, ils ordonnaient : « Va-t’en ! » À ces mots, on ramassait rapidement les vêtements jetés par terre en désordre et on allait dans le cabinet en attendant la fin de la perquisition. Le cabinet était tellement plein de monde, que le gardien avait de la peine à fermer la porte. Nous attendions la fin de la perquisition, ainsi entassés, avec nos effets sur la tête, aspirant les odeurs désagréables pendant une bonne demi-heure. La porte du cabinet était finalement ouverte et on nous renvoyait dans notre cellule.
Pendant notre absence, les gardiens avaient réuni tous les lits au milieu de la cellule, en culbutant toutes les paillasses et en y jetant dessus le peu de choses qui nous étaient restées.
Il fallait beaucoup de temps pour remettre tout en ordre, retrouver chaque chose au milieu de la paille. Pendant ce travail, on entendait des blasphèmes, des malédictions, car il arrivait toujours que quelqu’un ne retrouvât pas des objets d’une certaine valeur. Il n’y avait pas de remède : les réclamations pour les objets perdus n’étaient pas acceptées. » (3532 – P. R., cheminot.)
« ... Dans la prison de Izjum, ils m’avaient volé toutes les choses plus ou moins précieuses. Le directeur de la prison possédait ma montre, le « plénipotentiaire » de l’NKVD (représentant de la section secrète) écrivait avec mon stylo. Il ne me fut plus possible de retrouver une petite somme (100 dollars) que je possédais, ainsi que des objets de peu de valeur : une ceinture, un porte-monnaie, une lampe électrique, etc. Ils ne me rendirent pas, entre autres, mes documents personnels : le passeport, deux cartes universitaires, le certificat de bonne vie et mœurs, le certificat de résidence, quatre copies de mon diplôme, etc. Ainsi dépouillé, ils m’envoyèrent vers la fin de juillet 1940 dans la cellule de « peresilnaia tiurma » (distribution) dans la ville de Kharkov ». (10701 – M. H., médecin.)
9. UN JOUR QUELCONQUE
« ... La journée commençait le matin de bonne heure. On entendait au dehors le sifflement du vent du glacial hiver sibérien. Le thermomètre marquait certainement 40 degrés sous zéro. Les disputes eurent lieu pendant la nuit, car les prisonniers, allongés près de la fenêtre, l’avaient fermée hermétiquement, tandis que trois rayères devaient rester ouvertes. Ceux qui étaient sous la fenêtre craignaient de geler, les autres d’asphyxier ; ils s’accusaient tour à tour. Quelqu’un vociférait parce que, dans l’obscurité de la nuit, quelqu’un avait mis les pieds sur sa tête ; il s’agissait certainement de quelqu’un qui allait au seau. Ils allèrent jusqu’à se battre. Nous étions très entassés. Ceux qui dormaient avaient changé déjà plusieurs fois de position, car le plancher en ciment sur lequel ils dormaient était très dur ; il n’était pas permis de dormir avec le visage tourné vers un autre. À un ordre donné, nous devions tous nous retourner. C’étaient toujours les mêmes qui se réveillaient trop rot et commençaient à causer, parlait des plats qu’ils préféraient chez eux. Maintenant plus personne ne se dispute, tout le monde attend de pouvoir entendre, derrière la porte, les pas des gardiens qui apportent dans le couloir les corbeilles de pain. Il doit être très tôt. Le gardien n’ordonne pas encore de nous lever. Ou bien l’appel du matin n’aura-t-il pas lieu aujourd’hui ? Parfois on ne le faisait pas. Il me semble toutefois qu’il est déjà six heures du matin. On entend le bruit de la porte située entre les escaliers et le couloir ; ils ont évidemment apporté les paniers de pain. Le plus âgé de la cellule nous commande de nous taire ; les autres aussi désirent le silence. Il faut distinguer par les bruits si le moment le plus important de la journée approche, c’est-à-dire celui où le gardien se montrera à la petite fenêtre pour ordonner de prendre le pain. Quelqu’un dit qu’il est en train d’approcher. En attendant, nous nous mettons en rang près de la petite fenêtre. Il faut faire bien attention aujourd’hui que personne ne voie la ration. Les prisonniers implorent Dieu en silence pour que le pain arrive jusqu’à eux. Quelle qualité de pain recevrai-je aujourd’hui ? se demande-t-on. Quelqu’un se demande comment faire pour ne pas rendre la ration de pain prêtée, la veille, par un malade, qui se sent malheureusement mieux aujourd’hui et demandera certainement qu’elle lui soit restituée. Il faudra trouver un moyen. Ils ont distribué le pain. Les détenus le tâtent, car l’obscurité règne encore dans la cellule. Les disputes naissent, car quelques-uns n’ont point reçu leur ration Quelqu’un a volé. Un autre s’irrite parce qu’on lui a passé le pain par ce côté-ci et non point par l’autre côté de la petite fenêtre, où la portion était bien meilleure. Quelques-uns accusent le chef de la cellule d’avoir volé les petits morceaux supplémentaires appartenant à la ration qui est de 400 gr., et montrent les petits trous dans le pain, où les morceaux étaient certainement attachés au moyen d’un picot de bois 53.
Nous décidons tous d’attendre le « tchaï » (thé) qui est une écuelle d’eau bouillante ; on se sent plus rassasié en buvant de l’eau chaude et en mangeant du pain en même temps. Ce jour-là, l’eau chaude fut distribuée très tard, comme il arrivait d’ailleurs très souvent. Il fallait cependant goûter le pain. À force de le goûter, nous le mangeâmes en entier. Quelques personnes qui avaient une forte volonté, partagèrent leur portion en trois parts : une pour le matin, la deuxième pour le déjeuner, et l’autre pour le dîner. Ces personnes énergiques n’étaient pas nombreuses. Lorsque les premières lueurs commencèrent à pénétrer dans la cellule, nous avions déjà terminé notre déjeuner, le repas principal dans l’espace de 24 heures. On nous apporta de l’eau chaude. Il fallait vraiment lutter pour l’avoir. Une grande quantité était versée par terre. Nous ne possédions que vingt écuelles ; on nous promettait toujours d’ajouter celles qui manquaient. Les conversations habituelles commencent à présent. Quelques-uns font des commentaires au sujet de la qualité du pain reçu. D’autres discutent sur les mets qu’ils mangeaient autrefois chez eux et sur les manières de les préparer. Les plus sensibles, ne pouvant point entendre ces discours, car ils sont épuisés par la faim, s’éloignent de ce groupe. Il y a, entre autres, des occupations très importantes ; il faut chasser les poux. Oh ! si l’on pouvait prendre un bain ! Le dernier, nous l’avons pris il y a 6 semaines. Ils disent qu’un tuyau est endommagé. Mes compagnons polonais ne veulent pas parler de politique. Les détenus plus âgés nous apprennent que des conversations sur ce sujet en prison peuvent avoir de tristes conséquences. Parmi les prisonniers, il y en a plusieurs qui mouchardent ; ceux qui proviennent de Bessarabie sont particulièrement malicieux. Ils affirment en riant que la Pologne n’existera plus jamais. Aujourd’hui on ne nous permettra pas la promenade habituelle, on nous sort tellement rarement ! Quelques-uns parmi nous sont sortis pour la dernière fois il y a deux semaines et rien que pour dix minutes. Mais le temps a vite passé. Dans les cellules voisines, on distribue le déjeuner. Dans la nôtre aussi ils ont, enfin, apporté 3 seaux de soupe pour 80 personnes. Deux louches de soupe pour chacun, soit un peu plus qu’un demi-litre. La soupe doit être faite de pommes de terre, mais on n’en voit que quelques petits morceaux. Tout le monde se plaint et craint de mourir de faim. Certains se consolent en affirmant qu’il n’est pas facile de mourir de faim, même en ne mangeant que ce qui est distribué. Le moment le plus grave arrive : la distribution de la soupe. Il faut faire attention que personne ne reçoive quelques morceaux de pomme de terre en plus. Les Ukrainiens partagent, car ils sont les plus nombreux dans la cellule. Ils ont adopté diverses méthodes pour que le partage soit égal. Nous attendons avec nostalgie le soir et le dîner. Pour dîner, une seule louche de soupe, et nous sommes tous tellement affamés ! De nouveau la soupe faite de pommes de terre. Le mois dernier, on nous donnait du sarrasin. Nous le préférions. Le dîner nous causait une grande inquiétude, car il fallait le partager dans une obscurité complète. Un seau de soupe a été renversé par terre, par ceux qui tentaient de voler, en profitant de l’obscurité. Quel dommage ! Le soir il faut arranger les vêtements étendus sur le plancher en ciment, il faut enlever l’eau versée par terre, qui est cause d’humidité. Encore une queue devant le seau : il faut satisfaire les besoins physiologiques. Il vaut mieux anticiper, car pendant la nuit il faut aller à quatre pattes pour ne pas mettre le pied sur la tête de quelqu’un. Maintenant les détenus sont encore debout ou assis, il y a plus d’espace, on arrive facilement à la porte. Demain, on nous donnera de nouveau du pain. On a tellement faim ! Oh ! si on pouvait dormir toute la nuit jusqu’au matin ! Je ne peux pas m’endormir ; je me sens une démangeaison sur tout le corps.
Sur le pied et sous l’aisselle, juste du côté sur lequel il faudrait s’appuyer, des ulcères sont apparus. Aujourd’hui la journée a été pleine de querelles. Les meilleurs amis se sont disputés entre eux, excités par la faim ; tout le monde se dispute. Demain ce sera la même chose. Nous n’avons pas de nouvelles du monde. Il y a toutefois un peu d’espoir. Nous en vivons tous. Ainsi se passe presque chaque jour, du 7 août au 23 janvier 1942, dans la prison de Verkhno-Ouralsk, où il y avait près de 3000 détenus, parmi lesquels environ 350 Polonais. » (1645 – M. S. S., né en 1897, ingénieur des ponts et chaussées.)
10. LA CELLULE DE RIGUEUR
« ... Le sous-officier de garde rentra dans la cellule et demanda qui donc avait commencé à jeûner le premier, en signe de rébellion. Ayant dit que c’était moi, je reçus l’ordre de sortir de la cellule. Je sortis avec la seule chemise sur moi et mon pantalon, et je m’arrêtai dans le couloir. Il m’emmena en bas et m’enferma dans une cellule souterraine, où le froid me pénétrait jusqu’aux os. La fenêtre, dans cette cellule, était recouverte de fer-blanc, avec des trous grands comme une pièce de 50 centimes, par lesquels entrait un vent glacé. Pour ne pas geler, je commençai à faire de la gymnastique. Un instant après, j’entendis derrière la porte la voix du gardien : « Il est défendu de faire de la gymnastique. » Je cessai. Je ne sais pas combien de temps je passai dans cette cellule : cela me sembla des siècles. Quelque temps après, ils ouvrirent la porte, et je retournai à ma cellule. Au bout de trois jours après l’appel du soir, le même sous-officier m’ordonna de sortir dans le couloir avec tous mes vêtements. Ils m’emmenèrent en bas, où était l’officier, et là ils m’annoncèrent que j’avais été puni de 5 jours de cellule de rigueur, pour avoir poussé à la rébellion. On ordonna au gardien de me perquisitionner. Il me déshabilla dans le couloir, où le thermomètre marquait 5 degrés au-dessous de zéro. J’étais tout nu, tremblant de froid, et il fouillait tranquillement, examinant chaque vêtement. Dans la poche de mon pantalon j’avais deux mouchoirs. Il les prit et les jeta à terre. Lorsque je lui fis observer que ce n’étaient que deux mouchoirs et que je ne saurai plus où me moucher, il me cria : « Avec ta manche, canaille. » Après la perquisition minutieuse, il me rendit seulement le linge et le pantalon, en m’ordonnant de m’habiller, et il emporta dans son bureau le reste de mes affaires. Il me fit rentrer, habillé de cette manière, dans la cellule. Pendant mon séjour dans la cellule de rigueur, je n’arrivai pas à fermer les yeux, car le froid était trop perçant. Je croyais que ma fin était arrivée. Comme nourriture journalière, je recevais 250 gr. de pain et du thé. Je m’enthousiasmais cependant en vain à l’idée de boire du thé chaud. Le gardien qui faisait les distributions avait l’habitude de verser le thé dans l’écuelle, de la mettre près de la porte, par terre et de s’éloigner pour faire d’autres travaux. Quand le thé se recouvrait d’une couche de glace, il venait, ouvrait la porte de la cellule et me présentait la boisson que je désirais tant. La voyant tellement gelée, je la refusais ; le gardien fermait la porte et s’en allait avec indifférence. Pendant tout le temps j’entendais des plaintes provenant de la cellule voisine. Le troisième jour de mon séjour dans la cellule de rigueur, un officier de l’NKVD vint chez moi. Je dus lui paraître très misérable, car il me demanda si je possédais un vêtement chaud. Sur ma réponse négative, il ordonna au sous-officier de garde de me rendre mes vêtements. Ceci se passa pendant la nuit. Le matin suivant, je frappai à la porte de la cellule, demandant à parler au sous-officier de garde : j’appris qu’il était absent parce que malade et que personne ne le remplaçait. Le jour suivant était un dimanche, journée de repos, et je ne réussis pas non plus à le trouver. Mon supplice dans la cellule de rigueur devait finir le lundi. Je décidai donc de patienter et de ne pas demander la restitution de mes vêtements. Le soir, je retournai dans ma cellule. (3313 – Z. St., fonctionnaire à Léopol.)
« ... Ils ont enfermé dans la cellule de rigueur, avec 40 degrés au dessous de zéro, le général en retraite Jastrzebski âgé de 70 ans, malade et décrépit et ils l’ont laissé sur le plancher en pierre avec le seul linge qu’il avait sur lui et les chaussettes. Il avait été puni parce qu’il avait grondé un jeune Ruthène Blanc qui montait la garde dans le couloir de la prison. » (1871 – D. P. P.)
« ... Ils m’ont placé dans la cellule de rigueur pendant trois jours parce qu’ils ont trouvé sur moi un petit couteau fait avec un morceau de fer-blanc ; comme j’avais les gencives enflées, le petit couteau m’était nécessaire pour émietter le pain. Lorsque je rentrai dans le cachot, je m’aperçus qu’ils venaient de jeter sur le plancher le deuxième seau d’eau. Je restai assis, pendant trois jours dans la cellule, mesurant 2 × 4 m, vêtu seulement de mon linge et les chaussures aux pieds. Des lignes étaient tracées sur les murs, indiquant les journées de séjour de quelques prisonniers dans la cellule de rigueur. J’arrivai à en compter 72 dans un seul groupe... elles appartenaient à une seule personne. Soixante-douze jours dans la cellule de rigueur ! » (615 – P. T., 33 ans, ingénieur chimiste.)
CHAPITRE V
L’ENQUÊTE
1. À LA RECHERCHE DU CRIME
« ... Le 1er décembre 1939 je m’enfuis de Varsovie pour me dérober aux persécutions et aux cruautés des Allemands envers les Juifs. Je quittai ma mère, un fils de quatorze ans, ma femme et tous mes parents. Le 10 décembre de la même année, j’arrivai à Léopol. Le 14 janvier, je fus arrêté.
... Chacun de nous était introduit dans un bureau séparé, pour l’enquête préliminaire. Ils me soumirent à un interrogatoire d’identité, et une fois le procès-verbal signé, ils commencèrent à me battre en disant que tout ce que j’avais déclaré était faux et calomnieux. Ils affirmèrent posséder un document écrit par moi et ils me le montrèrent, sans me le faire lire, avec des photographies d’un homme que je voyais pour la première fois de ma vie : ils soutenaient que tout ce que j’avais affirmé au cours de l’interrogatoire n’était pas vrai, que j’étais un officier déguisé et qu’ils possédaient des preuves de tout cela. Comme je niais, ils recommencèrent à me battre, jusqu’à ce que je tombai par terre ensanglanté ; ils ouvrirent alors la porte et me jetèrent dans le couloir d’où je fus transporté dans une chambre où je restai tout seul. À 2 h. de la nuit, ils m’emmenèrent de nouveau dans la chambre précédente, ils s’excusèrent disant qu’ils s’étaient trompés à mon égard, mais ils ajoutèrent qu’ils possédaient des preuves irrécusables, qu’ils me montreraient, d’après lesquelles j’étais un espion de la Gestapo ; ils me demandèrent quelle était la mission qui m’avait été confiée, m’imposant de dire la vérité, sinon, avec les preuves qu’ils possédaient, ils me fusilleraient.
Je répondis que j’étais un Juif, échappé à la Gestapo de Varsovie, et que j’avais laissé ma famille dans cette ville. Je fis cette déclaration en pleurant. Je fus néanmoins de nouveau battu et on me déclara : « Nous te prouverons le contraire. » Ils me renvoyèrent ensuite de la chambre comme un chien et m’enfermèrent dans la même chambre qu’auparavant. » (702 – H. A., commerçant de Varsovie.)
« ... Une fois l’interrogatoire terminé, il me lut ma déposition, dans laquelle étaient mentionnés des faits que je n’avais jamais avoués. Je refusai alors de signer. Malgré son insistance je persistai dans mon refus ; il me fit alors emmener de nouveau en prison, dans une cellule sombre, sans lit, avec ordre de me mettre au pain et à l’eau. Après avoir passé sept jours dans cette cellule, je fus de nouveau conduit en présence de mon « tuteur » qui me demanda si je m’étais décidé à signer le procès-verbal.
Comme je répondis que non, il me renvoya à ma cellule. Quatre jours après, on me ramena chez lui. Le procès-verbal avait été refait, mais il ne correspondait pas encore à mes déclarations. Il m’expliqua alors que la personne interrogée ne signe pas ses déclarations, mais signe pour avoir pris connaissance des observations introduites dans le procès-verbal par le fonctionnaire qui a fait l’interrogatoire... » (108 – J. S., né en 1899, sous-officier.)
« ... Après avoir subi une perquisition personnelle, nous fûmes arrêtés. Au cours du premier interrogatoire, on me reprocha d’être instruit. Comment est-il possible que le fils d’un ouvrier, dans la Pologne des « Seigneurs », puisse recevoir une instruction ?... » (1773 – P. S., professeur de lycée.)
« ... Le 19 septembre 1939, une patrouille de l’armée rouge, composée d’un lieutenant et de quatre soldats de l’armée de frontière (lisérés verts 54), vint chez moi à 6 h. du matin.
La perquisition dura environ 4 heures. Dans la prison de Czortkow, ils me soumirent à une perquisition personnelle minutieuse. Après quoi, ils m’enfermèrent dans la cellule no 6, où j’étais seul. Ensuite je fus emmené, de la même façon que j’avais été conduit de chez moi à la prison, dans l’édifice jadis occupé par la garde de frontière polonaise (KOP). Là je fus interrogé par un capitaine. Il me demanda des renseignements sur toute ma vie et en particulier sur tout ce qui avait trait à mon service militaire, à ma carrière dans la magistrature et à mon activité dans les organisations politiques. Le procès-verbal de l’interrogatoire fut rédigé honnêtement. Quand je l’eus signé, il me déclara que j’étais en état d’arrestation. J’en demandai la raison. Un autre officier, un major, entra alors dans la chambre et me répondit : Vous êtes une personnalité ; vous serez pour nous un otage... » (2399 – S. F., juge d’arrondissement.)
« ... Voici les motifs de mon arrestation qui m’ont été donnés :
1) Service effectué dans l’armée polonaise en 1940.
2) Espionnage.
3) Attitude hostile vis-à-vis de tout ce qui est soviétique.
4) Possession de la Croix du Mérite et de Médailles militaires. » (11208 – K. J., sergent.)
« ... À Dniepropetrovsk, tout le monde fut soumis à une enquête. On me reprocha d’être un espion allemand, un officier polonais qui s’était vengé sur les soldats polonais. On me demanda ce que faisait mon père. Je répondis à tout cela en déclarant que j’étais un soldat polonais et plus exactement un tirailleur, sous les drapeaux sans interruption depuis le 24 mars 1938.
La cellule dans laquelle ils m’enfermèrent était humide, l’eau coulait des parois. Le sol était de pierre, et quarante-huit personnes étaient entassées dans la cellule. L’NKVD effectuait pendant la nuit des perquisitions. On trouva ainsi sur moi des notes sur le vocabulaire anglais, écrites par moi sur du papier à cigarettes. Ils m’emmenèrent tout de suite dans le couloir et là ils commencèrent à me battre, et à me donner des coups de pied. Puis ils m’enfermèrent dans une cellule isolée, et je restai là pendant toute la nuit. Le lendemain, je fus appelé par le Procureur. Il me demanda ce que ces notes signifiaient. Je lui répondis que pour passer le temps d’une manière quelconque, j’étudiais la langue anglaise... » (184 – M. W., comptable, 26 ans.)
« J’ai travaillé à Simféropol en qualité d’infirmier libre 55 dans l’« Hôpital du Citoyen Soviétique », dans la section chirurgicale.
Le 17 juillet 1941, je fus subitement arrêté pendant la nuit et emmené dans la prison « intérieure » de l’NKVD de Simféropol.
Le lendemain, au cours de l’interrogatoire, on me déclara que j’étais accusé de toute une série de délits politiques, prévus par les articles 58 § 6, 58 § 7, 59 § 10 IIe partie, 58 § 11, 58 § 12 (ou 14) et 192 § 16. Au cours des interrogatoires suivants (92 en 35 jours), je fus accusé d’avoir été envoyé par une organisation d’espionnage ; on me dit enfin que mon rôle consistait à dessiner le plan des hôpitaux de Simféropol. Dans ce but, je m’étais mis d’accord avec les Allemands domiciliés dans la ville, avec les Polonais, avec les Juifs et les Grecs ; de plus, j’étais en rapport avec la Turquie, et j’avais l’intention d’effectuer des actions de sabotage et d’instiguer les autres, pour me réfugier ensuite en Turquie.
Il me fut ensuite reproché d’être au service de la bourgeoisie anglaise et de mener une propagande antisoviétique. Je savais très bien que toutes ces accusations étaient sans fondement et que les « enquêteurs » faisaient tout simplement des « essais » pour voir ce qu’il en sortirait.
Le 11 août, on me déclara que les accusations faites jusqu’à ce moment-là n’avaient plus de valeur et que j’étais accusé d’avoir fait de la propagande antisoviétique à caractère diffamatoire. Le 18 août, je fus confronté avec une infirmière que je connaissais seulement de vue et je fus ensuite enfermé dans une cellule de la prison centrale de Simféropol. » (6654.)
« ... J’ai été maître d’école élémentaire dans le village de J. Le 11 mars 1941, je fus arrêté et conduit au bureau de l’NKVD, dont le chef commença à m’interroger. Il m’engagea à confesser spontanément les fautes commises contre l’autorité soviétique, sans toutefois me les énumérer. N’ayant obtenu de moi aucune déclaration, après quelques heures d’interrogatoire il appela le juge d’instruction auquel la suite de l’enquête fut confiée. Celle-ci dura sans interruption jusqu’à 8 h., le 12 mars. Je fus obligé d’avouer des fautes pas même formulées par les accusateurs. Je ne savais pas quoi confesser. Pour m’encourager à parler, ils m’obligèrent à rester debout pendant des heures, « pour que je ne m’ennuie pas en restant assis ».
À 4 h. du matin, le juge m’ordonna d’écrire mon « curriculum vitae ». Quand je l’eus écrit, il m’ordonna d’en préparer un deuxième, et ainsi de suite jusqu’à 8 h. du matin. Je ne sais pas combien de copies je fus obligé de rédiger. À 8 h. le juge fut remplacé par un autre enquêteur et l’interrogatoire continua, sans interruption pour le repos ou pour le repas, jusqu’à 8 h. du soir ; à cette heure-là, le juge précédent revint et recommença à m’interroger. Le lendemain, à midi, je fus emmené dans un autre bureau, où se trouvaient le chef de l’NKVD et d’autres personnes, et l’interrogatoire continua. Nombre d’accusations justifiées et injustes : trahison de la « Patrie », participation aux luttes de l’année 1920, collaboration avec la police, activité dans les organisations politiques, etc. Comme l’interrogatoire ne donnait pas les résultats désirés, je fus de nouveau livré au juge d’instruction précédent, qui recommença la litanie de mes fautes. Quand les paroles ne suffisaient pas, il passait à des voies de fait. Je restais débout pendant des heures, et si je donnais le moindre signe de fatigue, j’étais immédiatement battu. Ils m’obligeaient à fixer une paroi blanche et, si je fermais les yeux, ils me donnaient des coups sur la tête ou bien ils me cognaient la tête contre le mur. Ils me décrivaient ce qui arriverait à ma femme et à mes filles lorsqu’elles seraient sur le pavé.
L’enquête dura ainsi pendant quatre-vingt heures sans qu’on me permît de prendre un peu de nourriture et de repos. Toutes les douze heures, les enquêteurs se remplaçaient. Les méthodes employées par eux devenaient de plus en plus cruelles. Épuisé physiquement et moralement, je ne résistai pas davantage et j’avouai tout ce dont j’étais accusé, à tort ou à raison. Je croyais mes tourments enfin terminés : au contraire, on recommença à me faire des accusations nouvelles, exigeant de moi de nouveaux aveux. » (1732 – K. F., né en 1890.)
2. TERREUR MORALE
« ... Personnellement, je n’ai pas été battu. J’ai toutefois été l’objet d’injures russes, indispensables en pareil cas, et j’ai su que j’étais accusé principalement d’avoir voulu rejoindre en Hongrie les forces du « bandit Sikorski ». (5621 – K. R., 32 ans, marié, employé de l’État, prisonnier à Stanislawow.)
« ... Au cours des interrogatoires préliminaires, la conduite envers les prisonniers était empreinte d’une fausse gentillesse. Ceux-ci étaient avertis que, s’ils avouaient, la peine serait diminuée. À moi et à d’autres prisonniers ils proposèrent de collaborer avec l’NKVD, promettant la liberté et de l’argent pour cette collaboration, mais je refusai nettement cette proposition. Au cours de la suite de l’enquête, ils employèrent des moyens plus sévères, tels que les menaces d’arrestation de toute la famille et de la réclusion perpétuelle. Souvent le juge intervenait avec le « Nagant » (revolver), menaçant de faire fusiller celui qui n’avouait pas. Il joignait à ces menaces d’horribles blasphèmes et des injures contre Dieu, contre le gouvernement et contre le peuple polonais. » (4353 – Z. W., né en 1908, musicien, marié.)
« ... J’ai vécu en URSS sous un pseudonyme, et c’est ce qui fit que je dus déclarer, en donnant mon identité, que j’avais un fils, bien que ce ne fût pas vrai. Afin de m’épouvanter, un enquêteur me dit que mon « fils » et ma femme avaient été arrêtés, mais qu’ils seraient immédiatement libérés si j’avouais toute la vérité. » (9387 – C. E., 43 ans, docteur, prisonnier à Sniatyn, Kolomyja, Stanislawow, Ouman, Kiev, Moscou.)
« ... En ce qui me concerne, j’ai été giflé pendant l’enquête par le lieutenant-major 56 Koudrachov et par son aide « politrouk », dont je ne me rappelle pas le nom. » (2053 – O. L. M., 44 ans, marié, inspecteur d’école, prisonnier à Wilna dans la prison de Loukickki.)
« ... Ils vinrent me chercher tard dans la nuit, me réveillant, pour m’emmener dans le bureau de l’NKVD, où, au cours de l’interrogatoire, ils me giflèrent et m’insultèrent avec des mots affreux, indignes d’un homme. » (2237 – L. E., née en 1913, institutrice.)
« ... Parce que j’étais décoré de l’Ordre « Virtuti Militari » (la plus haute décoration militaire polonaise), je reçus quelques gifles ; ils me disaient que ces gifles étaient la décoration pour la guerre polono-soviétique. » (2783 – J. S., agriculteur, marié, arrêté en décembre 1939, emprisonné à Krzemieniec.)
« ... La conduite des autorités de l’NKVD était ignoble. Je citerai comme exemple le cas du général ou colonel R.
Ce vieillard fut torturé de la manière suivante : plusieurs fois ils lui firent rassembler ses effets lui disant qu’il allait être mis en liberté et, lorsqu’il avait franchi la porte de la prison et se trouvait déjà dans la rue, ils le rappelaient. » (1299 – Z. K., 28 ans, officier de carrière, prisonnier à Léopol – Bryghidki 57.)
« ... Le 16 mai 1940, à 23 h. 45, je fus arrêté dans ma maison à Stryj et conduit dans la prison de l’NKVD...
Au cours des premiers jours du mois d’octobre, une nouvelle enquête eut lieu ; elle dura six nuits. Ils me battaient, à dire vrai, avec moins d’acharnement, mais ils m’infligeaient des tortures morales bien plus grandes. Une nuit, ils me donnèrent lecture de la demande de divorce de ma femme, qui ne voulait plus vivre avec un contre-révolutionnaire, ennemi de l’Union Soviétique. Je savais très bien qu’il s’agissait d’un stratagème de la part des coupe-jarrets bolchéviques ; je me moquai donc de leurs méthodes.
Pour les interrogatoires suivants je fus introduit à minuit 45 dans le bureau du juge d’instruction, qui m’ordonna de me mettre contre le mur ; vingt minutes s’écoulèrent ainsi sans qu’il me posât de question.
Il régnait un silence de tombe, interrompu de temps en temps par le chuchotement des juges qui se consultaient à mi-voix ; après la sortie de l’un d’eux, qui alla dans une autre chambre, j’entendis tout à coup des pleurs et un cri : la voix de ma femme ; le son d’une gifle retentit très distinctement. Je compris immédiatement qu’ils étaient en train de battre ma femme pendant l’interrogatoire.
Je ne sus pas résister, je pris le banc sur lequel j’étais assis et je le lançai contre le juge. Je fus tout de suite immobilisé et je reçus quelques coups sur le visage avec une crosse de revolver et une série d’imprécations bolchéviques...
Je fais remarquer que ma femme ne fut pas arrêtée ; elle dut subir seulement quelques interrogatoires relatifs à l’enquête menée sur mon compte... » (3677 – J. D., 22 ans, sous-officier de carrière, marié.)
« ... Les femmes appartenant aux organisations insurrectionnelles non seulement ont été battues et ont subi de mauvais traitements au cours des interrogatoires, mais elles ont été aussi violentées. Dans le cas d’arrestation de deux époux, afin d’extorquer les aveux, ces tortures étaient infligées à chacun d’eux en présence de l’autre. Un exemple véridique est celui des époux O., mis dans la prison de Lomza ; le mari a été condamné à mort à Minsk (cellule n. 8), de sa femme, on n’a aucune nouvelle... » (4951 – T. Z. J. K., né en 1899, avocat, prisonnier à Bialystok, Minsk et Moscou, arrêté la nuit du 16-17 juin 1940.)
3. VIOLENCES PHYSIQUES
« ... Plusieurs membres de l’NKVD commencèrent à traverser la pièce. Je remarquai immédiatement le plus important en grade avec trois rectangles sur le col. Je sus ensuite que son nom était Kozlov. Ils me regardaient tous et chacun d’eux disait : « Qui est-ce ? Est-ce qu’il parle déjà ? Non ? Ça n’a pas d’importance, il parlera. »
J’éprouvai l’impression la plus désagréable à l’égard de l’un d’eux, un petit homme, maigre, aux dents abîmées, qui portait deux rectangles sur le col. Il me regardait à travers ses lunettes, s’approchant presque jusqu’à mon visage. À un moment donné, il siffla entre ses dents gâtées : « Il n’est jamais arrivé dans l’histoire de l’URSS que quelqu’un n’ait pas parlé. Tu parleras, ma colombe. Nous saurons tenir conversation avec toi. Sinon, une balle dans la tête et il ne restera que la mauvaise odeur de tes tendres os. Gorki a dit : « Si l’ennemi ne se rend pas, il faut le détruire. » (10746 – B. J., professeur de lycée, accusé d’appartenir à l’organisation secrète polonaise et de cacher une typographie.)
« ... Dans la prison de Léopol à Bryghidki, le docteur B. et le fonctionnaire des chemins de fer S. furent battus, pendant les interrogatoires, au point qu’ils ne purent plus marcher pendant quelques semaines. Le lycéen Brz., âgé de dix-sept ans, fut battu sur tout le corps avec une tringle en caoutchouc à un point tel qu’il se produisit une inflammation purulente de la peau sur le dos et sur la poitrine.
En ce qui me concerne, je dirai tout simplement qu’au cours de la perquisition à laquelle je fus soumis dans la prison de Kherson, on m’arracha de la bouche mon dentier en or, après l’avoir brutalement cassé » (1631 – L. K., vétérinaire.)
« ... Pendant mon séjour de onze mois dans la prison, j’étais continuellement soumis à des interrogatoires. Comme j’avais été arrêté pour avoir franchi la frontière soviéto-allemande et pour avoir essayé de passer en Hongrie, l’enquête gravitait autour de deux questions : pourquoi étais-je passé en territoire soviétique et quelles étaient les missions qui m’avaient été confiées par les Allemands ?
La première enquête commença dans la prison de Przemysl. Tous les interrogatoires avaient lieu la nuit. Outre les pièges les plus différents dressés par les membres de l’NKVD afin de me faire dire des contradictions, les gifles étaient à l’ordre du jour, les coups de pied, les menaces d’exécution, etc. Parmi les plus mauvais systèmes d’enquête, il y en avait un qui consistait à obliger l’accusé à s’asseoir sur un petit banc, dans une position déterminée, sans bouger. Pendant l’enquête, je fus tenu deux fois dans une position pareille, de sept à neuf heures. Près de moi, l’enquêteur veillait à ce que je ne fisse pas le moindre mouvement. Il s’écriait à chaque instant : « Parle donc », et il répétait de vilains mots russes. Ceux qui menaient l’enquête étaient des personnes grossières et des délinquants de la pire espèce, d’esprit très borné. Le fait que j’étais né à Niemtse suffit pour leur faire affirmer que j’étais un espion allemand patenté 58 ; j’avais beau expliquer que Niemtse était une localité et non pas l’Allemagne ; je ne réussis pas à convaincre ces enquêteurs bornés. Les femmes chargées de mener des enquêtes étaient, par rapport aux prisonniers, les plus mauvaises et les plus bestiales. Au cours d’un interrogatoire je fus emmené chez l’une d’elles : plus de dix fois elle me frappa au visage en me disant : « Vous ne verrez plus jamais... » (125 – F. D., né en 1911, employé de l’Administration autonome, prisonnier à Przemysl, Léopol (Bryghidki) et Nikolaïev près d’Odessa.)
« ... L’enquête dura quatre bons mois. Je subis quarante interrogatoires de la durée de quelques heures chacun, parfois même de douze heures ; les intervalles entre les interrogatoires étaient très courts, et pendant ces pauses, je n’avais pas le droit de manger. On pensait qu’étant affamé et épuisé de fatigue, je serais capable d’avouer tout ce dont j’étais accusé. Je fus battu et je reçus des coups de pied six fois. Comme une seule personne ne suffisait pas, cinq ou six autres vinrent me frapper jusqu’à me faire perdre connaissance. Je fus appelé une fois pendant la nuit, emmené dans une cour de la prison, et de là transporté en automobile jusqu’à un souterrain, que je ne saurais localiser, avant voyagé dans une voiture fermée. Au milieu de ce local, il y avait du sable ; les parois étaient tachées de sang et portaient des traces de balles de fusil. Un soldat soviétique de l’escorte me demanda encore une fois si j’avouais mes fautes, et après ma réponse négative, il me fit tourner le visage contre le mur ensanglanté. Il répéta que Staline pardonne à ceux qui avouent, puis il sortit un revolver. Il allait tirer sur moi lorsqu’un autre soldat bolchévique arriva en courant, criant de ne pas tirer. On me ramena ensuite en prison, me défendant de dire un seul mot sur ce qui s’était passé.
J. C., de Luck, une de mes connaissances, a été torturé de la manière suivante : ils lui versèrent dans le nez de la soude dissoute dans l’eau. Quelques jours après, à la suite d’une enflure terrible, C. dut se rendre à l’hôpital. J’entendis aussi hurler une femme polonaise dans une cellule voisine, parce qu’on tentait de la violer. Les cris devinrent ensuite plus faibles et je n’entendis plus que ses gémissements. » (1393 – J. K., né en 1903, agriculteur.)
« ... À partir du 17 novembre 1939, j’ai été interrogé plusieurs fois dans la prison de Stanislavov par le chef de l’NKVD. Les interrogatoires duraient quelques heures et avaient lieu deux fois par jour, et même la nuit. À part les menaces au revolver, je n’ai point subi d’autres mauvais traitements.
« ... Le 19 mars eurent lieu des arrestations en masse de membres d’organisations clandestines polonaises. Leur interrogatoire fut cruel. Ils furent battus jusqu’à perdre connaissance avec des tringles en caoutchouc. On leur écrasa les testicules contre les bords des chaises sur lesquels on les força à s’asseoir. Les bourreaux les jetèrent à terre, les tenant par les bras et par les jambes et leur fourrant les cendres du poêle dans la bouche, qu’ils bouchèrent ensuite par des chiffons. Le maître d’école L., de Stanislavov, arrêté le 19 mars 1940, qui était avec moi dans la cellule no 28, fut torturé et battu de cette manière. Après ces « interrogatoires », il resta couché pendant deux semaines ; il avait été battu de la tête aux pieds, de sorte que son corps était complètement noir. Des Ukrainiens accusés d’appartenir à l’OUN (Organisation ukrainienne nationaliste) furent pareillement battus, en septembre 1940. » (2387 – J. M. J., né en 1894, employé technique des chemins de fer.)
« ... Le jour de Pâques 1910, je fus arrêté et transporté dans une voiture de l’NKVD à la gare de Bialystok. Là je fus conduit au premier étage, dans la chambre du Chef de Division des Investigations de l’NKVD, où se trouvait un envoyé de Moscou, qui avait le grade de colonel. Ils commencèrent à me presser de questions, et l’envoyé de Moscou me notifia qu’il était venu exprès pour mon affaire, qui devait se terminer dans la journée ; ils dressèrent une liste de noms d’officiers connus par moi jusqu’à celui du général Haller, et ils insistèrent pour savoir quels rapports j’avais avec le groupe du colonel Dabrowski, opérant dans la région de Czerwony Bor et dans la forêt d’Augustov, quels étaient les officiers qui étaient en rapport avec moi et avec le colonel Dabrowski et où se cachaient-ils.
Ma réponse à toutes ces questions fut la suivante : « Frappez, frappez-moi au visage, maltraitez-moi, puisque je suis désarmé devant vous et puisque vous formulez contre moi de si graves accusations, mais je ne vous dirai rien ; la solution est donc bien simple : une balle dans le crâne, et finissez-en ; le rapport pour Moscou sera immédiatement prêt ». À la suite de cette réponse, les fonctionnaires soviétiques, furieux, se précipitèrent sur moi, me descendirent le pantalon, me jetèrent avec violence, à moitié nu, sur le plancher, et ils se mirent à me battre avec un torchon entortillé et mouillé. Après avoir été trois fois battu de la sorte, je fus de nouveau emmené en prison. Durant la même enquête dans la prison de Bialystok je subis plusieurs fois de mauvais traitements et des coups de la part des représentants raffinés de l’NKVD.
Voyant que je résistais à ces mauvais traitements, ils se mirent à m’exhorter à oublier définitivement la Pologne, à prendre soin de ma santé – tellement compromise – à penser à ma famille et à me mettre à leur service. Je répondis que je ne le ferai jamais.
Parmi les « héros » de l’NKVD qui s’acharnaient le plus contre le personnel des chemins de fer polonais et se distinguaient particulièrement, soit au cours des arrestations, soit dans les prisons de Bialystok, par leur cruauté envers les détenus, je me souviens de Nudelman, Mamjedov, Kokovkin, Lazarevitz. » (2408 – W. K., 48 ans, cheminot.)
« ... Les interrogatoires avaient lieu, d’ordinaire, durant la nuit. Chaque séance durait en moyenne de 10 à 12 heures et même davantage. Les enquêteurs se relayaient et interrogeaient collectivement. Lorsque des méthodes moins brutales ne donnaient pas de résultats désirés, ils avaient très volontiers recours aux sévices. Mes camarades revenaient souvent, après avoir été battues, couvertes de bleus et avec les dents brisées. Moi-même, étant à l’hôpital des prisons de Stanislavov, je fus appelée à l’interrogatoire, malgré la fièvre, et je dus demeurer debout pendant douze heures. Au cours de l’interrogatoire, je fus battue. Plusieurs agents de l’NKVD me commandèrent de me tenir droite, les bras le long du corps, et chacun à son tour, ils me donnèrent des coups de pieds et me frappèrent avec la chaise, n’importe où, cherchant à obtenir ainsi des confessions commodes pour eux, mais ils n’obtinrent aucun résultat. À la suite de cet interrogatoire je souffris de contusions sur tout le corps et en particulier à la jambe gauche, meurtrissures dont je porte encore les traces. Ces mauvais traitements m’obligèrent à garder le lit pendant cinq mois, jusqu’à la fin de l’enquête. » (2163 – P. W., 26 ans, étudiante de l’université.)
« ... Ils se comportèrent envers moi d’une manière excessivement « bienveillante » ; en effet, seulement plusieurs dizaines de fois je fus menacé avec le revolver, rien que quatre ou cinq fois je reçus des gifles, et une fois seulement je bus un quart de litre environ d’encre qui m’avait été versée par force dans la bouche pendant l’interrogatoire. » (4930 – E. T. P., né en 1914, chauffeur mécanicien, prisonnier à Oszmiana, Molodeczno, Polozk sur la Dvina.)
« ... J’étais dans la prison de Léopol, rue Sadowa 7.
... J’ai été interrogé durant six semaines pendant 24 heures environ de suite, avec de courts intervalles pendant le jour. J’ai été frappé avec des encriers, des presse-papiers, des règles et j’ai reçu des coups de poing. Entre 8 h. et 9 h. du soir, nous étions convoqués pour ce que les prisonniers nommaient le « dancing », dans la chambre no 33 de l’immeuble de la rue Sadowa. Le général de l’NKVD Klepov, le colonel de l’NKVD Karaganov, le lieutenant-major Dajev, chargé des investigations, prenaient part à cette « séance ».
Ils battaient les prisonniers jusqu’à minuit avec des tringles en caoutchouc autour desquels ils avaient enroulé du fil de fer barbelé : puis un intervalle, pendant lequel ils enfonçaient des allumettes sous les ongles des malheureux ; une heure après, les coups recommençaient, se prolongeant jusqu’à 4 h. ou 5 h. du matin. Les victimes étaient ensuite portées inanimées sur les chaises par les soldats et de nouveau enfermées dans la cellule. À quelques-uns, ils faisaient sauter les dents ou leur écrasaient les organes sexuels. » (5409 – S. F., 44 ans, chef de gare, veuf.)
« ...Au cours d’un interrogatoire, un nommé Cyprien Kominski, du village de Hute (commune de Osowce, arrondissement de Drohiczyn Poleski), a été tué en ma présence par les hommes de l’NKVD. » (1778 – P. F., né en 1897, agriculteur.)
« ... Je fus enfermé dans la prison de Berezwecz, située dans les édifices d’anciens couvents, transformés on prison par les bolchéviques.
... Lorsque je fus appelé pour l’interrogatoire, ils m’offrirent d’abord une cigarette puis ils commencèrent par me demander si j’appartenais à l’organisation anticommuniste. Comme je leur répondis négativement, ils se mirent à me « lire la constitution de Staline 59 », qui consistait en une tringle en caoutchouc de la longueur d’un mètre environ et de deux centimètres et demi de diamètre, avec laquelle ils me frappèrent jusqu’à me faire perdre connaissance. Chaque fois qu’ils me répétaient la question, ils me battaient ainsi. Après cet interrogatoire, je fus jeté dans la cellule de rigueur, vêtu du seul linge et des chaussettes : nous étions au mois de février. Lorsqu’au cinquième jour, je m’évanouis de froid et de faim, ils me transportèrent dans une autre cellule et, quand je revins à moi, je m’aperçus que j’étais habillé. Cela continua ainsi jusqu’au moment où j’acceptai l’accusation d’être membre de l’organisation antisoviétique.
Je les vis de mes propres yeux ramener dans les cellules, après les interrogatoires, des prisonniers évanouis.
En outre, des cris épouvantables de femmes torturées arrivaient constamment à nos oreilles, surtout pendant la nuit. C’étaient des cris de supplication, de malédiction et de prière. Par moments, les hurlements s’affaiblissaient ; nous en déduisions que les malheureuses étaient bâillonnées. Quelques-uns n’eurent pas la force de supporter tout cela. Par exemple, le propriétaire de la ferme de Kurylowice, dans l’arrondissement de Dzisna, du nom de Muraszow, se tua en se mettant la tête dans le poêle allumé. » (4400 – B. A., né en 1897, agriculteur, marié.)
« ... Le 21 octobre 1939, je fus arrêté dans le bureau soviétique du chef de la division du mouvement de Sarny. La nuit, je fus transporté à Kovel.
... L’interrogatoire des prisonniers avait lieu après minuit. Ils revenaient de chaque interrogatoire roués de coups et avec les dents brisées. Je cite un fait : Le secrétaire général de l’Association professionnelle des employés des chemins de fer de Varsovie Grylowski Stanislas, connu pour son activité sociale, mourut dès son retour de l’interrogatoire...
G., fonctionnaire des chemins de fer, qui avait servi dans les usines de la gare de Kovel, arriva la nuit dans la cellule n. 29, couvert de bleus et de meurtrissures, à la suite des coups qui lui avaient donnés les hommes de l’NKVD durant l’enquête. Je vécus avec ces personnes dans la même cellule. Je fis, à mon tour, l’expérience des systèmes brutaux de l’NKVD... Un jour, pendant un interrogatoire, je fus enfermé dans un placard, pendant quelques minutes, et je m’évanouis par manque d’air. » (2764 – H. S., né le 14.IV.1900, chef de gare.)
« ... Après une détention de trois jours, je fus emmené à Bialystok dans le bureau central de l’NKVD, pour un interrogatoire ultérieur. Je fus donc conduit dans une chambre où était installé un tube en caoutchouc conduisant l’eau au robinet. Ils me placèrent le visage contre le mur et un homme de l’NKVD m’introduisit le tube dans la bouche. Je fus ainsi obligé d’avaler de l’eau jusqu’à perdre connaissance. Ils me firent revenir à moi en pratiquant la respiration artificielle, puis recommencèrent l’interrogatoire. Ils voulaient que je confesse que j’appartenais au service d’espionnage. Je reçus des coups de pied et des gifles et je fus ramené en prison et enfermé dans une cellule sombre, où je restai isolé pendant dix jours. Mon procès fut renvoyé deux fois. La sentence fut enfin rendue, mais non pas en ma présence, par un collège de juges, formé de membres de l’NKVD de Moscou, qui me condamna à huit ans de travail dans les camps de concentration. » (8440 – J. S., né en 1899, chef de gare.)
« ... Au début, je fus accusé d’espionnage et battu avec une règle sur le dos et sur les côtes. J’ai reçu des coups de poing au visage, ainsi que des coups de crosse de revolver sur les côtes. Chaque coup était accompagné d’injures vulgaires. L’inquisiteur, voyant qu’il n’obtenait pas le résultat attendu, m’emmena dehors où il me montra de quelle façon un autre agent de l’NKVD s’acharnait sur le capitaine Baranowski. Celui-ci avait été placé contre le mur et cinq soldats soviétiques chargeaient leurs fusils, se préparant à tirer.
Au cours de cette scène, l’homme de l’NKVD frappait le capitaine, avec un revolver, en criant : « Canaille d’officier polonais ! » Je n’ai pas vu ce qui s’est passé ensuite... Seulement, celui qui m’interrogeait menaça de me fusiller. Une fois rentré dans le souterrain de la prison, je trouvai le capitaine dans un état horrible. Il avait été battu car il avait caché sa carte d’identité d’officier. Il y avait beaucoup de cas pareils. Celui qui vient d’être cité par moi a eu lieu à Nadworna le 20 décembre 1939. » (6799 – L. J., employé.)
« L’enquête a duré six mois. Six mois, dont le souvenir me fait encore peur. Elle a été conduite par cinq coupe-jarrets.
J’étais accusée d’appartenir à une organisation de résistance polonaise (ZWZ). J’étais appelée presque chaque nuit pour l’interrogatoire, qui durait de dix à vingt heures, sans qu’on me permît de m’asseoir. Je devais rester debout, bien droite.
Le répertoire d’injures et de gros mots que j’ai entendus m’a montré que le vocabulaire de malédictions et d’injures est chez les bolchéviques plus riche que dans n’importe quelle autre population du monde.
Au début, j’en étais choquée, mais toutefois pas offensée ; puis, la chose me devint tout à fait indifférente ; finalement, je n’entendais même plus ces mots vulgaires. C’était pis avec les gros souliers des inquisiteurs et avec le bâton en caoutchouc.
Les coups au visage, qui m’humiliaient, étaient plus terribles encore. » (7328 – S. I., née en 1918, étudiante d’école secondaire, prisonnière à Vygoda, Stanislavov, camp de Starobielsk et camp de travail de Vorkouta.)
4. AGENTS PROVOCATEURS DANS LA PRISON
« ... Le 5 juin 1940, je fus arrêté par l’NKVD, sous l’accusation d’appartenir à l’organisation partisane. Au cours de l’instruction, je fus enfermé dans la prison de Lida. L’instruction fut menée par le sous-lieutenant Tchevitchalov.
... J’étais enfermé avec un « mouchard » de la police soviétique dans une cellule séparée, mais j’ignorais au début sa qualité. Il m’ennuyait continuellement, insistant pour que j’avouasse que j’étais un partisan, et affirmant que, si je l’avouais, ils me remettraient en liberté et me délivreraient un certificat attestant que j’étais leur collaborateur. Il me tourmenta ainsi du 15 juin jusqu’au 1er juillet ; alors voyant que je persistais dans mon attitude négative, il commença à me battre, me donnant des coups de pied et disant : « Tu mourras comme un chien sous mes coups. » Cela se passait dans une cellule pour un seul prisonnier, dans laquelle nous étions deux. Pendant la nuit, j’étais appelé par le sous-lieutenant Tchevitchalov, qui employait le même système que le « mouchard ». Ils me torturèrent ainsi pendant dix jours. Le onzième jour, le mouchard me frappa si violemment que je perdis connaissance. Une fois revenu à moi, je m’aperçus que j’avais été transféré dans la cellule de rigueur, une cellule humide et froide, où il manquait un grabat pour pouvoir s’allonger, et je devais donc rester debout. Je restai là pendant 24 heures. Je fus ensuite ramené dans la cellule précédente. Je fus de nouveau interrogé pendant la nuit ; l’officier enquêteur m’engagea à avouer, sans quoi je serais battu et envoyé pourrir dans la cellule de rigueur. L’interrogatoire dura toute la nuit. Le matin, je fus renvoyé dans la cellule et, pendant cinq jours, je subis les tortures infligées par le mouchard ; après quoi, l’officier me renvoya dans la cellule de rigueur, pour six jours encore, avec 200 grammes de pain et un litre d’eau par jour. Pendant tout ce temps-là les interrogatoires nocturnes continuaient. Le sixième jour je fus appelé encore une fois pour un interrogatoire de la durée de cinquante heures, sans interruption. À cause du manque de nourriture, je m’évanouis, et, lorsque je revins à moi, je me trouvai de nouveau dans la cellule avec le mouchard. Il me répétait continuellement que je devais avouer, et il me battait sans cesse. « Ne pense plus à la Pologne, me disait-il, la Pologne a été déjà effacée de la carte du monde et seuls les Soviets et l’Allemagne gouverneront le monde entier ; la Pologne pourrie est finie à jamais... » (4096 – W. T., cheminot, marié.)
« ... Il s’appelait Alexandre Nikolaievitch Iefremov. Homme intelligent, licencié de l’Université de Léningrad, il avait travaillé en qualité de vice-rédacteur à la « Pravda de Irkoutsk » jusqu’à l’époque de son arrestation. Étant prisonnier, il était au service de l’NKVD, comme informateur. D’après nos discussions sur des sujets généraux, il se persuada que j’étais un acharné et irréconciliable ennemi du système communiste. Il formula donc contre moi une accusation spéciale, basée sur de prétendus récits que j’avais faits dans la cellule, au sujet des fusillements des « boïez » en 1920, de mon activité dans le contre-espionnage au détriment de l’URSS, etc., etc. Lorsque Iefremov fut enlevé de la cellule, je fus appelé par le fonctionnaire enquêteur, lequel reprit l’interrogatoire en se basant sur la nouvelle documentation recueillie à ma charge. Il me fit lire tout ce matériel d’accusation et m’exhorta à avouer. Comme je n’acceptai pas tout court les accusations, le juge ordonna une confrontation devant lui, après la réunion d’une commission composée du juge instructeur Krasnov, président du doyen des juges d’instruction, et de trois autres juges, sept personnes en tout. Je fus invité pour la deuxième fois à confesser sincèrement mes fautes. Je repoussai toutefois les fausses accusations. On me confronta alors avec celui qui devait prouver ma culpabilité – c’était mon compagnon de cellule. Après la vérification de son identité et la recommandation de déclarer la vérité en tenant compte des responsabilités contractées devant la loi pénale, la parole fut donnée au témoin. Il prononça les accusations d’une voix haute et claire, montrant une parfaite maîtrise de lui-même. Son « discours » dura vingt minutes ; après quoi, on me donna la parole. À cette époque je n’étais pas encore bien maître de la langue russe, de sorte que mes explications n’étaient ni concises ni claires. Afin de repousser les accusations faites par le témoin, j’en appelai aux documents en possession du juge, c’est-à-dire au dossier personnel de la Direction des forêts domaniales de..., dans lequel étaient réunis tous mes documents personnels et ceux du service. Puis, la parole fut de nouveau donnée au mouchard ; puis, encore à moi. Cela dura toute la nuit. Toutes les déclarations faites au cours de la confrontation furent consignées par le juge Krasnov, et signées au bas de chaque page, par moi en ce qui concernait ma déposition, et par le mouchard en ce qui concernait les siennes. Cette comédie se prolongea pendant six heures environ et ébranla fortement mes nerfs.
Cette confrontation fut l’acte final de l’instruction, le 28e interrogatoire subi par moi. » (5860 – B. N., 42 ans, agent forestier.)
5. LES JUGES D’INSTRUCTION
« ... Tous les interrogatoires avaient généralement lieu la nuit. Cela pour que la mise en scène fût mystérieuse et menaçante, et afin de démontrer au monde entier combien les hommes de l’NKVD étaient surchargés de travail pour nettoyer l’Occident pourri capitaliste.
... Je fus interrogé par quatre fonctionnaires différents, et j’eus l’occasion d’en étudier les différentes conduites. L’un d’eux accomplissait son devoir comme une nécessité ennuyeuse ; un autre se démenait, menaçait avec un revolver, etc. La plupart des jeunes gens, récemment promus à des charges soviétiques, appartenaient à cette deuxième catégorie. Quelques-uns adoptaient des moyens de persuasion : « Parle, avoue, il ne t’arrivera rien. » En dernier lieu je fus interrogé par le chef de l’NKVD de l’arrondissement, qui avait le grade de capitaine. Il employait le système de la « surprise ». Il entamait une conversation du genre d’entretien privé, parlant tout simplement du beau temps ou des bons rapports entre Russes et Allemands, puis tout d’un coup il posait une question qui avait trait à l’enquête. Je fais remarquer qu’en me donnant le procès-verbal à signer, il laissait toujours un blanc pour sa signature, de sorte que je ne connus jamais son nom. C’était un homme prévoyant.
Je crois que tous ces inquisiteurs avaient leurs « règles » pour leur travail, et comme les tâches qui leur étaient confiées n’étaient pas bien longues et qu’ils n’étaient pas mal du tout dans notre territoire, ils cherchaient à faire traîner leur travail en longueur le plus possible. Il me semble clair à présent que les punitions étaient déterminées au préalable pour les différents genres de « délits », sans tenir compte des cas particuliers. Par exemple, pour le délit de « contre-révolution » prévu par l’art. 58 du C. P., chacun recevait huit ans, sans tenir compte s’il s’agissait d’un chef d’arrondissement ou d’un adjoint communal ou d’un commandant de police du district ou bien d’un simple agent de police. Pour avoir franchi la frontière en entrant en URSS (art. 120) : trois ans ; pour l’avoir franchie en sens inverse : cinq ans. Ces peines étaient infligées par un collège spécial de juges. Les juges suivaient, chacun en particulier, des « principes » un peu différents, mais à peu près pareils. » (358 – W. K., né en 1901, comptable.)
« ... Le 9 mai 1940, nous fûmes emmenés à Irkoutsk et enfermés dans la prison politique de Krasnyi Korpus (« Corps rouge »).
Si nous répondions « oui » aux questions du juge, il se montrait aimable et nous permettait, ou mieux nous commandait de nous asseoir ; si au contraire nous répondions « non », les choses se gâtaient. Il fallait alors rester debout pendant tout l’interrogatoire, ce qui pouvait durer même huit heures. Les jambes s’enflaient, tout tournoyait, le bureau du juge et sa personne même prenaient les aspects les plus différents. Les demandes devenaient de plus en plus incompréhensibles, et, par conséquent, les réponses non plus ne pouvaient pas être logiques. Posant des questions importantes, le juge se laissait aller à des gestes de « tendresse », tortillant, par exemple, autour d’un crayon les cheveux, la barbe et les moustaches de l’accusé ; il les tirait ensuite brusquement comme le font les bouchers pour arracher les poils de soie des cochons.
On ressentait une douleur aiguë qui faisait venir les larmes aux yeux. Pendant trois mois, dans l’établissement des bains, il n’y avait pas eu de coiffeur ; les cheveux et la barbe s’étaient donc allongés, de sorte que le juge instructeur avait la tâche plus aisée. Les traces sur la tête et sur les lèvres existent encore aujourd’hui. Je fus d’abord interrogé par le juge Iermakov et, lorsque celui-ci, après le délai établi par le procureur en chef de la division, ne put guère s’occuper de moi, je fus confié au juge Krasnov. Jeune, blond, grand, de bonne mine, sous-lieutenant de l’NKVD, il comprenait le polonais, mais il ne se trahit jamais au cours des dix-huit interrogatoires. Il était spécialisé dans les sévices et dans les tortures. Son vocabulaire, pour ce qui est des blasphèmes, était tellement riche que celui des « ourki » et des « repris de justice » paraissait bien pauvre. Homme intelligent, instruit, psychologue raffiné, il savait à merveille cacher ses vraies pensées. Il portait toujours avec élégance, tant l’uniforme que l’habit civil. La plupart des Polonais étaient interrogés par lui. Son bureau, comme celui d’autres juges, était richement meublé : bureau en chêne, chaise et fauteuils en hêtre, deux appareils téléphoniques automatiques, lampes électriques multicolores. Le plancher était recouvert de tapis, les parois couvertes de tissus qui amortissaient les pleurs, les cris et les plaintes. Les lampes en couleurs éclairaient au moment propice l’accusé, le juge et les papiers sur lesquels celui-ci écrivait. Le nécessaire à écrire et le papier étaient de première qualité. Il fumait des cigarettes et offrait parfois des « bielomorkanal » (une des meilleures marques de cigarettes soviétiques) ; il se servait d’un élégant briquet à essence et portait une montre bracelet en or de marque étrangère. Pendant les interrogatoires, des femmes élégantes et jolies venaient lui rendre visite, sous prétexte du service ou pour fumer une bonne cigarette. Il interrompait alors l’interrogatoire, feignait de ne pas me voir et me traitait en ami, m’invitant à prendre part à la conversation mondaine. » (5860 – B. M., né en 1902, expert forestier, marié.)
CHAPITRE VI
L’ÉMISSION DE LA SENTENCE
1. LES DÉBATS JUDICIAIRES
« ... Une fois l’enquête terminée, le soir du 9 octobre, ils cessèrent de me torturer, et le 11 octobre 1939, je fus appelé aux débats judiciaires. J’étais accusé, d’après leur code, art. 54 § 6, 54 § 8, 54 § 2 II et 54 § 13, des délits d’espionnage, d’action à main armée et d’actes contre-révolutionnaires. Je fus jugé par un tribunal de guerre du 13e Front ukrainien à Drohobycz. Condamné à mort. Après les débats et la sentence, je fus emmené de la salle directement dans une cellule de ségrégation pour attendre l’exécution. Je restai là, isolé, depuis le 11 octobre 1939 jusqu’au 12 janvier 1940. Le 12 janvier 1940, je fus transféré de la cellule de ségrégation dans la cellule commune no 5, où je rencontrai Stypula Jean, garde forestier de Boryslaw, qui, condamné à mort, mourut plus tard à Kolyma, les professeurs S., M., J. et M. de Boryslaw et d’autres personnes encore, dont j’ai oublié les noms. J’appris par mes compagnons de prison que les bolchéviques avaient publié mon arrêt de mort le 12 octobre 1939, annonçant à ma femme que j’avais été fusillé. Le 17 janvier 1940 je fus transféré avec tout le groupe de prisonniers politiques et communs à Léopol, dans les prisons de Bryghidki. » (6816 – K. A., né en 1897, fonctionnaire du service sanitaire.)
« Le 21 juillet 1940, eut lieu mon procès pour une action contre un fonctionnaire de l’NKVD et se termina par une condamnation à trois ans de prison : La sentence était définitive. Comme le procès avait lieu dans la ville de R., où vivaient mes parents, ma sœur apprit, je ne sais comment, que j’avais été emmené dans ce lieu et accourut me voir. Les autorités soviétiques lui interdirent de me faire visite, mais, sur mes prières, un geôlier me fit avoir un entretien avec elle ; j’appris ainsi que mes parents avaient été déportés dans le cœur de la Russie, que tous nos biens avaient été confisqués par les bolchéviques et que ma sœur était sans nouvelles de nos parents.
Je fus ensuite emmené à Molodeczno et de nouveau enfermé dans une cellule pour prisonniers politiques. Les interrogatoires continuèrent et mes conditions de vie ne chargèrent pas.
Au mois de septembre 1940, sans m’avoir fait comparaître devant les juges, on prononça contre moi une sentence me condamnant à dix ans de réclusion. Comme je récusai cette sentence en déclarant que je n’avais pas été conduit au tribunal et que je n’avais signé aucun procès-verbal d’accusation, ils m’enfermèrent pendant cinq jours dans une cellule de ségrégation. » (110 – J. J., sous-officier.)
« ... Les débats durèrent deux jours. Le premier jour depuis 8 h. du matin jusqu’à 4 h. du soir, le second depuis 9 h. jusqu’à 15 h. Nous étions au nombre de douze, accusés d’un prétendu plan d’attaque contre les casernes.
Dans des voitures escortées de pelotons de mitrailleurs, nous fûmes emmenés à l’hôtel de Cracovie où le procès devait avoir lieu. Le trafic fut interrompu dans les rues de Léopol pendant notre passage. La salle des débats était rouge de drapeaux et tapissée de portraits de Staline. L’auditoire : vingt-deux hommes armés de revolvers et de fusils. (Plaidants d’office.) Je fus honoré d’avoir eu cinq plaidants d’office ; je dois toutefois faire remarquer que trois d’entre eux, lorsqu’ils eurent pris connaissance de l’acte d’accusation, refusèrent d’assister au procès. Les débats ne furent qu’une tragi-comédie mal montée. Les représentants de l’accusation publique n’étaient vraiment pas brillants ; ignorant la loi, ils se perdaient dans les débats et tombaient souvent dans leurs propres pièges. Er ce qui concerne la sentence, elle avait été auparavant préparée sans tenir compte du pli que les débats auraient pris, de sorte que les rôles et la présence même des défenseurs étaient parfaitement inutiles. Les défenseurs nous poussaient d’autre part à avouer, à nous repentir et à demander une peine mitigée. Mais leur rôle se renversait souvent et ils se transformaient de défenseurs en accusateurs.
Après toute cette comédie, la sentence fut rendue. La peine de mort fut infligée au capitaine S. K. (j’ignore son sort ; j’ai appris seulement qu’en 1941 il était dans les prisons de Moscou). Les autres accusés et moi, nous fûmes condamnés à 10, 8 et 5 ans de travaux forcés dans les camps de concentration. Dans le texte de la sentence, il y avait des absurdités de ce genre :
« On condamne à dix ans de travaux et à la privation des droits civils pendant cinq ans l’étudiant de l’école polytechnique de Léopol K. S., parce qu’au cours du procès, répondant à une question du plaidant, il a déclaré préférer l’ancienne Pologne à la présente (la Pologne rouge). » Durant les deux jours des débats, nous ne reçûmes aucune nourriture, « car la nourriture devait être fournie par la prison ». Bien que de nombreux civils, parents et amis des accusés, se tenaient devant l’édifice avec des paquets de vivres, il leur était interdit de nous voir : ils ne nous permirent même pas de recevoir des cigarettes. Après la sentence, nous fûmes ramenés dans la prison de Bryghidki, avec un déploiement de forces excessif. » (1336 – S. Z., né en 1912, lieutenant d’artillerie.)
« ... L’acte d’accusation me fut notifié deux jours avant le procès, au cours duquel on m’adressa des accusations dont on n’avait pas soufflé au cours de l’enquête ; en effet, outre la tentative de franchir la frontière, on m’attribua aussi le délit d’avoir tenté d’organiser un groupe qui aurait dû franchir la frontière avec moi, ainsi que l’intention d’entrer dans l’armée polonaise 60, dans le seul but de pouvoir engager la lutte contre l’armée rouge ; on m’accusa enfin d’appartenir à l’« OZN » (Union Nationale Polonaise). On ne prit pas en considération les résultats de l’enquête ni les arguments adoptés à ma décharge ; on ne m’accorda aucun moyen de défense ; on ne me communiqua point le contenu des dépositions faites par des témoins inconnus ni celui du matériel réuni pour ma justification. Les déclarations faites par moi au cours du procès pour me disculper furent tout simplement consignées de la manière suivante : « Il n’avoue pas sa tante. » Bref, l’accusation ne fut pas légalement prouvée. La sentence fut rendue peu de minutes après la fin des débats et la copie me fut remise quelques jours après. La sentence contenait : a) le nom du tribunal ; b) sa composition ; c) la date ; d) la localité ; e) la description du délit ; f) l’arrêt de la sentence avec référence aux sources légales ; g) l’indication des moyens d’appel. L’énoncé de la sentence était seulement basé sur le « matériel qui était aux actes ». (1402 P. W., né en 1909, fonctionnaire de 1re catég.)
« ... Je rapporte la formule de la sentence d’après laquelle, le 26 juillet 1941, je fus condamné à la peine de mort (je fus gracié par la suite) :
« PRIGOWOR 61 »
Le Tribunal Révolutionnaire de la Carélie-Finnoise RSS célébrant, au cours de la session judiciaire du jour..., le procès contre l’accusé P. Z. R., accusé d’après l’art. 58, § 10 IIe partie du code pénal de la RFRSS, décrète :
Le dénommé P. Z. R., né à Varsovie, âgé de 24 ans, polonais, fils d’un colonel, d’instruction moyenne, incensurable, arrêté en 1939 par les fonctionnaires de l’NKVD et jugé par la Commission Spéciale de l’NKVD comme un sujet socialement dangereux, le destinant pour cela aux camps correctionnels de travail pendant huit ans, s’est rendu coupable du délit prévu par l’art. 58 § 10, IIe partie du code pénal RFRSS, car :
l’accusé P. Z. R., travaillant dans ces camps, a mené l’agitation contre les autorités soviétiques, instiguant les camarades à ne pas travailler, il a organisé le sabotage contre-révolutionnaire, il a fomenté le trouble parmi les prisonniers polonais, disant que l’URSS croulerait sous peu et que la Grande-Bretagne reconstituerait la Pologne. En qualité d’élève du Corps des Cadets, imbu de l’esprit fasciste polonais, il a montré qu’il est un ennemi de l’Union Soviétique.
L’accusé P. Z. R. a complètement avoué sa faute.
Le Tribunal Révolutionnaire, après avoir examiné le procès de l’accusé P. Z. R., a reconnu ce dernier coupable d’infraction à l’art. 58 § 10 IIe partie du code pénal et a décidé d’adopter envers lui le plus haut moyen de défense sociale, le fusillement.
La faculté de se pourvoir en grâce est accordée au condamné.
La sentence est définitive et n’admet pas d’appel.
Le Président du Tribunal Révolutionnaire
Major PIETROW
Le 1erAssesseur
Capitaine KUZNIECOW
Le 2eAssesseur
. . . . . . . . . . .
Le Secrétaire
. . . . . . . . . . .
Signature du condamné :
(1486 – Z. P., 25 ans, célibataire.)
« ... Mon procès se déroula au mois de novembre 1940 (l’acte d’accusation consistait en treize pages, dans lesquelles on déclarait que j’appartenais à une organisation clandestine ; je ne possède pas une copie de l’acte d’accusation). Les débats eurent lieu à huis clos. Le tribunal était composé du juge, de deux assesseurs, du procureur et du plaidant. Durée du procès : depuis 10 h. jusqu’à 24 h., sans interruption. Les débats se déroulèrent en langue russe par manque d’interprète. Il s’agit d’une véritable enquête faite soit par le juge, soit par le procureur. Les faits suivants sont restés gravés dans ma mémoire :
a) Pendant les débats, on lança contre ma patrie les mêmes injures que j’avais entendues au cours de l’enquête. On dit que la Pologne n’existerait plus ou qu’elle serait sous le pouvoir de l’Union Soviétique, et que, si elle survivait, ce ne serait certainement pas grâce à l’Angleterre et aux États-Unis ;
b) On dit que l’Angleterre et l’Amérique, pays capitalistes, sont ennemies du peuple, et considèrent les Polonais comme des « valets d’écurie ». Les Soviets seuls domineront le monde entier.
c) Le procureur, prenant la parole, déclara que le peuple polonais a toujours eu la réputation d’être un peuple de bandits et de révolutionnaires, c’est pourquoi il fallait le détruire complètement pour qu’il n’en reste aucune trace.
La sentence fut lue et mon collègue, le prof. K, et moi, nous fûmes condamnés à la peine de mort. Cette peine fut par la suite commuée en dix ans de travaux forcés dans les lointaines régions de l’URSS. Mon oncle K., et un autre collègue, K., furent condamnés à dix ans de travaux forcés. J’ignore leur résidence actuelle. » (1121 – L. T.)
« ... Je fus arrêtée dans la colonie de Zolotogorka, kolkhoz de l’arrondissement de Arik-Balyk, région d’Akmolinsk, de la RSS du Kazakhstan, à la suite d’un rapport envoyé à la section locale de l’NKVD par la section de l’NKVD de Pinsk, et à la suite, je le suppose, d’une délation d’un homme du kolkhoz, dont la situation dans le parti était ébranlée à cause de nombreuses irrégularités financières.
Ils vinrent me chercher le lundi 25 ou 27 août 1940, dans le courant de l’après-midi, avec un grand autocar sur lequel il y avait huit hommes de l’NKVD avec la baïonnette au canon. Après une perquisition rapide mais minutieuse, ils me confisquèrent mon diplôme de baccalauréat, le doctorat du « Queen’s College » de Londres et 150 pages manuscrites d’un livre inachevé ainsi que quelques notes au sujet de mes impressions en Russie et 70 extraits de sentences rendues dans des différentes villes de la Russie soviétique et du Kazakhstan. Ces sentences avaient trait à des délits tels que le retard à se présenter au travail, l’appropriation de la part d’employés de « biens appartenant au peuple soviétique », à savoir : un morceau de charbon, une bande de gaze, un peu de sciure, une planchette ou d’autres rebuts ; une peine de six mois à deux ans de prison était prévue pour ces délits. D’après la loi du mois de juin 1940, une peine allant de deux mois jusqu’à un an était prévue pour ces délits. Celui qui dérangerait l’ordre public dans la rue, dans les rangs, dans les réunions ou pendant le travail, pouvait être condamné à un an de prison et ceci « dans un but éducatif, afin de civiliser les citoyens soviétiques en leur apprenant la bonne éducation ».
À Arik Balyk je fus enfermée dans une prison préventive, nommée prison « d’isolement », où une petite souris fut ma seule compagne.
Pendant deux jours, ils ne me donnèrent pas même un peu d’eau. Je reçus par la suite du pain et de l’eau et, tous les deux jours, une poignée de pâtes cuites, assaisonnées avec quelques gouttes d’huile, parfois avec un peu de suif ou bien du lard rance.
La fenêtre était fermée par des planches et la lumière pénétrait seulement à travers les fentes. De ce lieu, je fus conduite dans la prison préventive d’Atbasar, où j’attendis le procès pendant deux mois.
À cause des distances énormes, je ne fus pas emmenée à Akmolinsk ; mon procès se déroula cependant le 6 décembre 1940 devant la « session mobile ».
Le matin du 6 décembre, à 10 h., la clef grinça dans la serrure et le chef de garde rentra dans la cellule : « Reutt, prépare-toi à te rendre au procès, mais dépêche-toi. » Un Kazakh m’attendait dans le couloir, avec la baïonnette au canon.
Nous traversâmes une place couverte de neige pour rejoindre le siège de l’NKVD, où les débats devaient avoir lieu. Nous entrâmes dans l’édifice, dans une grande chambre malpropre ; j’aperçus là le bolchévique qui m’avait dénoncée et une Polonaise, femme d’un sous-officier, avec laquelle j’avais habité. Je fus emmenée de cette grande pièce dans une chambrette à côté, tout aussi sale et sombre, où j’attendis que le tribunal se réunît.
À 11 h., je fus finalement introduite dans la salle, c’est-à-dire dans une petite chambre au milieu de laquelle se trouvait une longue table en bois ; le long de celle-ci un banc et aux deux extrémités des chaises ; près de la porte un escabeau ; le long du mur à gauche un petit banc et aussi un escabeau. Les membres du tribunal étaient assis devant la table : le président, un Russe au visage bestial d’orang-outang ou de chimpanzé, sur le banc du milieu ; les deux assesseurs, deux jeunes femmes ni laides ni jolies, étaient à sa droite et à sa gauche. L’une d’elles avait une très jolie peau et des yeux bleus ; elle était vêtue d’une robe en cheviotte à bon marché et d’une blouse rouge (couleur dans laquelle on peut facilement teindre n’importe quel chiffon) ; l’autre portait un pull-over foncé. Ni l’une ni l’autre ne pouvaient avoir plus de dix-huit ans. Le secrétaire, un Mordvin ou un Mariiez qui parlait russe avec un accent caractéristique, était assis à gauche. À un bout de la table, il y avait le procureur Kazakh, homme trapu, au visage mat, avec deux petits yeux malicieux, un nez écrasé et un visage large et aplati. L’avocate, la camarade Kondratovitc, mince, petite, avec un visage souffreteux et des lèvres longues et serrées, était assise en face de lui.
Dès que je fus entrée, ils m’ordonnèrent de m’asseoir sur une chaise près de la porte, en pleine lumière, et pendant dix minutes environ ils me dévisagèrent avec des regards sévères. Ils voulaient probablement me troubler et m’intimider. Ils m’ordonnèrent ensuite de me lever et commencèrent la lecture de l’acte d’accusation. Le procès se déroulait à huis clos. La seule personne étrangère était un garde qui était à côté de moi. L’acte d’accusation contenait de nombreux griefs. Fait caractéristique : les juges affirmaient avec entêtement que j’étais née à Pinsk. Quand je voulus protester, leur indiquant le lieu exact de ma naissance (région de Kielce), ils répondirent que la chose n’avait point d’importance et ne pouvait pas modifier le cours du procès. En réalité, ils tenaient à me traiter comme leur sujette ; en effet, tous ceux qui sont nés dans les territoires de la Pologne orientale sont déclarés citoyens soviétiques et personne n’a donc le droit d’intervenir en leur faveur. Que n’y avait-il pas dans cet acte d’accusation ! On relevait entre autres que je n’avais pas suivi mes enfants en Allemagne et on en déduisait que j’étais restée afin de pouvoir observer de près la vie russe et critiquer ensuite le gouvernement soviétique, que j’avais l’intention de mener une activité anti-communiste, que, d’après mes déclarations, les plus humbles paysans vivaient chez moi mieux que les hommes des kolkhoz en Russie, que j’étais une propriétaire et par conséquent ennemie de la classe des travailleurs, que je buvais le sang de la population et que je m’enrichissais de sa sueur, que j’avais collectionné des journaux découpés en silhouettes pour avoir une documentation en vue de ma propagande anti-communiste ultérieure, puisque j’avais l’intention d’exploiter les mesures « pédagogiques », provisoirement adoptées par le gouvernement soviétique, en vue d’une campagne diffamatoire contre l’URSS, qui consistait à dire que « les Soviets seront certainement balayés et que mes compatriotes et moi, nous retournerons en Pologne. »
Le secrétaire donna lecture de cette litanie d’une voix monotone, traînante, comme un bègue. Tout le monde écoutait avec attention et j’observais les visages des dignitaires. Une femme assesseur se grattait la tête et l’avocate tapait sur la table avec le crayon ; le procureur, lui, avec un grand flegme, se mettait les doigts dans le nez.
La lecture se termina enfin. Un court silence suivit, puis le Président toussa et commença à me poser des questions.
Que faisait l’accusée avant la guerre ? Je répondis que j’écrivais, que je m’occupais de ma maison et d’activités sociales.
Président : « Elle a organisé la propagande anti-communiste... »
Procureur : « Elle était non seulement ennemie du communisme, mais aussi du peuple travailleur. »
Président : « L’accusée avoue qu’elle vantait son régime capitaliste, disant que dans l’ancienne Pologne le valet d’écurie vivait mieux que les hommes du kolkhoz dans la Russie communiste. »
« Non, leur dis-je, je ne l’avoue pas. Je n’ai jamais vanté le régime capitaliste. J’ai cependant affirmé un fait certain, c’est qu’en Pologne les ouvriers et les paysans vivaient mieux qu’en Russie. »
Procureur : « Non pas en Pologne, mais dans l’ancienne Pologne. »
« En Pologne et non pas dans l’ancienne Pologne. »
Président : « La Pologne n’existe pas et n’existera plus. »
« La Pologne existe et existera. »
Procureur (sévèrement) : « La Pologne n’existera plus. »
« Elle existera », insistais-je.
Président : « L’accusée ne doit pas oublier qu’elle ne doit répondre qu’aux questions posées. »
On me posa nombre de questions pareilles.
On appela finalement les témoins.
Le membre du parti arriva le premier. Il me regarda de travers. On lui donna lecture de la formule qui l’obligeait à dire la vérité pour éviter des responsabilités pénales. Il était très troublé, tout à fait effaré. Il bougeait la tête, s’étirait les doigts, les faisant craquer ; il ne me regarda pas une seule fois pendant l’interrogatoire. Le Président commença à lui poser des questions :
« Connais-tu l’accusée ? » Il fit signe de la tête : « Je la connais. »
« La considères-tu comme une ennemie de l’Union Soviétique ? »
« Oui » ; la réponse fut cette fois forte et décidée.
« T’a-t-elle dit par hasard que les soldats de l’armée rouge, quand ils sont entrés dans la Russie Blanche occidentale, ont pillé les biens de la population ? »
« Oui, elle dit... elle employa un mot difficile... »
Je me rappelai qu’il était venu une fois dans ma cabane et, regardant autour de lui et ne voyant que ma modeste petite valise, il m’avait demandé : « Pourquoi n’y a-t-il rien chez vous ? » « Parce qu’on m’a tout confisqué », répondis-je.
Je lui soufflais donc le mot : « confisqué ».
Il approuva de la tête.
Le président me dévisagea d’une manière menaçante et s’adressa de nouveau au témoin :
« Mais as-tu compris qu’elle traité de voleuse notre grande et noble armée rouge ? » – Le témoin approuva de la tête et dit : « Oui. »
« Et le témoin se rappelle-t-il ce que l’accusée a dit au sujet des Allemands ? – Le témoin, dont le visage s’éclaira, répondit : « Elle a dit que les Allemands seront balayés et qu’elle retournera en Pologne. »
Président : « Mais le témoin a-t-il compris qu’en disant cela l’accusée voulait affirmer que lorsque les Allemands seront balayés, l’Union Soviétique aussi s’écroulera et la Pologne renaîtra alors, et l’accusée rentrera chez elle ? » – Le témoin approuva de nouveau.
Président : « Et que disait-elle encore ? ». Le témoin, pour le moment du moins, ne s’en souvenait pas. Après un moment, ses veux brillèrent toutefois. Oh, oui, oui, il se rappelait que l’accusée avait affirmé que les paysans pauvres vivaient chez elle mieux que les hommes des kolkhoz en Russie, car ils recevaient annuellement cent « pud » de blé, outre dix de froment, de petits pois et de millet, pouvaient posséder deux vaches, sans devoir fournir du foin et de la paille, et ne payaient pas d’impôts ni pour les vaches ni pour le potager. Une grande indignation se traduisit alors sur tous les visages. Ils étaient scandalisés. Quelle propagande effrontée ! Quels mensonges ! Ils savaient tous que les paysans, qui vivaient chez nous en esclavage, chez les riches seigneurs mouraient de faim, tombaient malades et tombaient de fatigue et d’épuisement. Ils étaient cependant tellement satisfaits de cette preuve palpable de mon hostilité envers la plus grande conquête du communisme soviétique, le kolkhoz, qu’ils ne posèrent plus aucune question au témoin.
Un autre témoin entra : une Polonaise, femme d’un sous-officier de la marine de guerre. Au moment de mon arrestation, j’habitais avec elle dans la même cabane. Elle était pour cela appelée comme témoin. Son mari avait franchi la frontière et était loin, dans les environs de Cracovie. Elle avait été déportée avec son petit enfant. Elle paraissait terrifiée par le spectre de la prison. Et s’ils la considéraient comme ma complice ? Elle répondit négativement à toutes les questions : elle n’avait rien vu, rien entendu et me connaissait seulement parce que son mari était sous-officier dans la même armée que le mien.
Président : « Comment ? Vous habitiez dans la même cabane et tu ne sais rien ? Ne lui as-tu jamais adressé la parole ? » Il posa ces questions sur un ton ironique, presque railleur.
Témoin : « C’est la femme d’un officier, et si grande dame qu’elle ne voulut jamais parler avec moi, chose qui aurait offensé sa dignité. » On entendit dans la salle un murmure d’indignation.
Le procureur se leva : « Voilà, vous voyez vous-mêmes quelle ennemie du peuple travailleur se trouve devant vous. Jusque dans l’avilissement, dans un pays étranger, elle méprise ceux qui sont plus pauvres qu’elle. »
Ils congédièrent le témoin. Le procureur commença son réquisitoire.
« Une bourgeoise se trouve devant vous, une ennemie du peuple travailleur, descendant de riches seigneurs et elle-même grande dame et buveuse de sang. De même que ses aïeux se nourrissaient du sang et de la sueur de la population pauvre, torturaient les pauvres serviteurs de la glèbe, leur arrachant le dernier morceau de pain pendant les années de disette pour nourrir leurs chiens et obligeant souvent les mères à allaiter de tout jeunes chiens avec leur lait, ainsi elle vous prouve que dans les pays capitalistes rien n’a changé depuis des siècles ; il y règne toujours le même régime, la même exploitation, le même mépris envers la population pauvre. Voyez, au XXe siècle cette femme d’officier, cette dame, cette bourgeoise, cette propriétaire, comme elle s’acharne, méprise, ne voulant pas même parler avec une femme, qui lui est cependant moralement supérieure, seulement parce qu’elle est plus pauvre qu’elle. Regardez-la ! Admirez-la ! Le mépris, et la haine ne naissent-ils pas en vous, ne pensez-vous pas devoir lui infliger une peine proportionnée à sa faute ? Cette ennemie du peuple ne se contente toutefois pas d’opprimer le travailleur, d’avoir opprimé le malheureux pendant toute sa vie, elle ose aussi attaquer notre régime ; elle voudrait le miner par une propagande indigne et infamante, susciter contre lui le dégoût et la méfiance. C’est pourquoi elle n’est pas partie avec ses fils, qu’elle a envoyés en cachette en Allemagne, craignant qu’ils n’ouvrent les yeux, sous notre influence. Elle avait peur, elle tremblait pour ses jeunes messieurs. Elle craignait pour eux la vie dure, car ils valent plus que nous. Elle les a renvoyés mais elle, elle est restée. Et dans quel but donc ? Sachant écrire, elle est restée pour accomplir parmi nous une œuvre destructive. » Montrant les coupures de journaux : « Voici la preuve. Dès son arrivée elle a collectionné ces coupures. Dans quel but, je me demande ? » Un intervalle dramatique. « Dans le but d’exploiter nos mesures provisoires, dues aux nécessités actuelles de notre situation intérieure et de la situation internationale. Elle réunissait ces renseignements au sujet des sentences rendues par nos tribunaux afin de pouvoir nous diffamer. Elle est tellement naïve, malgré son instruction, qu’elle espérait retourner en Pologne et espère encore que cette ancienne Pologne capitaliste pourra être reconstruite. » Un sourire ironique apparut sur les lèvres du procureur et de tous les autres membres du tribunal. « Elle ne veut point croire que la Pologne n’existe plus et n’existera plus jamais. Elle espérait pouvoir reprendre un jour en Europe sa propagande anti-communiste.
Mais elle ne réussira pas et ne retournera plus là-bas. Nous ne pouvons toutefois pas réchauffer des serpents dans notre sein. Il faut la punir d’une manière exemplaire. Nous devons la transformer et la rééduquer. Je demande pour elle le maximum de la peine, soit au moins dix ans de réclusion et cinq ans de privation des droits civils. »
Il s’assit. Silence. Tout le monde ruminait son réquisitoire.
L’avocate, la camarade Kondratiewna, se leva enfin.
« J’estime l’accusée responsable de graves fautes, véritable ennemie non seulement de notre patrie communiste, mais aussi du peuple travailleur du monde tout entier.
Elle mérite une peine sévère ; j’estime toutefois que la peine de mandée par le camarade procureur est excessive. »
Le procès était terminé. Il avait duré une heure. Je fus emmenée, tandis que la Cour restait dans la salle pour délibérer et rédiger la sentence.
Tandis que le tribunal décidait de mon sort, je bavardais tranquillement avec le témoin à charge, la Polonaise, lui demandant des nouvelles de mes connaissances et l’interrogeant au sujet des nouvelles politiques.
Le garde se tenait à l’écart, bavardant lui aussi avec un compatriote arrivé, en qualité de témoin, pour un procès. Vingt minutes après, je fus appelée. Le président me communiqua la sentence. Elle disait dix ans de prison et cinq ans de privation des droits civils. » (Marie Reutt, écrivain.)
SENTENCE
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALE SOVIÉTIQUE
DU KAZAKHSTAN
La session mobile d’Akmolinsk du tribunal régional pour les procès pénaux composée du président membre du tribunal régional ISAKOV, des juges populaires : 1 Chasanow, 2 Grebniew ; avec la participation du procureur de l’état Pilewin et de l’avocate Kondratiewna avec le secrétaire Gafarow le 6 décembre 1940 dans la ville de Atbasar, après avoir passé au cours d’une session secrète du tribunal au procès pénal de l’accusée Reutt Marie, fille de Jean, née en 1893 dans la ville de Pinsk de l’ancienne Pologne, de nationalité polonaise sachant lire et écrire, journaliste, position sociale femme d’un officier de l’armée polonaise incensurée arrêtée le 12 août 1940 pour le délit prévu par l’art. 58 § 10 Ire partie du code pénal de la RFRSS le tribunal après avoir pris connaissance des actes du procès, après avoir entendu les explications de l’accusée et les dépositions des témoins et entendu l’opinion des parties a arrêté : l’accusée Reutt envoyée de l’ancienne Pologne dans le Kazakhstan comme personne dangereuse, une fois arrivée au kolkhoz Zlotogorka a fomenté l’agitation antisoviétique critiquant le régime et les kolkhoz, exaltant systématiquement les pays capitalistes et diffamant la vie des hommes des kolkhoz dans l’Union Soviétique ; s’exprimant ainsi : les hommes du kolkhoz meurent de faim dans l’Union Soviétique, il n’y a rien, dans le pays capitaliste on trouve tout, chez elle les paysans les plus malheureux vivaient mieux que les hommes des kolkhoz dans l’Union Soviétique de plus elle répandait des calomnies contre-révolutionnaires à l’adresse de l’armée rouge, au moment de l’occupation de la Pologne elle s’était donnée au pillage des biens appartenant à la population, etc... elle répandait en même temps le bruit que la Pologne serait reconstituée et l’Union Soviétique s’écroulerait par conséquent et nous ferions retour dans notre Patrie, etc. Tous ces faits par l’aveu de l’accusée et la déposition des témoins ont été pleinement confirmés tombant sous l’art. 319-320 du code de poursuites pénales le tribunal
ARRÊTA
Reutt Marie fille de Jean suivant l’art. 58 § 10 Ire le partie devoir se soumettre à la perte de la liberté pendant une période de 10 (dix) ans suivant l’art. 31 du code pénal, avec la perte pendant une période de 5 ans (cinq ans) des droits civils après avoir subi la peine qui aura son effet à partir du jour de l’arrestation soit 26 octobre 1940... (mot illisible)... laisser en état d’arrestation jusqu’au moment où la sentence devient exécutive la sentence pourra être contestée devant le tribunal suprême dans le délai de 72 heures par le moyen du tribunal régional 62.
Président ISAKOW
membre du tribunal (signatures illisibles)
(CHASANOWA)
Pour copie conforme :
Le Président du tribunal régional
(signature autographe)
ISAKOW
« ... Le prof. doct. Anatolij Timofieiewitch Markow, homme d’environ cinquante ans, mais qui paraissait en avoir soixante-dix, occupait à demeure la cellule. C’était un communiste acharné dans ses idées, membre du parti depuis 1905, autrefois menchévique et depuis l’an 1917 bolchévique, membre du Conseil militaire suprême d’un front ; il avait occupé des places importantes à des époques différentes, même des places ministérielles (parmi lesquelles celle de Commissaire du Peuple), directeur d’un institut d’édition, et, en 1937 de l’Institut bactériologique de...
Haut dignitaire du parti, il avait été plusieurs fois envoyé en mission spéciale ; il était l’ami de nombre de personnalités soviétiques, même actuelles, il connaissait bien Staline lui-même.
Le communiste par conviction, qui est en outre membre du parti depuis 1905, n’a malheureusement plus le droit de vivre dans le système actuellement en vigueur dans la Russie stalinienne. Le professeur partagea donc le sort de milliers d’autres communistes authentiques et l’on peut à présent affirmer de manière certaine qu’il fut « liquidé » comme un élément socialement dangereux.
Il fut arrêté en 1937, à la suite de la délation d’une femme docteur de l’institut bactériologique, qui était jalouse, et accusé d’avoir voulu infecter toute la ville, en y répandant la peste. L’accusation spécifiait qu’en sa qualité de directeur de l’institut, il avait laissé s’échapper quelques centaines de rats auxquels il avait inoculé le bacille de la peste et qui étaient enfermés dans des cages spéciales dans le siège de l’institut. Le professeur se défendait en faisant remarquer qu’il était évident que, si les rats, même en petit nombre, s’étaient réellement enfuis dans la ville, des cas de peste se seraient vérifiés ; or, pas un seul n’avait été enregistré. On lui répondit que c’était un pur hasard, étant donné que les rats s’étaient vraiment échappés. On lui reprocha en outre de n’avoir pas établi exactement le nombre de rats enfermés dans les cages. Comme il se défendit en déclarant que, les rats étant très prolifiques, il est impossible d’en tenir un compte exact, ils l’obligèrent à se tenir debout, sans même pouvoir s’appuyer au mur, pendant 45 heures ; s’il chancelait, ils le battaient sur la tête et sur le dos avec la crosse d’un revolver. Il finit naturellement par admettre l’accusation et par signer l’aveu. Mais comme l’accusation n’était par elle-même pas assez forte, le juge d’instruction de l’NKVD décida de l’aggraver par des sujets politiques ; Markov fut alors accusé d’avoir autorisé, en qualité de directeur de l’institut d’édition, la publication de livres dont les auteurs s’étaient révélés, deux ans après, ennemis du peuple. L’explication logique donnée par l’accusé, qui disait qu’il devait publier les ouvrages des plus hauts dignitaires du régime et ne pouvait point prévoir ce qui serait arrivé à ces derniers deux ans après, fut considérée comme un aveu de complicité avec ceux qui travaillaient contre Staline. Se servant de leurs méthodes particulières, ils l’obligèrent à signer des confessions de délits qu’il n’avait pas commis et dont le nombre se multipliait. Lorsqu’ils jugèrent que le patient avait été suffisamment « cuisiné » et qu’il ne chercherait plus à se disculper au cours des débats (ils le menacèrent d’ailleurs de graves représailles s’il changeait au procès ses dépositions : « Rappelle-toi que nous réglerons nos comptes après 63 »), un procès théâtral fut monté. Les débats se déroulèrent devant le Tribunal Suprême de Guerre à Moscou 64, dont les décisions sont sans appel et ne laissent au condamné que la faculté de demander grâce au Président du Conseil Suprême de l’URSS. On permit à l’accusé de choisir un plaidant : il profita de cette autorisation et sa femme (qui, tout de suite après l’arrestation de son mari, avait d’ailleurs formellement divorcé pour éviter de subir le même sort) obtint de pouvoir confier la plaidoirie à l’unique bon avocat de Moscou, désigné comme plaidant et représentant des accusés dans les procès politiques : un Juif, courageux, ami personnel de l’accusé. Au cours du procès, la victime fit à l’NKVD une surprise désagréable, en retirant toutes ses déclarations précédentes et en accusant l’NKVD d’avoir employé des méthodes inhumaines pendant l’enquête. Comme l’accusé était une personnalité assez connue et que l’accusation était manifestement fausse, le Tribunal rendit la sentence suivante : À cause de graves violences 65 pendant l’enquête menée par l’NKVD (coups, mauvais traitements, etc.), l’enquête même est à considérer annulée et non advenue et le procès est renvoyé dans l’attente des résultats d’une enquête ultérieure, confiée au Tribunal Militaire. L’avocat et l’accusé étaient rayonnants.
« Dans quelques semaines, dit l’avocat, vous serez libre. »
L’accusé retourna dans sa cellule à Butyrki ; il attendit un jour, deux, une semaine, un mois, il commença à s’impatienter et à écrire des instances qui régulièrement n’arrivaient pas à destination. Il attendit ainsi pendant seize mois. Il fut enfin appelé, naturellement pendant la nuit, et le cerbère de la prison lui dit : « Habillez-vous en vitesse » ; puis bras dessus, bras dessous, il l’emmena à travers de nombreux couloirs, tapant avec ses clés sur la boucle de son ceinturon afin d’avertir les autres gardiens qu’il conduisait un prisonnier. Lorsqu’il rencontrait d’autres détenus, il le cachait dans des armoires spéciales placées dans les couloirs. Le professeur arriva ainsi dans un élégant bureau et aperçut derrière la table le même juge d’instruction de l’NKVD, qui, un an et demi auparavant, s’était acharné contre lui et lui avait arraché les aveux. Lorsque le professeur, indigné, demanda pourquoi un membre de l’NKVD et non pas le procureur parlait avec lui, le juge d’instruction lui montra un document d’après lequel le procureur auprès du Tribunal Suprême donnait des dispositions pour que la nouvelle enquête soit faite par les représentants de l’NKVD.
Le procureur avait ainsi arbitrairement modifié la décision du Tribunal d’Instance Suprême. L’enquête recommença, accompagnée de tous les agréables « suppléments » employés par l’NKVD. Les accusations étaient toujours les mêmes ; l’accusé s’obstinait toutefois et n’avouait rien. L’NKVD eut alors recours à d’autres moyens ; on montra un jour à l’accusé un journal de l’année 1918, dans lequel il était écrit que le professeur A. T. Markow s’était distingué à Bijsk au cours d’une rencontre avec des divisions rouges et avait personnellement tué un commissaire. L’accusé nia énergiquement, déclarant qu’il ne se trouvait pas à cette époque dans la localité mentionnée. Le juge d’instruction lui répondit toutefois qu’il possédait le document prouvant le fait. Le professeur retourna dans la cellule, complètement résigné, et me dit : « Je suis perdu ; l’NKVD ne me remettra plus en liberté. Ma sentence de mort a déjà été signée. »
« Je le laissai dans la cellule, dans l’attente d’une mort lente. » (S. T., de 36 ans, docteur en droit.)
2. « MOSCOU EST LOIN »
« ... Popov nous ordonna le lendemain de nous rendre à dix kilomètres du village et de nous présenter au chef. Nous obéîmes à son ordre. Lorsque nous nous fûmes présentées, ce dernier nous demanda pourquoi nous n’avions pas achevé le travail qui nous avait été ordonné. Nous nous justifiions naturellement comme nous pouvions, nous éclations même en sanglots, mais il ne s’émut point. Il répondit d’un ton extrêmement calme : « Moscou est loin et ne croira pas aux larmes. » Après quoi, il rédigea le procès-verbal et nous renvoya à Jarensk.
... Notre procès eut lieu deux jours après.
Lorsque je fus en présence du juge, ses premiers mots furent les suivants : « Qu’avez-vous à dire à votre décharge pour ne pas avoir rempli la tâche qui vous avait été confiée ? » Je tremblais, naturellement, devant lui et pas un seul mot ne me sortit de la bouche. Un avocat se leva alors et m’ordonna de lui remettre cinquante roubles, car alors je ne serais pas jugée. Mais je n’avais pas cet argent et il m’invita alors à enlever mes chaussures et à les lui donner. Je répondis que j’avais les pieds blessés et qu’après avoir parcouru cent kilomètres les plaies s’étaient encore aggravées. L’avocat répondit : « Le diable ne t’emportera pas, ne crains point. » Le juge criait, le procureur hurlait et l’avocat n’épargnait pas les gros mots de style purement russe. Je pensais qu’ils ne m’auraient pas laissée sortir vivante de ce lieu.
Au débat je m’épouvantai, je commençai cependant à prier tout bas, ce qui me rasséréna complètement. Je les regardai donc avec indifférence comme s’ils s’adressaient à d’autres personnes et non pas à moi.
Ils se turent enfin et le tribunal me condamna à payer 25 % de mon salaire à l’État soviétique.
Quand mes camarades se présentaient devant le tribunal, la même scène avait lieu ; deux petites filles aussi et un enfant furent arrêtés à l’improviste et emmenés on ne sait où. » (11688 – Z. S.)
« ... Pendant tout l’été, les Polonais travaillèrent à la journée. Ils gagnaient en moyenne de 50 à 200 roubles par mois. Pendant l’hiver cependant la situation changea. Les Russes ne voulaient pas travailler dans l’administration de l’élevage des cochons, car les salaires étaient insuffisants et il y avait beaucoup de travail, il fut donc ordonné aux Polonais de le faire. Nous n’avions point de vêtements chauds, ni de chaussures convenables (car nos chaussures ou nos bottines en caoutchouc ne nous auraient pas permis de travailler à l’air libre avec une température de 60º sous zéro) ; nous répondîmes donc que nous nous serions volontiers rendus là-bas, mais que nous demandions des chaussures.
On convoqua une réunion de Polonais, à laquelle on amena même les malades obligés à garder le lit. Le directeur du « sovkhoz » nous adressa la parole et le « directeur politique » parla aussi.
Ils affirmèrent que nous exigions d’eux beaucoup de choses, mais que ne voulions pas travailler, que par cette conduite nous les obligions à suspendre complètement la distribution de pain (ils nous donnaient en ce temps-là 200 grammes de pain à chacun), que, si nous n’allions pas travailler, nous serions considérés comme des « rebelles » ou des « saboteurs ». Ils cessèrent finalement de parler. Ils fixèrent d’un regard victorieux les visages fatigués et tristes des femmes qui assistaient à la réunion. Ils savaient qu’il n’y avait rien de plus terrible pour elles que la menace de se voir enlever le dernier morceau de pain.
Des pensées de désespoir se présentaient à l’esprit des mères. Comment pouvoir aller travailler en laissant les enfants sans tutelle, dans une chambre non chauffée ? Et ne pas y aller, les laisser sans pain ! Que leur auraient-elles donné à manger ?
On entendit d’un groupe la question suivante : « Pourquoi les femmes russes, qui ont gagné pendant l’été beaucoup d’argent et ont de quoi s’habiller ne veulent-elles pas travailler ? Pourquoi ne se rendent-elles pas compte qu’elles travaillent pour un idéal et pour la diffusion de cet idéal dans le monde ? »
Il y eut un moment de silence. Les chefs réfléchissaient sur notre question. Nous entendîmes des paroles de raillerie et de moquerie du « directeur politique » : « Parce que c’est vous qui êtes venus chez nous et non pas nous chez vous. Celui qui demain ne se rendra pas au travail sera puni par le tribunal. Nous ne discuterons pas plus longtemps avec vous sur ce sujet. » Où était donc leur égalité des peuples devant la loi, si vantée dans le monde ?
Deux jours après, quelques-unes de nos femmes, avec les derniers objets qu’elles possédaient, achetèrent des « pimy » (sorte de chaussure) et se rendirent au travail. Mais pas même cette seule journée de retard ne resta sans punition.
Le tribunal arriva en effet trois jours après. Tous ceux qui ne s’étaient pas immédiatement rendus au travail furent appelés. Sans égard pour l’âge, sans nous empêcher, il est vrai, d’exposer nos raisons, qui ne furent toutefois pas prises en considération, ils condamnèrent tous les coupables à une retenue de 20 et 25 % sur le gain d’un semestre. » (11691 – P. M.)
3. L’OSSO
« ... Au mois de novembre 1940, quatorze paysans du Bug, la plupart Ukrainiens, furent transportés en automobile de Wlodzimierz à Kiev. L’un d’eux était un vieillard de 64 ans. Avant la guerre les choses allaient bien pour lui : il possédait cinq hectares de terrain et recevait, en qualité d’invalide de guerre, 30 zloty comme subside mensuel.
Après l’entrée des Soviets en Pologne, il fut probablement un de ceux qui « furent libérés de l’esclavage », mais il ne tarda pas longtemps à prier Dieu pour le retour des « temps polonais ».
Les bolchéviques obligeaient le vieillard à pousser une brouette transportant du matériel pour les travaux de fortification sur le Bug. Il fut arrêté parce qu’on le soupçonnait d’appartenir à une organisation d’espionnage agissant pour le compte des Allemands. Le vieux paysan ne savait ni lire ni écrire. Ils commencèrent aussitôt à le battre. Il devait avouer qu’il appartenait à l’organisation d’espionnage. Le vieillard pleurait : « Pourquoi ? Pourquoi ? » Puis le procès eut lieu et il dura trois jours. Après l’audience, le paysan retournait le soir dans la cellule et nous apprenions donc par lui comment se déroulaient les débats. Tout le monde déclara avoir été battu, torturé et obligé de faire des aveux au cours du procès. Le maire de leur village avait été torturé au point qu’il mourut des suites des cruautés subies. Résultat : huit personnes furent condamnées à la peine de mort, cinq à la réclusion perpétuelle, et notre paysan acquitté. Nous pensions qu’il serait remis en liberté et je lui confiai même un message pour ma femme. Deux mois après, je retrouvai le vieux paysan dans la Lukianovka (prison de Kiev). Le malheureux avait été condamné à huit ans de travaux forcés comme étant « socialement dangereux. » (3/681... capitaine.)
« ... Au mois de février 1941, je fus appelé pour recevoir notification de la sentence. Elle avait été rendue à Moscou, non pas à ma présence, par l’« Ossoboie Soviestchanie » et infligeait huit ans de travail dans les camps de concentration de Pothma pour avoir mené la lutte armée et sociale contre l’URSS et parce que j’étais un ennemi du peuple et un élément socialement dangereux. Vers fin de février 1941, je fus envoyé à Pothma dans le camp de concentration de Tiemnikow, gare de Pothma, de la RASS des Mordvins. » (11213 – doct. V. S., médecin.)
« ... Au mois de février 1941 je fus appelé par le bureau de la prison, où on me déclara que l’« Ossoboie Soviestchanie » de Moscou m’avait condamné à 8 ans de camp de concentration dans des lieux lointains de la Russie. À ma demande si je pouvais faire appel, on me répondit négativement. Je fus condamné comme ancien volontaire dans l’armée polonaise de 1920, employé de l’administration autonome, membre de l’association des « Tireurs » et de la Ligue de Défense Antiaérienne. » (10752 – D. E.)
« ... Je fus appelé pour la dernière fois par le juge d’instruction le 17 décembre 1940. Il me fit signer le procès-verbal de l’enquête et l’acte d’accusation d’après l’art. 58 §§ 11, 12 et 13 (les articles précédents avaient été mis à part). Il déclara qu’il me déférait au tribunal. À ma demande si j’allais être appelé au procès, il répondit évasivement que je pouvais être appelé et qu’il pouvait se faire aussi que le procès ne se déroule pas en ma présence. (12541 – H. J., né en 1897, maire de village.)
« ... On donna lecture de la sentence collective dans le couloir de la prison en l’absence des autorités et sans cérémonie spéciale. Cinq ans d’ « ITL » (camp correctionnel de travail) sur le fleuve Petchora. » (1539 – S. M. T.)
CHAPITRE VII
MOYENS DE DÉFENSE SOCIALE
I. DANS L’ATTENTE DE L’EXÉCUTION
DE LA SENTENCE DE MORT
« ... On m’apprit que j’étais accusé d’espionnage, avec mes collaborateurs : 1) Borszuk André ; 2) Perewiaska Maxime ; 3) Rekas Paul ; 4) Kusznir Fokej ; 5) Targonski ; 6) Maksymczuk ; tous de la commune de Bialowieza. Ces personnes et moi, nous fûmes condamnés par le tribunal militaire du commandement spécial de guerre de Kiev, à la peine de mort et à la saisie des biens. On accorda à Kusznir et à moi la faculté de faire appel, aux autres celle du pourvoi en grâce.
Après la sentence, nous fûmes enfermés dans une très grande prison centrale, nommée Loukianovka. Nous étions trois ou quatre dans la « cellule de la mort ». Les fenêtres de cette cellule n’avaient pas de vitres et étaient fermées par du fer-blanc troué par un gros clou ; de plus, il y avait à l’extérieur une espèce de panier en fer qui fermait l’ouverture de la fenêtre. La paillasse manquait, nous n’avions point de couvertures et on nous avait pris nos pardessus, nous laissant seulement nos habits. La nourriture nous était passée à travers le judas, et lorsqu’ils venaient chercher le seau des éjections, trois geôliers armés de fusil, y compris le chef de garde, prêts à tirer, se plaçaient devant la porte.
Vingt-neuf jours après, il nous fut notifié que la peine de mort avait été commuée pour Kusznir en 15 ans de réclusion, dix ans de déportation dans des régions lointaines de l’URSS, et 10 ans de privation des droits civils, avec la confiscation des biens. Quant à moi, la peine capitale fut commuée en 10 ans de réclusion, 10 de déportation dans des régions éloignées de l’Union Soviétique, 10 ans de privation des droits civils et confiscation des biens. Le pourvoi en grâce des autres personnes fut rejeté et la sentence de mort fut exécutée. » (765 – S. K., employé.)
« ... Ils emmenèrent un jour de la cellule de la mort un Polonais, un vieillard de Sambor (je ne me souviens pas de son nom), qui était resté pendant 75 jours dans la cellule, avec son fils officier. Il nous raconta comment on vit dans les cellules des condamnés à mort.
Une aile entière de la massive prison était occupée par des cellules qui étaient toujours pleines de monde. On restait là en attendant que Moscou confirme la sentence ou accorde la grâce. L’attente durait généralement trois mois. La décision serait communiquée au condamné par un seul mot : « Sors. » Quel était le sort du condamné emporté de cette manière, personne ne pouvait le savoir. Pendant la nuit, personne ne dormait dans la cellule, car la vie commençait seulement vers la fin du jour et les décisions n’arrivaient que la nuit. Chacun attendait son tour. Les condamnés à mort n’étaient pas emmenés à la promenade ; on ne leur faisait pas même prendre un bain et une grande saleté régnait dans la cellule. Les prisonniers étaient littéralement dévorés par les poux. » (8681 – capitaine.)
« ... Aucune prisonnière ne mourut dans la prison des femmes où je me trouvais. Une jeune fille de dix-neuf ans, Alina Ceprynska, élève du lycée de Pruzany, fut condamnée à mort. À l’époque de ma déportation, la sentence n’avait pas encore été exécutée : la jeune fille resta dans la cellule des condamnés à mort. » (1850 – J. M., institutrice.)
L’auteur de la description suivante réussit à s’évader du camp de concentration du district d’Arkhangelsk et à atteindre le Caucase à travers de nombreuses difficultés. Il fut néanmoins rattrapé à la frontière turque, condamné à mort et renvoyé aux prisons d’Arkhangelsk.
« ... Dans la cellule des condamnés à mort, les âmes des prisonniers se dévoilaient complètement. Chacun se sentait très proche de son camarade, dont les fautes devenaient compréhensibles : le tout paraissait justifié. L’atmosphère de l’attente et un sort commun les rendait tous camarades. Une attente navrante commença ainsi : le spectre de la mort voltigeait sur nous, se glissait dans la cellule, camarade inséparable, nous fixait des creux de ses yeux ; il nous paraissait parfois très près, d’autres fois plus éloigné. Nous voyons à chaque instant le tombeau s’ouvrir tout grand devant nous. Aucune personne n’était graciée. Je ressentis alors une peur de brute et un désir ardent de vivre, à tout prix. Les moyens les plus différents de sauvetage in extremis me venaient dans l’esprit. Je me raccrochais spasmodiquement à tout espoir : le Tribunal Suprême ne confirmera peut-être pas la condamnation, il accordera peut-être la grâce... Je compris profondément que plus la vie est courte, horrible, pénible, plus on désire vivre. J’aurais été prêt au sacrifice le plus grand, à la perte des yeux, des bras, des jambes, ou à commettre l’action la plus lâche, pour pouvoir continuer à vivre, ne fût-ce que peu de temps ; il n’y avait cependant plus d’espoir. Le Tribunal Suprême confirma la sentence, et j’attendais désormais la fin. Chaque soir, avec mes camarades voués aussi à la mort, j’étais aux écoutes, au guet jusqu’au spasme, afin de pouvoir entendre si les « corneilles noires » (des automobiles fermées) arrivaient.
S’ils prélevaient des condamnés dans une autre cellule, on se réjouissait : un jour de plus à vivre et peut-être même davantage. Nous entendîmes un soir le ronflement sourd d’un moteur. Nous nous lançâmes, alarmés, contre la porte de la cellule. Le gardien de nuit baissa le judas et nos cœurs tressaillirent, bondirent jusqu’aux oreilles. Un instant après la porte s’ouvrit. Dix agents de l’NKVD, le directeur de la prison et d’autres personnes entrèrent dans la cellule. Le directeur regarda des photographies, consulta des papiers qu’il avait à la main. Il désigna alors du doigt un de nous, un vieillard aux cheveux blancs, taciturne. Le condamné se leva tranquillement ; ses yeux brillaient étrangement. Il nous lança un regard d’adieu et dit : « C’est la fin. » Ils prélevèrent ainsi dans ma cellule sept personnes, les emmenant les unes après les autres. Je vis par le judas comment ils leur lièrent les mains derrière le dos et les bâillonnèrent pour les empêcher de crier. Je rêvais d’elles pendant la nuit ; je les voyais comme si elles étaient encore vivantes. Elles causaient avec moi, me regardaient avec surprise, me demandant : « Es-tu resté ? » L’un d’eux, un jeune homme de la Géorgie, me resta gravé dans la mémoire, tel que je l’avais connu aux premiers jours de notre captivité dans la cellule des condamnés à mort. Il dansait devant moi « La prière de Schamil », une danse caucasienne folle, sauvage, douloureuse, impétueuse et nostalgique. Le temps s’écoulait ; il y avait des journées de folie, de tension nerveuse ; je sentais parfois un terrible attachement à la vie, spasmodique, insensé ; j’invoquais parfois une mort rapide, comme une grâce. Je rêvais souvent de devenir invisible ou je désirais devenir un oiseau. Je revoyais ma patrie, j’entendais la voix de ma mère. Les nuits devinrent blanches, les jours noirs, la vie une agonie. J’oubliai ce que signifiait la joie ou les larmes. Je restai couché pendant des journées entières, sans prendre de nourriture, comme évanoui, je ne pouvais plus regarder la mort dans les yeux. Je cessai de parler avec ceux qui m’entouraient, je devins de pierre ; la souffrance se prolongeait, s’incrustait en moi ainsi que l’escargot dans sa coquille. J’avais l’impression d’être, vivant, dans un cimetière infernal. Il est bien difficile de décrire l’existence et les pensées navrantes d’un condamné à mort. J’avais l’impression d’être enfermé dans un antre sombre ; toute chose avait cessé d’exister pour moi. Je n’étais poursuivi que par le ronflement sourd du moteur qui devait me transporter dans l’autre monde. Une nuit, il y eut sur Arkhangelsk une incursion allemande. L’atmosphère dans la cellule devint lourde ; les lumières furent éteintes ; la frayeur nous regardait des coins de la pièce avec les yeux écarquillés ; tous les condamnés savaient que, s’il arrivait quelque chose, nous serions fusillés les premiers. Si les Allemands, par exemple, tentaient une descente ou n’importe quelle autre attaque de surprise, l’invraisemblable se produirait : ce serait pour nous la mort certaine.
Incapable de résister plus longtemps, d’écouter encore le tintement des clefs dans les mains du geôlier, mes nerfs fléchirent un jour sous cette folle tension. Je ne voulais point me livrer aux exécuteurs, je voulais me donner la mort tout seul. Je tapai ma tête avec violence contre la porte en fer ; un flot de sang me coula du nez ; je ne sus plus ensuite ce qui se passait ; je m’effondrai dans les ténèbres et dans le silence... Lors de mon réveil de l’étrange et fantastique sommeil, je me trouvai dans une salle blanche d’hôpital. Un vieux docteur penchait sa tête blanche sur moi et me souriait gentiment...
J’appris quelques jours après que j’étais libre et que le cauchemar de trois mois, dans la cellule de la mort, était enfin terminé.
L’Union des Soviets, en ce qui me concerne, a respecté les conditions du pacte stipulé avec la Pologne 66.
Elle ne l’a point respecté, par contre, envers ceux qu’elle a ensevelis pour l’éternité sous la terre froide du Nord. (7541 – S. K.)
2. LA COLONIE DE « RÉÉDUCATION »
POUR LES MINEURS
« ... Je fus assigné, pour cinq ans, à la colonie pour les mineurs de Kiev. J’avais en ce temps-là 17 ans. Dans cette colonie, nous étions trente Polonais. Outre nous, il y avait de jeunes citoyens soviétiques, la plupart des bandits, des voleurs et des homosexuels. Le nombre de détenus était de deux mille environ. Le niveau moral et la camaraderie dans la colonie reflétaient la vie de l’URSS tout entière. Les prisonniers se divisaient en deux catégories : les « activistes », qui avaient promis de se corriger et faisaient les mouchards ou « fils de chiens » (ainsi que nous les nommions dans la colonie), et les « zoulik », qui s’étaient voués au banditisme, ne travaillaient pas, n’étudiaient pas et passaient leur temps à jouer aux cartes tout ce qu’ils possédaient (même la vie des autres personnes) ; ils se battaient, se donnaient des coups de couteau, volaient tout ce qu’ils pouvaient. Afin d’obtenir une nourriture un peu meilleure je me consacrais à quelque travail. L’NKVD traitait les Polonais avec circonspection et méfiance. Après quatre mois de séjour dans la colonie, ayant démontré que j’étais bon travailleur, je fus appelé par le capitaine Kretow, chef de l’NKVD. Il me proposa d’entrer dans le groupe des activistes et de devenir membre du « Komsomol » (organisation juvénile). Il me promit monts et merveilles. Il dit que la Pologne n’existera plus ou, en tout cas, qu’elle serait une Pologne soviétique. L’URSS dominera le monde entier, la Commune régnera partout, ajouta-t-il. Je ne cherche pas à décrire ce que je ressentis et ce que je répondis à ces propositions. Il suffit de dire que, battu jusqu’à ce que je m’évanouisse, je revins à moi quelques heures après dans une cellule (une chambrette de trois mètres, sans fenêtres, et dont le sol en ciment était inondé d’eau mélangée avec des éjections, arrivant jusqu’à la cheville). J’y restai pendant un jour et demi sans manger ni boire. Quand ils m’emmenèrent de ce lieu, je fus placé avec d’autres Polonais dans une autre cellule. Ils devaient nous envoyer aux camps de travail pour adultes.
Un sort bien plus mauvais nous était réservé. J’appris par la suite que d’autres de mes camarades avaient eu la même mésaventure que moi. Nous passâmes une autre journée enfermés dans la colonie, nous fûmes ensuite transportés par la « corneille noire » à un train de prisonniers.
Passant par Moscou et Gorki, ils nous emmenèrent dans un camp de travail pour criminels adultes. Nous descendîmes à la gare de Sukha Beswodnaia 2, entre Gorki et Kirov, dans une région de vastes marécages... » (738 – F. S., lycéen.)
3. LA DÉPORTATION
« ... Je fus arrêté le 29 juin 1940 pendant la nuit avec tous les membres de ma famille (femme, fils de dix-huit ans, fille de seize ans et fils de quatorze ans). L’arrestation eut lieu à quatre heures du matin. Nous fûmes transférés à la gare de Persenkowka (Léopol). Soixante-deux personnes furent chargées sur un wagon de trente tonnes. Les couchettes dans le wagon étaient très élevées ; au milieu de la voiture, il y avait sur le plancher une ouverture de 25-30 centimètres de diamètre servant de cabinet. Au cours du chargement, une couchette s’écroula et une femme eut une fracture de l’os fémoral (je ne me rappelle pas le nom de la malheureuse). Toute intervention auprès de l’NKVD pour que la femme soit laissée à l’hôpital fut vaine. Je lui fis un bandage provisoire afin d’immobiliser l’os fracturé et cette femme fit un voyage de seize jours dans ces conditions jusqu’au lieu de la déportation. Le résultat final de ces soins fut que les os ne se soudèrent qu’imparfaitement et que la femme resta estropiée pour toute sa vie. » (11230 – Doct. S. S., médecin.)
« ... Les voyages en chemin de fer et sur les rivières se déroulaient dans des conditions terribles. Mon voyage fut un cauchemar inoubliable. Quarante personnes avec leurs bagages étaient avec moi dans un wagon de marchandises. Il y avait dans le wagon trois tailleurs et deux cordonniers, qui avaient heureusement été autorisés à emporter avec eux leurs outils. Il est donc facile d’imaginer que le bagage occupait plus de la moitié de la place. Il faut ajouter qu’il y avait une femme qui était à son neuvième mois de grossesse et trois nourrissons. Un trou dans le plancher, sur lequel était placée une caisse, servait de cabinet. Au cours des premiers jours de voyage, ils ne donnèrent la permission à personne, sauf au « chef du wagon », de sortir à l’air libre ; la chaleur accablante, les pleurs des enfants, la saleté ne faisaient qu’augmenter la crainte pour l’avenir qui nous torturait, étant donné que nous ignorions le sort qui nous serait réservé et la localité à laquelle nous étions destinés. Des cas de mort et de suicide se vérifièrent. Il y avait parmi nous des déportés auxquels on avait même défendu d’emporter avec eux les objets les plus indispensables. » (10561 – G. I., né en 1905 à Varsovie, marié, dentiste.)
« ... Aucun civil ne put s’approcher du train et échanger avec nous deux ou trois mots. Nous voyions dans les gares, par les petites fenêtres, des gens qui nous regardaient les larmes aux yeux. Je me souviens d’un employé des chemins de fer qui vérifiait les roues du wagon. Il s’arrêta devant nous et dit : « Ils vous envoient au diable en Sibérie. » Il fut entendu par un soldat de notre escorte, qui l’emmena. J’ignore ce qu’il lui arriva. Nous arrivâmes le 18 février à la gare-terminus du chemin de fer, au milieu d’une forêt. Dans cette gare on nous donna de la nourriture. Le nom de ce lieu était Schabrika. Notre repas terminé, les voitures furent déchargées ; chaque famille, chacune à son tour, retirait ses bagages ; on fit l’appel et nous fûmes livrés aux autorités locales, qui perquisitionnèrent encore une fois nos affaires et nous fouillèrent. Un homme du kolkhoz arriva, déguenillé, avec une paire de chaussures primitives, faites en bois de filleul macéré, sur un traîneau sibérien, tiré par un misérable roussin. Ils nous chargèrent quinze à la fois pour nous emmener au lieu de notre sort. Chacun de nous reçut une petite ardoise sur laquelle l’adresse était inscrite. Celle de ma famille, par exemple, était la suivante : « spez gorodok 67 » Poludniewiza, baraque numéro 11, salle numéro 2, cabine n. 13 – adresse assez longue, comme, vous voyez. Chacun de nous était curieux de voir l’aspect que tout cela avait. Il était défendu aux hommes du kolkhoz de nous parler. Nous fûmes emmenés chez un brave vieillard, qui examina d’abord avec attention nos affaires, puis nos vêtements, et finalement nos personnes. Après quelque temps, nous réussîmes à le faire causer. Il nous dit : « Je n’ai pas le droit de parler avec vous ; mais je suis vieux et rien ne peut plus me faire peur. On nous a dit que vous avez des maladies infectieuses, qu’on ne peut pas vous toucher ni prendre quelque chose de vous, et qu’on ne peut même pas vous adresser la parole ; et la paille sur laquelle vous êtes assis sera brûlée quand nous vous aurons emmenés à destination. Je ne crois pas à tout ce qu’on dit de vous, mais nos jeunes gens en sont totalement persuadés. Je peux vous affirmer que si les conditions politiques ne changent pas, vous mourrez sans revoir votre pays. Aucune personne ne saura plus rien de vous, tout comme je ne sais plus depuis quinze ans où je vis et si mon frère est mort. Je ne vous dirai qu’une seule chose : chez nous il n’y a plus de frère, ni de sœur, et il n’existe presque plus de fils ; figurons-nous donc un ami ! Tout le monde a peur, personne ne se fie à son prochain, personne ne parle. Nous avons été réduits à ce point. Les églises ont été toutes fermées et elles servent à présent de dépôts de blé, de clubs et de théâtres. » (482 – R. A., chauffeur mécanicien.)
« ... Les premiers jours après notre arrivée, nous rencontrâmes des Ukrainiens, qui se conduisirent envers nous très aimablement, voyant en nous des compagnons d’infortune. Ils nous aidèrent autant qu’ils le pouvaient, ils étaient très bien disposés et hospitaliers envers nous et, chose beaucoup plus importante, ils nous donnèrent beaucoup d’indications précieuses au sujet de notre future existence. J’appris alors leur terrible tragédie et leur situation désespérée. Ils avaient été déportés en 1930. Ce fut, en effet, vraiment cette année-là que commença en Ukraine la socialisation des terres. Presque tout le monde était séparé des autres membres de la famille. Les femmes étaient restées sans leur mari, les mères sans leurs fils. Personne n’apprit jamais le sort des parents dont il avait été séparé. Quelques femmes ukrainiennes me racontèrent leurs péripéties. Elles avaient été déportées dans le centre de la toundra, dans des lieux où il n’y avait pas de trace humaine. À peine débarqués, les déportés reçurent des matériaux de construction. Ils construisirent alors des cabanes, en travaillant dans des conditions assez difficiles, avec des rations de vivres très petites, et dépourvus de vêtements chauds. N’étant pas habitués au froid, ils mouraient en grand nombre. La localité où ils se trouvaient était loin du chemin de fer, à des centaines de kilomètres ; ils y furent menés en des embarcations, ou, pour mieux dire, sur des radeaux rudimentaires, formés de troncs d’arbres liés ensemble. Déjà au cours du voyage, de nombreuses personnes trouvèrent la mort dans les eaux de la rivière agitée, car les embarcations étaient surchargées ; ceux qui dirigeaient l’expédition ne s’en souciaient pas et ne faisaient pas attention aux hommes qui, dans les virages plus brusques, tombaient du radeau dans les gouffres du fleuve. Plusieurs personnes devinrent folles. Après six ans d’une existence terrible, les survivants furent transférés dans le « sovkhoz ».
Il est nécessaire de faire remarquer que, pendant ces six ans, les déportés furent plusieurs fois transférés d’un lieu à un autre, et le déplacement avait toujours lieu lorsque la construction des bicoques était terminée. On commençait le nouveau travail dans la nouvelle localité déserte. L’Union Soviétique s’étend de cette manière, avec l’injustice et la souffrance subies par ses citoyens. La vie des déportés dans le « sovkhoz » était sensiblement meilleure, puisqu’ils menaient une vie stable déjà depuis cinq ans et pouvaient en somme se fournir du nécessaire. Ils se construisirent des cabanes et, en même temps, quelques-uns achetèrent une vache à lait (pour acheter une vache à lait, il était nécessaire d’obtenir la permission de l’NKVD et on ne pouvait en posséder qu’une). À dire vrai, je me suis mal exprimée en disant qu’ils furent conduits au « sovkhoz », puisque le sovkhoz, en ce temps-là, n’existait pas encore : il n’y avait qu’une immense steppe déserte. Ils construisirent de leurs mains les cabanes et les dépôts ; ils creusèrent un réseau dense de canaux qui irriguaient les champs. Je dois reconnaître que ces canaux étaient creusés selon un bon plan et avec du bon sens.
La construction des digues et des enclos était simple et selon les règles de l’art. En regardant ces conduits, je pensais néanmoins combien les hommes qui les avaient creusés avaient dû souffrir, car cela avait été un véritable travail de fourmis. Les souffrances des Ukrainiens ne se terminèrent toutefois pas là. Nombre de leurs femmes avaient des enfants en train de devenir adultes et qui devinrent majeurs pendant leurs pérégrinations (l’homme en URSS devient majeur à l’âge de 18 ans et, à partir de 12 ans, il est destiné aux travaux manuels). Ces jeunes gens n’avaient pas le droit de servir dans l’armée, et sous le moindre prétexte ou même sans aucun prétexte, ils étaient arrêtés et envoyés aux camps de travail. Les familles n’apprirent jamais rien au sujet de leur sort. Les Ukrainiens manifestaient en toute occasion leur caractéristique nationale, et leurs enfants, bien qu’ils fréquentassent les écoles russes, ne se dénationalisaient point. » (10745 – E. K.)
« Description du lieu de déportation :
a) Bieregaiewo, camp central : six grandes baraques pour habitation, un réfectoire, une cuisine, un hôpital, et un bain de vapeur. Le tout entouré d’une grande palissade (peu de temps après, on ordonna de la défaire). Outre ces édifices, pour notre usage, il y avait aussi une quinzaine d’autres édifices destinés comme habitations des non-prisonniers ou comme bureaux. Le marché était dans la construction la plus grande. Le tout était le produit du travail des déportés : le camp était né en 1937. En dehors de la boulangerie et des locaux relativement confortables du commandement, les constructions étaient misérables. La radio était placée dans une petite cabane dont les parois à l’intérieur étaient pourries.
Les baraques étaient infestées d’une quantité incroyable de punaises. En détachant un morceau d’argile des fentes entre deux troncs de la paroi, on ne pouvait pas voir le bois à cause du grand nombre de punaises qui s’amassaient là. 90 % des nôtres vivaient à l’air libre. Ma femme dormait avec son enfant sous la palissade de l’école. Avec la seule force physique de nos hommes, qui ne s’entendaient toutefois pas à ce genre de travaux, le camp fut arrangé tant bien que mal. Des cloisons furent placées à l’intérieur des baraques ; le long de la baraque était un couloir, sur les deux côtés duquel s’ouvraient des chambrettes. Pas moins de 8 et jusqu’à 15 personnes devaient vivre dans chacune d’elles, sur une surface de 10 à 30 m2. Le terrain sur lequel le camp de Bieregaiewo s’élevait, excepté un petit espace surélevé, était un marécage bas et boueux.
b) Kiza. De Bieregaiewo à Kiza il y avait 12 km., 10 desquels étaient un sentier formé par des planches, jetées au travers du marécage. Avant d’arriver à deux kilomètres de la gare de Kiza, ce chemin s’interrompait et, pour pouvoir arriver à destination, il fallait prendre un sentier tortueux et boueux, évitant avec soin le marécage. Il y avait une quinzaine d’édifices, et, parmi eux, quatre grandes baraques pour le logement des nôtres. Les autres étaient pour eux et pour les services. La saleté et la construction misérable des baraques n’étaient pas au-dessous de celles de Bieregaiewo ; le secteur de Taïga était d’ailleurs, sous ce rapport, pire encore. Une petite rivière coulait près de Kiza. Ses bords étaient inaccessibles, boueux ; son eau était dégoûtante, d’une couleur marron foncé, causée par une énorme quantité de bois en putréfaction. Dans le secteur, il y avait, bien entendu, le commandement, le petit hôpital, la boulangerie, le marché et une grande écurie. Le petit hôpital fut en peu de temps évacué et le médecin fut transféré à Bieregaiewo. Il ne resta sur place qu’un « feltcher 68 » de Kalisz. Les malades devaient être transportés à Bieregaiewo.
Vers la fin de septembre, le premier froid commença et l’on pratiqua la désinfection des baraques par le gaz. Le résultat ne fut pas fameux ; il apporta toutefois un peu de soulagement. Il n’y avait pas de chaux pour badigeonner les murs. Seuls quelques privilégiés réussirent à obtenir un peu de chaux chlorée.
c) Taïga. Secteur où il y avait un camp de punition, destiné aux déportés condamnés à l’exécution des travaux forestiers les plus lourds sur un terrain particulièrement difficile : l’abatage des forêts marécageuses et le transport des troncs aux dépôts. Boue sur boue. L’hôpital est supprimé ; les malades sont transportés à Bieregaiewo. L’installation sanitaire ne disposait point de médicaments, ni de bandes ; l’ouate manquait totalement. Ces lacunes s’aggravaient toujours davantage avec le temps, au point que le médecin de Bieregaiewo n’avait pas un tampon d’ouate quand il dut soigner quelqu’un qui s’était suicidé (un certain Dzuba du district de Cracovie ou de Lublin, qui s’était coupé la gorge avec un rasoir). Le malheureux s’est pendu trois mois après. » (6942 – S. I., 42 ans, expert comptable.)
« ... Ils ne s’acharnaient pas spécialement contre les hommes, c’est-à-dire qu’ils ne les torturaient pas et qu’ils ne leur infligeaient pas des punitions corporelles. Ils les envoyaient cependant travailler nus et déchaussés, et le climat remplaçait le bourreau (en automne et au printemps il y avait une plaie de moustiques de la malaria ; pendant l’hiver, le tourment du froid). Un travail lourd et une nourriture insuffisante complétaient l’œuvre. Ces hommes épuisés étaient prédisposés, dans ces conditions, à toutes les maladies. Pendant l’été de 1941, le typhus et la dysenterie commencèrent à sévir. Afin de combattre ces épidémies, ils commencèrent à faire des vaccinations et des désinfections, mais d’une manière nullement rationnelle ni consciencieuse. En principe, nous n’avions pas le droit de lire les journaux et il n’était pas question de radio. » (6079 – B. H., née en 1921, élève de l’Académie des Beaux-Arts.)
« ... En ce qui concerne le salaire, je recevais pour une quinzaine, souvent avec beaucoup de retard, de 30 à 40 roubles. Comment pouvais-je vivre pendant quinze jours, ayant à ma charge une famille nombreuse, avec un tel salaire, qui n’aurait même pas suffi à une seule personne ! Rien d’étonnant donc que bien souvent, pendant deux ou trois jours de suite, nous n’avions que de l’eau avec un peu de sel. On peut facilement imaginer ma situation ; j’ajoute que je travaillais chaque jour depuis l’aube jusqu’à la nuit tombante. J’avais une quantité fixée de travail à exécuter et ma femme m’aidait comme elle pouvait ; deux filles m’aidaient un peu, de temps en temps. 10 à 15 roubles par jour étaient nécessaires pour la sustentation de ma famille, sans tenir compte du lait et des graisses, qui étaient presque introuvables et très chers. Ces genres « de luxe » toutefois ne m’intéressaient guère ; je tenais seulement à pouvoir acheter le pain auquel j’avais droit, mais souvent je ne pouvais même pas me le procurer. Les prix étaient fixés par les autorités. En voici la liste :
Pain noir : le kg. 1 rouble et 65 kopecks
Avoine mondé : le kg. 1 rouble et 50 kopecks
Orge ou perlé : le kg. 5 roubles
Mil : le kg. 4 roubles
Petits pois : le kg. 2 roubles
Pommes de terre : le kg. 40 kopecks
Huile comestible ou margarine : le kg. 12 roubles
Poisson séché : le kg. 4 roubles
Sucre-semoule : le kg. 10 roubles
Choux : le kg. 80 kopecks
Caramels : le kg. 15 roubles
Je ne pouvais d’aucune manière en Russie pourvoir à la sustentation de ma famille, tandis qu’en Pologne mon bilan familial était, pour l’achat des vivres d’une seule journée, de 2-4 zloty. Afin de pouvoir mener en Russie la même vie qu’en, Pologne, en supposant qu’il fût possible de trouver tous les genres de vivres que nous avions chez nous, la dépense aurait été de 40-50 roubles par repas et non pas pour une journée entière ! » (12062 – L. F., petit propriétaire.)
« ... Près de 2500 déportés, dont 40 % de Polonais, 25 % d’Ukrainiens, et le restant de Juifs, se trouvaient dans le « secteur spécial ». À l’exception des médecins et de quelques comptables, tous les déportés travaillaient à la scierie ou faisaient les bûcherons dans la forêt. D’après les tableaux de travail, le gain aurait dû être de 5-7 roubles par jour. Toutefois, la quantité de travail fixée pour la journée était tellement élevée que la plupart de nous gagnait en moyenne de 50 kopecks jusqu’à un rouble par jour. Pour donner une idée de ce qu’on pouvait faire avec ce salaire, il suffit de dire qu’un kilo de beurre, par exemple, coûtait de 60 à 80 roubles. Il y avait des familles composées de la mère seule, avec de nombreux fils. La mère devait avoir soin d’eux et ne pouvait donc pas travailler. Les familles ainsi composées vivaient au début par la vente de leurs affaires, puis grâce à l’aide des autres déportés qui organisaient souvent des quêtes entre eux. Cependant, ils finissaient souvent par mourir de faim. La mortalité dans le secteur était élevée, surtout parmi les enfants. En un an, les décès furent de 200 environ. Nous fûmes libérés au mois de septembre 1941, toutefois, même après la mise en liberté, ils nous firent nombre de difficultés pour nous laisser partir vers Assino. En conséquence, quelques-uns ne réussirent à partir qu’au début de 1942. Un certain nombre de déportés se trouvent d’ailleurs encore actuellement dans ce lieu, s’ils ne sont pas morts de faim. » (11.192 – Doct. Z. B., médecin.)
« ... Jusqu’à l’époque de l’amnistie, sept personnes moururent dans le « sovkhoz » où j’étais avec ma famille. Leur mort prématurée fut causée par la faim. Nous souffrions des peines inimaginables et il était difficile de surmonter ces épreuves. Qu’est-il arrivé de nos familles qui sont encore en Russie ? Sont-elles encore vivantes et que pensent-elles ?
L’assistance sanitaire pour les malades n’existait point en Russie, bien qu’il y eût un grand nombre de malades. Si quelqu’un tombait gravement malade, il était sûr de ne jamais plus recouvrer sa santé. Pendant l’hiver 1941-42, quand mon frère tomba malade des reins, ma mère dut personnellement le soigner, car ils ne voulurent point l’accepter à l’hôpital, sous prétexte qu’il n’y avait pas de place, tandis qu’en réalité c’était tout le contraire. Ma mère soigna la maladie par l’application de ventouses et mon frère ne guérit qu’au printemps suivant ; il ne pouvait pas guérir pendant l’hiver, car les conditions de vie ne le permettaient pas. Notre logement était très humide et nous n’avions pas de protection contre le froid. Sur les murs intérieurs de l’édifice, il y avait une couche de glace de deux ou trois centimètres. L’eau apportée à la maison le soir était complètement gelée le lendemain matin. L’hiver était très difficile à surmonter, car on ne pouvait pas avoir de vêtements lourds, et, s’il y en avait, ils coûtaient trop chers, de sorte qu’il m’était impossible d’en acheter pour tous les membres de ma famille.
Il arrivait parfois qu’une mère s’éloignât des enfants pour leur procurer de la nourriture et ne retournât plus chez elle parce qu’elle était restée transie en chemin ou avait été dévorée par les loups.
Pendant l’été, il y avait des nuées de moustiques qui répandaient la malaria. Les femmes en particulier mouraient de malaria, surtout celles qui étaient le moins réfractaires. » (12018 – W. S., étudiant.)
« ... Dans le secteur de Czurga moururent d’épuisement, de famine et par manque d’assistance médicale, les personnes suivantes :
1o) Fortecki François, d’environ 60 ans, mort de faim.
2o) Guzik Stanislas, de 37 ans, mort d’épuisement et faute de soins sanitaires.
3o) Gera Françoise, de 60 ans, morte d’épuisement.
4o) Uchyra Joseph, d’environ 50 ans, mort de faim.
5o) Strzech Anne, d’environ 38 ans, morte faute de soins médicaux.
6o) Fortecki Jean, d’environ 40 ans, mort de faim sans l’assistance du médecin.
7o) Strzech Stéphan, d’environ 16 ans, mort de faim, sans soins médicaux.
8o) Deux fils de Glinski Bronislas, le premier d’environ 13 ans, le second d’environ 10 ans, morts de faim, car leur père maladif, ne pouvait pas travailler.
Ces personnes provenaient de la colonie Stanislawowka, district de Sokal, province de Léopol. Elles ont été ensevelies dans la forêt, sans l’assistance d’un prêtre. » (17408 – K. B., agriculteur.)
« ... L’ombre d’un maître, agent de l’NKVD, devant lequel notre hôtesse cachait les œufs de Pâques, erre parmi les ruines du village détruit par la révolution. La vieille génération se prosterne devant les nombreuses images saintes, qui, rongées par les vers, tombent en poussière dans les coins des chambres, assiste aux offices des morts dans les cimetières et maudit la « collectivisation » et l’asservissement actuel des « kolkhoz » ; les jeunes gens sont parfois prêts à tuer les femmes polonaises sous prétexte qu’elles sont femmes d’officiers polonais. Là, dans la steppe grise, les enfants mineurs fléchissent sous le poids d’un travail accablant ; les tracteurs retentissent pendant la nuit, mais en même temps la moitié du bétail des « kolkhoz » meurt de faim ; le conducteur de tracteur pourrit dans les prisons, parce que, pendant une tempête de neige, il n’est pas allé réparer la machine ou a prononce, en état d’ivresse, quelques mots imprudents. Dans un lieu quelconque, il y a un « brigadier 69 » de Kamienez Podolski qui maudit le régime soviétique qui a déporté ses compatriotes, et sa fille, élève un cours décennal et appartenant à l’organisation du « komsomol », répète les phrases officielles du bolchevisme. Ou bien quelque Wanka de naissance polonaise – ne sachant pas parler polonais – manifeste sa solidarité à l’égard des familles polonaises déportées, calcule le nombre de kilomètres qui le séparent de la Pologne, ressent une haine foncière à l’égard des Soviets, rêve de pouvoir s’engager dans l’Armée polonaise, verse des larmes amères, comme un enfant, parce que son rêve ne pourra pas se réaliser. Et en prenant congé de nous, il nous apporte de chez lui un pain et un petit paquet de tabac. Poussés par un étrange instinct, les sauvages Kirghizes sympathisent avec les déportés que la souffrance met en commun avec eux. Monde étrange et terrible, où le mot liberté est le plus grand mensonge, où le mot égalité est effacé à tout instant, où le mot fraternité n’existe pas... Monde étrange, plein de charme et terrible ! Et lorsque je prends parfois en main un journal soviétique et que je lis quelque chose sur la vie des kolkhoz, moi qui connais bien mon kolkhoz, je sais que sous chaque mot se cache l’horrible, révoltant mensonge.
Et on voudrait alors crier, jusqu’à extinction de ses forces. On voudrait dévoiler toute la vérité sur la vie de là-bas à ceux qui sont désormais habitués à croire aux paroles mensongères. Mais seul celui qui a été là-bas, celui qui a vécu le sort tragique de l’animal fouetté peut comprendre pleinement cette vérité. » (10731 – S. K., 20 ans, élève d’une école moyenne.)
CHAPITRE VIII
VERS LES CAMPS DE TRAVAIL
1. PRISONS DE DÉCENTRALISATION
« ... La prison de Kharkov était tellement pleine de monde que la nuit nous dormions dans les couloirs, tandis que, le jour, ils nous jetaient dans la cour, recouverte de neige. Au printemps, quand le dégel avait commencé, on pataugeait jusqu’aux chevilles dans l’eau gelée, il n’était pas possible de s’asseoir, car il y avait partout de l’eau et de la boue. Nous attendions avec impatience le soir pour retourner dans les couloirs secs. Je passai un mois entier dans ces conditions. Après un mois, nous fûmes enfermés dans un local sans fenêtres, avec un plancher en ciment. Un coin de la chambre servait de cabinet, étant donné qu’il n’y avait pas de pot, et ce coin était donc plein d’excréments humains. Nous ne restâmes heureusement qu’un seul jour dans ce lieu, car le lendemain ils nous emmenèrent pour nous faire continuer le voyage. » (2313 – Z. S., employé de l’administration autonome.)
« ... Je passai l’époque des plus grandes chaleurs de l’été dans la prison de Kharkov, dans l’attente du départ d’un convoi vers les camps de travail. La cellule mesurait 10 × 10 x 3,5 mètres ; les fenêtres étaient barrées et fermées par une grille en fer faisant saillie vers l’extérieur. Nous étions 115 dans ce local, couchés par terre les uns près des autres ou, pour mieux dire, personne n’était couché, mais nous restions tous blottis sans même pouvoir allonger les jambes. Je passai 50 long jours et 50 nuits dans ces conditions, presque nu, car dans la cellule il faisait une chaleur insupportable. Dans les heures les plus chaudes de la journée, la sueur ruisselait sur notre corps. Nous suffoquions dans cette atmosphère intoxiquée par nos exhalations. Outre cela, la faim se faisait sentir, car les rations étaient minimes. Un prisonnier trouva un jour dans le cabinet un morceau de pain et il se hâta de le cacher sous sa chemise. Puis il le mangea dans la cellule, sale comme il était de fiente et d’urine. Cet exemple sert à montrer jusqu’à quel point la faim nous a tourmentés. » (10701 – J. H., médecin.)
« ... La prison de Kharkov était surpeuplée. Les mansardes, les couloirs, les cours débordaient de prisonniers, dont la plupart étaient des Polonais. Il y avait aussi de nombreux Roumains. Plusieurs centaines d’hommes passèrent deux nuits entassés dans une petite cour. Chaque coin était sale de fiente ; nous étions tourmentés par les mouches et par les voleurs. Ceux-ci volaient effrontément et attaquaient en plein jour. Après deux jours d’attente, ils nous enfermèrent dans les cellules. Il est difficile de décrire les conditions des prisonniers entassés dans un petit local, où, sur une superficie de six mètres et demi de côté, 137 personnes devaient trouver place. La cellule était exposée au nord-ouest et avait deux fenêtres, fermées avec de la tôle en fer. Des scènes indescriptibles avaient lieu, la nuit surtout, quand chacun cherchait un peu de place pour dormir. Les habitants de la cellule représentaient la mosaïque de peuples dont la Russie est constituée. Les Polonais formaient cependant le plus grand nombre. On emportait souvent de la cellule des hommes sur le point de mourir, mais à leur place on en poussait d’autres à l’intérieur.
Pour cette foule, il y avait seulement un petit cabinet pour trois personnes, avec un seul robinet. Des milliers de prisonniers, trois fois toutes les 21 heures, devaient se servir de ce cabinet ; ils étaient donc obligés de pourvoir à leurs nécessités en un temps record. Dans ces conditions, chacun satisfaisait ses besoins naturellement là où il pouvait, et dans la latrine il y avait une couche d’éjections d’au moins quinze centimètres, et les prisonniers étaient presque tous nu-pieds.
La Russie était en ce temps-là déjà en guerre et je souhaitai qu’une bombe allemande mît fin à mes souffrances. » (3681 – capitaine.)
2. LES TRANSPORTS
« ... À Berezowiez, au cours de notre déplacement de la prison à la gare, les miliciens soviétiques barrèrent les rues et arrêtèrent le trafic des véhicules et des piétons. Les habitants étaient obligés de fermer les fenêtres, les volets et les balcons. Nous traversâmes la ville fortement escortés, même par des chiens policiers. » (11228 – K. M.)
« ... Nous fûmes emmenés à pied, et notre cortège de « criminels » était conduit par un agent de l’NKVD pourvu d’un sifflet. Un long sifflement du « seigneur de la vie et de la mort » et tout s’arrêtait comme par enchantement. Le passant se cachait instantanément dans la première porte rencontrée, et s’il n’en trouvait pas tout près, il tournait aussitôt son visage vers le mur ou vers la palissade, là où le signal l’avait atteint. » (1781 – D. P.)
« ... Le 24 juin 1941, la prison de Vileika fut évacuée. Nous fûmes emmenés dans la rue devant l’édifice de la prison et placés cinq par cinq, en rangs, en deux groupes. Nous étions près de deux mille : ils nous mirent en route vers 16 h. Nous allions à une marche forcée en direction de Borysow, qui, ainsi que nous le constatâmes par la suite, était le but de notre voyage à pied. Nous avancions presque toujours le long de sentiers champêtres, nous dirigeant vers la frontière soviétique.
Quelques-uns parmi nous, affaiblis par une quinzaine de mois de prison, et déshabitués maintenant à la marche, puisque, dans la prison, la « promenade » n’était pas permise, devant en outre porter sur les épaules le paquet de leurs effets, se fatiguèrent bientôt et commencèrent à tomber. Les gardes leur donnaient des coups de pied pour les obliger à continuer la marche, mais lorsqu’ils s’apercevaient que ce « système de soin » ne donnait aucun résultat, ils les chargeaient sur des chers rustiques qui suivaient la colonne. Sous la chaleur insupportable, trempés de sueur et avec la bouche collée par une épaisse salive, on ne nous permit point de boire. La soif était tellement forte que l’eau la plus sale et gluante des flaques nous semblait une boisson exquise. Après deux jours d’une pareille marche, j’étais tellement altéré que lorsqu’on s’arrêta le soir près d’une fontaine, où il nous fut permis de puiser de l’eau à volonté, j’en bus en un quart d’heure quatre gamelles et demie d’un litre. Le 27 juin, tandis que nous avancions le long d’une grand-route, qui était déjà en territoire soviétique, à 10 heures du matin, nous fûmes attaqués pour la première fois par des avions allemands. Les appareils ne cessèrent pas de nous molester jusqu’à Borysow. Pendant la première incursion, ils obligèrent une centaine de nous à se coucher sur la route, l’un derrière l’autre, de sorte que si un avion allait survoler la route en mitraillant, seulement 20 % des hommes étendus le long du chemin seraient probablement restés en vie. Notre escorte perdit la tête : les soldats soviétiques s’éparpillèrent dans la campagne des deux côtés de la route, tirant à tort et à travers avec leurs revolvers et leurs fusils. Pendant l’action des avions, nous nous rendîmes parfaitement compte que les aviateurs ne voulaient point tirer sur nous. Les bombes tombaient, en effet, des deux côtés de la route et tuèrent quelques hommes de l’escorte, et en blessant d’autres. Chaque appareil lança quatre bombes, puis les avions s’éloignèrent. À partir de ce moment-là, nos tortures commencèrent. Les hommes de l’escorte, pris d’une panique indescriptible, commencèrent à fuir, nous obligeant de courir avec eux. Les prisonniers tombaient toujours en plus grand nombre d’épuisement ; ceux qui avaient plus de 50 ans ne pouvaient absolument pas suivre les plus jeunes et les plus forts. Les prisonniers qui se laissaient distancer ou tombaient de fatigue pendant la marche à travers les champs et les forêts, étaient tués à coups de revolver par les hommes de l’escorte. Près de Borysow, afin d’éviter que les coups n’alarmassent la population, les prisonniers restés en arrière ou tombés étaient tués à coups de baïonnettes. 400 prisonniers sur un total de deux mille furent tués de cette manière bestiale. Parmi mes connaissances moururent ainsi, en ce temps-là, Dziergacz Jean de Niestaniszki (district de Vileyka), Niedloszianski Jean de Niedroszle (district de Swienciany) et Merczanski Paul, maître d’école, de Swira. Ce dernier fut tué dans les bras de son fils Casimir, au moment où celui-ci le soulevait pour lui faire continuer le voyage.
À Borysow, nous fûmes chargés sur des wagons et commençâmes le voyage vers Moscou. Nous étions au nombre de 133 dans un wagon de marchandises de 60 tonnes. Les petites fenêtres et les portes du wagon étaient barrées. Nous nous déshabillâmes, gardant seulement sur nous le linge. La sueur ruisselait sur notre peau, la faim nous tenaillait, la soif nous brûlait les lèvres. Une salive épaisse nous collait la bouche. Depuis le 24 juin jusqu’au 5 juillet, nous ne reçûmes pas d’aliments chauds. Pendant ce voyage de Vileyka à Riazan nous reçûmes, deux fois, 600 grammes de pain, trois fois, une poignée de mies de pain noir rassis, un poisson salé et douze morceaux de sucre. Mais nous étions surtout torturés par la chaleur torride et la soif. Nous restâmes même 48 heures de suite sans une goutte d’eau. Lorsque, après deux jours, ils nous en distribuèrent un peu, nous dûmes nous partager le contenu de deux petits seaux entre 130 personnes, de sorte que chacun ne reçut que quelques gouttes. Une nuit, il y eut une pluie diluvienne. Nous en profitâmes, et, forçant la petite fenêtre, et nous bousculant l’un sur l’autre, nous recueillîmes de l’eau de pluie dans nos gamelles. Ce fut pour nous une véritable providence, car chacun recueillit en moyenne un litre d’eau. La soif avait déjà poussé quelques-uns à laisser refroidir leur urine et à la boire. J’étais prêt moi aussi à suivre cet exemple, et j’avais déjà recueilli de l’urine pour la laisser refroidir, quand la Providence voulut que dans une gare ils ouvrissent finalement les portes du wagon pour distribuer de l’eau à volonté. J’en bus cinq gamelles d’un litre. À la suite de ce manque d’eau pendant si longtemps, deux prisonniers moururent dans les wagons voisins. De Moscou, nous fûmes dirigés sur Riazan, où nous débarquâmes le 5 juillet. Ils nous transportèrent en autocar dans la prison, où je restai jusqu’au l6 septembre 1941. » (10749 – P. R., 43 ans, maître d’école.)
« ... Pendant notre passage, toutes les rues étaient interdites aux piétons et les fenêtres fermées pour que personne ne pût nous voir.
Je n’oublierai jamais les paroles de mon camarade d’infortune, qui marchait à coté de moi, dans le même rang. C’était un jeune ouvrier, un jeune homme qui avait sympathisé avec le communisme. Il me dit alors : « Je ne m’imaginais point que les communistes traitent les hommes de cette manière. Ils vantent cependant partout leur conduite humanitaire. J’ai visité une fois, au cours d’une excursion, une exposition de peinture, et j’ai vu un tableau représentant un convoi d’ouvriers poussés comme des troupeaux en Sibérie par les bourreaux tsaristes. Ce tableau m’a beaucoup frappé et je l’ai longuement contemplé. Mais si le peintre qui l’a fait nous voyait à présent, sous l’escorte de l’NKVD, il trouverait qu’il n’a pas assez de couleur noire pour peindre notre tableau. »
Oui ! ils ont commencé à comprendre la vérité ! » (14015 – L. C., né en 1906, commerçant.)
« ... Les convois devaient parfois parcourir à pied des distances atteignant ou même dépassant mille kilomètres. Au cours de ces voyages, les prisonniers devaient porter sur le dos leur bagage et celui du convoi, des provisions, constituées surtout de pain sec, des outils de travail et parfois même de l’eau. Les convois à pied passaient la nuit dans le parc. Autour du bivouac étaient allumés des feux au delà desquels se plaçaient les sentinelles, tandis que les prisonniers restaient à l’intérieur. Ce cercle de feu autour du bivouac était surtout destiné à éclairer la zone et à empêcher de la sorte une fuite éventuelle des prisonniers. Il n’était pas permis aux prisonniers, après la fin du jour, d’allumer d’autres feux pour se réchauffer. Le 6 janvier 1941, dans la troisième région du Petchora « lag », une colonne, marchant à pied, de 1300 prisonniers, 120 hommes d’escorte et 30 chiens mourut sous la neige, et la recherche des corps dura pendant deux mois ». (Extrait du rapport du doct. S. W. au sujet de l’hygiène du travail en URSS.)
« ... Au mois d’août 1910, je fus déporté en enfermé dans la prison de triage de Kharkov. Pendant le voyage de Kiev à Kharkov, les wagons étaient scellés ; on ne faisait point de distribution d’eau ou, lorsqu’on en donnait, il en revenait peu de gouttes à chacun, car un seau devait suffire pour un jour à une cinquantaine de personnes enfermées dans le même wagon de marchandises. Si un prisonnier mourait, son décès était signalé par nous seulement après la distribution de la nourriture afin de pouvoir nous partager le pain du mort. Pendant le voyage vers Kharkov sept prisonniers morts furent ainsi emportés. Les condamnés de droit commun, voyageant avec nous, nous volaient le dernier morceau de pain ; c’étaient eux qui décidaient de la distribution de l’eau. Un prisonnier se plaignit un jour et un de ces criminels le tua d’un coup assené avec un seau.
Le train, en tête et en queue, était éclairé par des projecteurs. Des mitrailleuses étaient placées aux deux extrémités et au milieu, et les chiens-loups nous accompagnèrent jusqu’à Kharkov.
De Kharkov, nous fûmes transférés à Boukhta Nakhodka, près de Vladivostok, où nous arrivâmes à la fin d’un voyage qui avait duré trente-quatre jours. Ce voyage est simplement indescriptible. Pendant presque tout le trajet, il ne nous fut pas possible de dormir, parce que, quand le trait était arrêté, les soldats de l’escorte frappaient sans cesse avec des marteaux aux parois des wagons ; de sorte que nous ne pouvions pas même penser à nous endormir. Mais nous étions surtout tourmentés par les condamnés communs, russes et ukrainiens, voyageant avec nous, qui nous volaient toute chose ». (765 – Sch. K., employé.)
« ... Le 12 juillet, ils chargèrent quelques centaines de prisonniers sur les fameux « stolypinki », et nous fûmes déportés vers l’Orient. Dans chaque petit compartiment, 20 ou 21 personnes étaient entassées. La chaleur était terrible et, à cause de la foule dans le compartiment, de la faim et de la soif, plusieurs déportés moururent au cours du voyage. J’étais, moi aussi, gravement malade et j’étais désormais destiné à être jeté en bas à la prochaine gare. Ils m’enlevèrent cependant du compartiment et m’abandonnèrent dans le couloir ; chaque fois que je revenais à moi, je priais Notre-Seigneur, et le Seigneur m’exauça.
Pendant 44 jours, je n’eus pas d’assistance médicale. Une seule fois, à Irkoutsk, ils appelèrent un médecin dans le seul but de pouvoir, après son rapport, jeter hors du train un Roumain, qui était sans connaissance depuis plusieurs jours. Le médecin n’osa pas toutefois faire jeter dehors un prisonnier encore vivant ; ils attendirent donc sa mort : il mourut peu de temps après.
Un jeune et fort Roumain était couché près de moi ; un jour, il tomba malade et s’évanouit. Il fut jeté avec violence hors du compartiment dans le couloir où il resta pendant 48 heures sans connaissance. Il mourut enfin. Un Européen aura de la peine à le croire, mais pas même un verre d’eau ne fut approché des lèvres du malade. Nous nous adressâmes au garde, lui demandant d’appeler un médecin à la première gare, mais il nous répondit : « Laissez le crever ! »
Dans une gare de Sibérie, on découvrit un dégât dans le wagon, malheureusement sous le cabinet. La réparation dura 21 heures et, pendant tout ce temps, personne ne put sortir du compartiment. Le prisonnier est en général un homme malade et doit souvent courir au cabinet. La situation dans notre wagon devint donc insupportable. Il était impossible de faire ses besoins par terre, où les hommes étaient couchés ; il ne restait donc qu’à remplir les récipients dans lesquels nous mangions et buvions, ce que nous fîmes. » (3681 – capitaine.)
« ... Le « train fantôme ». Vu de l’extérieur, il semblait être un train normal ; il avait même un très bel aspect. Mais à l’intérieur... Je tremblai et je me repliai sur moi-même : j avais l’impression d’être un fauve qui allait être enfermé dans une cage en fer. Être traitée comme une dangereuse criminelle, moi qui n’avais jamais eu l’occasion dans ma vie de voir une prison, pas même de l’extérieur ! Les parois du wagon étaient constituées par une épaisse maille de ter. La voiture était divisée en compartiments comme dans les trams normaux, mais à la différence que, dans notre compartiment, 20 personnes devaient prendre place, même sur les couchettes pliantes. La porte était munie d’une serrure cachée, dont les clés étaient gardées seulement par le chef du convoi. Près de la serrure était un judas, également fermé à clé, et avec un vasistas fait aussi en maille de fer. La clé du judas était gardée par un soldat armé d’un fusil, qui montait la garde pendant vingt-quatre heures dans le couloir. Nous recevions à travers cette ouverture la nourriture, composée de harengs et de 500 grammes de pain. Il n’était pas question d’eau, de sorte que chacun de nous, lorsque le chef du convoi nous autorisait personnellement à sortir, à 4 heures du matin, pour nous rendre au cabinet, buvant l’eau du lavabo, si, bien entendu, elle n’était point gelée. La visite au cabinet constituait l’attrait de la journée ; la permission était donnée à des heures fixes, à savoir à 4 heures du matin, à 1 heure de l’après-midi et à 6 heures du soir. On ne tint nullement compte de nos indispositions de l’estomac et de la vessie. « Attends, tu ne mourras pas », nous répondaient-ils. Lorsqu’on allait au cabinet, il fallait tellement se dépêcher qu’on avait à peine le temps de rentrer dans ce lieu heureux et déjà le garde frappait à la porte en criant : « Sors ! » Toujours et en toute occasion et pour toute cause, ils visent « Vite ! ». Dans le wagon, le compartiment cellulaire n’avait pas été oublié. Lette cellule était une petite cage sans siège et sans fenêtre (tandis que, dans les compartiments, il y avait une vitre, très petite, pas plus large que deux paumes de la main, peinte en noire et naturellement barrée) ; il y avait, d’autre part, une double porte en fer et, quand elle était tenace, nous étions dans une obscurité parfaite et sans air. Dans ce lieu, on pouvait hurler à tue-tête, crier vengeance au Ciel ou invoquer miséricorde, personne n’entendait et personne ne voulait entendre. » (11639 – J. T. D.)
« ... Parmi les moments les plus pénibles de notre voyage, il faut mentionner ceux pendant lesquels nous étions dans l’impossibilité de satisfaire nos besoins physiologiques. Souvent, pendant des heures entières, on entendait des voix suppliantes qui priaient de faire glisser la porte en fer ; ces voix se transformaient à la fin en des gémissements et malédictions. Les enfants (« maloletki ») transportés aux prisons ou aux maisons de correction et qui voyageaient dans les mêmes conditions que les adultes, souffraient plus que tout le monde. Ils étaient condamnés. Le monde de la criminalité enfantine n’est pas moins nombreux que celui des grandes personnes. Il existe en Russie, dans chaque wagon cellulaire, un compartiment pour les enfants.
Je me souviens d’un enfant qui se plaignait, « glapissait » pour qu’on le laissât aller au cabinet. Pendant quelques heures il gémit en répétant un seul mot : « c... » Il devint enfin complètement rauque et fit ses besoins à l’endroit où il se trouvait. Le garde devint enragé : il ordonna au coupable de ramasser avec ses mains ce qu’il avait fait. À travers la grille en fer, ils regardaient la scène pour voir comment elle finirait.
L’enfant pouvait avoir 13 ans. Il avait un beau teint foncé, des yeux clairs en amande qui le faisaient ressembler à un prince de l’Ouzbékistan. Il pleurait, mais ne voulait point se baisser ; au contraire, il relevait fièrement la tête. Le garde ne se sentit pas assez fort. Il appela le sous-officier, qui, d’un coup de pied, jeta violemment par terre le malheureux enfant ; il le saisit ensuite par le dos comme s’il s’agissait d’un tout jeune chien et lui frotta le nez par terre, comme l’on fait au chat, jusqu’à ce que les longs et noirs cheveux eurent nettoyé le plancher ; l’enfant avait le visage ensanglanté et sale de fiente ; un filet de sang lui coulait des dents. Abruti, il mordit une des mains de son persécuteur. Il fut jeté dans la cellule avec la seule chemise ; ils lui lancèrent une poignée de neige et comme il hurlait ainsi qu’une bête torturée, l’immobilisèrent en serrant ses mains dans de grands anneaux en fer, lesquels de temps en temps étaient serrés davantage ; la douleur causée par les blessures aux mains lui arrachait des gémissements toujours plus forts ; puis il devint rauque et commença à émettre des plaintes gutturales, sur le rythme des roues du train.
À la tombée du jour, mes camarades ferment les yeux, comme assoupies, mais je n’arrive pas à me rendre compte si elles dorment vraiment. Il fait dehors un froid glacial. Dans les compartiments-cages, l’air est saturé de la vapeur de notre souffle. La sueur ruisselle sur mon corps, comme sur les parois d’un bain turc. Je perds le fil de mes pensées. Je sens tout d’un coup ruisseler sur mon visage un liquide chaud qui pénètre dans mes yeux et entre dans ma bouche ; je me secoue et je commence à crier. Une de mes camarades, qui dort au dessus de moi, au comble de la souffrance, n’a pas pu résister.
Des jeunes filles emmenées vers une maison de correction voyagent aussi avec nous.
Impossible de s’étendre. Elles restent donc à moitié allongées et à moitié blotties ; de temps en temps, les jambes cherchent un peu d’espace et, en s’allongeant, elles rencontrent le visage de la voisine. Mouillée de transpiration, d’urine et de mes larmes mêmes, je m’endors très tard. Mais le sommeil ne me donne pas de repos. Un jour sale se lève apportant avec lui une autre journée pareille aux autres. Je perds le compte des jours et des heures qui s’égarent dans l’immensité de la Russie. J’ai l’impression que le pays n’a pas de fin, comme un antre infernal...
Le compartiment-cage change d’aspect. Les culottes suspendues, comme des chiffons sales, se balancent an rythme des roue du train. Bleu d’azur, couleur vineuse, de la plus vilaine maille en coton, elles ont désormais une forme qui ne rappelle plus celle des culottes normales : une odeur d’urine putride et d’autres éjections émanent d’elles. Madame Janka se plaint d’avoir des nausées. « Je me sens tellement agitée ; je ne peux pas lever la tête, et la gare est certainement encore bien loin »... Il est 7 heures. Le garde nous présente sur une planche un petit morceau de poissons plats et humides, sentant la salure. Nous n’avons pas mangé de pain depuis avant-hier et il semble bien que, sur notre itinéraire, il n’y aura pas d’autres gares importantes. J’essaye manger le poisson sans pain. Je le goûte. Il est salé, il pique à la gorge, mais nous le mangeons quand même. Après avoir avalé deux ou trois petits poissons, je commence à en sentir l’odeur, mais la faim est impitoyable. Après avoir mangé, on regarde avec moins de tristesse par la petite fenêtre sale. Je commence à fredonner une marche, rêvant de la miche la plus grande du monde, ronde, odorante, au grignon brillant. Mes camarades et moi, nous parlons souvent pendant le sommeil ; si nous pouvions avoir un unique, un seul pain de ce genre, la vie changerait de couleur... » (11658 – K. A.)
« ... L’histoire n’enregistre que deux seuls exemples de transport d’esclaves et de conditions inhumaines et cruelles : les galères romaines et les navires des négriers qui transportaient les esclaves de l’Afrique en Amérique. Un de ces deux exemples est de l’antiquité, l’autre remonte au XVIIe et XVIIIe siècle. Mais il y a un autre exemple, en plein XXe siècle, siècle du progrès et de la civilisation, et c’est le transport des prisonniers par embarcations sur la Dwina septentrionale, vers les rivages de l’Océan Glacial. Nous étions environ 1500 dans le fond des embarcations en bois (les écoutilles étaient gardées par des mitrailleuses), au milieu d’une foule de voleurs et d’assassins de la pire espèce, entassés au point de ne pas pouvoir redresser nos membres, avec 400 grammes de pain, un hareng et un godet d’eau pour chacun par jour. L’eau à boire était puisée directement à la rivière et donnée aux prisonniers sans être bouillie. La dysenterie faisait des ravages. » (11196 – E. M., médecin.)
« ... Une fois arrivés à Arkhangelsk, ils nous firent monter à bord d’un navire de cargaison tous ensemble, sains et malades. L’épidémie de dysenterie prit des proportions épouvantables. La cause de la maladie qui sévissait était très simple : un seul cabinet sur le pont supérieur pour cinq mille personnes. La queue devant le cabinet était très longue et les malades satisfaisaient donc leurs besoins n’importe où. Après six jours de ce voyage sur cet enfer flottant, à travers la mer de Barents et l’Océan Glacial, nous arrivâmes à Narian Mar, à l’embouchure du Petchora. Là nous fûmes de nouveau embarqués sur de grandes toues et enfermés sous le pont. Quinze jours après, nous arrivâmes au point de destination, mais nous étions réduits à la moitié et au maximum à 60 % du total ; les autres étaient morts pendant le voyage, à cause de la dysenterie ou d’autres maladies foudroyantes. » (11211 – doct. B., médecin.)
« ... Il y avait entre autres un « prorab », dont j’ai oublié le nom, qui, causant avec nous au sujet de notre libération et du voyage de retour que nous devrions faire, nous dit : « Ce sera bien pour vous si vous allez vers Kotlas, car, s’ils devaient vous transporter par mer, vous mourriez comme vos camarades. Deux bateaux qui allaient vers la Nouvelle Zemble ont coulé et 6000 personnes environ ont péri. » Je lui demandai des nouvelles plus précises, mais il ne sut pas m’en fournir, disant tout simplement qu’il avait entendu raconter ce fait par les agents de l’NKVD de la région ». (12541 – H. J., né en 1897, maire.)
« ... Au mois de mai, je partis avec le bateau « Minsk » et, à travers la mer du Japon et la mer d’Okhotsk, nous arrivâmes au port de Madagan sur le Kolyma. Si quelqu’un avait vu l’enfer dantesque, il dirait que ce n’est rien en comparaison de ce qui se passait sur ce bateau. Trois cent Polonais furent fourrés parmi 8500 brigands. On me vola tout et je restai nu comme Dieu m’a créé. Pendant deux jours, nous ne reçûmes pas de nourriture ; le troisième jour, ils distribuèrent quelques mies de pain, qui me furent arrachées des mains par ces bandits. De nombreux Polonais furent blessés à coups de couteau, parce qu’ils refusaient de livrer leurs vêtements et leurs effets.
Mais je ne pus résister quand ils se lancèrent contre un employé des chemins de fer de Léopol pour lui arracher son dentier en or. J’avais un couteau dans les mains. Je n’ai point de remords de conscience pour ce que je fis ; n’importe qui aurait fait la même chose à ma place. Une querelle furieuse éclata entre Polonais et Russes, et, à la suite de cette lutte, quatre Russes furent jetés à la mer par les surveillants du convoi, et 80, après avoir été fustigés avec des tringles, furent enfermés dans le fond de la cale où ils restèrent pendant tout le long du voyage. C’était un bateau marchand. Tous les prisonniers étaient obligés de rester sous le pont, où on respirait un air chaud et méphitique. Pour tant de monde il y avait seulement quatre cabinets. Les queues sous le pont devant le cabinet arrivaient jusqu’à 300 personnes. Bientôt, à cause de la foule et des maladies qui les obligeaient à faire leurs besoins n’importe où, l’intérieur du navire devint un grand égout. On s’attendait à ce que d’un moment à l’autre, une épidémie de typhus éclatât, mais heureusement, après 13 jours de voyage, nous arrivâmes à Magadan. » (1254. – C. K., 20 ans, étudiant.)
3. MINEURS CRIMINELS DES DEUX SEXES « OURKI » OU « CHALMAN »,
PLAIE DES PRISONS SOVIÉTIQUES
« ... Un mois après, nous frimes conduits de la prison de Vitebsk à Smolensk, où je fus pour la première fois en contact avec des prisonniers citoyens soviétiques. J’étais enfermé avec des enfants de 10 à 12 ans devenus complètement sauvages, condamnés pour brigandage, vol, coups, etc. Le chef de la cellule, généralement le pire délinquant, nommé par les autorités mêmes de la prison, s’appropriait par la force tout ce qu’il aimait, surtout des vêtements et des chaussures. Quelques prisonniers de la ville ou des environs recevaient des paquets de vivres, mais ils leur étaient immédiatement enlevés par les petits criminels, qui dévoraient tout. » (1781 – D. P., colonel.)
« ... Nous voyagions en compagnie de condamnées pour des délits différents ; c’étaient en majorité des voleuses (chalman). Dans le wagon, on me vola tous mes effets et même le verre pour l’eau me fut arraché des mains. » (2327 – L. F., institutrice.)
« ... Là-bas, c’est plein de voleurs. Des vols à chaque pas. En Russie on voit souvent des prisonniers en chemise et en caleçons, et déchaussés. Ils voyagent ainsi durant des milliers de kilomètres : ce sont des voleurs qui ont perdu leurs habits en jouant aux cartes. Les voleurs sont entre eux de parfaits gentlemen. Si l’un d’eux perd au jeu, il doit payer, sinon les autres le tuent. Souvent, le voleur se met à jouer aux cartes les effets d’un autre, et s’il perd, même ou prix de la vie du propriétaire légitime, il doit s’emparer des objets perdus au jeu, sans quoi il paye lui-même de sa vie. N’importe quel genre de travail dans le camp est permis aux voleurs ; les chefs des sections, des baraques et des brigades sont des voleurs. Le prisonnier politique, même s’il est un très bon spécialiste, ne peut pas se consacrer à son travail particulier. Pour les prisonniers politiques, il n’y a que les travaux lourds et sales. Dans les camps, les médecins seuls exercent leur profession ; les prisonniers politiques cherchent souvent à se faire condamner pour un délit commun dans le but d’obtenir la qualification de « non politique ». Les voleurs sont organisés et corrompent facilement leurs collègues, gardes des prisons ou des camps.
La pédérastie s’exerce presque ouvertement. Dans la prison de Kharkov, une nuit, huit voleurs violentèrent un jeune Russe. La chose fut connue, mais aucune sanction ne fut prise. » (3681– capitaine.)
« ... Les voleurs, les bandits et autres délinquants du même genre étaient les privilégiés. Ils formaient l’élite du camp. Ceux qui devaient administrer la vie du camp même, c’est-à-dire les « commandants » étaient recrutés parmi eux ; leur tâche consistait surtout à pousser brutalement les hommes au travail, en se servant souvent du bâton... » (10698 – N. D., 37 ans, directeur de coopérative.)
« ... Dans le camp de travail, nous fûmes mêlés aux plus mauvais « hommes-bêtes », c’est-à-dire, aux voleurs soviétiques. Ceux que je connus étaient complètement abrutis. Les actions homosexuelles étaient normales pour eux et ils s’y livraient ouvertement. Cette espèce de délinquants fut lâchée sur chaque nouveau contingent de Polonais qui arrivait au camp. Ils volaient tout ce que chacun possédait. Ils attaquaient en grand nombre une seule personne, lui enlevaient tout et fuyaient, tandis que le garde observait la scène en riant. Celui qui tombait parmi eux dans la cellule d’isolement était tourmenté par ces argousins qui allaient jusqu’à le faire mourir de faim. Lorsqu’ils jouaient aux cartes, ils étaient capables, s’ils n’avaient plus d’argent, de mettre en enjeu les chaussures d’un autre. Celui qui perdait devait à tout prix payer au vainqueur l’enjeu et lui remettre l’objet perdu ; ils attaquaient donc les étrangers, leur enlevant les chaussures et, si quelqu’un se défendait, ils le battaient et le blessaient ; contre eux, il n’y avait pas de défense possible, car le garde fermait l’œil, ou, au contraire, les incitait... Blesser ou tuer un homme était pour eux la même chose que tuer une mouche. Ils avaient toutes les charges et c’était à eux de déterminer la quantité de travail que les prisonniers devaient exécuter. » (768 – S. T., né en 1920, étudiant de l’université.)
« ... À Narjan Mar, il nous fut même impossible d’aller prendre un bain de vapeur. Nous nous épouillions tous les jours, mais nous étions chaque jour de nouveau infestés. Il ne se passait pas un seul jour sans que j’en tue au moins 150. Le vol à Narjan Mar était une chose normale, mais il n’y avait pas de cas de rapine.
Un fait fit sensation. Ils placèrent devant une baraque une petite table et quelques chaises ; peu de temps après, une commission médicale se présenta ; elle avait, disait-on, pour tâche de visiter les hommes afin de dispenser du travail les inhabiles. On mit sur la liste des hommes qui possédaient de belles fourrures et de beaux costumes. Mon nom aussi figurait sur cette liste mais heureusement à la fin, car il commence par la lettre Z. On fit l’appel d’une quinzaine de noms. Cinq par cinq, ceux qui étaient appelés devaient se dévêtir et la commission médicale les examinait. Lorsque les hommes, après la visite, voulurent remettre leurs vêtements, ils ne les trouvèrent plus : ils avaient été volés en présence de centaines de personnes. Complètement nus, ils commencèrent à hurler, appelant le chef. Personne cependant ne vint à leur secours, le chef ne se montra pas et les victimes couraient comme des fous à travers la section du camp. La « commission » disparut. Les Russes étouffaient de rire. Une gaieté générale régnait parmi eux. Ils avaient réussi à tromper les Polonais. La première neige tomba le même jour. Ainsi que nous l’apprîmes dans la suite, cette comédie de la fausse commission avait été mise en scène par le chef lui-même. Les victimes, restées nues, faisaient vraiment pitié. Nous nous dépouillâmes d’une partie de nos vêtements pour les recouvrir. N’ayant plus même leurs chaussures, ils se bandèrent les pieds avec des sacs... ». (Z. W., avocat.)
TABLE DES MATIÈRES
Introduction
PREMIÈRE PARTIE
CHAPITRE I – LA JUSTICE DÉMOCRATIQUE
CHAPITRE II – LES PRINCIPES DE LA JUSTICE SOVIÉTIQUE :
1) Relativisme et terrorisme
2) Le principe des moyens de défense sociale
3) L’obligation de la dénonciation, la responsabilité collective : le jugement par analogie et effet rétroactif de la loi ; la portée mondiale de la législation soviétique
4) La justice soviétique et les principes humanitaires
5) Prépondérance de l’action judiciaire en dehors des tribunaux
6) L’espionnage et le « trotskisme »
7) La justice est un élément de grande importance dans le système économique communiste
8) Conclusion
CHAPITRE III – TECHNIQUE DE L’ENQUÊTE ET DE LA PROCÉDURE :
1) Organisation judiciaire
2) Le Commissariat du Peuple pour les Affaires de l’Intérieur (NKVD)
3) Méthode des arrestations
4) L’instruction
5) Prison de l’instruction
6) Les débats juridiques
CHAPITRE IV – L’EXÉCUTION DES SENTENCES :
1) Genres de peine
2) La cellule de la mort
3) Exil
4) Transports par chemin de fer
5) Prisons de répartition
6) Camps de distribution
7) Transports par voie fluviale
8) Conditions de vie et de travail dans les camps
CHAPITRE V – URSS – PRISON DES PEUPLES :
1) C’est seulement une différence de termes
2) Organisation des camps
3) Nombre des prisonniers
4) La justice soviétique entre en Europe
DEUXIÈME PARTIE
Remarques préliminaires
CHAPITRE I – CARACTÈRE GÉNÉRAL DU DROIT BOLCHÉVIQUE :
1) Considérations d’un ex-prisonnier
2) Femmes et enfants
3) Qui est arrêté en URSS et pourquoi
CHAPITRE II – COMMISSARIAT DU PEUPLE POUR LES AFFAIRES INTÉRIEURES :
1) NKVD et Gestapo
2) L’NKVD dans les territoires occupés – La révolution administrée
3) Divide et impera
4) La délation commence déjà à l’école
5) Engagement de mouchards
6) La toile d’araignée des dénonciations
7) Passivité de la société
CHAPITRE III – SYSTÈMES D’ARRESTATION :
1) Arrestation dans les habitations
2) Coups de filet
3) Embûches
4) Pièges
CHAPITRE IV – LES PRISONS :
1) Les prisons de passage
2) Les prisons modèles
3) La « tiurma » soviétique commune
4) L’affluence dans les prisons
5) La mosaïque des prisonniers
6) La femme en prison
7) L’hygiène et le secours médical
8) Les perquisitions
9) Un jour quelconque
10) La cellule de rigueur 213
CHAPITRE V – L’ENQUÊTE :
1) À la recherche du crime
2) Terreur morale
3) Violences physiques
4) Agents provocateurs dans la prison
5) Les juges d’instruction
CHAPITRE VI – L’ÉMISSION DE LA SENTENCE :
1) Les débats judiciaires
2) « Moscou est loin »
3) L’Osso
CHAPITRE VII – MOYENS DE DÉFENSE SOCIALE :
1) Dans l’attente de l’exécution de la sentence de mort
2) La colonie de « rééducation » pour les mineurs
3) La déportation
CHAPITRE VIII – VERS LES CAMPS DE TRAVAIL :
1) Prisons de décentralisation
2) Les transports
3) Mineurs criminels des deux sexes « ourki » ou « chalman », plaie des prisons soviétiques