Le Mexique martyr
par
Albert BESSIÈRES
«... Barbaries sans égales... cruautés et atrocités à peine croyables, au XXe siècle, en pleine lumière de civilisation, à peine croyables, à la face des Nations... sans que tous les peuples se dressent avec un cri d’horreur et d’exécration... Tant de victimes immolées, ignorées du monde, ensevelies sous la pierre tombale d’une vraie conjuration du silence. »
PIE XI, Noël du 24 déc. 1927.
PRÉFACE
de Mgr PASCUAL DIAZ, évêque de Tabasco (Mexique),
secrétaire du Comité des Évêques mexicains.
Le R. P. Albert Bessières est trop connu dans le monde des lettres et particulièrement en France, pour qu’un patronage quelconque soit nécessaire au livre qu’il vient d’écrire sur la persécution religieuse qui sévit au Mexique.
Cependant, dans la profonde affliction qui pèse sur mon cœur d’évêque et d’exilé, il m’est particulièrement consolant d’associer mon nom au sien, pour dévoiler à tous ceux qui ignorent, indifférents ou trompés, les profondes et multiples souffrances des catholiques mexicains.
À ce premier et très puissant motif s’ajoute pour moi une vieille et fraternelle affection pour le R. P. Bessières, mon compagnon d’études, dans la France toujours très aimée, où s’est achevée ma formation religieuse et sacerdotale, entourée des exemples de vertu et des preuves de savoir de mes frères dans la Compagnie de Jésus.
Ce n’est ni la voix du P. Bessières ni la mienne qui ont dénoncé au monde la « Conspiration du silence », ces mots sont sortis des lèvres, ou, pour mieux dire, du cœur de notre auguste Pontife, S. S. Pie XI, paternellement ému de ce que souffrent ses fils mexicains, et profondément affligé de l’indifférence où se maintiennent les nations à leur égard. L’auteur du Mexique martyr en étudie et en sonde les causes anciennes, causes actuelles aussi, et d’autant plus pénibles à constater que, journellement, on entend, dans la presse, un écho universel désirant la paix pour tous les peuples, et, pour l’obtenir, affirmant la nécessité de l’union pour le maintien de l’ordre et de la justice.
Pourquoi ferme-t-on les yeux sur les horreurs de la persécution religieuse que le Mexique subit depuis deux ans ? Pourquoi les grands journaux qui, chaque jour, propagent, aux quatre vents du ciel, la plainte d’un opprimé, les réclamations d’une victime, les protestations d’un homme ou d’un pays qui s’estime lésé dans son honneur ou dans ses biens, gardent-ils le silence sur les martyrs mexicains, sur la tyrannie qui s’exerce cyniquement, au mépris de toutes les vraies libertés, et enlève aux âmes ce qu’elles estiment le plus nécessaire et ce qu’elles ont de plus cher ?
Le Mexique martyr répond à ces pourquoi pleins de mystères et d’angoisses.
Puisse-t-il ouvrir les yeux à la vérité des faits, fixer les regards sur un pays catholique qui ne veut pas mourir, et où déjà tant de martyrs ont donné leur sang au cri de Viva Cristo Bey !
Puissent ces pages hâter le triomphe de ce Roi divin, Roi des individus et Roi des nations, Roi de ce peuple mexicain que sa Reine et Mère, la Vierge de Guadalupe, a conquis à la foi et a comblé des marques de son maternel amour !
PASCHALIS DIAZ, S. J.
év. de Tabasco.
New York, 3 avril 1928.
INTRODUCTION
I
L’appel de Pie XI au nom du Mexique martyr
Un appel est parti du Vatican attirant l’attention du monde civilisé sur l’effroyable malheur d’un peuple qu’on égorge.
Le martyre du Mexique est un défi à la civilisation.
J’ai voulu, pour mon humble part, répondre à son cri de détresse.
Des documents de première main m’ont été fournis en abondance. Je les dois aux lettres, aux photographies, aux notes et mémoires, la plupart inédits, surtout aux longues conversations d’amis mexicains, de Français revenant du Mexique. On comprendra que je ne publie pas leurs noms. Il n’en faut pas tant à Plutarque Calles pour commander un peloton d’exécution.
J’adresse aussi des remerciements à la Fédération nationale des Catholiques Américains : « National Catholic Welfare Conference », à la revue America qui, sur la demande de Mgr Léopoldo Ruiz Y Florez, archevêque de Morelia, et celle de mon vénéré condisciple, Mgr Pascual Diaz, évêque de Tabasco, secrétaire du Comité épiscopal mexicain, tous deux exilés, ont bien voulu me fournir une documentation abondante.
Merci encore à mes amis du Séminaire missionnaire de Vals qui m’ont aidé à utiliser ces volumineux dossiers, à la Jeunesse Catholique de Toulouse et à Mgr Délies, vicaire général, directeur des œuvres, organisateurs de mes premières conférences sur le Mexique martyr, en mars 1928.
Un motif personnel m’encourageait à ce travail de solidarité catholique : la fidélité aux amitiés anciennes.
De 1912 à 1925, j’ai entretenu avec le Mexique une abondante correspondance. Ces noms : Mexico, Jalisco, Puebla, Guadalajara, etc., qui reviendront souvent sous ma plume, m’étaient, dès longtemps, familiers. Le Mexique fut un des premiers pays, après la France, à adopter ces Ligues eucharistiques de communion fréquente, cette Croisade eucharistique qui allaient couvrir le monde : hommes, jeunes gens, surtout une armée d’enfants s’y enrôlaient. Ils avaient leurs insignes, leurs costumes pittoresques, leurs drapeaux... et une si belle flamme ! Lettres et photographies m’arrivaient en grand nombre... pleines de soleil et de vie ardente. En mai 1922, les bataillons des Croisés mexicains m’envoyaient, avec une belle offrande pour Pie XI, un splendide volume illustré contenant un bien autre trésor : les millions de prières, communions, sacrifices que ces jeunes voulaient, par mes mains, offrir au Saint-Père.
Je lui présentai ce volume où battait le cœur du Mexique, avec les autres, où battait le cœur des cinq parties du monde. Et Pie XI souriait. Il ne savait pas qu’un jour (dans quatre ans), il lui faudrait pleurer (mais des larmes où il y a plus de joie que de tristesse) sur ces jeunes victimes dont les Indes, la Chine, le Mexique auraient pris le sang. « Ce sont en même temps des tristesses et des joies divines, disait le Saint-Père, au dernier Noël, qui germent et fleurissent sur les misères humaines. »
Nos pauvres chemins sont ainsi : la lumière, puis les ténèbres, quelques joies qui préparent aux amertumes... Mais, par bonheur, nous ne savons jamais la nuit qui nous attend au prochain carrefour.
Cette joie mêlée de tristesse, je l’ai connue aujourd’hui en entendant un témoin venu de ce Mexique dont il a parcouru tous les États, vu toutes les ruines et tous les héroïsmes, me dire : « Ce sont les Ligueurs, les Croisés de 1913, de 1925, ces jeunes gens, ces jeunes filles, ces hommes, formés à la vie héroïque par la communion fréquente, le sacrifice et l’esprit de prosélytisme, qui sont les martyrs d’aujourd’hui... Ils lisaient, avant de tomber, vos appels à la Croisade dans ces récits traduits par la Cruzada et la Jeunesse Catholique Mexicaine : Parvuli, Pour vivre, La Faim du Pauvre, Pour rebâtir la cité, Introibo, Inter Lilia, etc. L’Hostie a fait éclore des héros. »
*
* *
Souvenons-nous, puis mettons-nous à l’œuvre. Le silence de la chrétienté en face des attentats mexicains, s’il durait, serait la plus grande faillite morale de l’après-guerre.
L’Europe va-t-elle tolérer davantage une pareille atteinte à tous les principes de la civilisation ?
Le monde ne sera-t-il pas enfin réveillé par l’appel que Pie XI lui adressait au jour de Noël 1927 :
En ces tout derniers jours, et même en ces dernières heures, on Nous informe de choses très tristes, de barbaries sans égales, de cruautés et d’atrocités à peine croyables, au XXe siècle, en pleine lumière de civilisation ; à peine croyables, à la face de toutes les nations ; à peine croyables, sans que toutes les nations se dressent avec un cri d’horreur et d’exécration.
Dieu connaît ses secrets, Dieu sait ceux qui souffrent et meurent pour lui. Cette pensée Nous est nécessaire, quand tant de victimes meurent ignorées, peut-on dire, du monde, ensevelies sous la pierre tombale d’une vraie conjuration du silence.
II
La Conjuration du Silence
On a dit que le martyre de la Pologne, dans le silence ou la complicité du monde civilisé, avait mis l’Europe « en état de péché mortel ».
Ce péché mortel, commis en 1772, aggravé en 1793, consommé en 1815, 1830 et 1863, dura un siècle et demi et ne fut réparé, en 1919, que par l’effondrement des trois puissances coupables du long écrasement d’un peuple.
Depuis 1917, le monde assiste, impassible, à cet autre attentat contre la civilisation. Trois millions de Russes massacrés, torturés par la Tcheka et le Guépéou ; deux cents millions d’hommes réduits en esclavage [1].
Et voici un troisième attentat, plus criminel, peut-être, que les deux précédents. Depuis décembre 1924, à la frontière des États-Unis, un immense pays, trois fois et demi plus grand que la France, peuplé de quinze millions d’habitants, voit se renouveler toutes les atrocités qui font du nom de Néron l’opprobre du genre humain. Depuis trois ans, un monstre prétentieux, grotesque et ignoble : l’instituteur-général-président-dictateur, Plutarque Calles, pille, brûle, saccage le Mexique ; égorge, fusille, écorche, éventre, enterre ou brûle vivants des hommes, des femmes, des enfants ; en trois ans, le chiffre de la population tombe de quatorze à douze millions. Et le monde civilisé se tait.
Pie XI, qui osa dénoncer, à peu près seul, dans le silence des puissances, l’attentat qui se poursuit en Russie, tout en sollicitant la pitié pour ses millions d’affamés, rompt encore le lâche silence des civilisés.
Hélas ! qui répond à l’appel ? Quelques journaux, quelques revues catholiques ; l’épiscopat français, américain, espagnol, etc. ; quelques grandes Associations Catholiques : Aux États-Unis : les Chevaliers de Colomb, l’Association Nationale Catholique (NCWC). En France, la Fédération Nationale Catholique... et de nouveau le silence retombe. La TSF ne manque pas de nous dire les dernières paroles d’une étoile de cinéma qui, par chagrin d’amour, se donna la mort de l’autre côté de l’Océan ; les derniers gestes de deux anarchistes condamnés de droit commun, pour lesquels on a recueilli 600 000 dollars, dressé des barricades dans les cinq parties du monde : Sacco et Vanzetti ; nous savons les plus minimes fluctuations des changes ; l’appel d’un vaisseau pétrolier désemparé envoyant ses SOS du golfe du Mexique ; l’immense clameur d’un peuple traqué se perd dans le silence.
Je me trompe, une certaine presse humanitaire le rompt parfois, mais pour insulter les victimes, propager les mensonges des bourreaux, donner ces brutes imbéciles pour des précurseurs.
Il existe en France et ailleurs une Ligue des Droits de l’Homme [2], Langevin, Bidegarrav, Jean Bon se prononcent également contre l’ordre du jour de M. Bourdon. Seuls MM. Guernut et Basch insistent pour l’examen immédiat de la question mexicaine.
La majorité, par 7 voix contre 6 et 1 abstention, décide, en passant à l’ordre du jour, de fermer les oreilles à l’appel d’un pays où tous les droits de l’homme sont ignoblement violés. Mais les victimes ne sont ni des libres penseurs, ni des anarchistes ; dès lors, qu’importe ? La Ligue n’a-t-elle pas assez à faire à s’occuper des camarades ?
PREMIÈRE PARTIE
Historique de la persécution
I – LES PRODROMES
I. La domination espagnole.
Avant l’arrivée des Espagnols, le Mexique est habité par de multiples populations indiennes : les Mayas, les Otomites, les Toltèques, les Chichimèques, les Apaches, dont le nom est devenu un symbole. Au XIVe siècle apparaissent les Aztèques qui bâtissent Mexico, construisent des routes, élèvent des pyramides, des palais, des temples.
Des divinités informes y sont honorées par des sacrifices humains et particulièrement par des sacrifices d’enfants. L’intronisation d’un roi Aztèque comporte parfois, nous apprennent les premiers historiens du Mexique, l’immolation de 30 000 à 50 000 victimes. Même après l’arrivée des Espagnols, des scènes de cannibalisme couronneront, longtemps encore, les sanglantes liturgies aztèques. Au début du XVIe siècle, le roi Montezuma, le vaincu de Fernand Cortez, gouverne ce peuple parvenu à une certaine civilisation matérielle, mais moralement dégradé [3].
Cortez occupe le Mexique en 1519 et y établit une domination dont l’Église s’efforcera sans cesse d’adoucir les rigueurs.
Le P. Rutten, dans son discours au Sénat belge, le 21 février 1928, rappelle l’action du Dominicain espagnol Bartholomé de Las Casas en faveur des Indiens : « Au prix de difficultés que nous pouvons à peine concevoir, il traversa quatorze fois l’Océan pour aller détendre à la cour d’Espagne les Indiens de l’Amérique centrale réduits au pire esclavage. » Cet effort séculaire de l’Église mexicaine fut, en somme, couronné de succès et les Indiens ne l’ont jamais oublié.
Lé clergé séculier et régulier, Jésuites, Bénédictins, Dominicains, Augustins, Franciscains... commencent par arracher les Indiens à leur polythéisme sanglant, souvent au prix de leur propre sang.
Tandis qu’aux États-Unis, les gouvernements puritains exterminent les populations indigènes, résumant leurs vœux par ce proverbe barbare : « Un bon Indien, c’est un Indien mort », les conquérants espagnols du Mexique, formés par l’Église à une autre morale, conservent, multiplient la population indienne [4]. Les chiffres relevés par les évêques nord-américains ont, ici, une éloquence. Tandis qu’aux États-Unis, six fois plus étendus que le Mexique, la population indigène est tombée à 342 406 pour 115 millions d’habitants, il reste au Mexique 10 millions d’Indiens sur une population de 15 millions.
L’Église ne se contente pas de sauver ces Indiens dont Calles prétend se faire, contre elle, le défenseur, elle les élève à un haut degré de civilisation, créant, pour eux, des écoles, des Universités, les premières et les plus florissantes du Nouveau Monde, une littérature et un art indigènes [5].
À cela passent presque toutes les ressources dont le pouvoir laisse l’usufruit à l’Église : celles, par exemple, de cet humble Frère convers Pierre, de Gand, parent de Charles-Quint, qui, menant lui-même une vie de miséreux, consacre toute sa fortune à la construction d’églises, d’hôpitaux, d’écoles pour les Indiens.
N’en déplaise à Calles, l’indianisme a connu un âge d’or, un seul, c’est celui de la domination espagnole, et cet âge d’or qui fit surgir de cette race, aujourd’hui revenue à la barbarie, des peintres de génie comme Velasquez, des poètes et des poétesses comme Inès de la Croix, religieuse métisse considérée comme « le Racine espagnol » du XVIIe siècle, c’est l’influence de l’Église qui le rendit possible.
Et cependant, cette civilisation porte en elle un germe de décadence. L’absolutisme royal prépare à la fois la déchéance de l’Église et celle du peuple mexicain. Le pouvoir du roi sur les affaires ecclésiastiques, déterminé par les doctrines régaliennes et joséphistes, soumet l’Église à une tyrannie absolue. Le roi nomme les évêques, les bénéficiaires, délimite les diocèses, les missions, se proclame possesseur de tous les biens d’Église, ne laissant à celle-ci qu’un usufruit toujours précaire ; les gouverneurs s’immiscent dans les questions de liturgie et de culte.
L’absolutisme révolutionnaire, n’aura, pour asservir l’Église, qu’à s’inspirer des traditions royales.
Par ailleurs, le peuple indien, maintenu en une étroite tutelle, n’ayant jamais fait l’apprentissage de la liberté, va être livré, sans défense, aux pires dictatures et ne comprendra rien au nouveau rôle que, théoriquement du moins, lui reconnaîtra la constitution républicaine.
À partir de Charles III (1759-1788), la décadence de la nouvelle Espagne s’accélère. Partout, relâchement religieux et administratif. L’expulsion des Jésuites, en 1767, ruine, non seulement un grand nombre d’écoles primaires et secondaires, mais ces admirables réductions où des écoles d’agriculture, d’apprentissage, des caisses communales de Secours Mutuel, avaient donné un merveilleux essor à des régions aujourd’hui désertiques. Les gouverneurs, imbus des idées voltairiennes sur l’éducation du peuple, laissent se fermer des milliers d’écoles. La décadence industrielle du Mexique, l’effrayante multiplication des illettrés commencent alors.
Les exactions royales, pendant la Révolution française, la confiscation des couvents, des biens d’Église, des revenus consacrés par elle aux œuvres d’assistance et d’instruction, déclenchent la révolte. Dès que les Indiens voient l’Espagne paralysée par ses luttes contre Napoléon, ils se soulèvent, sous la conduite de deux curés : Hidalgo (1810) et Morelos (1813), au cri de : « Vive Notre-Dame de Guadalupe ! »
2. L’indépendance.
Hidalgo et Morelos, exécutés, comme le seront à peu près tous les chefs vaincus jusqu’à nos jours, les Cortès espagnols, en votant la suppression de toutes les maisons et institutions religieuses, donnent un nouvel élan à la révolte. Le général espagnol Iturbide, Mexicain de race, se proclame empereur du Mexique (1822). La constitution, qu’il promulgue, connue sous le nom de « plan d’Iguala », est résumée par trois mots : « Religion, indépendance, union ». Renversé, grâce à l’appui des États-Unis, par les révolutionnaires, exécuté en 1824, la République fédérative est proclamée ; calquée sur celle des États-Unis, elle comprend 27 États jouissant d’une certaine autonomie sous la direction générale du Congrès.
3. Les convulsions mexicaines.
– L’ère des persécutions.
Pas plus que leur peuple, les fondateurs de la République mexicaine et leurs successeurs, jusqu’à ce jour, n’ont la moindre idée d’un gouvernement démocratique. Le suffrage universel est un mythe au Mexique. C’est à coups de fusils qu’on renverse le gouvernement dont on est fatigué ou qu’on juge suffisamment engraissé par ses exactions. Un pronunciamiento l’expulse, et les nouveaux occupants recommencent le jeu. Il est mené, depuis l’indépendance, par une petite minorité bourgeoise imprégnée du voltairianisme qui se répandit comme une traînée de poudre dans la haute société mexicaine, à la fin de la domination espagnole. Affiliée aux loges rivales : rite d’York et rite d’Écosse, « Yorkinos et Escoceses », parlant, en 1928 comme en 1824, le langage amphigourique des encyclopédistes et du Café du Commerce, cette bourgeoisie n’a pas bougé depuis un siècle et a empêché son pays d’avancer d’une ligne. Je dirai comment les États-Unis ont vu leur intérêt économique et idéologique à la maintenir dans cette impasse. Le premier consul américain, Joel Ponsett, qui arma les États-Unis contre le conservateur Iturbide, fit deux cadeaux au Mexique : celui d’un gouvernement révolutionnaire et celui de la Maçonnerie qu’il implanta dans tout le pays, au point que la qualité de maçon devint, comme aux États-Unis, presque indispensable pour jouer un rôle politique.
Dès lors, l’histoire du malheureux Mexique se présente à l’esprit comme une série de tremblements de terre qui ne permettent de rien bâtir, renversent tous les édifices au moment où ils sortent de terre. La comparaison est d’autant plus juste que, depuis 1501, époque où le Popocatépetl entra en éruption, le Mexique a connu 669 tremblements de terre, dont quelques-uns, comme celui de 1920, anéantirent des villes entières, déplacèrent des fleuves et des montagnes. Le rôle joué par l’Église au cours de cet épouvantable cataclysme résume parfaitement son action au cours de cent ans de convulsions politiques.
Au moment où le fléau s’abattit sur le Mexique, les évêques revenaient d’exil, le sang des martyrs avait coulé à flots. Dans l’universelle confusion d’une terre qui paraissait entrer en agonie, c’est autour de l’Église, de ses évêques, de ses prêtres, que les populations épouvantées se groupèrent d’instinct ; c’est par eux, évêques et prêtres, hier pourchassés comme des malfaiteurs, que le sauvetage fut presque partout organisé. Presbytères, évêchés, églises, tout ce qui leur restait de ressources et celles que leurs appels à la charité catholique surent créer, furent mis à la disposition des milliers d’infortunés errant loin de leurs maisons effondrées.
Ainsi, depuis un siècle, c’est l’Église mexicaine qui répare et bâtit, la révolution qui détruit. De 1825 à 1925, le Mexique subira près de

Le président Calles.
300 révolutions, et les ardeurs d’une nature excessive porteront tout de suite les maux à des excès inconnus de races plus évoluées et de cieux plus cléments.
1. – Le général VICTORIA, nommé président par le Congrès de 1824, ouvre cette histoire qu’on a dite « écrite par la main du bourreau ». Tout son gouvernement est marqué par de continuelles révoltes. La Constitution de 1824 garantit, comme « le plan d’Iguala », les droits de l’Église. Mais les chefs de bande qui ont porté Victoria au pouvoir pillent impunément églises et monastères.
Pedrazza succède en 1827 à Victoria, et donne en 1828 valeur légale à ces exactions, en décrétant l’expulsion des Congrégations missionnaires et la confiscation de leurs biens. Ce décret a pour résultat de fermer à peu près toutes les écoles du village et rejette les Indiens vers la barbarie.
Dès lors, les gouvernements successifs, qu’ils soient aux mains des maçons Yorkinos ou aux mains des maçons Escoceses, ceux-ci représentant la gauche radicale, le parti libéral aristocratique des « Illustrudos, éclairés », ceux-là formant la gauche démocratique composée surtout de métis, tous sont d’accord pour dépouiller une Église qui condamne leur concussion, réprouve leurs sectes.
Pedrazza est renversé par le général Guerrero, lui-même fusillé en 1831. Le radical Farias arrive pour sauver le pays et supprime les vœux monastiques !
Santa-Anna. – Un chef de bande, Santa-Anna, qui occupe Veracruz depuis 1832, devient dictateur en un pronunciamiento (1833). Appuyé par 1a Maçonnerie américaine, il fait de l’anticléricalisme l’article essentiel de son programme, bannit le clergé et l’enseignement religieux des écoles publiques, confisque les propriétés d’Église et revendique néanmoins le privilège royal de nommer les titulaires des évêchés et bénéfices. Chassé quatre fois de la présidence, il y revient quatre fois (1835, 1841, 1846 et 1853 à 1855). Pendant vingt ans, il terrorise et ruine le Mexique, supprime ou conduit à coups de bottes les Congrès, retire le droit de vote aux Indiens, supprime la Constitution, livre les provinces aux chefs de bandits qui le maintiennent au pouvoir. Il n’y a plus un sou dans le trésor. En 1841, c’est la banqueroute.
Pour protéger les intérêts français, le prince de Joinville bombarde Veracruz et exige des réparations, tandis que les États-Unis envahissent le Mexique, mettent Santa-Anna en déroute, et, le 2 février 1848, annexent la moitié du pays : le Texas, l’Arizona, le Nouveau-Mexique, l’Utah, la Nevada, la Californie. L’anticléricalisme ne perd pas ses droits pour autant... Tandis que les troupes américaines marchent sur Mexico, les patriotes pillent les églises, fusillent les prêtres.
Enfin, Santa-Anna est chassé du pouvoir en 1855. Voilà le premier grand homme dont se réclame Calles.
Et voici le second, le plus grand :
2. – BENITO JUAREZ. Indien de race, ancien séminariste, maçon « escocese », Juarez, pendant, ses dix-huit ans de dictature (1854-1872), à peine interrompus par quelques disgrâces, consommera la ruine de l’Église et du Mexique, mettra au service de son sectarisme et de son ambition les mêmes brutalités sauvages que le président actuel. Quarante ans de troubles sous 73 chefs différents et 36 formes de gouvernement successives ont blessé à mort le Mexique, lui ont fait perdre le moitié de son territoire ; Juarez va lui donner le coup de grâce. Nationaliste farouche comme Santa-Anna, ce jacobin obtus combattra l’Église parce qu’elle obéit à un Pape étranger et livrera son pays aux maçons, aux financiers étrangers et à l’envahisseur.
Sous la présidence du général Comonfort (1856-1858), maçon du rite Yorkino, Juarez, vice-président, représentant du rite « Escocese », établit, entre les deux sectes rivales, un « cartel des gauches » dont le ciment est l’accentuation et la codification de la politique anticléricale.
Les biens du clergé (du moins ce qui en subsiste), les établissements d’instruction, d’assistance, confisqués ; malades, écoliers jetés à la rue (car ce qu’on supprime n’est pas remplacé, mais les liquidateurs, la tourbe des généraux faméliques, s’enrichissent) ; Dominicains, Carmes, Franciscains, chassés de leurs paroisses... La Constitution de 1857, œuvre de Juarez et de Comonfort, codifie toutes ces violences ; le Sénat, supprimé ; les articles 5 et 27 abolissent les Ordres monastiques, enlèvent aux ministres de la religion le droit d’acquérir des propriétés et de percevoir des revenus.
Cette Constitution, imposée par voie dictatoriale, la liquidation des biens d’Église, provoquent la guerre civile qui chasse Comonfort et Juarez de Mexico (1858).
Deux présidents conservateurs, Zuloaga (1858-1859) et Miramon (1859-1861), commencent à organiser le sauvetage du pays. Mais, tandis que l’Europe les reconnaît, les États-Unis reconnaissent Juarez, dont la politique anticléricale et diviseuse sert leurs intérêts.
En 1859, sans autre autorité que celle d’un partisan révolté, Juarez développe les articles 5 et 27 de sa propre Constitution repoussée par le pays. Les lois qui complètent les mesures dictatoriales de 1857 reçoivent le nom de Lois de Réforme. Juarez y décrète les points suivants : Suppression de tous les Ordres religieux, noviciats, confréries et communautés de femmes ; confiscation de tous leurs biens, y compris « les livres, imprimés et manuscrits, les peintures, antiquités, etc. » ; interdiction, sous les peines les plus sévères, de porter l’habit religieux et de vivre en communauté ; sécularisation de tous les hôpitaux, asiles, maisons de correction, institutions charitables, de quelque dénomination qu’elles puissent être ; les legs à des ministres de la religion, à leurs serviteurs (!), à leurs parents (!), jusqu’au quatrième degré, sont frappés de nullité ; nul ministre, d’aucune religion, ne peut ni diriger, ni administrer, ni patronner une institution de charité privée ; églises, résidences ecclésiastiques et leurs dépendances, deviennent propriété d’État. L’usage n’en sera permis qu’en conformité avec les règlements de l’État ; aucun rite religieux ne sera toléré hors des églises, « ni dans les cimetières, ni dans les caves, ni dans les cryptes », où aucun clerc ne peut entrer, où aucun ministre ne peut porter d’habit ou d’insigne ecclésiastique ; le mariage n’étant qu’un contrat civil, tous les mariages contractés autrement sont annulés. L’État seul déterminera la validité, la nullité des mariages, les cas de divorce ; non seulement l’Église ne pourra pas enseigner, mais l’enseignement religieux est prohibé dans les établissements publics...
Telle est la législation d’un sectarisme dément, œuvre d’un chef de bande, que Calles prétendra remettre en vigueur. C’est seulement deux ans plus tard (1860-1861) que Juarez, grâce aux fusils des États-Unis, confisquera la présidence, pour la ruine définitive du Mexique.
Un de ses premiers actes est de suspendre le payement des dettes étrangères. Émus, les États-Unis décident d’intervenir contre leur protégé d’hier. Mais, voyant l’Angleterre, la France, l’Espagne intervenir, à leur tour, en ce pays, où ils entendent demeurer seuls arbitres, voyant Napoléon III donner, en Maximilien d’Autriche, un empereur au Mexique (1864-1866), les États-Unis s’allient à Juarez redevenu chef de guérilla, massent une armée à la frontière, expédient argent et munitions, consomment la ruine de Maximilien qui est fusillé in Queretaro, le 19 juin 1867.
Revenu au pouvoir pour cinq ans (1867-1872), Juarez ne se préoccupe point de guérir les blessures de son pays, mais ravive la guerre civile en complétant ses Lois de Réforme. Ainsi, en 1871, une loi enlève aux ecclésiastiques le droit de vote. La presse gouvernementale reproche âprement aux catholiques d’avoir soutenu l’étranger Maximilien. Et, pourtant, le malheureux empereur, imbu d’idées joséphistes, a préparé la tâche de son bourreau, découragé les conservateurs en refusant d’accepter le « Plan d’Iguala » pour se rallier à la Constitution anticléricale de Juarez... C’est sous son gouvernement que se consomme la vente des biens d’églises.
3. – LERDO DE TEJADA, ministre de Juarez, prend sa succession à la présidence (1872-1876) et, dès 1874, fait entrer les Lois de Réforme dans la Constitution, prétendant par là les rendre intangibles. La séparation de l’Église et de l’État, l’interdiction du costume ecclésiastique, la suppression des Ordres religieux, la laïcité de l’enseignement et de l’assistance, l’interdiction des cérémonies extérieures du culte, etc., deviennent lois d’État. Le despotisme de Tejada, la dilapidation des deniers publics amènent une révolution, le pronunciamiento de Porfirio Diaz, qui prend la présidence en 1876, et, sauf quatre ans d’interrègne (1880-1884), la gardera jusqu’en 1910.
4. – Né d’un cabaretier espagnol et d’une Indienne, DIAZ arrive, comme ses prédécesseurs, à la présidence par la carrière des armes. Ancien séminariste, il a gardé la foi, sinon la pratique ; vaincu, exilé après trente ans de dictature, il mourra pieusement à Neuilly-sur-Seine le 2 juillet 1915. Son « règne » réparateur assure au Mexique une grande prospérité matérielle et une paix relative.
Le plan de « Palo Blanco », base de son gouvernement, comporte l’application de la Constitution, le rétablissement du Sénat, la liberté électorale pour tous, y compris pour les prêtres.
Les réformes utiles se multiplient : assainissement financier, suppression du brigandage, organisation d’une armée régulière, construction d’un réseau ferré. Télégraphes, téléphones, tramways électriques couvrent le pays ; la population passe de 5 à 18 millions d’habitants.
Et cependant, plus efficacement, peut-être, que les gouvernements révolutionnaires précédents, ce « règne » d’union et de prospérité nationale prépare la catastrophe actuelle. Cet organisateur de génie n’a oublié qu’une chose : l’organisation morale, religieuse et sociale.
Au point de vue religieux, Diaz laisse volontiers dormir les dispositions anticléricales des Lois Juaristes. Les églises se rouvrent, le clergé rétablit 2 000 écoles indiennes, réorganise ses Séminaires ; écoles libres, collèges, hôpitaux dix et douze fois confisqués depuis trente ans, sortent partout de terre sous l’impulsion des Congrégations religieuses.
Mais, par contre, tout l’arsenal des lois sectaires demeure ; la paix de l’Église est à la merci d’un pronunciamiento. Bien mieux, l’esprit de cette législation, base de l’enseignement officiel, prépare en silence des générations de démolisseurs. Esclave des Cientificos, intellectuels positivistes et sectaires qui dirigent les ministères, gouvernent les États, nomment les fonctionnaires, lui font accepter pour vice-président le franc-maçon militant Corral, Diaz travaille inconsciemment à la paganisation du Mexique. Les catholiques, accusés d’être « les hommes de l’étranger », les suppôts de Maximilien, sont tenus à l’écart de toute vie politique et s’y résignent trop facilement. La paix a fait tomber leurs ardeurs militantes des jours de lutte.
Au point de vue social, les ferments de révolte préparés par « le bon tyran » sont plus graves encore.
C’est d’abord le régime du bon plaisir dont Diaz donne l’exemple aux gouverneurs : le « Caciquismo » qui accumule partout les haines.
Ce sont les injustices sociales qui écrasent la foule des indiens. Les 5/6 du territoire appartiennent à un petit nombre de familles colossalement riches, à ces « cientificos » blancs et créoles, possesseurs de latifundia et des mines, dont le matérialisme économique tend à rejeter dans le « péonisme » (esclavage à peine déguisé) 10 à 12 millions d’Indiens et de Métis. Presque tout l’État de Coahuila appartient ainsi à la famille Madero, d’où va sortir le chef de la révolution. Une partie de ces immenses « haciendas » demeure en friche, tandis que le pauvre « Indito », occupât-il depuis cent ans un lambeau de terre, peut s’en voir dépouillé du jour au lendemain par l’Alcade ou un accapareur, si son titre de propriété n’est pas inscrit au cadastre. Quant aux « peones » attachés aux terres des opulents « hacendados » comme travailleurs, leur sort demeure continuellement à la merci du maître. Leur ignorance est presque absolue. À la fin du règne de Diaz, en 1911, il y a 10 millions d’illettrés sur 15 millions de Mexicains. La presse indépendante, très étroitement surveillée, ne peut guère combattre ces abus, et la presse radicale, subventionnée par le dictateur, les ignore volontairement.
Le xénophobisme, un des sentiments que Calles exploitera le plus activement, grandit aussi. Les étrangers : Belges, Allemands, Hollandais, Anglais, Français, surtout Américains du Nord, établissent partout des usines, exploitent les mines et les haciendas, construisent les voies ferrées, éclaboussent de leur luxe « l’Indito », qui, poussé par des agitateurs professionnels venus d’Amérique, maudit les « Gringoes » qui grignotent sa terre.
La ruine de Diaz viendra de ces causes et d’une autre décisive à tous les tournants de l’histoire mexicaine : l’intervention des États-Unis.
Le Mexique, industrialisé par les Américains, risquait de tomber, comme l’isthme de Panama, sous leur contrôle. On sait comment le canal, commencé par Lesseps, achevé par les Américains en 1913, passa sous leur domination. Une révolution fomentée par eux à Panama fournit le prétexte d’intervenir pour rétablir l’ordre, se rendre maître du canal et annexer une bande de terrain sur chaque rive...
Diaz vit le danger, emprunta en Europe l’argent nécessaire pour racheter les voies ferrées aux actionnaires yankees, favorisa la Compagnie pétroléenne anglaise « El Aguila », présidée par Pearson, au détriment de la « Standard Oil », Compagnie américaine régie par le multimilliardaire Rockefeller. Un autre crime que le gouvernement de Washington allait lui faire expier fut le refus de louer aux Américains la baie de la Madeleine, future base navale de la Californie mexicaine.
Dès lors, Diaz fut condamné, à Wall Street, par « la diplomatie du dollar ».
5. – MADERO (1911-1913) fut « l’homme de paille » de ces intérêts financiers, « le pantin » dont les États-Unis tiraient les ficelles. L’opinion ne s’y trompa pas qui baptisa la nouvelle révolution : « La lutte de Rockefeller contre Pearson », et en infligea à Madero le sobriquet de « Président Pétrole ». Ploutocrate-démagogue, immensément riche, ambitieux, éloquent, courageux et fat, Madero fit appel aux socialistes déjà puissants dans les milieux industriels, aux agrariens, aux Inditos, à qui il promit le partage des terres et la réforme scolaire. Connaissant les sentiments religieux des masses, il s’abstint de toute surenchère anticléricale. Et l’on vit des bataillons indiens se ruer au pillage avec une image de Notre-Dame de Guadalupe sur la poitrine, tandis que d’authentiques bandits à la solde de Madero : Orozco, Zapata, Villa, mettent le pays en coupe réglée.
Ces bandes n’eussent jamais triomphé des troupes régulières, sans l’intervention de l’oncle Sam, qui envoie des armes aux révoltés, en refuse à Diaz et expédie ses croiseurs à Veracruz pour appuyer la révolution. Parvenu au pouvoir, Madero se révèle immédiatement inférieur à sa tâche. Il n’a pas la volonté de Diaz pour gouverner un peuple enfant passé, sans transition, de la servitude à l’indépendance. Socialistes et agrariens réclament le partage immédiat des terres, tandis que les bandits : Zapata, Villa, Orozco, hier à la solde du maître, terrorisent le pays, appuyés par les États-Unis, à qui Madero (accusé de leur être vendu) n’ose accorder les avantages promis. Les honnêtes gens, par ailleurs, appellent de tous leurs vœux la fin de ce régime d’exactions.
En février 1913, le « Présidente Petroleo » est attaqué dans Mexico par les généraux Félix Diaz, Reyes, Huerta ; pendant une dizaine tragique, on se bat, à coups de canon, en pleine capitale ; 3 000 morts, 7 000 blessés demeurent sur le terrain. Madero et son vice-président Suarez sont assassinés. La victoire de la « Standard Oil » coûte cher, mais, au moment où le Mexique retombe dans l’anarchie, les financiers new-yorkais remportent une précieuse victoire, en acquérant 60 pour 100 des actions des voies ferrées. À ce prix, le Mexique peut descendre au fond du gouffre. Les mêmes influences vont l’y précipiter [6].
6. – CARRANZA (1914-1919). Le général Victoriano Huerta, élu comme président provisoire, Indien de race, homme de talent et de conscience, pourrait sauver de la décomposition son malheureux pays. Reconnu d’abord par l’Angleterre, l’Allemagne, tardivement par les États-Unis (malgré les rapports pleinement élogieux envoyés par les ambassadeurs et les consuls américains), il va succomber par la politique maçonnique et protestante du président Wilson. « C’est de cette politique, écrit un religieux américain, le P. Michaël Kenny, S. J., qu’est sortie l’orgie de persécution et d’anarchie parvenue a son apogée dans les décrets Calles. »
Pour la première fois, le président de la République mexicaine ouvrait le Congrès au nom de Dieu et invitait les députés à prier pour que le règne de la paix et de la justice arrivât enfin.
Le peuple indien applaudit Huerta, ce président de sa race qui osait parler le langage des masses. Mais les députés, pour la plupart bourgeois radicalisants, se montrèrent hostiles.
Les Loges américaines prirent peur ; une députation de maçons américains et mexicains vint informer Huerta qu’elle obtiendrait pour lui la reconnaissance et l’appui des États-Unis, s’il consentait à adopter son programme, sinon ce serait la lutte. Huerta refusa de s’incliner devant la sommation et déclara qu’il entendait « vivre et mourir catholique ».
C’était signer sa condamnation.
Sur ces évènements les documents abondent : l’Enquête officielle de la Commission Fall sur le rôle des États-Unis dans la politique mexicaine, publiée par le gouvernement américain, résumée dans la relation faite au Sénat de Washington, en 1920 ; le livre de Mgr Kelley, évêque d’Oklahoma : Le Livre Rouge et Jaune (Sang et Folie) et ses nombreux articles dans l’Extension Magasine ; enfin les études de Mgr Curley, archevêque de Baltimore (Washington fait partie de ce diocèse), primat des É.-U. dans sa Revue catholique.
À elle seule, l’Enquête officielle des É.-U. constitue un document accablant. Après avoir reconnu Victoriano Huerta, que les vœux du pays appellent, le président Woodrow Wilson, méthodiste franc-maçon, se tourne contre lui et passe au parti de Carranza, qui, s’appuyant sur la maçonnerie, les socialistes, le bandit Villa, vient de déclencher la révolution.
Le grand-maître de la Maçonnerie écossaise aux É.-U. assure le révolté du concours du président Wilson et du secrétaire d’État W. J. Bryan. L’ambassadeur américain Lane Wilson, favorable à Huerta, est rappelé de Mexico. Carranza et Villa entrent en campagne, pourvus d’armes, de munitions et d’argent par la « Standard Oil », par le gouvernement de Wilson qui met l’embargo sur les armes de Huerta.
Et c’est un débordement de barbarie épouvantable.
L’ambassadeur Lane Wilson le résumera ainsi pour la Commission Fall : « 300 000 Mexicains tués, plus d’un million morts de faim. Le Mexique ruiné ; 3 000 églises désaffectées ; 1 500 prêtres chassés ; 364 institutions religieuses (dont plusieurs de femmes) envahies, profanées, dans des circonstances qu’on ne peut convenablement décrire... » Et tout cela se passe, ajoute-t-il, avec l’appui des organisations protestantes et maçonniques des États-Unis.
Le protestant américain E. Coll Byam, dans la revue France-Amérique-Latine (fév. 1920), n’est pas moins explicite : « Partout, les églises furent saccagées, les prêtres et les évêques contraints de se cacher ou de s’exiler ; les religieuses outragées et traitées avec une brutalité sauvage. Nombre de prêtres furent mis à mort, après avoir été affreusement torturés et mutilés... »
Villa, l’homme de confiance de Carranza, raconte Mgr Kelley devant la Commission Fall, prend, un jour, un effort au poignet droit, à force de tirer, dans une cour, contre des prisonniers sans défense, à coups de revolver...
Wilson n’ignore rien de cela, l’Enquête Fall contient une lettre de lui au cardinal Gibbons, on il reconnaît « l’étendue et l’énormité des crimes contre la vie, contre la liberté et la religion », commis par Carranza-Villa et déplore l’inefficacité de ses efforts pour arrêter ces débordements.
Et cependant, le triomphe de ses protégés paraissant trop lent, Wilson organise, par son envoyé John Lind, des meetings révolutionnaires en plein Mexique, et, le 10 avril 1914, fait occuper Veracruz, fermant ainsi la seule porte par où les munitions pouvaient arriver d’Europe aux gouvernementaux. En conséquence, Victoriano Huerta doit démissionner, le 15 juillet 1914.
Carranza, vainqueur, va organiser méthodiquement la persécution contre les catholiques. Wilson, néanmoins, non seulement le reconnaît comme le président légitime du Mexique, mais s’emploie à le faire reconnaître par l’Europe. Le 9 mai 1919, il se vante du rôle joué au Mexique : « J’étais poussé par le seul désir d’aider les Mexicains à se débarrasser d’un homme (Victoriano Huerta) qui rendait impossible tout arrangement de la politique mexicaine. » On verra le bel « arrangement » procuré par les mitrailleuses de Wilson. À la fin du règne sinistre de Carranza, le journal le plus rouge de Mexico, la Révolution, résumera ainsi l’arrangement : « Disons-le nettement, la révolution carranziste s’achève en désastre ; un immense et sanglant suaire, un « sambenito », où on a enveloppé pendant dix ans le peuple mexicain. Au concret, Néant... »
Mais Wilson est au-dessus de ces jugements ; Dieu lui-même l’a investi d’un rôle messianique ; il le proclame en ces termes : « La mission qui est la mienne et que la divine Providence m’a confiée, est d’établir, au Mexique, l’ordre social que j’estime convenable à ce pays. » Cet ordre social, c’est le triomphe de la maçonnerie, du protestantisme, et, chose plus singulière, du socialisme. Tandis que Carranza va entreprendre une lutte sanglante contre l’Église, donner libre cours à un vrai délire antireligieux : statues mutilées, tabernacles violés, confessionnaux brûlés sur les places publiques, églises transformées en écuries, écoles et hôpitaux catholiques confisqués, biens d’Église nationalisés, promulgation de la constitution maçonnico-socialiste de Queretaro, évêques expulsés, 60 000 Mexicains catholiques exilés, pendant ce temps, constate la Commission Fall, les protestants sont encouragés, leurs écoles, leurs œuvres subsidiées, et Carranza choisit, pour chef d’état-major, le protestant Obregon.
... Selon la commune destinée de ses émules, Carranza va, néanmoins, périr par les protecteurs qui le hissèrent au pouvoir.
Pour remplir les caisses de l’État que les confiscations des pauvres biens d’Église ne suffisent pas à alimenter, Carranza, créature des pétroliers américains, comme son prédécesseur le « Présidente Petroleo », double les droits d’exportation des pétroles. C’est signer sa déchéance. Obregon, général de fortune, âme damnée de Carranza, à qui il doit d’être devenu, lui, soldat famélique, criblé de dettes, un des plus puissants « hacendados » et le « Roi du pois chiche », monte la révolution, avec l’appui des pétroliers, expulse Carranza et le fait assassiner, en mai 1920, sur la route de Veracruz. Mais Carranza ne meurt pas tout entier. Il laisse la fameuse Constitution de Queretaro, promulguée dans la ville de ce nom en 1917, l’arme sanglante de Calles. Quelle est l’origine de cette Constitution ? « Volonté souveraine du peuple mexicain », affirme Calles. Exactement la même que celle de la Constitution juariste qu’elle prétend ressusciter.
Tandis qu’en 1913-1914, révolté contre le président Huerta, il ensanglante le Mexique en compagnie de l’atroce Villa, Carranza porte un certain nombre de décrets militaires. Ces proclamations d’un chef de guérilla, imprimées plus tard, formeront le code de Queretaro. Fut-il au moins soumis à la ratification du suffrage universel comme l’exigeait la Constitution ? Nullement, une chambre constituante fut, il est vrai, réunie en 1917 : ce fut le Club des Jacobins.
Seuls furent admis à voter les révolutionnaires qualifiés, environ 3 pour 100 des électeurs, encore ne pouvaient-ils élire comme députés que les « candidats capables de prouver qu’ils avaient apporté une aide matérielle à la révolution carranziste ». C’est ce Club, « la Convention des Porte-Drapeaux Rouges », qui fut chargé d’élever les décrets militaires de Carranza à la dignité de lois.
Voici résumés les principaux articles de cette Constitution de Queretaro.
ART. 3. – L’enseignement officiel à tous ses degrés, ainsi que l’enseignement primaire privé, seront neutres.
Aucune corporation religieuse, aucun ministre du culte ne pourront fonder ou diriger des écoles primaires.
ART. 5. – Les Ordres monastiques sont interdits, quels que soient leur objet et leur dénomination.
ART. 24. – Les exercices du culte ne peuvent se célébrer que dans les églises, et celles-ci sont, en tout, soumises à la surveillance officielle.
ART. 27. – L’Église ne peul acquérir, posséder ou administrer nul immeuble, ni par elle-même, ni par personne interposée. Ceux qu’elle possède actuellement : églises, évêchés, presbytères, Séminaires, asiles, collèges, couvents... sont confisqués et nationalisés.
La simple présomption, la délation à laquelle tous les citoyens sont conviés, suffisent pour que l’on considère comme propriété d’Église tel ou tel bien.
Les ministres du culte, les associations religieuses ne peuvent avoir à leur charge aucune institution de bienfaisance publique ou privée.
ART. 130. – Les ministres du culte sont considérés comme exerçant une profession individuelle, sans aucun lien avec aucune espèce de hiérarchie et astreints aux lois édictées par l’État sur l’exercice de leur profession.
Les Congrès de chacun des 27 États de la Confédération mexicaine ont seuls qualité (et non les évêques ou le Pape) pour déterminer, selon les besoins locaux, le nombre maximum des ministres du culte (curés, évêques, pasteurs...) autorisés à exercer leur ministère.
Tous les ministres du culte doivent être Mexicains de naissance. Ils ne pourront en aucune réunion, ni publique, ni privée, critiquer les lois, ou les gouvernants, sous peine d’amende et de prison.
Ils n’auront droit de vote ni actif ni passif.
On ne pourra ouvrir au culte nul local nouveau sans l’autorisation du ministère de l’Intérieur.
Chaque église doit avoir un responsable laïque auquel est commise la garde du mobilier nationalisé.
Tout changement de pasteur doit être communiqué à l’autorité municipale par le prêtre sortant et son successeur, accompagné de dix paroissiens.
Aucune revue religieuse, aucun journal religieux ne peut s’occuper de politique ni des actes des autorités y ayant quelque rapport.
Les prêtres ne peuvent hériter ni d’un prêtre, ni de n’importe qui, si ce n’est de proches parents, jusqu’au quatrième degré de consanguinité...
Législation burlesque et odieuse qui, renouvelant à la fois les folies du joséphisme et celles de la Convention, met d’une part l’Église hors la loi, et de l’autre la surveille étroitement, l’organise eu Église nationale et schismatique.
Les évêques mexicains, Benoît XV et Pie XI l’ont condamnée, au nom des droits de la conscience qu’elle viole impudemment.
*
* *
7. – OBREGON (1920-1924), principal auteur de la Constitution de 1917, universellement méprisé pour ses innombrables actes de banditisme, pillard d’églises, voleur des terres des Indiens Yaquis, après avoir fait assassiner son maître et bienfaiteur, Carranza... trouve en face de lui Adolfo de la Huerta, président provisoire. Homme de courage et de conscience, Huerta prétend assurer au Mexique un régime de liberté. À son programme figure la liberté des cultes, de l’enseignement. C’est dire que la Constitution de Queretaro, reconnue par Wilson, sera abolie.
Contre Huerta, Obregon fait appel aux pétroliers, leur promettant de larges concessions, aux méthodistes et aux maçons américains. Chef de rebelles, il est constitutionnellement inéligible. Le Comité américain des relations étrangères, à la suite de son enquête de 1920, rédige sur son compte un rapport accablant, réclame la révision de l’odieuse Constitution de Queretaro, déclarée anticonstitutionnelle, qualifie la politique de Wilson au Mexique de « déshonneur pour la civilisation »... Rien n’y fait. La victoire, une fois de plus, restera au pétrole. Sous le président Harding (1921), les grands pétroliers de la « National Petroleum Oil Company » descendent à Mexico, où Obregon et son lieutenant Calles leur promettent 51 pour 100 des pétroles mexicains. Les négociateurs offrent, en retour, un cadeau de 5 millions de dollars, la reconnaissance d’Obregon par les États-Unis, des secours en munitions contre Huerta qui serre de près le révolté.
Les concessions demandées sont contraires à la Constitution de 1917, œuvre d’Obregon... Il accorde tout.
Pareillement, en violation de la Constitution, il donne par un Pacte secret pleine satisfaction aux prédicants protestants, aux pro-propriétaires américains. Voici le texte :
1o Les missionnaires nord-américains, ministres du culte et maîtres, seront libres d’entrer et de résider au Mexique pour y enseigner, prêcher, écrire, posséder et diriger des écoles sans l’intervention de l’autorité mexicaine, à condition qu’ils ne se mêlent pas de politique intérieure.
2o Les limites fixées par la Constitution aux propriétés des étrangers ne s’appliqueront pas aux propriétés déjà acquises par les Nord-Américains.
3o De même, la prohibition de posséder des terres, pétroles, mines, ne s’appliquera pas au Nord-Américains.
4o De même, la partie de l’article 48 de la Constitution qui interdit aux organisations religieuses de posséder des immeubles : presbytères, évêchés, Séminaires, orphelinats, collèges, écoles, ne s’appliquera pas à eux.
... Ces quatre articles, comme les évènements vont le montrer, joueront pour les protestants américains, mais non pour les catholiques.
Harding se déclare satisfait et envoie à Obregon les armes nécessaires pour réduire Adolfo de la Huerta.
En attendant, Obregon fait procéder à la comédie des élections (1920), dispersant à coups de fusil les partisans de Huerta. Ses soldats, devenus grands électeurs, « jouent le rôle de comparses de théâtre, sortant par une porte après avoir voté ; rentrant par l’autre pour recommencer », raconte un témoin, R. Capistran Garza.
Faisant honneur aux promesses du président Harding, son successeur Coolidge reconnaît le gouvernement d’Obregon en 1923.
« Il n’ignore pourtant pas », s’écrie Mgr Curley, primat des États-Unis, que ce bandit s’est « imposé à main armée, que le peuple mexicain n’a pas eu plus de part à l’élection d’Obregon qu’à celle de Coolidge... » Et cette reconnaissance, continue le prélat, déclenche une reconnaissance semblable de la part des autres États qui « ignorent les pactes secrets par lesquels cette reconnaissance fut achetée » ! Et il conclut : « Depuis douze ans, la politique des États-Unis au Mexique est dictée par les intérêts financiers, le pétrole, les minerais. Tout se résume en questions de lucre, de faveurs légales ou illégales. » (Mexican Tyranny and the Catholic Church, p. 35-36.)
Le sénateur Lodge demande aussi à la tribune du Congrès Américain qu’on en finisse avec la politique wilsonienne : « Si nous voulons participer à la pacification du monde, dit-il, commençons ici, par le Mexique. »
Hélas ! par leur élu, Obregon, les gouvernants des États-Unis vont précipiter la ruine du pays, après en avoir arraché les premières germinations de vie poussées sur le sang des martyrs.
En effet, malgré brimades et mises hors la loi, les catholiques, réveillés par la chute de Diaz, n’ont cessé de gagner du terrain. Organisé en 1910, le Parti National Catholique Politique envoie 90 députés au Congrès qui porte Madero au pouvoir (1911). Ce parti publie des revues sociales, crée des syndicats ouvriers, fait voter par l’État de Jalisco, où il domine, des lois sociales importantes.
Le clergé mexicain excellent, formé souvent dans les Séminaires romains et par nos Lazaristes, aidé par les Congrégations étrangères : Maristes, Frères des Écoles chrétiennes, etc., ne fait pas de politique, mais se donne à l’action catholique et sociale. Le nationalisme ombrageux d’une poignée de prêtres ambitieux ou indignes, hostiles à Rome et au clergé étranger, ne saurait diminuer la valeur de ce fait, mis en relief par la persécution actuelle et la fidélité héroïque du grand nombre.
Ces prêtres, de 1901 à 1913, multiplient les écoles primaires et secondaires, les coopératives, les œuvres de bienfaisance ; dans quatre Congrès ou Semaines Sociales, ils étudient les principaux problèmes agricoles, ouvriers, ethniques. En 1914, la consécration du peuple mexicain au Sacré-Cœur montre la vitalité du catholicisme dans les masses. En même temps s’organisent les Chevaliers de Colomb, la Jeunesse Catholique, la Confédération nationale Catholique du Travail, l’Union des Dames Catholiques ; plus tard, la Ligue Nationale pour la liberté religieuse.
Bref, une vraie renaissance capable de régénérer le Mexique, d’en faire une nation indépendante. En face de cette activité, Carranza comprit la nécessité d’atténuer son sectarisme, et, en 1920, manifesta même l’intention d’amender la Constitution de Queretaro, ce qui amena sa chute.
Obregon, à son tour, n’ose pas appliquer, dans sa rigueur, la Constitution, mais multiplie les brimades : le 12 janvier 1923, le

La foule des fidèles devant l’église Notre-Dame de la Guadeloupe
aux heures qui précédèrent l’exécution des décrets de persécution.
délégué apostolique, Mgr Filippi, pose la première pierre d’un monument au Christ-Roi, sur le Cubilete, centre géographique du Mexique ; 60 000 fidèles assistent à la cérémonie. Bien qu’elle se déroule dans une propriété particulière, et donc légalement, Mgr Filippi est expulsé pour avoir, lui, étranger, participé à une cérémonie du culte public.
En septembre 1921, une bombe éclate à la porte de l’archevêché de Mexico, une autre dans le sanctuaire national de Notre-Dame de Guadalupe. Au lieu de sévir, Obregon prétend que la justice populaire a voulu prévenir la justice officielle trop lente à punir un épiscopat rebelle. Les manifestations de piété occasionnées par ces attentats donnent lieu à de sauvages représailles.
Le Centre de la Jeunesse Catholique, pris d’assaut par les ouvriers de la C.R.O.M., les jeunes catholiques sont proclamés provocateurs.
À Guadalajara, à Morelia, des ouvriers, des membres de la Jeunesse Catholique, des chrétiennes de la meilleure société, sont abattus à coups de revolver par les communistes.
Au mois d’octobre 1924, Mexico voit se dérouler les cérémonies triomphales du Congrès Eucharistique National. À l’issue du Congrès, Obregon traduit en justice les catholiques coupables d’avoir arboré des insignes religieux. Les inculpés sont des millions ; il faut renoncer aux poursuites ou décréter la terreur.
C’est ce que va faire son collaborateur et successeur à la présidence, Calles.
II – LA PERSÉCUTION DÉCHAÎNÉE
1. Calles (novembre 1924-...).
Ancien sacristain, puis instituteur primaire, dans un village de Sonora, Plutarco Elias-Calles, né d’une Indienne et d’un Juif Syrien [7] venu aux États-Unis pour y exercer l’usure, mena d’abord une vie besogneuse. Devenu général, comme tout citoyen qui se respecte, en un temps et en un pays où il suffit pour acquérir ce grade de coudre des étoiles à sa manche, puis ministre d’Obregon, enfin président, cet ancien magister, ennemi mortel des latifundia, est devenu par la politique sectaire et communiste le premier « latifundiste » du Mexique. À la tête d’immenses propriétés dans la Nouvelle Léon, à Saint-Louis de Potosi, dans l’État de Mexico, une seule de ses haciendas, celle de Soledad de la Mota (N. Léon) vaut un million de pesos (500 000 dollars).
D’après la Constitution, dont il s’instituera le chevalier, Calles était triplement inéligible : 1° parce que fils d’étranger ; 2° parce que mêlé aux révolutions précédentes ; 3° parce que, ayant foulé aux pieds, pendant la campagne électorale et au jour des élections, tous les dispositifs de la Constitution. Mais, pour Calles, comme pour Obregon et tous leurs prédécesseurs, la Constitution c’est la volonté du plus fort. Or, Obregon a décidé que son ministre Calles lui succédera. Tout revient donc à une question de fusils.
La campagne électorale s’ouvre en 1924. L’immense majorité des Mexicains, tous les hommes d’ordre, souhaitent le succès du président provisoire, Adolphe de la Huerta. Mais Calles a pour lui le gouvernement de Coolidge, la « National Petroleum » et les Loges. Tout se passe donc selon les rites accoutumés. Les États-Unis désarment la Huerta en mettant l’embargo sur ses armes (comme ils le mettent aujourd’hui sur les armes destinées aux catholiques révoltés), ils en fournissent à Calles. Ils pousseront la complaisance jusqu’à arrêter, à la frontière, les hommes suspects d’hostilité envers Calles, comme le général Estrada. Mieux encore, ils prononceront l’extradition contre des adversaires du dictateur qui, livrés à cette brute, seront fusillés. Malgré cela, en mars 1924, Calles et Obregon, réduits à l’extrémité par Huerta, envoient un câblogramme à un grand pétrolier de Washington disant « leur état désespéré et réclamant des secours immédiats ». Résultat : « le Washington Post du 29 décembre narre la visite de deux gérants de la Compagnie des Pétroles à la Maison Blanche », qui va organiser le sauvetage de Calles. J’emprunte ce récit au primat Mgr Curley qui en tire ces conclusions : « Notre gouvernement empêcha, de la manière la plus efficace, le salut du peuple mexicain, en prohibant la vente des armes aux chefs du mouvement national...
« Tout le monde sait parfaitement que Calles ne fut pas l’élu du peuple mexicain. C’est un bolcheviste de marque supérieure. Comment expliquer que le président Coolidge ait envoyé, à lui et à son gouvernement, un message de spéciale amitié ?
« Aujourd’hui, lorsque les périodiques nord-américains condamnent toute intervention au Mexique, il serait bon de se souvenir que notre gouvernement est intervenu, au plus intime des affaires mexicaines, pour soutenir Obregon, assurer sa succession à Calles et sauver les intérêts pétroliers auxquels de si grandes promesses avaient été faites par ces deux types. » (sic).
Le 11 avril 1926, dans la Baltimore Catholic Review, Mgr Curley revient sur ce tragique sujet. Après avoir exposé les abominables exploits, les tueries et les brigandages du « ministricule rouge » Calles, il s’écrie : « Comme Nord-Américain et comme catholique nous estimons un droit et un devoir de nous élever contre la persécution religieuse du Mexique. C’est nous, Américains du Nord, qui sommes responsables de tout cela...
« Si Washington abandonnait seulement le Mexique à lui-même, interrompait l’aide déloyale qu’il prête au présent gouvernement bolcheviste, Calles et sa bande ne dureraient pas un mois. C’est nous et rien que nous qui sommes responsables des évènements mexicains des douze dernières années par la négligence ou l’intervention positive de notre gouvernement. »
La farce sanglante de l’élection présidentielle s’ouvrait en novembre 1924. Le Dr John Deister dans la Daily American Tribune, Miss Sophie Tredwell dans The New York Herald Tribune, nous ont livré le récit détaillé des faits : « Calles, de passage à New York, affirma que sur 2 millions de suffrages, 1 500 000 l’avaient porté au pouvoir. La vérité est que Calles arriva à la présidence par la force des armes comme Obregon et Carranza et Huerta et Madero et Diaz et Lerdo et Juarez. »
« J’estime, poursuit le Dr Diester, que, sur une population de 15 millions, Calles n’eut pas 50 000 suffrages. J’étais à Mexico ; tout le peuple tremblait à la pensée de son succès... J’ai vu les camions pleins de soldats, allant de collège en collège, imposant partout leur candidat Calles. »
À ce propos, il est plaisant de voir tel grave périodique, exposant les malheurs du Mexique, incriminer le suffrage universel, le régime républicain, coupables de tous ces maux. C’est vouloir fermer les yeux aux évidences historiques. Suffrage universel, République, ne sont, au Mexique, depuis 1857, qu’une dérision. C’est une oligarchie bourgeoise qui (n’en déplaise à ces Messieurs de la Ligue des Droits de l’Homme) gouverna et gouverne ce malheureux pays par une suite de coups d’État. Porfirio Diaz, comme Juarez et les autres dictateurs mexicains, n’ont fait que continuer en l’aggravant l’absolutisme espagnol ; ils ont, de parti pris, maintenu le peuple en minorité, en un étroit servage civique... Et, néanmoins, la pétition pour la liberté religieuse et scolaire, pour la liberté de la presse et de l’action politique, signée, en 1926, par plus de cinq millions de Mexicains en âge de voter, montre que, du jour où le suffrage universel, le régime démocratique, seraient une réalité au Mexique, le règne du terrorisme, y cesserait.
Haut dignitaire de la maçonnerie, sectaire forcené et obtus, imbu des doctrines bolchevistes, ayant donné sa mesure comme gouverneur de Sonora et ministre de l’Intérieur, Calles s’engage, au cours de la campagne électorale, à appliquer, dans sa rigueur, cette Constitution socialiste et sectaire de Queretaro, laissée partiellement en sommeil par les deux derniers présidents. Il va le faire, négligeant les points qui le brouilleraient avec ses protecteurs américains protestants, et aggravant les mesures persécutrices à l’égard des catholiques [8].
Lucien Romier, dans un article fantaisiste de la Revue des Deux Mondes, nous présente ainsi le personnage : « Haute stature, épaules fortes, masque à la fois de violence et de réserve, avec une sorte d’illumination dans le regard. Nul trait, nul mouvement qui trahisse, en cet homme, une goutte de sang latin, anglo-saxon, ou, à plus forte raison, celte. Ce n’est pas l’Oriental avec son indolence trompeuse. Ce n’est pas l’Indien agile. Ce n’est pas le Sémite. C’est un type à part. J’imagine le fauve tranquille qui, soudain, broiera l’assaillant. »
Le portrait est flatté. Calles n’a rien du lion, mais beaucoup du renard et plus encore du loup. C’est le primaire prétentieux qui, à plusieurs reprises, déclare, sans sourciller : « Je suis l’adversaire personnel du Christ ! » (M. Homais n’avait pas encore trouvé cela), mais aussi le Juif haineux et cupide qui ramasse, dans le sang chrétien, une fortune doublement précieuse, l’Oriental idéologue et madré, professeur d’anarchie et avide de bénéfices solides, à qui les contradictions ne pèsent guère dès quelles sont commandées par un profit, habile à payer les foules en paroles, tout en se payant lui-même en bonnes haciendas. « Bref : vingt-cinq pour cent de Robespierre, vingt-cinq pour cent de Tartarin et cinquante pour cent d’Apache. » D’où les singulières antinomies qui marquèrent la politique du dictateur.
2. La politique communiste de Calles et ses complices.
Parvenu au pouvoir par la finance américaine, gêné par les engagements consentis aux pétroliers, ses bailleurs de fonds, plus gêné encore par le pacte bolchevique qui le lie aux agrariens et à la CROM [9] (Confédération Régionale des Ouvriers Mexicains), Galles va louvoyer, donnant, un jour, satisfaction aux bolchevistes, l’autre, aux capitalistes.
Dès 1925, il décrète la mise en vigueur de ses décrets communistes et antireligieux. Or, l’article 27 donne à l’État la propriété de toutes les terres, le droit de déterminer l’étendue maxima des terrains qu’il louera, annule tous les contrats antérieurement conclus, décrète que toutes les mines, sources de pétrole, entreprises industrielles, seront exploitées uniquement par des Mexicains d’origine. Les étrangers ne pourront posséder quoi que ce soit qu’à la condition de se faire naturaliser et de renoncer à tout recours à leur gouvernement. Calles va appliquer ces dispositions à l’Église à coups de fusil, la privant de tous ses biens, la proclamant incapable d’acquérir, de posséder, expulsant les prêtres étrangers... L’Église n’a pas de cuirassés pour se défendre.
Mais les capitalistes américains, dépouillés des biens acquis au Mexique : terres, mines, sources de pétrole, seront de moins facile composition. Le président Coolidge, le secrétaire d’État Kellogg, muets tant que leur protégé ne fait que confisquer églises, écoles, hôpitaux, et fusiller les catholiques, s’émeuvent soudain, et défendent le passage du matériel de guerre acheté par Calles. Ils s’émeuvent, davantage encore, en le voyant propager son bolchevisme au Nicaragua où les États-Unis veulent demeurer les maîtres, comme ils le sont à Panama, pour y établir et y posséder un second canal. Kellogg déclare donc que la propagande mexicaine au Nicaragua constitue « un acte hostile ».
En ce moment, la révolte des Indiens Yaquis, dont Calles vole les terres à son profit, la révolte armée des catholiques, dont il poursuit l’extermination, mettent le dictateur à deux doigts de sa perte. Il lui faut des armes, de l’argent, donc l’appui des États-Unis. Les pourparlers s’engagent avec la Maison Blanche, avec les pétroliers américains... Il est entendu que, non seulement la Constitution ne jouera pas avec les possédants américains, mais que de plus larges concessions pétrolifères leur seront accordées. Dans ce but, Calles amende les articles 14 et 15 de la loi sur les pétroles et accorde aux Compagnies américaines, comme le lui fait vainement remarquer un sénateur, plus de concessions qu’elles n’en demandent.
C’est à ce moment que plusieurs personnalités américaines interrogent mon ami vénéré, Mgr Pascual Diaz, évêque exilé de Tabasco, chargé d’affaires de la hiérarchie mexicaine, sur « la possibilité d’une entente durable entre les États-Unis et Calles ». Mexicain authentique, de race indienne, grandement apprécié au Mexique et aux États-Unis pour sa haute culture et son caractère, « le Mercier du Mexique », comme on dit là-bas, connaît parfaitement son Calles, ayant eu, avec lui, plusieurs rencontres où le magister n’a pas brillé. Il s’est vengé, en cuistre, envoyant ses policiers enlever l’éminent prélat sans lui laisser le temps de prendre deux mouchoirs, pour le jeter à la frontière... Mgr Diaz répond [10] donc à ceux qui le questionnent : Calles tiendra ses engagements tant que les évènements l’y obligeront, et il les violera dès qu’il en verra la possibilité. Les faits justifieront la prophétie. Calles respectera, en général, les droits des gros financiers américains, mais laissera ses gouverneurs et les communistes de la CROM prendre leur revanche sur de moindres seigneurs. En 1928, M. Walter Saunders, dans The National Financial Weekly, signalera 2 200 cas de brigandage commis au détriment d’Américains ; la conséquence est que, sur 50 000 Américains résidant au Mexique en 1914, il n’en reste plus que 20 000. L’auteur avoue, avec courage, que c’est là une juste punition de la politique folle ou criminelle menée, au Mexique, par les présidents des États-Unis, depuis Wilson. Combattant le communisme chez eux, refusant de le reconnaître en Russie, ils l’ont implanté, à leurs portes, au Mexique. Car c’est bien le communisme que Calles prétend établir. On sait, d’ailleurs, par l’exemple de la Russie, que cette doctrine ne s’oppose nullement à ce que les chefs deviennent eux-mêmes de puissants capitalistes. C’est par là que Calles et Obregon, l’ancien président devenu ministre et successeur éventuel de son complice, ont commencé.
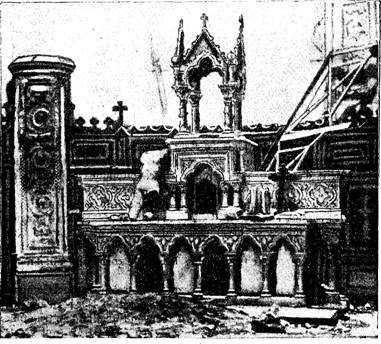
Une église saccagée de Mexico.
Puis en bon magister qui apprit sa leçon, Calles, documenté par un voyage à Moscou (1924) d’où il ramena plusieurs docteurs de la IIIe Internationale, s’est appliqué à calquer les us et coutumes des Soviets. Leur militarisme forcené d’abord.
Son train, de huit millions de dollars, est une forteresse mouvante. Au cours du voyage qu’il fit à Guadalajara pour recevoir le corps de sa femme, morte à Los Angeles, Calles était gardé comme ne le fut aucun tsar : en avant du train présidentiel, armé en bastion, roulait un autre train bondé de troupes ; et, en arrière, suivait un wagon blindé. Sur toute la ligne, la troupe montait la garde.
Le président a aussi son Guépéou : la Policia reservada, police secrète peuplée surtout d’étrangers. Et cette Tcheka-Guépéou a naturellement son Dzerjinski et sa Lubyanda, le premier s’appelle Roberto Cruz, inspecteur général, et ses oubliettes sont les sous-sols de l’inspection de police.
C’est là que, tous les jours, surtout le dimanche, on entasse, pêle-mêle, prêtres et religieuses, jeunes filles et dames surprises en flagrant délit d’assistance à la messe, filles publiques et bandits de grands chemins, braves ouvriers et pauvres servantes appréhendés en quelque office religieux. C’est là que Roberto Cruz emplit ses poches et comble le déficit du budget en soutirant 500 pesos d’amende aux simples fidèles et 1 000 pesos aux prêtres et aux religieuses qu’il consent à gracier ou à expédier aux bagnes des îles Marie ; de là surtout que sort, chaque jour, le grand corbillard automobile chargé de cadavres...
Ce n’est pas là, nous l’espérons, ce que prévoyaient Samuel Gompers et William Green, présidents de la Confédération Nord-Américaine du Travail (American Federation of Labor) en travaillant au triomphe de Calles, en affiliant sa garde rouge, la C.R.O.M. (qui est la CGTU mexicaine) à l’American Federation. C’est du moins ce que le P. M. Kenny, S. J., dans sa brochure The Mexican Crisis, suppose charitablement : « Quand Calles présenta son plan de confiscation des propriétés privées à Gompers, il le donna comme une simple charte de restauration des droits des peones à la propriété du sol. »
Malheureusement, les faits semblent contredire cette opinion et ajouter un nouveau chapitre aux responsabilités américaines dans la soviétisation du Mexique.
Carlos Pereyva, dans le Crime de Wilson ; Mgr Kelley, dans le Livre rouge et jaune ; David Golstein, dans America (19 juin 1926), nous montrent les dirigeants de la Fédération, unis à la Maçonnerie américaine (à laquelle ils appartiennent, comme Wilson), travaillant au triomphe des trois persécuteurs Carranza, Obregon, Calles, obtenant l’embargo des armes destinées à leurs adversaires, organisant la police à la frontière pour empêcher tout secours de parvenir aux libérateurs. Comment Gompers pouvait-il ignorer les tendances des trois tyrans, lui qui avait eu, comme Wilson, « ses délégués dans l’antre de Queretaro » où on transforma en lois les décrets communistes dont Calles est l’exécuteur ?
D’ailleurs, Gompers, dans son livre Soixante ans de vie et de travail, revendique pour lui et sa Fédération l’honneur d’avoir « fait » Carranza ; plus tard, il présentera Calles comme le champion de la liberté et de l’humanité ». William Green ira plus loin et, célébrant la victoire de Calles, s’écriera : pour lui « nous avons marché la main dans la main avec la CROM au sein de la Fédération Pan-Américaine du Travail... Sous la conduite de Calles, homme qui représente notre idéal humanitaire mis en pratique, nous pouvons espérer le déroulement d’une vie méthodiquement constructive ».
Disons, à la décharge des nombreux catholiques égarés dans la Confédération N.-A. du Travail, qu’en face du « déroulement destructeur » des infamies mexicaines, leurs yeux s’ouvrirent. Au mois d’août 1925, 50 000 ouvriers de Chicago protestèrent contre les crimes de Calles. En septembre, le meeting de Philadelphie, où assistaient les délégués de 150 000 travailleurs, demandait à W. Green, en un mémoire énergique, de retirer tout appui au persécuteur. À l’assemblée annuelle tenue à Détroit, en octobre, W. Green essaya de se tirer du mauvais pas où il s’était mis. Les délégués de Philadelphie exigeaient la création d’une Commission qui étudierait le rôle joué par la CROM dans la persécution. Finalement, W. Green écrivit, en décembre, au nom de la Fédération, à Luis Morones, ministre mexicain du Travail et fondateur de la CROM : « Les intérêts des travailleurs du Mexique et des États-Unis exigent qu’on donne une prompte solution au conflit religieux. Le déplorable état de choses actuel ne pouvant continuer sans compromettre les relations amicales des deux Fédérations. » Y a-t-il là autre chose qu’une formule platonique ? En tout cas, la CROM continue à organiser le Mexique sur les bases du bolchevisme.
Dans la session du 4 mars 1925, le commissaire des relations extérieures de la Russie donnait le Mexique pour « base de la Ligue Anti-impérialiste-Américaine et de la pénétration soviétique en Amérique ». Pour faciliter cette tâche, Calles, oubliant ses décrets sur les étrangers, ouvre largement le Mexique aux Russes. Il en arrive 4 000 en mai 1927 et on les installe dans les riches haciendas de Chihuahua, de Durango, enlevées à leurs propriétaires.
Pendant ce temps, la CROM fait une réception royale à la citoyenne Alexandra Kollontay, ambassadrice des Soviets, l’encourage à prêcher l’amour libre, la nationalisation des femmes et des enfants et à organiser, à Mexico, les jeune bataillons de Pionniers rouges...
3. La politique sectaire de Calles et ses complices.
La politique religieuse de Calles tient en ces quelques lignes : asservir ou exterminer le catholicisme ; s’appuyer pour cela sur la Maçonnerie internationale et surtout américaine, sur les protestants et sur les Juifs.
Maçon du 33e degré, il recevait, le 28 mai 1926, des mains du Suprême Grand Commandeur du Rite écossais, Luis Manuel Royas, la médaille du Mérite maçonnique. En la lui remettant, dans la Salle Verte du Palais National, au milieu de batteries d’allégresse, ledit Commandeur s’écrie : « L’ordre que j’ai l’honneur de présider n’a encore jamais accordé cette très haute distinction. Elle est décernée à l’extraordinaire mérite dont vous avez fait preuve comme président de la République, résolvant, en si peu de temps, les plus graves problèmes... Nous ferons connaître solennellement aux gouvernements et aux corps maçonniques, avec qui nous sommes en relations d’amitié, la récompense que vous avez méritée... »
Cette apothéose est un symbole. Les appuis que Calles trouve pour ses agressions contre la religion, l’immense conjuration du silence qui les couvre, le caractère atroce des attentats depuis bientôt quatre ans, tout cela ne trouve son explication dernière que dans les haines maçonniques dont il est l’instrument. C’est là le lien du faisceau qui rapproche Gompers et Wilson ; socialistes, communistes, radicaux des deux continents, le journal le Peuple, l’Ère Nouvelle, le Quotidien, les complices actifs ou passifs de la Terreur mexicaine, bourreaux et chiens muets.
Veut-on quelques preuves ? En 1924, le Convent suprême de la Maçonnerie tenu à Genève, décrète la « déromanisation » de l’Amérique latine en commençant par le Mexique.
Le 12 août 1926, la Tribuna de Rome publie un article sensationnel – reproduit partout : dans la revue catholique America, comme dans le journal libéral la Prensa, de Buenos Aires, – où la thèse suivante est établie : « La Maçonnerie internationale accepte la responsabilité de tout ce qui se passe au Mexique et entend mobiliser toutes ses forces pour l’exécution complète, totale, du programme qu’elle s’est fixé en ce pays. »
De ce programme nous connaissons les détails. Ils furent rappelés au Congrès maçonnique de l’Amérique latine tenu à Buenos Aires en 1906.
Le numéro 10 du Diario Masonico, de Caracas, publie les résolutions du Congrès. En voici quelques-unes :
ART. 5. – La Maçonnerie latino-américaine combattra, par tous les moyens, l’établissement et l’action des Congrégations religieuses, et coordonnera ses efforts pour les expulser de l’Amérique latine.
ART. 6. – Les Maçons procureront le succès des hommes politiques qui veulent défendre leur idéal en votant la séparation de l’Église et de l’État, l’expulsion des Congrégations, le mariage civil, le divorce, l’éducation laïque, la laïcisation des hôpitaux.
ART. 10. – La Maçonnerie luttera pour le rappel de tous les représentants des gouvernements auprès du Vatican ; ces gouvernements ne devraient pas reconnaître la Papauté comme un pouvoir international, etc.
Le gouvernement des États-Unis qui s’est arrogé le rôle de tuteur dans l’Amérique latine, dominé lui-même par l’influence maçonnique, sera le maître ouvrier de la « maçonisation » du Mexique.
En cela, il poursuivra à la fois le triomphe de son idéologie philosophique et celui de son impérialisme.
On connaît le célèbre aphorisme du président Roosevelt : « L’absorption des pays latins par les États-Unis sera très difficile, tant que ces pays seront catholiques. » Décatholiser pour américaniser, telle est, depuis cinquante ans, la politique des États-Unis dans l’Amérique du Sud, et principalement en la grande république voisine. Les affirmations circonstanciées du cardinal Gibbons, du primat Mgr Curley, de Mgr Kelley, rempliraient un volume. On trouvera les plus éloquentes dans La Lucha de los catolicos Mejicanos (Tarragona).
Le cardinal Gibbons résume, en cette simple phrase, les interventions américaines, au Mexique, pour y établir des dictatures sectaires depuis Santa-Anna : « Le but fut d’extirper au peuple mexicain son antique foi. »
On s’étonnera moins ou point du tout, on ne parlera plus de marotte si on consent à étudier froidement les faits que nous avons exposés, et encore ceux-ci. Le P. Kenny, Américain, avoue l’existence de 3 millions de francs-maçons aux États-Unis. Ce chiffre prend sa pleine valeur si on le rapproche de celui-ci : l’annuaire de 1910 donnait pour toute l’Europe le chiffre de 372 626 maçons, et pour la France celui de 36 700.
Le P. Kenny ajoute, il est vrai, que les « francs-maçons américains sont plus américains que maçons, et sont portés à tenir le point de vue américain plutôt que le point de vue maçonnique, dans les questions où l’intérêt national entre en litige ». Le malheur est que les gouvernants américains estiment trop couramment « le point de vue maçonnique identique au point de vue américain ». Ainsi pensent le maçon Roosevelt, le méthodiste-maçon Wilson, l’actuel secrétaire d’État Kellogg (48 ans de carrière maçonnique), ainsi pensent 70 pour 100 des députés et sénateurs, maçons eux aussi, et 32 sur 46 gouverneurs d’États, pareillement maçons.
Ce fait explique l’audace de Calles. Il sait qu’il durera tant que la maçonnerie américaine l’appuiera. Et, pour garder cet appui, son nationalisme consentira tous les sacrifices : il acceptera, en violation de sa Constitution, que la franc-maçonnerie américaine crée au Mexique 1 100 écoles du soir, indépendantes du gouvernement et dirigées par des maçons ; que des propagandistes américains viennent, comme jadis Ponsett, maçonniser le Mexique et y doubler, en peu de temps, le nombre de leurs affiliés – ce dont M. William Vail, ex-suprême commandeur du Rite Écossais, lui rend grâces, dans le New Age Magazine. – Malgré le paragraphe 8 de l’article 130 du Code fédéral, et l’article 1 du Code pénal, promulgué par lui le 14 juin 1926, où il est dit : « Pour exercer, dans le territoire de la République mexicaine, le ministère d’un culte quelconque, il est nécessaire d’être Mexicain de naissance » ; malgré cet article, au nom duquel il expulse ou fusille tous les prêtres étrangers, Calles assure aux pasteurs méthodistes américains, presque tous maçons, une pleine liberté d’action.
Il sait pouvoir tout oser, donner libre cours à ses instincts primitifs d’indien mâtiné de Turc, tant que les services rendus à la cause commune lui assureront la solidarité maçonnique. Jusqu’ici, sa confiance n’a pas été trompée. Tandis que le Grand Commandeur du Rite écossais le décore, le Grand Maître de la Maçonnerie argentine lui envoie une adresse publique de félicitations, le journal libéral El Heraldo de Madrid, l’Ère Nouvelle, le Congrès de la Libre Pensée, tenu à Dieppe, en décembre 1927, l’Organisation Prolétarienne, libre-penseuse de Prague (6 août 1926), même de petites gens, comme les conseillers municipaux rouges de Cahors, chantent ses louanges, font de ce vulgaire bandit un héros précurseur. Des organes socialistes comme le Peuple, oubliant que toutes les révolutions mexicaines, depuis l’Indépendance, furent l’œuvre d’une poignée de bourgeois, de ploutocrates-démagogues, emboîtent le pas à leurs frères maçons de la presse bourgeoise.
En même temps qu’il s’appuie sur la Maçonnerie et le socialisme, Calles trouve, je l’ai dit, un allié dans le protestantisme nord-américain.
Le fait, à cause même de sa gravité, réclame quelques explications.
Nous avons entendu Mgr Curley élever, au nom de la justice, un terrible réquisitoire contre les menées impérialistes de son pays.
Depuis douze ans, la Diplomatie du Dollar [11] organise au Mexique la politique du pire, le brigandage légal des dictateurs successivement intronisés puis brisés, dès qu’ils tendent à s’émanciper. « Cette politique, dit le primat, est dictée par les intérêts financiers : le pétrole, les minerais. Tout se résume en questions de lucre, de concessions, de faveurs... » Mexican Tyranny, p. 35-36.
L’impérialisme américain eût volontiers fait mieux que cela et annexé son riche et faible voisin [12]. Il parut s’y décider en 1848, et commença par l’amputer de deux immenses provinces.
Mais la question des races, devenue très aiguë, l’arrêta : « Annexer douze millions d’Indiens à la libre démocratie qui « assimile » déjà péniblement dix millions de Noirs et qui repousse l’immigration des Orientaux... écrit Lucien Romier. Encore si le Mexique était, comme les Philippines, Cuba ou Panama, une terre séparée, on trouverait une formule : colonie, protectorat... mais on ne déclare pas « colonie » un empire limitrophe, dont on annexa, pour commencer, il y a soixante ans, la moitié du territoire [13]. »
Les É.-U. se contenteront donc d’un vasselage économique, politique et religieux. « Aussi, voyez, continue L. Romier [14]. Les Nord-Américains interviennent au Mexique comme entrepreneurs, comme exploitants de gisements de pétrole, comme acquéreurs de mines et d’industries, comme constructeurs de routes, comme fournisseurs de machines et d’objets. Ils ripostent brutalement ou sournoisement à toute tentative des Mexicains pour enrayer cette avance économique. Ils subventionnent, au gré des circonstances, les factions qui favorisent leurs intérêts... » Ils font et défont les présidents... appellent Calles et ses démocrates au pouvoir, parce que les chefs conservateurs comparaissant devant Coolidge ne présentent pas aux hommes d’affaires des garanties suffisantes. On impose à la grande presse la conspiration du silence, on laisse grandir à ses portes l’incendie moscovite, au risque d’en être un jour dévoré. « Les affaires sont les affaires [15] ! »
Mais il y a autre chose que les affaires, et d’ailleurs, n’exigent‑elles pas qu’on entretienne, sur leurs divers boulevards, des auxiliaires moins aléatoires que le dollar, un corps expéditionnaire ou le contrôle financier : des complices convaincus, des coreligionnaires ? D’où, la nécessité de compléter la domination économico-politique par une mainmise morale et religieuse sur les esprits.
Nécessité d’autant plus urgente que le prestige de l’Espagne commence à supplanter, dans l’Amérique latine, le prestige américain. Les chèques des banquiers de Wall Street ne suffisent plus à imposer aux âmes leurs admirations...
« Dans ces pays du Sud, les trois quarts des écrivains à la mode sont des Espagnols... Le catholicisme, pour nous, s’identifiant avec l’hispanisme, c’est vers l’Espagne que le vent pousse nos voiles. » Ainsi parle Victor Belaunde, professeur à l’Université de Lima, un des hommes les plus représentatifs de l’Amérique latine [16]...
Une telle évolution est commandée à la fois par le cœur et l’intérêt national. Les États-Unis, devenus après la guerre les rois de l’or... ont abusé. Et aux récents congrès panaméricains, les peuples du Sud s’en sont expliqués avec vivacité.
Raison de plus, pour les États-Unis, d’entreprendre, au Mexique, une pénétration intellectuelle philosophico-religieuse. Ils y ont travaillé, par la diffusion de la Maçonnerie. Ils y travaillent, par la propagande protestante. Et Calles, là aussi, est un instrument docile et averti.
Il expulse brutalement la Mère M. Sample, fille d’un général des États-Unis, avec 44 religieuses, la plupart Américaines, Coolidge ne bouge pas.
En mai, à la suite de l’expulsion de Mgr Caruana, citoyen américain, délégué apostolique à Mexico, Mgr Curley proclame publiquement : « Si Mgr Caruana avait été pasteur méthodiste, le secrétaire d’État de Washington, M. Kellogg, aurait pris victorieusement sa défense. Mgr Caruana était catholique, M. Kellogg et M. Coolidge ont laissé faire. »
Au début du mois d’août, est confisquée la « Christ Church », église appartenant aux méthodistes américains. De suite, le plénipotentiaire Away proteste énergiquement. Le ministre des Affaires étrangères, le pasteur méthodiste Aaron Saenz, arrange tout, faisant comprendre que si, en droit, la Constitution est également applicable aux catholiques et aux protestants, en fait, le gouvernement, ayant reçu des protestants toutes les garanties de loyalisme, ne les inquiétera pas...
Bien mieux, en 1925, Calles fait don de 100 000 pesos à l’Association protestante YMCA pour l’aider à construire un grand stade à Mexico. Mais, pour secourir les milliers d’infortunés que les inondations de Léon ont ruinés, il ne trouve que 5 000 pesos.
Tandis qu’il traque les catholiques, les chasse de leurs églises, de leurs écoles, de leurs hôpitaux, qu’il leur interdit toutes les œuvres d’assistance, de propagande, qu’il martyrise leurs prêtres, expulse leurs religieux étrangers, les méthodistes, épiscopaliens, presbytériens disposent, pour leurs quelque 100 000 affiliés [17], de 33 chapelles avec 206 missionnaires étrangers, parmi lesquels 174 femmes ; ils ont plus de 300 écoles dont une dizaine de séminaires ; la YMCA, par ses sociétés sportives, protestantise librement la jeunesse. L’Armée du Salut, le Club cosmopolite, la Fédération Étudiante, etc., un vrai pullulement d’œuvres protestantes importées des États-Unis, utilise le malheur catholique pour étendre l’influence luthérienne. Et Washington applaudit. Une souscription ouverte, aux États-Unis, pour la « civilisation (protestante) de l’Amérique latine et en particulier du Mexique », a donné des sommes fabuleuses. Onze souscripteurs (en tête desquels vient Rockefeller avec 144 millions de pesetas) on versé, à eux seuls, 306 millions de pesetas. Si le Christ avait donné ses promesses à l’or et à la faveur des pouvoirs, le protestantisme ferait, au Mexique, des miracles.
En attendant, il laisse aux catholiques la double béatitude de la pauvreté et de la persécution. Le New York Herald du 20 février 1926 le constate à peu près en ces termes :
« Pendant qu’on décime les catholiques, les protestants, grâce à la protection de leur grand leader Moïse Saenz, frère du ministre des Affaires étrangères, travaillent, en pleine liberté, avec une activité fiévreuse ; 200 écoles ou Instituts méthodistes continuent leurs cours sous la houlette de l’évêque épiscopalien de Mexico, Creigliton, qui ne songe nullement à rejoindre les évêques catholiques en exil, en prison, ou dans les forêts. On a fermé les Séminaires catholiques, mais le séminaire évangélique de Mexico, dirigé par des Nord-Américains (donc doublement hors la loi), ne fut jamais plus prospère. L’Église de l’Union évangéliste, desservie, elle aussi, par des Nord-Américains, vit en paix. L’évêque Georges Miller, directeur général de l’Église méthodiste au Mexique, ne cesse de louer l’aménité de Calles.
« Au moment où on ferme les Séminaires de Guadalajara, Ciudad, Gusman, etc., les protestants de Saltillo célèbrent, par de grandes réjouissances, où Calles est représenté, l’ouverture d’un nouveau collège. À Mexico, pendant qu’on fusille les membres de la Jeunesse Catholique légalement dissoute, l’Association chrétienne des Jeunesses protestantes donne un grand banquet de propagande, sous la présidence du secrétaire de l’Instruction publique, Moïse Saenz ; le président Calles est également représenté. »
Pour attester au monde que la persécution mexicaine n’est qu’un mythe, on voit arriver un jour, à Mexico, une Mission d’enquête expédiée par les États-Unis. Elle est dirigée par un Juif roumain, sectaire de marque, Robert Habermann, entouré d’une équipe de pasteurs méthodistes. Il y eut force banquets et force toasts. La Mission se retira attestant que la réputation persécutrice [18] faite à Calles n’était qu’une calomnie des catholiques ! Cette enquête servit d’argument au président des États-Unis, pour reconnaître le gouvernement de Calles. On comprend que beaucoup de protestants tiennent autant que les Maçons, les Juifs ou les pétroliers américains, à éterniser le règne de Calles ; que des publications protestantes comme Le monde chrétien, La voix de la Paix, publiées, l’une à Mexico, l’autre à Monterrey, écrivent : « Nous ne pouvons pas ne pas seconder, dans notre très humble sphère, le travail de nationalisation des éléments religieux, poursuivi par Calles. » Pour lui montrer leur désir de l’aider à fonder une Église catholique nationale, ils poussent la générosité jusqu’à mettre leur temple, « Le Messie », de Mexico, à la disposition des schismatiques, cependant que le chef des méthodistes, dans le district fédéral, D. Baez, écrit dans le journal El Universal : « Les protestants mexicains doivent s’organiser en église nationale selon les désirs du président. » Bien mieux, aux États-Unis, l’évêque protestant Muller s’est fait l’apologiste de Calles, et le Congrès fédéral des Églises du Christ a estimé habile de féliciter le persécuteur pour ses hauts faits.
Enfin, Calles ne saurait manquer d’appuyer sa politique anticatholique sur les Juifs. Autant qu’avec les francs-maçons, plus qu’avec les protestants, il est ici en famille.
Pour ces hommes de sa race, la loi sur les étrangers est mise en sommeil.
En même temps qu’il appelle des bandes d’immigrés russes, il s’entend avec le rabbin Martin Zielan et invite les Juifs à venir coloniser la République. En 1927, 10 000 sont déjà arrivés de Russie et surtout des États-Unis. Zielan estime qu’en 1928 les immigrants dépasseront 100 000. Pendant ce temps, le nationalisme bruyant de Calles ne s’inquiète pas de voir deux ou trois millions d’ouvriers et de paysans émigrer aux États-Unis.
DEUXIÈME PARTIE
Les causes intérieures du malheur mexicain et les complicités extérieures
Écrire une histoire anecdotique de la persécution mexicaine, comme on l’a fait trop souvent, servirait de peu. Il y a eu, à toutes les périodes de l’histoire, des tyrans et des persécuteurs. Dire que Calles continue la tradition de Néron, de Robespierre ou du sultan rouge Abdul‑Hamid II, c’est nous rappeler, simplement, que les monstres sont possibles.
Si flétrir Robespierre est un devoir, d’ailleurs facile, il est autrement profitable, pour la France et la chrétienté de rechercher les causes sociales, religieuses, de la Révolution et de la Terreur. Cette étude, outre les leçons qu’elle comporte, permet de comprendre la durée du cataclysme.
Une partie de l’indifférence qui accueille, même dans les milieux bien disposés, la plainte de nos frères mexicains vient de cette pensée simpliste : ces malheurs se passent loin de nous, notre sécurité n’en est pas intéressée. Au surplus, ne rappellent-ils pas ces cyclones des pays tropicaux, dont on ignore les causes et qui meurent, comme ils sont nés, leur violence même étant un gage de leur brièveté ?
Eh ! non. La révolution mexicaine a, comme la Révolution française, des causes profondes et qui nous touchent de près. Elle n’est pas un phénomène transitoire. Parvenue à son paroxysme depuis quatre ans, elle dure depuis cinquante et durera encore, si la solidarité chrétienne ne nous fait point porter un prompt secours à nos frères éprouvés, à la civilisation menacée.
– Ne nous alarmons pas, me disait hier un homme politique plein d’optimisme ; Calles, d’après la Constitution, se retirera en 1929 ; et le cauchemar finira.
– Oui, Calles quittera la présidence, mais il la passera, malgré la Constitution, à l’ancien président, son complice, Obregon ; lequel, par réciprocité, lui confiera le ministère de l’Intérieur et, en 1933, le réinstallera, par un pronunciamiento, à la présidence.
Calles pourra alors achever, avec les mêmes complicités, d’assassiner le Mexique et d’y exterminer le catholicisme.
Or, c’est cela que la chrétienté doit empêcher, d’abord, en étudiant les causes profondes du mal, pour éviter d’escompter une trop prompte guérison et se préserver elle-même de la contagion, puis en secourant, par tous les moyens, les catholiques mexicains. Ce qu’il leur faut ? Des prières, des sympathies, de l’argent. Surtout des campagnes d’opinion qui éclairent l’Europe, forcent la main à ses gouvernants, à la Société des Nations, protectrice attitrée des minorités opprimées ; qui, par contre, délient les mains des puissances financières, impérialistes ou confessionnelles acharnées à l’étranglement d’un peuple qui demande à vivre libre.
Les développements qui suivent ne feront guère que coordonner et compléter les indications contenues dans notre exposé historique.
I – CAUSES INTÉRIEURES
1. Ethniques et sociales. – La mêlée des races.
Le Mexique comptait, au moment où Calles arriva au pouvoir, environ 15 millions d’habitants : dix millions d’Indiens indigènes ; classe inculte, pauvre, mais généralement croyante [19] ; quatre millions de Créoles et de Métis, agriculteurs, ouvriers, industriels et petits commerçants, gardant un fond de religion, mais violents, indisciplinés, imbus d’idées révolutionnaires, agitateurs habituels des masses populaires ; un million de Blancs, c’est la classe supérieure et noble qui possède et exploite la terre, les mines, les immeubles des villes, exerce les professions libérales, dirige l’administration, du moins jusqu’à Calles.
Aristocratie de la fortune ou de la race, ces grands propriétaires s’occupaient assez peu de politique, mais beaucoup d’affaires ; ils n’appartenaient à aucun parti.
Enfin, parmi les « intellectuels », existait une funeste division de doctrine qui est à l’origine de tous les bouleversements du Mexique. D’un côté, les conservateurs (parfois conservateurs à outrance), de l’autre, les révolutionnaires ; c’est aux mains de ces derniers que se trouvait généralement l’armée et donc le gouvernement. Arrivés au pouvoir, leur principal souci était de s’y maintenir en avivant la lutte des classes, en rendant impossible toute action du clergé. Ces extrémistes conquirent le pouvoir en 1867 et le gardèrent à peu près constamment jusqu’à la révolution actuelle.
Ces trois éléments ethniques, à peu près stables, constituent, à proprement parler, le Mexique. Les uns sont nés sur le sol, les autres, d’origine française, américaine, surtout espagnole, ont été assimilés par lui [20]. Mais, à côté de ces Mexicains d’origine ou d’adoption, se trouve, depuis l’exploitation méthodique des pétroles et des mines, une population fort mêlée, n’ayant de mexicain que ses intérêts. En haut : industriels, capitalistes, brasseurs d’affaires, ingénieurs sachant tout juste la langue du pays et pratiquant assez souvent, comme unique religion, celle de l’argent ; en bas, une cohue ouvrière vagabonde que nous retrouvons en France : Turcs, Noirs, Chinois, Japonais, Espagnols, Italiens, etc.
Cette masse flottante (quelques-uns l’ont évaluée à 2 ou 3 millions) constitue pour les révolutionnaires et les sectes une « masse de manœuvre » que les historiens du Mexique moderne ont trop négligée. Elle explique, disons-le en passant, que parmi eux les uns nous parlent de 13, de 15 millions, et les autres, pour la même année, de 17 et 18 millions d’habitants.
Elle explique surtout les progrès du communisme mexicain. Là-bas, comme chez nous, cette foule déracinée, prête à se donner au plus offrant, lie que les commotions sociales font remonter à la surface, devait constituer la première armée du désordre. En lui ouvrant les portes du régime bolcheviste, Calles répondait à tous ses vœux.
Il répondait aussi aux vœux, et ceci est plus grave, d’une partie notable de la population indienne. Pour elle, la question agraire se présente, dès 1914, comme vraiment tragique.
« Sur 13 ou 14 millions d’habitants que le Mexique compte alors », 37 000 seulement « sont propriétaires terriens en un pays de 2 000 000 de kilomètres carrés » [21]. Ainsi, la presque totalité de la population indienne vivait dans la dépendance d’un petit nombre de possédants. Dépendance parfois très dure, car aucune loi précise ne régit les rapports de maître à serviteur, de propriétaire à ouvrier. « Si l’on ne réforme cet état de choses, disait prophétiquement, en 1914, l’Année Sociale, le socialisme trouvera au Mexique un terrain d’élection. Il existe déjà un Comité socialiste de propagande établi à Mexico, disposant d’un journal, El Socialista, qui est fort répandu parmi les travailleurs des champs et des fabriques. »
Le monde ouvrier, et particulièrement l’ouvrier rural, se trouve donc, à la veille de la crise actuelle, dans cet état de « misère imméritée », décrit en 1891 par l’Encyclique Rerum Novarum. Le retard qu’on mettait à corriger les abus dénoncés par Léon XIII allait, comme il l’annonçait en 1901, dans l’Encyclique Graves de Communi, amener ces « fléaux qui, à défaut du remède opportun qui les eût conjurés, déchaînent parfois leurs rigueurs sur toutes les classes de la société ».
Cette immense armée salariée, composée surtout d’Indiens, non seulement ne possédait pas de terre dans son propre pays, mais son travail n’arrivait pas à la sauver de la misère : salaires insuffisants, trop souvent payés en nature, contrats léonins réduisant l’ouvrier à un véritable servage ; dans certaines provinces, par exemple dans le Yucatan, un ouvrier avait-il besoin d’une petite somme d’argent, il allait trouver le maître de l’hacienda, qui la prêtait, faisait signer un reçu. Le papier équivalait à l’engagement de ne pas quitter l’hacendia jusqu’à ce que les dettes fussent purgées. Elles ne l’étaient jamais. Le propriétaire liquidait-il sa terre, désirait-il la transformer en pâturages, il vendait son personnel en passant ses créances à un autre propriétaire. En somme, une forme à peine atténuée de l’esclavage.
D’immenses biens communaux existaient. L’État, à court d’argent, les vendit. Acquis par les grands propriétaires, la misère des campagnes en fut accrue. De véritables mouvements de Jacquerie, occasionnés par ces abus, éclatèrent à plusieurs reprises. Celui auquel Zapata donna son nom ravagea tout le Sud du Mexique.
Le remède eût été dans une action courageuse des catholiques sociaux pour organiser la petite propriété, lotir et céder à des conditions abordables aux humbles les latifundia en friches, fournir des avances, des sécurités aux petits possédants par des Mutualités, des Caisses rurales, des Assurances... On fit quelque chose ; les tyrannies officielles permettaient si peu ! Bref, pour des causes diverses, autant et plus que leurs frères de France, les catholiques mexicains laissèrent passer l’heure opportune, perdirent une grande bataille sociale dont la paix de leur pays et le salut des millions d’âmes étaient l’enjeu... Avant de les accuser, faisons notre examen de conscience...
Or, la force de Calles vient de l’appui qu’il trouve, non seulement dans les organisations ouvrières des villes, dans la CROM communiste, mais encore dans cette masse paysanne d’Indiens à qui, d’un premier geste (ce fut aussi le premier geste de Lénine), il indiqua les immenses territoires des latifundistes en leur disant : « On va partager ; la terre est à vous. »
C’est pour cela qu’il nomma ministre du Travail l’ouvrier communiste Morones, président de la CROM. Celle-ci, d’accord avec le « parti agrarien », se propose essentiellement le partage des terres, la division des haciendas promise par la Constitution de 1917.
Des millions d’Indiens, à qui on a fait entrevoir la possibilité de posséder enfin, en propre, un peu de la terre qu’ils cultivent, demeurent catholiques, cachent le curé, font à l’occasion le coup de feu contre les persécuteurs, mais, en somme, seraient désolés qu’un pouvoir conservateur vînt déloger le dictateur de son poste et eux-mêmes de leurs terres.
Mais cela est illogique ! Et puis ? L’histoire ne nous a-t-elle pas habitués à ces contradictions ? Le paysan de 1793, demeuré souvent croyant, continuait, au péril de sa vie, à réclamer le ministère du prêtre insermenté, pour son mariage, sa mort, la première Communion de ses enfants... ce qui ne l’empêchait pas toujours d’aller saccager ou incendier le château ou l’opulente abbaye voisine. Il était partisan, non de Danton ni de Robespierre qu’il ne connaissait guère, mais d’un régime qui s’affirmait l’ennemi de trop réels abus.
Il suffirait, peut-être, de parcourir quelques Cahiers des États généraux, pour s’expliquer cette double attitude.
Ajoutez à ces causes de popularité, auprès de la multitude, un Nationalisme indien, par lequel Calles s’efforce de rendre leur fierté aux vaincus d’hier, relevant les pyramides aztèques, bâtissant des musées pour y glorifier l’art national. « Hier l’indien n’était rien, demain il sera tout ; car le Mexique, c’est l’Indien. » Telle est la formule. Elle explique la popularité restreinte, mais réelle, de Calles.
Il ferme les écoles catholiques ! La masse des Indiens, jusqu’ici illettrée, en profitait si peu ! Désormais, elle va, par ses soins, affirme-t-il, être initiée au savoir, dans mille écoles d’enseignement technique et agricole.
En tout cela, dit L. Romier : « Nationalisme... libre pensée, syndicalisme, communisme : J.-J. Rousseau, Robespierre, Michelet, Karl Marx et Lénine... » beaucoup de verbiage ; ce mélange incohérent paralyse les affaires, arrête les échanges, épouvante les capitaux, multiplie la misère, dépeuple le Mexique, tarit le trésor, tue le peso, met Calles aux genoux des Américains qui se préparent à faire payer le nouvel emprunt par un véritable vasselage, sans doute... Mais, ne voir que ces ombres n’aide pas à résoudre le problème.
Avoir gagné une certaine gratitude de 10 millions d’indiens, n’est-ce pas une force et qui fait comprendre que Calles puisse durer ? Elle fait comprendre aussi, pour une part, l’attitude de l’épiscopat mexicain ; sans doute ne pense-t-il pas qu’une situation aussi complexe, ayant dans l’histoire et le pays des racines profondes, puisse être résolue durablement par quelques gestes héroïques. Il n’ignore pas, pour autant, la divine fécondité du sang des martyrs.
2. Causes religieuses.
– L’état du catholicisme au Mexique.
Des affirmations massives comme celles-ci ne sont pas rares dans la presse catholique : les catholiques sont, au Mexique, « la presque totalité de la nation ». « La religion catholique est professée par presque tous les Mexicains. »
Il faudrait, au moins, exclure de cette universalité les Mormons du Chihuahua, les protestants des grandes villes, les francs-maçons... dont on sait le nombre croissant.
Mais encore, qu’entend-on par catholiques ? Les baptisés ? Lors du Congrès eucharistique d’Amsterdam, en 1924, Mgr l’archevêque de Michoacan aurait confié au journal hollandais le Telegraaf que le nombre des vrais chrétiens, au Mexique, ne dépassait pas 20 pour 100 des baptisés [22]. Ce fait ne répond-il pas à cette question que plusieurs se posent avec scandale : comment un peuple en immense majorité catholique peut-il se laisser tyranniser par une poignée de sectaires ? Eh ! mon Dieu ! les Mexicains ne pourraient-ils, à leur tour, nous demander : « Comment, en 1789, puis, de 1880 à nos jours, la France, pays catholique, a-t-elle pu se laisser domestiquer par quelques milliers de francs-maçons ? »
À quoi nous répondrions : 1° Les registres de baptême, même utilisés par des statisticiens expérimentés, ne donnent qu’une idée lointaine du véritable état religieux d’un pays.
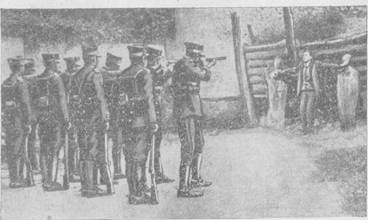
Le P. Pro Juarez attendant, les bras en croix, le feu du peloton.

Roberto Cruz, inspecteur général de la police, pendant l’exécution du P. Pro Juarez.
2° Au point de vue de l’action civique, une petite troupe bien organisée vaux mieux qu’une immense armée inorgarnisée. L’offensive du Cartel, en mai 1924, nous a rappelé ces vérités un peu oubliées, et c’est sous le fouet de l’épreuve qu’on s’est mis à l’œuvre.
Voilà ce que peuvent aussi nous répondre nos frères mexicains, et ce qu’ils répondent.
Dans une lettre écrite par un catholique mexicain, M. de Castro, au journal El Pais (24. 2. 26), je lis : « L’apathie et la désunion des catholiques ont seules rendu possibles les attentats du gouvernement. » Ce courageux aveu est à rapprocher de celui de Mgr Léopoldo Ruiz y Flores [23]. Les deux réunis éclaireront aussi les doutes de ces catholiques tentés de condamner l’attitude temporisatrice du Saint-Siège et de l’épiscopat mexicain. « Pourquoi ne pas proclamer la guerre sainte ? Est-ce que les Papes, au moyen âge ne délivraient pas du serment de fidélité [24] ? »
Ne sommes-nous pas assurés « qu’une insurrection armée, comme celle que dirige le jeune chef de la Jeunesse Catholique mexicaine, René Capistran Garza, appuyé par plusieurs généraux, a de grandes probabilités de réussir, s’il est vrai, comme l’affirment les évêques mexicains, que « la grande majorité » du pays est hostile à la politique du gouvernement » ?
Ces questions furent aussi posées au Mexique, et parfois sur un ton de sommation, par certains extrémistes. Les évêques leur firent la réponse qu’ils opposaient, en novembre 1926, à l’état-major présidentiel, les accusant de fomenter la révolte. « Nous avons recommandé fortement aux catholiques de se borner à user de moyens pacifiques et légaux. »
Un communiqué de la National Catholic Welfare Conference rapporte en ces termes une conversation du 21 avril 1927, entre six évêques mexicains et M. Tejeda, ministre de l’Intérieur :
– Vous êtes les chefs de la révolution, dit M. Tejeda, et, par votre silence, après la récente lettre pastorale de l’archevêque de Durango, déclarant que les laïques catholiques étaient en droit de s’armer pour leur propre défense, vous êtes coupables de participer à la rébellion.
– Monsieur, répond Mgr Mora y del Rio, archevêque de Mexico, l’épiscopat n’a provoqué aucun soulèvement. Il a simplement déclaré que les laïques avaient, depuis toujours, licence de défendre par la force les droits inaliénables qu’ils ne pourraient protéger par des moyens pacifiques.
– C’est là un acte de rébellion.
– Non, pas de rébellion, mais de légitime défense contre une tyrannie injustifiable.
– Dites : contre l’autorité constituée.
– Quant à l’autorité de votre gouvernement, le monde entier connaît l’illégalité des élections qui l’ont amené au pouvoir.
Cette réponse ne satisfit ni le ministre qui, le soir même, fit conduire les évêques à la frontière, ni... les catholiques « militants ».
Peut-être les eût-elle apaisés, s’ils avaient ajouté aux considérations susdites ces réflexions : avant de jeter elle-même ses enfants dans une bataille générale, même de légitime défense, d’en accepter toutes les conséquences qu’elle prévoit mieux que personne, pour elle et les fidèles, l’Église n’agit-elle pas sagement, en se demandant : 1° si nul meilleur moyen légitime de défense n’existe que la lutte à main armée ; 2° si cette lutte a des chances sérieuses de succès ?
Or, ces chances existent-elles, au Mexique, pour une armée de fortune, dépourvue de vrais généraux, d’armes, de munitions ?
Ceci n’est nullement écrit pour diminuer le mérite des braves, à qui leur conscience de libres citoyens et de croyants a commandé de prendre les armes, ni pour leur enlever le droit à notre admiration, mais pour expliquer l’attitude très sage de l’épiscopat mexicain, mieux informé que nous des choses de son pays, et des longs efforts constructeurs qui pourront seuls assurer une paix durable.
II – LES COMPLICITÉS EXTÉRIEURES
Avant de rappeler ces solidarités criminelles, il faut, hélas ! constater l’absence d’une solidarité que tout commandait : la Solidarité catholique. Il y a eu, nous le verrons, de beaux, de magnifiques gestes, dans tous les pays catholiques ; il n’y a pas eu cette grande vague d’indignation qui pouvait tout sauver, ne fut-ce qu’en faisant retirer par les États-Unis cet appui qui maintient Calles.
Plusieurs solidarités ont joué, les Solidarités maçonniques, socialistes, communistes... On n’a pas vu, à l’œuvre, une solidarité catholique comparable à celles-là. Rappelons ce fait éloquent : L’affaire Sacco-Vanzetti (dont je n’examine pas ici le fond), a été « montée » par l’Internationale. Les frères ennemis, socialistes et communistes, réconciliés pour la circonstance, ont fait front unique autour du même drapeau. De New York à Moscou, la bataille a été menée avec une activité, un ensemble impressionnants : déluge d’affiches, d’articles de journaux, de meetings, de grèves, Comités de propagande, de défense... rien n’a manqué.
Or, au même temps, des ouvriers, comme Tirado Arias, des paysans, comme Anselmo Padilla, sont massacrés par centaines, sans jugement, pour délit de conscience. L’internationale se tait ou félicite. Pourquoi ? Calles travaille pour elle. Dès lors, ce qui était crime, dans le verdict légal des juges américains, devient vertu dans les fantaisies sanglantes du dictateur.
Nous sommes parfaitement en droit de flétrir cette partialité, mais, cela fait, un examen de conscience s’impose. Nous, catholiques, quand la cause des martyrs mexicains était de toute évidence celle de la justice, de l’humanité, de la civilisation, avons-nous fait pour eux ce que les socialistes et les communistes des cinq parties du monde ont fait pour deux anarchistes ?
D’ailleurs, la question est posée à d’autres qu’à nous. Dans l’affaire Sacco-Vanzetti, les gouvernements ont, à peu près partout, laissé la campagne d’opinion, malgré ses violences extrêmes, se développer librement, n’intervenant que lorsque les meneurs la transformèrent en révolte. Tout au contraire, la campagne amorcée par les catholiques s’est heurtée, en maints pays, à l’hostilité muette ou déclarée des gouvernements, plus soucieux de profits matériels que d’honneur.
La Finance Internationale, qui leur suggérait ou leur imposait cette attitude, agissait de même façon, auprès de la grande presse d’information. Hier, si prodigue de détails sur la vie et la mort des deux anarchistes, la voici soudain aveugle, sourde et muette, ou, qui pis est, faisant siennes les informations mensongères de Calles [25].
La Semaine Sociale du Havre a levé un coin du voile, en flétrissant l’action néfaste (déjà dénoncée par Léon XIII) de la Finance Internationale, de ses trusts et consortiums, exerçant sur l’économie du monde une véritable dictature.
De 1897 à 1910, le nombre des Cartels internationaux s’est élevé, de 40, à plus d’une centaine. Et ce progrès ne semble pas s’être ralenti. Or, un grand nombre de ces Cartels, dont les « commandes » se trouvent aux États-Unis, ont des intérêts financiers considérables au Mexique.
S’attaquer au dictateur Calles pour des motifs d’humanité ou de religion, c’est risquer de s’aliéner cette brute impulsive, compromettre les affaires. La grande presse américaine d’information, serve de ces Cartels, dont les annonces la font vivre, donnera donc l’exemple à la presse européenne d’un silence qui vaut de l’or...
Mussolini impose à la presse italienne le silence sur les affaires mexicaines. Peut-il oublier, pressé par le problème de l’émigration, que le néonationalisme mexicain saisirait volontiers la première occasion de fermer ses portes aux immigrants italiens, de supprimer leurs banques et leurs comptoirs ?
Et voilà une explication de ce fait signalé par l’Osservatore Romano : le 12 janvier, le préfet d’Udine fait saisir la Fiamma Giovanile, revue de la Jeunesse Catholique du Frioul, parce qu’elle contient un article sur les martyrs du Mexique. Des faits semblables se sont produits à Crema, Côme, Palerme...
Pourquoi l’Espagne garde-t-elle le silence, pourquoi n’intervient-elle pas ? demandait dernièrement, à une haute personnalité de la cour, un évêque mexicain exilé.
– Hélas ! lui répondit-on, nous ne demanderions pas mieux, mais les rancunes des nationalistes mexicains contre les anciens maîtres rendent déjà très difficile le séjour des Espagnols au Mexique. Une imprudence de langage, de notre part, peut amener une expulsion immédiate et la ruine de plusieurs entreprises.
Alors, tandis que le Directoire contraint au silence les journaux catholiques, les organes de gauche, comme le Heraldo de Madrid, publient sur le Mexique des informations d’une mauvaise foi révoltante et le gouvernement laisse faire.
Quant à la France, même si le Cartel ne se trouvait pas flatté d’entendre Calles se proclamer, en toute occasion, disciple de sa politique laïcisatrice, pourrait-elle oublier que la colonie française, « Les Barcelonnettes », comme on dit là-bas [26], est à la tête des principales maisons de nouveautés de Mexico et n’a nul désir de s’en voir expulser ?
Par toutes ces complicités ne perd-on pas « pour vivre les raisons de vivre » ? N’oublie-t-on pas que certaines lâchetés provisoirement profitables, se soldent eu dures rançons ! Pour parler un langage intelligible à tous, le monde civilisé a-t-il gagné à laisser se développer, à favoriser le foyer d’infection qu’est la Russie soviétique ? À tel ou tel pays cela valut des concessions de charbons, de mines, de forêts, des commandes en matériel de guerre, mais les désordres occasionnés par la libre importation des folies soviétiques, les grèves multipliées, ne lui ont-ils pas fait perdre déjà plus qu’il n’a gagné et préparé de redoutables risques ?
Cette expérience n’est-elle pas assez concluante pour qu’on n’ajoute pas, au nom de quelques profits, l’exemple et la prédication de Mexico à ceux de Moscou ?
Mais, au-dessus de ces responsabilités de la finance, du nationalisme païen ou aveugle, il en est d’autres qui chargent la civilisation elle-même.
Le défense de l’Occident de M. H. Massis nous conviait, naguère, à une croisade contre l’Orient. Ce livre et quelques autres opposent l’Orient à l’Occident, la civilisation gréco-latine et, pour tout dire, française, à l’orientale.
Ce nationalisme et cet occidentalisme oublient un peu la mesure et l’histoire. Jésus était Oriental, la Bible, orientale, l’Évangile, oriental.
Mais laissons cela, pour nous souvenir que la valeur de notre civilisation est étroitement tributaire du christianisme ; on ne voit pas ce que l’Asie pourrait envier à la Grèce ou à la Rome païennes. Dans la mesure où la civilisation occidentale oublie qu’elle tire sa supériorité de l’Évangile, elle perd ses titres à enseigner la sagesse au monde. De fait, que lui apporterait-elle ? Un rationalisme prétentieux, un matérialisme passionné de lucre, indifférent aux valeurs spirituelles ; bref, la déchéance de l’esprit ?
L’Orient n’aurait-il pas d’excellentes raisons de mépriser un tel don ? Or, que voyons-nous à l’occasion de la crise mexicaine ? Un pays de civilisation gréco-latine traquer, martyriser des millions de catholiques, sous la poussée d’un nationalisme outrancier, d’un sectarisme obtus, pour lequel toute valeur de l’esprit est une régression. Si les meneurs du jeu ont pris quelques méthodes à la Russie ou à la Chine, ce n’est point à elles qu’ils ont demandé leur philosophie et leur politique. Elles étaient définies, depuis 1857, dans la Constitution et, depuis 1760, dans le Contrat Social.
Et quelle a été, depuis cette date, l’attitude des autres puissances occidentales (j’entends de leurs gouvernements et des corporations financières ou des sectes qui souvent imposent leurs volontés au pouvoir) ; qu’a fait l’Occident pour défendre sa civilisation gréco-latine ? Les États anglo-saxons, et d’abord les États-Unis, non seulement n’ont pas réagi contre cette barbarie installée à leur frontière, mais ils l’ont fomentée, protégée ; les pays latins : Italie, France, Belgique, etc., ont ignoré, ou déformé, ou applaudi ce défi porté, depuis des années, aux fondements de leur civilisation.
La défense de l’Occident, en ce qui concerne le Mexique, a consisté à défendre (en y sacrifiant l’humanité et l’honneur) nos droits sur les gisements pétrolifères et les mines d’argent. Cela ne suffit point à attester la supériorité de l’Occident sur l’Orient. Notre titre de défenseurs de la civilisation, pour être légitime, exige d’autres actes.
L’Occident prendra-t-il enfin conscience de ses responsabilités ?
TROISIÈME PARTIE
La persécution de Calles et le réveil catholique
I – PREMIÈRES VEXATIONS : 1925
Après deux mois d’attente, Calles ouvrait les hostilités, aux jours gras de février 1925, par deux scènes de carnaval : 1° la création d’une Église Nationale Mexicaine ayant à sa tête, comme patriarche, un prêtre défroqué de soixante ans, devenu cheminot puis capitaine (par la voie que l’on sait) : Joaquin Pérez.
2° Le défilé, dans les rues de Mexico, de la propre fille de Calles, Ernestina Ire, déguisée en reine de beauté, précédée et suivie d’un cortège de fausses nonnes et de faux moines en goguette, dont Satan, présidait les ébats... Puis, le film rouge commença.
Aidé par les gendarmes, les pompiers, les ouvriers de la CROM, Pérez, auquel se rallient cinq ou six mauvais prêtres, chasse de leur presbytère, de leur église, le curé et les vicaires de « La Soledad », à Mexico, s’installe à leur place. Les catholiques conspuent l’intrus ; par représailles, Calles interdit aux prêtres non Mexicains d’exercer leur ministère, tandis que les gouverneurs de plusieurs États ferment collèges catholiques et Séminaires.
En juillet 1925, ordre est donné aux directeurs des collèges catholiques du district fédéral d’enlever les Christ et autres emblèmes religieux des classes, de supprimer l’enseignement du catéchisme et toute cérémonie religieuse. Les catholiques estiment qu’il est temps de se grouper et fondent La Ligue de Défense religieuse. Leur langage modéré est traité de séditieux : la Jeunesse Catholique est supprimée.
Le nouveau délégué apostolique (successeur de Mgr Filippi expulsé par Obregon pour avoir pris part à des cérémonies du culte public), Mgr Cimino, entouré d’une surveillance offensante, doit s’absenter... et reçoit défense de rentrer au Mexique. Ces vexations remplissent l’année 1925.
II – LA PERSÉCUTION BRUTALE : 1926
Le 4 janvier 1926, le journal El Universal publie une interview de Mgr José Mora y del Rio, archevêque de Mexico, où le prélat condamne la Constitution schismatique de 1917, dont Calles annonce l’application intégrale.
Comme réponse, le gouvernement met le prélat en accusation, expulse plusieurs religieux étrangers sans leur donner le temps d’emporter même leur bréviaire, fait fermer l’église de la « Sagrada Familia » desservie par les Jésuites, au moment où les servantes du quartier assistent à une retraite ; elles se rebiffent ; les pompiers les inondent. Et le gouvernement annonce que désormais il emploiera, en pareille occurrence, « contre les femmes, les pompes à incendie ; contre les hommes, les mitrailleuses ». Plusieurs collèges catholiques sont fermés et mis à sac, pour délit de messe célébrée devant les élèves.
En mars 1926, on apprend l’arrivée à Mexico du nouveau délégué apostolique (successeur de Mgr Cimino), Mgr Caruana, citoyen américain ; les catholiques espèrent que ce titre lui vaudra quelques égards.
Surveillé comme un malfaiteur, Mgr Caruana reçoit, deux mois après son arrivée, l’ordre de quitter le Mexique : il a oublié que les étrangers, fussent-ils délégués apostoliques, n’ont pas le droit d’exercer les fonctions liturgiques.
Pressés par Calles, les gouverneurs des États légifèrent, à qui mieux mieux.
Celui de Jalisco, le señor Zuno, ferme l’Institut scientifique à la veille des examens ; celui de Tabasco nomme évêque de Villahermosa le sacristain de la cathédrale et prescrit à Mgr Pascual Diaz, d’avoir à prendre femme dans le plus bref délai, s’il veut continuer à exercer ses fonctions. À Guadalajara, l’évêché est dynamité au milieu de la nuit ; facétieux, le gouverneur accuse l’évêque.
Devant cette recrudescence de tyrannie plusieurs évêques ordonnent la suspension du culte public et sont emprisonnés ou expulsés.
III – LES DÉCRETS INIQUES : JUIN-NOVEMBRE 1926
On pensait : ce qui est violent ne dure pas ! Or, soudain, en vertu de pouvoirs dictatoriaux qu’il affirmait tenir des Chambres, Calles publiait deux décrets modifiant le Code Pénal, le premier, en 33 articles, est du 14 juin 1926 ; le second, du 25 novembre, eu 20 articles.
Ces décrets, portant réglementation de l’article 130 du Code Fédéral, constituent une véritable mise hors la loi du catholicisme.
Résumons les principaux articles.
1. Exercices du culte. – Ministre du culte, non Mexicain, ou Mexicain mais non approuvé par le gouverneur [27] : 500 pesos d’amende, quinze jours de prison ou expulsion ; utilisation pour le culte d’une église sans préavis aux autorités civiles et autorisation : 500 pesos d’amende (le peso vaut, environ, la moitié du dollar) ou quinze jours de prison, fermeture de l’église ; port de l’habit ecclésiastique ou de n’importe quel insigne dans la rue, célébration d’un acte du culte hors de l’église : amende et prison. (Art. 1, 2, 17, 18, 19.)
2. Ordres religieux. – Est en contravention quiconque émet des vœux ; tous les Ordres religieux sont dissous ; contre les contrevenants : un à deux ans de prison ; six ans pour les supérieurs, mais la peine (Calles est gentleman) est réduite des deux tiers pour les femmes... Contre quiconque conseille à un citoyen d’entrer en religion, prison ou amende. Je ne dis pas et, Calles connaît les nuances. (Art 6, 7.)
3. Biens d’Église. – Tous les biens du clergé et des religieux sont nationalisés ; contre quiconque endommagera les édifices confisqués : deux ans de prison et amendes proportionnées ; contre les détenteurs subreptices de biens ecclésiastiques ou personnes interposées : deux ans de prison, etc. (Art. 21, 22.)
4. Enseignement catholique. – Contre tout prêtre ou religieux établissant ou dirigeant une école primaire, contre tout citoyen enseignant la religion dans une école libre : 500 pesos d’amende, ou quinze jours de prison ; en cas de récidive fermeture de l’école. (Art. 3, 4, 5, 12.)
5. Liberté de la Presse. – Contre tout directeur (ou gérant) d’un périodique à tendances (!) religieuses commentant (!) les affaires publiques (!), prison et amendes variées. Les Bulletins de la Ligue Nationale de défense religieuse publiés d’abord dans les journaux doivent, par suite de l’art. 13, se transformer en tracts ; la loi du 25 novembre les poursuit sur ce terrain en précisant qu’il faut entendre par publications religieuses prohibées : « les manuscrits (!), imprimés, et, en général, tout périodique, pli ou feuille qui se vend, s’expose ou se distribue, en quelque forme que ce soit, soit au public en général, soit aux affiliés de certaines religions ou sectes ; et dans lesquels, au moyen de paroles écrites (!), de dessins, gravures, lithographies, photographies, ou de toute autre manière (!) qui ne soit point la parole parlée, on propage ou défend, ouvertement, ou à mots couverts (!) des doctrines religieuses [28] ».
« Le fait que les publications ci-dessus ne voient point le jour en toute régularité ne fera point obstacle à l’application des peines édictées... » En novembre 1926, Calles déclarait sérieusement que son programme politique était « profondément chrétien et non soviétique ». Et, en effet, les Soviets ont, au moins, sur lui, la supériorité de ne pas cacher leur jeu. Toutes ces mesures paraissant d’ailleurs insuffisantes pour museler la presse, Calles fait envoyer une note à l’administration des postes lui ordonnant de ne transmettre aucune des feuilles figurant sur la liste noire qu’il a dressée.
6. Liberté politique d’association et de parole. – Contre tout ecclésiastique critiquant les lois, le gouvernement, même dans une réunion privée : six ans de prison ; défense, sous peine d’amende et de prison, de former des groupements politiques (!) dont le titre indique ou trahit (!) un lien quelconque (!) avec une confession religieuse. (Art. 8, 9, 10, 11, 15, 16.)
7. Garanties juridiques. – Toute personne a qualité pour dénoncer aux tribunaux les délits visés par les décrets-lois. La négligence (!) des agents du ministère public, des municipalités à rechercher les délinquants, à punir les délits de culte, de messe, de procession, de port de soutane ou d’insignes religieux, etc., sera châtiée, selon les cas, par l’amende, la suspension, la destitution, la déportation [29]. (Art. 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33.)
8. Liberté de conscience. – Surveiller les actes est insuffisant, Calles, déjà grand inquisiteur, brigue le rôle de grand pénitencier ; il va confesser son peuple. Au mois d’août 1926, les employés des administrations publiques reçoivent ce questionnaire auquel ils doivent répondre par oui ou non :
– Êtes-vous membre de la Ligue de défense religieuse ?
– Êtes-vous Chevalier de Colomb ?
– Êtes-vous fidèle au gouvernement ?
– Approuvez-vous sa conduite ?
– Critiquez-vous ses actes ?
Et aussitôt les gouverneurs de faire du zèle !
Dans l’État de Jalisco, le directeur de l’Instruction publique destitue 400 maîtresses d’écoles coupables de faire profession de foi catholique. Ces vaillantes répondent par une magnifique lettre :
Jamais nous n’accepterons de consignes scolaires qui nous avilissent à nos propres yeux comme aux yeux du peuple... Nous sommes heureuses que la direction de l’IP ait exactement défini son attitude, en déclarant qu’une profession de foi religieuse rend impossible, à ceux qui la font, toute collaboration avec le gouvernement... Nous avons donné jusqu’ici suffisamment de preuves que nous sommes des êtres conscients et libres. Mais, dès aujourd’hui, il est clair qu’il n’y a ni liberté ni conscience possible chez tous les maîtres qui accepteront de travailler dans votre administration.
Par respect pour nos principes et la liberté des pères de famille, nous avons sacrifié notre bien-être. La société entière jugera l’illégalité et l’arbitraire de notre destitution.
Les maîtresses d’école de Chihuahua font une réponse semblable et préfèrent être destituées que sacrifier la liberté de leurs consciences.
Ces violences donnent naissance à l’Association Civique pour la défense de la liberté. Elle aura de la besogne...
Les décrets de juin doivent entrer en vigueur le 1er août 1926.
On assiste alors à un magnifique réveil des âmes. Pendant les semaines qui précèdent la promulgation, les églises ne désemplissent pas. La foule, ne pouvant pénétrer dans les sanctuaires devenus trop petits, prie dans la rue malgré les violences de la police. Les prêtres immatriculés par l’État... Serré de près, M. Germain Martin avoue, dans une lettre à l’Éclair de Montpellier, que sa chronique, faite sur la « demande d’un représentant... du gouvernement mexicain », est de décembre 1927 ; il ne saurait donc « prendre une responsabilité sur les faits commis depuis... » Mais, dès décembre 1927, M. Germain Martin pouvait connaître la législation schismatique de Queretaro et les décrets Calles... Ce professeur de droit les ignore totalement, comme il paraît ignorer les documents dans lesquels l’épiscopat mexicain explique pourquoi sa conscience réprouve une législation qui renouvelle la Constitution civile du clergé...
IV – LA TERREUR ROUGE : AOÛT 1926 ET DEPUIS...
En réponse à une mise hors la loi aussi catégorique, l’épiscopat ordonne la suspension du culte public dans tout le pays, à partir du 1er août 1926, date où les décrets entrent en vigueur [30].
Le culte public devenu impossible, la Constitution réservait la possibilité du culte privé, à domicile. Mais les décrets de Calles et les mesures de police poursuivent les catholiques sur ce terrain, proscrivent tout acte clandestin de culte, le prêtre en fût-il absent.
Comme au temps des Catacombes, l’Église autorise les prêtres à célébrer la messe en surplis et en étole ou même sans aucun vêtement liturgique, à la célébrer sans autel, sans calice, avec une coupe ou un verre quelconques, en s’en tenant à l’Offertoire, la Consécration et la Communion.
Les laïques, hommes, femmes, enfants pourront se communier eux-mêmes, porter la communion dans un linge ou une boîte aux prisonniers, aux malades...
Un espionnage odieux organise partout « la chasse au curé ». Un prêtre célèbre-t-il la messe, bénit-il un mariage, fait-il faire une première Communion, apporte-t-il le Viatique à un mourant... dans une maison amie, les policiers envahissent la chambre, la cour ou le grenier, arrêtent ou fusillent le prêtre en habits sacerdotaux, répandent sur le sol Hosties consacrées et précieux Sang, emprisonnent ou massacrent les assistants.
En février 1928, plus de 200 prêtres ont été massacrés en de semblables circonstances.
Interrogé, en mars 1928, par un rédacteur du Daily Express, Calles ne nie plus les faits : « Oui, des membres du clergé ont été fusillés. Je ne puis vous donner de chiffres exacts. »
Puis, le dictateur justifie ces exécutions par des arguments que les empereurs romains Caligula, Claude, Néron... n’auraient pas répudiés, arguments qui dictèrent chez nous la Constitution civile du clergé et les massacres de septembre : « Le Mexique lutte pour la suprématie du pouvoir civil... Il est vrai que nous avons enlevé aux prêtres catholiques le droit de suffrage. Il est juste qu’ils n’aient plus le privilège de citoyens dès l’instant qu’ils prêtent allégeance à l’étranger : « à Rome... »
« Nous cherchons à faire des prêtres mexicains avant tout... », c’est-à-dire à créer une Église schismatique nationale.
V – LE RÉVEIL CATHOLIQUE
Au Mexique.
En commençant sa campagne contre les catholiques, Calles savait pouvoir compter sur la connivence des communistes, des maçons et des protestants ; il avait également constaté, note le P. Kenny, que les efforts des catholiques américains pour « arrêter l’intervention wilsonnienne en faveur des persécuteurs avaient été faibles et inefficaces... Son expérience lui donnait la certitude que le clergé mexicain aurait devant l’épreuve une attitude passive, habitué qu’il était à être tenu par les divers dictateurs à un régime très dur... ».
Or, ces vues optimistes allaient être déçues en ce qui concernait l’attitude du clergé mexicain et celle des catholiques américains.
1° Le 6 mars 1926, éclatait, comme un coup de clairon, la lettre pastorale de Mgr Manriquez Y Zarate, évêque de Huejutla. Renonçant aux formules atténuées du style diplomatique, le vaillant évêque appelait hommes et choses par leur nom : « Entre les persécuteurs du Mexique, disait-il, et Néron ou Caligula, il n’y a guère que cette différence : les chrétiens étaient une petite minorité dans l’empire, et nous sommes, au contraire, la majorité de la nation. »
Et après avoir examiné la série d’attentats, de violences arbitraires par lesquels une poignée de sectaires asservissait et ruinait le Mexique, l’évêque faisait loyalement l’examen de conscience des catholiques.
Leur faute n’était point, comme les en accusait Calles, d’avoir fait trop de politique, mais, au contraire, de ne pas en avoir fait du tout, d’avoir négligé leurs devoirs de citoyens en se parquant eux-mêmes, véritables exilés à l’intérieur, en un universel abstentionnisme, en abandonnant la direction du pays, la solution des problèmes d’où dépendaient la paix, la prospérité du peuple, à des hommes sans conscience... Dieu punissait cet égoïsme par la main des persécuteurs.
Et, après ce double réquisitoire, l’évêque de Huejutla passait à l’énoncé des devoirs :
Que les catholiques réparent leurs péchés d’omission, affirment leurs droits civiques ; qu’ils résistent courageusement aux destructeurs des lois de l’humanité, ne fuyant pas devant les loups, mais que, prêts au martyre pour la foi et la liberté, ils aillent en prison et à la mort.
Que les pasteurs donnent l’exemple ! Si les églises sont fermées, que chaque maison devienne un sanctuaire ; si une école est confisquée, qu’on en ouvre une autre, et si les maisons font défaut, qu’on ouvre des écoles dans les bois. Que tous, les vieux et surtout les jeunes, sacrifient les amusements et combattent le combat de Dieu, ne reculant plus jusqu’à la reconquête de toutes les libertés confisquées. Par là, nous obtiendrons de Dieu qu’il cesse le châtiment mérité par notre coupable indifférence. Il nous ramènera alors des catacombes au soleil de la liberté.
À cette magnifique lettre, Calles répondit en faisant arrêter, jeter en prison et traiter comme les pires criminels de droit commun celui qu’on allait appeler « le martyr de Huejutla ».
Une pastorale collective de l’épiscopat vint confirmer la lettre de Mgr Manriquez, déclarer que l’acceptation des décrets de Calles serait une apostasie. Une lettre du cardinal secrétaire d’État confirmait au nom de Pie XI cette condamnation.
De nouveau, Calles répondit par la violence, en expulsant les évêques. Au mois de mars 1928, 22 sont exilés, 7 sont cachés à Mexico et 6 dans le reste du pays.
Les catholiques, mexicains, leurs prêtres, vont se montrer dignes de leurs évêques, donner au monde un admirable exemple d’héroïsme chrétien, s’organiser, faire front.
La Ligue pour la défense de la liberté religieuse décide le boycottage du commerce taxé, pour tarir les ressources du gouvernement persécuteur. Tout luxe sera banni dans la nourriture, le vêtement, les voyages, les amusements. Cette offensive de restriction, de pénitence volontaire, fait rapidement tomber de 50 % les revenus de l’État [31].
Comme compensation, le gouvernement entasse, dans d’ignobles cachots, évêques, prêtres, laïcs, et ne les délivre que moyennant forte rançon.
La Ligue donne le mot d’ordre : « Pas de Rançon ! Souffrons et mourons. » Les rançons n’étant plus payées, le nombre des martyrs va, en effet, croître chaque jour.
Ne pouvant utiliser les journaux pour la défense catholique, puisque la liberté de la presse est supprimée, la Ligue multiplie les tracts imprimés, puis, ceux-ci devenus impossibles, les tracts polycopiés qu’on distribue de la main à la main ou que des ballons en papier répandent du haut des airs.
Enfin, le 10 janvier 1927, un manifeste publié, dans les montagnes du Chihuahua, par trois généraux, proclame la guerre sainte pour la défense des libertés opprimées, nomme chef du « Gouvernement National Libérateur » René Capistran Garza qui, en 1913, fondait la Jeunesse Catholique Mexicaine et devenait, en 1926, vice-président de la Ligue DR. Peu à peu, les sauvageries de Calles aidant, la révolte s’étend à dix États, et, bien que privée de munitions par l’embargo des États-Unis, amène, plusieurs fois, le gouvernement désemparé à des propositions de paix [32].
Aux États-Unis.
2° Le second imprévu, dû au réveil des âmes catholiques, est venu des États-Unis. Calles comptait sur l’inertie des catholiques américains.
Là encore, il s’est trompé. Et ce m’est une joie, après ce que j’ai dit (empruntant d’ailleurs les paroles mêmes de l’épiscopat américain) des lourdes responsabilités qui pèsent sur la République étoilée, ses gouvernants, ses financiers, ses sectes, de rendre ici un hommage ému aux catholiques américains.
Certes, il n’est venu à la pensée de personne que je puisse les confondre avec leur gouvernement. Il y aurait à cette confusion la même injustice qu’à identifier la cause des catholiques français, espagnols, belges, italiens, etc., avec celle de leurs maîtres ou des influences occultes qui entravent de leur mieux nos appels à l’opinion.
En réalité, les catholiques américains ont donné au monde l’exemple de ce qu’on eût dû faire partout.
L’appel de l’évêque de Huejutla imprimé dans le compte rendu officiel d’une séance du Parlement, à la suite d’un discours du député Galliwan atteignit, providentiellement, par la poste gouvernementale, surprise de ce rôle imprévu, jusqu’aux provinces les plus lointaines de la République... Sa sincérité virile, les détails nombreux et précis qu’elle donnait sur le despotisme de Calles, la suppression de toutes ces libertés considérées comme intangibles par les Américains : liberté de conscience, de la presse, de l’enseignement, de la parole, des réunions... produisirent sur l’opinion un effet énorme. Puis, Mgr Kelley, Mgr Curley, archevêque de Baltimore, élèvent la voix ; dans des séries d’articles, de discours, ils ne craignent pas d’attaquer en face, sur le ton de libres citoyens d’un pays libre, « l’administration officielle », cause de tous les malheurs du Mexique. Ce que nous demandons, conclut Mgr Curley, ce n’est pas que notre gouvernement « intervienne en faveur des catholiques, mais qu’il cesse d’intervenir contre eux ».
Le 12 décembre 1926, la magnifique lettre collective de l’épiscopat vient redire aux 20 millions de catholiques américains les adjurations de Mgr Curley. Celui-ci, d’ailleurs, continue sa campagne dans la Revue Catholique de Baltimore : il ne suffit pas de prier, répète-t-il, il nous faut renoncer « à la prudence des lâches... à cette attitude d’agenouillement, cause de toute notre faiblesse », puisque notre pays est responsable du martyre du Mexique, c’est notre devoir de nous organiser pour sauver ce pays. Depuis les jours de John Adams, second président des États-Unis (1797-1801), nous avons protégé les minorités ennemies de l’Église mexicaine qui s’emparaient du pouvoir par la force armée...
Les catholiques américains qui ont laissé faire doivent enfin prendre conscience du pouvoir dont ils disposent, en faisant plus hardiment usage de leurs droits civiques. Trop souvent, les catholiques de langue anglaise s’estimèrent en état d’infériorité, acceptant d’être tolérés sans oser réclamer la pleine égalité [33], alors qu’ils apportent seuls le salut à notre pays... Quatre générations, élevées par l’école sans Dieu, ont créé une société où la moitié des citoyens n’a plus aucune croyance, ce qui aboutit souvent à n’avoir plus aucune morale... Les catholiques américains n’ont pas encore assez compris que l’action civique est un devoir de conscience, que seule elle peut sauver leur liberté et la liberté des autres...
Ces exhortations de Mgr Curley et de l’épiscopat américain, utiles à méditer ailleurs qu’aux États-Unis, ont eu un double résultat : les catholiques américains ont pris une meilleure conscience de leurs droits et de leurs devoirs civiques ; la vaillante campagne qu’ils ont entreprise a contribué à réveiller les énergies des catholiques mexicains ; ils ne sont plus seuls ; ils savent que 20 millions de catholiques, en la République voisine, suivent avec une admiration croissante leur rude combat, et que, jusqu’à la victoire, ils les aideront.
Les actes, d’ailleurs, ont suivi les paroles.
En juillet 1927, le Conseil National des Chevaliers de Colomb, représentant 800 000 membres, crée un fonds d’un million de dollars pour venir en aide aux catholiques mexicains, décide une campagne de presse qui commencera dans l’organe de l’Ordre, Columbia, au tirage mensuel de 800 000, adresse une protestation au président Calvin Coolidge contre la persécution et la connivence des États-Unis : « Les excès que nous déplorons ont été fomentés et approuvés par l’action officielle de notre département d’État... Aux catholiques mexicains, nous promettons l’aide de 800 000 hommes qui aiment Dieu, respectent l’autorité légitime, et, dans l’accomplissement de leur devoir, ne craignent pas les forces du mal, qu’elles viennent de la terre ou de l’enfer... »
Les délégués de l’Ordre, ceux des Chevaliers du Saint-Nom (deux millions de membres), la Mère Sample, expulsée du Mexique, plusieurs témoins oculaires des horreurs mexicaines, le célèbre avocat M. Barr, se présentent à la Maison Blanche, devant la Commission des Affaires Extérieures, pour réclamer une politique plus active des É.-U. au Mexique. La Mère Sample répète le propos à elle tenu par M. Sheffield, l’ambassadeur des É.-U. : « J’ai les mains liées, je ne puis rien pour vous ni pour les autres persécutés. »
La Conférence nationale de Prospérité Catholique (NCWC), présidée par l’archevêque de Californie, Mgr E. Hanna, devant l’inefficacité de ces démarches, tient, au mois d’avril, trois grands meetings qui adressent, à la nation entière, un manifeste sur les crimes de Calles ; créent une Commission permanente mixte, où seront représentées les grandes œuvres masculines et féminines : le Centralverein, le Saint-Nom, etc., demandent aux évêques de vouloir bien ordonner un triduum solennel de prières pour le Mexique ; décident d’intensifier la propagande par le tract, la brochure ; envoient au secrétaire d’État, M. Kellogg, une nouvelle protestation. Au même temps, les catholiques de New York créent une Association pour la défense des droits religieux du Mexique, avec les buts suivants : rendre universelle la campagne de conférences et de presse, réunir des fonds pour secourir les émigrés mexicains, aider, dans leur lutte civique, les défenseurs de la foi.
À ces initiatives privées, encouragées, dirigées par l’épiscopat, viennent se joindre des démarches plus officielles.
Le député catholique J. Boylan, devant les Chambres Fédérales, le 4 mars, somme M. Coolidge de retirer la reconnaissance des É.-U. à un gouvernement qui s’est mis au ban de la société aussi bien que celui des Soviets. En juin, le sénateur des Massachusetts, J. Gallican ; en janvier 1927, le sénateur de Montana, J. Walsh ; en décembre 1927, le député des Massachusetts, P. Connery, renouvellent les mêmes instances... M. Kellogg, maçon considérable, depuis 1880, de la Loge Indiana, se retranche, comme M. Coolidge, derrière le principe de non-intervention ; « la voix de 20 millions de catholiques américains se perd dans le silence de 100 millions de citoyens esclaves du dollar, des Loges et du Protestantisme ! » s’écrie un orateur catholique.
Eh non, grâce aux catholiques, l’indifférence n’est plus possible aux États-Unis : désormais, la question mexicaine est posée devant le pays.
3° Le troisième imprévu, celui contre lequel se brisera inévitablement la haine du persécuteur, c’est l’héroïsme des persécutés.
QUATRIÈME PARTIE
Le film des Martyrs [34]
I – CENT PHOTOGRAPHIES
La citoyenne Alexandra Kollontay, ambassadeur des Soviets, à Mexico, débarquant à Veracruz, le 6 décembre 1926, rendait à Calles ce témoignage : « Votre gouvernement présente de profondes analogies avec celui de Moscou. »
On voit, en effet, de part et d’autre, un pays conduit à sa ruine, par le règne du bon plaisir et de la terreur, une régression de l’humanité vers la préhistoire.
Mais Calles a dépassé Lénine sur un point. Je ne sache pas que le Moscovite ait songé à « filmer » ses exécutions.
Son rival mexicain a eu cette trouvaille.
J’ai sous les yeux une centaine de photographies d’exécutions capitales communiquées par plusieurs amis revenus de là-bas. Je ne connais pas de documents plus accablants pour les bourreaux, plus glorieux pour les victimes.
Je les grouperai sous certaines rubriques : martyre de prêtres, de jeunes gens, d’enfants, de vieillards, de femmes..., sans prétendre, tant s’en faut, à une énumération complète, qui, d’ailleurs, ne sera sans doute jamais possible.
Prêtres et religieux.
Les premières photographies reproduisent dans tous ses détails la mort du P. Pro, Jésuite, et de ses compagnons : l’ingénieur Segura Vilchis, l’ouvrier Tirado Arias et Humbert Pro, frère du Jésuite [35].
Voici le P. Pro conduit au supplice, priant à genoux pour ses bourreaux, tombant les bras en croix, percé de balles, un Crucifix à la main droite, un chapelet à la main gauche, recevant le coup de grâce, porté sur sa civière, exposé dans la chapelle ardente à côté de son frère, les obsèques triomphales... Mêmes détails pour les trois autres martyrs, et pour couronner le tout, l’ignoble chef de la police, le général Roberto Cruz, présidant, d’un air satisfait, aux exécutions, en fumant un cigare.
Le P. Pro avait fait ses études théologiques dans un scolasticat français de Belgique, à Enghien, comme son confrère Mgr Diaz.
Arrêté le 17 novembre 1927, tandis qu’il exerce son ministère, à Mexico, déguisé, tantôt en ouvrier, tantôt en marchand ; il est jeté en prison avec son frère Humberto, l’ingénieur L. Ségura et l’ouvrier Tirado Arias. Tous quatre accusés d’avoir participé à l’attentat dirigé, le 13 novembre, contre le général Alyaro Obregon, qui, d’ailleurs, n’a même pas été blessé.
Les accusés niaient ; nulle preuve n’existait. Mais cela était-il nécessaire ? Nul procès ne fut instruit [36].
Calles avait résolu de venger sur les prisonniers l’échec de ses négociations religieuses. Dans la soirée du 22 novembre, il donnait à Roberto Cruz l’ordre de fusiller, au plus tôt, les détenus. Par un scrupule inédit, Cruz demande au président s’il ne vaudrait pas mieux donner une forme légale à la condamnation. « Je ne demande point de formes, répond Calles, je demande le fait. – ne quiero formas, lo que quiero es el hecho. »

L’ingénieur Segura Vilchis exposé à l’amphithéâtre après son exécution.
Le P. Pro tombait le 23 novembre 1927, après avoir, une dernière fois, protesté de son innocence, pardonné à ses bourreaux. Les bras en croix, il donne le signal de la décharge.
Son père, vieillard de soixante-dix ans, apprit par les journaux l’exécution de ses deux enfants. Ayant fait rouvrir les cercueils qui se trouvaient à l’amphithéâtre, il baisa ses enfants au front. Et, comme sa fille sanglotait, il dit, d’une voix calme :
– Ma fille, il n’y a pas de raison de pleurer.
Une immense foule accompagna au cimetière les deux frères. Les obsèques terminées, le père, se redressant, murmura Te Deum ! et la foule poursuivit le chant sacré [37].
Pour lui arracher des révélations sur les organisations catholiques, on tortura longuement Tirado Arias. Suspendu par les pouces, frappé jusqu’à lui briser les os, plongé dans l’eau glacée, alors qu’il souffre déjà de la poitrine, il est finalement traîné plus mort que vif au stand de tir pour l’exécution.
L’ingénieur Ségura Vilchis, l’ouvrier Tirado eurent aussi des funérailles triomphales. Le cercueil de celui-ci, accompagné par plus de 7 000 personnes, fut porté, pendant plusieurs kilomètres, sur les épaules des ouvriers, ses compagnons de travail. Une avalanche de fleurs, de couronnes, tout au long du parcours et au cimetière, couvrait le cercueil. Malgré l’opposition de la police, on fit une collecte parmi les assistants, pour secourir le père (aveugle) de la victime et sa femme pauvre et malade.
Ces premières exécutions (malgré la violation éhontée des formes élémentaires de cette Constitution dont Calles s’affirme le défenseur) s’entourent de quelques vestiges d’humanité.
Mais la griserie du sang va déchaîner la sauvagerie pure, ressusciter les rites atroces des anciennes peuplades indiennes.
Désormais, je me bornerai presque à traduire dans leur brièveté éloquente, à la façon d’une citation à l’ordre du jour, les notes de mes correspondants mexicains. Ici ou là, je relève quelques variantes de détail, des différences d’orthographe qui, à mon sens, loin de diminuer la valeur documentaire de ces dépositions, en attestent la sincérité [38].
Pendant la semaine du 1er au 9 mai 1926, appelée la semaine rouge, 17 prêtres, emmenés de la prison de Santiago Tlatletolco au cimetière de Dolorès, sont exécutés au bord de leur fosse. Le chef du peloton, Rosado, oblige le fossoyeur à les enterrer tous, même ceux qui se débattent dans les affres de l’agonie. Le spectacle était si horrible que le fossoyeur perdit la raison et fut interné dans la maison de santé de la Castaneda.
Une personne partie de Mexico affirme que ces scènes d’horreur se multiplient. On avait transporté au cimetière de Mexico un cadavre, mais il était trop tard pour l’enterrer ; une personne de la famille resta pendant la nuit près du mort. S’étant endormie, elle se réveilla au bruit de coups de fusil, et courut se cacher dans une fosse. Le lendemain, elle alla trouver le concierge du cimetière, qui, surpris, lui demanda pourquoi elle était restée au cimetière. Elle en donna la raison et demanda la cause des coups de fusil, le concierge lui dit : « Venez voir, mais gardez le silence » ; il lui montra le corps des prêtres, fusillés cette nuit-là, et ajouta qu’il en était de même les autres soirs.
À Zacatecas, le P. Correa portait le Viatique à un malade ; surpris par un groupe de soldats, qui voulurent lui arracher la sainte Hostie :
– Vous me tuerez si vous voulez, dit-il, mais jamais je ne permettrai un tel sacrilège.
Revenant un peu en arrière, il consomma la sainte Hostie. Furieux, les soldats se jetèrent sur lui, et, après l’avoir injurié, l’emmenèrent à Durango, l’accusant d’être de connivence avec les libérateurs.
– D’abord, lui dit le général Ortiz, vous allez confesser tous ces rebelles que vous voyez là et qui seront fusillés au Panthéon de Dolorès. Ensuite, nous verrons ce que nous ferons de vous.
Le prêtre confessa et encouragea tous ces vaillants.
– Maintenant, dit Ortiz, vous allez me révéler ce que ces bandits vous ont dit.
– Jamais.
– Comment ? Je vais ordonner qu’on vous fusille...
– Vous pouvez le faire, mais vous n’ignorez pas qu’un prêtre doit garder le secret de la confession.
Le général ordonna que le prêtre fût immédiatement fusillé. Cela se passait au matin du 6 février 1927.
... Pris dans la maison d’un cordonnier, le P. Raphaël Chowel, conduit à Silao, puis à Guanajuato, fut tué dans un lieu inconnu, ainsi que le cordonnier, père de huit enfants.
Près de Lagos, sur le lieu même où fut attaqué le train militaire du général Amarillas, le P. Escoto, curé de la paroisse de San-Juan de Los Lagos, a été fusillé. Arrêté à Aguas-Calientes, il fut martyrisé avant d’être exécuté.
À Léon, trois prêtres, dont on n’a pu connaître les noms, furent pris dans des maisons particulières, où ils étaient cachés. On les emmena à la gare où on martyrisa le P. Escoto, et là ils furent exécutés.
Le 22 mars, deux prêtres passèrent par Salamanca dans un train de marchandises. L’un d’eux avait la langue coupée et un bras entièrement cassé ; l’autre, les bras et les mains brisés, une blessure au cou, baignait dans son sang. Les deux victimes étaient attachées. Des personnes de la ville allèrent les voir. Un médecin voulut les soigner, mais le conducteur ne le permit point.
Ramon Adame, octogénaire, Isabel Flores, Andres Sola... trois prêtres, fusillés, après divers supplices, pour avoir célébré la messe, avec dix civils coupables d’y avoir assisté et communié.
Ramon Adame, curé de Nochistlan est conduit à Yahualica. Comme il marche difficilement, le capitaine ému de pitié lui offre son cheval.
– Non, répond doucement le prêtre, le Christ a gravi son Calvaire à pied.
– Je ne puis tuer un innocent, continue le capitaine.
– Mon pauvre ami, répond le condamné, vous exposez votre propre vie, si vous n’obéissez pas.
Au terme du voyage l’officier refuse, de fait, de commander le peloton ; on le fusille avec son prisonnier.

Le P. Gumersindo Sedano.
Le P. Robbes, pendu (25 juin). Le P. Alvarez, fusillé.
Le P. F. Vera, fusillé, en ornements sacerdotaux, pour délit de messe.
L’officier se donne lui-même le luxe de photographier la scène.
Le P. Sedano (la Croix du 17 février 1928 a publié ce cliché), vendu pour 50 centimes par une mendiante à qui il a fait l’aumône. On lui arrache la peau de la plante des pieds, puis on le pend, et les soldats, après lui avoir attaché, aux genoux, cette inscription : « Voilà le curé Sedano », font de son cadavre une cible bientôt déchiquetée.
L’avocat P. V. Cisneros, aujourd’hui exilé, écrit de Mexico, en juillet 1927, un récit que j’abrège : Le vicaire Sabas Reyes, curé du bourg de Tototlan (Jalisco), est recherché ainsi que son curé don Vizcarra.
Les callistes arrêtent la vieille servante du vicaire, la somment de révéler où se cache son maître. Refus. On la pend, on la détache pour renouveler la sommation ; à la fin, folle de douleur, elle révèle la cachette du vicaire Reyes.
– Où est le curé Vizcarra ? demandent les bourreaux au jeune prêtre.
– Je ne sais...
On le pend par les mains à une colonne, à l’entrée de l’église, les pieds ne touchant pas le sol. Les soldats lui labourent tout le corps à coups de baïonnette en répétant :
– Où est le curé ?
Le malheureux demeure ainsi pendu trois jours et trois nuits au milieu d’atroces souffrances, sans boire ni manger.
Comme il refuse toujours de parler, on lui écorche les pieds, puis on les entoure d’étoupes enduites d’essence auxquelles on met le feu. Les soldats le détachent alors, et à coups de baïonnette le font marcher sur ses pieds écorchés, brûlés, jusqu’au cimetière. Il tombe, on le fait se relever à coups de pied, à coups de crosse. Il parvient enfin au cimetière où on le fusille (14 avril 1927).
Le P. L. Ariola, curé de Tamasula, est surpris distribuant les Sacrements : on lui coupe les deux mains. Il meurt trois jours après.
Le R. P. André Sola, qui vivait caché, va bénir un mariage. Des soldats l’arrêtent avec le fiancé Leonardo Perez, la fiancée Nieves Pueller, le notaire Valdivia. Tous sont fusillés. Leurs cadavres restent plusieurs jours exposés sur la place publique avec cette inscription : « Fusillés pour avoir violé les lois religieuses du gouvernement. »
Le P. R. Aguilar, curé de la « Union » de Tuba, brûlé vif à Ejutla, en ornements sacerdotaux.
Le 6 janvier 1926, le journal américain El Paso nous informe que, d’un seul coup de filet, les troupes de Calles ont saisi et emprisonné 300 prêtres à Jalisco, et 100 à Queretaro, tous accusés de n’avoir pas expédié au gouverneur le compte complet de leurs dépenses.
Peu après, un des prêtres emprisonnés fait savoir, par un billet écrit à un ami, qu’on « leur a injecté le virus de la tuberculose et de contagions... pires que celle-là ».
À Lagos, deux prêtres, coupables d’avoir célébré la messe sans autorisation, sont fusillés. À l’un deux, les bourreaux commencent par couper les deux bras :
– Ainsi, tu ne pourras pas dire la messe.
Puis, ayant disposé un bûcher au pied d’un arbre, pour brûler leur victime vivante, ils lui commandent de monter sur l’arbre. Après avoir assisté à ses vains efforts, ils l’assomment.
Au mois de mars 1926, à Jalisquillo, le député J. Moreno envahit, un dimanche, la chambre où le curé dit la messe.
– La messe est défendue ! crie-t-il en se jetant sur le prêtre.
Huit fidèles et le curé sont ficelés et pendus à un frêne en face de l’église. M. Sydney Sutherland, fils d’un ministre protestant, prend la photographie de l’arbre où pendent les neuf cadavres, et son père la publie dans le Liberty Magazine, aux États-Unis.
Jeunes gens.
Les six jeunes martyrs de Léon (Guanajuato) fusillés le 2 janvier 1927.
Les voici exposés, étendus à la file, sanglants, avec cette pancarte explicative :
Jose Valencia Gallardo, 21 ans, célibataire.
Nicolas Navarro, 20 ans, marié.
Antonio Romero, 35 ans, marié.
Salvador Vargas, 20 ans, célibataire.
Ezequiel Gomez, 18 ans, célibataire.
Augustin Rios, 13 ans, célibataire (sic).
Arrêtés, la veille, sous le vague prétexte de sympathie pour les « libérateurs », conduits au poste de police, insultés, malmenés par les soldats, on leur annonce, sans autre forme de procès, qu’ils vont être fusillés.
Le jeune Rios, enfant de treize ans, se met à pleurer. Le professeur Jose Gallardo le console, l’encourage. Les soldats se jettent sur lui et lui arrachent la langue, en criant :
– Parle, maintenant, si tu le peux.
Après une nuit de mauvais traitements, tous sont fusillés. Ils ont pu, la veille, être communiés. Navarro, avant de mourir, reçoit la visite de sa jeune femme, mère d’un petit enfant. Il l’embrasse, puis :
– Quand notre petit sera grand, tu lui diras que son père est mort pour défendre sa religion.
La mère de Gallardo, ne se jugeant pas digne d’embrasser le cadavre mutilé de son fils, lui baise les pieds.
Un autre jeune : Manuel Bonillas, jeune ouvrier typographe, de Taluca. Son crime ? Il est président de l’ACJM, catéchiste volontaire des enfants du peuple dans le district fédéral. Un fermier, chez qui il a dîné, le vend. Comme on est au Vendredi-Saint, 15 avril, les soldats songent à singer les scènes de la Passion..., lui attachent les pieds, les bras, en forme de croix, à un arbre, et, à trois heures, le fusillent, en lui disant :
– C’est l’heure où ton Christ est mort.
La scène se passe à Salazar, près de Mexico.
Pie XI, dans son Encyclique sur la persécution mexicaine, fait allusion à la mort héroïque de deux jeunes catholiques : Manuel Melgarejo (17 ans), et Joachin Silva (27 ans).
Ils sont arrêtés, à Zamora (12 sept. 1926), comme propagandistes de la Ligue pour la défense des libertés religieuses et membres de la Jeunesse catholique.
Le général Zépéda, monté avec eux dans le train, se fait passer pour catholique, provoque leurs confidences et les arrête à l’arrivée. Silva demande qu’on relâche son jeune ami Melgarejo, prenant sur lui toutes les responsabilités, mais celui-ci proteste qu’il ne quittera pas son compagnon.
Pas de procès, mais un télégramme à Calles, qui répond, par retour : « Fusillez. »
Et en route pour le cimetière, « le Panthéon », en langage nouveau. On offre la vie à Melgarejo s’il consent à quitter la JC. Il refuse. On le somme de crier :
– Vive Calles !
Il répond :
– Vive le Christ-Roi !
Comme on conduit les deux amis au cimetière pour l’exécution, un des bourreaux veut arracher à Joachin le chapelet qu’il récite :
– Laissez-moi, répond-il énergiquement. Tant que je vivrai, il ne me quittera pas.
Arrivé au lieu d’exécution, il dit :
– Ne me bandez pas les yeux, je ne suis pas un criminel. Je vous donnerai moi-même le signal quand je crierai : « Vive le Christ-Roi ! Vive Notre-Dame de la Guadeloupe ! »
Puis il adressa quelques mots aux bourreaux, disant qu’il pardonnait, content de mourir pour Dieu et sa patrie. Touché par la grâce, un soldat jeta son fusil :
– Je ne tire pas, jeune homme, je pense comme vous ; je suis catholique.
Ce qui lui valut l’honneur du martyre dès le lendemain.
Joachin se tourne alors vers Manuel, le serre dans ses bras en lui disant :
– Découvre-toi, nous allons paraître devant Dieu.
Tenant toujours son ami enlacé, il pousse le cri sonore qu’il a annoncé et tous deux tombent enlacés sous les balles des bourreaux.
En apprenant la mort de son fils, la Señora Silva craignit que le père de Manuel ne reçût mal la nouvelle. Sur ces entrefaites, celui-ci se présenta :
– Embrassons-nous, dit-il, nous sommes père et mère de martyrs.
Les quatre jeunes martyrs de Guadalajara, Anacleto Gonzalez Flores (vingt-trois ans) et ses compagnons. Le 1er avril 1927, une troupe de policiers prend d’assaut la maison de l’avocat Flores, membre de la Ligue pour la défense religieuse, président de l’Union populaire de Jalisco, créateur de nombreux cercles d’études, promoteur, au Congrès national ouvrier de Guadalajara, de la Confédération catholique du Travail, rédacteur aux journaux Gladium et La Restauration. Ce sont là ses multiples crimes...
Par la même occasion on arrête les trois jeunes Vargas, ses amis et collaborateurs. Flores s’avance seul d’abord en disant aux soldats :
– Arrêtez-moi, mais laissez partir ces jeunes gens.
On les arrête tous, et, comme on les conduit à la « Caserne Rouge », le moderne Colisée de Guadalajara, où tant de martyrs tomberont, on saisit encore le jeune Louis Padilla. Tous les cinq demeurent sans manger jusqu’à 2 heures. Puis les supplices commencent. C’est le premier vendredi du mois. L’avocat Flores est suspendu par les pouces six heures durant, flagellé, poignardé aux pieds. Les bourreaux veulent savoir où se cache l’archevêque. Il refuse de répondre, mais encourage ses compagnons à persévérer. On lui brise alors les dents à coups de crosse, puis on l’égorge, sous les yeux de sa jeune femme. Louis Padilla, Raymond et Georges Vargas sont fusillés [39]. Leur jeune frère Florentin assiste à leur supplice mais, à son grand regret, est épargné.
L’avocat Flores laisse sa jeune femme et deux petits garçons, l’un de trois ans, l’autre de dix-huit mois. L’aîné de ces petits vient voir le cadavre de son père horriblement mutilé, les habits ensanglantés jusqu’au collet. Il demande qu’on le soulève pour l’embrasser, et comme on lui demande ce qui est arrivé à son papa :
– Des méchants, dit-il, l’ont tué parce qu’il aimait beaucoup l’Enfant Jésus.
Le corps de Flores fut porté au cimetière par des ouvriers. L’un d’eux et deux jeunes gens firent sur la tombe l’éloge du martyr. Au sortir du cimetière la police les saisit et les fusilla ; l’ouvrier put s’échapper, mais, le soir même, on arrêtait le chantre Ézéchiel Huerta et son frère Salvador, ouvrier mécanicien, présents au cortège. On les somma de révéler la retraite de leur frère prêtre. Sur leur refus de parler, ils furent immédiatement fusillés et enterrés. Le chantre Ézéchiel laisse onze enfants et le mécanicien Salvador dix.
Les jours suivants, huit étudiants de Guadalajara sont conduits au même Colisée, la « Grande Caserne Rouge », et sous prétexte de propagande catholique torturés longuement et fusillés. Pour que les parents ne puissent pas constater les traces de tortures, ils ne sont ni admis à voir les cadavres ni même prévenus de l’exécution et de l’enfouissement.
À Tlalpujaluca, quatre jeunes gens, membres de la Ligue, sont arrêtés par le général Urbalejo et fusillés après deux jours de marche où les soldats les font avancer à coups de crosse.
Le général E. Ortiz arrête à Zacatecas le jeune A. Hurtado coupable de porter l’insigne de la Jeunesse catholique ; on l’exécute.
Cette Association compte en ce moment environ 200 martyrs.
Hommes.
Les deux journaux El Diario de El Paso (Texas) et El Pueblo ont publié l’information suivante où le comique se mêle au tragique :
À San Julian (Jalisco) une colonne fédérale appartenant au corps du général Martinez poursuit un groupe de libertadores. Arrivé à San Julian, le 15 août, le capitaine demande à voir un des notables du village, le jeune paysan Anselmo Padilla. Il s’adresse à un brave homme en train de traire sa vache.
– Avez-vous vu passer le sieur Padilla ?
– Non.
Un peu plus loin, il interroge un enfant de la ferme.
– As-tu vu le sieur Padilla ?
– Mais, répond innocemment le gamin, c’est lui qui vient de vous parler. Il est en train de traire sa vache.
– Furieux, les soudards se jettent sur Padilla, le rouent de coups, puis, avec une petite scie à main, lui scient le nez à sa racine. Avec le même instrument, ils lui arrachent la chair des joues et la plante des pieds.
– Crie : « Viva Calles ! » commandent-ils à chaque supplice. Et lui de répondre :
– « Viva Cristo Rey ! »
Il tombe râlant. On allume alors un brasier. Les soldats relèvent l’agonisant dont la face ruisselle de sang et le poussent vers le feu :
– Tu vas marcher sur les charbons ardents.
Et lui :
– Puisque j’ai l’honneur de souffrir pour le Christ, le feu ne m’épouvante pas, j’éteindrai s’il le faut le feu avec mon sang...
Et, les pieds écorchés, ruisselant de sang, il traverse le brasier sans une plainte et tombe mort.
Un médecin de Moroleon est fusillé, parce que ses fils sont membres de la Ligue de défense religieuse.

Exécution du général rebelle Alfredo Rueda Guijano.
Un commerçant de Puebla, G. Farfan, est fusillé le 26 juillet 1926, pour avoir écrit sur sa devanture : « Vive le Christ-Roi ! Dieu ne meurt pas ! »
Le général qui commande l’exécution lui dit en ricanant :
– Voyons comment meurent les catholiques !
– Voici, dit Farfan, en baisant son crucifix : « Je vous pardonne ». Et il tombe.
Dans son paroissien, on trouva cette prière écrite la veille de son martyre : « Mon Dieu, aidez-moi à faire quelque chose pour vous ; je n’ai encore rien fait. »
Vieillards.
Tandis qu’on martyrise à Mexico, en lui rompant les deux bras, un enfant de douze ans coupable d’avoir répandu des tracts catholiques, un vieillard de soixante-dix ans, R. Acevedo, et son fils Vicente, sont, pour le même crime, fusillés à Tlaciaco.
Le Señor Alvarez, frère du chef d’état-major de Calles, a raconté lui-même avec indignation, dans un journal de Guadalajara, le crime commis à Purificacion, au mois de juillet 1926. Le capitaine J. I. Gomez arrête un vénérable prêtre de quatre-vingts ans, pacifique, pieux, aimé et admiré des pauvres, perclus et complètement sourd. On l’accuse de conspiration ; comme il n’entend même pas ce qu’on lui demande, une balle explosive l’étend raide mort.
À Colotlan (Jalisco), on fait mieux encore. Un pauvre aliéné, don Henri Marquez, est deux fois emprisonné, puis fusillé.
Enfants.
Un enfant de quinze ans est arrêté à Parras (Coahuila), avec sept hommes d’âge mûr. L’officier, pris de pitié, l’envoie en avant du cortège, espérant qu’il s’enfuira. Mais l’enfant revient.
– Jeune fou, crie le capitaine, pourquoi reviens-tu ?
– Je veux mourir avec mes compagnons... Ils sont catholiques, moi aussi.
Tous les huit sont fusillés.
À Guadalajara, un enfant de douze ans est surpris répandant des tracts de propagande religieuse. Les soldats le torturent pour obtenir le nom de celui qui lui a livré ces papiers. Il refuse de trahir.
On appelle sa mère. Elle l’encourage à rester ferme :
– Ne dis rien, mon enfant, ne dis rien. Notre-Seigneur te donnera le ciel pour ta constance.
On lui brise les deux bras. Il meurt peu après.
À Arandas, un enfant de treize ans est arrêté par des soldats qui poursuivent « les libertadores ». Sur sa bonne mine, le capitaine lui dit :
– Tu m’as l’air d’un brave. Viens avec nous. Tu feras ton chemin.
Le gamin qui, en effet, est un brave, montre son chapelet, en baise le Crucifix :
– Vous autres, dit-il, vous combattez pour un homme, moi pour Dieu. « Viva Cristo Rey ! »
À l’instant même, il est criblé de balles.
Femmes et jeunes filles.
À Ciudad Victoria (Guanajuato), le 4 février 1927, un groupe de dames et de jeunes filles va réclamer la liberté des catholiques arrêtés pour la foi. Les soldats tirent en l’air pour les effrayer. Comme elles avancent toujours, on les fusille. Plusieurs tombent, les autres sortent leur revolver, tirent sur le cacique, les soldats, les mettent en fuite, délivrent les prisonniers. Le gouvernement envoie un régiment qui assiège la petite ville, exige qu’on livre la vaillante jeune fille, Guadalupe Chairez, qui a organisé l’expédition. On la torture longuement en la sommant de crier : Vive Calles ! Elle s’y refuse.
– Où sont les prêtres qui desservaient la paroisse ?
Silence !
– Le fouet te fera parler.
On la flagelle. Silence ! Attachée à un poteau, on lui arrache l’un après l’autre les doigts des mains, puis on lui coupe les bras par morceaux. À chaque nouveau supplice et jusqu’à la mort, elle crie : « Vive le Christ-Roi ! »
Au mois d’octobre 1926, pour avoir répandu des tracts recommandant le boycottage, cinq dames de la noblesse mexicaine sont, par les ordres de R. Talamantes, commandant d’armes à Colima, pendues haut et court aux arbres de la grande promenade. La fédération catholique féminine des États-Unis (NCWC), qui a des correspondants et des délégués au Mexique, publie sur ces atrocités les détails les plus circonstanciés [40]. Mais il faut descendre plus bas, dans ces ordres infernaux. Un beau jour, une jeune fille de Mexico, coupable, elle aussi, de distribuer des tracts, disparaît. Le père, au désespoir, la cherche longtemps et finit par la retrouver dans la prison d’un poste de police. Dès que l’enfant l’aperçoit, elle se jette dans ses bras en sanglotant, et lui raconte les violences qu’elle a subies. Le père dépose une plainte en justice contre les bandits qui ont déshonoré sa fille. Le procureur Ortega, lui répond en riant :
– Toutes les femmes qui feront la même propagande cléricale seront traitées de semblable façon.
L’inspecteur général de la police, Roberto Cruz, a encore trouvé des variantes. Des dames, tenant une Assemblée de la Ligue de Défense religieuse, sont appréhendées, conduites en prison, à travers les rues de Mexico. Cruz ordonne qu’on les enferme, non dans le quartier des femmes, comme le veut la loi, mais dans celui des filles publiques. Celles-ci les accueillent avec des plaisanteries obscènes. Réfugiées dans un coin, les vaillantes catholiques récitent le rosaire pendant toute la nuit. Peu à peu, leurs compagnes s’arrêtent de les injurier et, finalement, prient avec elles. Le matin venu, l’ignoble R. Cruz vient s’informer « si ces dames ont bien dormi ». Une des filles publiques lui répond vertement :
– Le gouvernement se trompe s’il compte sur nous pour outrager ces dames.
À Victoria, la présidente des Enfants de Marie, conduite au poste de police, est ignoblement mutilée, puis égorgée, etc.
Déportations.
Voici maintenant un Train infernal : des centaines de catholiques déportés, en route pour le bagne de l’île Maria-Madre. Entassés par 80 ou 90, dans des wagons à bestiaux, vraies cages à fauves, gardés par des Indiens, liés les uns aux autres : bandits et condamnés politiques ; avocats, médecins, professeurs, prêtres et repris de justice... roulant, pendant trois ou quatre jours, au milieu des excréments, sous le soleil torride, nourris de pain moisi... Leurs peines ne font que commencer. Les bagnes de Sibérie sont des lieux de plaisance auprès des bagnes des îles Marie. En deux ou trois ans, le climat meurtrier a raison des tempéraments les plus vigoureux. Et ces catholiques, hier hommes du monde, honnêtes ouvriers, vont, sous la garde de quelques nègres, travailler, à moitié nus, à exploiter des salines, mêlés aux pires bandits. Heureux les martyrs à qui le peloton d’exécution épargna cet enfer !
Des journalistes parisiens ont publié des enquêtes apitoyées sur nos colonies pénitentiaires ; la Ligue des droits de l’homme a fait écho à leurs généreux projets. Qu’attendent ces messieurs pour aller faire un tour à Maria Madre ? Je ne puis supposer que, seuls, les repris de justice, les condamnés de droit commun, les intéressent, et que l’infortune des honnêtes gens [41] les laisse indifférents.
Exécutions collectives. – Les Colisées mexicains.
Dans les premiers mois de 1927, le gouvernement mexicain publiait et faisait distribuer, dans les chancelleries, un fort volume signé de M. Perez Lago et intitulé : La question religioso en Mexico.
Le plaidoyer est résumé dans la préface et revient à ceci : « L’agitation actuelle, provoquée par l’épiscopat mexicain, n’a nulle raison d’être. Les vrais motifs sont la volonté de faire rétrograder la société jusqu’au Moyen Âge ; de tenir pour non avenue l’Encyclique Rerum Novarum ; d’arrêter l’ère de progrès social inaugurée par la Loi de Réforme. Le clergé se flatte de revivre, grâce aux évènements qu’il a provoqués, les jours des empereurs romains. La prétention est « grotesque ». Il y a longtemps que l’ère des martyrs est close.
« Le Gouvernement du Mexique ne persécute personne, il ne fait qu’imposer le respect des lois fondamentales. » (P. 34-35.)
On a vu où se trouvait le « grotesque », en ceux qui parlent des martyrs mexicains, ou en ceux qui nient leur existence, les mains rouges de sang.
La Croix de Paris a eu l’excellente pensée de publier quelques-unes des photographies dont j’ai parlé. Des lettres du Mexique ajoutent à leur éloquence.
Le 17 février 1928, elle reproduit la photographie où on voit le P. Sedano, debout contre un arbre, la plante des pieds écorchée, pendu, déchiqueté par les balles des soldats. Encadrant cette photographie, deux lettres ; l’une expédiée de Villa-Hidalgo, le 27 décembre 1927 ; je la résume :
Le dimanche 11 décembre, 600 fédéraux arrivent, ici, pour venger la défaite que leur infligèrent, dernièrement, les libertadores (catholiques), à la ferme Gonzalez... Aussitôt, le général donne ordre de tout piller, afin que les Cristos (les libertadores) ne trouvent plus aucun refuge. Tout fut pillé ; on détruisit ce qu’on ne pouvait emporter, puis on réunit les habitants, sur la place publique, autour d’un bûcher, en disant qu’on allait les brûler vifs.
Les soldats riaient...
Un des libertadores, resté à l’hôpital, malade, fut découvert, traîné un, jusqu’à la place ; martyrisé, on le somme de crier : « Vive Calles ! » Il répond : « Vira Christo Bey ! Vira la Virgen de Guadalupe ! » On finit enfin par l’égorger.
Un pauvre homme, Tomas Serna, de Jacona, conduisait une charge de bois. Les fédéraux lui disent : Crie « Vive Caties ! » Il répond : « Vive le Christ Roi ! » Ils le décapitent aussitôt, à coups de sabre. La même chose arrive à deux autres.
Toutes les familles émigrent... J’oubliais de dire que les fédéraux transformèrent l’église en caserne et firent de la grille de communion des fers à chevaux. L’église fut entièrement pillée.
Au moment où je t’écris, j’apprends qu’à la gare de Castro ils ont martyrisé le P. Leandro-Juan Garcia ; ils lui ont écorché la plante des pieds, coupé les doigts et l’ont torturé jusqu’à ce qu’il meure. Sa famille a été amenée prisonnière parce que le Père avait célébré le saint sacrifice chez elle.
L’enterrement fait à Encarnacion a été très émouvant...
La seconde lettre, venant de la région d’Aguascalientes, contient de semblables détails et explique la recrudescence de la rébellion :
Les soldats de Calles ont tout dévasté : ce qu’ils ne peuvent manger, ils le saccagent ; ils lâchent les chevaux au milieu des récoltes ; ils brisent les portes des maisons, emportent l’argent qu’ils découvrent. Cela fait que la révolution s’étend de plus en plus, car beaucoup, qui n’avaient nulle envie de prendre les armes, se sont vus obligés à le faire, parce que, ne devant rien à personne, on les persécute néanmoins et on les dépouille de tout ; ils n’ont plus rien pour nourrir leur famille. On entend des paysans s’écrier : « Puisque ces bandits ne m’ont pas même laissé de quoi manger, je préfère me joindre aux insurgés que mourir de faim ; peut-être pourrai-je vendre ma vie pour deux ou trois des leurs, ceux que Dieu mettra à ma portée... »
Pour célébrer, par des plaisirs nouveaux, les solennités de Pâques, le ministre de la Guerre, Joaquin Amaro, fait fusiller 45 catholiques à Guadalajara.
La Palabra, journal révolutionnaire, publie, le 19 septembre 1926, avec une indignation qui l’honore, l’horrible exploit du général B. Garcia, à Colima. Lui et ses soldats, en état d’ébriété, arrêtent dans la rue 10 catholiques et les abattent à coups de revolver.
Le 4 décembre 1926, la Civilta Catolica raconte, d’après un témoin, le martyre de Luis Batis, curé de Chalchihuites (Zacatecas). Dans la nuit du 4 août 1926, par ordre du général Eulogio Ortiz (Eulogio le Cruel, ou le Tigre de Durango, comme on dit dans le pays), une dizaine de soudards envahissent le presbytère, jettent le prêtre au bas du lit, le malmènent, l’emprisonnent. Le lendemain, deux membres de la Ligue de défense : Manuel Morales et Salvador Morales, un jeune homme de la Jeunesse catholique, D. Roldan, sont arrêtés. La foule, révoltée, veut massacrer les soldats ; le prêtre la calme, mais demande grâce pour ses compagnons, l’un père de trois petits enfants, les deux autres soutiens de famille. Tous sont fusillés.
Deux télégrammes rédigés à Mexico, les 12 et 20 janvier 1927, par des touristes américains, sont publiés dans la Revue Catholique de Baltimore le 21 janvier. Les voyageurs disent qu’ils ont compté sur la route d’Ozumba, à 30 milles de Mexico, 142 cadavres de catholiques pendus aux poteaux télégraphiques ; ils en ont compté 22 dans le district fédéral.
La Gaceta de Guaymas du 5 août 1927 publie un article de son correspondant à Nogales, expliquant l’exode de nombreux Mexicains. Pour imposer la terreur dans les campagnes, nouveaux Caciques et Alcades terrorisent les campagnes, pendant, par douzaines, sous le moindre prétexte ou sans prétexte aucun, des douzaines d’humbles travailleurs des champs.
– C’est une chose horrible, me disait une paysanne, de voir les mères, les femmes, les petits enfants de ces malheureux prier, pleurer, implorer ces brutes armées qui répondent par des rires... et pendent à tous les arbres d’innocents « peones »... Et voilà pourquoi nous fuyons...
Et la terreur ne cesse pas. Une lettre du 3 avril 1928 contient les détails suivants :
La police a arrêté 68 catholiques qui assistaient à la messe et trois prêtres qui célébraient l’office divin, dimanche dernier, dans un faubourg de Coyacan.
Parmi les personnes arrêtées, se trouvent plusieurs fonctionnaires des ministères de l’Instruction publique et de l’Agriculture.
De nombreux prêtres languissent dans les cachots, parce qu’ils n’ont pas de quoi payer les amendes de 500 ou de 1 000 pesos. Les cellules ne suffisent plus à contenir les détenus. Le P. Osio Leyva et huit catholiques qui distribuaient des tracts religieux ont été condamnés au bagne des îles Marie...
II – LA VOIX DES CATACOMBES
Une pauvre feuille polycopiée : le Boletin de la Liga Defensora de la libertad religiosa, rédigée, au péril de leur vie, par des catholiques mexicains, m’apporte, périodiquement, de nouveaux détails sur la persécution, qui, loin de s’atténuer, s’aggrave chaque jour. C’est la voix des Catacombes. Dans les livraisons de mars-avril-mai 1928, je relève cette plainte tragique : Pourquoi le gouvernement de M. Coolidge, de M. Kellogg, au moment même où il poursuit avec la France des pourparlers de pacification universelle, persévère-t-il à favoriser l’extermination de notre peuple ? Qu’un père de famille américain donne à son mioche un châtiment mérité, les voisins le dénonceront et le juge le punira ; quand l’aviateur Lindbergh se permet d’assister, dans l’Amérique centrale, à une course de taureaux, les Sociétés protectrices des animaux, qui pullulent aux É.-U., lui envoient des milliers de télégrammes indignés ! Chevalier des droits de l’homme et des droits des animaux, le peuple américain prit contre la Belgique le parti des Nègres du Congo ; contre l’Angleterre, le parti des Boers, des Irlandais ; contre la France le parti des Marocains, des Druses ; contre les Soviets, le parti de l’Ukraine ; contre Calles même, envoyant aux « révolutionnaires » du Nicaragua un million de dollars, le parti des « réguliers »... Pourquoi donc le gouvernement des É.-U. persévère-t-il à protéger chez nous une politique qu’il réprouve partout ailleurs : politique communiste, atrocement sectaire ; politique « jaune » même, qui appelle, pour remplacer les millions de Mexicains fugitifs, ces légions de Chinois, de Japonais, dont les É.-U. s’efforcent de purger l’Amérique ? Le gouvernement de Washington connaît mieux que personne la recrudescence de violence dont nous souffrons ces derniers temps ; il sait les martyrs individuels : le P. Albin Cardenas et deux catholiques fusillés, sans jugement, à Sayuda, pendant la Semaine Sainte, six autres prêtres exécutés à San Isidro, Irapuato, Mexico, ce qui porte à 250 environ le nombre des prêtres martyrisés. Le jeune J. Sanchez del Rio, enfant de douze ans, arrêté le 5 février 1928, par le général Guerrero, emprisonné, conduit au cimetière où on pend sous ses yeux, le 6, un enfant du même âge, après qu’avec un grand signe de croix il a dit à ses bourreaux :
– Je suis prêt !
On fixe alors la rançon du petit Sanchez, ainsi averti de ce qui l’attend, à 5 000 pesos, mais, lui, de mander à son père :
– Ne verse pas un seul centavo.
Puis, à 7 heures du soir, il écrit à sa tante : « Je suis condamné à mort ; à 8 h 1/2, viendra le moment tant désiré... Je n’ai pas le courage d’écrire à maman, tu le feras pour moi. Vive le Christ ! Qu’il règne ! qu’il commande ! Vive le Christ-Roi et Notre-Dame de Guadalupe ! José Sanchez del Rio, qui meurt pour sa foi... Adieu. » Et l’enfant tombe fusillé à 11 h 1/2 du soir, en criant : « Viva Christo Rey ! »
Encore un enfant : Thomas de la Mora, seize ans, étudiant au Séminaire de Colima ; arrêté le 5 août 1927, comme il joue avec ses petits frères ; voyant sa mère se lamenter : « Ne pleure pas, dit-il : donne-moi ta bénédiction ; si nous ne nous revoyons pas, ici-bas, nous nous reverrons au ciel. » À genoux, il reçoit la bénédiction de sa maman, suit le général Rodriguez qui commence par le souffleter, réclamant des renseignements sur les libertadores, puis le fait fusiller.
Parmi les centaines de libertadores blessés et lâchement achevés, voici Salvador Gutierrez de Mora, né à Tacubaya, en 1904, élève des Frères Maristes français au collège Luz Savinon. Sa première Communion faite, le Jeudi-Saint 1913, il devient zélateur de la Croisade Eucharistique. Plus tard, employé à la Banque internationale et hypothécaire, il fonde, en 1920, le groupe de Jeunesse catholique de Tacubaya d’où sortiront nos deux premiers martyrs : J. Silva et Melgarejo, puis, un groupe de la Ligue de défense. Enfin, il rejoint l’armée des libérateurs. Blessé le 19 mai, fait prisonnier, désarmé, conduit au colonel Olivares, il est achevé à coups de revolver, tandis qu’il crie : « Viva Christo Rey ! »
Washington n’ignore pas les sacrilèges, les provocations qui grossissent chaque jour les rangs de nos 50 000 libertadores : l’église de Tamaulipas volée aux catholiques et donnée aux francs-maçons, l’église de Atotonilco, centre de pèlerinage célèbre, envahie par les soudards, pillée, les statues décapitées, les confessionnaux brûlés, les autels ignoblement souillés (19 mars), les quatre églises de Saint-Miguel de Allende mises à sac par les troupes callistes et également souillées par ces nouveaux accroupis... etc. Et, contre les libertadores, à qui toutes ces infamies ont fait prendre les armes, qui donc peut ignorer les procédés mis à l’ordre du jour par le général Amaro, ministre de la Guerre et ses lieutenants, les généraux : Jaime Carrillo et Waldo Garza : prisonniers fusillés, blessés achevés, emploi des gaz asphyxiants ?... Dans le rancho de San Isidro, combattants et non combattants, vieillards, femmes, enfants, bétail... tout a été ainsi asphyxié tandis que, dans « los Altos », on bombarde avec les avions fournis par les É.-U., des villages entiers, massacrant des centaines de civils pour atteindre quelques libertadores [42].
Washington n’ignore rien de tout cela, et néanmoins, note la présidente de la Ligue des Femmes Catholiques des États-Unis dans une lettre ouverte au président Coolidge demeurée sans réponse : les relations de la Maison Blanche, de notre ambassadeur, avec les persécuteurs s’affirment plus intimes que jamais ; nous envoyons « l’idole du peuple américain », le colonel Lindbergh, donner un témoignage de notre amitié à cet homme taré dont le livre de Brigido Caro (P. E. Calles dictator bolchevique de Mexico, Los Angeles, 1924) nous dit la sinistre carrière : instituteur à Guaymas (Sonora), chassé par les parents pour sa brutalité et sa conduite... devenu, grâce à son oncle, Alexandre Elias, trésorier municipal, cassé pour malversation, tenancier d’hôtel, commissaire véreux, à Agua Prieta, sous Madero... Voilà l’homme que nous protégeons...
Au Congrès panaméricain de La Havane, continue le Boletin, les États-Unis ont empêché de prendre en considération le mémoire signé par 10 000 Mexicains exilés, établissant les innombrables excès du dictateur. La même influence boycotte la lettre pastorale des évêques américains, organise la conjuration du silence, menace l’Espagne, l’Italie, de faire tomber la peseta et la lire, sur le marché de New York, si une intervention quelconque se produit en faveur des persécutés ; c’est parce qu’il sait pouvoir compter sur ces complicités que Calles, dont les pouvoirs expirent en juillet 1928, les a fait proroger de deux ans...
– Pourquoi cet acharnement à prolonger notre martyre ? Depuis soixante-dix ans, la raison demeure la même : implanter la domination américaine au Mexique, en y déracinant le catholicisme pour lui substituer la maçonnerie et le protestantisme ; le jour où ce rêve sera réalisé, les É.-U. auront pour frontière réelle, au Sud, le canal de Panama. Qui donc dira à l’Europe que les évêques, les catholiques du Mexique sont les seuls défenseurs de leur pays contre l’étranger, les seuls vrais patriotes ? Qui osera dire au monde où se trouve la clé de la tragédie mexicaine [43] ?...
CINQUIÈME PARTIE
La réaction du monde civilisé
Les appels répétés de Pie XI à la conscience du monde civilisé [44], s’ils se perdent dans le silence de la grande presse et des gouvernements, n’en suscitent pas moins un mouvement d’ardente sympathie dans les milieux catholiques.
J’ai parlé de l’exemple donné à tous par les catholiques des États-Unis [45]. Notons encore très brièvement quelques faits qui sauvent l’honneur de l’humanité.
I – LES CATHOLIQUES D’AMÉRIQUE
Argentine. – Au mois d’août 1926, de la seule ville de Buenos Aires, douze télégrammes de protestation sont adressés à Calles, par les principaux groupements catholiques : jeunesses catholiques, masculine et féminine, jeunesse universitaire, cercles catholiques, groupant 30 000 ouvriers, Union Populaire Argentine, Ligue des Dames catholiques et 365 sociétés adhérentes, Tiers-Ordre de Saint-François, etc. Voici le télégramme de l’institut de Culture Catholique :
Président Calles ; Catholiques Argentins protestent énergiquement contre décrets iniques vexatoires des libertés élémentaires de la conscience humaine. – La barbarie russe est en fête, la civilisation et ses libertés en deuil.
Les délégués des mêmes groupements portent à la Légation mexicaine leurs protestations tandis qu’on distribue à la foule des milliers de tracts et de brochures.
Uruguay. – Articles et pétitions remplissent, dès le 1er août 1926, les colonnes du Bien Public de Montevideo ; de grands meetings populaires flétrissent les attentats de Calles.
Chili – Le 1er août, la Jeunesse Catholique de Santiago organise un grandiose meeting auquel prennent part toutes les œuvres, tous les partis politiques conservateurs. Les discours terminés, un immense cortège gagne la Légation mexicaine et remet au consul les vœux de l’Assemblée qui sont, ensuite, envoyés à toutes les Jeunesses de l’Amérique du Sud : celles-ci, par câblogramme, envoient leur adhésion.
Colombie. – Protestations semi-officielles.
Le 31 juillet 1926, une Commission diplomatique de l’Amérique du Sud demande une entrevue à Calles et le supplie, au nom de l’humanité, de mettre fin à la persécution, l’engageant à nommer une « Commission » médiatrice pour arbitrer le conflit.
À la prise de possession du nouveau président de la Colombie [46], le 7 août, le Dr Rengifo, président du Sénat, en présence du ministre de la Légation mexicaine, flétrit « certains gouvernements » qui poursuivent la tâche antipatriotique de brimer les sentiments religieux du peuple, sentiments auxquels la Colombie doit sa prospérité croissante. Le ministre du Mexique se fâche, menace et se tait.
Brésil. – Au collège des avocats de Rio de Janeiro, réunis dans les premiers jours d’août 1926, plusieurs discours sont prononcés, en présence de l’ambassadeur mexicain, où en condamne durement une législation qui révolte la conscience du Brésil. L’ambassadeur menace de réclamer ses passeports... et se tait.
Pérou. – Protestations officielles. – Le seul gouvernement civil [47] qui ait eu l’honneur de prendre officiellement la défense des catholiques mexicains est celui du Pérou. Le 3 août 1926, le président, Dr Auguste Leguia, écrit à S. Exc. Plutarco Elias Calles une lettre très digne :
Au nom de la fraternité américo-latine, je supplie Votre Excellence de rétablir l’harmonie avec l’Église, de mettre un terme aux déchirements actuels, d’éviter par là pour votre peuple des malheurs pires que ceux de la guerre...
Dieu voit mes intentions : je n’écris à Votre Excellence que dans le but de faire cesser le deuil des vrais catholiques...
À quoi le sieur Plutarco Elias, dit Galles, Mexicain depuis une génération, répond sans sourciller :
Et, d’abord, je me dois d’interpréter le message de Votre Excellence comme une démarche purement personnelle qui ne peut en rien signifier une immixtion d’un pouvoir étranger dans les affaires intérieures de mon pays. Mais je dois informer Votre Excellence qu’elle est évidemment abusée par des informations inexactes. Les calomnies du clergé portent seules la responsabilité de tous les maux qui ont affligé le Mexique aux diverses époques de son histoire, et le prétexte fut toujours qu’il ne pouvait observer les lois du pays. Auxquels blasphèmes je réponds : Si Dieu est la raison suprême de la bonté des individus et des nations, je ne crois pas qu’il soit du côté de ceux qui, depuis plus d’un siècle, déchaînent sur le Mexique les calamités intérieures, les invasions, les intrigues internationales, et troublent les consciences. La Constitution mexicaine n’est pas une loi spéciale, mais un code général et fondamental que j’ai le devoir et la volonté de faire respecter sans crainte des interdits ni des châtiments surnaturels.
Le loup de la fable n’est pas plus facétieux.
Canada. – En la Nouvelle-France, au mois de janvier 1928, le député libéral, M. Charles Marsil, de la province de Québec, dépose, sur le bureau de la Chambre une résolution demandant à son pays de rompre toutes les relations avec le gouvernement mexicain, oublieux des lois de l’humanité.
II – LES CATHOLIQUES D’EUROPE
La Jeunesse Catholique Internationale. – Le Comité International des JC, réuni à Bonn, en juin 1926, invite toutes les associations affiliées à provoquer un mouvement en faveur des catholiques mexicains.
Au mois d’août, les revues de l’association publient le communiqué du Secrétariat International et demandent que tous, répondant enfin à l’appel de Pie XI, organisent, sous la direction de l’épiscopat, une active propagande en faveur des persécutés.
L’Espagne, dès 1917, proteste par la voix de son épiscopat contre la persécution carranziste. En mai 1926, le même épiscopat, les journaux et les œuvres catholiques envoient à leurs frères de la Nouvelle Espagne des adresses d’ardente solidarité. En juillet, le journal El Debate, de Madrid, réclame, au nom des honnêtes gens, la « pleine liberté » de manifester contre la « barbarie illégale » de Calles. En effet, la censure militaire de Primo de Rivera sévit contre toutes les manifestations hostiles au persécuteur.
Cependant, la Jeunesse Catholique de Saragosse prend, en octobre 1926, l’initiative d’un meeting, d’où toutes les œuvres d’action catholique envoient une adresse au gouvernement, le suppliant d’intervenir ; au consul général mexicain lui reprochant les sophismes par lesquels il trompe la presse et le peuple espagnol. Enfin, un Comité Permanent d’action pour le Mexique est organisé qui lance partout de semblables meetings.
La Junte centrale d’Action Catholique féminine, présidée par la comtesse de Gavia, s’adresse enfin au gouvernement royal. Le 12 novembre, le gouvernement de Sa Majesté répond : il déplore la persécution ; des instructions seront données aux agents diplomatiques afin qu’ils fassent ce qui est humainement possible pour adoucir les rigueurs de la Constitution mexicaine et interviennent énergiquement lorsque seront molestés les sujets espagnols ; mais le gouvernement ne saurait envahir le terrain réservé au pouvoir spirituel de l’Église représenté par la Nonciature...
La Junte d’Action Catholique de Barcelone insiste, s’adresse à Primo de Rivera, lui envoyant un mémoire détaillé sur les atrocités mexicaines.
Fin décembre, le dictateur répond : son gouvernement a transmis à Mexico la lettre collective des évêques. Quant à intervenir lui-même, il ne le pourra « qu’avec la mesure commandée par les relations amicales qui unissent les deux gouvernements ».
En Belgique, la Jeunesse Catholique et son président, J. Hoyois, nous donnent un exemple d’action méthodique : campagne de presse, réunions d’études et conférences se succèdent. Une adresse de solidarité est expédiée avec cette adresse télégraphique : Archevêque, Mexico. Le central télégraphique de Mexico se donne le ridicule de renvoyer le télégramme avec cette mention : « Retourné pour adresse insuffisante. » Le télégramme est réexpédié avec le nom de la rue et le numéro.
Une protestation contre la barbarie de Calles est remise au consul mexicain de Bruxelles. Une Agence d’Information fournit à la presse belge des données précises, documente les équipes de jeunes conférenciers. Le premier meeting tenu à Bruxelles, le 17 septembre, est présidé par le ministre Carton de Wiart, et donne naissance au Comité Belge de Protestation. Un appel de ce Comité, à la nation, est signé par le ministre Carton de Wiart, plusieurs anciens ministres, des députés, des sénateurs, des recteurs de Faculté, etc.
C’est encore la JC belge qui demande à Pie XI d’introduire la cause des jeunes martyrs tombés pour la foi.
On ne s’étonne pas, après cela, que le Comité national de la JC, invité à faire le pèlerinage de Rome pour les fêtes de saint Louis de Gonzague, réponde que cela est impossible, toutes ses ressources étant engagées dans la défense des catholiques mexicains.
Enfin, voici le P. Butten, O. P., qui plaide, devant le Sénat belge, la cause du Mexique (23 fév. 28).
Sans s’immiscer, dit-il, dans la politique intérieure des États, n’est-il pas des droits, des libertés, patrimoine commun de l’humanité, dont le respect intéresse tous les États ?
Comment excuser le silence glacial gardé par les gouvernants en face des sévices qui broient les catholiques mexicains ?
Serait-ce parce que celles-ci ne représentent aucun intérêt financier ou commercial, et n’incarnent que le droit des minorités, de la liberté de conscience ?
On croyait, jadis, à une hiérarchie des valeurs, et les grandes nations d’Europe se seraient déshonorées en n’assurant pas la suprématie à ces hautes valeurs morales et civilisatrices que sont le respect de l’idéal, de la conscience, de la liberté et de la faiblesse.
Serait-il donc vrai qu’aujourd’hui tout cela ne vaut pas une concession de source pétrolifère, et que les seules valeurs vraiment intéressantes sont celles qui sont cotées à la Bourse ? Et n’est-il pas pénible de voir, qu’à part de rares exceptions, la presse catholique a été seule à protester contre le régime dont souffrent nos frères du Mexique ?
En réponse à ce réquisitoire, vivement applaudi par la droite, à laquelle se sont joints des libéraux et plusieurs socialistes, M. Hymans se borne à formuler des vœux pour la concorde et la paix religieuse au Mexique ! Son langage résume, hélas ! celui de tous les chefs d’États.
En France, le 15 décembre, la Croix publie un message de l’épiscopat à nos frères persécutés ; La Fédération Nationale Catholique expédie, à son tour, une touchante adresse de solidarité, tandis qu’une grande affiche, d’un mètre de haut, est placardée sur les murs de Paris : « On fusille, au Mexique. »
Au mois de mars 1928, à l’occasion de l’emprisonnement de Mme Lescuram de Silva, présidente des Femmes catholiques mexicaines, les Femmes catholiques d’Alsace, la Ligue des Femmes Françaises, la Ligue Patriotique, protestent contre les attentats mexicains et le servilisme de la grande presse...
Au mois de mars 1928, l’épiscopat français envoie une nouvelle adresse de solidarité à l’épiscopat mexicain :
Les sanglantes épreuves par lesquelles vous passez, la France les a connues, à la fin du XVIIIe siècle. Les martyrs des Carmes, que l’Église vient d’élever sur les autels, ont été mis à mort pour avoir refusé d’accepter une Constitution schismatique du clergé...
Nous souffrons avec vous, nous prions pour vous. Nos cœurs battent à l’unisson des vôtres...
Le Mexique aura désormais, dans les annales de l’Église, des pages glorieuses, dignes des actes des martyrs des premiers siècles du christianisme.
Votre cause est notre cause. Elle est celle de toutes les nations catholiques...
Que dis-je ? Votre cause est celle de l’humanité tout entière, car les droits pour lesquels vous combattez sont les droits sacrés de la conscience, que l’homme tient, non de l’État, mais de Dieu même, et dont l’inviolabilité intéresse toute l’humanité...
Pauvres nous-mêmes, puisque nous ne vivons que des dons charitables de nos fidèles, nous avons tenu, cependant, à venir fraternellement au secours de votre détresse, et nous vous prions d’accepter le modeste subside que nous serons heureux de votes adresser. Ce sera l’offrande des évêques et des prêtres de France à leurs frères persécutés du Mexique.
En conséquence :
L’assemblée des cardinaux et archevêques a prié tous les évêques de France de demander aux prêtres de leurs diocèses respectifs de vouloir bien verser chacun, s’ils le peuvent, une offrande de cinq francs.
Allemagne. – Au mois d’août 1926, lors du Congrès des catholiques tenu à Breslau, présidé par le Nonce et le chancelier Marx, le président proteste contre la barbarie de Calles et adresse un message de sympathie aux victimes de ce sanglant Kulturkampf. Le 10 août 1926, 80 000 catholiques de la province de Brandebourg, réunis à Berlin pour leur vingt-quatrième Journée Catholique, envoient un télégramme de solidarité à l’archevêque de Mexico. Deux jours plus tard, l’épiscopat, réuni à Fulda, expédie un télégramme semblable, tandis que le Volksverein publie un livre de 132 pages, signé J. Echeveria, sur la persécution.
En Irlande, le maire de Wexford et son Conseil invitent toutes les municipalités irlandaises à s’unir à eux pour flétrir le « terrorisme bolchevique » de Calles.
Angleterre. – Le Congrès annuel des catholiques, tenu le 23 septembre 1926, à Manchester, et où toutes les œuvres religieuses et sociales sont représentées, expédie deux messages : l’un, de protestation à Calles, l’autre, d’admiration à l’épiscopat mexicain.
En mars 1927, un grand meeting pro-mexicain supplie les deux gouvernements d’Angleterre et des États-Unis de flétrir, au nom de l’humanité, les sauvageries de Calles ; au mois d’avril 1928, l’épiscopat anglais envoie une lettre de solidarité à l’épiscopat mexicain.
En Écosse, à Édimbourg, dans un meeting de protestation (mars 1928), Mgr Graham, M. Donovan exposent, en s’accompagnant de projections, la tyrannie des persécuteurs mexicains. À la fin de la conférence, un homme se lève, s’approche de Mgr Graham et déclare :
– Je viens du Mexique, je suis protestant et franc-maçon, mais je peux témoigner de la vérité de tout ce que M. Donovan a affirmé. J’aime le peuple mexicain, et je ressens pour lui la plus profonde compassion.
Hollande. – Au Congrès de La Haye (5 déc. 1926), au Congrès des œuvres ouvrières, où 110 000 travailleurs sont représentés, de semblables protestations s’élèvent, tandis qu’à Varsovie, au théâtre du Colisée, les catholiques supplient leur gouvernement d’intervenir.
Hongrie. – Les catholiques de Budapest tiennent, le 19 février 1926, un meeting de protestation. Le prince-primat de Hongrie, cardinal Sérèdi, salue les martyrs, et les députés Aladar Krüger, Étienne Haller, ancien ministre, dénoncent les cruautés du gouvernement mexicain, en appellent à la conscience de l’humanité civilisée muette en face de ces crimes. « Où sont, s’écrie le ministre, Haller, les Ligues toujours à l’affût d’un tort à redresser ? Pourquoi se taisent-elles, et où est la Société des Nations, qui prétend prendre la protection des opprimés ? »
Enfin, le comte Albert Apponyi combat ce lâche principe : qu’il faut se taire sur la politique intérieure des autres pays. « Que ferait-on si un pays rétablissait l’esclavage ? Il y a une solidarité de la conscience humaine, et l’État souverain n’échappe pas à son verdict. »
III – LA PRESSE LAÏQUE
Ce sera la gloire du monde chrétien d’avoir été à peu près seul à élever la voix en faveur des droits de l’homme, foulés aux pieds par la barbarie mexicaine. Une fois de plus, apparaît l’identité, éloquemment affirmée par Taine, de ces deux termes : Christianisme et Civilisation.
Quelques voix, cependant, commencent à s’élever de sphères non spécifiquement chrétiennes.
Le Petit Bleu, par exemple (17, 3, 28), publie un article méritoire :
Les persécutions, ou plus exactement les massacres, continuent au Mexique. Une dépêche de presse signale qu’un prêtre vient d’être fusillé, ainsi que cinq autres chefs catholiques. Détail poignant : ce prêtre fut exécuté, alors qu’il était à genoux, priant avec ferveur, pour que le sang versé fût désormais épargné...
De telles mœurs sont-elles dignes d’un pays civilisé ? Comment les hommes dignes de ce nom peuvent-ils, par haine religieuse ou même politique, en arriver à de telles abominations ?... La conscience humaine s’insurge contre ces abominables folies qui déshonorent les gouvernements capables de s’oublier à ce point.
Et comment accepter, dans les capitales d’Europe, que ces gouvernements soient représentés par des fonctionnaires accrédités ! Le silence serait une honte devant ces crimes barbares, et une insulte à la civilisation.
À la même date, l’Avenir publie un loyal résumé des évènements :
... Cet ancien magister (Calles), à cerveau étroit et à volonté têtue, se cabre à l’idée qu’on ose demander la réforme de la Constitution mexicaine de 1917. Toucher à l’arche sainte du laïcisme, quelle audace !
Et voici le contenu de cette arche sainte, vrai bazar de notions arbitraires et contradictoires...
Il est superflu d’analyser plus en détail le document sorti du cerveau fumeux des constituants de Queretaro, le 31 janvier 1917. Un mot résume leurs hantises et leurs passions : pour les catholiques, point de droit commun ! S’ils crèvent sous le joug des lois d’exception, tant mieux ! S’ils vivent, au moins seront-ils esclaves...
Plutarco Elias Calles devait à son passé d’instituteur d’oser plus que personne ; après quelques mois de réserve, il décida de presser l’exécution littérale des articles antireligieux de la Constitution, sauf à oublier toutes les autres. À deux reprises, en 1926, il enrichit même de lois nouvelles le code de la tyrannie. De cette conception obtuse du gouvernement, et de cette volonté féroce, est né le conflit qui, depuis deux années, a fait du Mexique une arène sanglante.
Je pourrais recueillir, dans la presse neutre, une douzaine d’articles semblables... Mais, qu’on soit ainsi réduit à compter sur les doigts, lorsque l’affaire Dreyfus, l’affaire, Ferrer, l’affaire Sacco-Vanzetti suscitèrent des millions d’articles, quand le moindre fait divers de criminalité passionnelle mobilise reporters, journalistes, photographes, envahit les colonnes des grands quotidiens ! Ce silence et cette indifférence sont la plus terrible sentence de déchéance que la civilisation ait portée sur elle-même depuis un siècle.
Il semble qu’elle commence à en avoir conscience.
Un journaliste américain, M. Michaël Williams, écrivait à Bernard Shaw, le grand dramaturge irlandais, dont on sait qu’il n’a rien d’un catholique, pour lui demander « de prendre la tête d’une protestation mondiale de la pensée libre contre les massacres du Mexique, et d’une enquête sur place par une Commission indépendante de publicistes de toutes nations. » Bernard Shaw a accepté.
À Londres, le Daily Telegraph (9 avril 28), pris d’un beau sentiment d’émulation, annonce qu’il va envoyer un Correspondant, au Mexique, pour lui fournir des informations sincères [48].
SIXIÈME PARTIE
Le bilan du Bolchevisme mexicain
Deux ans ont passé, depuis ce mois de février 1926, où le président dictateur Calles inaugurait un régime de bolchevisme antireligieux en proclamant patriarche du schisme national un défroqué de soixante ans, en intronisant, dans les rues de Mexico, le culte de la déesse Raison sous les espèces de sa propre fille, en envoyant par radio à tout le Mexique le discours du Trône où la jeune souveraine annonce un nouvel âge d’or.
Les vrais Mexicains sifflèrent les acteurs de cette sarabande, mais, le lendemain, paraissaient les circulaires ministérielles ordonnant de briser, par tous les moyens, la résistance catholique.
La bataille fut menée, depuis lors, par le magister Calles tout enivré de sa prompte fortune, le ministre des Affaires étrangères, un pasteur protestant, célèbre par ses excentricités, le ministre du Travail Morones, ouvrier communiste, véritable président du Conseil, le ministre de l’Agriculture, un toréador...
Dès le début, Tchitcherine et l’ambassadeur des Soviets à Mexico, Stanislas Pesthovsky, rendirent à Calles le témoignage qu’il entendait parfaitement et pratiquait à merveille les doctrines soviétiques.
À quoi ont-elles abouti au Mexique ? Au même résultat qu’en Russie ; qu’on lise, dans Moscou sans voiles, la déposition émouvante de M. J. Douillet, ancien consul de Belgique en Russie...
Les exécutions capitales « ont lieu chaque nuit du mardi au mercredi, chaque semaine, toute l’année durant ». Chacune des innombrables prisons « a son mardi » et même plusieurs « mardi, par semaine ».
Et, à côté de ces abattoirs, les tchékistes et les clubistes font bombance, abusent des femmes « qu’ils vont choisir parmi les détenues ».
D’un côté : l’orgie, la plus ignoble tyrannie, exercée par une poignée de brutes ; de l’autre, un peuple torturé, avili, réduit à un esclavage dont la Rome païenne ignora les horreurs.
Cela se passe en l’an de grâce 1928.
Dans son discours de Serpoukho, le 17 août 1920, Lénine prévenait son monde : « La liberté n’est qu’une invention bourgeoise !! » Sept ans après, Trotsky déclare : « Le régime actuel n’est pas une dictature du prolétariat, mais une dictature personnelle », un gouvernement reposant sur ces deux étais : 1 750 000 fonctionnaires et l’armée rouge ; nulle garantie des droits individuels : liberté de la presse, d’association, d’opinions... inexistantes ; les élections, le suffrage universel, une abominable comédie.
Un tel régime a accumulé les justes sujets de révolte plus vite que nul régime de droit divin. La crise de l’URSS se manifeste dans tous les domaines : religieux, moral, social, politique, pédagogique, international. Même faillite au Mexique.
I – FAILLITE ÉCONOMIQUE
Tandis que la Maçonnerie socialisante occupe tous les postes, toutes les sinécures, que pullulent généraux, colonels et capitaines, que se multiplient, à leur usage, lieux de prostitution, cabarets, maisons de jeu, fumeries d’opium et jusqu’aux sanglants divertissements du cirque, le pain manque, en un pays qui pourrait être le grenier de l’Amérique. Les Chambres de Commerce constatent qu’il a fallu importer, en une année de Révolution, pour 240 millions d’objets de première nécessité : blé, maïs, graisse, savon... Les mines chôment, le peuple s’expatrie pour manger et donner à ses enfants une éducation morale et religieuse.
Le banditisme envahit le pays. M. F. MacCullagh rapporte qu’en juin 1927, la police ne pouvait assurer l’ordre aux portes mêmes de la capitale et que les Anglais n’osaient plus s’en aller à leur terrain de golf. Occupé à dépister les catholiques qui assistent à la messe, l’inspecteur général de police, Roberto Cruz, laisse en paix les bandits qui pullulent dans les montagnes voisines de Mexico.
Un groupe de bandits, opérant sur la grand-route de Cuernavaca, à 30 kilomètres de la capitale, a arrêté les voitures et délesté les voyageurs de tout ce qu’ils possédaient. Deux cents bandits auraient arrêté 54 automobiles, dont l’une était occupée par des soldats de la troupe fédérale, lesquels furent promptement désarmés.
De New York, on mande, le 27 mars 1925 : Samedi dernier, des bandits arrêtèrent et dépouillèrent environ 200 personnes qui passaient en autos sur la route de Mexico à Puebla, à quelque 40 kilomètres de la capitale...
C’est à un retard tout à fait imprévu que l’ambassadeur des É.-U. devrait de ne pas être tombé aux mains des bandits.
II – FAILLITE SOCIALE
Les lois agraires dont s’enorgueillit Calles sont basées sur la Constitution de Queretaro (1917). Par elle, sont justifiées les mesures en cours : morcellement des haciendas en lots, saisies de biens, surveillance de la propriété étrangère, etc. Quant à la façon brutale dont il interprète la loi, par ses décrets, il en portera la lourde responsabilité. Selon l’usage, le dictateur réunit, chaque année, la Chambre pour une session de quelques mois qu’on passe à s’injurier, à fréquenter les cafés, après quoi le jeu est terminé, et le dictateur se fait donner pleins pouvoirs, pour légiférer, par voie de décrets.
Or, ses décrets agraires ont été portés avec un mépris tout soviétique des droits acquis, des intérêts généraux et des véritables intérêts paysans...
Le dernier texte, publié le 27 avril 1927, interdit de posséder plus de 375 acres de terrain. L’article consacré aux lots a pour but de rendre, par expropriation, aux villages indiens les anciens Communaux dont l’État les dépouilla.
Mais le dictateur a négligé les détails suivants : fournir à l’Indien les instruments d’achat et de culture ; lui donner le sens de la propriété. Le paysan indien a été, jusqu’ici, habitué à compter sur son maître. Aujourd’hui, ce paysan, dépourvu de capital et de crédit, méfiant de la Banque rurale officielle qui le gruge plus que l’usurier professionnel ; ne comprenant rien aux écritures, n’utilise pas les terrains expropriés que le fermier dépossédé ne cultive pas davantage... Résultat : les friches envahissent le pays.
Les Cercles agricoles vont changer tout cela ! affirme Calles ; mais, pour l’instant, on y fait plus d’anticléricalisme que de pratique agricole. Et comme cet anticléricalisme se traduit, quotidiennement, par des fusillades, les Indiens catholiques passent par milliers le Rio Grande, émigrent vers les États-Unis, cèdent la place aux immigrants chinois et japonais.
Et ceux qui s’en vont, avoue le général Lopez, gouverneur de Guerrero, sont les meilleurs paysans, les ouvriers qualifiés.
Combien en est-il parti ainsi ? Deux millions, trois millions, ne craignent pas d’affirmer des Mexicains informés.
Le système des lots communaux, bon en soi, devient meurtrier, par la volonté de brimer les anciens propriétaires. Voici le système courant :
Le maire d’une commune voisine se présente accompagné d’une Commission professionnelle à la porte d’une hacienda de... 300 hectares.
– Nous allons, señor, découper, dans votre terre, un lot communal de 100 hectares.
– Mais il n’y a pas de commune dans le voisinage pour en prendre livraison...
– On en fondera une...
– En attendant ? La moisson est mûre... Elle périra. Attendez la moisson.
– Non, tout de suite. Et nous prenons les 100 hectares au centre de la propriété.
– J’ai là mes granges ; de plus, les Indiens du futur village, pour gagner le lot, avec leurs troupeaux, piétineront les récoltes.
– Peu importe...
Ces agriculteurs ambulants ont ainsi ravagé plusieurs États, notamment celui de Nayarit.
Excédés, les grands propriétaires, après les petits, abandonnent la partie, vendent leur terre à vil prix, à la grande joie de Calles, d’Obregon et autres généraux de fraîche date, qui, hier faméliques, possèdent maintenant d’immenses domaines où on ne fait pas de lot.
Ajoutez à cela les innombrables actes d’arbitraire des gouverneurs.
Le 29 juin 1928, le député Trévino ne craint pas de dénoncer à la tribune les sauvages exploits du général Montes. Ce gouverneur de 1’État de Puebla pratique une méthode inédite. Entouré de bandes d’agrariens, il retire les terres aux cultivateurs suspects de modérantisme pour les donner à ses partisans.
Le gouverneur de Nayarit, général de la Pena, fait mieux : lui et ses agrariens, pour être sûrs d’une tranquille possession, commencent par massacrer les propriétaires, puis partagent leurs terres... Par malheur, ils ont commis la distraction de tuer deux Américains, ce qui a ému le gouvernement et causé le rappel du général massacreur.
Troisième tare du régime actuel : la xénophobie.
Par sa loi sur les étrangers : Ley de Extranjera, Calles expulse les étrangers des régions les plus fertiles, les côtes.
Nul étranger ne pourra acheter de terres à moins de 50 kilomètres de la côte ou 100 kilomètres de la frontière. Les étrangers possédant déjà des terres dans la zone prohibée ne peuvent les léguer ou les vendre qu’à des Mexicains, et, si l’acheteur mexicain ne se présente pas, ce qui est le cas habituel, c’est l’État qui hérite.
Cette loi a ravagé la côte Ouest, les régions de Sonora, de Sinaloa, de Tepic, de Michoacan, la côte Est, la frontière Nord jusqu’ici, en grande partie, exploitée par des Américains. Application imprévue de la doctrine de Monroe... qui pourrait, un de ces jours, brouiller Calles avec l’oncle Sam.
Qu’il y eût quelque chose à faire, la chose est certaine, et les catholiques sociaux s’en préoccupaient, mais Calles est un horloger qui manie des ressorts de montre avec des pinces monseigneur et des tenailles de charpentier.
Même remarque pour les lois ouvrières. Le syndicalisme de classe était jusqu’ici embryonnaire. Pour le développer, Calles commence par supprimer ou rendre impossibles les Syndicats chrétiens, puis pousse, sans préparation ni transition, le monde ouvrier vers les Syndicats communistes de la CROM, organise des Comités soviétiques d’arbitrage.
Résultat : la lutte des classes se déchaîne partout : grèves, chantages, désordres, conflits perpétuels où la police et les juges savent qu’il faut toujours donner raison au Soviet. Bénéfice de cette législation impulsive ? Les employeurs embauchent le moins possible et au jour le jour. L’ouvrier est payé davantage, mais la cherté de vie gagne en vitesse la hausse des salaires.
Les mines du Chihuahua ont à peu près cessé toute activité, le nombre des chômeurs augmente chaque jour.
Comme, par ailleurs, les lois ouvrières ferment la frontière aux capitaux étrangers, et que les capitaux mexicains émigrent, un arrêt presque universel du travail ne tardera pas à se produire avec son cortège habituel de misère et de désordres [49].
Or, les œuvres religieuses d’assistance détruites, nul ne sera là pour secourir les infortunés.
L’Église, qui avait couvert le Mexique d’écoles, de collèges, d’Universités, l’avait également couvert d’œuvres d’assistance.
Pendant cent ans, la révolution a ruiné, pierre à pierre, ce magnifique édifice. Calles lui donne le dernier coup : hôpitaux, refuges, orphelinats, sont sécularisés, confisqués, fermés. Comme on n’a rien à mettre à la place, les malades, les vieillards rejoignent dans la rue les écoliers expulsés des écoles catholiques.
Vent-on savoir avec quelle brutalité se font les exécutions ? Voici un trait, entre cent, raconté par le Wall Street Journal (1er Sept. 27) :
À Tacuba, près de Mexico, une bienfaitrice laisse une rente, un immeuble, pour fonder un hôpital de vieillards, spécifiant dans le contrat que l’établissement sera confié à des religieuses. Or, le 25 mai, les quatorze religieuses, jeunes encore pour la plupart, sont arrêtées, bien qu’elles ne portent plus l’habit religieux. Roberto Cruz les fait enfermer, non dans une prison de femmes, mais dans une caserne où on les met en chambre au milieu des soldats... La señora Cruz, qui est catholique, supplie son mari de délivrer les prisonnières. Pour toute réponse, l’inspecteur général de la police envoie un avoué à la Mère supérieure avec un papier à signer qui abandonne l’hôpital, les fondations, les terrains au gouvernement... Larmes, protestations. « Si vous refusez, insiste Cruz, vos jeunes religieuses seront laissées un temps indéfini entre les mains des soldats. »
Devant cette perspective, la pauvre femme signe. Relâchées, mais expulsées de leur hôpital, sans feu ni lieu, les quatorze religieuses doivent chercher un abri auprès de catholiques compatissants...
L’asile de vieillards de Popolla, l’asile Colon, l’asile Josephino... assistent à des scènes d’une autre sorte. Deux crimes y ont été commis : ce sont des religieuses qui soignent les vieillards indigents, les orphelins, et elles ont un oratoire ! La troupe se présente, expulse les religieuses et fait jeter à la rue petits vieux et petites vieilles, orphelins et orphelines.
III – FAILLITE PÉDAGOGIQUE
En dépit de l’opposition gouvernementale, les catholiques ont réussi à conserver environ 6 000 écoles jusqu’à la révolution [50] actuelle. Au mois de février 1928, le gouvernement en ferme 500. Le même mois, le ministre Téjéda déclare publiquement : « Nous ne nous arrêterons que lorsque toutes les écoles et tous les collèges catholiques du Mexique auront été fermés. »
À chaque fermeture d’école, l’immeuble et le matériel sont confisqués. Par ailleurs, les immeubles des écoles officielles étant trop peu nombreux, de même que les maîtres, les milliers d’écoliers expulsés sont dans la rue.
D’après le ministre de l’Instruction publique, José Puig Casauranc : « Dans les États de la République où le Département de l’éducation n’a pas juridiction, 2 millions d’enfants d’âge scolaire ne fréquentent aucune école ; les gouvernements de ces États manquent des moyens financiers voulus pour remédier à cette situation. » (El Universal.)
Avoir fermé les écoles catholiques lorsque les 95 pour 100 de notre peuple sont absolument illettrés est un crime contre la patrie (El pais, 16 avril 26). Quant à l’enseignement donné dans les écoles officielles, il est laïque, athée, antireligieux, stupide et immoral... À des gamins de dix ans, ne sachant pas lire, on bourre la mémoire de dissertations révolutionnaires : thèses civiques et morales, faisant l’apologie du divorce, du bolchevisme, exposant les détails les plus scabreux de l’éducation sexuelle [51]. (Excelsior, 11 février 1927.)
CONCLUSION
Espérances et Devoirs
– LE RÔLE SOCIAL DE L’ÉGLISE MEXICAINE
J’ai dit que le problème agraire se posait depuis longtemps au Mexique avec une singulière gravité.
On demeure étonné qu’un pays quatre fois grand comme la France, aux inépuisables richesses, n’ait qu’une population de 15 millions d’habitants.
Le régime de l’immense propriété, l’absence de culture intensive, ne permettaient qu’à un nombre restreint de travailleurs de vivre sur le sol. Même ceux-là n’y vivaient souvent que misérablement.
En somme, situation agraire assez semblable à celle de la Russie avant la révolution communiste.
L’Église ne demeurait pas indifférente à cet état de choses quoi que prétende Calles, en lui reprochant d’avoir oublié l’Encyclique Rerum Novarum.
Qu’on lise, à l’appendice, la lettre collective de l’épiscopat américain : l’Église mexicaine, malgré les persécutions qui la désolent, la paralysent et la dépouillent depuis un siècle, est à l’origine de tout ce qui a été fait de sérieux pour l’organisation sociale.
La question ouvrière, le problème agraire, la préoccupaient, alors que les politiciens, sauterelles du Mexique, n’avaient d’autre souci que de la brimer et s’enrichir de ses dépouilles. Ce n’est pas seulement en France que l’anticléricalisme fut un moyen de « berner le prolétariat ».
Dès 1903, aux Congrès de Mexico, de Puebla, les catholiques élaborent des projets sur les banques coopératives agricoles, les unions ouvrières, l’émancipation des Indiens, l’apprentissage. En 1909, le Congrès d’Oaxaca s’attache particulièrement au problème Indien.
Ce fut un groupe de délégués catholiques au Congrès de Mexico qui voulut donner un statut légal aux unions ouvrières, établir le repos dominical, fixer des indemnités pour les accidents du travail. Dans l’État de Jalisco, en 1912, les catholiques, formant la majorité de la Chambre, promulguent des règlements garantissant les droits de propriété des femmes et des enfants, les droits des minorités, accordant un statut légal aux syndicats ouvriers.
En mars 1913, le Parti catholique national, réuni à Guadalajara, discute un programme où figurent ces questions : l’autonomie municipale, le problème agraire, les banques rurales coopératives, etc.
À leur Assemblée plénière, tenue à Zamora en 1913, les Unions ouvrières catholiques du Mexique adoptent des résolutions demandant déjà tout ce qu’il y aura de juste dans l’article 123 de la Constitution de 1917.
Non seulement ils sont précurseurs, mais ils vont plus loin que cet article, quant à la protection des droits ouvriers.
La révolution n’a rien inventé. Ce qu’il y a de sensé, en son programme social, elle l’a emprunté à l’Église, comme elle lui emprunta ses hôpitaux, ses écoles, ses Universités, ses bibliothèques.
En somme, les catholiques sociaux jouèrent au Mexique le même rôle qu’en France. Ils semèrent et leurs adversaires moissonnèrent, en gâchant la moisson.
Que cet apostolat social ait mobilisé un trop petit nombre d’apôtres, qu’il se soit heurté au scepticisme, à l’hostilité de cette « égoïste et jouisseuse », que le comte A. de Mun dénonça si souvent et à laquelle Léon XIII annonçait les « rigueurs » de la justice immanente [52] ; que les Léon Harmel, les Albert de Mun de là-bas, comme ceux d’ici, aient souvent parlé dans le désert ; que le clergé, n’ait pas toujours prêté une suffisante attention aux avertissements des Souverains Pontifes sur cet « objet le plus important de l’action catholique, la solution de la question sociale, qui mérite l’application la plus énergique et la plus constante de toutes les forces catholiques » [53] ; que le clergé et les fidèles absorbés par le jeu des compétitions politiques engagé sous leurs yeux, aient, parfois, attendu de l’action dictatoriale d’un Huerta ou d’un Porfirio Diaz la solution d’une crise qui, avant d’être une question politique ou économique, était « une question morale et religieuse » [54], la chose est possible et même, si l’on veut, certaine. Mais les catholiques français ont-ils le droit de s’en scandaliser, et les persécuteurs du Mexique le droit de s’en prévaloir, eux qui n’eurent qu’une pensée, annihiler l’Église, paralyser son action dans le domaine social, et qui lui doivent le peu qu’ils savent d’utile ?
... La tourmente passera, laissant d’immenses ruines.
II – L’HEURE DE L’ÉGLISE
Et ce sera l’heure de l’Église, cette éternelle infirmière des sociétés malades.
Elle arrivera, sur un terrain renouvelé, débarrassé des végétations parasitaires. Son vœu de voir la foule des humbles sortir de cet état de « misère imméritée » auquel le régime agraire et les autres causes signalées la tenaient asservie ; ses efforts pour organiser, en face d’une oligarchie bourgeoise égoïste et sectaire, une véritable force populaire, pénétrée d’esprit chrétien, connaîtront des succès imprévus.
Ce qui le fait espérer, c’est que, malgré ses malheurs ou ses égarements, l’âme mexicaine demeure, en somme, profondément chrétienne.
Le communisme russe eût-il duré si longtemps s’il eût trouvé, en face de lui, des légions de chrétiens comparables à ceux qui, au Mexique, luttent et meurent pour leur foi ?
Et puis, nous, croyants, ne savons-nous pas que le sang des martyrs est une semence ?
Dans son Encyclique Iniquis Afflictisque consacrée à la persécution mexicaine, Pie XI, après avoir rappelé les faits, flétri la barbarie des persécuteurs, réclamé à nouveau, en faveur des persécutés, les prières du monde catholique, rend un magnifique hommage à l’héroïque fidélité des catholiques mexicains. Il signale et loue les œuvres nées de la persécution ou fortifiées par elle. Puis, rappelant que, depuis vingt siècles, les épreuves de l’Église n’ont servi qu’à étendre ses conquêtes, il affirme qu’il en sera de même pour l’Église mexicaine.
Dans ce splendide monument de solidarité chrétienne qu’est leur Lettre du 12 décembre 1926, les évêques des États-Unis redisent à leurs frères mexicains la même affirmation.
Oui, l’Église mexicaine, taillée durement, sortira, des mains du vigneron, purifiée, fortifiée, fécondée.
Dès maintenant, elle agenouille devant elle l’admiration du monde catholique et de toutes les nobles âmes.
Si j’ai parlé des causes de l’épreuve, avec liberté, c’est pour être vrai : surtout pour que les catholiques, en qui j’ai voulu éveiller des remords, ne s’endorment pas trop aisément.
L’épreuve déjà longue ne finira point par enchantement ; elle paraît même redoubler de rigueur. Le devoir de tout homme de cœur est d’agir, dès maintenant ; de réparer l’inconsciente cruauté d’une trop longue inattention.
Par la prière, sans doute, mais aussi par la plume, la parole, par des démarches auprès des pouvoirs publics, venons en aide à un peuple martyrisé. Sa cause est la nôtre.
Communistes, socialistes, révolutionnaires, sectaires de tous les pays, comprennent la solidarité qui les unit aux terroristes.
Serons-nous moins clairvoyants ?
La démarche courageuse des Chevaliers de Colomb auprès du président Coolidge nous est une leçon.
« Nous voulons, disent-ils dans le mémoire remis au président [55], faire parvenir à nos concitoyens un mot d’avertissement. Qu’ils ne permettent pas, à la porte des États-Unis, la russification du Mexique... »
Les catholiques des États-Unis, clergé et fidèles, nous ont donné l’exemple de courageuse solidarité qu’il faudrait suivre.
Ils n’ont pas craint de faire entendre à leurs gouvernants les plus dures vérités.
Il y a dans ce courage civique une leçon.
Des protestants, des Israélites américains se sont honorés en joignant leur voix à celle des catholiques.
Que tous les honnêtes gens pour qui les mots d’humanité, de justice, de liberté ne sont pas des vocables creux, unissent leurs voix à celles de la libre Amérique, et ce sera, après les mérites des martyrs mexicains, le meilleur moyen de dissiper l’horrible cauchemar d’un peuple égorgé, en une terre jadis arrosée de sang français.
Terminons par ces paroles du message des évêques américains à l’épiscopat mexicain, à la suite de leur réunion de 1926 :
Vous donnez au monde entier l’exemple du véritable esprit des martyrs, prêts à supporter, pour la cause du Christ, toutes les souffrances.
Vous êtes, au Mexique, les champions des libertés civiles et religieuses.
Contre la force armée, vous défendez les droits de l’homme.
Cette lutte peut être longue [56]. Elle ne se terminera que par la victoire de la liberté et de la justice.
En pleine Révolution française, en 1795, un écrivain de génie, un voyant, Joseph de Maistre, ne craignait pas d’écrire : « L’esprit religieux n’est pas éteint en France ; il y soulèvera des montagnes ; il y fera des miracles. »
Ce n’est pas nous, ce sont les évènements que nous venons d’étudier, c’est l’héroïsme des catholiques mexicains qui imposent une pareille conclusion. « L’esprit religieux n’est pas éteint au Mexique ; il y soulèvera des montagnes ; il y fera des miracles. »
APPENDICE I
L’Encyclique Iniquis afflictisque de S. S. Pie XI
sur la persécution mexicaine (18 nov. 1926)
Nous donnons ici, d’après la Documentation Catholique (26 mars 1927), de larges extraits de l’Encyclique :
Nécessité d’implorer la miséricorde divine. Elle seule
peut arrêter un tel déluge de maux [57].
Dans l’allocution par Nous adressée ; vers la fin de l’année dernière, aux cardinaux réunis en Consistoire, Nous avons dit que Nous n’espérions ni n’attendions que « d’un prompt secours du Dieu de miséricorde » quelque adoucissement à l’état de choses injuste et affligeant pour le nom catholique, dans la République mexicaine...
Elle seule soutient l’héroïsme des catholiques mexicains,
dignes d’être glorifiés devant l’univers catholique.
Qu’il ne vous semble pourtant pas, Vénérables Frères, avoir prescrit en vain ces supplications sous prétexte que les dirigeants de la République mexicaine, inspirés par leur haine implacable de la religion, ne laissent point de presser, avec un nouvel acharnement et une brutalité croissante, l’exécution de leurs décrets impies : ce qui est vrai, c’est que le clergé et les nombreux catholiques de là-bas, fortifiés par une plus abondante effusion de la grâce, ont offert, en leurs personnes, un tel exemple et un tel spectacle que Nous-même croyons devoir le mettre en lumière, comme il le mérite, à la face de l’univers catholique, par un document solennel de l’autorité apostolique.
Le mois dernier, au jour où Nous décernâmes à ces nombreux martyrs de la Révolution française les honneurs qui sont dus aux bienheureux du ciel, Notre pensée s’envolait d’elle-même vers les catholiques mexicains, qui ont, tout comme eux, pris la résolution et fait le ferme propos de se montrer réfractaires aux exigences d’autrui jugées arbitraires et tyranniques, et cela, pour ne point se séparer de l’unité de l’Église et de l’autorité du Siège, Apostolique...
LES ÉTAPES DE LA PERSÉCUTION
Les discordes de 1914 et 1915.
Nous estimons superflu, Vénérables Frères, de remonter bien haut dans l’histoire de l’Église mexicaine pour en retracer les phases douloureuses. Contentons-Nous d’en rappeler une seule, celle des discordes civiles qui éclatèrent tout récemment et à plusieurs reprises, non sans troubler chaque fois la religion et la bouleverser, comme il advint, surtout en 1914 et 1915, alors que des hommes en qui s’était perpétué quelque chose de la sauvagerie primitive se livrèrent sur les membres du clergé séculier et régulier, sur les vierges consacrées à Dieu et sur les choses réservées au culte divin, à des actes si féroces et si barbares qu’ils ne s’abstinrent d’aucune injustice, d’aucune ignominie, d’aucune violence.
Renvoi des délégués apostoliques.
... Il Nous paraît inopportun de Nous répandre avec vous en doléances sur ce qui s’est vu en ces dernières années : Nos Délégués apostoliques au Mexique renvoyés de ce pays au mépris de toute notion de justice, de bonne foi et d’humanité, celui-ci expulsé de la République, celui-là empêché d’y rentrer après s’être retiré quelque temps au delà des frontières pour des raison de santé ; cet autre enfin, également traité en ennemi, et sommé de partir... Ce sont là sans doute de dures et lourdes épreuves. Mais le tableau que Nous allons tracer de la violation des droits de l’Église et du sort plus malheureux que jamais des catholiques de cette nation dépasse tout ce qu’il est possible d’imaginer.
LA CONSTITUTION DE 1917
La Séparation qu’elle prononce entre l’Église et l’État
n’est qu’un monstrueux attentat contre la liberté religieuse.
Examinons d’abord la fameuse loi portée en 1917 et appelée Constitution politique des États fédérés du Mexique. Relativement au point particulier qui nous intéresse, il résulte du décret de Séparation de la République d’avec l’Église que celle-ci n’a plus et ne peut plus acquérir ultérieurement aucun droit, comme si elle était frappée d’incapacité civile. Les magistrats ont reçu le pouvoir de s’immiscer dans l’exercice du culte et la discipline extérieure de l’Église, lesquels relèveraient de leur autorité. Les ministres sacrés sont mis sur le même pied que tous les autres citoyens, à professions libérales ou manuelles, avec cette différence toutefois qu’ils doivent remplir les trois conditions suivantes : être Mexicains de naissance, ne pouvoir point excéder en nombre un certain chiffre fixé d’avance par les législateurs de leurs États respectifs, perdre enfin leurs droits civils et politiques, comme les criminels et les aliénés. Il leur est ordonné en outre d’aller, avec une Commission de dix citoyens, notifier au magistrat leur entrée en possession d’une église ou leur transfert dans un autre lieu. Les vœux de religion, les Ordres ou Congrégations religieuses ne sont plus autorisés au Mexique. Le culte public y est prohibé, sauf à l’intérieur des églises et sous la surveillance du gouvernement ; les églises même sont déclarées propriétés nationales ; palais épiscopaux, demeures canoniales, Séminaires, maisons religieuses, hôpitaux et tous établissements de bienfaisance sont également soustraits à l’Église. Elle ne garde plus la propriété de quoi que ce soit : tout ce qui lui appartenait au temps où la loi fut ratifiée est dévolu à la nation, avec faculté pour tous et pour chacun de dénoncer devant les tribunaux les biens que l’Église semblerait posséder par personne interposée. En vertu de la loi, il suffit d’une simple présomption et l’action judiciaire est fondée. Les ministres sacrés ne peuvent rien acquérir par voie testamentaire, si ce n’est ce qui leur revient de leurs plus proches parents. Nul pouvoir n’est reconnu à l’Église touchant le mariage des chrétiens, lequel est seulement regardé comme valide s’il est reconnu comme tel par le droit civil. Sans doute, l’enseignement est proclamé libre, mais avec les restrictions que voici : défense aux prêtres et aux religieux d’ouvrir ou de diriger des écoles élémentaires ; exclusion absolue de la religion dans les écoles enfantines, même privées. Il a été décrété encore que les certificats scolaires donnés par l’Église dans les institutions dirigées par elle seraient dépourvus de toute valeur officielle...
La protestation calme et ferme
de l’épiscopat était légitime.
Or, après la promulgation d’une loi si odieuse, comment les archevêques et évêques du Mexique auraient-ils pu se résoudre à garder le silence ? Le fait est qu’ils protestèrent tout aussitôt en des lettres empreintes d’une sereine énergie : protestation que ratifia Notre prédécesseur immédiat, puis qu’approuvèrent les évêques, en certains pays, collectivement ; en d’autres, presque tous individuellement ; que Nous confirmâmes enfin Nous-même le 2 février de cette année, par une lettre d’encouragement adressée à tous les avenues mexicains...
LA LOI CALLES DU 2 JUILLET 1926
Elle ravit à l’Église les derniers vestiges de liberté.
Mais, nonobstant l’extrême patience dont témoignèrent le clergé et le peuple, suivant en cela les conseils de modération que leur donnaient les évêques, tout espoir de paix et de tranquillité finit par s’évanouir. Car, conformément à la loi promulguée par le président de la République le 2 juillet de cette année, presque aucune parcelle de liberté ne reste ni n’est laissée à l’Église dans ces contrées. L’exercice du saint ministère y est tellement entravé qu’on le punit de peines très sévères à l’instar d’un crime capital...
Parmi ces lois, la dernière en date s’est ajoutée à une autre loi antérieure, non point tant pour l’interpréter, comme on l’a prétendu, que pour l’aggraver encore et la rendre plus insoutenable ; et le président de la République, secondé de ses ministres, en presse si vivement l’application qu’il ne peut souffrir, de la part de ses subordonnés, gouverneurs des États fédérés, magistrats ou commandants militaires, le moindre ralentissement dans la persécution contre les catholiques. Et à la persécution se joint l’insulte. On a pris l’habitude d’incriminer l’Église aux yeux du peuple, ici, en des conférences publiques, par d’impudents mensonges, tandis que les huées et les injures couvrent la voix des nôtres et les empêchent de faire entendre la réplique ; là, au moyen de journaux, ennemis déclarés de la vérité et de l’action catholique. Si, au début, les catholiques ont pu tenter, dans une certaine mesure, de défendre dans les journaux quotidiens l’Église et d’en faire l’apologie, en exposant la vérité et en réfutant les erreurs ; désormais, à ces bons citoyens qui aiment sincèrement leur patrie, il n’est plus permis d’élever, même inutilement, leurs voix plaintives pour la liberté de la foi ancestrale et du culte divin.
Elle donne le signal des pires injustices,
des mesures les plus arbitraires.
On a expulsé les prêtres et les religieux étrangers, fermé les collèges pour l’instruction chrétienne des enfants de l’un ou de l’autre sexe, parce qu’ils portent un nom religieux ou renferment quelque statue ou image pieuse, fermé pareillement et en masse Séminaires, écoles, hôpitaux, couvents et maisons annexes des églises. Dans presque tous les États, le nombre des prêtres destinés à exercer le ministère sacré a été restreint et fixé au minimum : encore ceux-ci ne peuvent-ils même pas l’exercer s’ils ne sont inscrits sur les rôles du magistrat ou sans sa permission. En quelques lieux on a imposé à l’exercice du ministère des conditions telles qu’elles seraient risibles si elles n’étaient déplorables sous tant d’autres rapports : il est exigé, par exemple, que les prêtres aient tel âge, qu’ils aient contracté le soi-disant mariage civil, qu’ils ne baptisent qu’avec de l’eau courante. Dans l’un des États de la Fédération, il a été décrété qu’il ne devait y avoir sur son territoire qu’un seul évêque : c’est pour cela, Nous le savons, que deux évêques durent s’exiler de leur diocèse. La situation qui leur était faite contraignit aussi par la suite d’autres évêques de quitter leur siège ; certains furent déférés aux tribunaux, plusieurs arrêtés, et ceux qui restent enfin sont sur le point de l’être. On somma tous les Mexicains éducateurs de l’enfance et de la jeunesse ou chargés d’une autre fonction publique de répondre si, oui ou non, ils étaient avec le président de la République et approuvaient la guerre faite à la religion catholique. On les força, sous peine de révocation, de prendre part, avec les soldats et les travailleurs, au cortège organisé par la ligue socialiste appelée Fédération régionale ouvrière du Mexique. Ce cortège, qui défila le même jour à travers les rues de Mexico et des autres villes du pays, et que signalèrent des discours impies adressés au peuple, avait pour but, tout en accablant l’Église d’outrages, de faire approuver par les applaudissements et les acclamations de la foule présente l’action du président lui-même.
Ceux qui protestent sont emprisonnés, assassinés.
Le cruel arbitraire de nos ennemis ne se borna point là. Des hommes et des femmes qui défendaient la cause de la religion et de l’Église, de vive voix ou au moyen de journaux et de tracts par eux distribués, furent traînés en justice et emprisonnés. Emprisonnés également des Chapitres entiers de chanoines, parmi lesquels des vieillards que l’on dut transporter sur des civières. On tua sans pitié, dans les carrefours et sur les places, devant les églises, des prêtres et des laïques.
LA RÉSISTANCE CATHOLIQUE
Ferme attitude de l’épiscopat.
On ne pouvait douter que les évêques mexicains ne dussent essayer unanimement de tous les moyens disponibles pour défendre la liberté et la dignité de l’Église. Ils commencèrent par adresser au peuple une lettre collective. Après y avoir prouvé clair comme le jour que l’amour de la paix, la prudence et la patience n’avaient jamais cessé d’inspirer le clergé dans son attitude vis-à-vis des chefs de la République et qu’il avait même témoigné de dispositions trop libérales, en tolérant des lois peu conformes à la justice, ils rappelèrent aux fidèles, non sans la leur expliquer, la doctrine de la constitution divine de l’Église, l’obligation qu’il y avait pour eux de persévérer dans la religion catholique, et ainsi d’« obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes [58] », chaque fois que l’on voudrait leur imposer des lois non moins contraires à la notion même et au nom de loi qu’en désaccord avec la constitution et la vie de l’Église.
Puis, quand le président de la République eut promulgué la loi néfaste, ils publièrent une nouvelle lettre collective, de protestation, celle-là, où ils disaient qu’accepter une loi pareille, c’était ni plus ni moins asservir l’Église et la livrer comme une esclave aux chefs de l’État, lesquels ne renonceraient point, pour ce motif, à leurs desseins. Nous préférons, ajoutaient-ils, nous abstenir d’exercer publiquement le ministère sacré : par conséquent, le culte divin, qui ne peut se célébrer sans le ministère des prêtres, sera complètement suspendu dans toutes les églises de nos diocèses, à partir du 31 juillet, jour où cette loi entrera en vigueur.
Sur ces entrefaites, le gouvernement fit constituer gardiens des églises des laïques choisis par les chefs des municipalités avec défense absolue de charger de ce soin quiconque aurait été nommé ou désigné par les évêques ou les prêtres. C’était faire passer des autorités ecclésiastiques aux autorités civiles la possession des édifices du culte. Alors la plupart des évêques interdirent aux fidèles une fonction élective qui pourrait leur échoir par l’organe de l’autorité civile et leur défendirent de pénétrer dans les temples sur lesquels l’Église aurait cessé d’exercer son pouvoir. Ailleurs, les évêques prirent d’autres décisions, vu la différence des circonstances locales et particulières.
Ne pensez pas toutefois, Vénérables Frères, que les évêques mexicains, dans le doute ou pour mieux dire le désespoir d’arriver au moindre bon résultat, aient négligé les occasions opportunes et les moments favorables pour ramener les esprits au calme et tenter une conciliation. N’est-il pas avéré que les évêques présents à Mexico, où ils sont comme par procuration les fondés de pouvoir de leurs collègues, écrivirent au président de la République une lettre polie et respectueuse en faveur de l’évêque d’Huejutla, que l’on avait traîné indignement et avec un grand déploiement de forces utilitaires dans la ville de Pachuca ? C’est un fait non moins notoire que le président leur répondit d’une odieuse façon et sur le ton de la colère.
Peu après, plusieurs personnages éminents, désireux de la paix, étant intervenus pour provoquer une entrevue du président lui-même avec l’archevêque de Morelia et l’évêque de Tabasco, on discuta beaucoup et longtemps d’un côté comme de l’autre, mais sans aucun résultat.
Tous les efforts de conciliation ayant été épuisés,
la résistance passive est le seul recours possible.
Les évêques délibérèrent ensuite sur la question de savoir s’il y avait lieu de demander à la Chambre législative l’abrogation des lois contraires aux droits de l’Église ou de continuer comme par le passé en toute patience la résistance dite passive, car il leur semblait tout à fait inutile de présenter une pareille requête. Ils présentèrent néanmoins la pétition, que des catholiques très compétents en matière de droit avaient rédigée judicieusement, après en avoir pesé les termes avec le plus grand soin. Sur l’initiative des sociétaires de la Fédération pour la défense de la liberté religieuse, dont Nous parlerons plus loin, un très grand nombre de citoyens des deux sexes avaient apposé leur signature au bas de cet acte épiscopal. Mais les évêques avaient bien prévu ce qui devait arriver : l’Assemblée nationale rejeta, à l’unanimité moins une voix, la pétition qui lui avait été soumise sous prétexte que les évêques étaient privés de toute personnalité juridique, avaient fait appel au Souverain Pontife, et refusaient de reconnaître les lois de la nation. Que restait-il donc aux évêques, sinon de décider que rien ne serait changé dans la ligne de conduite observée par eux et par les fidèles tant que les lois injustes ne seraient pas abolies ?...
À ce propos, si Nous faisons réflexion que parmi les quatre mille prêtres du Mexique, malgré toutes sortes de moyens mis en œuvre là-bas, malgré les efforts tentés et les tracasseries employées par nos adversaires en vue de séparer de la hiérarchie sacrée et du Siège Apostolique le clergé et le peuple, il s’en est à peine trouvé un ou deux pour trahir misérablement leur devoir, Nous sommes fondé, pensons-Nous, à tout espérer du clergé mexicain ; Nous les voyons, en effet, ces prêtres, se tenir étroitement unis entre eux, obéir avec une affectueuse déférence aux ordres de leurs prélats, bien que cette attitude ne laisse pas généralement de leur causer un grave dommage ; Nous les voyons vivre de leur saint ministère, c’est-à-dire pauvrement, l’Église n’ayant plus de quoi les sustenter ; supporter courageusement la pauvreté et la misère ; célébrer privément le saint sacrifice ; pourvoir de toutes leurs forces aux besoins spirituels des fidèles ; entretenir et ranimer chez tous ceux qui les entourent la flamme de la piété ; enfin, par leurs exemples, leurs conseils, leurs exhortations, élever les esprits de leurs concitoyens vers un plus noble idéal...
Les faits parvenus à Notre connaissance en ces derniers jours l’emportent en iniquité sur les lois elles-mêmes et atteignent au comble de l’impiété : les prêtres sont assaillis à l’improviste, lorsqu’ils célèbrent la messe chez eux ou chez les autres ; on outrage ignominieusement la sainte Eucharistie et l’on jette en prison jusqu’aux ministres sacrés.
LES LAÏQUES
Une armée de défense groupée autour du clergé :
Les associations.
Nous ne louerons jamais assez les courageux fidèles du Mexique...
Nous devons un hommage tout particulier aux associations catholiques, qui constituent dans la crise actuelle pour le clergé et à ses côtés une espèce d’armée auxiliaire, puisque leurs membres s’efforcent, autant qu’ils le peuvent, non seulement de pourvoir à l’entretien des prêtres et de leur venir en aide, mais encore de veiller sur les édifices sacrés et d’apprendre le catéchisme aux enfants ; véritables soldats de garde, ils se donnent pour mission d’avertir les prêtres afin que personne ne soit privé de leur assistance. Ce que Nous disons là s’applique à toutes sans exception mais il Nous plaît d’y ajouter quelques mots touchant les principales associations de ce genre pour leur faire savoir que chacune d’elles est pleinement approuvée et hautement louée par le Souverain Pontife.
La Société des Chevaliers de Colomb.
La première de toutes, la Société des Chevaliers de Colomb, s’étend à la République entière : elle se compose en grande partie d’hommes actifs et laborieux aussi recommandables par leur expérience des affaires que par la profession publique de leur foi et leur zèle à se porter au secours de l’Église ; elle dirige spécialement deux œuvres plus opportunes à notre époque que ne le fut jamais aucune autre par le passé ; c’est d’abord l’Association nationale des Pères de famille, ayant comme programmes de procurer une éducation catholique aux propres enfants de ses adhérents et de revendiquer pour les parents chrétiens le droit naturel d’élever les leurs à leur guise, et, là où ceux-ci fréquentent les écoles publiques, de leur donner une saine et complète instruction religieuse ; c’est ensuite la Fédération pour la défense de la liberté religieuse, définitivement établie quand il apparut avec une évidente clarté qu’un véritable déluge de maux menaçait la vie catholique. Une fois que cette Fédération se fut répandue dans toute la nation, ses membres travaillèrent avec concorde et persévérance à l’organisation de tous les catholiques et à leur formation...
L’Association catholique de la Jeunesse mexicaine.
La Fédération catholique des Femmes mexicaines.
Deux autres Sociétés n’ont pas moins bien mérité de l’Église et de la patrie que les Chevaliers de Colomb : l’Association catholique de la Jeunesse mexicaine et l’Union ou Fédération catholique des Femmes mexicaines. L’une des spécialités de leurs programmes respectifs est de collaborer à l’œuvre dite de l’Action catholique sociale. Tout en poursuivant le but qui leur est propre, elles ne laissent pas d’appuyer et de faire en sorte que l’on appuie partout les initiatives prises par la Fédération pour la défense de la liberté religieuse...
Héroïsme et martyre des fidèles.
Ils ne sont point rares, en effet, comme Nous l’avons dit, les Chevaliers de Colomb, les chefs de la Fédération, les femmes et les jeunes gens que des piquets de soldats conduisirent enchaînés à travers les rues, pour les jeter ensuite en d’infectes prisons ; ils ne sont point rares ceux qui sont traités brutalement, condamnés à payer l’amende et punis de diverses peines. Bien plus, Vénérables Frères, quelques-uns de ces adolescents et de ces jeunes gens – et, en le racontant, Nous ne pouvons retenir Nos larmes – sont allés à la mort de leur propre gré, avec, à la main, leur chapelet, et sur les lèvres des invocations au Christ-Roi. Nos vierges eurent à subir, dans leur prison, d’indignes outrages, que l’on divulgua tout exprès pour intimider les autres et les détourner de leur devoir.
MOTIFS DE CONFIANCE
Dieu veille sur son Église.
Quand est-ce donc, Vénérables Frères, que le Dieu de toute bonté imposera des bornes et mettra un terme à cette calamité ? Personne ne peut ni le soupçonner ni le prévoir par le propre effort de sa pensée ; la seule chose que Nous sachions, c’est qu’un jour, pour l’Église du Mexique, le repos succédera à cette tempête de haine...
Et puis le Christ, qui seul est tout-puissant, fait servir au bien de l’Église toutes les persécutions auxquelles sont en butte les catholiques ; car, dit saint Hilaire, « c’est le propre de l’Église de vaincre quand elle est persécutée, d’éclairer les esprits quand on l’attaque, d’étendre ses conquêtes quand on l’abandonne ».
Ainsi en sera-t-i1 pour l’Église du Mexique,
mère de la civilisation en ce pays.
Si tous ceux qui, dans la République mexicaine, s’acharnent contre leurs propres frères et concitoyens, coupables seulement d’observer la loi de Dieu, se remémoraient et considéraient attentivement, en dépouillant leurs préjugés, les vicissitudes historiques de leur patrie, ils seraient forcés de reconnaître et de confesser que tout ce qu’il y a chez eux de progrès et de civilisation, tout ce qu’il y a de bon et de beau, tout cela, à n’en point douter, tient de l’Église son origine. Nul ne l’ignore, dès qu’une communauté chrétienne eut été établie au Mexique, les prêtres et les religieux, que l’on y persécute aujourd’hui avec tant de dureté et d’ingratitude, travaillèrent – au prix d’immenses fatigues, et nonobstant mille difficultés que leur imposaient d’un côté les colons, dévorés par la fièvre de l’or, et de l’autre les indigènes, encore barbares – à répandre abondamment en ces vastes régions la splendeur du culte divin, les bienfaits de la foi catholique, les œuvres et institutions de charité, les Écoles et les collèges pour l’instruction et l’éducation du peuple sur toutes matières : lettres, sciences sacrées et profanes, arts libéraux et métiers manuels.
Prière à Notre-Dame de Guadalupe.
Nous n’avons plus, Vénérables Frères, qu’à implorer Notre-Dame de Guadalupe, célèbre Patronne de la nation mexicaine, et à la supplier de vouloir bien oublier les outrages dont elle aussi fut abreuvée, et obtenir à son peuple par son intercession le retour de la paix et de la concorde. Si cependant, par un mystérieux dessein de Dieu, ce jour tant désiré devait tarder longtemps encore, qu’elle daigne consoler pleinement les âmes des fidèles mexicains et fortifier leur résolution de défendre jusqu’au bout leur liberté de professer la foi...
PIE XI, PAPE.
APPENDICE II
Lettre pastorale de l’épiscopat des États-Unis
12 novembre 1926,
en la fête de Notre-Dame de Guadeloupe.
Celte lettre, signée par plus de cent cardinaux, archevêques et évêques, est adressée aux vingt millions de catholiques des États-Unis. Nous en publions des extraits d’après la Documentation catholique (26 mars 1927) :
... Le grand cœur du peuple américain n’a jamais refusé sa sympathie à ceux qui souffrent pour les droits de la conscience. Il sent presque d’instinct que toute oppression est la ruine de l’unité nationale, une source intarissable de méfiances et de haines entre les nations et les peuples, un outrage à la cause des ententes internationales et de la paix du monde. Si donc, en tant qu’évêques américains, nous n’avions, pour publier cette lettre pastorale, que la seule raison de notre profonde sympathie pour les souffrances du peuple mexicain durant la persécution qui s’est actuellement déclenchée contre la religion dans ce pays, nous serions déjà amplement justifiés. Mais il est d’autres raisons, d’une importance et d’une urgence plus grandes, qui nous imposent le devoir de parler. Ces raisons, nous les trouvons tout d’abord dans le fait que le Mexique est notre voisin – ce qui lui donne tonte la puissance dont le voisinage renforce un bon ou un mauvais exemple ; – qu’il constitue une république qui devait à l’origine se modeler sur la nôtre ; qu’il est enfin une nation à population chrétienne, dont le dévouement envers l’Église catholique mérite spécialement d’émouvoir la charité des fidèles du monde entier, mais aussi et surtout de ceux des États-Unis.
Des raisons plus graves encore nous imposent la publication de cette pastorale ; c’est le sentiment profond de nos devoirs envers les principes qui doivent former la base de tout gouvernement légitime, principes qui affirment les droits accordés à l’homme non par les États, mais par Dieu lui-même. Personne, et, moins que tous, les évêques de l’Église que le peuple mexicain presque entier reconnaît commue son autorité spirituelle, ne peut être indifférent quand ces principes vitaux sont attaqués audacieusement et cruellement comme ils le sont actuellement au Mexique...
Nous parlons dans l’intérêt aussi bien de l’Église
que de l’État [59].
Le devoir de parler librement et publiquement de la persécution religieuse qui fait actuellement rage au Mexique nous paraît d’autant plus impérieux que le Père commun de la chrétienté, Pie XI, Vicaire de Jésus-Christ, a prié les fidèles du monde entier de s’unir à lui par le cœur et la prière pour implorer Dieu en faveur de l’Église éprouvée...
Un autre motif, encore plus pressant, nous oblige à parler. Le présent conflit est, en effet, comme un épisode d’une guerre entreprise au Mexique contre la religion voici près d’un siècle : mais, avec une violence bien supérieure à ceux qui l’on précédé, il ne vise à rien de moins qu’à détruire la divine constitution de l’Église ; car on veut la réduire à la situation d’un corps schismatique, placé sous le contrôle de l’État, la priver du droit de donner l’éducation, la formation professionnelle et l’instruction à ses propres clercs, de les recruter en nombre suffisant pour les besoins des âmes, de trouver les moyens de subsister, de développer des œuvres en rapport avec sa mission de charité et d’enseignement, d’appliquer enfin les maximes de 1’Évangile à la formation de la conscience nationale. Une triste expérience aussi bien que la droite raison nous enseignent quelle serait la conséquence du succès d’une telle entreprise et ce qu’il signifierait pour l’Église, de même que pour l’État.
Contrôlée et enchaînée comme le pouvoir civil s’efforce de la contrôler et de l’enchaîner, l’Église mexicaine pourrait être nominalement séparée de l’État ; de fait, elle ne serait plus qu’un département politique dans la machine gouvernementale. Ses dignités et ses fonctions formeraient le casuel des politiciens, et sa voix se modulerait au gré des évolutions de la politique. Elle serait un objet de mépris pour ses fidèles, et ses ennemis n’auraient à bon droit pour elle que des risées. Le lien de son union avec l’Église universelle serait d’abord relâché, puis complètement brisé. Le gouvernement mexicain demande à l’Église d’accepter un esclavage qui, aujourd’hui, ne serait en somme qu’une infection contractée dans un voisinage malsain et, dans l’avenir, une maladie mortelle qui, fatalement, ferait disparaître l’Église de la vie du peuple mexicain.
Nous parlons aussi bien en Américains qu’en catholiques.
Au point de vue temporel, les conséquences n’en seraient pas moins funestes. Le frein de l’influence religieuse une fois détruit, l’histoire se répéterait de nouveau pour l’État. Il oublierait ses rêves démocratiques et deviendrait un despotisme de fait. La corruption augmenterait avec le pouvoir de conférer des prébendes ecclésiastiques à des indignes. Il mériterait et subirait la haine des hommes justes du pays, le mépris des hommes justes de l’étranger. Un « Saint-Synode » faisant l’œuvre malsaine du despotisme absorberait peu à peu les forces de l’État, en usurperait les pouvoirs, car il serait le plus commode des instruments de gouvernement. Tout ce que l’idéal de l’État mexicain peut renfermer de bon irait se briser contre un des plus vieux écueils que recèlent les eaux de la vie politique.
La question qui nous occupe est donc une question vitale, autant pour l’Église que pour l’État. Si aveugles que puissent être les défenseurs de pareils plans de gouvernement, et pour leur plus grand dommage, l’Église mexicaine préfère périr, s’il le faut, en défendant sa divine constitution et les droits religieux de son peuple, plutôt que d’accepter un esclavage qui, sans parler de la honte d’une forfaiture, équivaudrait à la ruine finale de sa mission spirituelle. En fait, l’Église du Mexique n’a pas le choix entre son devoir ou son asservissement ; car le seul fait de continuer ses fonctions religieuses publiques sous ce régime tyrannique et injuste serait avouer devant le monde entier qu’elle s’y soumet et prépare son divorce d’avec l’unité catholique.
... De graves raisons nous imposent enfin l’obligation de parler en tant qu’Américains fidèlement attachés aux institutions de notre pays et les aimant pour les bienfaits qu’elles nous ont valus à tous. Du reste, par son action dans notre propre milieu, le gouvernement du Mexique ne nous permet vraiment plus de garder le silence ; car, dans sa lutte contre la religion, il opère au dehors de ses propres frontières à l’aide d’une propagande organisée dans plusieurs pays, et notamment dans le nôtre.
Nous considérons le Gouvernement mexicain
à la lumière des principes américains et chrétiens.
Par ses agents diplomatiques et consulaires aux États-Unis, ce gouvernement en appelle au peuple américain, afin de justifier sa conduite. Étrange spectacle, en vérité ! Voici donc un gouvernement étranger qui non seulement remplit notre pays de sa propagande en faveur de ses programmes et de sa politique intérieure, mais qui tente de justifier et de défendre par-devant notre nation des lois et une conduite en opposition formelle avec nos principes fondamentaux, ceux mêmes qu’ont posés les pères de notre République dans des documents impérissables. Se méprenant sur la signification de notre indulgence pour un voisin que troublaient encore les conséquences de nombreuses révolutions militaires, le gouvernement du Mexique ne craint pas d’en appeler à nos concitoyens pour se faire approuver. Pareille manière de faire équivaut en somme à vouloir être jugé par un tribunal extraterritorial ; le gouvernement mexicain veut donc plaider, non pas devant ses propres concitoyens, qui, aux termes de sa Constitution, forment le seul tribunal compétent pour le juger, mais devant des étrangers. Et ces étrangers ne revendiquent aucune juridiction sur les affaires politiques de leur voisin ; tout l’intérêt qu’ils y prennent se borne à faire des vœux pour le bien-être du peuple mexicain et pour le maintien de la paix, grâce à d’amicales relations mutuelles. Dans ces conditions, le gouvernement du Mexique n’a rien à objecter si nous étudions la cause qu’il met lui-même en jugement, à la lumière des principes américains, tels qu’on les trouve dans nos lois fondamentales, ainsi qu’a la lumière des principes chrétiens, puisqu’il en appelle à la sympathie d’un peuple de chrétiens. Et, puisqu’il affiche un grand zèle pour les progrès de l’instruction, il ne s’opposera pas non plus à ce que nous soumettions à l’épreuve de l’histoire les arguments qu’il présente à l’appui de sa cause. C’est ce que nous allons faire. De la sorte, non seulement nos propres concitoyens seront absolument au courant des intérêts en jeu, mais le peuple mexicain lui-même ne sera pas entièrement privé d’avocats devant ce tribunal auquel, en somme, bien maladroitement, du reste, ses dirigeants viennent de faire appel.
PREMIÈRE PARTIE
La liberté à la lumière des Constitutions
américaine et mexicaine.
Le gouvernement mexicain appuie sa défense sur l’affirmation répétée qu’il ne fait qu’appliquer la Constitution et les lois fondamentales de la nation mexicaine. Dès lors, rien de plus naturel que de comparer cette Constitution et ces lois avec les nôtres, dans la mesure du moins où elles touchent aux droits de la conscience. C’est évidemment le meilleur moyen d’élucider les points en litige.
Les divergences qui séparent les conceptions de la liberté civile et religieuse dans la Constitution américaine, d’une part, chez les auteurs et défenseurs de la Constitution actuelle du Mexique, d’autre part, ressortent aisément de la comparaison des deux documents. On verra de la sorte que c’est uniquement en dérobant ou en travestissant la réalité des faits en cause, que le gouvernement du Mexique entend s’assurer nos sympathies ; car tout Américain impartial et réfléchi possède, en matière de justice et de droits civils, des idées radicalement différentes de celles qui sont exprimées dans la loi mexicaine. Le contraste des documents suffit à le faire voir sans nul besoin de démonstration...
En quémandant nos sympathies et notre approbation, le gouvernement mexicain ne nous demande rien de moins que de condamner l’œuvre des pires de notre République, de témoigner notre mécontentement de la Constitution qu’ils nous ont léguée et d’en réclamer l’abrogation ; car il n’est point d’Américain qui puisse trouver la théorie mexicaine de gouvernement conforme à la justice la plus élémentaire sans répudier du même coup ses traditions et son idéal national. En invoquant les sympathies américaines, en faveur de lois et d’une conduite en opposition formelle avec nos convictions politiques les plus jalousement aimées, le gouvernement mexicain fait preuve d’une audace et d’une impertinence extrêmes...
Si nous passons, des conceptions de la liberté civile et religieuse dans les Constitutions, aux Constitutions elles-mêmes, nous nous heurtons à cet argument du gouvernement mexicain qu’il ne fait, après tout, qu’appliquer sa propre Constitution. Mais alors, il se trouve aussitôt confronté par deux faits importants : le premier est que les lois antireligieuses du pays datent bien, il est vrai, de 1857, mais qu’aucun gouvernement n’a encore tenté de les appliquer intégralement ; le second est que ces lois furent bien réaffirmées et aggravées dans la Constitution de 1917, mais que le président Carranza lui-même proposa de modifier les clauses concernant la religion ; quant au président Obregon, il n’a jamais essayé de les appliquer en totalité pendant les quatre ans de son administration. Ces deux faits montrent qu’il était tacitement reconnu combien de pareilles lois s’écartaient de la justice et s’opposaient aux vœux du peuple mexicain. Mais, puisqu’on en appelle à la Constitution, laissons de côté les questions de personnes et considérons maintenant l’instrument écrit an nom duquel ces personnes veulent justifier leurs actes. C’est donc le moment d’étudier la nature et le but d’une Constitution.
Le but d’une Constitution.
Une Constitution écrite est un instrument qui énumère et définit les droits et les devoirs du gouvernement, répartit ses différentes attributions, règle l’exercice du pouvoir et en fixe les bornes, afin que les libertés des citoyens soient respectées. Du moment que le but du gouvernement est de protéger les droits de l’homme, non de les détruire, il s’ensuit que la charte au nom de laquelle agit un gouvernement ne peut lui concéder un pouvoir illimité. Car un gouvernement qui disposerait d’un tel pouvoir serait une tyrannie, et d’autant plus qu’il chercherait davantage à détruire les droits que la loi naturelle et la loi positive de Dieu placent en dehors de la juridiction des hommes. De là, suivant la doctrine américaine courante, une Constitution donne au gouvernement les droits et les pouvoirs qui lui sont nécessaires pour le juste accomplissement de ses fonctions ; mais, en même temps, elle lui interdit d’empiéter sur les droits d’un ordre plus élevé, ceux que les hommes détiennent non du peuple, de l’État ou d’un groupe d’États, mais du Créateur et des hommes et des États, du Dieu tout-puissant. Cette conception est absolument conforme à l’enseignement de l’Église catholique.
Dès lors, il est indéniable que la protection des droits naturels et inaliénables de l’individu est un principe essentiel, une partie intégrante de la notion même d’une Constitution. Un pouvoir absolu n’a pas besoin de Constitution, car une Constitution est une garantie de liberté et non point un instrument de tyrannie...
L’homme a des droits inaliénables.
C’est justement dans cet esprit que réside la force de la Déclaration de l’indépendance, un document que tous les Américains regardent, à bon droit, comme la pierre angulaire de leur gouvernement. Avec les signataires nous tenons certaines vérités « pour être évidentes d’elles-mêmes ». Nous admettons que « tous les hommes », y compris les Mexicains, « ont reçu de leur Créateur certains droits inaliénables ; que, parmi ces derniers, il faut compter la vie, la liberté et la poursuite du bonheur. C’est à la garantie de ces droits que répond l’institution des gouvernements parmi les hommes... » Il est donc évident que les hommes détiennent ces droits, non par une tolérance ou par un don provenant d’un État quelconque, mais par un décret immuable du Dieu tout-puissant. Il n’est au pouvoir d’aucun gouvernement de les détruire ou de les entraver. Au contraire, c’est l’impérieux devoir du gouvernement de les « garantir » ; et le gouvernement qui s’y attaque doit être rejeté par tous les hommes justes. Suivant les paroles de saint Thomas, son action aboutit non pas à des lois, « mais plutôt à une sorte de violence ». Dans cette doctrine, saint Thomas et la Déclaration de l’indépendance sont en complet accord.
Mais il n’est pas aisé, ainsi que la Cour suprême l’a récemment déclaré, d’énumérer tous les droits qui sont compris sous le droit fondamental « à la vie, à la liberté, à la poursuite du bonheur ». Par contre, il est certain, comme l’a fait valoir cette même Cour dans une cause fort importante, qu’il y faut ranger le droit d’honorer Dieu suivant les prescriptions de la conscience. Observons de plus que l’interprétation constante et invariable de la Constitution fédérale par les tribunaux vient à l’appui de notre thèse que le gouvernement existe pour protéger les citoyens dans l’exercice de leurs inaliénables droits naturels et qu’il ne peut porter aucune loi qui détruise ces derniers.
L’État doit protéger ces droits.
Constamment aussi l’Église catholique a soutenu cette conception du gouvernement, quelle que soit la forme sous laquelle il s’exerce. Un pouvoir absolu sur la liberté des citoyens n’est pas une doctrine chrétienne. Ce n’est pas non plus la doctrine des pères de notre République. Ce n’est pas la doctrine de nos tribunaux, qui l’ont maintes fois rejetée. Créer une Constitution ou bien une législation qui ne laisse pas l’homme jouir de son héritage naturel de liberté n’est pas dans les attributions légitimes d’un gouvernement civil quelconque, et quelle que soit la manière dont il se soit formé. Car cet héritage échoit à l’homme par la loi naturelle, « qui est contemporaine de l’humanité », et, du moment qu’elle « est dictée par Dieu lui-même », ainsi que l’écrit Blackstone dans ses célèbres Commentaires...
Dans cet ordre d’idées, nous rappellerons ce que nous écrivions dans notre Pastorale de 1919 : « La fin pour laquelle existe l’État et dont il tire son autorité marque la limite de ses pouvoirs. Il doit respecter et protéger les droits divinement établis des individus et de la famille. Il doit sauvegarder la liberté de tous, en sorte que personne n’empiète sur les droits d’autrui. Mais il n’a aucun droit légitime d’entraver un citoyen dans l’accomplissement de ses obligations de conscience, encore moins dans l’accomplissement de ses devoirs envers Dieu.
L’homme ne peut suspendre des droits donnés par Dieu.
Ces paroles sont en plein accord aussi bien avec la loi naturelle qu’avec les lois positives de Dieu. Elles reçurent aussi l’acquiescement des pères de notre République. C’est pour leur faire rendre tout leur effet pratique qu’on adopta le Premier Amendement à la Constitution ; il y est interdit au Congrès de prohiber le libre exercice de la religion. Peu à peu des prohibitions analogues furent introduites dans les Constitutions ou les lois fondamentales (Bills of Rights) de plusieurs États. Ces garanties sont plus que de simples articles de la Constitution fédérale et des Constitutions des différents États. Elles font partie intégrante de toute charte des droits convenant à des hommes libres. L’Église ne s’est jamais prononcée contre elles ; toujours attentive à maintenir la paix et à s’opposer aux discordes, en défendant l’autorité légitime, elle n’a pourtant jamais manqué de rappeler aux gouvernements leurs devoirs envers les peuples et leur responsabilité devant Dieu. Par ses théologiens, au nombre desquels on peut citer saint Thomas d’Aquin, le bienheureux Robert Bellarmin et Suarez, elle a spécifié les droits populaires que ni l’État ni aucun gouvernement n’ont le droit d’entraver ; elle a insisté sur le fait que ces droits sont au-delà et au-dessus des statuts élaborés par les rois ou les assemblées, car ils tirent leur sanction non de la volonté ou du pouvoir d’une autorité terrestre, mais de l’autorité divine et de la dignité de l’homme, en tant qu’être pourvu d’une intelligence.
Le sanctuaire inviolable de l’âme
Le citoyen considéré isolément ne cède donc pas à la société tous les droits qu’il possède en tant qu’homme libre, ainsi que certains voudraient nous le faire croire ; il ne reçoit donc pas, en échange, une portion de ces droits, comme un don de l’État, tout en ne gardant pour lui-même qu’une souveraineté nominale, qui, en fait, est exercée par ceux qui gouvernent à sa place. Cette doctrine, bien connue des pères de la République, fut néanmoins rejetée par eux. En exigeant la soumission à une Constitution faite en dehors de toute justice par une poignée de dirigeants militaires, Constitution qui viole les droits de l’homme et ne fut jamais soumise à la ratification du peuple, le Gouvernement du Mexique veut que le citoyen pris individuellement n’ait aucun droit que le gouvernement soit tenu de respecter : les pouvoirs du gouvernement sont illimités. Aucune doctrine n’est plus certaine d’anéantir la robuste confiance d’un peuple, de semer la discorde au dedans et l’hostilité au dehors. Venant de Dieu, le pouvoir de l’État peut être conféré par le peuple, mais, ainsi conféré, il n’implique pas et ne peut impliquer ce qui n’est pas dans les attributions de l’État. Si Dieu avait ordonné que l’État dirigeât les âmes et les consciences, il aurait donné à l’État les moyens voulus pour diriger la conscience et contrôler les opérations de l’âme, puisqu’il donne les moyens nécessaires à une fin. L’État ne peut envahir le sanctuaire de l’âme et de la conscience. Or, c’est là justement ce que le gouvernement du Mexique tente de faire...
Les Américains reconnaissent les droits
et l’utilité de la religion.
Si, des Constitutions, nous passons aux lois qu’elles inspirent au Mexique ou dans notre République, c’est en meilleure connaissance de cause que nous pourrons maintenant les comparer.
Les lois américaines reconnaissent au citoyen le droit d’adorer Dieu « suivant les prescriptions de sa conscience », et, pour que cette liberté lui soit garantie, elles reconnaissent les Sociétés religieuses comme des entités corporatives légales, ayant la capacité de posséder les propriétés qui leur sont nécessaires pour l’accomplissement de leur mission. De plus, cette mission est reconnue comme étant religieuse, non seulement dans ses racines et son tronc, mais dans les fleurs et les fruits qu’elle porte, sous forme d’œuvres d’éducation et de bienfaisance sociale. Par conséquent, les Sociétés religieuses peuvent posséder des terrains et y construire tels édifices qui sont nécessaires à leurs fins. Elles peuvent établir, posséder et diriger des écoles, collèges, Universités, asiles, hôpitaux et autres établissements de bienfaisance ou d’éducation. En tant qu’entités légales, elles peuvent défendre leurs droits de propriété en recourant aux procédures légales. Elles peuvent posséder des dotations en vue de leur action et recevoir des legs. Elles peuvent avoir des Séminaires où leur clergé se forme et s’instruit. Bien plus, les propriétés qu’elles possèdent, quand elles sont employées dans un but cultuel, éducationnel ou charitable, sont, chez nous, presque partout exemptes d’impôts ; on témoigne par là non seulement qu’on les reconnaît utiles au bien de la société, mais qu’on veut transporter dans la pratique l’esprit de la volonté nationale, tel qu’il s’exprimait dans cette déclaration du Congrès continental : « La religion, la moralité, les sciences étant nécessaires au bon gouvernement et au bonheur de l’humanité, les écoles et les instruments d’éducation devront toujours être encouragés [60]. » À cet égard, les paroles de notre premier président sont éloquentes : « Et ne nous laissons pas trop bercer de cette opinion que la moralité peut être maintenue sans la religion. Quoi qu’on puisse concéder à l’influence d’une éducation raffinée sur des esprits d’une nature spéciale, la raison et l’expérience s’unissent pour nous interdire l’espoir que la moralité nationale puisse se maintenir en dehors de tout principe religieux [61]. »
Tel est l’esprit qui règne depuis la fondation de la République. Il a produit le bien de l’État et du peuple. À l’heure actuelle, personne ne songe sérieusement à le changer. On le reconnaît et l’apprécie hautement comme partie intégrante de notre vie nationale...
Cet esprit a subi l’épreuve de prés d’un siècle et demi, et, de nos jours certainement, le peuple américain est plus que jamais convaincu des avantages de son maintien. Chez nous, l’union de l’Église et de l’État n’existe pas, mais il n’y règne pas moins une pleine et franche reconnaissance des avantages de la religion pour un bon gouvernement. De là vient que l’État américain encourage la religion à contribuer de plus en plus largement au bonheur du peuple, à la stabilité du gouvernement et au règne de l’ordre.
La tentative du Mexique pour détruire la religion.
Au rebours de cet esprit, la Constitution présente du Mexique refuse à toute Société religieuse le droit à une existence corporative légale [62]. Officiellement, il n’y a pas d’Églises au Mexique ; car une Église ne peut posséder quoi que ce soit ; elle n’a pas le droit de pétition pour obtenir satisfaction de ses griefs ; elle ne peut poursuivre ou être poursuivie devant les tribunaux ; bref, elle est entièrement dépourvue de statut légal. Par le fait de leur ordination, les prêtres sont dépouillés de leurs droits civiques [63]. Une Église ne peut posséder d’édifice pour le culte public [64]. Elle ne peut posséder de dotation [65]. Elle ne peut faire de collecte ou de souscription en dehors des édifices du culte. Ces derniers sont la propriété du gouvernement, bien qu’ils soient payés et entretenus par les fidèles. Le gouvernement autorise seulement le propriétaire légitime à en user, mais suivant le bon plaisir des fonctionnaires de l’État [66]. Toutes les Églises du Mexique, par conséquent, doivent être entretenues par des collectes faites durant le service religieux. Or, les Églises reçoivent partout leur principal support des souscriptions reçues en dehors des exercices cultuels. C’est grâce à celles-ci qu’on acquitte chez nous la dépense de presque tout édifice religieux. Mais pareille manière de faire est interdite au Mexique, non par un simple règlement, mais par une clause de la Constitution [67].
Pour rendre cette clause opérante, la loi stipule qu’une Église n’a pas le droit de posséder des maisons pour ses évêques, prêtres, ministres, instituteurs ou administrateurs. Son avenir n’est pas assuré, car elle ne peut avoir un Séminaire où se forme le clergé destiné à remplir les places rendues vacantes par la mort ou l’inaptitude. Le fait qu’une Église se sert d’un édifice est considéré comme un motif suffisant pour admettre qu’il appartient réellement à cette Société religieuse. Il peut donc être saisi et confisqué. Si même un ecclésiastique loue une maison pour son usage personnel, la loi édicte qu’elle peut être saisie sur un simple soupçon. Les parents d’un ecclésiastique sont menacés de la confiscation de leurs propres biens, sous le prétexte que cette propriété appartient de fait à une Église, car la loi porte que le simple soupçon autorise en pareil cas de supposer que la propriété est détenue pour le compte d’une Église [68]. Toute propriété consacrée par des Sociétés religieuses à des buts éducationnels ou charitables est sujette à confiscation [69]. Afin qu’une Église ne puisse jouir d’aucun édifice que ce soit, il est spécifié que, en cas de saisie, l’affaire ne sera jamais déférée au jury [70].
Destruction des œuvres d’enseignement et de charité.
Une Église ne peut donc rien posséder ; elle ne peut pourvoir à ses dépenses courantes : elle ne peut recruter son clergé futur. Un clergé indigène est ainsi rendu impossible, ce qui a généralement pour conséquence de faire passer en des mains étrangères le soin religieux des populations. Mais la loi a prévu cette éventualité ; elle stipule donc qu’aucun ecclésiastique, à moins d’être né Mexicain, ne peut officier dans les exercices du culte [71] : par suite, les ecclésiastiques étrangers ont été expulsés. Ainsi donc, la loi empêche d’abord le peuple d’avoir un clergé national, puis d’en avoir un d’étranger ; et, en même temps, le gouvernement ne cesse d’affirmer devant le monde son libéralisme et l’absence de toute persécution religieuse au Mexique [72].
De pareilles lois ne font pas uniquement sentir leurs effets dans l’œuvre spirituelle de l’Église. Elles aboutissent encore à la ruine des œuvres d’enseignement et de bienfaisance. La religion favorise l’instruction. Pratiquement parlant, toutes les grandes Universités des États-Unis, par exemple, furent fondées par des organisations religieuses ; celles de l’État font exception, mais quelques-unes d’entre elles n’en doivent pas moins leurs débuts à des ministres de la religion ou à des corporations religieuses, et toutes leur doivent l’inspiration qui les fit naître. On peut affirmer que pas un tiers des Universités ou Collèges des États-Unis n’existeraient aujourd’hui si l’action éducationnelle des diverses Églises ne s’en était mêlée. Jusqu’en 1840, presque tous les hommes d’État et tous les hommes cultivés nés en Amérique furent élevés dans des écoles fondées sous les auspices religieux. Or, la Constitution mexicaine spécifie qu’aucun ecclésiastique ne peut enseigner dans une école primaire ou diriger des écoles secondaires, à moins de conditions qu’il lui serait impossible d’accepter [73]. Aucun collège privé n’a le droit de conférer des grades reconnus par l’État [74]. Tous les Ordres religieux enseignants ont été supprimés [75], et la formation d’Ordres de ce genre est déclarée illégale.
Plus tristes encore sont les effets de pareilles lois sur les œuvres de bienfaisance, un domaine où s’exerce tout spécialement l’activité religieuse. Les Églises ont toujours été et sont encore les principales génératrices du soulagement des malades et des pauvres. Aux États-Unis, plus de 60 pour 100 des lits des hôpitaux se trouvent dans des établissements religieux. Pour être bien sûre que les Églises ne s’adonnent pas à ces œuvres de miséricorde corporelle, la loi mexicaine confisque les établissements charitables et interdit l’existence de toutes les associations religieuses d’hommes ou de femmes dévoués qui se consacraient à ces œuvres. En conséquence, le Mexique est aujourd’hui plein d’établissements charitables ruinés, et ses pauvres et ses malades n’ont plus de protecteurs.
Poursuivons. La loi mexicaine autorise la presse religieuse, mais à la condition qu’elle sacrifie son indépendance. Un journal religieux ne peut critiquer les lois et même les actes des fonctionnaires publics sous peine de châtiments sévères ; ne le peuvent même pas les journaux profanes qui manifestent des tendances religieuses [76]. Plusieurs feuilles religieuses ont déjà été supprimées et même quelques quotidiens largement répandus, qui n’étaient pas religieux, mais qui témoignaient de la sympathie envers la religion. Combien de pareilles lois s’écartent de l’idéal américain, on le voit par la loi fondamentale (Bill of Rights) de la Virginie et autres documents de ce genre.
La persécution est le fruit d’un nouveau paganisme.
Il est à peine nécessaire de tirer les conclusions qui découlent naturellement du parallèle que nous venons d’établir. Elles apparaissent du premier coup et doivent convaincre tout homme et toute femme bien pensants qu’il n’y a pas d’assimilation possible entre les principes fondamentaux de la Constitution mexicaine, les lois qui les consacrent, l’esprit suivant lequel on se propose de les appliquer, et les principes, les lois et l’esprit que le peuple américain tient pour sacré.
En fait, de pareilles lois nous ramènent au paganisme. Si elles venaient à triompher, elles montreraient que la société civile a marché non de l’avant, mais en cercle ; elle reviendrait ainsi, de nos jours, au point dont elle est partie à l’aurore du christianisme. De telles lois, en réalité, consacrent le programme païen du gouvernement, car du paganisme elles ne diffèrent en rien par les effets ; elles n’en diffèrent que par la manière et les formes qu’elles prennent pour atteindre le but. Le païen de l’antiquité concédait un pouvoir despotique à l’État, car il le divinisait en son principe, souvent même en ses maîtres et ses actes. Les fondateurs de Rome passaient pour les enfants des dieux. Ses empereurs étaient salués du nom de « divin », et des autels leur furent dressés. Les mêmes honneurs échurent aux grands hommes de la Grèce...
Le paganisme unissait donc le pouvoir temporel et le pouvoir divin dans un État qu’il divinisait. Mais, dans son programme, notre néo-paganisme élimine le divin et ne laisse place qu’au temporel. Le résultat de ces deux extrêmes n’en est pas moins identique : l’esclavage de l’individu. On voit aussitôt combien tout ceci est loin de nos convictions et d’Américains et de chrétiens.
DEUXIÈME PARTIE
Ce que l’Église a fait pour le Mexique.
Une cause qui pour se défendre devant le peuple américain doit dissimuler les intimes mobiles de ses actes ne reculera pas devant le mensonge ; elle tentera même d’escamoter l’histoire. Par suite, il ne faut pas s’étonner de rencontrer des accusations, ni prouvées ni prouvables, contre le rôle joué par les missionnaires catholiques, alors qu’ils implantaient la religion et la civilisation au Mexique. Ces calomnies sont d’autant plus aisées que la grande majorité des citoyens qui les lisent ou les entendent n’ont ni le temps ni les moyens de les vérifier ; ils les acceptent donc comme l’expression de faits historiques incontestés. Certains s’imaginent ainsi, et la propagande du gouvernement mexicain encouragea de son mieux pareille croyance surtout dans nos établissements d’enseignement, que ces missionnaires ont détruit au Mexique une civilisation supérieure pour édifier sur ses ruines un monument national à l’ignorance et à la superstition. L’esprit populaire a été nourri de ce mensonge que non seulement l’Église ne donna au peuple mexicain rien de bon, mais qu’elle implanta chez lui tout ce qui pouvait lui nuire, qu’elle a refusé d’améliorer son sort en fondant des écoles et qu’elle a mérité sa haine pour l’avoir ainsi tenu dans l’ignorance, en dehors de tout progrès, pendant des siècles.
L’Église et l’Indien mexicain.
Un franc et loyal examen des faits montre l’inanité de pareilles accusations. Il y avait jadis au Mexique, selon toute probabilité, une civilisation païenne supérieure à l’état social et politique qui régnait à cette époque dans le reste de l’hémisphère, sauf peut-être au Pérou ; mais elle avait disparu depuis longtemps quand les missionnaires prirent pied sur le sol mexicain. Il est impossible d’en apprécier la valeur intrinsèque. Toutefois, ce que les missionnaires trouvèrent, ce fut non pas l’empire fantastique des Aztèques, une création de l’imagination [77], mais un peuple dégradé chez lequel le meurtre et le cannibalisme s’étaient élevés à la dignité de rites religieux [78]. La vieille civilisation, depuis longtemps éteinte, n’avait laissé qu’une partie de son histoire dans des légendes et des ruines. La nouvelle civilisation apportée par les missionnaires espagnols a ses monuments encore debout, et ses actes sont consignés dans des écrits historiques. Les lois des Indes ont été précisément considérées comme le code le plus juste qu’on ait jamais rédigé pour protéger un peuple aborigène [79]. Si nous comparons les conditions de l’Indien mexicain au début dit XIXe siècle avec celles de son voisin du Nord, nous voyons d’emblée que l’œuvre des missionnaires catholiques fut une belle et bonne œuvre. Nous constatons même qu’elle n’a pas cessé de porter des fruits jusqu’à nos jours. Les louanges et les honneurs dont on a couvert Juarez, par exemple, ne sont pas immérités, à ne voir du moins que son intelligence et son habileté ; mais ces louanges et ces honneurs reviennent en somme à l’Église qu’il persécuta, cette Église qui avait rendu un Juarez possible. Un Indien comme Juarez serait chez nous un prodige ; au Mexique il ne l’était nullement. De grands hommes sont en effet sortis de la population indienne et en sortent encore, parce que l’Église, avant que son œuvre fût entravée et calomniée, avait rendu possible ce résultat. Le plus grand peintre mexicain, Miguel de Cabrera, était Indien. Dans ce même domaine, Panduro et Velasquez comptent encore parmi les gloires indiennes. Altamirano fut tout à la fois un grand orateur, un romancier, un poète, un journaliste ; lui aussi était Indien. Juan Esteban, simple Frère coadjuteur de la Société de Jésus, était un instituteur primaire tellement remarquable que nombre de familles d’Espagne envoyaient leurs enfants à travers l’Océan pour les faire instruire suivant les méthodes originales, mais extrêmement efficaces, de cet Indien. Parmi les orateurs, un évêque indien, Nicolas del Puerto, tient une place distinguée. Dans le domaine de la haute philosophie, le monde en compte peu de plus grands que l’archevêque Munguia de Michoacan. Francisco Pascual Garcia fut un grand juriste ; Ignacio Ramirez, un journaliste distingué ; Rodriguez Gavan, un noble poète, en même temps qu’un journaliste ; Bartolomé de Alba fut un prédicateur couru, mais solide ; Diego Adrian et Augustin de la Fuente furent d’habiles éditeurs ; Adriano de Tlaltelolco, un non moins habile latiniste. Tous étaient Indiens, ainsi que les historiens Ixtlilxochitl et Valeriano. Rincon a écrit la meilleure grammaire de la langue aztèque. Ainsi que De Alba, il descendait des rois de Texcoco. Une bibliographie des livres écrits par des Mexicains avant la première révolution remplit nombre de gros volumes, et les Indiens n’y occupent pas une petite place. À qui l’honneur ? À cette Église que le gouvernement mexicain accuse devant le monde de n’avoir rien donné à son pays.
Progrès de l’enseignement au Mexique
sous la direction de l’Église.
Citons le témoignage du baron von Humboldt après sa visite au Mexique : « Aucune ville du nouveau continent, sans même en excepter celles des États-Unis, ne peut montrer des établissements scientifiques aussi vastes et aussi sérieux que la capitale du Mexique [80]. » Comment des abîmes de la barbarie le Mexique s’est-il élevé à une pareille hauteur, pour s’arrêter, puis commencer à rétrograder, alors que les États-Unis marchaient de l’avant et parvenaient à leur présente supériorité ? Posez cette question à l’Université fermée, aux collèges supprimés, aux écoles vides, aux monastères, aux couvents confisqués, aux étudiants dispersés à l’étranger, à la presse muselée, aux lois de réforme, au sabre, au canon, aux urnes électorales violées. Les réponses isolées ne seront peut-être que de simples chuchotements, mais toutes ensemble crient si haut et si fort que le monde entier peut les entendre. Voici, du reste, un témoignage éloquent de l’œuvre merveilleuse de l’Église persécutée : si le Mexique, au commencement du XIXe siècle, avait relativement plus de collèges et plus d’élèves dans ces collèges, aussi bien que moins d’illettrés, que la Grande-Bretagne elle-même, il le devait à l’Église, à elle seule. Qui le dit ? L’auteur d’un récent article dans un magazine londonien [81].
Ce magnifique tableau s’assombrit et fait place à l’image de la désolation quand, voici plus d’un siècle, commencèrent les troubles intérieurs du Mexique. En deux générations ce pays a perdu ce que trois siècles de paix et de civilisation lui avaient acquis : ses églises saisies, et sa richesse, autrefois employée à l’éducation et au bien-être social, passée aux mains de brigands. Les pires éléments se sont hissés au pouvoir et le pouvoir n’a été pour eux que le moyen de s’enrichir. Les doctrines jacobines subversives, legs funeste qui se transmet de génération en génération comme une viciation du sang, règnent encore ; les monuments consacrés par l’Église à l’enseignement et à la bienfaisance sont encore debout, il est vrai, mais employés, hélas ! à d’autres usages, et souvent des usages ignobles. Puissamment, souvent magnifiquement bâtis, beaucoup de ces édifices sont devenus des casernes, des prisons, des hôtels, des bureaux. C’est au Mexique que revient la gloire du premier livre, de la première presse à imprimer, de la première école, du premier collège et de la première Université, du Nouveau Monde, et la gratitude du Mexique pour cet honneur devrait aller à ses missionnaires catholiques. À la philosophie perverse de la Terreur Rouge, ne revient que la triste gloire d’un siècle de destruction. Un sociologue français a dit que « l’initiative privée commence là on finit l’intervention du pouvoir ». Au Mexique, on se propose de ne jamais la laisser commencer, car le pouvoir de l’État ne doit avoir aucune borne. Et cependant, l’État est redevable de tous ses progrès, de tous ses succès, à l’individu. Tous les progrès en matière d’éducation, par exemple : tels que la science pédagogique, l’invention des méthodes, la division convenable des études, la gradation des cours, sont des contributions individuelles. Ces néo-jacobins doivent certainement sentir la force des paroles d’un écrivain français qui disait d’un peuple placé sous un tel régime : « Il pense que la liberté consiste à restreindre celle d’autrui. »
La richesse de l’Église au Mexique.
L’accusation que l’Église avait envahi une portion excessive du sol mexicain et qu’elle accaparait aussi bien de vastes domaines que des valeurs monnayées, n’est devenue, après enquête, qu’une grossière exagération. Quand on étudie les faits, à la froide lumière de l’histoire, et quand on a en mains les chiffres réels se rapportant à ces biens, l’accusation tombe d’elle-même, car la soi-disant richesse de l’Église était surtout formée par les dotations des œuvres mexicaines d’enseignement et de bienfaisance sociale. L’Église ne possédait que peu de terres, et les biens accumulés pour doter les établissements éducationnels ou charitables ne venaient que pour une part des dons nationaux accumulés pendant trois siècles dans un des plus riches pays du monde, car ces dotations représentaient également le travail et le renoncement de milliers de religieux et de religieuses, dont l’unique salaire était leur pain et leur vêtement. La plus grande partie des biens, comme nous l’avons dit, appartenaient non pas à l’Église, mais aux établissements éducationnels ou charitables du pays ; du reste, la valeur en a été grandement exagérée pour les besoins de la propagande.
Quand on a devant soi les chiffres indiquant l’exacte valeur de ces dotations et quand on les compare aux dotations analogues des établissements éducationnels et charitables des États-Unis, on voit de toute évidence que la part soi-disant excessive de l’Église dans la richesse du Mexique est une accusation dénuée de fondement. À elles seules, trois Universités américaines ont des dotations supérieures à celles de tous les établissements scolaires et charitables dirigés par les Ordres religieux du Mexique. Une certaine confession religieuse non catholique de chez nous, et qui ne figure pas entre les plus importantes, possède à elle seule plus de placements que l’Église catholique du Mexique, avec toutes ses ouvres d’enseignement et de charité, à l’époque de sa plus grande prospérité [82]. Cette confession possède aujourd’hui dans notre pays, par rapport au nombre de ses adhérents, vingt fois plus de ministres et cinq fois plus d’églises [83]. De plus, l’histoire de l’origine et du développement des fondations en faveur de l’enseignement et des œuvres charitables dans notre pays est presque identique avec celle du Mexique, pour autant du moins que des motifs religieux entrèrent dans cet effort. Ainsi que nous l’avons déjà signalé, l’éducation populaire et secondaire aux États-Unis fut tout entière organisée par les confessions religieuses qui participaient à la vie américaine ; si donc nous supprimions dans notre société toutes les valeurs fournies par nos pionniers de renseignement et des œuvres sociales, il resterait aujourd’hui moins de la moitié de ce que nous possédons. Mais ici, aux États-Unis, l’inspiration vint du zèle, et les fondations, du désir d’encourager les œuvres, tandis que les « patriotes » du Mexique ont détruit et dévoré la propre substance de leur pays, vendu son droit d’aînesse en fermant une école après l’autre, en chassant les maîtres et en détournant de leur premier usage les institutions de bienfaisance. Nombre de ces dernières furent vendues à des prix fictifs pour enrichir des familles de révolutionnaires...
Les chiffres sont pourtant plus éloquents que les paroles. L’évaluation la plus forte qui ait été faite des biens de l’Église au Mexique, même par ses ennemis, s’élève à 250 millions de dollars, y compris les biens de toutes les fondations. En dehors des fondations destinées à l’enseignement et aux œuvres de bienfaisance, la propriété consacrée à la religion aux États-Unis est évaluée par la Federal Trade Commission à 2 820 220 000 dollars. Avec les fondations, on l’évalue à 7 milliards de dollars. Proportionnellement, les chiffres mexicains devraient être à peu près le quart des chiffres américains. En fait, ils ne s’élevaient pas au dixième. Après la confiscation, le gouvernement réalisa beaucoup moins que la moitié de ses estimations.
L’histoire de la décadence de l’enseignement au Mexique commence avec l’expulsion des Jésuites, en 1767. Bientôt après vint la débâcle, qui, depuis, ne s’est plus arrêtée. Il en était bien peu qui fussent capables de prendre la place des anciens maîtres. Un collège après l’autre dut être abandonné ; la plupart d’entre eux furent supprimés par les prédécesseurs du président Calles. En 1833, Gomez Farias ferma l’Université de Mexico, la première Université de ce continent. Rouverte par des catholiques, elle fut fermée de nouveau par Comonfort en 1857. Elle rouvrit une seconde fois un an plus tard ; Juarez la ferma en 1865. Dans la suite elle tomba au niveau d’une école secondaire, et, quelques branches exceptées, c’est à peine si de nos jours elle peut prétendre à un rang plus élevé.
L’Église et les pauvres au Mexique.
Bien amer fut le destin des populations mexicaines. Témoin de la confiscation des établissements éducationnels et charitables – à vrai dire leur propre bien ; – elles voyaient de plus grandir, avec la rafle de leurs dotations, l’usure et l’exploitation du pauvre ; et tout ceci n’avait d’autre but que d’augmenter la fortune des nouveaux riches qu’avait engendrés la révolution. Autrefois, les fonds des établissements de l’Église étaient presque entièrement employés à développer les grandes ressources agricoles du Mexique, sous forme de prêts à un taux fort modeste. Les intérêts, à leur tour, servaient à entretenir les établissements éducationnels et charitables, les écoles, les collèges, les orphelinats, les hospices de vieillards et les hôpitaux. Ainsi donc, les fonds augmentaient la prospérité agricole et industrielle, et les intérêts payés favorisaient le progrès intellectuel et social. Du seul fait de sa mission, le prêtre transformait ses débiteurs en ses amis. Mais laissons un adversaire raconter cette histoire. Nous la trouvons exposée dans un discours prononcé sur cette question, le 20 octobre 1893, à la Chambre des députés du Mexique, par juan A. Mateos. « Aux jours de l’ancien régime, alors que le clergé possédait un grand nombre de propriétés urbaines ou rurales, les années se succédaient sans qu’on vit les honteuses expulsions dont tant de familles sont aujourd’hui les victimes. D’une avarice sordide, les propriétaires actuels n’ont point de pitié ; tel n’était pas le clergé, qui, animé d’un esprit vraiment chrétien, fermait les yeux ou bien excusait. L’Église prêtait ses capitaux à un taux peu élevé, 4 %, 5 % ou 6 %, ce qu’alors on appelait le taux légal, taux inconnu de nos jours. Bien rarement on publiait un avertissement de forclusion contre une propriété hypothéquée en raison d’un prêt sur ces fonds. Au temps de la confiscation des biens ecclésiastiques, j’ai proposé, il est vrai, qu’on établît une banque pour les pauvres avec les millions du clergé ; mais les passions de la révolution ont étouffé ma voix. C’est ainsi que les intérêts égoïstes et les exactions présentes ont laissé sans abri de nombreuses familles qui jouissaient autrefois de la tolérance et de la charité du clergé. » Ce fut le chef révolutionnaire, le président Juarez, qui repoussa les lois contre l’usure par son décret du 15 mars 1861. L’Église, en employant les fonds des dotations sous forme de prêts populaires, réalisait en somme une banque agricole pour les cultivateurs mexicains. Voici quelques années à peine que notre propre gouvernement a fondé une banque de ce genre aux États-Unis dans le but de venir en aide aux fermiers.
L’Église et le progrès social au Mexique.
On a, au Mexique, accusé l’Église de n’avoir aucun programme défini d’action sociale et d’avoir adopté une attitude d’opposition. Mais l’énumération de ce que l’Espagne catholique a fait pour le Mexique justifie la déclaration suivante, émanée d’une autorité reconnue en matière d’histoire mexicaine : « Aucune autre nation n’a produit avec une telle ampleur d’aussi grands bienfaits dans ses colonies. » L’Église est au Mexique la première organisation qui se soit consacrée à la solution de la question sociale. Mais, depuis soixante ans ou plus, elle n’est plus libre. Et cependant, avant même qu’éclatât la révolution de 1910-1911, elle avait un programme d’action sociale, programme au courant du progrès, avancé, étendu, dépourvu d’esprit de caste ; il ne devait enfanter ni troubles ni confiscations injustes. Loyal envers le peuple mexicain, il était généreux, désintéressé, et ne s’inspirait d’aucune passion politique.
Dès 1903, les délégués catholiques au Congrès national de Mexico présentèrent des projets de loi portant création de banques coopératives agricoles. Cette même année, les catholiques mexicains s’assemblèrent à Puebla et, entre autres problèmes, discutèrent ceux des unions ouvrières, des Indiens et de l’apprentissage industriel. Des assemblées similaires furent tenues les années suivantes. Dans celle de 1906, on ne présenta pas moins de 29 rapports se référant aux différents aspects de l’action sociale dont l’Église s’occupait alors au Mexique. À l’assemblée de 1909, à Oaxaca, toute la session fut presque exclusivement consacrée à la discussion du problème indien.
Ce fut un groupe de délégués catholiques au Congrès de Mexico qui présenta des propositions de loi donnant un statut légal aux unions ouvrières, établissant le repos du dimanche et fixant des indemnités pour les accidents de travail. Dans l’État de Jalisco, en 1912, les membres catholiques formaient la majorité de la Chambre législative ; ils promulguèrent des règlements garantissant les droits de propriété des épouses et des enfants, les droits des minorités, et accordant un statut légal aux syndicats ouvriers. Il suffit de lire les publications catholiques de cette époque pour voir avec quel zèle les catholiques et le clergé catholique du Mexique se consacraient aux questions sociales du pays, quand on leur laissait leur liberté d’action. En mars 1913, le parti catholique national, assemblé à Guadalajara, discuta un programme où figuraient des questions telles que l’autonomie municipale, les problèmes agraires, les banques rurales coopératives et les droits de propriétés des épouses et des enfants ; la seule énumération de ces questions montre jusqu’à quel point non seulement le parti, mais les catholiques du Mexique s’étaient avancés dans la solution des problèmes sociaux de l’époque. Les Unions ouvrières catholiques du Mexique, à leur assemblée plénière tenue en 1913 à Zamora, adoptèrent des résolutions demandant tout ce qu’il y avait de juste dans l’article 123 de la Constitution de Queretaro ; ils allaient même plus loin que cet article pour la protection des droits des ouvriers.
N’était-ce l’obligation de nous limiter, nous pourrions sans peine nous étendre sur l’histoire des efforts de l’Église pour améliorer la situation sociale du peuple ; nous insisterions en même temps sur ce fait que les catholiques du Mexique n’ont jamais cessé de répondre de leur mieux toutes les fois qu’on a fait appel à leur intelligence et à leur patriotisme.
L’Église et la politique au Mexique.
L’accusation qui revient le plus facilement sur les lèvres ou sous la plume des politiciens mexicains, c’est que l’Église intervenait dans la politique. La réponse est encore plus facile que l’accusation, car personne ne tenta jamais de prouver la seconde. Il semblerait qu’on dût la croire sur parole. Quand et comment l’Église du Mexique se mêla-t-elle de politique ? Si l’accusation vise l’époque de la domination espagnole, il est vrai que certains hommes – tel l’évêque Las Casas, à la mémoire duquel le Mexique révolutionnaire a récemment élevé un monument – se mêlèrent de « politique » au point de combattre les fonctionnaires espagnols de la colonie jusqu’au pied du trône royal, afin d’obtenir la justice et l’instruction en faveur des Indiens. L’accusation est encore vraie en ce sens qu’a cette époque, du fait de l’union par trop idéale de l’Église et de l’État, le dernier allait souvent au delà des droits que lui garantissait le Concordat et s’immisçait dans le domaine de l’Église : il se heurtait en conséquence à des refus ou de l’opposition. Elle est également vraie en ce sens que certains individus voulurent utiliser cette union pour faire fortune. Quant au reste, elle n’est vraie en aucune manière.
Que si l’accusation vise les premiers temps de la révolution, elle est vraie en ce sens que des prêtres dirigèrent la lutte contre l’Espagne ; mais l’Église les condamna pour avoir déserté leurs devoirs spirituels et s’être mêlés à la seule politique que comprenaient les gens d’alors, à la guerre. Elle est vraie de nouveau en ce sens que les évêques tentèrent de maintenir les droits de la religion contre les attaques des révolutionnaires du jour. Elle n’est vraie d’aucune autre façon.
Si enfin l’accusation se rapporte à l’histoire révolutionnaire plus récente, il est vrai que l’Église fut la seule à défendre le pays contre les communistes et les athées, quand ils s’en prirent aux libertés civiles, politiques et religieuses. Il n’est pas vrai que l’Église s’engagea dans la politique pure des partis. Le parti catholique du temps de Madero était formé de laïques travaillant à obtenir pour le Mexique, par les moyens constitutionnels, un code de lois plus justes et plus équitables. Madero salua ce parti comme « le premier fruit de ma révolution ». En ce sens et aucun autre, les catholiques – non l’Église – intervinrent dans la politique. Mais quoi ? L’État démocratique ne proclame-t-il pas la légitimité des voies constitutionnelles pour obtenir le redressement des abus ? Si cette voie est mauvaise, nous autres Américains n’entendons rien à la démocratie. Et si ces abus, par le fait des ennemis de la religion, occupent le terrain religieux, est-il interdit aux amis de la religion de travailler à leur redressement, parce que, en ce faisant, ils se mêlent de politique ?
L’Église et l’État au Mexique.
Le gouvernement du Mexique déclare qu’à l’heure actuelle il tente simplement de rompre l’union de l’Église et de l’État, mais que l’Église recherche le pouvoir temporel. L’histoire de la nation mexicaine lui répond d’emblée. Depuis 1857, il n’y a plus d’union de l’Église et de l’État au Mexique. Avant cette date, en 1824, un gouvernement mexicain révolutionnaire exprima le désir de conserver une parcelle de cette union sous forme de l’ancien droit de « patronat » dont jouissait autrefois la couronne d’Espagne ; il voulait ainsi garder en mains la nomination des évêques ; mais l’archevêque de Mexico répondit par un refus. L’année suivante, la demande fut présentée une seconde fois ; elle fut également repoussée, et cette fois par le corps entier de l’épiscopat.
La Constitution de 1857 proclama la séparation de l’Église et de l’État. Toutefois, ce document reconnaissait l’Église, bien que séparée, comme une entité légale. En vertu de la doctrine « libérale » alors régnante, aucune « personne légale » n’avait cette qualité en vertu d’un droit propre et inhérent ; elle ne l’avait que par une concession de l’État, qui la créait par une fiction légale. Mais ce que l’État fait, il peut le défaire ; et c’est ce que la Constitution de 1917, tirant la conclusion logique d’une prémisse fausse, a voulu réaliser. Elle ne reconnaît pas « la personnalité juridique aux institutions religieuses connues sous le nom d’Églises » ; elle les prive ainsi de toute protection légale contre les ingérences des tyrans mexicains, qui avaient et ne cessent d’avoir pour but réel – ils l’ont dit bien souvent – non point la séparation de l’Église et de l’État, mais l’assujettissement de l’Église au contrôle de l’État. D’autre part, l’Église au Mexique ne demande pas que l’union de l’Église et de l’État soit restaurée ; elle réclame uniquement le système américain de liberté religieuse. On le voit sans peine dans l’adresse des évêques mexicains à l’Assemblée législative : « Que demandons-nous ? Ni tolérance ni complaisance, encore moins des privilèges ou des faveurs. Nous demandons la liberté, et nous ne demandons rien que la liberté ; nous la demandons pour toutes les religions... Un régime de restrictions à l’égard de la religion est la négation de la liberté. »
Calomnies contre le clergé du Mexique.
L’accusation d’extorsion portée contre le clergé du Mexique est non moins calomnieuse que celle lancée contre l’Église à propos de ses richesses et de l’instruction. Ceux qui ont vu dans quelle pauvreté vivait le clergé mexicain de notre époque n’ont nul besoin de statistiques pour savoir qu’on a calomnié ce clergé. Pour celui des époques antérieures il suffira de dire que la totalité des offrandes recueillies dans les églises mexicaines n’atteignit jamais la valeur d’un peso par fidèle par an. Les offrandes faites à l’occasion des baptêmes ou des mariages étaient plus faibles que celles qu’on fait aux ecclésiastiques des États-Unis. De même que dans notre pays, les œuvres d’enseignement et de bienfaisance étaient principalement soutenues par ceux qui avaient le moyen d’être généreux. Les pauvres ne payaient rien en dehors de la piécette de cuivre qu’ils donnaient aux quêtes dominicales. Durant l’époque espagnole il est tout à fait exact que les évêques disposaient de revenus souvent considérables, mais il est non moins vrai qu’ils dépensaient leur superflu en faveur des grands établissements dont nous avons parlé. L’édification d’hôpitaux et d’orphelinats semble vraiment avoir été l’œuvre de prédilection de beaucoup d’évêques ; ils couvraient la dépense avec ceux de leurs revenus que n’absorbaient pas leur train de maison ou l’administration de leurs vastes diocèses. Les hôpitaux notamment étaient les meilleurs de l’époque et supérieurs à ceux de l’Europe. Quelques-uns, encore debout, passent, même de nos jours, pour des modèles en un climat tel que celui du Mexique. De tous ces magnifiques établissements le plus remarquable est celui de Guadalajara, que des médecins, venant même des États-Unis, visitent encore aujourd’hui en vue du soin des malades ; il date néanmoins de trois siècles et fut un don épiscopal. Où passaient les revenus de l’évêque Zumarraga, nous l’apprenons par une de ses lettres au roi d’Espagne, lettre écrite en 1537 : « L’objet habituel de mes pensées, celui vers lequel se porte surtout ma volonté et auquel je consacre mes modestes forces, c’est d’avoir, en cette ville et dans chaque diocèse, un collège pour enseigner au moins la grammaire aux enfants indiens et, de plus, un grand établissement capable de recevoir un grand nombre de filles d’Indiens. » Avant sa mort, l’évêque put voir se réaliser une bonne partie de ses vœux. N’oublions pas non plus la lettre adressée par Geronimo Lopez au roi et dans laquelle, dès 1541, il se plaignait de ce que l’Église, par ses prêtres, instruisait les Indiens trop fidèlement, au point même d’en faire d’excellents écrivains et d’habiles latinistes.
Rappelons que les évêques étaient les gardiens responsables des fonds destinés aux autres œuvres que les paroisses et les missions. Toutefois, dans leur amour du progrès, ils allèrent souvent un peu loin, en voulant faire du Mexique un pays devançant leur temps ; nous les voyons, en effet, construire des grand-routes et même des aqueducs. Si les pauvres du Mexique ont été systématiquement dépouillés par les extorsions de leur clergé, il est certainement difficile d’expliquer leur attachement à l’Église et à ses pasteurs : en dépit des rigueurs de la censure actuelle, cet attachement n’est ignoré d’aucun de ceux qui s’intéressent aux évènements du Mexique.
L’Église recourt aux prières, non aux armes.
Des catholiques eux-mêmes ont demandé pourquoi l’Église, au Mexique, n’utilise pas son pouvoir incontestable pour mettre un terme à la persécution et se prémunir contre son retour, puisqu’il est admis que la très grande majorité du peuple mexicain est de son bercail. Ils oublient qu’à cet égard il n’est que deux moyens humains : le bulletin de vole et l’épée. Du premier on ne peut rien obtenir au Mexique, car les votes n’y sont pas respectés et les gouvernements ne s’en émeuvent pas. Peu de citoyens usent de leur bulletin, car leurs suffrages ne sont comptés que s’ils favorisent le parti au pouvoir, ou quand le gouvernement, pour faire impression ou mieux tromper, veut bien admettre l’existence d’une petite minorité. On en a la preuve éclatante dans le rejet, à l’unanimité moins une voix, de la pétition adressée par les évêques mexicains au Congrès en faveur d’un régime plus doux, pétition qui avait pourtant l’appui du peuple. Congrès, Sénat et tribunaux sont aux ordres du président ; cette situation est la règle, non l’exception, depuis le jour où le Mexique reçut la « liberté » par la force des armes. Elle ne cessera point d’être la règle tant que ce genre de « liberté » régnera. Les balles sont plus puissantes que les bulletins de vote quand elles servent de jouets à la tyrannie.
Le second remède humain n’offre également aucun espoir, car les principes chrétiens interdisent à l’Église, fondée par le Prince de la paix, de prendre l’épée ou de s’appuyer sur des armes aussi matérielles qu’en peuvent choisir les hommes surexcités par la passion. Pendant sa vie de deux mille ans, l’Église apprit bien des choses ; la principale leçon lui vint pourtant de la patience de son divin Fondateur. Elle n’est point condamnée à mourir, mais elle a appris à souffrir. Avec lui elle sera crucifiée, mais avec lui aussi elle ressuscitera. Les armes des hommes ne sont pas faites pour elle. Mais si l’Église ne veut pas recourir aux armes humaines, elle en a une qui sied bien à sa main, armée comme elle l’est de justice et de vérité. Elle a la prière. Or, dans l’histoire des épreuves de l’Église au Mexique, jamais cette arme ne fut tenue d’une main aussi ferme qu’aujourd’hui, grâce aux paternels conseils du Souverain Pontife. La voix tremblante de l’Église affligée du Mexique n’est donc plus seule à s’élever vers le Consolateur. D’un bout à l’autre de la terre monte vers le trône de Dieu la réponse à l’appel de Pie XI. Cette prière, la haine des hommes peut la mépriser. La méchanceté des hommes peut la maudire. L’incroyance des hommes peut en rire. Mais elle a son espérance dans une promesse et sa puissance dans la foi.
Il n’y a pas eu d’appel en faveur
d’une intervention politique
ou d’une action d’un genre quelconque.
Ce que nous venons d’écrire n’est donc pas un appel lancé aux fidèles de ce pays ou d’ailleurs en vue d’une action purement humaine. Soit comme évêques, soit comme citoyens, nous ne cherchons nullement à peser sur les détenteurs de l’autorité politique en un point quelconque de la terre et, moins que partout, dans notre propre pays, afin d’amener une intervention armée dans les affaires intérieures du Mexique et d’y protéger l’Église. En racontant l’histoire, en défendant la vérité, en insistant sur les principes, nous avons fait notre devoir, car du même coup nous avertissons la civilisation chrétienne qu’on attaque et qu’on mine de nouveau ses fondements. Pour le reste, Dieu fera triompher sa volonté à son heure et de la manière qui lui plaît. Le Mexique sera sauvé pour la mission qu’il doit remplir, quelle qu’elle soit. Que cette mission consiste maintenant à donner un grand exemple de patience chrétienne, ainsi qu’à démontrer la force indomptable de la foi, nous pouvons le croire aisément. Pour l’avenir nous pouvons avoir confiance ; songeons aux exemples que nous ont légués d’autres nations qui, jetées dans ce même creuset de la persécution, en sortirent victorieusement et prêtes à de grandes choses. Jadis la nation mexicaine a prouvé sa valeur intrinsèque par ses rapides progrès dans la civilisation chrétienne. Car pour l’époque qui vit les De Gante et les Zumarraga, les Las Casas et les Motolinia, ou bien encore les Junipero Serra – missionnaires d’un pays aujourd’hui nôtre, – le Mexique n’a nul besoin de se la faire pardonner.
Ce que le Mexique doit à l’Église.
Aux tristes jours de la décadence, l’Église, privée par la loi du droit d’enseigner, dépouillée des moyens de continuer son œuvre de lumière, ne peut plus que montrer ses chaînes et dire à ses ennemis : « Vous injuriez ma pauvreté ; mais vous m’avez pris les dotations de mes hôpitaux, de mes orphelinats, de mes innombrables établissements de bienfaisance. Vous me taxez d’ignorance ; mais vous avez fermé mes écoles et volé mes collèges, les premiers de ce continent où se soit allumé le flambeau de la science. Vous dites que je n’ai rien ajouté à la science et aux arts ; mais vous avez détruit les arts que j’avais apportés et développés, brûlé mes livres et dispersé les résultats de mes travaux scientifiques aux quatre vents du ciel. Vous m’accusez de violence ; mais vous avez détruit mes missions au sein d’une population paisible et prospère d’Indiens ; puis, en la place de l’Évangile du Christ, vous leur avez compté les trente pièces d’argent qui devaient payer l’assassinat de leurs compatriotes. Vous avez arraché la croix de leurs mains et vous l’avez remplacée par la torche et le fusil. Montrez-moi dans le Mexique quoi que ce soit de bon que je ne vous aie donné. Montrez-moi un génie dont l’honneur ne me revient pas. Avez-vous jamais fait un pas vers la lumière sans le secours de mon assistance ? Enlevez de votre pays tout ce que j’y ai mis et voyez ce qui vous reste. Vous pouvez me jeter dehors, exiler mes évêques, massacrer mes prêtres, voler de nouveau mes écoles et profaner mes sanctuaires, mais vous ne pouvez oblitérer l’histoire, vous ne pouvez effacer le sceau que j’ai imprimé sur vos fronts, vous n’y parviendrez pas dans tous les siècles des siècles. »
« Pour l’honneur de mon nom. »
Si, pour un homme, le gain du monde entier ne compense pas la perte de son âme, pour une nation quel profit espérer d’un pareil marché ? Au Mexique il y avait une âme, un esprit qui manifestait sa présence par l’élan des missionnaires portant la civilisation au long des routes que n’avait encore frayées que l’empreinte des sandales ; c’est maintenant la Grand-Route royale de Californie, le Camino Real. Édifiant avec l’inspiration de sa foi, cet esprit a laissé des monuments qui racontent l’histoire du Mexique dans les antiques missions du Texas, de l’Arizona, du Nouveau Mexique et le long des rivages du Pacifique, de San Diego à San Francisco. Pour nous, gens du Nord, ces établissements sont les témoins des premières missions chrétiennes de notre pays, les phares lumineux de la religion et de la civilisation sur notre sol, les sources fécondes d’une littérature spéciale dont les tableaux avaient des touches et des teintes d’une couleur et d’un ton caractéristiques ; ils forment un trésor que nous apprécions à l’égal d’un héritage aussi riche que noble et qui de plus nous ennoblit. Par les anciens documents, qui nous l’apprennent en leur langue espagnole, nous savons que c’était non pas l’Espagne, mais le Mexique qui envoyait les « Padres » vers le Nord.
Elle ne s’est point effacée, la piste de ces pionniers qui donnèrent au Far West les premiers martyrs et les premiers maîtres de toute notre nation. Par eux nous participons aux gloires des premières œuvres de la civilisation chrétienne sur ce continent. Nous n’avons pourtant pas renié et nous ne renierons pas notre dette envers le Mexique. Bien des voix l’ont déjà reconnue ; toutes, il est vrai, ne chantent pas les vieux hymnes, mais elles comprennent, au moins, une part du message des chanteurs. Tous ne prient pas au pied des anciens autels, mais tous tiennent néanmoins pour sacrés les lieux où les « Padres » les ont dressés. Et c’est ainsi qu’aux nouvelles cités qui s’élèvent tout autour ils donnent les vieux noms d’autrefois, afin de garder, à ce grand Ouest des traditions, son caractère et ses charmes. Si la mère vient à oublier ce qu’aiment les enfants, les enfants n’en éprouveront-ils pas de la honte plutôt que de la fierté ? Pour vous – nos fidèles en cet heureux pays où les droits de la conscience sont reconnus par les lois, garantis par les pouvoirs, respectés par le peuple, – nous nous faisons l’écho de l’appel de Notre Saint-Père le Pape Pie XI, et nous vous demandons la charité de vos prières pour vos frères affligés du Mexique : un memento aux messes quotidiennes des prêtres, un souvenir dans la dévotion journalière des fidèles. Rappelez-vous ces paroles de Notre-Seigneur qui vous apprennent que votre sympathie, en se traduisant ainsi dans la pratique, lui sera agréable : « Bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. »
Aux évêques, clergé et fidèles du Mexique, nous consacrons cette défense de leur histoire et de leurs droits, non seulement pour accomplir un devoir issu de la foi commune, mais pour rendre témoignage à leur vaillance dans l’épreuve, à la justice de leurs nobles et légitimes revendications. Nous leur souhaitons bon courage, car au Mexique affligé on peut appliquer une fois encore les paroles si expressives du Maître à l’Apôtre des Gentils : « Cet homme est pour moi un vase d’élection, destiné à porter mon Nom devant les Gentils, les rois, les enfants d’Israël. Car je lui montrerai combien il doit souffrir pour l’amour de mon Nom. »
Donné, ce 12 décembre, en l’année 1926 de Notre-Seigneur.
Albert BESSIÈRES (1877-19...),
Le Mexique martyr,
Maison de la Bonne Presse, 1928.