Le bonhomme Lénine
par
Curzio MALAPARTE
PARIS
ÉDITIONS BERNARD GRASSET
61, Rue des Saints-Pères, VIe
1932
PROLOGUE
Il monte à cheval comme un homme qui ne serait pas philosophe.
(BLAISE PASCAL).
Il est facile de donner des règles générales. Mais les détails ?
(CATHERINE à VOLTAIRE).
La mission de ma vie est de combattre Oblomov.
(LÉNINE).
Ainsi, dans le temps des fables, après les inondations et les déluges, il sortit de la terre des hommes armés, qui s’exterminèrent.
(MONTESQUIEU).
LA légende de Lénine, cette sombre légende qui fait de ce petit bourgeois fanatique, de ce bonhomme violent et timide, un monstre altéré de sang, un Gengis-Khan prolétarien issu du fond de l’Asie pour se précipiter à la conquête de l’Europe, n’aurait pas pris naissance sans l’optimisme de Candide et de Babbitt, héros représentatifs de la bourgeoisie d’Occident. Pour justifier leurs inquiétudes, calmer leurs remords et ranimer leurs illusions, ces inguérissables optimistes ont cru qu’il suffisait de renier Lénine, de le refouler au delà des frontières de l’esprit bourgeois, d’en faire un Mongol. Sont-ils réellement sûrs que la morale et la logique de la civilisation bourgeoise ne pouvaient pas, n’auraient pas pu, accoucher d’un tel monstre ? Qu’il n’aurait jamais pu naître sur les rives de l’Hudson ou de la Tamise, de la Seine ou de la Sprée ? Croient-ils vraiment que, seul, le sommeil fébrile de l’Asie pouvait donner naissance au Gengis-Khan de la révolution prolétarienne ?
Il est tout à fait naturel que les Plutarque du Kremlin aient fait de Lénine, après sa mort, une sorte d’image d’Épinal à l’usage des moujiks. Mais les Russes intelligents, communistes ou anciens bourgeois, techniciens, étudiants, intellectuels, ouvriers d’élite, ne le jugent pas d’après cette image d’Épinal, haute en couleur, qui nous montre un Lénine tartare, aux yeux terribles, au poing énorme tendu vers un horizon rouge, sur lequel se détachent la Tour Eiffel, la Tour de Westminster, et, plus loin, des gratte-ciel couronnés de nuages pourpres : un Wladimir Ilitch debout, la tête rejetée en arrière, les narines frémissantes, aussi raide sur ses jambes qu’un cavalier mongol se dressant sur ses étriers. Ils le jugent tel qu’il était : « un Européen moyen », un bonhomme au fanatisme doctrinaire, d’une volonté abstraite, un « fonctionnaire ponctuel et zélé du désordre », un noircisseur de papier incapable d’agir en dehors du domaine de la théorie, un petit bourgeois d’habitudes casanières, perdu dans le tumulte de la révolution comme un bibliothécaire au milieu d’une émeute : un fanatique de bon sens, somme toute, le seul pouvant racheter, aux yeux du peuple, le romantisme jacobin de ses « lieutenants », la violence sanguinaire des Trotsky, des Raskolnikov, des Dzerjinski, des Dybenko, des Piatakov. « Ah ! si Wladimir Ilitch vivait encore ! » Ce sont des mots qui reviennent souvent, en Russie, dans les conversations privées. Comment a-t-il bien pu se faire que le Lénine de la légende officielle à l’usage des moujiks soit devenu un Lénine a l’usage des bons bourgeois d’Occident ?
À leur premier voyage au pays des Soviets, Candide et Babbitt, portés par le vent doux et tiède de l’optimisme, ce fameux vent d’Ouest qui amène de loin, des rives du Potomac, de la Tamise et de la Seine, les graines de la philanthropie, ne s’attendaient pas à voir que les bottes de Pierre le Grand n’étaient pas les escarpins de Casanova : deux personnages qui ont eu du succès là-bas, à ce qu’on raconte, et qui ont assez bien compris ce pays, tout en marchant chacun à sa façon et dans ses souliers. Nos deux braves bourgeois, on peut le croire, sont entrés dans Moscou tout de neuf habillés, leurs chaussures à la main, en marchant sur la pointe des pieds pour ne pas éveiller les soupçons de ce peuple bizarre. Ce sont eux qui ont apporté en Europe, au retour de leur premier voyage dans la Russie des Soviets, cette image d’Épinal à l’usage des moujiks, dont on peut dire qu’elle est faite pour épouvanter et rassurer tout à la fois les bourgeois de chez nous. « Méfiez-vous de Lénine, car c’est un monstre, mais, en même temps, rassurez-vous, car c’est un Gengis-Khan, issu du fond de l’Asie. Ce monstre n’est pas de chez nous. » Tel a été, à partir d’octobre 1917, le sens de tous les propos de Candide et de Rab but au sujet de Wladimir Ilitch. Mais c’est un tout autre langage qu’on attendrait de deux gentlemen qui se réclament toujours de Voltaire et de Rousseau, affectent d’avoir à cœur la liberté de l’Europe, et se prétendent cartésiens au point d’affirmer que le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. « Méfiez-vous de Lénine, car c’est un petit bourgeois : voilà le langage qu’ils devraient tenir, si l’optimisme ne voilait pas leur jugement. Méfiez-vous de ce monstre, car c’est un bonhomme de chez nous. »
Le signe le plus clair de la décadence de la bourgeoisie en Occident, c’est qu’elle n’arrive à voir en Lénine qu’un Gengis-Khan. Heureusement, de tels monstres ne sauraient naître que sur les rives du Volga ou dans les steppes de l’Asie : ils ne sauraient être ni Anglais, ni Allemands, ni Français. C’est cette considération qui apaise les inquiétudes de nos braves bourgeois. Pour se rendre compte de l’optimisme insouciant avec lequel on juge, en Europe, les hommes et les évènements de la révolution russe, il suffit de considérer les affirmations de quelques Candide des plus qualifiés de nos jours, celles de l’économiste anglais Keynes, par exemple, dont la réputation est au-dessus de toute ironie. « Certains politiciens de France, écrit-il, Poincaré entre autres, suivi de près par quelques représentants de la politique des États-Unis, me semblent être au nombre des hommes les plus irréligieux qui existent aujourd’hui au monde ; et Trotsky, Bernard Shaw, Baldwin, chacun à sa manière, parmi les hommes les plus religieux. » Il conclut en affirmant que le léninisme est une religion et non un parti, que Lénine est un Mahomet, et non un Bismarck. Qu’est-ce que l’Europe moderne pourrait avoir à craindre d’un Mahomet marxiste ? Tout le monde n’est pas moujik. Que Lénine soit un Gengis-Khan ou un Mahomet, peu importe. L’essentiel, c’est qu’il ne soit pas de chez nous. Ce qui rassure l’Europe bourgeoise sur son destin, c’est qu’elle n’a pas enfanté, qu’elle ne pouvait pas enfanter un monstre.
Mais Lénine n’est un monstre que dans la mesure où peut l’être, où peut le devenir, à la faveur des circonstances, n’importe quel Européen moyen de nos jours. Son fanatisme est un des traits les plus caractéristiques – et les mieux cachés – de l’esprit petit bourgeois. L’histoire j des révolutions de ces trois derniers siècles n’est que l’histoire des incendies allumés en Europe par le fanatisme de la, petite bourgeoisie. Lénine, ce bonhomme violent et timide, n’est pas de la race des Gengis-Khan et des Mahomet, comme le croient « the gentlemen who write to the Times ». Il appartient plutôt à cette innombrable famille de petits employés, de petits notaires, d’intellectuels, d’avocats de province, dont l’esprit fanatique n’a pas cessé de bouleverser l’Europe, depuis l’avènement de la philanthropie et de l’optimisme. Il était, lui-même, clerc d’avoué. Ce qu’il y a de monstrueux en lui, c’est ce même fanatisme doctrinaire qui peut faire, de n’importe quel petit bourgeois, dans certaines conditions, aussi bien un Cromwell ou un Mac Donald, qu’un Robespierre, un Clemenceau ou un Lloyd George. Si l’on considère la jeunesse de Lloyd George, on verra que seul un heureux hasard : sa rencontre avec sir William Harcourt, l’a empêché de devenir le Mahomet gallois des dernières années du règne de la reine Victoria.
Le plus grave des dangers qui menacent la société moderne, c’est cet esprit petit bourgeois dont est issue la logique qui domine la vie et l’œuvre révolutionnaire de Lénine : cet esprit fanatique se trouve depuis près de trois siècles à l’origine de toutes les révolutions, de toutes les aventures morales, politiques et intellectuelles de l’Europe. On pourrait presque dire que pour arriver à devenir ce qu’on appelle un monstre, la condition indispensable, c’est d’être un petit bourgeois.
Moscou, 1929
Paris, 1932
Les écrits et les documents dont je me suis servi sont tous de source bolchévique. Quelques détails seuls ont été recueillis dans l’œuvre de MM. Wells, Lafue, Chasles et Keynes. Quant aux innombrables anecdotes qui courent les rues de Moscou et de Leningrad sur le compte de Lénine, je n’en ai retenu que quelques-unes dont la valeur de témoignage est attestée par la qualité de ceux qui, en Russie, me les ont rapportées.
C. M.
I
LE FRÈRE DU PENDU
IL est prudent de ne pas se fier à la bonté des Russes. Ce peuple a de sa propre humanité cette curiosité inquiète, mêlée de soupçon et de crainte, qui est particulière à la nature féminine. Le bien et le mal, dans l’humanité pravaslavni, c’est-à-dire orthodoxe, forment ce que les Grecs appelaient l’hermaphrodisme sexes distincts, mais qui se confondent dans une sensibilité contaminée par la suspicion et la sympathie d’un sexe pour l’autre. Sensibilité aiguisée par le désir viril de la possession, troublée par les inquiétudes périodiques de la femme. L’histoire de ce peuple est remplie d’erreurs et de folies, de candeurs affreuses, d’un sanguinaire amour du prochain, qui enlèvent, au sacrifice même, tout aspect humain. Hommes et femmes, les dramatis personæ de l’histoire de Russie évoluent sur ce fond d’humanité angélique et bestiale, comme Candide au milieu des guerriers ou Paméla chez les courtisanes : anges vêtus à la moscovite, capables de tout, même d’une bonne action. Mais nul ne peut dire ce qui se cache dans ces yeux bleus, sous ces fronts blancs, dans le son lointain de ces voix douces. À les voir, les tsars, les tsarines, les boyards, les « faux Dimitri », les puissants de cette terre, ont plus l’air de victimes que de despotes, d’usurpateurs et d’oppresseurs. Jamais, en Russie, il n’y a eu de grand prince, ni d’impitoyable tyran, qui ne se plaignît hautement des péchés d’autrui, des brutalités du peuple, de cette fatalité qui le condamnait à porter le poids de tous les méfaits de ses sujets, à devenir, en quelque sorte, le Saint-Christophe du peuple russe, à verser le sang des hommes pour le salut de leur âme, à faire le mal par bonté naturelle. On connaît les lamentations de Pierre le Grand, de ce pauvre Pierre, sentimental naïf, sur l’ingratitude du peuple russe, courbé tout sanglant sous le poids de sa terrible volonté. Le tsarévitch Alexis, fils de Pierre le Grand, ce candide et libéral Alexis, qui se plaint du despotisme féroce de son père et traite à coups de pieds dans le ventre sa femme enceinte, est le modèle du comportement, des mœurs, de l’esprit, et surtout du bon cœur des puissants de cette terre. Un juge averti des affaires de famille de la cour de Russie, le judicieux Voltaire, a écrit au sujet de la mort violente de Pierre III et de l’astucieuse innocence de Catherine : « Je sais qu’on reproche à Catherine quelques bagatelles au sujet de son mari, mais ce sont des affaires de famille dont je ne me mêle jamais. » Alexandre Ier était dit blagoslovenni, c’est-à-dire béni de Dieu. « C’est une âme noble, disait de lui Napoléon, une âme noble qui a fait étrangler son père. »
Tout le monde est bon, en Russie, tout le monde est innocent, tout le monde a la crainte de Dieu, tous sont, hélas, des pécheurs repentis, des esprits généreux, tous, humbles et puissants, princes et peuple. Quel climat ! « Le climat, c’est moi », proclamait Nicolas Ier. Mais dans ce monde obscur, où cent forces contraires faisaient jaillir de leur choc d’étranges passions, des folies fabuleuses, des candeurs monstrueuses, une loi manquait, une règle, une mesure constante, une logique, fût-elle la logique de Machiavel. L’égoïsme même était désintéressé. Le peuple innombrable des moujiks, des artisans, des marchands, des bergers, des vagabonds, des mendiants, des moines, des soldats, des sorciers, chez qui la révolte et le fanatisme, toutes les hystéries sexuelles et religieuses, fermentaient à chaque retour de saison, chez qui l’instinct du bien et du mal remontait confusément à tous les changements de vent, ce peuple immense toujours prêt aux sacrifices les plus nobles et aux plus étranges ignominies, cruel et miséricordieux, violent et servile, paresseux, veule et fanatique, était apparu sur le seuil de l’histoire moderne presque à l’improviste, traîné de vive force, poussé en avant à grands coups de pied par ce terrible Pierre, dont les bottes qu’on voit au Kremlin dans le Palais des Armes suffiraient à dire la politique, la volonté de fer, la férocité barbare. Par la fenêtre que Pierre le Grand avait ouvert sur l’Occident, sur le mystérieux Occident, voici qu’était entré en Russie le vent libéral de Candide, le souffle tiède et léger de l’Europe du XVIIIe siècle, corrompue par la philosophie et déjà illuminée par le pressentiment de la liberté. Cette brusque révélation d’un monde nouveau, d’une civilisation réglée par une logique qui n’était, aux yeux des Russes, qu’un jeu facile, élégant et pervers, et dont le sens leur demeurait incompréhensible, n’avait fait que réveiller chez ce peuple les instincts les plus morbides et les illusions les plus dangereuses. Une inquiétude nouvelle faisait fermenter en lui, peu à peu, une douloureuse conscience de sa propre misère, et de son impuissance « à résister au mal ». Du fond des plaines de la Russie, comme du fond de son histoire, ce peuple, jusqu’alors sans remords et sans espoirs, avait devant les yeux pour la première fois, par delà l’horizon de sa bonté pourrie et de sa candeur barbare et féroce, la terre des peuples riches, des hommes heureux, des rois souriants, l’Europe, pays défendu, paradis sans moujiks. Ne pouvant donner à son peuple la logique des nations riches, des hommes heureux et des rois souriants, c’est par cette sorte de révélation de l’au-delà que Pierre le Grand avait racheté son âme de barbare, et la faillite de son œuvre. Comme tous ces tsars qui avaient tenté, avant lui, d’imposer une logique au peuple russe, Pierre le Grand, à sa mort, avait été couché dans le lit d’Oblomov, ce héros immortel, ce témoin muet de l’histoire de Russie. Il ne pouvait être un Russe, un véritable Russe, celui qui était capable de donner une logique au peuple d’Oblomov.
Karl Marx estimait que les philosophes avaient suffisamment interprété la vie humaine, qu’il fallait maintenant commencer à la transformer. C’est là le rapport entre le marxisme et le léninisme : Marx interprète la vie des hommes, Lénine la transforme. L’instrument dont Lénine se sert pour accomplir cette transformation, c’est sa logique froide et violente. Marx, qui méprisait, tout en le redoutant, le fanatisme petit-bourgeois, ne se serait pas trompé en jugeant Lénine. Il ne lui aurait certainement paru ni un Mahomet, ni un Napoléon, mais un de ces petits bourgeois, fils de notaires de province, qui avaient assumé la tâche, en 1789, de transformer la vie humaine, de ces mêmes petits bourgeois qui avaient préféré, en 1871, la Commune à Versailles. De tous ceux qui ont examiné Lénine de près, les professeurs Gambarov et Plekhanov sont ceux qui l’ont le mieux observé. À la première des trois conférences qu’il fit à Paris, au début de 1903, rue de la Sorbonne, à l’École russe des sciences sociales, Lénine était extrêmement ému, mais à la tribune il reprit aussitôt la maîtrise de soi. Le professeur Gambarov, qui était venu l’écouter, dit son impression à Deutch d’un air étonné et satisfait. « Quel remarquable professeur eût fait Lénine ! » Au congrès de Londres de 1903, Axelrod faisait d’amers reproches à Plekhanov, qui avait montré quelques velléités de rapprochement avec Lénine. « C’est de cette pâte qu’on fait les Robespierre », lui répondit Plekhanov. C’est le fanatisme petit-bourgeois, le fanatisme des petits avocats, des petits professeurs, des fils de notaires de province, qui explique aussi bien la logique de Lénine que celle de Robespierre. Lénine est aussi loin de Mahomet que Robespierre de Napoléon.
Ennemie de tout romantisme politique et social, même de cette ombre prophétique qui obscurcit parfois la pensée de Marx, la logique de Lénine révèle le secret mécanisme de toute l’histoire de Russie : les instincts et les passions du peuple, sa nature inquiète et fantasque, trouvent en elle leur justification morale, la loi historique de leur noblesse et de leur ignominie. Comme une lueur brusque, elle illumine au plus profond la vie du peuple des moujiks, perçant l’obscurité des siècles les plus reculés. Le drame de la Russie moderne révèle ses lois antiques, sa fatalité, son immuable climat. Dans le vaste horizon de la logique de Lénine, la Tour de Westminster et la Tour Eiffel font pendant aux coupoles asiatiques de Vassili Blajenni ; cet horizon n’embrasse pas seulement la Russie, mais l’Europe. Lénine n’est pas seulement russe, typiquement russe, ainsi que l’affirme Trotsky. Il n’est pas le héros de Carlyle, ou l’homme représentatif d’Emerson, mais l’expression antithétique de la nature russe, contre laquelle toute sa logique réagit. Il pourrait être aussi bien Français ou Allemand, que Russe. Cet « optimisme combattit », ce côté de son caractère qui, d’après Gorki, n’avait rien de russe, bien que Lénine lui parût « le type même de l’intellectuel russe », Gorki le considère comme une des qualités caractéristiques du moujik. Pour Trotsky, Lénine est un véritable moujik. « Cet intellectuel typique, n’est-il pas tout ce qu’il y a de plus russe, de plus local ? N’est-ce pas un bonhomme de Stambov ? » jette-t-il non sans ironie, dans sa réponse à Gorki. Pour lui, Lénine est un vrai moujik, bien qu’il n’ait pas « le talent de conduire les poux en laisse, qui est un talent, à vrai dire, indiscutablement russe, un vieil art national ». Ce n’est que plus tard, à propos de la révolution puritaine d’Angleterre, que Trotsky notera chez Lénine quelque chose que l’on ne retrouve pas dans le caractère des moujiks, ce trait qui rend Lénine moderne et le léninisme actuel. « S’il faut comparer Lénine à quelqu’un, écrit Trotsky, ce n’est pas à Bonaparte, et bien moins encore à Mussolini, c’est à Cromwell et à Robespierre qu’il faut le comparer. On est en droit de voir en Lénine le Cromwell prolétarien du XXe siècle. Cette définition doit être la plus haute apologie du Cromwell petit-bourgeois du XVIIe siècle. » Ce n’est pas le côté moujik, c’est plutôt le côté petit-bourgeois qui peut faire comparer Lénine à Cromwell et à Robespierre.
Il n’a certainement ni l’air d’un paysan de Simbirsk, ni l’esprit d’un moujik, ce jeune Vladimir Ilitch Oulianov qui paraît pour la première fois dans les réunions révolutionnaires de Pétersbourg. Presque tous ses biographes, préoccupés de soumettre sa vie et son œuvre à cette fatalité à laquelle obéissent les héros de Plutarque, et d’interpréter sa pensée, ses actes et sa volonté comme on interprète les rêves, ont fait de Lénine une manière de héros du marxisme, descendant dans les couches profondes de la société comme Orphée aux Enfers. Cette préoccupation de soumettre les débuts de Lénine aux fois de la fatalité ne va pas jusqu’à interpréter les rêves de sa mère pour voir si Maria Alexandrovna Oulianovna, comme la mère d’Alexandre de Macédoine, a rêvé que la foudre de Zeus la frappait, et que, de son ventre ainsi fécondé, il jaillissait des flammes qui mettaient le feu au palais. Mais presque tous ses biographes se sont efforcés de nous donner une image de Wladimir Ilitch qui ressemble assez à un Saint-Georges aux yeux obliques, dont les paroles et les gestes les plus insignifiants révélaient à ses auditeurs des parlotes socialistes de Samara, de Kazan et de Pétersbourg, le génie et la volonté d’un jeune Dieu. Pour guérir les biographes de Lénine du romantisme de certaines interprétations, il faudrait que Gide consentît à regarder de près le jeune Wladimir Ilitch. Mettez Lénine à la place d’Œdipe, vous verrez ce que Gide en tirera.
En réalité les débuts de Lénine ne pouvaient être plus communs, dans cette Russie fin de siècle où le fanatisme petit-bourgeois allait du libéralisme terroriste au christianisme pourri de Tolstoï. Wladimir Ilitch Oulianov, fils du directeur des écoles primaires du gouvernement de Simbirsk (il est né à Simbirsk, sur le Volga, le 10 avril 1870), issu d’une famille de cette petite bourgeoisie dans laquelle le tsarisme recrutait ses plus humbles fonctionnaires et la révolution ses nihilistes les plus redoutables, n’était qu’un petit avocat de province, inscrit au barreau de Samara, sur le Volga, qui se rendait à Pétersbourg pour s’initier à l’existence médiocre de clerc d’avoué. Sa mère était fille d’un médecin militaire. Femme douce, patiente, éprouvée par la douleur, elle avait mis tout son espoir dans son fils cadet Wladimir. En dépit de ses idées socialistes qui n’avaient pas manqué d’attirer sur lui la bienveillance de la police, Wladimir Ilitch n’avait rien d’un jeune Gengis-Khan prolétarien. C’était un étudiant sans fortune, que la perte de son père, et la fin tragique de son frère aîné Alexandre, avaient plongé dans une sombre tristesse. Son affection pour sa mère, et sa volonté de s’instruire, n’illuminaient que faiblement sa rassurante médiocrité. Jusqu’à 1887, les rapports scolaires n’avaient rien révélé d’anormal ou de dangereux dans son caractère, si ce n’est « une réserve excessive, une sorte d’insociabilité avec les siens aussi bien qu’avec ses camarades de classe ». Cette réserve excessive, et cette insociabilité, ne pouvaient être attribuées qu’à sa timidité, le trait le plus marqué, déjà, de son caractère. Même après la mort de son frère aîné, Alexandre, accusé de complot contre la vie du tsar et pendu en 1887 dans la forteresse de Chlisselbourg, le directeur du « gymnase » de Simbirsk, Fédor Kerensky, père de ce même Kerensky à qui Lénine devait montrer, plus tard, les avantages d’une bonne éducation bourgeoise, notait avec satisfaction : « Wladimir Ilitch, très doué, constamment appliqué, a été le premier dans toutes les classes. La religion et une prudente discipline ont été à la base de cette éducation familiale, dont l’excellente conduite d’Oulianov a mis en évidence les heureux effets. » Sur sa vie d’étudiant, on ne rapporte rien, pas un geste, pas un incident, qu’on ne retrouve dans la médiocre histoire de n’importe quel étudiant de cette Russie « fin de siècle ». Le fait que la police ait eu les yeux sur lui et qu’il ait été expulsé de l’Université de Kazan, ne prouve rien. Ce n’étaient point ses idées socialistes, ni le fait qu’à Alakaïevka, près de Samara, il passait, à ce que raconte sa sœur Marie, ses journées dans le jardin à lire le Capital de Marx, en remplissant des cahiers de notes et de résumés, ni son goût des discussions politiques, ni son humeur sombre et froide, qui faisaient de lui, aux yeux de la police, un sujet dangereux, un ennemi de la société, un révolutionnaire redoutable, mais bien le fait qu’il y avait dans sa famille un pendu : ce jeune terroriste aux yeux clairs, aux cheveux frisés, au visage innocent et rêveur de jeune Anglais du temps de la Reine Victoria. En me montrant le portrait du frère de Lénine au Musée de la Révolution, à Moscou, l’ouvrier qui m’accompagnait, un de ces ouvriers communistes de la génération d’octobre 1917 qui, tout en travaillant à l’usine, suivent les cours de sciences politiques à l’Université, me faisait remarquer l’air innocent et rêveur de ce visage d’adolescent. « Rien ne m’empêche de penser, me dit-il, que, si la corde ne l’avait pas retenu, ce pendu se serait envolé dans le ciel, par-dessus la forteresse de Chlisselbourg, comme un ange rouge. » C’est ce même ouvrier, et dans ce même musée, qui me faisait noter, devant la photographie de toute la famille Oulianov, groupée autour du bon Ilia Nicolaïevitch, que le père de Lénine avait la main droite passée dans le revers de sa redingote, comme Napoléon. « C’est un geste bien bourgeois », me dit-il.
Il ne semble pas que le souvenir de la fin tragique de son frère ait, comme le laissent croire ses biographes, obsédé la jeunesse de Lénine. Il n’en parlait presque jamais, et n’avait pas grand plaisir à constater que la sympathie qu’on lui manifestait dans les milieux socialistes de Kazan, de Samara et de Pétersbourg, n’allait qu’au frère d’Alexandre Ilitch, martyr de la cause révolutionnaire du peuple russe. Ce petit avocat de province, qui faisait à Pétersbourg métier de clerc d’avoué et profession de marxisme, n’a laissé chez ses camarades aucun souvenir particulièrement frappant de ses débuts d’agitateur révolutionnaire. Les biographes les plus officiels, de Trotsky à Zinoviev, ne rapportent pas de lui le moindre trait de caractère quelque peu singulier. Son ami Krjijanovski, qui joue actuellement un rôle fort important dans la réalisation du Plan Quinquennal, ce même Krjijanovski à qui Lénine racontait un jour qu’à l’âge de seize ans, brusquement persuadé de l’inexistence de Dieu, il avait arraché de son cou une petite croix, avait craché sur « cette pieuse relique » et l’avait jetée à terre, est tout aussi sobre en souvenirs personnels sur les débuts de Vladimir Ilitch, que le Plutarque du Kremlin, Jaroslavski, devenu maintenant le grand Inquisiteur du parti communiste en Russie en même temps que le chef des besbojniki, des sans-Dieu. Pour nous raconter sa jeunesse, les biographes officiels de Lénine sont obligés de l’inventer. De là cette légende d’un Gengis-Khan prolétarien, héros de la volonté, de l’action et de la violence.
Chez ce jeune homme de vingt-quatre ans, que l’ingénieur Krassine présentait un jour à l’ouvrier Chelgounov, chez cette espèce d’étudiant qui avait l’allure d’un petit employé, trapu et voûté, avec un vaste front jauni par la calvitie, un visage ridé et semé de taches de rousseur, une barbe rousse embroussaillée, chez ce jeune homme déjà vieux, aux mains courtes, blanches et grassouillettes qui semblaient, tandis qu’il parlait, extraire les mots de ses poches et les modeler fébrilement, de leurs doigts désossés, comme des boulettes de pain, personne n’aurait pu voir le Lénine qu’on a inventé plus tard, ce révolutionnaire hanté par le souvenir du meurtre de son frère, cet homme décidé à l’action, et prêt à payer de sa vie la liberté du peuple. C’est Chelgounov lui-même qui nous a laissé son portrait : le seul portrait authentique de Lénine, du temps de son premier séjour à Pétersbourg. Il parlait beaucoup à cette époque, et même trop : il ne perdait jamais l’occasion, au cours des parlotes révolutionnaires, d’intervenir dans là discussion pour débiter ses statistiques, ses citations du Capital, ses remarques sur les déviations de la doctrine marxiste clans les interprétations des chefs les plus en vue du mouvement socialiste en Russie. Il avait la tête bourrée de formules et de chiffres. Quand on lui parlait de son frère, il répondait par des statistiques. Lénine méprisait les terroristes ; c’est avec un profond dédain qu’il parlait de la Narodnia Volia, l’organisation révolutionnaire dont avait fait partie son frère Alexandre Ilitch, et il ne manquait jamais de dénoncer ses affiliés, les populistes, comme les plus dangereux ennemis de la cause prolétarienne. On sentait qu’au fond il désapprouvait secrètement le sacrifice de son frère. Le terrorisme ingénu et cruel de la Narodnia Volia, cette mystique de la dynamite, n’était pas de son goût. La violence aveugle et fanatique des populistes n’était pas celle qui, dans la paume de sa main courte et blanche, avait gravé les lignes de la volonté et de !a vie, celle qui, selon l’expression de Trotsky, « mettait du métal dans son caractère ». Lénine sentait bien que, pour avancer dans la voie de l’action révolutionnaire, il lui fallait se débarrasser de tout romantisme, de même qu’il s’était débarrassé du souvenir d’Alexandre Ilitch. Longtemps, la corde à laquelle on avait pendu son frère avait lié ses mouvements, jusqu’au jour où il avait eu le courage de couper, comme une corde, le souvenir d’Alexandre Ilitch. « Quand Lénine m’en a parlé pour la première fois, en faisant le geste de couper quelque chose, je me suis tout de suite représenté cette scène », racontait Chelgounov. C’est au cours d’une visite à un club ouvrier du faubourg de Viborg, à Leningrad, qu’une image populaire en couleurs, collée au mur sous un portrait de Lénine, m’a rappelé ce geste : dans la cour d’une usine, dominée par une haute cheminée, au milieu d’une foule d’ouvriers émus devant ce miracle, Lénine, impassible, lève sa barbiche rousse pour suivre au loin, au-dessus du gibet de la forteresse de Chlisselbourg, un pendu qui s’envole dans un ciel brumeux « comme un ange rouge ».
En juin 1929, je me trouvais à Leningrad, où je m’étais rendu pour recueillir des témoignages directs sur la vie de Lénine dans cette ville, de l’automne de 1893 à la fin de 1895. Des amis de Moscou m’avaient adressé dans ce but au camarade Ivanov, lié d’une profonde affection avec le vieux Chelgounov, devenu complètement aveugle après la mort de Lénine, mais dont le fanatisme avait encore des reflets d’acier, « comme un couteau dans le noir ». Le camarade Ivanov, vieil ouvrier d’esprit inquiet et large, d’intelligence claire et froide, est un des hommes les plus intéressants que j’aie connus en Russie : communiste sincère, sans doute, mais véritable Européen, bien que l’Europe, dans la géographie de l’esprit, soit pour les communistes orthodoxes un continent défendu. Il avait été l’un des correspondants de l’ancienne Iskra pour le faubourg de Viborg, et il avait pris une part active au coup d’État d’octobre 1917, parmi les gardes rouges d’Antonov-Ovseienko. C’est à lui que je dois la révélation de ce Lénine de vingt-quatre ans, violent et timide, profondément dégoûté de l’action directe, et porté bien plutôt aux discussions, à la polémique, aux luttes personnelles, aux intrigues et aux manœuvres d’assemblée, à l’intransigeance absolue sur le terrain de la doctrine marxiste et à l’opportunisme le plus autoritaire sur le terrain de l’action révolutionnaire. C’est le camarade Ivanov qui m’a donné la possibilité de rassembler, sur les débuts de Lénine, sur la formation de son caractère, sur les hommes, les faits et le milieu qui ont contribué à donner une méthode et un but à son intelligence et à sa volonté, les témoignages les plus directs, les traits les plus caractéristiques, les données les plus singulières. Il est suffisamment exempt de préjugés bourgeois, je dirais même de préjugés prolétariens, pour sourire sans méfiance de la légende qui s’est créée, tant en Europe qu’en Russie, autour de la figure de Lénine : « On en a fait un monstre, disait-il : c’était un bonhomme comme bien d’autres. »
De même qu’on ne saurait se rendre compte des ambitions, des inquiétudes et des circonstances qui ont dominé la jeunesse de Robespierre, de Bonaparte ou de Lloyd George, si l’on n’a jamais vu Arras, Brienne-le-Chateau, et le sauvage pays qui s’étend aux pieds du Snowdon, dans le comté de Carnarvon, il me fallait, pensait-il, voir de près les rues et les maisons des quartiers de Pétersbourg où avait habité Lénine, la foule à travers laquelle il avait marché lentement, d’un pas lourd et distrait, les poches bourrées de livres et de journaux, un regard de noyé dans ses yeux de Mongol. Les journées étaient chaudes, le vent d’Est soufflait déjà sur la ville la grande fièvre de l’été : glissant du Nord dans le ciel vert, l’étrange clarté des premières nuits blanches prolongeait jusqu’à l’aube l’inquiétude des soirées tièdes et transparentes. Nous nous promenions souvent ensemble, après de longues heures passées dans les usines et les clubs ouvriers. Un soir que nous nous trouvions sur le quai de la Fontanka, dans les alentours de la Place aux Foins, cette fameuse Sennaïa qui forme le centre d’un des quartiers les plus pittoresques et les plus sordides du vieux Pétersbourg, Ivanov me proposa d’aller voir la maison de Dostoïevski, au numéro 14 du Stoliarny Péréoulok, la première ruelle à droite en sortant de la Sennaïa. « C’est dans ce quartier, plus encore que dans le faubourg de Viborg, me dit-il, c’est dans ces rues étroites et misérables, peuplées de vagabonds, d’ivrognes, de prostituées, d’étudiants, de juifs, de petits employés, d’artisans pauvres, que s’exerçait l’activité secrète de la jeune Russie révolutionnaire d’il y a quarante ans. C’est là que les socialistes élevés à l’école de Plekhanov venaient des provinces les plus lointaines pour se rencontrer avec les terroristes de la Narodnia Volia. » C’était l’époque des grandes aspirations et des grandes incertitudes. La généreuse illusion des populistes, ce rêve romantique de la régénération du peuple russe par la dynamite, jetait encore un trouble profond dans la conscience des jeunes, que les premiers apôtres du socialisme scientifique en Russie, les Plekhanov, les Axelrod, les Martov, réfugiés depuis peu à l’étranger, s’efforçaient de soustraire à l’influence du romantisme terroriste de Mikhaïlovski. C’est dans le quartier de la Sennaïa qu’avaient lieu les réunions secrètes ; c’est là que Lénine fit son apparition dans ces parlotes révolutionnaires, où les disciples de Plekhanov opposaient les doctrines du socialisme scientifique de Marx aux passions violentes et à la sombre illusion des terroristes.
Tous ceux qui ont alors connu et approché Lénine, se souviennent vaguement de lui comme d’un jeune homme d’un caractère froid et réfléchi, extrêmement timide, qui n’aimait pas la compagnie des gens dangereux et affectait un profond mépris pour les fanatiques de l’action directe. Ces populistes dévorés d’une fièvre de complots et d’attentats lui paraissaient gens équivoques, dont il était nécessaire de se méfier. Leurs propos violents n’éveillaient en lui qu’une prudence ironique. Quelques-uns des populistes les plus ardents, de même que, plus tard, en 1905, certains socialistes révolutionnaires, allaient jusqu’à le juger froussard. Certes, son extrême timidité, qu’il s’efforcera de masquer sa vie durant, par la violence des paroles et des gestes et la méchanceté d’un rire guttural, ne se révélait pas seulement dans son mépris pour les méthodes des terroristes. « Il n’a de courage que dans la discussion », dira-t-on de lui en 1905. Lénine aurait sans doute passé inaperçu dans les milieux socialistes de Pétersbourg, si le souvenir du sacrifice de son frère, Alexandre Ilitch, n’avait attiré sur lui l’attention de ceux-là même à qui il inspirait le moins de bienveillance. Lénine était pour tous « le frère du pendu ». Cette parenté, pour un homme qui se disait lui-même « un révolutionnaire professionnel », ouvrait la perspective d’une belle carrière. Ce n’est qu’à ce titre qu’il était accueilli partout, admis dans les réunions clandestines, initié aux secrets des cercles révolutionnaires.
Si Lénine n’avait pas été « le frère du pendu », on n’aurait pas toléré ses critiques du marxisme russe et son mépris des « vieux ». On attribuait son parti-pris à l’égard des plus vieux et des plus respectés des disciples de Plekhanov, comme son dédain des populistes les plus en vue, au bovarysme révolutionnaire qui caractérisait la jeunesse marxiste des provinces, et à la préoccupation de se mettre en avant par l’originalité des vues et des attitudes. En décembre 1893, Lénine se rendit à Moscou pour assister à une réunion secrète. Il n’était qu’une recrue, et ce fut au milieu de l’indifférence générale qu’il prit la parole pour réfuter les arguments d’un orateur populiste, Vorontzov, très connu dans les milieux révolutionnaires de Moscou. « Je n’ai jamais lu Marx ? l’interrompit Vorontzov, quand il s’entendit reprocher son ignorance de la doctrine marxiste : je veux bien admettre que vous êtes le fils de Marx, mais je ne peux pas croire que vous soyez son fils unique. » Lénine racontait plus tard à Vera Zassoulitch que ce Vorontzov lui avait révélé pour la première fois sa véritable vocation : devenir le fils unique de Marx. « Voilà ce qui s’appelle une idée claire ! » disait-il en riant. En général, ses idées n’étaient pas alors très claires. À Krassine, qui lui reprochait un jour son manque d’enthousiasme et sa critique trop facile et trop commode des résultats de trente années de lutte révolutionnaire en Russie, « le marxisme, répondit-il, n’est pas une doctrine fondée sur des sentiments, mais sur des statistiques ». Il ajouta que la révolution prolétarienne ne serait possible que le jour où il y aurait en Europe quelques hommes, trois ou quatre, capables de comprendre Marc. « Et Kautsky, et Plekhanov, et Martov ? » répliqua Krassine. « Mais ils n’ont jamais rien compris au marxisme ! » murmura Lénine, d’un air indulgent et triste. « Je vous ferai connaître un jeune homme, disait à l’ouvrier Chelgounov l’ingénieur Krassine, qui pourrait vous être fort utile : mais à condition que vous n’en ayez pas trop besoin. »
C’est d’un collaborateur comme Lénine que Chelgounov avait besoin. Ce jeune homme timide et gauche, sa mise, sa démarche, sa manière de gesticuler en rentrant les deux bras dans les épaules et en écartant les coudes comme un paralytique, ses yeux mi-clos qui lui donnaient un air dégoûté et distrait, ne pouvaient pas faire grande impression sur les ouvriers que Chelgounov était arrivé à grouper autour de lui dans le faubourg de Viborg. Mais ce qu’il fallait à Chelgounov, ce n’était pas un de ces agitateurs à la Vorontzov ardents et imaginatifs, aussi dangereux qu’utiles dans une organisation clandestine. Il lui fallait un homme froid et réfléchi, capable de jouer chez les ouvriers le rôle qu’avait joué Plekhanov près des intellectuels. Lénine n’allait pas seulement l’aider à créer une véritable association révolutionnaire de travailleurs, et à garder le contact avec les éléments intellectuels du socialisme russe : il assumerait surtout la tâche de rédiger les tracts et les brochures de propagande, d’expliquer, le marxisme aux ouvriers, de « prolétariser » Marx. Esprit clair et simple, doué de bon sens et de perspicacité, ignorant, mais sans présomption, Chelgounov ne cherchait pas en Lénine une figure de premier plan, un de ces intellectuels d’école allemande et de tradition européenne, qui consacraient leur vie au peuple tout en le méprisant. Il ne cherchait en lui qu’un collaborateur de bonne volonté, disposé à mettre sa connaissance des théories marxistes au service de la classe ouvrière, non point dans des réunions d’intellectuels mais chez les travailleurs des faubourgs de Poutilov et de Viborg. Ce n’est que beaucoup plus tard, après le congrès de Londres de 1903, que Chelgounov se rendit compte qu’il avait été le premier à saisir et à savoir mettre à profit, chez Lénine, ce fanatisme opportuniste qui manquait à la plupart des intellectuels socialistes de Russie, divisés comme ils l’étaient entre le fanatisme sans opportunisme des populistes et l’opportunisme sans fanatisme des disciples de Plekhanov. Krassine non plus, lorsqu’il présenta à Chelgounov « le frère du pendu », ne soupçonnait sans doute pas que, de ce clerc d’avoué, d’aspect si commun, et qui avait l’air si timide et si méfiant, il fût possible de faire autre chose qu’un rédacteur de brochures clandestines.
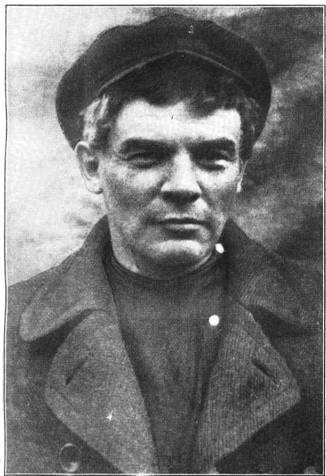
LÉNINE DÉGUISE EN OUVRIER ET AFFUBLÉ D’UNE PERRUQUE
À LA VEILLE DE LA RÉVOLUTION D’OCTOBRE
Le rôle joué par Lénine dans les premiers cercles ouvriers organisés par Chelgounov, est déjà celui qu’il va jouer, sur un rayon de plus en plus vaste, dans la social-démocratie russe jusqu’au congrès de Londres de 1903, et, après ce congrès, dans le parti bolchevique. Il s’agissait d’organiser des noyaux marxistes au sein des masses de travailleurs, de créer des élites ouvrières, de veiller à l’éducation de leur esprit révolutionnaire, de combattre par tous les moyens les déviations romantiques et doctrinaires, de soustraire ces élites aussi bien à l’influence des terroristes qu’à celle des disciples de Plekhanov. « Il nous faut créer, disait Lénine à Chelgounov, un instrument de lutte n’obéissant qu’à nous, que nous soyons les seuls à avoir en mains. Il nous faut des purs. » Le mot purs ne signifiait pour lui que des hommes soumis à sa seule volonté. C’est le sens que Cromwell donnait au mot puritain, Robespierre au mot Jacobin. Dans la logique du « fils unique de Marx », comme l’avait appelé Vorontzov, la lutte révolutionnaire ne consistait que dans l’emploi de tous les moyens servant à entamer le prestige, l’autorité des intellectuels, et à dissiper l’auréole d’héroïsme des terroristes les plus en vue. Mais les moyens de Lénine, et cela ne manquait pas d’exciter la méfiance des travailleurs et de Chelgounov lui-même, n’étaient que des moyens pacifiques : la critique des doctrines et des méthodes des adversaires, la polémique personnelle, la diffamation la plus sourde, l’opportunisme le plus prudent. Du point de vue de son apport à l’interprétation des théories marxistes, les tracts de propagande qu’il imprimait clandestinement, comme la brochure intitulée Ce que sont les amis du peuple et comment ils combattent les social-démocrates, que Jaroslavski appelle « une œuvre très sérieuse », étaient tout à fait insignifiants. « Il y démontre, écrit ce même Jaroslavski, biographe officiel de Lénine, que les belles paroles des écrivains populistes sur le peuple sont, en réalité, pernicieuses au peuple ; qu’il est impossible d’arrêter le développement du capitalisme, mais qu’il faut l’étudier, en découvrir les lois, trouver et organiser les forces capables de le détruire. » Cette brochure, que de simples travailleurs ne pouvaient arriver à comprendre, ne fut pas accueillie sans méfiance par les élites ouvrières de Poutilov et de Viborg. Elle n’attira l’attention des intellectuels que par les insinuations, dont elle était remplie, sur les résultats de trente années de lutte révolutionnaire et sur les hommes les plus représentatifs du socialisme russe. Mais Lénine ne se bornait pas à saper le prestige des intellectuels dans des brochures clandestines. Au début de l’année 1895, dans un recueil d’études marxistes qui parurent sous le titre Matériaux pour caractériser le développement économique de la Russie, à côté de la signature de Strouve, social-démocrate des plus modérés, bien connu pour son interprétation libérale des théories de Marx, on voyait figurer la signature de Wladimir Ilitch, sous le pseudonyme de Touline, qu’il devait abandonner plus tard pour celui de Lénine. L’article signé Touline était plein des mêmes insinuations, que celles répandues à mots couverts sur les populistes et sur les disciples de Plekhanov, par les amis de Strouve. Collaborer avec Strouve contre les plus honnêtes, les plus fidèles marxistes de Russie, c’était passer à l’ennemi, faire œuvre de provocation et de désagrégation. « Nous, nous risquons la prison et même la mort, écrivait à Véra Zassoulitch un populiste très en vue : Wladimir Ilitch ne risque que le mépris. »
Lénine ne se souciait pas du mépris, ni de la défiance dont il se sentait entouré. « Je ne suis pas ce que vous appelez un homme d’action », disait-il un jour à Chelgounov, qui lui conseillait de prendre aux luttes ouvrières une part plus active. Au cours de toute sa vie, il se refusera constamment à se laisser entraîner dans le domaine de l’action. En 1905, il ne se décidera à quitter la Suisse, et à retourner en Russie, que trop tard. Lénine assistera aux évènements révolutionnaires de 1905 en spectateur ; il se contentera de prendre des notes et de griffonner des considérations, relatives à la tactique insurrectionnelle, en marge des volumes de Clausewitz sur l’art de la guerre. Au mois d’octobre 1917, au moment décisif de l’insurrection, il se coiffera d’une perruque, se coupera la barbe et les moustaches, se déguisera en ouvrier : il aimera mieux se cacher et se tenir à l’écart que se risquer sur le terrain de l’action et de la violence. En déclarant : « je ne suis pas ce que vous appelez un homme d’action », Lénine n’entendait certes pas s’avouer un froussard ou bien un doctrinaire, un de ces « professeurs de marxisme », un de ces « avocats », incapables d’assumer une responsabilité révolutionnaire. Ce qui lui répugne, c’est de se mêler à la lutte, de prendre part aux évènements. Ce sont les évènements qui le poussent en avant, et qui, parfois, l’entraînent et le dépassent. Il se borne à étudier la nature des phénomènes, à en prévoir les conséquences, à appliquer ses théories aux faits accomplis. Son rôle dans la révolution, depuis sa rencontre avec Krassine et Chelgounov jusqu’à l’insurrection d’octobre 1917, c’est de se forger un instrument personnel de lutte, de grouper autour de lui une poignée d’hommes sûrs, de se créer un parti capable de diriger, au moment décisif, le cours des évènements. Sans jamais perdre de vue les objectifs de la révolution, c’est-à-dire de son parti, il consacre son fanatisme, sa volonté, sa ruse, à combattre tous ceux qui lui portent ombrage, éveillent sa jalousie et sa rancune, froissent sa timidité, tous ceux que leur prestige, leur autorité, leur indiscutable fidélité à la cause de la révolution prolétarienne pourraient amener à le frustrer de son rôle de dictateur au sein de la fraction bolchevique. Si l’objectif du parti c’est la conquête de l’État, son objectif personnel c’est la dictature au sein du parti. Lénine ne se soucie pas d’influer sur les évènements, non plus que de les préparer : il les attend. L’horizon de sa volonté agissante ne dépasse pas les limites du parti. Le champ de son activité se restreint aux discussions théoriques, aux polémiques personnelles, à la lutte sourde, insidieuse, contre tous ceux dont il se méfie, voire ses plus fidèles partisans. Se défier de tous, même de ses propres partisans, c’est être le contraire d’un homme d’action. Dans ces querelles byzantines, qui durent vingt-cinq ans, le fanatisme petit-bourgeois de Lénine trouve son climat d’élection. Ce sont de petits moyens tendant à un but héroïque, qui font la grandeur de Lénine. On avait déjà vu avec Mazarin et avec Robespierre, que ce sont ces petits moyens qui font la grandeur des héros petits-bourgeois.
C’est lui le chef, mais ce sera un autre, en 1905 et en 1917 : ce sera Trotsky, l’homme qui assumera la responsabilité de l’action révolutionnaire. Lénine, ce héros petit-bourgeois, a compris que se mêler à la lutte, chercher à dominer, à régler, ou à faire dévier le cours des évènements, ce n’est pas seulement inutile, c’est dangereux. Il a très bien compris que, pour se trouver à la tête de la révolution victorieuse, il lui suffira de rester à la tête du parti bolchevique. Ce qu’il dirige de Londres, de Paris, de Zurich, ce n’est pas le mouvement révolutionnaire, c’est la lutte contre Plekhanov, contre Martov, contre ses adversaires ; ce n’est pas la révolution russe qu’il prépare, c’est sa dictature personnelle. « La révolution c’est moi », dira-t-il au cours du congrès de Londres de 1903, à quelqu’un qui lui reprochait sa myopie. Sa myopie voyait loin. C’est Trotsky, ce fanatique de l’action, qui se chargera de lui frayer la voie du pouvoir. Il y a dans la jeunesse de Lénine un épisode qui caractérise aussi bien son rôle à venir dans la révolution prolétarienne, que sa profonde répugnance à prendre aux évènements une part active. En janvier 1895, une grève éclate dans l’usine Semiannikov. Tandis que ses camarades, Chelgounov lui-même, se mêlent aux travailleurs et prennent la direction de la grève pour s’efforcer d’en accentuer le caractère révolutionnaire, Wladimir Ilitch, qui était alors âgé de vingt-cinq ans et ne jouait, dans le mouvement socialiste en Russie, qu’un rôle de troisième ordre, ce qui lui permettait de s’exposer sans compromettre le destin de la révolution prolétarienne, Wladimir Ilitch s’enferme chez lui, et là, au milieu de ses livres, de ses papiers et de ses statistiques, rédige une feuille volante destinée aux grévistes.
L’occasion qu’il saisit dans cette grève, ce n’est pas d’agir, mais d’exposer une fois de plus ses théories, de donner des conseils, d’exprimer son profond mépris pour les populistes et les disciples de Plekhanov. Ce n’est point contre la bourgeoisie capitaliste qu’il excite les ouvriers, c’est contre les membres de la Narodnia Volia et contre les « avocats ». Il dénonce aux grévistes les provocations des terroristes, qui voudraient mettre à profit cette grève pour leurs entreprises sanguinaires, et il les exhorte à se méfier des illusions des disciples de Plekhanov, qui voient dans cette grève un danger pour le développement pacifique de la révolution socialiste, et cherchent à étouffer la révolte ouvrière dans la légalité. La prudence de Lénine parut excessive même à ses camarades : on lui reprocha sa conduite équivoque, l’inopportunité de sa tentative de transformer la grève en une question personnelle, en un grief contre les populistes et les représentants les plus respectés du marxisme en Russie ; on alla jusqu’à le traiter de déserteur. Il n’y eut que Chelgounov qui essaya de le défendre. « Chelgounov, écrit Jaroslavski, montra combien il était important de commenter ainsi chaque grève, chaque manifestation de mécontentement, de souligner ce que les ouvriers sentaient, d’expliquer les obstacles qu’ils rencontraient à chaque pas. Ces exemples concrets les amenaient peu à peu à comprendre les causes profondes de leur malheureuse condition. »
À la suite de cet épisode, Lénine décida de se rendre à l’étranger afin d’y rencontrer Georges Plekhanov, Axelrod, Véra Zassoulitch, ces apôtres de l’évangile de Marx qui avaient été les premiers à donner en 1884 un programme socialiste au mouvement révolutionnaire de Russie. De ces « professeurs de marxisme », de ces petits bourgeois aux scrupules téméraires, à l’ingénuité violente, qui s’étaient réfugiés en Suisse pour y chercher le calme et la sécurité nécessaires au développement théorique de la révolution prolétarienne, de leur révolution, l’ancienne terroriste Véra Zassoulitch était la seule ayant su garder quelque goût pour l’action, dans ce Port-Royal du marxisme. Le Plekhanov que Lénine rencontra à Genève, l’air doux et triste, vieilli « par l’exil et par l’opportunisme », n’était plus le Plekhanov du portrait conservé à Moscou, au Musée de la Révolution, avec ses cheveux descendant en grosses mèches sur le front, ses yeux vifs, ses petites moustaches, ses bottes montant jusqu’à mi-cuisse, et sa tolstovskaia d’ouvrier endimanché : beau grand garçon ressemblant plus à un héros de Fenimore Cooper qu’à un philosophe marxiste. Il avait déjà pris, à cette époque, l’allure d’un professeur allemand : barbe grise, yeux brumeux derrière le verre luisant de ses lunettes, sourire contraint, gestes réglés par un rythme plus lent que sa parole. « Que faire ? », demanda l’exilé à ce jeune homme de vingt-cinq ans qui venait de Russie. Les paroles par lesquelles Plekhanov accueille le frère d’Alexandre Ilitch sont celles-là même que Lénine donnera plus tard pour titre à l’une de ses brochures les plus fameuses. « Voilà. Que faire ? », répondit Lénine.
Ces deux petits bourgeois, ces deux doctrinaires violents et timides, prennent bien garde de se révéler, à cette première rencontre, leur commun dégoût pour l’action, leur profonde répugnance à soumettre leurs théories aux lois des évènements. Ils se méfient l’un de l’autre. Si les Russes n’étaient pas naturellement bavards, Plekhanov et Lénine n’échangeraient pas un mot. Afin de cacher leur jeu, ils se déclarent convaincus de la nécessité d’une action énergique réveillant, chez le peuple russe, l’esprit révolutionnaire. Lénine tient des propos violents, s’attarde à des considérations minutieuses, appuyées par des statistiques, sur l’état d’esprit des ouvriers russes, se déclare opposé à la tactique opportuniste. En parlant, il cligne des yeux, penche la tête, observe Plekhanov. Le vieux Georges semble transfiguré par la présence de Lénine : sa voix monte d’un ton, ses yeux myopes se dégagent de ses lourdes paupières, s’illuminent d’un éclair de jeunesse. Il a peur de paraître vieux aux yeux de ce jeune révolutionnaire venu de Russie : il ne veut pas qu’on le croie dépassé. Il renie l’opportunisme de ses disciples. Il se déclare de l’avis de Wladimir Ilitch, « tout à fait de son avis », et va jusqu’à donner sur les populistes des jugements favorables. « Il faut tenir bon », dit-il. « Nous tiendrons », répond Lénine. Axelrod et Véra Zassoulitch se regardent en souriant, comme si, de la rencontre de ces deux hommes, l’apôtre du marxisme et la jeune recrue, une ère nouvelle allait s’ouvrir pour la révolution prolétarienne. Lénine sait bien que Plekhanov ment, qu’il ne croit pas aux paroles qu’il prononce, que son attitude n’est pas sincère. Mais ce dont Plekhanov ne se rend pas compte, c’est que Lénine non plus n’est pas sincère, que son voyage à Genève a un but secret, que sa rencontre avec le chef du marxisme russe ne doit servir qu’à faire oublier, dans les milieux révolutionnaires de Pétersbourg, aussi bien son étrange conduite lors de la grève de l’usine Semiannikov que son attitude méprisante à l’égard des disciples de Plekhanov.
On a prétendu qu’il n’y avait pas seulement, dans son jeu, l’astuce d’un homme qui ne se sent pas suffisamment fort pour se révolter ouvertement contre les préjugés, les opinions et les méthodes de la vieille école ; qu’il avait subi, malgré lui, l’influence du prestige de Plekhanov et d’Axelrod, et qu’une sorte de respectueuse sympathie pour ces honnêtes et fidèles apôtres de Marx entrait peut-être pour quelque chose dans sa démarche. Il est certain qu’il rentra en Russie profondément convaincu de la loyauté et de la bonne foi de Plekhanov et d’Axelrod. Même après le congrès de Londres, quand il exposait cyniquement, en public, les raisons de sa rupture définitive avec les chefs de la social-démocratie russe, il ne cachait jamais à ses plus proches amis, une nuance de regret sincère pour ce qui s’était passé entre eux. « C’était nécessaire », disait-il. Inflexible aussi bien dans son intransigeance que dans son opportunisme, imperturbable dans ses théories, téméraire dans son fanatisme doctrinaire, et conséquent dans sa logique jusqu’à l’absurde, Lénine restera toujours un faible devant les hommes et devant les évènements. Dans le domaine de la réalité et de l’action, il subira toujours la volonté des autres. La personnalité de ses collaborateurs, même celle de ses adversaires, ne cessera jamais d’influer sur ses actions et sur ses réactions. Ce qui est caractéristique chez lui, comme chez tout petit bourgeois fanatique, c’est le courage intellectuel, ce courage abstrait que les Anglais appellent « cérébral ». Les conséquences pratiques, humaines, de ses idées et de sa doctrine révolutionnaire, les massacres, la famine, la destruction, lui font peur ; il les accepte avec un profond dégoût, ou bien les subit timidement. Au milieu des hommes et des évènements, il est toujours tel que nous le décrit Henri Guilbeaux (le seul Français qu’il comptât parmi ses amis les plus dévoués) au milieu des soldats et des ouvriers, dans les meetings de Petrograd et de Moscou : « simple, modeste, timide, juste, équitable, humain, camarade ».
À son retour en Russie, pendant l’automne de 1895, Lénine se remet au travail, sombre et décidé. Il fonde, à la fin de septembre, avec Chelgounov et d’autres camarades, la Ligue de combat pour l’affranchissement de la classe ouvrière. « À cette époque, raconte Jaroslavski, le mouvement gréviste commence dans la capitale et dans les centres industriels. Les clubs ouvriers accomplissaient leur œuvre, éveillant chez les travailleurs la conscience de la nécessité de la lutte. Vladimir Ilitch écrivit pour les grévistes des feuilles volantes et des proclamations. Lénine reste fidèle à son caractère et à sa méthode. Enfermé dans sa chambre, loin des clameurs de la lutte, penché sur ses papiers, sur ses notes, sur ses statistiques, il attend les évènements. Dans cette misérable chambre au cœur du vieux Pétersbourg, comme à Londres, comme à Paris, comme à Zurich, il ne fait que les attendre. Que lui reproche-t-on ? Que veut-on de lui ? A Chelgounov, qui se mêle aux ouvriers et incite les travailleurs à la lutte armée contre les oppresseurs du peuple, il répond qu’il n’est pas un meneur de grèves. À Trotsky, lançant ses gardes rouges à la conquête de l’organisation technique de l’État, il répondra plus tard qu’il n’est pas un faiseur d’insurrections. Son rôle est d’une autre nature, d’une importance autrement décisive : c’est de veiller à la pureté de la doctrine marxiste, de dicter les lois de la lutte, de donner des règles à l’esprit révolutionnaire et de tirer la leçon des évènements. C’est le rôle de Robespierre. « Robespierre était l’homme de la loi et de la justice ; il signait des décrets ». Aux autres d’agir, d’appliquer jusqu’à leurs dernières conséquences les règles établies par lui. Mais s’il faut payer, il prendra sa part de responsabilité. Dans sa volonté de payer cette part, il y a de la résignation.
Dans la nuit du 8 au 9 décembre 1895, alors qu’il se prépare à lancer parmi les travailleurs de Pétersbourg le premier numéro d’une feuille illégale, La Cause ouvrière, Lénine est arrêté avec tous les chefs de la « Ligue de combat ». On perquisitionne chez lui : on ne trouve que des papiers, des livres, des cahiers remplis de notes et de statistiques. À côté de Chelgounov, de Babouchkine, de Krjijanovski, de Radchenko, de Starkov, sombres et taciturnes, Lénine se montre tranquille et souriant. La prison, pour des hommes comme Chelgounov, c’est la fin de toute possibilité d’agir, de se mêler aux évènements, de prendre part à la lutte révolutionnaire. Pour Lénine, la prison n’est qu’un incident ennuyeux qui ne lui enlève pas la possibilité de persévérer dans sa méthode, de poursuivre son but, d’étudier, comme il dit, la mécanique des évènements, qui ne l’empêche pas, surtout, de griffonner des notes sur ses cahiers et de continuer ses lectures. L’histoire qui s’accomplit dans les usines et dans les rues des faubourgs ouvriers, ne l’intéresse pas. Le développement de la lutte révolutionnaire suffirait-il à changer l’histoire du peuple russe ? Ni grèves, ni révoltes ne donneront jamais une logique à la révolution prolétarienne. « Les martyrs et les héros, dit-il, ne sont pas nécessaires à la cause de la révolution : il lui faut une logique. » C’est lui qui doit apporter cette logique. Pour Lénine, la seule histoire qui compte, c’est celle qui se déroule en lui-même, qu’il crée, qu’il invente au jour le jour, sur la base de ses observations, de ses considérations, de ses statistiques. Comme tous les petits bourgeois fanatiques, il possède une surprenante imagination créatrice, mais une imagination méticuleuse, s’occupant des détails les plus insignifiants, de tous les petits faits entrant dans la composition des grands évènements ; une imagination quelque peu bureaucratique, n’ayant rien du caractère irrationnel, ardent, exalté, qu’on trouve chez le type de héros qui est à l’opposé du héros petit-bourgeois. Par son imagination rationnelle, froide, méticuleuse, Lénine crée en lui-même les conditions favorables au développement arbitraire de la révolution, fixe les lois des évènements, ses lois personnelles, pose les principes de cette logique absurde qu’il donnera un jour à la révolution prolétarienne.
Pendant ses quatorze mois de prison, Lénine ne fait que compulser des statistiques, noter sur des morceaux de papier le résumé de ses lectures, remplir ses cahiers de cette écriture fine et serrée qu’on a comparée à l’écriture d’un poitrinaire. Il travaille à ce Développement du capitalisme en Russie qu’il ne devait achever qu’au cours de sa déportation en Sibérie. À l’occasion du 1er mai 1896, Lénine rédige une feuille volante que des camarades répandent parmi les ouvriers de Pétersbourg. Même en prison il demeure fidèle à son rôle de scribe. En avril 1897, condamné à trois années en Sibérie, Lénine part pour le village de Chouchenskoïe, dans la région du Haut-Ienisseï. C’est dans la calme monotonie de sa vie de déporté qu’il se propose à lui-même les objectifs de son action future, dans une brochure dirigée contre ceux qu’on appelait alors les économistes. « Certains économistes, écrit Jaroslavski, déclaraient que les ouvriers ne devaient pas s’occuper de politique ; qu’ils devaient se contenter de réclamer quelques centimes d’augmentation et abandonner la lutte contre le tsarisme à la bourgeoisie libérale, aux avocats, aux ingénieurs, aux professeurs, aux docteurs. Dans son pamphlet, Les objectifs des social-démocrates de Russie, Lénine posait nettement la question. Il démontrait aux ouvriers qu’ils devaient s’engager immédiatement dans la lutte politique et qu’ils n’avaient rien à attendre de la bourgeoisie. Ce qui a été accompli par la bourgeoisie en Occident, par exemple dans la grande Révolution française, doit être fait en Russie par la classe ouvrière ». Comme toujours, ce clerc d’avoué, ce myope, voyait juste et loin. « Ce que le peuple russe devra faire, dit-il un jour à Nadejda Konstantinowna Kroupskaïa, je l’ai déjà fait depuis longtemps. »
Nadejda Konstantinowna l’avait aussitôt rejoint en Sibérie avec sa mère. C’est sa compagne et sa collaboratrice. Son importance est singulière dans la vie de Wladimir Ilitch, et ne peut que surprendre ceux qui voient en Lénine le Gengis-Khan de la révolution prolétarienne. Femme énergique et d’une intelligence virile, avec ses gros yeux clairs à fleur de tête, son regard doux et lent, ses grosses lèvres, son esprit calme et limité, son caractère patient et résolu, Nadejda Konstantinowna ne sera pas seulement la secrétaire de ce révolutionnaire professionnel, sa collaboratrice infatigable et dévouée, mais sa femme dans le sens le plus bourgeois du mot, celle qui partout, tant à Chouchenskoïe qu’à Londres, à Paris, à Zurich, dans ses mornes années d’exil comme aux jours tragiques de la révolution, dans la chambre meublée de Montrouge comme dans le modeste appartement du Kremlin, veillera sur la santé de Lénine, sur son travail, sur son repos, sur ses loisirs, lui créera un foyer pauvre mais tranquille, un climat de confiance et de bonheur familial. Parfois Wladimir Ilitch penche la tête sur l’épaule, dans son attitude habituelle, et cligne des yeux en riant : « Notre ménage, dit-il, c’est un vrai ménage petit-bourgeois. » Il n’y a pas de reproche dans ces paroles. Lénine aime cette existence paisible au milieu du tumulte, ce calme refuge au cœur de l’Europe malade de guerres et de révolutions. Il lui plait de se sentir entouré d’une attention aussi affectueuse, d’un courage aussi confiant. Aux époques les plus violentes de sa vie, Lénine reste toujours, chez lui, un petit bourgeois menant une existence paisible et modeste. En octobre 1902, quand Trotsky arrive à Londres, un matin de bonne heure, il le trouve encore au lit, dans la petite chambre qu’il partage avec sa femme. Ce Gengis-Khan a l’air bien aimable et bien tranquille. « Sur son visage, raconte Trotsky, l’amabilité se nuançait d’un étonnement compréhensible. » Lénine n’aimait pas être dérangé dans ses habitudes. En 1920, au cours de l’automne, Clara Zetkin se rend à Moscou. « Ma première visite à Lénine au sein de sa famille, raconte Clara Zetkin, confirma l’impression que j’avais eue à la conférence du parti et qui, depuis, s’était renforcée au cours de plusieurs entretiens. Son logement privé était de la plus grande simplicité. Je trouvai la femme et la sœur de Lénine en train de prendre leur repas du soir, qu’elles m’invitèrent immédiatement et très cordialement à partager avec elles. Le repas était frugal, comme l’était celui de n’importe quel employé à cette époque : du thé, du pain noir, du beurre et du fromage. À la fin du repas, pour faire honneur à son invitée, la femme de Wladimir chercha s’il n’y avait pas quelques douceurs et eut la chance de découvrir un petit pot de confitures. Peu après l’entrée de Lénine, lorsqu’une grosse chatte fit son apparition, accueillie par des transports de joie de toute la famille, et qu’elle sauta sur l’épaule du dictateur, puis s’installa sur ses genoux, j’aurais pu croire que j’étais chez moi. »
Lénine, à Chouchenskoïe, n’a que vingt-sept ans, mais il a déjà les allures et les habitudes qu’il gardera toute sa vie. Ordonné, méthodique, cet opiniâtre noircisseur de papier passe de longues heures enfermé dans sa chambre, à développer ses considérations sur les statistiques relatives au développement du capitalisme en Russie, ou bien se promène en compagnie de sa femme dans les bois et dans les prairies qui entourent le village. Il fréquente assidûment les réunions organisées par les déportés, sous l’œil bienveillant de la police, afin de discuter les principes marxistes dans leur rapport avec la situation des ouvriers et des paysans russes. Les jours de beau temps, il prend sa ligne et part à la pêche. Ce jeune homme déjà chauve, assis au bord d’un étang ou d’un fleuve, attentif aux plus légers mouvements du bouchon et qui se tourne de temps en temps vers une jeune femme étendue dans l’herbe à quelques pas de lui, un livre à la main, est déjà ce Lénine, ce « fonctionnaire ponctuel et zélé du désordre » qu’on verra plus tard pêcher au bord de la Seine, à Saint-Cloud, ou prés d’un étang dans les environs de Moscou. Nadejda Konstantinowna lève sur lui ses yeux clairs, et sourit. Quelle soumission dans son regard maternel et préoccupé !
Elle est jeune, à Chouchenskoïe, mais son visage triste porte déjà les marques de la maladie perfide qui la condamne à la stérilité. Elle est déjà cette femme douce et obstinée dont Clara Zetkin dira un jour : « Avec ses cheveux plats tirés en arrière et réunis derrière la tête en un chignon sans art, avec sa robe sans garniture, on aurait pu la prendre pour une femme d’ouvrier usée de fatigue. » Quand elle quittera la Sibérie et suivra Lénine à Munich, elle mettra un petit chapeau bien modeste, et prendra l’air d’une de ces petites bourgeoises allemandes qui vont au marché, suivent les cours de l’Université, visitent les musées et font la soupe chez elles dans ce climat gemütlich des jeunes ménages de la petite bourgeoisie allemande. « Nature profondément maternelle, écrit Clara Zetkin, elle faisait du logis de Lénine un foyer dans le sens le plus noble du mot ». Cette femme stérile avait pour Wladimir Ilitch un amour jaloux, sournois et profond, l’amour d’une mère pour son enfant. Quand il sentait son regard posé sur lui, Lénine levait ses yeux obliques sur cette jeune femme fidèle et modeste, au cœur tendre et fort, et dans ces yeux de Mongol qu’adoucissait la blancheur du visage, Nadejda Konstantinowna lisait toute la faiblesse de ce cœur d’homme violent et timide, au fanatisme méticuleux, aux haines cachées. Elle seule savait que Lénine, qui s’était donné pour mission de combattre la paresse, la bonté, la résignation d’Oblomov, et d’égorger au lit la vieille Europe bourgeoise, avait horreur du sang et n’aurait jamais eu le courage de voir un homme mourir. « Sais-tu ? lui dit-elle un jour à Chouchenskoïe : aujourd’hui, dans la boutique de Zavertnine, j’ai entendu dire quelque chose qui t’aurait fait rire. On disait que le père d’Oblomov s’appelait Ilia, comme le père de Lénine. »
Le soir où nous traversions la Place aux Foins, cette fameuse Sennaïa située au cœur du vieux Pétersbourg, le camarade Ivanov me montra la maison de Dostoïevski, au numéro 14 du Stoliarny Péréoulok : « C’est là, me dit-il, que Dostoïevski a écrit Crime et châtiment, et qu’il a fait loger Raskolnikov ». Il ajouta que Lénine aussi avait habité une des petites ruelles sordides et sombres de ce quartier. Le jour où Wladimir Ilitch sortit de chez lui, vers la fin d’une tiède après-midi, pour se rendre chez Chelgounov, qui l’attendait avec d’autres camarades, et fonder « La ligue de combat pour l’affranchissement de la classe ouvrière », il traversa la Place aux Foins et suivit, jusqu’au coin de la rue Gorokovaia, où le romancier Gontcharov a situé la maison de son héros Oblomov, le même itinéraire que Raskolnikov allant tuer la vieille usurière. Lénine marchait lentement, au milieu de cette même foule de marchands, d’ouvriers, d’ivrognes, de petits employés, de juifs, d’étudiants, de prostituées, dans ce même nuage de poussière, dans ce même tapage assourdissant, qui avaient si bizarrement troublé l’esprit irrésolu de Raskolnikov.
En se dirigeant vers la maison de Chelgounov, Lénine laissait errer de temps en temps ses yeux distraits sur les passants. À son esprit perdu dans une profonde rêverie, la mission de sa vie ne se révélait pas à cet instant comme une lutte héroïque contre les oppresseurs du peuple, une suite d’actions violentes contre la force armée du tsarisme et du capitalisme, mais comme un jeu de sa volonté et de son astuce, une partie d’échecs patiente et méthodique jouée contre les évènements, afin de s’en tenir à l’écart, de ne pas se laisser prendre dans l’engrenage de l’action révolutionnaire et de la réaction bourgeoise. Cette idée claire et simple qui sera toujours à la base de sa tactique personnelle, que, pour se trouver un jour à la tête de la révolution, il lui faut se mettre à la tête du parti révolutionnaire et y rester, se présente à lui pour la première fois, à cet instant, comme une nécessité à laquelle il allait falloir subordonner tous ses calculs et toutes ses décisions. Tandis qu’il se dirigeait vers la maison de Chelgounov, l’idée qu’il allait tuer la vieille Europe bourgeoise ne suscitait pas chez lui les sombres rêves de Raskolnikov allant tuer la vieille usurière Aliona Ivanovna. Sa pensée n’était pas hantée, comme la rêverie du héros de Dostoïevski, par l’image de Mahomet, de Napoléon, de « tous ces bienfaiteurs de l’humanité qui répandirent terriblement le sang ». Ce n’est guère vers le pont d’Arcole qu’il dirigeait ses pas. Ce que Lénine allait accomplir, ce n’était ni un crime, ni un geste héroïque. Il ne sera jamais un grand criminel, un héros à gestes théâtraux, mais un « fonctionnaire ponctuel et zélé du désordre », un bonhomme timide et fanatique, un petit bourgeois faisant modestement tout son possible pour que la révolution prolétarienne soit, comme il le dira plus tard, « la réalisation la plus indolore du socialisme ». Il sentira toujours un mépris, un dégoût profond pour ces hommes féroces, Trotsky, Dzerjinski, Piatakov, Dybenko, qui ont fait de lui le chef d’une révolution sanglante.
En avril 1918, à Moscou, me disait le camarade Ivanov, lors d’un meeting, quand Lénine se montra au peuple massé sur la Place Rouge, un hurlement s’éleva de la foule : « Tu es notre Napoléon ! » crièrent des ouvriers ; Lénine, souriant, se tourna vers Trotsky : « Est-ce que je ressemble vraiment à Napoléon ? » dit-il.
« Pas même à Koutouzov » lui répondit Trotsky d’un air ironique et rêveur.
II
ROBINSON CHEZ LES VENDREDIS
SE trouvant à Londres avec des bombes dans sa chambre d’hôtel, Felice Orsini, cette manière de libéral italien « de noble race, jeune encore, éloquent, aimé des femmes », et qui avait de si respectables tendances au terrorisme, ce qui n’est point la manière la plus correcte d’être libéral, se demandait un jour s’il n’avait pas peur de la mort : « Il prit alors un cab, se rendit au Musée Tussaud, examina la guillotine pour savoir comment on mourait quand on mourait guillotiné, et, là-dessus, il partit pour Paris », décidé à lancer ses bombes. On sait de façon indubitable qu’au cours de son séjour à Londres, Lénine ne s’est jamais rendu au musée Tussaud ni au British Museum (sauf à la bibliothèque), non plus qu’au musée Grévin ou au Louvre à Paris. L’idée de se demander s’il aurait peur de la mort ne pouvait même pas se présenter à son esprit : pas un instant il ne pensera qu’il pourrait mourir au cours d’une révolte ouvrière, ou bien pendu dans la forteresse de Chlisselbourg. Ce révolutionnaire professionnel ne conçoit pas son rôle dans la révolution comme celui d’un héros de Plutarque aux beaux gestes, aux nobles sentiments, prêt à sacrifier sa vie à la rhétorique des historiens. Lénine n’aime pas le danger. Il trouve qu’il n’est pas nécessaire de risquer sa vie pour tâcher de changer le cours des évènements. Il faut laisser les évènements suivre leur cours. Son rôle de révolutionnaire professionnel, c’est de se préparer à s’emparer de la situation à un moment donné, de se créer un parti, de se mettre à la tête d’une poignée d’hommes résolus, et d’attendre.
Quand Lénine revient de Sibérie, en janvier 1900, il comprend tout de suite que sa place n’est plus en Russie : poursuivi de ville en ville par les bienveillantes attentions de la police, traqué par les espions et les agents provocateurs, arrêté de nouveau à Pétersbourg, à peine a-t-il purgé ses trois semaines de prison qu’il traverse la frontière au mois de juillet de la même année, et se rend à Munich. Certains camarades de la « Ligue de combat pour l’affranchissement de la classe ouvrière », n’ont pas manqué de lui reprocher cette « désertion », ce premier pas dans la voie de Plekhanov. L’exil, c’est le commencement de l’évolution vers l’opportunisme. Lénine, une fois détaché des masses de travailleurs, subira fatalement, lui aussi, l’influence déprimante de l’exil, ce climat tempéré si favorable aux renonciations et aux compromis. Mais rester en Russie, ç’eût été pour lui s’exposer à toutes sortes de dangers. Il n’a pas, comme un Trotsky, comme un Staline, comme tant d’autres, le goût des conspirations, de la propagande secrète, de la vie cachée, d’une existence hors la loi, ce goût du danger qu’il considère comme un résidu du romantisme révolutionnaire de la vieille école, comme une manière de romantisme professionnel, dont les populistes ont donné des exemples si nobles et tellement inutiles. Lénine n’est pas un homme d’action, au sens pratique du mot. L’action, pour lui, c’est la polémique, la lutte d’idées, l’interprétation des théories marxistes transportée sur le terrain des antagonismes personnels. Ce qui caractérise ce héros petit-bourgeois, c’est que la liberté lui est nécessaire, qu’il cherche l’ordre, la sécurité personnelle, la tranquillité, qu’il ne peut vivre et agir que dans un climat petit-bourgeois. C’est aussi à son austérité, à son ascétisme, que l’on reconnaît en Robespierre le héros petit-bourgeois qui bouleverse et détruit la société, mais veille soigneusement à la tiédeur paisible et au calme de son foyer. Chez tout héros petit-bourgeois, il y a un bonhomme avare et timide cachant son destin dans un bas de laine.
En exil, à Munich, à Londres, à Paris, à Genève, Lénine ne cherche que sa sécurité personnelle, sa tranquillité, le climat tiède et paisible de l’ordre européen. Cet homme qui vilipende si violemment, dans ses écrits et dans ses discours, les libertés bourgeoises, ne saurait vivre et agir hors la loi, sa vie, sa liberté constamment menacées. En Russie, il ne pourrait pas cacher son destin : la police viendrait fouiller son bas de laine. Dans le premier numéro de l’Iskra qu’il fait paraître à Munich, en décembre 1900, en énonçant le principe fondamental de toute conquête révolutionnaire, Lénine pose pour la première fois sa candidature au rôle de « chef politique, capable d’organiser le mouvement et de le conduire ». Ce rôle, il ne le saurait jouer qu’en Europe. C’est d’Allemagne, d’Angleterre, de France, de Suisse, qu’il expédiera en Russie, clandestinement, sans aucun risque pour lui, les numéros de son journal, l’Iskra, pour propager chez les intellectuels et chez les ouvriers les principes du marxisme, de son marxisme, qui deviendront les principes du léninisme après le coup d’État d’octobre 1917. À l’égard de Plekhanov et d’Axelrod, avec qui il travaillait pour le moment en plein accord, tout en cherchant à se soustraire peu à peu à leur autorité et à leur contrôle, Lénine gardait une attitude de soumission apparente. Pendant les premiers temps de son séjour à Munich, son plus grand soin avait été de dissimuler aux apôtres du marxisme russe établis à Genève les véritables objectifs de son activité de polémiste. Il ne s’agissait pas seulement, pour lui, de faire de l’Iskra l’instrument de la propagande révolutionnaire en Russie, mais surtout l’instrument de son influence personnelle au sein des émigrés, dont les seuls chefs reconnus étaient Plekhanov et Axelrod. Il ne se sentait pas encore assez fort pour imposer un programme personnel à la social-démocratie russe et, tout en acceptant les conseils et la protection du groupe de Genève, qui le considérait non pas tant comme un concurrent éventuel que comme un journaliste dont il fallait surveiller les attitudes et réfréner les ardeurs polémiques, il ne laissait pas échapper une seule occasion de marquer, dans les détails les plus insignifiants, son indépendance de vues et sa liberté d’action. Pour se soustraire au contrôle de Plekhanov et d’Axelrod, il lui était indispensable de se tenir éloigné de Genève le plus possible. Tant qu’il restait à Munich, à la rédaction de l’Iskra, il était maître chez lui. Aussi quand il fut question à la suite des difficultés de tout genre créées par les imprimeurs allemands, de transférer la rédaction de l’Iskra à Genève, qui était alors la capitale de la social-démocratie russe, Lénine trouva le moyen de persuader Plekhanov et Axelrod que c’était à Londres, au cœur du capitalisme et de l’impérialisme bourgeois, qu’il fallait, de l’Iskra (l’Étincelle) « faire jaillir la flamme de la révolution prolétarienne ».
Quand il débarqua à Londres, au mois d’avril 1902, Lénine était un homme de trente-deux ans, déjà chauve, le menton rasé, avec des moustaches à la gauloise, les yeux obliques sous l’arc puissant du front large et bombé, le regard honnête et droit et l’air fort respectable. Si l’on compare au portrait de Lénine à Londres son portrait en Sibérie, avec ses yeux tristes et rêveurs dans son visage maigre, une barbiche rouge à la nazaréenne et un cou mince comme celui d’un phtisique, il est impossible de ne pas s’étonner du changement survenu en si peu de temps dans l’expression de son visage. Dans ce masque mongol, qui a tellement impressionné les bons bourgeois d’Occident, les pommettes n’étaient pas plus saillantes ni les yeux plus obliques que dans le masque de Clemenceau, ce Français de Vendée qu’on eût pu prendre pour un Tartare issu du fond de l’Asie. Il y avait plus de Gengis-Khan chez Clemenceau que chez Lénine, aussi bien dans le masque que dans le caractère. Cependant, on n’a jamais dit que Clemenceau fût un mongol, ni essayé d’expliquer sa politique et sa vie par ses pommettes tartares. De même que les fleuves polissent les pierres, l’histoire parlementaire en France polit les traits du visage et du caractère des grands hommes, et les fait demeurer des bourgeois même dans la légende. Ne faut-il pas plutôt croire Wells lorsqu’il note, au cours de son entretien avec Lénine, à Moscou, que « son crâne rappelle celui d’Arthur Balfour » ?
Vêtu de sombre, un haut faux-col cerné d’une cravate noire, Lénine avait l’air correct et endimanché d’un jeune notaire de n’importe quel pays de l’Europe continentale, ou d’un professeur allemand de la Berlitz School. Il n’avait rien d’un Anglais, mais il avait tout ce qui distingue, en Angleterre comme sur le continent, un petit bourgeois gentleman. Pendant les premiers temps de son séjour à Londres, il se promenait seul, ou bien en compagnie de Nadejda Konstantinowna, au milieu du tumulte de Trafalgar Square et de Piccadilly, au cœur de ce Londres où les Anglais placent le pivot du monde, et qu’il haïssait de toute sa rancœur de petit bourgeois de l’Europe continentale, élevé à l’école de Marx. Ceux qui l’ont connu et observé de près dans cette période de sa vie, nous racontent qu’il aimait, les premiers jours, se laisser porter à la dérive par la foule encombrant les trottoirs d’Oxford Street ou de Shaftsbury Street, et qu’il prenait un plaisir enfantin à étudier la figure des passants, leurs gestes mesurés, leur façon de s’habiller, leur innocent sourire d’hommes respectables, sincèrement satisfaits tant de l’état de leur conscience que de celui du monde.
Ce Londres des premières années du siècle était encore le noble et vieux Londres du temps des équipages et des cabs, du Long Parlement conservateur et du socialisme philanthropique de la Fabian Society. Rien, pas même la guerre du Transvaal ou la grève qui avait failli tuer le port de Londres, n’était arrivé à troubler l’extase dans laquelle le long règne de la Reine Victoria avait plongé l’esprit anglais. Les fenêtres d’Oxford Street ne présentaient plus la stupide uniformité dont se plaignait Ruskin, et le mobilier de mauvais goût des premières années de l’ère victorienne, les tables rondes avec la grosse lampe au milieu, les oiseaux et les fruits de cire aux couleurs criardes sous un globe de cristal, les coquillages, les albums peuplés d’une collection de gentlemen et de ladies dans leurs atours du dimanche, tout prêts à se rendre à l’église, les Bibles reliées en cuir vert et les éventails de nacre, avaient déjà émigré des quartiers élégants du West-End vers les rues bourgeoises de l’East-End. Le Parlement n’était plus aussi puissant qu’au temps où il pouvait tout, « excepté faire un homme d’une femme », et la fin de la splendid isolation s’annonçait toute proche dans cet accent particulier, bien nouveau pour la cour de Saint-James, qui avait un charme si parisien dans la bouche d’Édouard VII, quand il parlait en anglais de l’Europe et de la France.
Un an ne s’était pas écoulé depuis le 22 janvier 1901, jour de la mort de la reine Victoria, qu’on avait déjà oublié que ce même Édouard VII, encore prince de Galles, se rendant chaque automne en Autriche, faisait dire quelques années avant à un habitant de Marienbad : « Quand le prince de Galles vient chez nous, il nous fait la grâce de parler l’allemand avec l’accent autrichien. » C’était encore par l’accent, avec lequel les membres de la famille royale prononçaient l’anglais, que l’on jugeait à Londres la politique étrangère de l’Angleterre. Ainsi, tandis qu’un profond changement devenait de plus en plus visible dans l’aspect des choses, dans les manifestations de la politique, dans le goût, dans les mœurs, l’esprit anglais demeurait indifférent aux problèmes nouveaux qui se posaient, non sans brutalité, sur le terrain social. Rien de ce qui, dans la vie anglaise, se développait en dehors de la Chambre des Communes, indépendamment des formules traditionnelles des discussions parlementaires, n’appartenait, pour l’Anglais moyen, au domaine de la réalité. Tout ce qui ne donnait pas matière aux caricatures du Punch, cet autre Times des Anglais, ne rentrait pas dans l’ordre constitué, restait étranger à la conscience et à l’intelligence du public. En matière de problèmes sociaux, ce peuple de gens bien pensants n’ignorait que la réalité.
Il n’y a rien de surprenant à ce que le socialisme soit entré dans la vie anglaise par les discussions parlementaires et les dessins du Punch : ce n’est que par ces deux portes-là que les idées nouvelles entrent en Angleterre. Les apôtres de la Société Fabienne, Hyndmann, H. G. Wells, Bernard Shaw et, en tête de ligne, Sidney Webb et sa femme Béatrice, dont Herbert Spencer s’était porté garant aux yeux du public, toujours prêt à croire comme il l’était à la respectabilité d’une idée sociale patronnée par une femme, n’avaient pas eu grand-peine à persuader l’opinion anglaise que le socialisme n’avait rien de dangereux pour les traditions et la tranquillité de la Grande--Bretagne. C’est à M. Webb que la sociologie doit d’avoir pris pied dans la jeune Université de Londres, à travers cette London School of Economics que le même M. Webb avait créée sur le conseil de sa femme Béatrice. Vers l’année 1902, grâce aux théories philanthropiques et progressistes de la Fabian Society, ainsi nommée en souvenir de ce personnage de l’histoire romaine, Fabius dit « le Temporiseur », dont la tactique consistait « à faire perdre du temps à Hannibal en lui posant des lapins », les préventions du public anglais à l’égard du socialisme avaient cédé la place à des considérations plus honnêtes. Les socialistes du County Council et les députés, à peu près marxistes, de la Chambre des Communes, étaient même considérés avec une certaine sympathie dans le domaine des réformes sociales, les Anglais n’éprouvent de sympathie que pour les programmes et les hommes qu’ils jugent inoffensifs. On avait déjà oublié le mélange de dégoût et d’effroi dont l’opinion publique avait été saisie dix ans plus tôt, à l’occasion d’un horrible évènement, dont l’histoire parlementaire d’Angleterre n’offrait pas d’exemple, même au temps de Cromwell.
Au printemps de 1892, nous raconte le Français Augustin Filon, collaborateur de la Revue des Deux Mondes, « un char à bancs où s’entassaient des hommes du peuple hurlant en chœur, au son d’un vigoureux cornet à piston, un refrain antisocial, déposait devant la porte du Parlement un homme en casquette et en chemise de flanelle, qui pénétrait seul dans l’enceinte législative et y prenait place dans un farouche isolement. Ceux qui virent passer ce cortège grotesque ne devinèrent pas que Keir Hardie, l’homme ainsi introduit dans le Parlement, cet homme hautain et triste, apportait à Westminster un germe destiné à se développer et à grandir ; qu’à quinze ans de là il commanderait un parti dont il faudrait acheter l’alliance ou soutenir l’assaut ». Cet horrible évènement, qui avait risqué de troubler pour toujours la confiance du public dans les traditions parlementaires, ne laissa pas la moindre trace dans l’opinion des bien-pensants. Les députés socialistes qui vinrent, peu de temps après, s’asseoir aux côtés de Keir Hardie, se firent connaître bien vite pour des bonshommes cultivés, corrects et discrets, et aussi pédants, au besoin, que s’ils avaient passé par l’Université. Ils citaient les blue books, usaient et abusaient des statistiques officielles, et se montraient si respectueux du règlement de la Chambre des Communes, que nul n’aurait osé les supposer jamais capables de répéter ce que M. Tim Healy a dit de ce règlement : « J’ai appris à le connaître en le violant. » Ce n’est qu’en 1906, au lendemain des élections générales qui amèneront, après si longtemps, les libéraux au pouvoir, que l’Angleterre se souviendra du printemps de 1892 et de ce dégoûtant Keir Hardie. Elle s’apercevra trop tard que l’ennemi était déjà dans la place. « Un ennemi très commode », disait Lénine.
À l’égard des socialistes, Lénine partageait tout à fait la façon de voir du public anglais. Quelqu’un a dit que c’est à Londres que Lénine avait appris à rire. Il penchait la tête sur l’épaule, fermait à demi les yeux, prenait son poignet gauche dans sa main droite et riait longuement, avec des soubresauts dans les épaules, d’un rire strident qui finissait par un accès de toux. Il ouvrait alors les yeux, et jetait autour de lui un regard méfiant, comme pour bien s’assurer que nul n’avait remarqué sa façon de rire qui tenait à la fois de celle des vieillards et de celle des femmes. Jusqu’aux derniers instants de sa vie, lorsque sa paralysie progressive lui donnait une incoercible envie de bâiller et qu’il riait incessamment (il s’efforçait de réagir contre ces crises en riant), Lénine gardera cette habitude de fermer les yeux, de saisir de la main droite son poignet gauche, et de rire en secouant les épaules, comme si cela lui coûtait un effort pénible. Dans ses moments de gaîté, il avait l’air de souffrir : son visage se crispait, on eût dit qu’il avait des crampes d’estomac. Son rire était séditieux. Maintenant, dans son cercueil de cristal au pied du Kremlin, il repose en souriant, les yeux mi-clos. Sa main gauche, doucement ramenée sur sa poitrine, semble tendre son poignet à la main droite, appuyée grande ouverte au côté. On dirait que Lénine a été surpris par le sommeil dans l’instant qu’il esquissait ce geste qu’il avait à Londres, quand il regardait en souriant la Tour de Westminster, de leur Westminster, ou la colonne de Trafalgar Square, symboles de la puissance et de l’orgueil de la libre Angleterre.
Ce qui l’amusait le plus, chez les socialistes anglais, c’était leur sentimentalisme philanthropique, leur incapacité à comprendre la nécessité de la violence révolutionnaire dans la lutte de classe. Les Webb, les Mac Donald, les Snowden, les Henderson, les Lansbury, les Hyndman, tous ces marxistes puritains, tous ces protestants qui cherchaient Marx dans les versets de l’Évangile, « comme Cromwell cherchait Dieu sous la table », avaient l’air, à ses yeux, d’idéologues petits-bourgeois, mais de petits bourgeois de la famille de Candide, dépourvus de ce fanatisme qui, seul, peut tirer des principes de Marx la loi de la révolution prolétarienne. Il s’apercevait non sans gaîté que le Marx des Anglais, ce gentleman puritain nourri de lait, de légumes, et de bonnes intentions, aux façons correctes, et d’une hypocrisie si favorable au réveil de toutes sortes de sentiments inutiles chez le peuple, était très différent de celui des Russes, ce Marx au sang noir qui tantôt se dressait, froid et cynique, pour stigmatiser les oppresseurs du peuple et révéler les lois des misères et des grandeurs prolétariennes, tantôt rôdait comme un fiévreux, comme un halluciné, comme le prophète d’un Dieu inconnu, au milieu des ouvriers et des paysans de l’Europe. Le Marx hypocrite et philanthrope de M. Webb et de la Fabian Society, c’était bien le Marx de ce peuple anglais qui se profile, orgueilleux, impassible, sur le fond romantique d’une histoire inimitable d’invasions et de conquêtes, d’une civilisation merveilleuse de ténacité, décourage, d’égoïsme, de prudence et d’esprit d’aventure, illuminée par toutes les hypocrisies de la liberté et de la tyrannie. L’autre, le Marx des moujiks, c’était bien celui du peuple russe, surgissant des profondeurs d’une histoire qui se confond avec celle de l’Asie, d’une histoire sombre et mystérieuse, peuplée de divinités splendides et cruelles, de princes sans humanité, de plèbes sans espérance et sans miséricorde, d’une civilisation dominée par un obscur sentiment religieux de la nature, où le mysticisme le plus vague s’unit au réalisme le plus trouble, où la patience, la soumission, l’acceptation de toute misère, de toute souffrance, de tout esclavage, ne vont jamais sans une aspiration au bien, à la vertu, au bonheur, sans un pressentiment lointain de liberté, sans un instinct de rébellion et de vengeance.
Mais autant Lénine avait de mépris pour le Marx de M. Webb, autant il avait de dégoût pour celui des moujiks. L’optimisme philanthropique des socialistes de la Fabian Society lui semblait aussi loin de l’esprit du marxisme que l’ignorance superstitieuse du peuple russe. C’est à Marble Arch, devant l’entrée de Hyde Park, alors qu’il écoutait les orateurs prêcher les théories de Marx dans la langue du Poplar, de Lime-flouse et de Whitechapel, cet anglais des faubourgs ouvriers de l’East-End si incompréhensible pour les oreilles d’un gentleman de Kensington, que l’idée fixe de Lénine de grouper autour de lui une poignée d’hommes prêts à tout, de révolutionnaires professionnels animés d’un fanatisme froid et violent, d’un cynisme scientifique au delà des préjugés de la morale bourgeoise, lui revint à l’esprit comme une nécessité dont ne dépendait pas seulement le succès de la lutte, qu’il allait entreprendre pour fonder au sein du parti sa dictature personnelle, mais encore l’avenir du mouvement révolutionnaire en Russie. Cette idée, il fallait la réaliser au plus vite. C’est au congrès du parti qu’il allait donner une réponse définitive au titre de sa fameuse brochure : « Que faire ? ». L’idée de grouper autour de lui une petite armée irrégulière de révolutionnaires professionnels, lui était venue pour la première fois à Pétersbourg, alors qu’il travaillait avec Chelgounov à l’organisation de la « Ligue de combat pour l’affranchissement de la classe ouvrière ». On en avait ri, alors, dans les milieux socialistes de Russie « Je les aiderai à rire jusqu’au bout », disait Lénine à Chelgounov.
Sa brochure Que faire ? parue en Suisse au début de cette même année, un peu avant son départ pour Londres, avait fait très grande impression, tant sur les émigrés que sur les socialistes de Russie. Elle avait été accueillie par de violentes polémiques. Même en 1917, Lénine n’a jamais écrit rien de plus original ni de plus intéressant sur les problèmes révolutionnaires. Dans la médiocrité décevante de toute son œuvre d’écrivain, ces pages nous semblent les plus caractéristiques de ce doctrinaire petit-bourgeois, chez qui le dégoût pour l’action s’accompagnait d’une confiance absolue en l’efficacité de ses écrits. C’est en grande partie à cette brochure qu’il doit sa situation personnelle dans le parti à la veille du congrès de 1903. « Nous sommes si primitifs, écrivait Lénine, que nous avons fait baisser le prestige du révolutionnaire en Russie. Faible et chancelant dans des questions de théorie, n’ayant que des vues étroites, arguant de l’indiscipline des masses pour justifier sa propre faiblesse, plus près d’un secrétaire de trade-union que d’un tribun du peuple, ne sachant pas tracer de ces plans larges et audacieux qui inspireraient du respect aux adversaires eux-mêmes, inexpérimenté et maladroit dans son métier, c’est-à-dire dans la lutte contre la police politique, ce n’est pas un révolutionnaire, c’est un pauvre Koustar, un pauvre amateur. Que nos militants me passent ce mot sévère : pour ce qui a trait au manque de préparation, je me l’adresse avant tout à moi-même. J’ai travaillé dans un groupe qui se donnait des buts très larges et très vastes, et nous autres, membres de ce groupe, nous souffrions douloureusement à la pensée de n’être que des amateurs, des dilettantes, et cela au moment où l’on eût pu dire, en paraphrasant un mot connu : donnez-nous une organisation de révolutionnaires, et nous bouleverserons la Russie ! Et chaque fois qu’il m’arrive de me rappeler le sentiment brûlant de honte que j’éprouvai alors, je ressens plus d’amertume contre ces faux social-démocrates qui déshonorent le titre de révolutionnaire, qui ne comprennent pas que notre devoir n’est pas d’accepter l’abaissement du révolutionnaire au rang de dilettante, mais d’élever les dilettantes au rang de révolutionnaires. » J’ai cité ce passage parce qu’on y voit, mieux qu’en aucun autre, fonctionner le mécanisme de son idée dominante, de son fanatisme cérébral, qui ne concevait l’action révolutionnaire que sous une forme abstraite et la révolution que comme l’inévitable résultat de ses spéculations théoriques, de son activité intellectuelle, de sa tactique personnelle au sein du parti. Même ses passions, même ses instincts révolutionnaires n’étaient que des aspects de son rationalisme. Le moteur de la circulation du sang, chez lui, ce n’était pas le cœur, c’était le cerveau. Il n’était pas ce qu’on appelle un froussard, mais il y avait des moments, comme en décembre 1905, et en octobre 1917, où sa tête avait peur. Chaque fois que les circonstances l’entraînaient irrésistiblement sur le terrain de l’action révolutionnaire, le poussaient à mettre en pratique ses théories, à prendre sur lui seul la responsabilité directe de la réalisation de ses idées et de l’application de ses principes de tactique insurrectionnelle, chaque fois que les évènements menaçaient de le faire monter sur les barricades, comme on aurait dit en 1848, Lénine reculait ou s’écartait.
Cette répugnance à se mêler à a lutte révolutionnaire et à agir personnellement sur le terrain de la violence, ce n’était pas de la frousse, ainsi que l’ont prétendu certains de ses adversaires et les moins éclairés d’entre ses amis. Ce qui le faisait reculer, c’était bien plutôt le soupçon qu’il s’était peut-être trompé dans ses calculs, que les évènements n’étaient peut-être pas de la nature de ceux qu’il attendait. Il ne voulait pas se laisser entraîner par des circonstances dont il ignorait la nature et l’issue, c’est-à-dire l’origine et la direction, et qui, par cela même, étaient arbitraires. Tout ce qui ne provenait pas de lui, était illogique, immoral. La fameuse incorruptibilité de Robespierre consistait en ce fait, qu’il ne se laissait jamais corrompre par des évènements qui ne venaient pas de lui. L’incorruptible Lénine eût risqué mille fois la fin de Robespierre, s’il n’avait eu à ses côtés Trotsky, le grand corrompu. Pour comprendre l’importance qu’avait pour Lénine la question des révolutionnaires professionnels, il faut bien se garder d’oublier qu’il n’a jamais conçu la révolution comme le résultat d’un ensemble de circonstances historiques, politiques et sociales, indépendantes de lui, mais comme le résultat mathématique de ses calculs et comme l’inévitable aboutissement de sa tactique personnelle au sein du parti. Toutefois, ce qui éclaire d’une lumière singulière son rôle de révolutionnaire professionnel, c’est que, jusqu’au lendemain du coup d’État d’octobre 1917, les évènements décisifs se sont toujours produits en dehors et indépendamment de sa volonté, de ses calculs et de sa tactique. Jusqu’au mois d’octobre 1917, Lénine n’a jamais pris sur lui que la responsabilité d’évènements qui n’auraient jamais pu, qui ne pouvaient plus se produire.
C’est à Londres que Lénine s’est aperçu, pour la première fois, qu’il n’était pas un gentilhomme. Bien qu’il soit plus difficile, pour quiconque n’est pas Anglais, d’être pris pour un gentleman en Angleterre, que pour un gentilhomme dans n’importe quel pays du continent, rien, dans ses façons correctes, dans sa réserve, dans sa mise modeste, n’était propre à lui attirer l’hypocrite mépris des Anglais. Mais Lénine s’apercevait qu’il ne pourrait jamais être ni un gentleman en Angleterre, ni un gentilhomme en Suisse ou en France. Il rôdait dans Londres comme un espion dans un camp ennemi. Il observait tout, s’intéressait à tout : rien n’échappait à sa curiosité, à sa méfiance, à son regard sournois. L’Angleterre lui révélait peu à peu le secret de sa puissance, qui est le secret même de la civilisation bourgeoise.
Les frontières de l’Empire lui apparaissaient comme un tatouage imprimé sur la peau de cent peuples. Lui-même, comme n’importe quel petit bourgeois, ouvrier ou paysan d’Europe, sentait sur sa peau la brûlure de ce tatouage. Les frontières de l’Empire britannique, et celles de la puissance politique et financière du capitalisme international, suivaient à ses yeux le même contour, d’individu à individu, de peuple à peuple, de continent à continent. « Je ne suis pas un gentilhomme, disait Lénine, mais un révolutionnaire professionnel. » Jamais il ne s’était senti moins gentilhomme qu’à Londres, au cœur de la civilisation capitaliste, au milieu de ce peuple hypocrite et naïf, de ces Anglais à figure rose, aux cheveux blonds, aux lèvres souriantes, parmi ces « anges criminels » chez qui l’amour de la liberté n’a d’égal que le mépris de la liberté des autres peuples. Lorsqu’il comparait, dans les ruelles noires et crasseuses de Whitechapel, les misérables Anglais des slums, de ces masures où s’entasse la plus pauvre population ouvrière de Londres, aux Anglais satisfaits, optimistes et rasés des riches quartiers du West-End et des nobles rues du centre, « Two Nations ! » s’écriait-il, et il prenait son poignet gauche dans sa main droite. Le Marx de la Fabian Society, comment eût-il pu être le Marx de Whitechapel ? Fallait-il vraiment croire à ce que disait Webb, que chaque peuple a le Marx qu’il lui faut ?
La vie que Lénine menait à Londres n’était pas très différente de celle qu’il menait jadis à Pétersbourg et à Munich. « Il menait une vie de famille, raconte Trotsky : le rencontrer en dehors des séances officielles était un petit évènement. Les habitudes et les passions bohêmes des émigrés russes ne plaisaient pas à Lénine. » Il passait presque toute la journée à la bibliothèque du British Museum, remplissant ses cahiers de notes et de statistiques sur l’histoire du mouvement ouvrier en Angleterre, ou bien jetant sur le papier, de son écriture fine et rapide, l’ébauche de ses articles pour l’Iskra. Lénine ne s’occupait alors, personnellement, que de la rédaction du journal. C’était Nadejda Konstantinowna qui avait pris en mains la clef de l’organisation du parti, qui s’occupait de la correspondance secrète avec les camarades de Russie, chiffrait et déchiffrait les rapports, dirigeait l’activité de tous les noyaux révolutionnaires, éparpillés jusque dans les régions de Sibérie les plus lointaines. Ce n’était que par l’intermédiaire de Nadejda Konstantinowna que Plekhanov, Axelrod et les autres membres influents du groupe de Genève pouvaient se tenir en contact avec les organisations clandestines de Pétersbourg, de Moscou, de Kiev : ils étaient bien trop confiants pour soupçonner que la femme de Lénine pût exercer une censure si sévère sur leur correspondance avec les leaders du mouvement ouvrier en Russie. Obligée de passer par le chemin détourné de Londres, la voix de Plekhanov et d’Axelrod s’affaiblissait de plus en plus, leurs paroles n’arrivaient aux camarades lointains qu’indistinctes et déformées. Des lettres se perdaient, de regrettables malentendus se produisaient à tout propos ; certains passages, chiffrés ou déchiffrés par la femme de Lénine, altéraient savamment le sens de documents de la plus haute importance ; des paroles maladroites se glissaient entre les lignes des lettres de Plekhanov et d’Axelrod destinées aux socialistes de Pétersbourg et de Moscou, que Nadejda Contantinovna se chargeait de recopier à l’encre sympathique pour déjouer la censure de la police. Peu à peu, dans l’esprit des camarades de Russie, la figure de Lénine, de ce nouveau chef, placé au centre stratégique, au point le plus sensible de l’action révolutionnaire, c’est-à-dire à la rédaction de l’Iskra et au secrétariat du parti, prenait la place que les « vieux » occupaient depuis si longtemps. La clef de la victoire de Lénine au congrès de 1903, c’est donc Nadejda Konstantinowna qui l’avait entre les mains. C’est elle qui avait la liste des membres du parti, les noms et les adresses des agents de liaison, des courriers et des propagandistes clandestins. C’est elle qui recevait les dénonciations et les informations confidentielles sur les camarades suspects, sur les agents provocateurs, sur les opinions personnelles et même sur la vie privée des socialistes les plus en vue. Dans l’intimité du petit logement de Londres, cette femme fidèle et modeste poursuivait patiemment son travail de taupe et d’araignée, sapant le terrain sous le pied des austères, des trop confiants apôtres du marxisme russe, et tissant la toile des intrigues qui devaient « organiser le désordre » au sein du parti et provoquer la fameuse scission de 1903. C’était une vraie campagne électorale en faveur de Lénine qu’elle faisait parmi les camarades de Russie, en prévision du congrès. À Londres, comme partout et toujours, la grande œuvre révolutionnaire de ce petit bourgeois fanatique et méticuleux n’était faite que d’intrigues, de fiches et de petits papiers.
Un jour d’octobre 1902, de bon matin, une main inconnue frappait trois coups à la porte de Lénine. Ces trois coups devaient résonner bien longtemps dans la vie de ce fonctionnaire ponctuel et zélé du désordre. « Wladimir Ilitch était encore au lit, raconte Trotsky, et, sur son visage, l’amabilité se nuançait d’un étonnement compréhensible. C’est dans ces conditions qu’eut lieu notre première entrevue et que nous causâmes pour la première fois. On m’offrit du thé, dans la cuisine, je crois. Lénine pendant ce temps s’habillait. » Trotsky était alors un jeune homme de vingt-cinq ans, de stature moyenne, aux yeux myopes enfoncés sous la courbe large d’un front haut et vaste, encadré d’une masse de cheveux ébouriffés qui s’échappaient de tous les côtés sous les vastes ailes d’un chapeau de feutre. Sa bouche extrêmement grande, aux lèvres sensuelles ombragées d’une moustache, aux dents jaunes « mâchonnant les mots comme des morceaux de viande crue », donnait déjà à son pâle visage cette expression cynique et violente, ce contraste d’ironie et d’orgueil, cette sombre tristesse qu’il portera un jour, comme un masque, pendant les luttes sanglantes de la révolution d’octobre et sur les champs de bataille devant Kazan et Varsovie. Son menton volontaire n’était pas encore caché par cette barbe caprine qu’il s’acharnera plus tard, dans le congrès, dans les meetings, dans les séances du Comité militaire révolutionnaire, à tourmenter d’une ma n tremblante, campé à la tribune, les jambes écartées, le front emperlé de sueur, la tête renversée, ses yeux brumeux levés vers le ciel dans une sorte d’extase fébrile. Son cou mince serré dans un haut col droit, sans cassure, entouré d’une petite cravate noire comme celles des instituteurs de province, Trotsky fixait sur Lénine un regard plein de respect et de curiosité. Le reflet de ses lunettes donnait à ses yeux myopes cette étincelante mobilité des yeux de vieillards ou d’enfants, quand ils brûlent de fièvre. Tout en buvant son thé, il parlait à haute voix, disait sa romanesque évasion du village sibérien de Verkholensk, son vagabondage à travers l’Europe, son entrevue avec Victor Adler à Vienne et avec Axelrod à Zurich, l’impatience qu’il avait de se rencontrer avec Wladimir Ilitch, qu’il admirait depuis longtemps avec tout l’enthousiasme de sa jeunesse (un enthousiasme qui, visiblement, embarrassait Lénine), son désir de travailler à ses côtés, de rattraper le temps perdu en Sibérie, de consacrer toutes ses forces au triomphe de la révolution prolétarienne.
Ce langage orgueilleux et violent ne plaisait pas à Lénine. La tête penchée sur son épaule, les yeux mi-clos, il écoutait ce jeune homme ardent avec un embarras qu’il n’arrivait pas à cacher. Wladimir Ilitch et Nadejda Konstantinowna connaissaient déjà Trotsky par une lettre de Krjijanovski, qui l’avait introduit officiellement, à Samara, dans l’organisation de l’Iskra. Mais, bien que la lettre de Krjijanovski fût une garantie suffisante, et que l’activité révolutionnaire de Trotsky ne lui fût pas inconnue, Lénine ne pouvait s’empêcher de considérer avec une certaine méfiance ce pâle Juif d’un marxisme douteux, d’idées inquiétantes, qui glissait des citations d’Homère dans les textes de Karl Marx. « Pendant mon voyage vers la Sibérie, lui racontait Trotsky, dans mon wagon, entre les gendarmes, je lisais l’Iliade. » Dans son visage hardi, à peau humide et blanche comme celle d’un poitrinaire, dans ses lèvres sensuelles au sourire agressif, Lénine discernait, non sans répugnance, cette expression de volonté audacieuse, de courage physique, d’amour du risque et de l’aventure, qu’il a toujours considérée comme un stigmate de médiocrité bien dangereux. Il sentait que Trotsky possédait au plus haut degré ce qu’il redoutait le plus chez un homme : la fièvre de l’action, le goût de la violence, l’instinct morbide de violer les évènements, de les dominer, d’en faire les instruments de sa volonté et de ses passions. « Venez, dit-il à Trotsky, je vais vous montrer leur Londres. »
Cette promenade à travers Londres est un signe bien caractéristique de la méfiance de Lénine pour tous ceux qui venaient mettre du désordre dans ses habitudes et brouiller ses petits papiers. Ce n’était pas pour lui montrer le Parlement, les lions de Trafalgar Square, ou bien Hyde Park, qu’il était sorti avec Trotsky. « Il voulait me connaître, raconte celui-ci, et me soumettre à un examen. » Il ajoute que Lénine savait écouter. Wladimir Ilitch l’écoutait en clignant des yeux, les mains derrière le dos, la tête légèrement inclinée sur l’épaule, dans son attitude habituelle. « Il me montra Westminster du dehors, écrit Trotsky, et d’autres édifices remarquables. Je ne me rappelle pas exactement ce qu’il dit, mais il mit dans sa phrase cette nuance : c’est leur fameux Westminster. Leur se rapportait non pas aux Anglais, mais aux classes dominantes. Cette nuance qui n’était nullement soulignée, mais profondément sentie, exprimée surtout par le timbre de la voix, se retrouvait toujours chez Lénine lorsqu’il parlait de valeurs culturelles, de progrès récents, de l’installation du British Museum, de la richesse des informations du Times, ou bien, quelques années plus tard, de l’artillerie allemande ou de l’aviation française : ils savent, ils possèdent, ils ont fait, ils ont obtenu. Une ombre imperceptible, celle de la classe des exploiteurs, semblait s’étendre à ses yeux sur toute la culture humaine, et cette ombre lui était toujours présente, aussi indubitable, aussi apparente, que la lumière du jour. » Tout en marchant à travers cette foule correcte et souriante de Londres, qui faisait dire à Lénine que les Anglais sourient dans les rues pour se faire pardonner ce qu’ils font chez eux, Trotsky parlait de son exil en Sibérie et de l’impression qu’avait produite sur les déportés le livre de Lénine sur le Développement du capitalisme en Russie. Wladimir Ilitch était très sensible à l’admiration des jeunes gens. « Il lui était visiblement agréable de constater que de jeunes camarades étudiaient attentivement le plus important de ses ouvrages économiques. » Ils en vinrent à parler de Makhaïsky, de Plekhanov, d’Axelrod, de l’influence de l’Iskra dans les milieux révolutionnaires de la Russie, de la situation de la classe ouvrière en Angleterre, des attitudes du socialisme anglais, de Vera Zassoulitch, de Martov, et du prochain congrès. Trotsky se disait qu’il avait bien passé son examen.
Lénine avait commencé sans doute par se tromper sur la personnalité de Trotsky. Il l’avait jugé violent et ambitieux, appesanti par ces médiocres qualités morales et intellectuelles, qui lui semblaient le propre des hommes d’action, mais il était bien loin de soupçonner le rôle que ce jeune homme de vingt-cinq ans jouerait dans la révolution. Trotsky lui était antipathique : il s’en méfiait comme un homme sain se méfie d’un malade. Cependant, au prochain congrès, ce malade allait pouvoir lui être utile. Il avait besoin de pions dans son jeu. Comment imaginer que ce jeune homme pourrait ne pas le préférer à Plekhanov, à Axelrod et aux autres « vieux » de Genève et de Zurich ? Lénine se trompait sur ce point. Trotsky n’avait pas la vocation du disciple, surtout du disciple fidèle et dévoué. À ses yeux, Wladimir Ilitch était certes préférable aux vieux chefs du marxisme russe. Mais ce qui l’arrêtait chez Lénine et l’empêchait de devenir un pion dans son jeu, c’était son goût pour les intrigues et les petits papiers, sa tendance à identifier les buts de la révolution aux visées de sa tactique personnelle au sein du parti. Alexeiev, un émigré qui vivait à Londres depuis longtemps et fréquentait assidûment la rédaction de l’Iskra, parlait de Lénine avec beaucoup de respect. « Je crois, disait-il, que, pour la révolution, Wladimir Ilitch est plus important que Plekhanov. » C’est sans doute au cours de son séjour à Londres que Trotsky se rendit compte de ce que signifiait pour la révolution « être plus important que Plekhanov ». On peut supposer qu’il s’en rendit compte d’une manière tout opposée à celle d’Alexeiev.
Il était fort difficile d’approcher Lénine : il n’aimait pas qu’on allât le voir chez lui, ni qu’on interrompît ses lectures à la bibliothèque du British Museum, où il s’enfermait presque toute la journée. « Il n’en sortait que pour pousser, de temps en temps, des pointes d’éclaireur dans les milieux ouvriers anglais. » Trotsky s’était lié d’amitié avec Alexeiev, le londonien Alexeiev, qui l’initia, pour ainsi dire, à la vie anglaise et l’introduisit dans les cercles révolutionnaires de l’East End. C’est à Whitechapel que Trotsky fit la connaissance du vieux Tchaïkowsky et de l’anarchiste Tcherkezov, et qu’il se mesura avec eux au cours d’un débat oratoire sur les problèmes du marxisme. Il fréquentait aussi la rédaction de l’Iskra, où il avait débuté comme collaborateur, à l’occasion du second centenaire de la fondation de la forteresse de Chlisselbourg, par un article qui finissait sur une citation d’Homère. « Au sujet de cette citation, raconte Trotsky, Lénine tomba dans un doute légitime, qu’il m’exprima avec un rire bonhomme. » C’est ce même rire que Trotsky devait surprendre sur les lèvres de Wladimir Ilitch à un meeting de socialistes anglais, auquel ils assistèrent quelques jours après.
Lénine et Nadejda Konstantinowna s’étaient rendus un dimanche, avec Trotsky, dans une église de Londres, où un meeting socialiste était accompagné de psaumes pieusement révolutionnaires. Trotsky se souviendra toujours de cette scène singulière : Lénine à l’église, debout, écoutant l’orateur avec intérêt et les psaumes avec respect. « L’orateur était un ouvrier typographe qui revenait, je crois, d’Australie. Wladimir Ilitch nous traduisit à mi-voix son discours, qui avait un sens assez révolutionnaire, du moins pour cette époque. Ensuite, tous se levèrent et chantèrent en chœur : Dieu tout-puissant, fais en sorte qu’il n’y ait plus sur cette terre ni rois ni riches ! » Lorsque les ouvriers se levèrent pour entonner le psaume, Lénine prit son poignet gauche avec sa main droite, et, derrière le dos de Nadejda Konstantinowna, il se mit à tousser pour s’empêcher de rire. « Il y a dans le prolétariat anglais, dit-il à Trotsky en sortant de l’église, une multitude d’éléments révolutionnaires et socialistes dispersés dans la masse : mais tout ça se combine avec du conservatisme, de la religion, des préjugés, cela ne réussit pas à percer et à se généraliser. »
En rentrant de l’église, Wladimir Ilitch, Trotsky, Nadejda Konstantinowna et la mère de celle-ci, qui avait rejoint sa fille à Londres, déjeunèrent dans la petite cuisine de l’appartement de Lénine, qui n’avait que deux pièces. Le repas se composait de petits morceaux de viande qu’on servit dans la poêle même. On prit du thé et la discussion s’engagea au sujet du prochain congrès et de l’attitude de Lénine envers Plekhanov. Le témoignage de Trotsky sur ce point éclaire dans ses détails la tactique suivie par Wladimir Ilitch pour se soustraire à l’influence et au contrôle de Plekhanov. « La rédaction de l’Iskra se composait de six personnes : trois vieux, Plekhanov, Zassoulitch et Axelrod, et trois jeunes, Lénine, Martov et Potressov. Le directeur politique était Lénine, mais Martov était la principale ressource comme rédacteur. Plekhanov et Axelrod vivaient en Suisse. Véra Zassoulitch résidait à Londres, avec les jeunes. Potressov, à cette époque, se trouvait quelque part sur le continent. Cette dispersion des collaborateurs présentait certains inconvénients, mais Lénine ne paraissait pas s’en ressentir : il en était même satisfait. Avant de me laisser repasser la Manche, il m’initia avec circonspection aux affaires intérieures du journal et me dit, entre autres choses, que Plekhanov insistait pour que toute la rédaction vînt s’établir en Suisse, mais que lui, Lénine, était opposé à ce transfert, parce que cela ne pourrait que gêner le travail. C’est alors que je compris pour la première fois, ou plutôt devinai à de faibles indices, que le séjour de la rédaction à Londres devait s’expliquer par des considérations où la police, sans doute, jouait son rôle, mais où l’influence des rédacteurs était aussi pour quelque chose. Lénine désirait dans le travail courant d’organisation politique le plus possible d’indépendance vis-à-vis des vieux, et, surtout, de Plekhanov, avec lequel il avait déjà eu de graves conflits, notamment en élaborant un projet de programme du parti. Je me rappelle que Wladimir Ilitch me demanda ce que je pensais de celui que l’on venait de publier dans l’Iskra. Mais je ne m’étais assimilé ce programme que dans les grandes lignes, et j’étais incapable, par conséquent, d’exprimer une opinion sur la question intérieure qui intéressait Lénine. » C’est précisément sur cette question intérieure, si peu intéressante aux yeux de Trotsky, que Lénine allait jouer sa première carte, la plus importante, dans le jeu de la révolution prolétarienne.
« Plekhanov est un lévrier, disait Véra Zassoulitch à Lénine : il mordille bien, mais il finit toujours par lâcher. Vous, vous êtes un bouledogue ! Quand vous mordez, vous ne lâchez plus. » Lénine était très fier de cette comparaison. « Je mords et je ne lâche plus... C’est bien ça ? » demandait-il avec joie. Et Véra Zassoulitch, quand elle racontait cette anecdote, imitait avec une bonhomie railleuse le ton satisfait de Wladimir Ilitch et son R strident. »
Trotsky, le jeune homme pâle aux dents jaunes, disait plus tard que Lénine, de toute sa vie, n’avait jamais mordu que le vieux Plekhanov.
Le congrès, qui s’était réuni à Bruxelles, au mois de juillet, avait dû interrompre ses travaux et se transporter à Londres pour se soustraire à la vigilance trop sévère de la police belge et aux intrigues des agents provocateurs du gouvernement de Pétersbourg. Lénine, qui venait de quitter Londres quelques mois plus tôt, et qui s’était fixé à Genève pour obéir, disait-il, à la pression de Plekhanov, mais en réalité pour surveiller de près les agissements des amis de celui-ci en prévision du congrès, n’avait pas manqué de mettre à profit son séjour à Genève pour étendre en Suisse la « propagande électorale » qu’il poursuivait depuis longtemps en Russie par l’intermédiaire de Nadejda Konstantinowna. Les soupçons que les amis de Plekhanov nourrissaient au sujet de son activité à Londres, de nouveaux éléments les confirmaient de plus en plus. « On cherchait à deviner ses desseins, rapporte Trotsky : Lénine s’était préparé le terrain en Russie, ce qui n’était pas étonnant, car Nadejda Konstantinowna avait entre les mains tous les moyens de liaison. C’était en Russie qu’elle travaillait tout doucement l’opinion des camarades contre le groupe de Genève. Dans quelle mesure et dans quel sens pourrait-il être vrai que Lénine eût préalablement travaillé l’opinion des camarades en Russie ? C’est Nadejda Konstantinowna, mieux que personne, qui pourrait nous le raconter. Mais dans un sens plus large, et sans invoquer ces faits précis, on peut dire que cette préparation des esprits eut lieu. » Le témoignage de Trotsky, dans les pages qu’à la mort de Wladimir Ilitch il consacra à la mémoire du chef de la révolution, est fort important pour établir, en dépit des réticences des documents officiels et de la version imposée à ses biographes russes, les éléments fondamentaux du caractère de Lénine et de sa tactique, aussi bien que son rôle dans le mouvement révolutionnaire.
La tactique qu’il a suivie pour établir sa dictature personnelle au sein du parti, ce qui était à ses yeux la seule condition susceptible de lui permettre, un jour, de se trouver à la tête de la révolution, n’est pas très différente de la tactique d’un Herriot ou d’un Daladier pour se placer à la tête du parti radical en France. La conception que Lénine avait de la tactique révolutionnaire ne s’appliquait pas à la politique extérieure de parti, c’est-à-dire à la révolution prolétarienne, mais à sa politique intérieure, c’est-à-dire au jeu des influences réciproques des hommes, des groupes, des circonstances, et, en dernier lieu, des idées. La révolution, pour lui, ce n’était qu’une question intérieure de parti : c’est en tenant compte de cette conception qu’il faut mesurer la personnalité de Lénine, et son rôle dans la révolution russe. On a dit de lui qu’il a toujours observé la règle de nager entre deux eaux. En octobre 1917, il faudra que Trotsky l’empoigne par les cheveux pour le ramener à la surface. Sa tactique, dans la préparation du congrès de 1903, n’a rien de caractéristique ni d’extraordinaire, rien qui révèle la présence du génie ni le signe d’une volonté pour ainsi dire héroïque : c’est la tactique d’un petit bourgeois qui manœuvre prudemment pour déjouer le plan de ses adversaires, racoler des électeurs, compromettre à son profit la situation politique du parti, s’assurer des partisans à placer dans l’assemblée aux points sensibles, en vue du jeu inévitable des ordres du jour et des votations. « Les premiers délégués du prochain congrès commençaient à se réunir à Genève, raconte Trotsky, et l’on tenait conseil avec eux d’une manière ininterrompue. Sur ce travail préparatoire, Lénine avait indiscutablement la haute main, bien que son rôle ne fût pas toujours perceptible. Trois ouvriers seulement vinrent de Russie pour le congrès. Lénine s’entretint de façon très détaillée avec chacun d’eux et les conquit tous les trois. » Un de ces ouvriers était Kalafati, délégué par l’organisation socialiste de Nikolaïev, celui qui appelait Trotsky un « tolstoïen ». Pendant toute cette période de pourparlers, de manœuvres et d’intrigues, Lénine ne se départit pas de son calme habituel. Sachant qu’on le soupçonnait, il se surveillait. En quelques lignes, Trotsky a tracé un portrait bien caractéristique, de ce bonhomme « debout près de la table, coiffé d’un faux panama qu’il avait tiré sur son front », à la fin d’une des interminables séances que la rédaction de l’Iskra tenait à Genève, au café Landolt. « C’était au début de l’été, le soleil luisait gaîment, et le petit rire de gorge de Lénine était jovial. Je me rappelle son air tranquillement railleur, sûr de lui-même et ferme. Wladimir Ilitch n’était pas alors tel qu’on l’a connu dans la dernière période de sa vie : il était assez maigre. »
Quand le congrès reprit à Londres les travaux interrompus à Bruxelles, cinquante et un délégués se trouvèrent réunis dans la grande salle du siège des syndicats. Il est regrettable qu’aucun des membres du congrès ne se soit fait, je ne dis pas l’historien, mais le chroniqueur de la scission de 1903. Au sujet de la querelle byzantine qui est à l’origine de cet évènement, nous sommes assez bien renseignés par des documents plus ou moins officiels, mais ce qui nous manque, c’est une chronique détaillée des séances du congrès. Il s’agit pourtant d’un évènement qui est sans doute, il faut insister là-dessus, le plus important de toute la vie révolutionnaire de Lénine, le seul qui porte la marque de sa volonté, car il l’a voulu, préparé et plié à ses fins. Bien qu’il ait pris une part extrêmement active aux débats et qu’il ait eu plus tard sous les yeux les actes du congrès, (que la Sadowa avait apportés à Pétersbourg, « écrits en caractères très menus sur du papier mince, nous raconte-t-elle, et cachés dans les cartonnages du Larousse), Trotsky lui-même déplore l’insuffisance de son récit. La chronique de la révolution a toujours paru bien médiocre, à cet homme assoiffé d’histoire.
On était au cœur de l’été : il faisait une chaleur écrasante. Les cinquante et un délégués, beaucoup en bras de chemise, étaient assis sur des rangées de chaises et bavardaient entre eux, échangeant à haute voix leurs impressions, fumant, et crachant par terre. Le parquet était couvert de mégots et de crachats. Les orateurs à voix rauque, aux gestes violents, se succédaient à la tribune pour prononcer des discours interminables sur des questions d’organisation que Plekhanov jugeait tout à fait secondaires et que Lénine avait, plus que tout autre, des raisons de considérer comme de la plus grande importance. Au bout de nombreuses journées de discussion (on en était déjà à la vingt-deuxième séance), le congrès n’était pas encore arrivé à se mettre d’accord sur le premier paragraphe des statuts. Qui devait-on considérer comme membre du parti ? « Ceux qui professent son programme, lui fournissent des ressources matérielles et lui apportent un concours personnel régulier sous la direction de l’une des organisations », comme le proposait Martov, ou bien, conformément à la proposition de Lénine « tous ceux qui professent son programme, le soutiennent par leurs cotisations et participent personnellement à l’une de ses organisations » ? Martov objectait : « Peut-on exiger des professeurs et des lycéens qu’ils travaillent personnellement dans les organisations ? » Pouvait-on refuser le concours des intellectuels, méconnaître leur dévouement, leur fidélité à la cause du prolétariat ? « Nous nous passerons des professeurs, des lycéens, des intellectuels, répliquait Lénine : ce qu’il nous faut, ce sont les ouvriers. » C’est de l’issue de ce débat au sujet d’une « question secondaire », c’est de la formule que le congrès allait choisir pour le premier paragraphe des statuts, que dépendait la question des révolutionnaires professionnels, fondamentale pour Lénine. La formule de Martov consacrait la mainmise des intellectuels, c’est-à-dire de Plekhanov et de ses partisans, sur les organisations du parti, et ouvrait la porte à toutes sortes de koustars, de dilettantes, d’opportunistes, de faibles, d’hésitants, de mous. C’était aux durs, à une poignée d’hommes résolus, prêts à tout, de révolutionnaires professionnels au delà du bien et du mal, que la formule de Lénine donnait le pouvoir dans le parti. Mais la tactique de Lénine, qui visait à provoquer une scission au moyen du jeu combiné d’une intransigeance agressive et d’un opportunisme de couloir, allait-elle pouvoir atteindre son but ? N’eût-il pas été préférable d’essayer de forcer la situation par tous les moyens, de mener une lutte violente contre la prudence, l’opportunisme et l’hypocrisie de ces petits abbés de l’orthodoxie marxiste ? Mais Lénine aurait dû, à cet effet, poser des problèmes théoriques d’ordre fondamental ; or, il voyait très bien que le congrès ne se laisserait pas engager sur le terrain des questions de principe, et repousserait toute tentative de procéder à une révision des doctrines de Marx, de porter atteinte à l’orthodoxie marxiste, telle qu’elle avait été fixée par les apôtres du socialisme russe. « Ce ne sont pas des apôtres, ce sont des petits abbés », ricanait Lénine, en observant le visage en sueur d’Axelrod, les gestes abondants de Martov, la mine pâle et craintive de Plekhanov.
De tous ses adversaires, Plekhanov était le seul qui hésitât encore à prendre ouvertement parti contre Wladimir Ilitch. Au fond, il avait pour Lénine une répulsion féminine, une méfiance jalouse tenant de l’affection. Au cours de ces journées, dans son attitude envers Lénine, il y avait autant d’orgueil blessé que de regret. Wladimir Ilitch était bien le dernier « amour » de sa vie. Que pourrait-on reprocher de plus noble au cœur si généreux du vieux Plekhanov ? C’est seulement dans le domaine des idées qu’un homme comme Plekhanov peut avoir des amants. Il n’en est pas moins triste de constater que, dans la vie des hommes de cette nature, voués aux sacrifices de l’exil et des luttes révolutionnaires, brûlés par les idées comme d’autres par les passions, le secret de leurs sentiments, cet alliage d’équivoque et de sublime qui règle les rapports entre maîtres et disciples, on le trouve toujours mêlé aux médiocres évènements de la chronique des partis, des assemblées, des débats politiques, au jeu des majorités et des minorités, aux intrigues, aux misères des cabales, au hasard des ordres du jour, des votes et des irrévocables décisions de congrès. Ces hommes ont leurs secrets, comme les jeunes filles les plus pures ont leurs péchés et leurs remords. « Lénine a été amoureux de Plekhanov », écrit Zinoviev. Au congrès de Londres, il n’y eut que deux hommes, parmi ses adversaires, qui ne foncèrent pas ouvertement sur Lénine : le jeune Trotsky, déjà son ennemi, et le vieux Plekhanov, qui l’aimait encore, et qui souffrait d’abandonner pour toujours celui qui eût pu être le plus cher et le plus infidèle de ses disciples.
À la vingt-troisième séance, Lénine se présenta une rose à la main, l’air souriant et distrait. Ses amis le considérèrent avec étonnement. Lénine n’était pas à son aise avec les fleurs ; c’est toujours avec une certaine timidité qu’il s’en approchait ; on eût dit qu’il avait peur de les briser rien qu’en les effleurant des doigts. Il n’avait de hardiesse qu’avec les fleurs en papier. « Il va nous battre avec une rose », dit Martov à Plekhanov. Lénine traversa la salle, cette rose à la main, et il alla s’asseoir près de Trotsky, lui parlant à l’oreille et se retournant, de temps en temps, pour regarder du côté d’Axelrod. Pendant toute la séance, il alla ainsi d’un groupe à l’autre, parlant avec animation, faisant beaucoup de gestes, et oubliant sa fleur. À la fin de la séance, quand il monta à la tribune, on remarqua qu’il n’avait plus qu’une tige dans sa main. Tous les regards se tournèrent vers cet homme pâle, trempé de sueur. Qu’allait-il dire encore ? Sa cause était perdue. « Il va se soumettre », dit à haute voix Axelrod à Martov. Lénine tourna la tête, et, tout en parlant, fixa quelques instants ses yeux brûlants de fièvre sur Axelrod « cet homéopathe de la politique prérévolutionnaire » comme l’appelait Trotsky. Lui se soumettre ? Alors c’était une soumission qu’Axelrod attendait de Lénine ? « Les méthodes et les procédés d’Axelrod avaient un caractère de laboratoire, de pharmacie. Les quantités sur lesquelles il opérait étaient toujours infiniment petites : les groupes qu’il étudiait, il était obligé de les mettre sur une balance de précision, en regard des poids les plus minuscules ». Ce n’est pas en vain, ajoutait Trotsky, que Deutch rapprochait Axelrod du type de Spinoza, polisseur de verres de lunettes : ce travail se faisant, comme on sait, à la loupe.
Lénine tendit le poing. Fini, le temps où il fallait se prêter aux expériences de laboratoire de tous les homéopathes de la politique prérévolutionnaire, le temps où l’on était mis en quarantaine sous la loupe de tous les Spinoza du marxisme. C’est l’état de siège qu’il fallait établir dans le parti, la dictature des révolutionnaires professionnels sur les opportunistes, les mous, les avocats et les petits abbés. « Assez ! Assez ! », cria Martov. Axelrod était accouru et s’était arrêté à quelques pas de Plekhanov, qui écoutait debout, les yeux fermés, dans le fond de la salle. Le vieil apôtre était pâle, ses lèvres tremblaient, des larmes de sueur, ruisselant de son front, inondaient son visage : Axelrod crut qu’il pleurait. Lénine avait toujours le poing levé. « Ce qu’il faut au parti, c’est une main de fer. » Dans une brochure publiée en russe à Genève, la même année, Le deuxième congrès du parti social-démocrate ouvrier de Russie, Trotsky nous montre Lénine à la tribune, le bras tendu, la mâchoire serrée, une flamme jaune dans les yeux. « Cet homme jouait, avec l’énergie et le talent qui lui sont propres, le rôle de désorganisateur du parti. L’état de siège, sur lequel le camarade Lénine insistait avec tant d’énergie, demandait un pouvoir ferme. La pratique de la méfiance organisée exigeait une main de fer. Lénine passait mentalement en revue tous les membres du parti, et arrivait à la conclusion que la main de fer, c’était lui, et lui seulement. Et il avait raison. L’hégémonie de la social-démocratie dans la lutte libératrice signifiait, d’après la logique de l’état de siège, l’hégémonie de Lénine sur la social-démocratie. »
Ce poing tendu n’était pas dans le style de Lénine. C’était un geste nouveau pour lui, habitué au travail méthodique des fiches et des statistiques, dans l’intimité familière de son cabinet de travail ou dans le silence solennel de la bibliothèque du British Museum. Ce poing tendu était lourd, fatiguait son épaule ; il aurait tant voulu le fourrer dans sa poche, comme d’habitude, le sentir presser sur sa cuisse, bien niché dans sa poche, ainsi qu’une arme prohibée. Cependant, à ce moment décisif de sa vie révolutionnaire, bien plus décisif que les heures de fièvre et de tumulte de l’Institut Smolny, en octobre 1917, il lui fallait montrer ce poing non comme une menace mais comme un exemple (comme un symbole, dira plus tard Trotsky), pour faire comprendre au congrès non seulement ce qui manquait au parti, mais la fonction que le Comité central devait exercer dans l’organisation révolutionnaire. « Le camarade Lénine a montré le poing comme le symbole politique du Comité central ; remarque Trotsky dans sa brochure : nous ne nous rappelons pas si cette mimique violente a été signalée dans le compte rendu officiel. Ce serait grand dommage qu’elle ne l’eût pas été, car ce poing couronnait toutes les discussions du congrès. C’est par ce geste que Lénine prenait pour lui-même, dans le Comité central, le rôle de l’incorruptible Robespierre. » Quand Lénine quitta la tribune, l’unité du parti était déjà brisée, bien que la scission ne dût se produire ouvertement que quelques jours plus tard.
Cette vingt-troisième séance se termina par un vote nominal. La majorité fut pour la formule que Martov proposait pour le premier paragraphe des statuts. C’est en vain qu’au dernier moment Plekhanov, les yeux rouges et les mains agitées d’un tremblement nerveux, monta à la tribune pour déclarer que « tous les adversaires de l’opportunisme » devaient voter pour la formule de Lénine. Le congrès se prononça pour Martov. Lénine était donc battu, et Plekhanov avec lui. Mais, quelques jours plus tard, sur la question du nombre et du choix des rédacteurs de l’Iskra, le Comité central et le Conseil du parti soutinrent la proposition de Lénine, qui eut la majorité du congrès. C’était la scission. Une fois de plus, Plekhanov avait voté pour Wladimir Ilitch. « L’état de siège est proclamé », s’écria Martov à l’issue du vote. « Je ne me laisse nullement épouvanter, répliqua Lénine, par ce terme effrayant d’état de siège dans le parti. À l’égard des éléments instables et chancelants, nous avons non seulement le droit, mais le devoir de créer un état de siège. Tous nos statuts, toute notre centralisation, désormais approuvés par le congrès, ne sont pas autre chose qu’un état de siège déclaré contre les sources innombrables de confusion politique. Contre la confusion il faut des lois spéciales, fussent-elles d’exception. »
« Comment a-t-il osé, comment ? », s’écria Axelrod blême et tremblant. Jamais il n’oubliera cette vingt-troisième séance du congrès qui lui révéla, pour la première fois, le vrai visage du fanatisme de Lénine : cet homme pâle montrant à ses adversaires un poing fermé qui serrait une queue de rose. Lorsque Lénine, quittant la tribune laissa tomber cette tige d’un geste distrait, « cette fois-ci, commenta Trotsky, c’est une rose qu’il a oubliée sur la tombe de Marx ». Ces paroles de Trotsky faisaient allusion à un épisode qui revint à l’esprit d’Axelrod. Quelques jours avant, un dimanche, Lénine avait conduit les membres du congrès sur la tombe de Marx, dans le cimetière de Prime Rose Hill. Autour de cette pierre blanche qui porte, gravé, le nom du Prophète, tous ces disciples, venus du fond de la Russie, étaient restés un instant en silence, penchés, comme s’ils eussent prié. Lénine avait les yeux fermés et paraissait plongé dans une profonde méditation. Ils s’en retournaient et se trouvaient déjà près de la sortie du cimetière, quand un gardien les rattrapa pour les avertir qu’ils avaient oublié quelque chose sur la tombe. Lénine pria ses camarades de l’attendre, et suivit le gardien. Il avait oublié son chapeau sur le tombeau de Marx.
III
MAXIMILIEN LÉNINE
« C’EST de cette pâte qu’on fait les Robespierres », avait répondu Plekhanov à Axelrod, qui lui reprochait d’avoir pris la défense de Lénine. À la fin du congrès, lorsque tous les délégués eurent quitté Londres, ce Robespierre, ce Maximilien Lénine, comme l’appelait Trotsky, s’aperçut qu’il était resté seul. Cette victoire, qui restera la seule victoire personnelle de toute sa vie, lui avait coûté cher. Bien que la majorité du congrès se fût prononcée pour lui (il est vrai que cette majorité n’était que de deux voix), il ne restait autour de lui qu’une poignée d’inconnus, dont la plupart n’étaient certes pas ce qu’on appelle des gentilshommes. « Ce sont les bactéries de la révolution », disait Lénine de ses partisans.
« La nouvelle de la scission, écrivait Lounatcharsky, nous frappa comme un coup de tonnerre. » Tel était bien le sentiment de tous les socialistes de Russie qui avaient suivi de loin les travaux du congrès. « Nous étions plutôt indignés de cette scission, et en examinant les rapports, assez laconiques, qui nous parvenaient de Londres, nous nous efforcions de voir clair. On ne manquait pas de raconter que Lénine était un sectaire et voulait établir à tout prix sa domination personnelle dans le parti, mais que Martov et Axelrod n’avaient pas voulu le reconnaître comme le seul chef de l’organisation révolutionnaire. Autour de Lénine, il n’y avait pas un seul nom connu : presque tous étaient des délégués venus des provinces de Russie, tandis que dans le camp des mencheviks, tous les dieux de l’étranger s’étaient réunis. » Les marxistes les plus en vue, ceux que Lounatcharsky appelait les dieux de l’étranger, s’étaient rangés du côté de Martov et d’Axelrod. Mais tout en prenant parti contre Lénine, le jeune Trotsky ne s’était pas jeté dans les bras des mencheviks : il était resté à mi-chemin, en équilibre sur un pied comme Mercure volant. Trotsky était trop ambitieux pour se compromettre avec des philosophes. La révolution, à ses yeux, n’avait rien à voir avec es décisions des assemblées et les démêlés personnels des dieux de l’étranger. Ce n’était pas dans les montagnes suisses que se trouvait l’Olympe de la révolution prolétarienne.
Georges Plekhanov, qui avait donné au cours du congrès des preuves émouvantes de sa faiblesse et de sa prudence, était le seul à nourrir l’illusion que la rupture fût encore réparable. Peut-être un accord était-il encore possible entre les deux fractions. « Aux yeux de Georges, ce n’est qu’une scission », disait Lénine. Mais l’optimisme de Plekhanov ne devait pas résister longtemps aux amères désillusions que lui causaient chaque jour la haineuse rancune de Martov et la violente intransigeance de Wladimir Ilitch. Les tentatives de réconciliation échouaient l’une après l’autre. Cette querelle byzantine prenait de plus en plus le caractère d’une lutte personnelle entre les chefs des deux fractions. Les arguments cédaient aux calomnies. Aux accusations des mencheviks qui dénonçaient « son absolutisme, le formalisme bureaucratique qu’il voulait établir dans le parti, l’obéissance mécanique qu’il exigeait ». Lénine répondait en accusant Martov et Axelrod de trahison. De nouveaux pourparlers engagés par Plekhanov à la fin d’octobre aboutissaient à un dernier échec. Le 1er novembre 1903, Lénine se retirait de la rédaction de l’Iskra, laissant le journal aux mains de ses adversaires, et il annonçait la publication d’une feuille bolchévique, le V périod (En avant), dont le premier numéro ne devait paraître qu’au mois de décembre de l’année suivante. C’était le démembrement du parti, la fin de l’illusion généreuse de Plekhanov : c’était également la rupture de toute relation personnelle entre Wladimir Ilitch et lui. Son affection se fit méchante. Il avait trop aimé Lénine pour demeurer juste envers lui. « Vous le suivez, disait le vieux Georges à Zinoviev, mais Lénine ne sera bon, dans quelques semaines, qu’à faire peur aux moineaux dans les vergers. Il me défie, défie Véra Zassoulitch, Deutch. Ne comprenez-vous pas que c’est une lutte inégale ? Lénine est un homme fini ». Ce langage n’était pas sans faire une certaine impression sur Zinoviev : « Plekhanov, en parlant, fronçait les sourcils d’un air revêche et nous paraissait quelque peu terrible. » Lorsqu’il sut ce que le vieux Georges disait de lui, Lénine se mit à rire. « Il riait, raconte Zinoviev : les poussins se comptent à l’automne, nous assurait-il, nous verrons bien avec qui iront les ouvriers. »
Il riait, se montrait sûr de lui, bafouait ses adversaires, mais une inquiétude obscure tirait les traits de son visage. Les poussins réunis sous les ailes du leader bolchevique, ces « bactéries de la révolution » aux mœurs si douteuses, à l’idéalisme si lourd, étaient bien loin de représenter la classe ouvrière de Russie. Les évènements devaient vite lui montrer qu’il lui fallait recruter ses bactéries non pas dans la lie des émigrés, avilis par l’exil et la misère et prêts à se laisser prendre au filet des compromissions policières, mais dans l’élite des travailleurs, parmi les camarades de Russie. Tâche difficile. Il ne se dissimulait pas que la scission avait troublé l’esprit de l’élite révolutionnaire. Sur qui pouvait-il encore compter ? Le travail patient, obstiné, que Nadejda Konstantinowna avait poursuivi jusqu’alors, se révélait désormais inutile : ses chiffres, ses fiches, ses listes de noms et d’adresses, tout était à refaire. L’Iskra était aux mains de Martov. Sans journal, sans collaborateurs sûrs, comment allait-il pouvoir organiser cette petite armée de révolutionnaires professionnels, destinés à faire du parti l’instrument de sa volonté ? Comment pourrait-il mener tout seul la lutte contre les mencheviks ? Il ne lui restait plus qu’à offrir la paix à ses adversaires. En janvier 1904, il fit au Conseil du parti une offre de conciliation. Il ne lui manquait plus que cette humiliation : sa proposition fut repoussée. Il était le plus faible. Contre Maximilien Lénine, contre ce bonhomme qui avait osé montrer le poing au congrès, la lutte devint cruelle. En Europe, toute la presse socialiste était remplie d’accusations contre sa centralisation excessive, son esprit bureaucratique, son bonapartisme, son jacobinisme. La brochure de Martov, La lutte contre l’état de siège dans le parti social-démocrate, était répandue parmi les travailleurs de Russie à des milliers d’exemplaires. « Dans un instant de découragement, il songea à partir pour l’Amérique, afin de s’y livrer à des travaux de statistique », lit-on dans les notes de P. Pascal aux Pages Choisies de Lénine, publiées par les soins du parti communiste français. Henri Guilbeaux nous montre le leader bolchevique « s’en allant à travers les montagnes de la Suisse : il s’interrogeait et s’analysait. Qui avait raison ? Lui, ou les dissidents ? Mais, triomphant de cette crise, il pensait : je resterai seul, peut-être ; je continuerai tout de même à défendre mon opinion et à suivre la ligne droite. » Cette ligne droite ne le conduisait pas à la révolution prolétarienne, mais à la lutte contre les mencheviks. Écraser ses adversaires, établir sa dictature personnelle sur toutes les fractions du marxisme russe, voilà le but principal qu’il propose à son activité révolutionnaire. Pour comprendre son caractère, sa tactique, son rôle dans les évènements, il faut toujours se rappeler que le but de l’activité de Lénine n’a jamais été de préparer la révolution prolétarienne, mais de se préparer systématiquement à la révolution.
Ce n’était pas pour lui une tâche facile que de rallier, dans les provinces les plus lointaines de la Russie, des camarades disposés à partager avec lui la responsabilité de la scission et les dangers de la lutte contre les mencheviks. L’autorité de Plekhanov était toujours extrêmement grande. Aux yeux des travailleurs le véritable chef du parti, le seul apôtre légitime du marxisme, c’était toujours lui. Parmi les ouvriers de Pétersbourg, de Moscou, de Kiev, d’Odessa ou de Kazan, combien, disait Martov, abandonneraient Marx pour suivre Lénine ? La tâche de Nadejda Konstantinowna était de les dénicher un à un, de les compter, de les faire entrer dans ses fiches, de les mettre en rapport entre eux, de leur envoyer les instructions nécessaires à la nouvelle organisation du parti, de leur fournir les brochures et les tracts de propagande, de les tenir au courant de la campagne engagée par Lénine contre les renégats, les mencheviks, les partisans de Plekhanov. La pauvre Nadejda Konstantinowna se trouvait dans la situation de Koutouzov au lendemain de la bataille de la Moskova ; elle avait la certitude que le congrès de Londres était bien une victoire, mais les pertes avaient été si graves qu’elle se voyait dans l’obligation de racoler les traînards pour en faire l’avant-garde. Cette femme au cœur simple, au fanatisme réfléchi, ne se dissimulait pas que la petite armée bolchevique avait subi une victoire qui ressemblait beaucoup à une défaite. Mais, tout en mesurant froidement les difficultés de sa tâche, elle poursuivait seule, avec un courage patient et têtu, son triste jeu d’échecs, explorant l’immense échiquier de la Russie marxiste de ses gros yeux à fleur de tête, guidée seulement par son instinct, son flair, son expérience d’archiviste de la révolution.
Les débuts de ce racolage avaient été bien difficiles. Enfermée toute la journée dans son pauvre logis de Genève, Nadejda Konstantinowna sentait à tout moment quelque fil de sa faible organisation se casser dans ses doigts. Des camarades venaient de Russie, de temps à autre, porteurs de lettres, d’argent, de listes de nouveaux adhérents. Les listes, hélas ! étaient toujours très courtes. Le recrutement des bactéries de la révolution ne se faisait qu’au milieu de difficultés sans nombre, lentement, une à une. À chaque nouvelle recrue que Nadejda Konstantinowna inscrivait dans ses fiches, Lénine ne cachait pas sa joie. « Encore un ! » écrivait-il à sa sœur. Ses lettres sont remplies d’expressions semblables, qui révèlent une joie enfantine. Sa petite armée de révolutionnaires professionnels était une couvée de poussins bien modeste : elle n’était pas encore assez forte pour faire peur à ses adversaires, mais c’était tout de même une armée. « Vos partisans, lui reprochait-on de toutes parts, ne sont que des aventuriers, des mouchards, des escrocs, des individus tarés, sans moralité, sans culture. » Il le savait, ou tout au moins il s’en doutait, car il n’en eut la preuve que beaucoup plus tard, au moment des affaires Jitomirski, Mirone et Malinovski. Mais pourquoi eût-il dû s’occuper du degré de culture et de moralité de ses partisans ? La fraction bolchevique n’était pas la Salvation Army. Il ne savait que faire des mains propres et des consciences blanches. « Tout ce qui est utile à la révolution est moral », disait-il. C’est avec des microbes qu’il voulait infecter les ennemis de la révolution, c’est-à-dire ses adversaires personnels. Pour épurer le parti de tous les opportunistes, il lui fallait l’empoisonner, lui mettre dans le sang le virus de la désagrégation. Seuls les marxistes qui survivraient à cette épreuve décisive, se montreraient dignes de lutter pour la cause du prolétariat. Comment douter que ces survivants s’unissent à lui ?
Cependant, les nouvelles qui venaient de Russie ne justifiaient pas l’optimisme de Lénine. L’état d’esprit des camarades de Pétersbourg et de Moscou était des plus mauvais. Même dans les milieux intellectuels, on ne s’était pas encore rendu compte des raisons qui avaient déterminé la scission du parti. Les ouvriers les plus intelligents se demandaient comment cette querelle d’idéologues pouvait servir la cause du prolétariat. Pour la plupart des vieux marxistes, le mot bolchevisme n’avait aucun sens. La question que l’on se posait au sujet de Lénine était celle d’Axelrod : comment a-t-il osé ? Tandis que les dieux de l’étranger se querellaient entre eux et remplissaient du bruit de leurs inutiles et dangereuses polémiques cette Suisse paisible, dont le climat est si favorable aux théoriciens, aux phtisiques et aux opportunistes, le devoir des travailleurs de Russie n’était pas de prendre parti pour les uns ou pour les autres et d’entrer dans les démêlés personnels des mencheviks et des bolcheviks, mais de demeurer fidèles à la cause du prolétariat et de lutter sans faiblesse ni déviation contre les exploiteurs de la classe ouvrière. « Comment Lénine, se demandaient les camarades de Russie, comment ce jeune homme de trente-quatre ans, ose-t-il se révolter contre le vieux Plekhanov, le traiter de renégat, de philosophe bourgeois, de traître, de vendu ? Comment ose-t-il l’accuser de ne pas avoir le courage de descendre dans la rue, un drapeau rouge à la main, pour se mettre à la tête de l’insurrection ? Le vieux Plekhanov, cet apôtre si désintéressé, si honnête, si sédentaire, ne s’est jamais posé en héros de la violence : il n’a jamais prétendu que l’odeur de la poudre et du sang fût meilleure que celle de l’encre et du papier. Que pourrait bien faire en Russie le bon vieux Georges ? Ce n’est pas là qu’est sa place, mais à la rédaction de l’Iskra, dans les bibliothèques de Genève et de Zurich, dans les salles de conférence de Berlin, de Bâle ou de Paris, dans les cercles intellectuels de France ou d’Allemagne. Dans l’Olympe de l’émigration, le seul Jupiter officiellement reconnu ne peut être que Plekhanov. C’est un dieu qu’on peut aimer sans crainte, car il est incapable de faire des miracles. On peut se fier à lui : c’est un homme d’une bonté, d’une prudence et d’une philosophie à toute épreuve. Qui, mieux que lui, parmi les doctrinaires du parti, pourrait remplir ce rôle d’ambassadeur de la Russie opprimée ? C’est le plus noble, le plus honnête des représentants du marxisme russe, le plus savant des théoriciens du parti, un des interprètes les plus autorisés et les plus écoutés de la pensée de Marx, dans l’Europe des Bebel, des Kautsky et des Guesde. Peut-être, sous certains rapports, Plekhanov est-il discutable tant comme philosophe que comme révolutionnaire : mais il faut, en tout cas, le juger avec une indulgence que le leader bolchevique est loin de mériter. Que prétend Lénine ? S’emparer du pouvoir ? Jouer le rôle de chef ? Et puis ? Lui ou un autre, ce n’est pas de Londres, de Genève ou de Zurich qu’on peut diriger le mouvement révolutionnaire de Russie. On ne fait pas la révolution avec des congrès, des discours et des brochures. Les querelles byzantines, les scissions, les polémiques personnelles, cette honteuse campagne de calomnies engagée entre mencheviks et bolcheviks, tout cela ne peut que nuire à la cause du prolétariat. C’est faire le jeu de la police impériale, des espions et des agents provocateurs. À Genève, à Zurich, les émigrés peuvent bien prendre au sérieux les propos calomnieux que les leaders des deux fractions se renvoient consciencieusement d’un journal à l’autre, mais à Pétersbourg, dans la presse bourgeoise et dans les cercles réactionnaires, on rit. Les appels à la violence, imprimés sur papier pelure, que Lénine envoie clandestinement de Suisse, ne peuvent faire naître, au cœur des ouvriers de Poutilov et de Viborg, que des sentiments d’amertume. Il y a de l’ironie dans ces appels à la révolte. Sans doute Lénine n’a-t-il pas tort quand il exhorte les travailleurs à ne se fier qu’à eux-mêmes, à ne compter que sur leurs forces, à secouer la tutelle des opportunistes, à engager seuls et directement, sans l’intermédiaire de philosophes, la lutte armée contre les oppresseurs de la classe ouvrière. Mais pourquoi n’a-t-il pas l’idée de quitter la Suisse, et d’abandonner le rôle de philosophe à ce Plekhanov qu’il critique si violemment pour sa prudence, pourquoi n’a-t-il pas l’idée de rentrer en Russie pour se mêler aux ouvriers, lutter avec eux, se mettre à la tête de la révolution prolétarienne ? Ce serait une bonne occasion de prouver que Plekhanov n’est qu’un philosophe et les mencheviks des opportunistes.
Il était donc bien inutile d’abandonner le vieux Plekhanov pour aller grossir les rangs, encore si clairsemés, des partisans de Lénine. Le leader bolchevique n’était aux yeux des camarades de Russie qu’un ambitieux sans scrupules, et même, chose plus grave, un sectaire employant de petits moyens pour atteindre de grands résultats. « Lénine, disait Trotsky, est un illuminé qui travaille dans le noir. » Son fanatisme n’avait rien d’héroïque ou de captivant, c’était une sorte de fièvre froide. Personne ne l’aimait. Les bolcheviks eux-mêmes parlaient de leur chef avec un farouche mépris. Il fallait, pour s’attacher à lui, le détester beaucoup. Dans sa brochure Un pas en avant, deux pas en arrière, parue à Genève en 1904, Lénine nous montre ironiquement, et non sans plaisir, l’image que ses adversaires, et même ses partisans, se faisaient de lui : « Autocrate, formaliste, centraliste, unilatéral, entêté, soupçonneux, étroit, bureaucrate. » C’est le portrait d’un petit bourgeois fanatique.
« Les mêmes coups brutaux qu’il avait assenés aux populistes, aux économistes et aux socialistes-révolutionnaires, écrit Henri Guilbeaux, Lénine les porta à Martov, à Plekhanov et aux mencheviks. » Et Kamenev ajoute : « La lutte contre les social-conciliateurs, les mencheviks, les liquidateurs, est marquée d’un trait rouge dans le travail de Lénine. » Krjijanovski nous dit : « Dans la lutte, Lénine était inflexible et sans pitié : avec les amis, il était gai et courtois. » C’est dans cette violence inflexible et sans pitié, dans cette analyse froide, cynique, méticuleuse, des doctrines et des arguments de ses adversaires, que se révèle le caractère singulier de son fanatisme : soupçonneux, entêté. Un fanatisme de bureaucrate, sans rapports avec la réalité, les faits, les circonstances, les occasions, les hommes, agissant uniquement sur les idées, dans le domaine des idées, allant droit au but avec cette précision, cette violence abstraite et calculée, qu’on ne retrouve jamais dans le fanatisme lourd et brutal des hommes d’action. Quand on lui raconte que Trotsky, pour souligner le côté petit-bourgeois de son caractère, l’appelle « Maximilien Lénine », il cligne des yeux en penchant la tête sur l’épaule. « Ah ! Ah ! Monsieur Trotsky ! » dit-il en souriant.
Brûlé de fièvre, pâle, amaigri, penché des journées entières sur sa table de travail, il jette en hâte sur le papier articles, accusations perfides, répliques véhémentes. Dans cette lutte contre les intellectuels du marxisme, sa méthode est d’en appeler aux masses contre l’élite. « Il injurie, il calomnie, il déshonore », écrit Pierre Lafue, qui l’a connu personnellement et nous en a donné un portrait haut en couleurs, dans lequel les traits arbitraires du Gengis-Khan conventionnel cachent ceux du bonhomme Lénine, du bourgeois fanatique, du Maximilien de Trotsky. « Il improvise des arguments d’une mauvaise foi évidente. Il renie chaque jour ce qu’il a affirmé la veille. Il répète de plus en plus son fameux peu importe, qui, en toutes circonstances, ne laisse plus subsister que l’essentiel. » Cette méthode, il ne l’emploie pas seulement contre ses adversaires mencheviques, mais au sein même de sa fraction, contre tous ceux qu’il jalouse pour leur indépendance de jugement, et dont il redoute les critiques. Le brave Kamenev, ce pauvre Kamenev qui sait par cœur le Capital de Marx, et qui, plus tard, la veille du coup d’État d’octobre 1917, pris de peur à l’idée de ce qui va se passer, osera allonger timidement la main pour tirer la manche de Lénine et pour lui dire : « Attends, il est trop tôt », ce pauvre Kamenev, dont la tête est marxiste et le cœur bourgeois, ne va pas tarder à apprécier tout l’avantage des méthodes polémiques de son chef. Chaque fois qu’il prendra la parole dans une réunion bolchevique, on lui jettera à la figure, de tous les côtés, les mots de renégat, de traître et de vendu. Il n’ose plus parler : sa bonne foi pourrait le perdre. Ce qui arrive à Kamenev, fidèle partisan de Lénine, s’était déjà produit pour Axelrod, adversaire des bolcheviks. Pendant le congrès de Londres, Axelrod s’était approché de Wladimir Ilitch : « Pourquoi m’as-tu calomnié tout à l’heure ? Pourquoi m’as-tu accusé d’avoir trahi le marxisme ? » lui demanda-t-il. « Il me fallait un argument, répondit Lénine en clignant des yeux, j’ai choisi celui-là. »
Si les critiques des adversaires de Lénine sont haineuses et violentes, celles de ses partisans ne sont pas sans amertume et sans rancœur. Quand ils l’avaient suivi dans la scission, c’était un chef, un véritable chef révolutionnaire qu’ils avaient cru choisir en lui, un homme d’action et non ce petit bourgeois, ce bureaucrate qui s’imagine pouvoir bouleverser le monde par une guerre de dossiers. Le but évident de son « activité administrative » n’est pas la révolution prolétarienne, mais la désorganisation du parti. Sa campagne de calomnies et sa guerre de dossiers ont fini par faire perdre de vue les véritables objectifs de la lutte révolutionnaire. Même les marxistes les plus dévoués à la cause du prolétariat en sont réduits, pour se défendre, aux polémiques personnelles, les plus dangereuses et les plus stériles des polémiques. Ne voit-il pas qu’il s’éloigne de plus en plus des masses et perd de plus en plus contact avec les ouvriers de Russie ? Comment ont-ils bien pu donner leur confiance à cette sorte de petit bourgeois fanatique ? C’était un chef, un homme d’action qu’ils avaient cru choisir en lui, un homme capable de faire du parti un puissant instrument de lutte révolutionnaire, le bélier de la révolution. Ils se rendent compte trop tard qu’entre les mains de Lénine, le parti ne saurait être qu’un instrument personnel contre ses adversaires.
Ils ont tort de ne pas comprendre que le rôle d’un véritable chef révolutionnaire, dans le sens moderne et, j’allais ajouter, dans le sens marxiste du mot, n’est pas de préparer la révolution, mais d’en établir les cadres et d’en fixer la doctrine. « Sans théorie révolutionnaire, pas de mouvement révolutionnaire », écrit Lénine dans sa brochure Que faire ? Et plus loin : « Seul un parti dirigé par une théorie d’avant-garde peut jouer le rôle de combattant d’avant-garde. » Au lendemain ces épisodes sanglants de la révolution de 1905, Martov publie dans l’Iskra (No 85 du 27 Janvier 1905) une suite de considérations tirées des évènements : « L’objectif de la social-démocratie au moment voulu, écrit-il, n’est pas tant d’organiser la révolution que de la déclencher. » La réplique de Lénine à Martov ne fait que confirmer ses idées sur les rôles respectifs du chef révolutionnaire et de l’homme d’action.
Le rôle de Lénine ne saurait être celui d’un meneur d’émeutes. Une révolution n’est pas une insurrection. La veille du coup d’État d’octobre 1917, celui qui prend la tête des équipes insurrectionnelles, c’est Trotsky. C’est Trotsky, l’homme d’action. Lénine se déguise, met une perruque, se coupe la barbe et se cache. Ses biographes officiels n’aiment pas beaucoup parler de cet épisode banal, et pourtant essentiel si l’on veut comprendre le vrai caractère de Lénine. Aux moments dangereux, ce bonhomme fanatique n’a fait que se déguiser et se cacher. Ce n’est pas un rôle ridicule ou honteux. C’est son rôle. Comment ne pas voir que le caractère de Lénine est fait pour ce rôle ? Il y a une stratégie révolutionnaire et une tactique insurrectionnelle. Lénine est le stratège : Trotsky le tacticien. Pour préparer les cadres de la révolution, il faut combattre toute déviation doctrinaire, « toute interprétation tendancieuse et opportuniste des idées de Marx dans le domaine de la politique, de la philosophie et de la morale ». Il lui faut épurer le parti de tous les faibles, de tous les opportunistes, de tous les dilettantes, et faire de cette organisation pléthorique, sans unité de doctrine ni de commandement, une équipe de spécialistes de la révolution, aveuglément soumis à sa volonté. De ce parti, il veut faire une bande. « Ce n’est pas avec un pensionnat de jeunes filles, dit-il, qu’on peut s’emparer du pouvoir. » Seul, un homme comme Lénine peut atteindre ce but. Quant à préparer et à déclencher la révolution, ce n’est pas son rôle : c’est en dehors des partis, sur le terrain de la lutte de classe, des grèves, des émeutes ouvrières, qu’elle se prépare. Elle se déclenchera d’elle-même, en dehors de toute organisation. Mais, sans Lénine, il n’y eut pas eu d’octobre 1917. Sans Sieyès, il n’y eut pas eu de 18 Brumaire ; sans Robespierre, pas de Napoléon. Ne serait-ce pas réellement le rôle du chef révolutionnaire dans le sens moderne et marxiste du mot, que celui de fixer la doctrine, de préparer les cadres de la révolution, d’attendre et de guetter la conquête du pouvoir ? Ou bien ne serait-ce pas, plutôt, celui de forcer les évènements, de déclencher la révolution par tous les moyens, par la propagande, les mouvements ouvriers, les attentats, les troubles, les émeutes ? Il n’y a pas un seul homme, dans l’histoire révolutionnaire de l’Europe, qui ait pu jouer ce dernier rôle. C’est trop pour un homme, c’est trop pour un parti. La révolution n’est pas un coup d’État.
Dans la société moderne, les révolutions obéissent à des lois qu’il n’est pas au pouvoir d’un homme ou d’un parti de modifier ou de briser : ce sont les lois qui règlent les phénomènes sociaux et économiques, les lois qui ont pour code le Capital de Marx. En marxiste scientifique, Lénine se refuse à forcer les évènements : d’ailleurs, il n’en serait pas capable. Toujours, en 1905 comme en 1917, les évènements auxquels il se mêle l’écrasent. Il sait que la révolution se produira d’elle-même, que l’heure de la conquête du pouvoir arrivera fatalement, que rien ne sert d’avancer sa montre. C’est en dehors de lui que les évènements se produiront : son rôle, c’est d’être prêt à en profiter, d’épier les occasions favorables, et, dans l’attente, d’entretenir l’esprit révolutionnaire des masses par une propagande active. Mais rien que par la propagande. Les méthodes des terroristes et des meneurs de grèves et de révoltes, il les condamnait au nom du marxisme scientifique, les déplorait de tout son cœur. « Je ne suis pas un héros de roman » dira-t-il plus tard, au cours des sanglantes journées de 1905, pour se justifier d’avoir eu peur. C’est ce que voulait dire Trotsky quand il déclarait tout récemment à la comtesse Irène de Robilant, correspondante d’un journal américain, qui était allée l’interviewer sur la côte d’Asie, dans son lieu d’exil : « Lénine n’a jamais soigné sa ligne historique. »
Trotsky, le héros du coup d’État d’octobre 1917, juge les hommes et les évènements en homme d’action. Mais, pour Maximilien Lénine, le rôle des hommes d’action dans les évènements révolutionnaires est un rôle de second ordre. Ils ne sont nécessaires que dans la phase insurrectionnelle, dans la conquête violente du pouvoir. Une fois le coup d’État fait, il faut les empêcher de profiter de circonstances exceptionnelles pour pousser leur rôle jusqu’à ses dernières conséquences, il faut les obliger à laisser sur-le-champ la place au chef légitime de la révolution, qui est presque toujours un homme profondément dégoûté des coups de feu et des barricades, et dépourvu de tout enthousiasme pour cet indispensable intermède héroïque. Ce n’est pas un révolutionnaire qu’il faut voir dans un homme d’action, dans le héros d’un coup d’État : c’est un fondateur de dynasties, un créateur d’empires. Certes, par rapport à la farouche grandeur de la Révolution française ou de la révolution russe, cette conception du rôle du véritable chef révolutionnaire moderne ne saurait satisfaire le romantisme de tous les Candide et de tous les Babbitt de nos jours, prêts à voir un héros de Plutarque en la personne d’Henry Ford, aussi bien qu’un Gengis-Khan ou un Mahomet chez Lénine. Il peut se faire, pourrait-on objecter, que Lénine n’ait point été un homme d’action au sens traditionnel, ou mieux, conventionnel du mot, mais que, toutefois, son rôle dans la révolution russe n’ait pas seulement été celui d’un petit bourgeois fanatique, d’un bonhomme violent et timide. Pour comprendre le vrai caractère de Lénine et son rôle dans la révolution, il suffit d’examiner sa participation personnelle aux évènements de 1905 et de 1917. Aux moments décisifs, quand la révolte se déclenche, sa conduite n’est pas celle d’un homme d’action. En cela encore, il ressemble à Robespierre. Trotsky le sait bien, lui qui a le goût des parallèles à la Plutarque. Ceux qui jugent Machiavel non seulement sur ses écrits, mais d’après ce qu’il était, ne le diminuent pas le moins du monde, lorsqu’ils montrent qu’il n’était, en réalité, qu’un petit bourgeois, qu’un bonhomme plein de prudence et de bon sens. On ne diminue pas Lénine quand on dit qu’il n’était qu’un petit bourgeois, et cela beaucoup plus, par exemple, que n’importe quel Clemenceau.
À la veille de la révolution de 1905, l’activité révolutionnaire de Lénine se bornait, comme toujours, à la rédaction d’articles polémiques et de brochures de propagande. La vie qu’il menait à Genève était celle d’un petit employé à la retraite. Nul n’aurait soupçonné le dangereux personnage qui se cachait dans ce Monsieur de mine modeste et correcte, aux habitudes tranquilles, qui s’en allait tous les matins, son panier sous le bras, faire ses emplettes au marché, fréquentait assidûment la bibliothèque de la Société de lecture et se promenait le dimanche sur les quais, les mains croisées derrière le dos, le chapeau tiré sur les yeux, en compagnie d’une femme épaisse, à la démarche lente, regardant au loin des nuages bleus sur des montagnes blanches de neige. Les cygnes noirs glissaient lentement sur la surface du lac, autour de l’île de Rousseau.
Le climat de Genève avait achevé l’éducation sentimentale et intellectuelle de Lénine : ce climat doux, favorable aux consciences prédestinées à l’égoïsme et à la philanthropie, l’avait dégoûté pour toujours de Rousseau et de Calvin. Il découvrait trop d’îles vertes, trop de saules pleureurs, trop de justice distributive dans la philosophie de Jean-Jacques. On n’a pas le droit de compromettre la nature à ce point. Dans le calvinisme, dans cette austère religion de marchands, il entrevoyait le fond de cet esprit bourgeois, qu’il subira plus tard dans la « nep ». Calvin, Rousseau, Voltaire (« Je ne ferai jamais le pèlerinage de Ferney, disait-il : je n’aime pas les hommes d’esprit »), étaient le sujet préféré de ses conversations avec Lounatcharsky, qu’il voyait très souvent au café Landolt ou bien au Cercle russe de la rue de Carouge, chez les Lépéchinsky. L’homme de lettres Lounatcharsky, l’esthète, le platonicien qui méditait déjà son hérétique « construction de Dieu », avait depuis peu quitté la Russie en compagnie de sa femme, et menait à Genève une vie de bohème sans parti pris et sans idées générales. Un lundi matin, le 10 janvier, Lounatcharsky rencontra Lénine dans la rue et le mit au courant des évènements de Pétersbourg. Le 8, la grève était générale. Le dimanche 9, sous la conduite du pope Gapone, d’immenses processions d’ouvriers, de femmes et d’enfants, porteurs de croix et d’icones, s’étaient dirigées vers le Palais d’Hiver pour présenter une pétition au tsar Nicolas. Accueillie par une fusillade, la foule s’était jetée à genoux sous le feu des cosaques, en chantant des prières et des cantiques. À la nouvelle de ce massacre, un cri terrible avait jailli du fond du pays russe : la grève générale s’était propagée au-delà des monts Oural, en Asie, de violentes insurrections avaient eu lieu à Varsovie, à Kowno, à Riga, à Kiev, à Tiflis, à Batoum, à Lodz, à Saratov. Partout les ouvriers menaient la lutte avec une sauvage énergie. À Riga les travailleurs armés s’étaient emparés de la ville ; à Varsovie, pendant huit jours, les troupes furent assiégées dans les quartiers du centre ; toute la Pologne était aux mains des insurgés. La grève générale avait mobilisé, sur tout le territoire de l’empire russe, une armée de plus de 600.000 grévistes. C’était la révolution. « Il faut attendre les détails de l’affaire, disait Lénine, pour juger si, vraiment, c’est la révolution. »
Que va décider Lénine ? Que va-t-il faire ? Il va sans doute quitter la Suisse : sa place est en Russie, à la tête des ouvriers. Au café Landolt et au Cercle russe de la rue de Carouge, la confusion est énorme. Tous les émigrés de Genève sont là, pâles d’émotion, les yeux voilés de larmes, la voix rauque, excités et tremblants. Il faut partir, rentrer en Russie, pour aider le peuple, pour se battre avec les ouvriers contre le régime des oppresseurs. Et Wladimir Ilitch ? Où est Wladimir Ilitch ? Lénine est tranquillement rentré chez lui et s’est enfermé dans sa chambre. Pendant que le prolétariat russe engage une lutte à mort pour la liberté de la Russie, Lénine engage une polémique avec Martov et Plekhanov sur l’attitude que la social-démocratie doit prendre dans la révolution. Tandis que les ouvriers russes se battent dans les rues, Lénine écrit un article. On peut penser tout ce qu’on veut de lui : le fait est là ; il écrit des articles. Pour ridicule ou sublime qu’elle puisse paraître en présence d’évènements aussi tragiques, son attitude est peut-être dictée par une prudence fort compréhensible : Lénine se méfie d’une révolte ouvrière conduite par un prêtre. Mais dans la révolution de 1905 le pope Gapone n’est qu’un épisode. Ce prêtre, debout sous le feu des cosaques au milieu de la foule à genoux dans la neige, ne peut rien avoir d’équivoque aux yeux de Lénine : ce n’est que bien plus tard qu’on a su que le pope Gapone, le héros du dimanche rouge, était payé par la police. Étonnant pays, où même les héros de la révolution sont des mouchards ou des agents provocateurs.
Il serait bien naïf de prétendre accuser ou justifier la conduite de Lénine. Elle ne pourrait être plus logique. Certes, si Wladimir Ilitch était le Lénine conventionnel des biographies courantes, le monstre asiatique que la bourgeoisie d’Europe croit voir en lui, il ne resterait pas tranquillement à Genève, il ne passerait pas ses journées, comme d’habitude, devant sa table de travail, pendant que six cent mille prolétaires lèvent, en Russie, le drapeau rouge de la révolution. Mais la conduite de Lénine n’est pas surprenante pour ceux qui le connaissent bien. Il attend, c’est tout. On ne saurait dire qu’il ait peur ; mais la tragique grandeur des évènements l’écrase. Ce sera de même en octobre 1917. Que pourrait-il faire, au milieu de cette foule énorme d’ouvriers en révolte ? Comment pourrait-il arriver à imposer sa volonté à cette immense armée de six cent mille grévistes ? Il n’a pas encore une autorité suffisante pour se proclamer le chef de la révolution. Personne ne le suivrait. Ce n’est pas son heure : c’est l’heure de Gapone. Il attend : il faut attendre. Sa conduite ne pourrait être plus raisonnable. La logique d’un chef révolutionnaire élevé à l’école de Marx n’est pas celle d’un homme d’action. Pour être en mesure d’imposer sa volonté à la révolution, il lui faut d’abord l’imposer à tout le parti, écraser tous ses adversaires. Son devoir est de poursuivre la lutte contre les mencheviks, contre les renégats du marxisme, « contre les opportunistes qui hésitent à prendre une attitude révolutionnaire en face des évènements de Russie ».
Dans la question que Lénine pose dans le V périod en réponse aux arguments de l’Iskra, on trouve en abrégé toutes les raisons qui règlent sa conduite au cours de l’année 1905 : Devons-nous organiser la révolution ? Cette querelle byzantine, qui se prolonge au cours de plusieurs mois entre le V périod et l’Iskra, tandis que des épisodes révolutionnaires de plus en plus sanglants se succèdent en Russie, offre bien la mesure du désarroi dans lequel la scission de Londres a plongé le parti. Le ton en est médiocre et la sincérité douteuse. Les interprétations arbitraires de certains passages de Marx et d’Engels, les appels démagogiques au peuple, les calomnies ad personam, tous les mots usés, les arguments périmés, les prétextes conventionnels, les thèmes obligés constituant le fond de l’interminable polémique qui met aux prises, depuis quarante ans, les marxistes les plus en vue de l’Europe, reviennent tour à tour dans les articles de Lénine, de Martov, de Plekhanov, de Martynov et de Parvus. Les contradictions et les sophismes sont de rigueur, dans cette querelle de petits bourgeois persuadés qu’ils dictent ainsi, aux travailleurs qui se battent en Russie, les règles du jeu révolutionnaire. Sur quoi roule la discussion ? « La révolution populaire ne peut pas être commencée à date fixe », écrit Martov dans l’Iskra. « C’est juste, réplique Lénine, mais fixer la date de l’insurrection si nous l’avons réellement préparée et si elle est possible en elle-même, grâce à la révolution déjà accomplie dans le domaine social, est chose parfaitement réalisable. » C’est le thème de l’article Deux tactiques, paru le 1er février dans le n° 6 du V périod. Dans deux autres articles intitulés « La Social-démocratie et le gouvernement révolutionnaire provisoire » et « La dictature révolutionnaire démocratique du prolétariat et des paysans », parus respectivement dans les numéros 13 et 14 du V périod. Lénine, remarque P. Pascal, « affirme contre Martynov et Martov la nécessité de matérialiser la victoire de la révolution en une dictature révolutionnaire du prolétariat et des paysans, cela vu l’importance sociale des éléments petit-bourgeois. Contre Parvus et Trotsky, il soutient le caractère bourgeois de la révolution présente et la distinction entre le programme maximum et le programme minimum ». Dans sa brochure Avant le 9 janvier, Trotsky avait écrit que la révolution russe en était arrivée à son point culminant, l’insurrection de tout le peuple : « Organiser cette insurrection, dont dépend la destinée, prochaine de la révolution, voilà la tâche de chacun de nous. Un pope Gapone a pu apparaître une fois. Mais si, aujourd’hui, on voyait surgir une seconde figure égale à Gapone par l’énergie, l’enthousiasme révolutionnaire et la force des illusions politiques, elle viendrait trop tard. Ce qui, chez Gapone, était grand, pourrait maintenant sembler ridicule. Un second Gapone est impossible. » Le point de vue de Trotsky n’est pas sans déplaire à Lénine et sans lui donner quelque inquiétude. « Si Trotsky écrit maintenant qu’un second Gapone est impossible, proteste Lénine, ce ne sont que des phrases. S’il n’y avait pas de place pour un second Gapone, il n’y aurait pas de place non plus pour une révolution démocratique vraiment grande, allant jusqu’au bout. » N’y a-t-il pas quelque ironie, dans cette prétention de se réserver le rôle de second Gapone, chez ce marxiste qui fait de la polémique en marge d’une sanglante révolution prolétarienne ? Trotsky n’a pas tort quand il avertit que ce qui est grand chez le Gapone d’aujourd’hui pourrait paraître ridicule chez celui de demain.
Trotsky est en Russie avec Krassine, au milieu des ouvriers. Que fait Lénine à Genève ? Il organise le troisième congrès du parti, qui doit se réunir à Londres en avril. La convocation du congrès ne peut manquer d’offrir de nouveaux prétextes à la polémique acharnée qui se poursuit entre l’Iskra et le V périod. Cependant que les bolcheviks, d’accord avec le Comité central et avec le bureau des comités de la majorité, se réunissent à Londres, les délégués mencheviques, conformément aux instructions du Conseil du parti présidé par Plekhanov, refusent de prendre part à ce congrès et convoquent, à Genève, une conférence social-démocratique panrusse.
« Nous avons fait le jeu de Lénine », devait dire plus tard Plekhanov. Jusqu’à ce jour, la scission n’avait point été légalisée par le parti. Lénine n’était que le chef de la fraction bolchevique, comme Plekhanov le chef de la fraction menchevique. Le journal officiel du parti était toujours l’Iskra, le V périod étant considéré simplement comme l’organe de la fraction bolchevique. Par leur refus de participer au troisième congrès, les partisans de Plekhanov ne font qu’aider Lénine à atteindre son but, qui est de devenir le chef légal du parti. Tant qu’il ne le sera pas, ni ne sera reconnu tel par tous les militants socialistes de Russie, il ne pourra prétendre devenir le chef de la révolution prolétarienne. Cette tactique, à laquelle il restera fidèle toute sa vie, c’est le secret de son succès et celui de son caractère. Lénine lui-même, qui se plaît à des comparaisons impossibles, observe ironiquement que la règle fondamentale de sa tactique n’a rien de surprenant. Dans l’histoire du Parlement d’Angleterre n’est-ce pas toujours le chef du parti whig ou du parti tory qui est désigné pour former le nouveau cabinet ? Ce principe, qui s’est montré si raisonnable et qui a donné de si bons résultats dans la vie parlementaire anglaise, rien n’empêche qu’il se révèle tout aussi raisonnable et donne des résultats tout aussi bons dans la vie révolutionnaire de Lénine. Au fond, lorsque le chef du parti bolchevique, par le seul fait qu’il se trouvait à la tête du parti, est devenu le chef de la révolution russe, tous les bons libéraux d’Angleterre ont dû se réjouir d’une confirmation aussi exceptionnelle, d’un principe qui fait la force du Parlement et constitue la meilleure garantie des libertés britanniques.
La majorité des comités de Russie, lit-on dans les documents officiels, se trouvant représentée à Londres (20 comités sur 34), le congrès devait être considéré, d’après les statuts, comme le seul interprète authentique de la volonté du parti. Aussi les mencheviks furent-ils déclarés hors la loi ; l’Iskra dut renoncer au titre de journal officiel, et le V périod se fondit avec un nouvel organe central qui devait s’appeler Le Prolétaire, et dont le premier numéro devait paraître au mois de mai. Enfin, le congrès approuva une motion proposée par Lénine sur la question du gouvernement révolutionnaire provisoire : « La participation des délégués de notre parti au gouvernement révolutionnaire est admissible dans certaines circonstances, pour mener une lutte implacable contre toutes les tentatives contre-révolutionnaires et défendre les intérêts de la classe ouvrière. » Cette décision marque une date dans la tactique de Lénine : son fanatisme intransigeant tournait brusquement au fanatisme opportuniste. « L’intransigeance mène à tout, disait-il, pourvu qu’on sache en sortir à temps. » La stupeur que provoqua dans tous les milieux socialistes la motion approuvée par le congrès de Londres était d’autant plus grande, que l’ordre du jour voté par la conférence menchevique de Genève était nettement intransigeant : « La social-démocratie, au cours de la révolution, doit s’efforcer de conserver la position qui lui permettra le mieux de pousser la révolution en avant. Elle ne doit pas se proposer de prendre ou de partager le pouvoir dans le gouvernement provisoire, mais de rester un parti d’extrême opposition révolutionnaire. » Au fond, l’attitude de Lénine et celle de Plekhanov devant les évènements de Russie partaient du même jugement sur le caractère bourgeois de ces évènements. Que pouvait-on attendre d’une révolution semblable ? Mais le même scepticisme qui prenait, dans l’ordre du jour de Plekhanov, un ton d’intransigeance agressive, se nuançait chez Lénine d’un opportunisme prudent et satisfait, dont Machiavel n’eût point dédaigné la saveur et la mesure.
C’est ici que se pose pour la première fois la question de l’opportunisme de Lénine. On s’est déjà demandé à propos de Luther, de Cromwell, de Robespierre, et de bien d’autres, qui ajoutaient au sentiment de leur fatalité personnelle un sens très aigu des occasions et des circonstances, s’il est possible d’être à la fois fanatique et opportuniste. Nous ne manquons pas d’exemples qui nous prouvent que l’opportunisme est le trait le plus caractéristique du fanatisme petit-bourgeois. En ce qui concerne Lénine, ce trait est particulièrement visible dans les moments décisifs, quand le problème révolutionnaire, du domaine de la théorie, passe dans le domaine de l’action, de la révolte armée. C’est alors que le petit bourgeois fanatique met en jeu toutes les ressources de son astuce, de sa souplesse, et de son cynisme, pour se soustraire aux responsabilités qui lui incombent, pour demeurer, aussi longtemps que possible, en dehors des évènements. Ce qu’on appelle, dans ces cas-là, son opportunisme, c’est l’art qu’il met à rester extérieur aux responsabilités de l’action, étranger aux évènements, par conséquent dans les meilleures conditions pour en profiter. « Comme Danton et comme Cromwell, remarque Lounatcharsky, Lénine est un opportuniste de génie. » Tous ceux qui ont examiné de près les caractères de sa volonté et de sa tactique, s’accordent à le définir « un opportuniste ». Lénine lui-même est clair, à ce sujet, quand il écrit qu’il est ridicule de se refuser, en principe, au compromis, de nier la légitimité de tout compromis. Comment donc a pu naître l’opinion courante de l’inexorable intransigeance de Lénine ?
La définition la plus pénétrante de la logique de Lénine est celle de l’écrivain Babel : « Une courbe complexe tracée par une ligne droite. » Trotsky la commente pour dire qu’en dépit de son antinomie et de sa subtilité, la définition de Babel est exacte. On pourrait dire, avec plus de clarté, que la logique de Lénine s’enroule en spirale autour de la ligne droite de sa volonté. L’opportunisme de cette logique est aussi utile pour adhérer au fur et à mesure aux circonstances extérieures, que l’intransigeance est nécessaire pour réagir, dans une mesure égale et constante, aux forces qui s’opposent les unes aux autres dans l’évolution de l’esprit révolutionnaire. On a voulu trouver la justification de cette intransigeance, comme de cet opportunisme, chez Marx, dans les considérations de sa lettre à Bolte. Il serait plus simple de constater que la logique de Machiavel est de tous les temps : la fin justifiant les moyens, ce fut toujours la loi de tout opportunisme et de toute intransigeance, même celle du réalisme de Marx. La logique de toute révolution, c’est le rapport entre hasard et volonté, opportunisme et intransigeance. « Ma vie est-elle sous le signe de la fatalité ? » demandait parfois Lénine à ses amis. Et il riait en clignant des yeux. Sans doute ne connaissait-il pas le mot de Napoléon, au cours de son fameux entretien avec Goethe : « De nos jours, que nous veut-on avec la fatalité ? La politique, voilà la fatalité. »
Même après sa consécration officielle de chef de parti, Lénine demeurait fidèle à sa fatalité, c’est-à-dire à sa politique. Il ne croyait pas, au moins pour l’instant, que ce fût la révolution. Tout fait supposer qu’une vraie révolution l’eût considérablement dérangé. Il n’était pas encore prêt. « Lénine était un de ces précurseurs qui arrivent toujours en retard. » S’il s’attardait à Genève, c’était afin d’arriver en retard sur la scène de Russie, c’est-à-dire au bon moment. Les évènements de Pétersbourg, bien que les masses ouvrières y jouassent un rôle considérable, se déroulaient suivant des règles qu’il lui était facile de décréter soumises à la fatalité bourgeoise. Aussi, dans son langage même, au cours de la polémique qu’il soutenait contre l’Iskra, on voit reparaître à tout propos les expressions que l’opportunisme révolutionnaire emprunte, depuis un siècle, à la prudence et à la rhétorique des libéraux et des démocrates bourgeois. Lénine à cette époque n’avait pas encore répudié comme bourgeois les mots liberté et démocratie, si chers à Plekhanov, à Martov et aux libéraux russes partisans de la Douma Boulyguine. La révolution prolétarienne, il continuait de l’appeler une révolution démocratique.
Après la révolte des matelots de la Mer Noire, au mois de juin de la même année, dont le principal épisode fut l’émeute qui se produisit à bord du cuirassé Potemkine, Lénine publia une brochure ayant pour titre : Deux tactiques de la social-démocratie dans la révolution démocratique. Cet opuscule, commencé « avant les évènements d’Odessa » mais terminé et publié à la fin de juillet (c’est-à-dire bien après la fusillade du 15 juin), nous permet-il de supposer que Lénine ait cru sincèrement voir, dans la révolte des matelots du Potemkine, un épisode de cette révolution démocratique qu’il défendait alors avec une telle surabondance d’arguments médiocres ? Il était faux dans son langage, mais sincère dans ses idées. N’avait-il pas écrit quelques mois avant, dans un article intitulé La social-démocratie et le gouvernement révolutionnaire provisoire, paru en mars dans le V périod : « Le prolétariat révolutionnaire prendra part à cette révolution avec toute son énergie, en marchant obstinément et hardiment de l’avant, sans craindre la dictature révolutionnaire démocratique, en la désirant au contraire passionnément, en combattant pour la république et pour la pleine liberté républicaine, pour de sérieuses réformes économiques ? Il est bien amusant d’entendre Lénine, en 1905, pendant que les ouvriers, en Russie, se battent dans les rues, tenir à Genève le langage de Jaurès.
En ce qui concernait le boycottage de la Douma Boulyguine, que le gouvernement du tsar au début d’août avait octroyée à la bourgeoisie libérale pour tâcher d’enliser le mouvement révolutionnaire dans le terrain constitutionnel, Lénine ne cherchait pas ses mots dans le dictionnaire du marxisme scientifique. Ses considérations en faveur du boycottage (« le boycottage est une question intérieure de la démocratie bourgeoise : la classe ouvrière n’y est pas directement intéressée, mais elle a un intérêt certain à soutenir la fraction de la démocratie bourgeoise qui est la plus révolutionnaire ») et ses appels à l’insurrection (« nous devons faire appel à l’insurrection ! » ; puis, revenant sur ses pas, comme quelqu’un qui a oublié son chapeau il ajoutait : « évidemment, sans en fixer d’avance la date »), n’étaient pas exprimés dans un langage approprié au sujet et aux circonstances. C’était comme des discours séditieux prononcés au cours d’un meeting ouvrier, par un Monsieur en redingote. L’Europe révolutionnaire avait déjà donné un spectacle semblable à Paris, en 1830 et en 1848 : des bourgeois en chapeau haut-de-forme incitant à la révolte, en un langage noble et correct, les ouvriers en blouse et en casquette du faubourg Saint-Antoine. Les articles que Lénine écrivait à Genève au cours de l’été 1905, tandis qu’en Russie Trotsky haranguait la foule dans les rues et que Krassine distribuait aux travailleurs des armes et des cartouches, font penser à cette statue de Karl Marx en redingote qui s’élève devant l’Institut Smolny, à Leningrad, ou bien à ce Marx de certains portraits, qui a l’air d’un héros de Balzac avec son monocle pendant sur le plastron d’une chemise amidonnée. Le rabiat gewordene Kleinbürger d’Engels, la brusque rage du petit bourgeois fanatique, prenait chez Lénine, à ce moment décisif de la lutte révolutionnaire, un air de dignité qui révélait en lui, sans trop le compromettre, un extrême souci de prudence.
Combien la préoccupation que Lénine, en septembre et octobre 1905, à la veille de son départ pour la Russie, cachait sous un air de dignité, était différente de celle qu’il montrait ouvertement en janvier ou en février, quand le visage barbu du pope Gapone se détachait sur le fond rouge de la révolution comme le visage d’un saint sur une icone. Lénine n’était pas encore devenu le chef légal du parti et les évènements de Russie l’intéressaient beaucoup moins que sa querelle avec Martov. Il pouvait alors regarder les hommes et les faits de cette révolution comme un joueur d’échecs regarde les pions sur l’échiquier d’à côté. La partie qui se jouait dans les rues de Pétersbourg et de Moscou n’était pas du même genre que celle qu’il jouait à Genève à sa table de travail, dans les colonnes du V périod, et dans les réunions du café Landolt. Il pouvait bien, en quelque sorte, s’en désintéresser, tant qu’il n’était pas le chef légal du parti et qu’il n’avait pas le droit et la possibilité de manœuvrer les pions sur l’échiquier voisin. Les hommes de cette révolution ne le troublaient pas alors : il n’en était pas encore jaloux. La nouvelle qu’en février Trotsky était déjà rentré en Russie (pour y jouer un rôle que Lénine méprisait et pour lequel il se sentait inadapté, bien que, plus tard, il ait souhaité que personne d’autre que lui ne le jouât) avait été accueillie par Lénine sans grande surprise. Il s’y attendait. Au fond, il n’était pas encore jaloux de Trotsky ; il s’en méfiait seulement ; il aimait mieux le savoir loin, occupé à une autre partie d’échecs, que trop près de sa table de jeu. Lénine n’avait eu qu’un sourire de mépris, un mépris sans inquiétude. On disait que Monsieur Trotsky venait d’arriver à Kiev ; à qui voulait-il donc faire croire que sa présence était nécessaire en Russie ? On ne pouvait rien attendre de lui, rien d’héroïque dans le sens marxiste. Trotsky n’avait rien d’un héros marxiste. Au café Landolt, personne n’ignorait certains propos de Lénine sur lui : « Il pouvait très bien se faire que Trotsky eût les défauts d’un héros ; mais il était inadmissible qu’un héros eût les qualités de Trotsky. » Cette question du rôle de l’héroïsme dans la révolution démocratique, occupait beaucoup Lénine en ce temps-là. Il commençait à se réconcilier avec les héros et avec les démiurges. Le marxisme scientifique produirait sans doute un nouveau type de héros : désintéressé, froid, cynique, dépourvu de pittoresque et d’esprit d’aventure. Le héros marxiste, à ses yeux, n’était pas nécessairement un homme d’action.
Quand le pope Gapone en personne était arrivé à Genève, peu après le dimanche rouge, Lénine l’avait accueilli avec une sincère émotion. « J’espérais trouver en lui un véritable héros, un héros marxiste » disait-il plus tard, en souriant, pour se justifier de cet enthousiasme candide. Contrairement à ce qu’avait fait Plekhanov, qui avait traité Gapone d’une manière extrêmement froide et ne lui avait adressé la parole que pour lui faire sentir sa méfiance, Wladimir Ilitch l’avait reçu chez lui avec une cordialité que Nadejda Konstantinowna, bien plus lente que lui à s’émouvoir, avait jugée « enfantine ». Mais au bout d’un quart d’heure elle avait observé que cette cordialité se nuançait déjà d’un commencement de mépris. Ces yeux doux, ce visage pâle, cette barbe soyeuse, ces gestes de prophète et cette voix d’apôtre, ce n’étaient pas les traits caractéristiques d’un héros marxiste. Gapone sentait l’astuce, la sincérité, le pittoresque et, en même temps, l’ingénuité et la police. En le regardant et en l’écoutant, Lénine se persuadait de plus en plus qu’il n’était pas possible de se tromper sur la nature de cet héroïsme naïf et corrompu. Quel rapport pouvait bien avoir avec Marx ce pope qui avait défié le feu des cosaques, debout devant le Palais d’Hiver, et qui avait béni les drapeaux rouges au nom de Notre-Seigneur Jésus-Christ ?
Le héros du tragique dimanche de janvier était assis à la table de Lénine, en face de Nadjeda Konstantinowna : il lisait de sa voix douce et grave le texte d’une proclamation qu’il voulait adresser aux paysans de Russie. « Nous n’avons pas besoin de tsar : que Dieu soit le seul maître de la terre et vous serez tous ses fermiers. » Décidément ce Gapone n’avait rien d’un héros marxiste. S’il avait été, au moins, de mauvaise foi ! On eût pu lui pardonner bien des choses ; on eût pu le traiter avec une grande indulgence, on l’eût compris. Mais sans doute était-il sincère, et c’est ce qui est inadmissible chez un personnage de la sorte, moitié héros, moitié mouchard. L’histoire du peuple russe est pleine d’anges criminels, naïfs et corrompus, de monstres aux yeux doux, d’hommes et de femmes aux gestes cruels et au cœur bon, qui font le mal sans le savoir, et que leur candeur, leur bonne foi, leur innocence même, vouent à la honte et à l’exécration. Quand, plus tard, au Kremlin, au cours du terrible hiver de 1920, Lénine lisait à ses collaborateurs les messages que d’Annunzio lui adressait de Fiume, il riait aux larmes en disant : « Voilà un héros dans le genre de Gapone ! » Et il racontait les détails de son entrevue avec ce pope extraordinaire qui voulait, de connivence avec la police, faire des moujiks les fermiers de Dieu. Mais Lénine, qui n’était guère un héros, ne comprenait pas que l’héroïsme même, comme la politique, est une fatalité. Ce qu’il méprisait chez Gapone, c’était ce mélange d’ingénu et de louche, ce côté pittoresque, cet esprit d’aventure, qui forment le fond de l’héroïsme des hommes d’action. En 1906, au mois de mars, un an après sa rencontre avec Lénine, cette sorte de héros et de mouchard, à la barbe de prophète et aux mains de femme mourait assassiné à Pétersbourg. Décidément ce pope Gapone n’avait rien d’un héros marxiste.
IV
DU COTÉ DE CHEZ SWAN
À la veille de son départ pour la Russie, tandis que le mouvement révolutionnaire, qui avait semblé à un certain moment s’orienter vers le compromis constitutionnel, en revenait à la tactique des grèves et des révoltes, Lénine se préparait méthodiquement à son rôle de chef de la révolution. L’idée que l’héroïsme n’est pas une fatalité, mais une science, et qu’il doit être conduit par des règles scientifiques, s’était formée en lui peu à peu après son entretien avec Gapone. Le romanesque des hommes d’action, leur sentimentalisme, ou plutôt leur cynisme irrationnel, ce je ne sais quoi de féminin dans leur caractère, était complètement étranger à sa conception de l’héroïsme scientifique. L’insurrection est un art, avait affirmé Karl Marx. Prétexte très commode pour des hommes médiocres et prédestinés, qui prétendaient tricher par des coups de main au jeu de la révolution, comme on triche au jeu de cartes par des tours de main. En effet, tout comme le marxisme, la révolution est une science : l’héroïsme révolutionnaire, l’héroïsme marxiste, est également une science. Des principes, des règles, des formules ; tout le reste est littérature.
Aussi, voulant se préparer à jouer dans la révolution le rôle de chef (ce qu’on appelle, d’un mot bourgeois, le rôle de héros), Lénine occupait-il les dernières semaines de son séjour à Genève à la lecture de livres de stratégie et de tactique militaire, et particulièrement d’ouvrages concernant la guerre civile, l’art d’attaquer et de défendre les maisons, les ponts, les carrefours, les barricades. C’est dans la bibliothèque de Genève qu’il découvrit l’importance du rôle des francs-tireurs dans la guerre de rue. Seul, un petit bourgeois fanatique pouvait concevoir l’idée de mettre Napoléon et Clausewitz au service de Marx, et d’appliquer à la lutte révolutionnaire le règlement tactique de l’infanterie allemande. Cette conception n’était ni sublime ni ridicule ; c’était tout simplement une conception petit-bourgeoise. L’idée que Lénine se faisait de la stratégie et de la tactique militaire, et du rôle d’un Napoléon, d’un Koutouzov ou d’un Moltke dans la guerre, n’est pas différente de celle que s’en fait n’importe quel professeur ou quel fonctionnaire. Ce profond dégoût de l’action, qui caractérise le fanatisme sédentaire et bureaucratique d’un Robespierre ou d’un Lénine, cette instinctive répugnance à agir, au sens brutal du mot, à agir directement, presque physiquement, dans le domaine de la réalité, sur les hommes et sur les évènements, cette incapacité mentale, organique, à concevoir l’action autrement que sous la forme d’une activité supérieure de l’esprit et de l’intelligence, d’une volonté abstraite s’exerçant sur la réalité du dehors et de haut, ne sauraient mieux se manifester que dans cette conception de la guerre en tant que science, ars perpulchra, forme supérieure de l’activité intellectuelle. Appliquer à la révolution prolétarienne les principes et les règles de l’art de la guerre d’après Napoléon et Clausewitz voilà le rôle de Lénine, son rôle de chef.
Il entreprit aussi, à la bibliothèque de Genève, la lecture de La Guerre et la Paix de Tolstoï. Ce qui l’attirait dans ces pages, ce n’est pas la conception tolstoïenne du rôle des généraux dans les batailles, mais la tactique des « partisans », ces francs-tireurs russes, pendant la retraite de la Grande Armée. On peut croire toutefois que certaines considérations du prince André Bolkouski sur le génie des bons capitaines ont dû attirer son attention : « Un bon capitaine n’a besoin ni d’être un génie ni d’avoir des qualités spéciales ; tout au contraire, il doit être dépourvu de ce qu’il y a de plus élevé et de meilleur dans l’homme : l’amour, la poésie, la tendresse, le doute philosophique. » Mais on verra plus tard quelle leçon Lénine a tirée de ce roman. Ce qu’il est intéressant d’établir ici, c’est sa fidélité à cette conception petit-bourgeoise, et qu’on pourrait appeler bureaucratique, de l’héroïsme marxiste, du rôle de chef dans la révolution. Que va-t-il faire au début de mars 1917, quand il apprendra que la révolution a éclaté en Russie ? Il va s’enfermer dans sa chambre, seul, avec Napoléon et Clausewitz, et il occupera les dernières semaines de son séjour en Suisse à relire des travaux de stratégie militaire.
Que fait Lénine, en octobre 1905, quand le tsar, dans son fameux manifeste « constitutionnel » promet au peuple la liberté civile ? Il part pour la Russie, s’installe aux environs de Pétersbourg et assiste de loin, caché dans un lieu sûr, au développement révolutionnaire de la situation. L’État, paralysé par la grève générale, ne réagit que par la promesse de concessions politiques. De la Finlande et du Turkestan l’insurrection ouvrière et paysanne s’éveille au chant du coq rouge. Le coq rouge, c’est le feu. Quand les paysans mettent le feu aux maisons seigneuriales, aux fermes, aux greniers des propriétaires, c’est le coq rouge qui chante dans les campagnes de Russie. « Tout va bien », écrit Lénine à Nadejda Konstantinowna, restée à Genève. Dans ses lettres à sa femme il emploie l’expression « notre révolution ». En réalité, les évènements se produisent en dehors de lui : ce chef n’est qu’un spectateur. Plus tard, Lénine s’est efforcé, au congrès de Stockholm en particulier, de justifier son attitude en déclarant que le Comité central du parti lui avait interdit de s’exposer trop ouvertement. Zinoviev, le plus dévoué de ses biographes officiels, va jusqu’à écrire que « le parti lui interdisait de paraître en public trop ouvertement ». Après tout, pourquoi et de quoi se justifier ?
Lénine n’a pas besoin d’invoquer l’autorité du Comité central, très faible à ses yeux, pour expliquer la logique de sa ligne de conduite. Clausewitz ne lui a-t-il pas appris que la guerre est une science ? Pour appliquer cette science à la révolution, il n’a besoin de s’exposer ni au public, ni au danger. Un chef doit se cacher, se mettre à l’abri. Sa place n’est pas dans la rue. Ce n’est qu’à présent qu’il voit clairement que Trotsky avait raison : un second Gapone serait ridicule. Au moment voulu, quand l’occasion favorable se présentera, il saura jouer son rôle de chef mieux que n’importe quel homme d’action. Pour le moment, son devoir est de se tenir 4 l’écart, de surveiller les évènements, de ne pas se laisser happer trop vite par l’engrenage révolutionnaire. Pour entrer en scène, il attend des circonstances favorables. Lénine n’est pas comme les personnages de Shakespeare, qui manquent presque tous d’à propos. Il a le souci des circonstances. Cette grève générale, ce n’est pas encore une révolution. Dans l’attente, il étudie la tactique des Japonais pendant la guerre de Mandchourie. L’apparition des mitrailleuses et des grenades sur les champs de bataille a bouleversé les principes marxistes de l’art insurrectionnel, de la même façon que l’apparition du Soviet a montré l’inutilité du parti comme instrument de lutte révolutionnaire. Ce n’est pas seulement la Commune de Paris qu’il faut prendre comme modèle de tactique prolétarienne c’est aussi Moukden, Port-Arthur, et le Soviet de Pétersbourg.
Le Soviet, création spontanée des ouvriers d’Ivanov-Voznessenski, c’est la nouveauté que la révolution de 1905 introduit dans la tactique révolutionnaire. « Le Soviet des députés ouvriers, écrit Lénine, ce n’est pas un parlement ouvrier, ni un organe de self-government prolétarien, ni même un organe de self-government en général, mais une organisation de combat avec des buts bien définis ». Cette conception du Soviet, on l’a noté de différents côtés, est tout à fait opposée à celle que Lénine va élaborer à la veille de 1917. Mais, en réalité, le Soviet de 1905, fondé et dirigé par les mencheviks n’est qu’une organisation de combat, bien que Trotsky s’efforce de lui faire jouer le rôle de « second gouvernement ». Quel homme extraordinaire, ce Trotsky ! Du haut de la galerie de la Société économique libre, siège du Soviet de Pétersbourg, caché parmi les spectateurs, Lénine regarde en clignant des yeux ce jeune homme de vingt-sept ans, à la voix métallique, aux gestes violents, qui, élu président du Soviet de la capitale à la place de Kroustalev-Nossar, « quelque chose d’intermédiaire entre Gapone et le socialisme », se montre déjà l’homme le plus téméraire et le plus dangereux de l’élite révolutionnaire de 1905.
Lounatcharsky raconte que Lénine s’assombrissait quand on lui disait que le membre le plus puissant du Soviet c’était Trotsky. Ce pamphlétaire congestionné d’ambition et d’orgueil, à qui l’on reprochait d’imiter l’accent et les attitudes de Ferdinand Lassalle, n’est, aux yeux de Lénine, qu’un homme d’action, un, démagogue sans culture, un tribun éloquent, un opportuniste audacieux. Le président du Soviet, le chef du mouvement révolutionnaire, ce n’en est pas moins lui, Trotsky, « ce juif gentilhomme, bourgeois et prolétaire ». Lénine ne joue aucun rôle dans le Soviet de Pétersbourg, c’est-à-dire dans la révolution de 1905. « Il n’assista qu’une ou deux fois aux séances du Soviet, écrit Zinoviev : le camarade Lénine nous racontait comment, de la galerie, dans la salle de la Société économique libre, il assistait à la séance et contemplait pour la première fois le Soviet des députés ouvriers de Pétersbourg. Le camarade Lénine habitait à Pétersbourg d’une manière illégale et le parti lui interdisait de paraître en public trop ouvertement. Le représentant officiel de notre Comité central au sein du Soviet c’était Bogdanov. Et lorsqu’on sut que le Soviet serait arrêté, nous interdîmes au camarade Lénine d’assister à la dernière séance pour qu’il ne fût pas lui aussi arrêté. » Dans ses efforts pour justifier la prudence de Lénine et dans son zèle de disciple, d’ami, de biographe officiel, Zinoviev oublie que cette soumission aux ordres du Comité central, chez un homme exerçant sur le parti une autorité presque dictatoriale, ne saurait manquer de paraître par trop prudente. Trotsky n’habitait-il pas, lui aussi, Pétersbourg d’une manière illégale ? Il ne craint pas, toutefois, de se montrer trop ouvertement en public, et il n’accepterait ni l’ordre ni le conseil de se cacher. L’imprudence est aussi nécessaire à l’homme d’action que la prudence au stratège. « L’imbécile », s’écrie Lénine le 3 décembre, quand il apprend, dans sa cachette, que Trotsky et tous les autres membres du Soviet ont été arrêtés. Et il quitte en hâte Pétersbourg pour aller se cacher dans un endroit plus sûr.
Ceux qui ont reproché à Lénine « d’avoir pris la fuite » ne se rendaient pas compte qu’il n’était pas un fuyard, un lâche qui jette son fusil et tourne le dos à l’ennemi : c’était un stratège qui reculait pour mieux voir, un chef qui ne s’arrêtait pas aux détails mais prenait du recul pour être en mesure d’embrasser, d’un coup d’œil, l’ensemble de la situation. Le seul juge de la situation c’était lui : le seul juge, c’est-à-dire le seul chef. Lénine ne rougissait pas de « prendre la fuite » : c’était son droit et son devoir. En quittant Pétersbourg, en abandonnant le champ de bataille pour un refuge plus sûr, il ne renonçait pas à son rôle de stratège de la révolution. « Mais jamais ses départs un peu prompts, écrit Pierre Lafue, (auteur de Lénine ou le mouvement, biographie du Lénine conventionnel), jamais ses départs un peu prompts ne déconcerteront autant ses partisans que ne les a déconcertés celui-ci. Quoi ? Les ouvriers russes se battent pour la liberté du peuple. Ils vont succomber et payer de la prison et de l’exil leur audace malheureuse, et c’est à cet instant que Lénine les abandonne ! Oui, parce que Lénine ne pense pas seulement au sort de quelques individus menacés d’être passés par les armes : il songe uniquement à l’avenir de la révolution. À ceux qui le blâment, il répond simplement qu’il n’est pas un personnage de roman. » Ce Lénine, « aux départs un peu prompts », il serait trop simple de le juger un héros comme nous le montrent ses partisans, ou un lâche comme le voient ses adversaires. Ce qui rend complexe le fanatisme petit-bourgeois, c’est qu’il contient en grand toutes les petitesses de l’héroïsme, et en petit toutes ses grandeurs.
Du fond de sa retraite des environs de Pétersbourg, tandis qu’une nouvelle grève générale éclatait dans toute la Russie, Lénine, son Clausewitz à la main, notait minutieusement dans ses cahiers les détails de la situation. Jusqu’alors son « héroïsme marxiste » avait consisté à écrire des articles pour la Novaïa Jizn et à assister aux séances du Soviet de Pétersbourg du haut d’une galerie, au milieu du public. Du fond de son nouveau refuge, dans l’attente de circonstances favorables lui permettant d’appliquer à la révolution la stratégie de Clausewitz, il prenait des notes et il élaborait méthodiquement, jusque dans les détails, le plan de sa « campagne de Russie ».
La grève générale avait tourné presque aussitôt en insurrection. À Rostow, à Novorossisk, à Odessa, à Kiev, à Lodz, les ouvriers avaient élevé des barricades, creusé des tranchées. Une véritable guerre civile avait ensanglanté les rues de Moscou pendant dix jours. Lénine remplissait ses cahiers de considérations sur la tactique employée par les ouvriers dans leur lutte contre les troupes du gouvernement. Le 17 décembre, l’artillerie du gouverneur de Moscou, Doubassov, a finalement raison des fusils et des grenades des insurgés ; le 25, la « République de Novorossisk » est écrasée par les cosaques. Lénine prend des notes, rassemble les matériaux dont il se servira plus tard pour écrire la série d’articles parus dans l’Izvestia en mars et en août 1906. « Il n’y avait pas pour lui, écrit le zélé Zinoviev, de page plus noble et plus admirable dans l’histoire que celle de l’insurrection armée de Moscou. Il commença d’abord à réunir des documents sur cette révolte. Il voulait en élucider les moindres incidents, les moindres détails techniques. Il voulait tracer la biographie de chaque combattant. Lénine comprenait que l’insurrection de Moscou avait été la première bataille rangée livrée à la bourgeoisie du monde. » Le disciple de Marx et de Clausewitz se préoccupe d’établir des analogies entre la révolution russe de 1905 et la révolution française de 1848 : « L’analogie extérieure de la défaite des ouvriers de Moscou avec celle des ouvriers de Paris en juin 1848, est certaine », écrit Lénine. Il proteste violemment contre les marxistes russes, qui jugeaient inutile « d’analyser l’insurrection de Moscou du point de vue militaire ». Il s’en prend à Kautsky, à Plekhanov, à tous ceux, bolcheviks ou mencheviks, qui ne partagent pas ses idées sur la nécessité d’appliquer à la révolution prolétarienne la stratégie militaire, la science de la guerre. Ce héros scientifique, qui se tient prudemment caché depuis le mois d’octobre, et dont la façon de prendre part à la lutte, est d’assister aux évènements de loin et d’un lieu sûr, reproche au Soviet de Moscou la mauvaise conduite des opérations : « L’ordre d’élever les barricades est parvenu aux faubourgs avec un énorme retard, lorsque, dans le centre de la ville, on les construisait déjà. » Parlant des chefs de l’insurrection, il dit : « Nous autres. » Son langage est celui d’un général résumant dans un rapport, au lendemain d’une défaite, les erreurs commises par ses subordonnés dans l’exécution du plan de bataille. Sa carrière de stratège commence à Waterloo. « Nous autres, en décembre, nous avons été semblables à ce capitaine qui avait si bien disposé ses régiments, que la plupart de ses troupes étaient hors d’état de prendre une part active à la bataille. Les ouvriers cherchaient des directives pour des opérations de grande envergure et ils n’en trouvaient pas. » Ces critiques ne sont pas sans ironie, de la part d’un chef qui n’avait rien vu de près, qui n’avait rien fait, et qui n’avait pris dans les évènements aucune responsabilité personnelle.
La leçon que Lénine tirait des évènements de Moscou était une véritable, leçon de stratégie et de tactique militaires. Analysant les principaux épisodes de l’insurrection, ceux de la place Strastnaïa, de la Grande Rue de Serpoukov, des casernes Nesvij et Kroutisky dans les faubourgs de Kamovniky et de Simonovo, il concluait qu’on n’avait pas su profiter du désarroi moral des troupes. Et l’armement des ouvriers, était-ce un armement moderne ? Il fallait sans retard se mettre de pair avec la technique militaire. « La technique militaire n’est plus ce qu’elle était au milieu du XIVe siècle. Opposer la foule à l’artillerie, et défendre des barricades à coups de revolver, ce serait stupide. » C’était peut-être bien stupide, mais les ouvriers de Moscou n’avaient pu faire autrement. « La technique militaire, dans ces tout derniers temps, s’est encore perfectionnée. La guerre avec le Japon a fait paraître la grenade à main. L’armurerie a lancé le fusil automatique. L’un et l’autre ont déjà été employés avec succès dans la révolution russe, mais dans une mesure encore bien insuffisante. Nous pouvons et devons mettre à profit le progrès technique. » Autour de lui, tout s’écroulait : une réaction impitoyable sévissait, des tribunaux militaires se substituaient aux tribunaux civils, des expéditions punitives de cosaques parcouraient les campagnes, en fusillant et en saccageant ; les prisons regorgeaient d’intellectuels et de travailleurs ; de longs convois de condamnés partaient chaque jour pour la Sibérie. Mais Lénine qui, pendant ce temps, avait fait venir de Genève sa femme et sa belle-mère, analysait dans ses détails l’insurrection de Moscou, critiquait la conduite des opérations, et déplorait que la technique révolutionnaire des travailleurs n’eût pas été au niveau de la technique militaire des troupes japonaises.
Irrités par la défaite et par la persécution, les ouvriers mencheviques et bolchéviques s’en prenaient aux chefs, aux querelles qui troublaient le parti, et réclamaient violemment la fusion de toutes les forces révolutionnaires. Une colère sourde grondait autour de Lénine : dominé par des préoccupations sans rapports avec la réalité, il se laissait emporter par le courant, acceptait la réconciliation avec les mencheviks, la création d’un Comité central unifié, le partage même, avec ses adversaires, de l’autorité et de la responsabilité, toutes les atteintes qu’on portait à sa dictature personnelle, à son rôle de chef du parti. Ce qui le préoccupait à ce moment, ce n’étaient plus les problèmes de l’organisation révolutionnaire, mais les aspects nouveaux de la lutte qu’en Géorgie, en Ukraine, en Pologne, dans les provinces baltiques et même dans la campagne de Moscou, les ouvriers poursuivaient contre les troupes du gouvernement. La rentrée de Plekhanov, de Martov, de tous les mencheviks, le laisse indifférent. La décision de convoquer à Stockholm un congrès de toutes les forces de la social-démocratie russe, pour décider de la tactique à suivre à l’égard de la réaction policière et dans la question de la Douma, n’a pas, à ses yeux, la moindre importance. Lénine laisse ouvertement à Plekhanov, à Martov, à Kamenev le soin de se quereller sur de vagues questions de principe, sur des détails insignifiants. Il renonce à son rôle de chef du parti pour se consacrer entièrement à son rôle de chef de la révolution. Ce n’est plus le moment de la politique, mais celui de la stratégie. Maximilien Lénine s’efface devant Napoléon Lénine.
Quelle devait être l’attitude du parti dans la question de la Douma ? Fallait-il décider le boycottage, participer aux élections, laisser aux organisations une entière liberté de choix ? Tels étaient les problèmes qui préoccupaient Martov, Plekhanov, et quelques-uns des bolcheviks les plus influents, à la veille du congrès de Stockholm. Dans quelle mesure son plan stratégique devait-il tenir compte de la lutte engagée par les équipes ouvrières contre les forces du gouvernement, après la défaite de décembre ? Pour Lénine, toute la situation se résumait dans ce problème. Il était le seul à refuser d’admettre que la révolution fût bien morte. L’insurrection de Moscou avait été écrasée, mais la révolution survivait à la révolte de décembre. En réalité, les masses ne voulaient plus se battre. Un terne silence pesait sur les faubourgs, sur les usines, sur les villages ; un nuage sombre couvrait toute la Russie. Seules les « équipes de combat », organisées au cours des journées de décembre, s’étaient refusées à déposer les armes et, cachées dans les bois, poursuivaient contre les troupes du gouvernement cette guerre de partisans dont Lénine avait étudié la tactique dans la Guerre et la Paix de Tolstoï.
Ces « équipes de combat » étaient formées des éléments les plus fidèles et les plus courageux de l’élite ouvrière. Après la défaite de l’insurrection de décembre, les équipes de Moscou, de Kiev, de Riga, de Reval, de Lodz, de Kazan, de Bakou « se lancèrent soit dans les attentats isolés contre les représentants du pouvoir, soit dans des expropriations organisées, c’est-à-dire des attaques de banques, de transports de fonds, de trains-poste, etc. ». C’est une guérilla de bandits, s’écriait Plekhanov. C’est de la tactique marxiste, ripostait Lénine. Le terrorisme des équipes de corn- bat, lit-on dans les notes de P. Pascal à l’édition française, autorisée par Moscou, des Pages choisies de Lénine, « n’était pas sans présenter des dangers pour le mouvement révolutionnaire. Souvent, en effet, les expropriateurs s’attaquaient tout simplement à tel ou tel bourgeois, à un caissier d’usine transportant les salaires de la semaine, etc., de sorte que la frontière avait tendance à disparaître entre l’acte révolutionnaire et le crime de droit commun. D’autre part, les équipes de combat, dans leur travail spécialisé et réclamant une large liberté d’action, s’émancipaient facilement de toute discipline. Recrutant parfois leurs membres imprudemment, elles risquaient de dégénérer, dans la pratique, en bandes, et terrorisaient moins les autorités que les populations. Inutile de dire que, dans ce cas-là, le produit des expropriations tombait avant tout, ou même exclusivement, dans les poches de leurs auteurs ».
C’est une honte protestait Plekhanov : la social-démocratie russe n’a rien à voir avec ces bandits. Mais ces bandits, aux yeux de Lénine, c’étaient des révolutionnaires qui combattaient par tous les moyens les forces de la réaction, des francs-tireurs qui protégeaient la retraite de l’armée ouvrière battue au cours des luttes de décembre, des partisans qui harcelaient nuit et jour l’ennemi pour l’empêcher de profiter de sa victoire. Leur tactique, c’était la situation stratégique générale qui l’imposait. Du point de vue de la stratégie révolutionnaire, les partisans de 1905 n’étaient pas plus des brigands que n’étaient des bandits les partisans de Koutouzov. Leur historien, ce n’était pas Plekhanov ni Kautsky : c’était Tolstoï.
Le parti de la social-démocratie russe, c’est-à-dire l’union des mencheviks et des bolcheviks, enfin réconciliés par la défaite, pouvait-il se désintéresser des « équipes de combat » ? Le devoir du parti, c’était de les aider moralement et matériellement, de sanctionner leurs actes, d’en assumer la responsabilité politique. C’était une véritable campagne de Russie que cette guerre de partisans contre les forces de la réaction. Au congrès de Stockholm, en avril 1906, le plan proposé par Lénine était un véritable plan de campagne. Le congrès le repoussa. Martov et Plekhanov allèrent jusqu’à renier la politique du Soviet de Pétersbourg et à condamner dans un ordre du jour la guerre de partisans, « cette bacchanale de vols et de brigandage ». L’ordre du jour étant approuvé, les ouvriers des équipes de combat devenaient officiellement des brigands. Lénine revint de Stockholm décidé à assumer toute la responsabilité de la guerre de partisans. Pour mieux diriger les opérations, il quitta au début de mai es environs de Pétersbourg et s’installa avec sa femme et sa belle-mère à Koukalla, en Finlande. L’endroit était sûr, la maison confortable, le printemps doux dans ce pays de lacs et de bois.
De sa retraite de Koukalla, bien qu’il n’entretînt aucun rapport avec les équipes de combat, Lénine suivait leur action comme un stratège surveille l’exécution de son plan de campagne. L’article La guerre de partisans, qu’il publia dans le Prolétaire du 30 septembre 1906, était moins une défense politique de cette guerre qu’une défense d’un point de vue stratégique, militaire, en opposition avec le point de vue « antiscientifique » du congrès de Stockholm. Mais le disciple de Napoléon et de Clausewitz était aussi impuissant à jouer le rôle de stratège de la révolution que le disciple de Marx à transformer des bandits en héros marxistes. Lénine se promenait dans les bois de Koukalla, les mains dans les poches, le chapeau sur les yeux. Que de tristesse dans les paroles sur lesquelles s’achève son apologie de la guerre de partisans ! « Nous n’avons pas la moindre prétention d’imposer aux militants une forme de lutte quelconque inventée par nous, ni même de résoudre, du fond de notre cabinet, la question du rôle de telle ou telle forme de la guerre de partisans au cours de la guerre civile en Russie. » Du fond de son cabinet, de si loin que pas un coup de fusil n’arrivait à troubler sa solitude, Lénine suivait des yeux ces ouvriers affamés, déguenillés, errant de bois en bois, rôdant aux alentours des villages, harcelant l’ennemi sur les grand-routes de Russie.
Un jour, peut-être... Mais le congrès de Londres d’avril 1907, comme plus tard celui de Stuttgart, se refusa à voir en ces bandits de grand chemin des partisans de Koutouzov. Le congrès social-démocrate d’avril 1907 eut lieu dans une petite église de la New Southgate Road, sous la bienveillante protection d’un pasteur protestant, le Révérend Arthur Baker : étrange spectacle, que celui de Lénine prêchant dans une église le respect aux principes de la stratégie de Clausewitz et du banditisme sanguinaire des partisans. Dans un des quartiers du Nord-Ouest de Londres, parmi des rues flanquées de petites maisons d’aspect très modeste, la New Southgate Road est une des rues les plus pauvres et les plus tristes. Au début du siècle, dans ces quartiers du Nord-Ouest, paisible refuge de gens qui n’ont rien à cacher, petits rentiers, avocats respectables, médecins sérieux, colonels en retraite, austères magistrats et gentlemen de toute espèce « who write to the Times », le brouillard, ainsi qu’il arrivait jadis dans tous les quartiers que la nuance politique de leurs habitants pourrait faire appeler libéraux, était plus clair et moins épais qu’ailleurs. Depuis une vingtaine d’années, une population pauvre et grise a envahi la New Southgate Road : les anciens habitants ont émigré vers l’Est, et les rues du quartier ont pris de nos jours cet aspect morose qui marque toujours le passage des idées libérales aux préjugés petit-bourgeois. Mais la fumée des cheminées monte encore bien droit dans l’air, et l’on arrive à se rendre compte de l’existence du soleil, même les jours les plus sombres, à une certaine transparence d’aquarium flottant sur les toits et sur les arbres, et donnant aux yeux clairs des passants cette étrange expression distraite de naïveté et de bonheur, avec laquelle les poissons contemplent la lumière du soleil, flottant à la surface de l’eau.
La New Southgate Road n’offre aucune particularité qui permette de la distinguer des autres rues du Nord-Ouest de Londres, si ce n’est une église en pierre grise qui semble exclusivement consacrée à la piété dominicale des petits bourgeois du quartier. Cette église, la Brotherhood Church, appartenant à la secte des Congregationalists, n’a pourtant pas la même réputation que beaucoup d’autres églises protestantes. Le Dieu qu’on y prie est le même que celui qu’on prie dans toutes les églises d’Angleterre, mais sa miséricorde est bien plus puritaine que bourgeoise. Il n’y a rien d’irrévérencieux dans l’opinion qui le considère comme le Dieu le moins bourgeois du Royaume-Uni et, aussi, pourrait-on ajouter, le plus marxiste. Alors qu’il n’était encore que Monsignor Achille Ratti, nonce apostolique à Varsovie, le pape actuel Pie XI disait un jour, au printemps de 1920, à la réception donnée par le comte Rzewuski à l’occasion des fiançailles d’une de ses filles, que, pour les bons catholiques, la lutte de classe survit même dans la vie future. Les âmes du Paradis, du Purgatoire et de l’Enfer ne sont-elles pas les nobles, les bourgeois et les prolétaires de l’au-delà ? Les Polonais de 1920, engagés dans leur guerre contre la Russie des Soviets, avaient bien quelque raison de se scandaliser du marxisme de ce futur pape, mais le Dieu de l’Église « congregationalist » de la New Southgate Road n’eût rien trouvé d’inconvenant dans les propos marxistes du nonce apostolique à Varsovie. Car la Brotherhood Church, autrement dit l’Église de la Fraternité, n’est pas du tout ce qu’on appelle une église. Elle est, tout à la fois, une église, un club et un petit parlement. Le Capital de Karl Marx y est prêché au même titre que la Bible. Les problèmes de la lutte de classe et de l’organisation du prolétariat y sont discutés avec le même sérieux que les problèmes de la vie spirituelle : les aspirations de la classe ouvrière à une existence de bien-être et de justice sociale y sont considérées sous le même jour que les aspirations de tous les chrétiens au royaume des cieux.
Le pasteur actuel de la Brotherhood Church, le Révérend F. R. Swan, dont le nom pourrait être à peu près celui d’un personnage de Proust, est un homme encore jeune, aussi anglais que peut l’être le pasteur d’une église d’un quartier du Nord-Ouest. Le Révérend Arthur Baker, qui était pasteur de la Brotherhood Church en 1907, à l’époque du congrès, est mort depuis longtemps, et sans le soin du Révérend F. R. Swan à pieusement conserver tous les souvenirs concernant l’histoire de son église, bien des détails de ce qui s’est passé à la Brotherhood Church en avril 1907 eussent été oubliés. C’est à lui que nous devons cet étonnant portrait de Lénine aux yeux morts, au visage pâle, aux mains tremblantes, debout devant l’autel, prononçant l’éloge du terrorisme des partisans, de ces « bandits de grand chemin », au nom de Clausewitz, de Tolstoï et de Marx. Les visiteurs qui, de nos jours, se rendent « du côté de chez Swan » n’y rencontrent habituellement qu’un petit nombre de fidèles d’allure petit-bourgeoise, et ne manquent pas de s’étonner que des souvenirs aussi profanes restent liés à une église si simple, si recueillie, où rien ne décèle la présence d’un Dieu quelque peu responsable de la révolution bolchevique, et dont on pourrait dire qu’il a tenu sur les fonts baptismaux la dictature de Lénine. Mais quiconque pénètre dans la Brotherhood Church au cours d’une réunion politique, et entend le Révérend F. R. Swan prêcher la Bible à des ouvriers peu soucieux de problèmes religieux, à des secrétaires de syndicats dont la mise est celle de rigueur dans les meetings de Hyde Park ou de Whitechapel, à des petits Juifs communistes à figure contrite, puis diriger ensuite les discussions sur l’interprétation orthodoxe de Marx, sur la politique de Mac Donald et sur les problèmes du chômage, n’a plus aucune raison de s’étonner que la social-démocratie russe ait choisi, en 1907, un lieu aussi sacré pour discuter les problèmes de l’organisation du parti et décider si les ouvriers des « équipes de combat » étaient des brigands ou des héros marxistes.
C’est en rentrant de Londres que Lénine se rendit compte, pour la première fois, que la révolution de 1905 était finie, que la bataille était perdue. Ce révolutionnaire qui se cachait toujours, prudemment, au moment du danger, ce stratège qui n’avait jamais entendu un coup de fusil, ce petit bourgeois sédentaire qui ne savait pas manier un pistolet, ce bonhomme aux yeux mongols, incapable de faire du mal à une mouche, quitte la Finlande au mois de décembre 1907 pour Genève et la France. Lénine a perdu sa campagne de Russie. Mais le dernier bulletin de la révolution de 1905 annonce déjà celle de 1917. Chez ce bonhomme morose qui rentre en Europe entre sa femme et sa belle-mère, il y a déjà, tout entier, le vainqueur d’octobre 1917. La santé de Lénine n’avait jamais été meilleure.
V
MONSIEUR LÉNINE
FRANÇAIS MOYEN
LA route de Paris à Leningrad est une bien mauvaise route, de nos jours, à parcourir à bicyclette. Elle était encore bien plus mauvaise en 1909 et en 1910. Il était presque impossible, alors, de faire du tourisme sur les routes politiques de l’Europe. Dès qu’on sortait de la banlieue de Paris, les difficultés que les cyclistes rencontraient étaient telles, qu’il était prudent de s’arrêter sur les coteaux de Saint-Cloud, sous les ombrages de Sèvres, sur les rives de la Seine, bordées de pêcheurs à la ligne, en tout cas de ne jamais pousser plus loin que Versailles ou que Chantilly. Au cours de ces dimanches paisibles, le vin rosé et le ciel bleu se mêlaient dans les verres, et les orgues de Barbarie faisaient éclore aux balcons ces étranges fleurs de faubourg qui se fanent si vite dans les toiles du douanier Rousseau.
Lénine et Nadejda Konstantinowna ne se laissaient pas impressionner par le mauvais état de la route Paris-Pétersbourg, qu’ils avaient choisie pour leurs excursions à bicyclette. D’habitude, quand ils sortaient ensemble, ils n’allaient jamais plus loin que Saint Cloud ou que Sèvres. « Nous partons pour Pétersbourg », disait Wladimir Ilitch en quittant avec Nadejda la rue Marie-Rose, près du Lion de Belfort, où il habitait avec sa femme et sa belle-mère. Ils rentraient chez eux le soir un peu las, mais fiers et souriants. Dans leur petit logement au numéro 4 de la rue Marie-Rose, la mère de Nadejda Konstantinowna attendait « les enfants » dans la cuisine qui servait de salle à manger, en faisant des patiences ou en déchirant minutieusement les papiers que sa fille lui confiait pour qu’elle les détruisît. « Je puis être utile à quelque chose », disait la vieille femme. Elle avait pour Wladimir Ilitch une affection maternelle. « Volodia me fait la cour comme un chevalier servant », disait-elle en riant. « Un jour, raconte un témoin, Lénine arriva chez nous, au 110, avenue d’Orléans, ou s’abritait l’imprimerie du Social-démocrate. Sa bicyclette était poussiéreuse, un bouquet de fleurs des champs était attaché au guidon les fleurs étaient pour la mère de Nadejda Konstantinowna. Wladimir Ilitch rapportait de chaque promenade un bouquet de fleurs, qui faisaient un énorme plaisir à la vieille femme. Il y avait ainsi toujours chez eux des fleurs fraîches venant de la campagne. « C’est Volodia qui me les a apportées, disait la vieille femme : il me gâte toujours. »
Lénine n’a jamais passé de jours aussi calmes, aussi bons qu’à Paris, de novembre 1908 à juillet 1912. Le ciel de l’Île-de-France n’est pas moins favorable aux grandes destinées qu’aux petites existences, aux enfants du siècle qu’aux hommes de tous les jours. Quelques mois après son arrivée de Genève, Lénine était devenu ce qu’on appelle un petit bourgeois parisien, c’est-à-dire beaucoup plus qu’un simple Parisien. Un homme qui n’a pas de jours néfastes : voilà ce qu’était encore, en 1908, tout habitant de Montrouge ou de la Porte d’Orléans, ce quartier caractéristique de la petite bourgeoisie. Il n’y avait que les grands bourgeois de Paris, ou les cadets de quelques familles illustres, qui eussent des jours néfastes. Peut-être bien s’agit-il moins d’une superstition que d’une loi naturelle ou sociale ; s’il ne s’agit pas, toutefois, de snobisme, d’un dernier souvenir du romantisme anglais du XIXe siècle. Mais rien ne trouble l’existence du petit bourgeois de Paris ; tous ses jours sont fastes et tous se ressemblent. Même l’histoire de France ne résiste pas au charme de cette règle de bonheur quotidien. Un petit bonheur de chaque jour : saurait-on rien prétendre de plus raisonnable ? En quittant Genève pour la France, c’est à Paris que Lénine avait trouvé sa véritable Suisse.
La plupart des biographes de Lénine nous le montrent toujours dévoré par une fièvre d’action révolutionnaire, et se font un devoir de nous faire croire que son séjour à Paris a été la période la plus difficile et la plus douloureuse de sa vie. Pourtant, ses nuits étaient tranquilles, ses journées étaient calmes. Nadejda Konstantinowna nous dit que ce fut, comme toujours, quatre années de pauvreté, mais jamais de misère. La Russie était morte. Un lugubre silence régnait dans les Universités, dans les usines, dans les villages. La réaction tenait le pays à la gorge. Dans ces conditions, tout travail de propagande et d’organisation révolutionnaire était impossible. Les leaders du parti, bolcheviks et mencheviks, Lénine, Plekhanov, Martov, avaient donné le mot d’ordre : attendre. Après la grande polémique de 1908, suscitée par l’hérésie des « constructeurs de Dieu », tout le monde paraissait las des discussions, dégoûté de la philosophie. Dans l’attente, on vivait comme on pouvait. Certains biographes de Lénine ne lui auront jamais de reconnaissance d’avoir pensé pendant quelque temps plus à sa bicyclette qu’à la révolution prolétarienne.
« Quel remarquable professeur eût fait Lénine », s’était écrié Gambarov quelques années plus tôt. Quel bon petit bourgeois de Paris, quel bon Français moyen eût pu faire ce bonhomme en bras de chemise, qu’on voyait souvent sur le trottoir de la rue Marie-Rose en train de graisser et d’astiquer sa bicyclette. « Je me rappelle, raconte l’ancien directeur de l’imprimerie du journal bolchévique Social démocrate, dans ses souvenirs sur Lénine à Paris, publiés sous le pseudonyme d’Alin, je me rappelle qu’on le trouvait sur le trottoir devant sa maison, sans veste, ses manches de chemise retroussées. Il nettoyait, frottait, graissait, vérifiait les écrous, l’état des pneus, les gonflait, collait des pièces. » Le visage en sueur, les mains graisseuses, la casquette sur la nuque, Wladimir Ilitch accueillait ses amis avec une joie enfantine, et riait aux larmes au récit des aventures de Rykov et de ses démêlés avec Kameneff. Aucun biographe de Lénine ne nous a donné de lui un portrait aussi vivant, aussi familier, et en même temps aussi pittoresque, que celui que nous a tracé dans ces quelques pages l’ancien directeur de l’imprimerie du Social démocrate. Dans le premier chapitre de l’État et la Révolution, qu’il écrivit en Finlande aux mois d’août et septembre 1917, Lénine plaint le sort des grands révolutionnaires persécutés toute leur vie par les ennemis du peuple. « Après leur mort, ajoute-t-il, on cherche à les convertir en icones, à les canoniser pour ainsi dire, à entourer leur nom d’une auréole de gloire pour la consolation des classes opprimées et pour leur duperie. » Mais l’auteur des souvenirs sur Lénine à Paris nous prévient qu’en dessinant le portrait de Wladimir Ilitch, il a voulu faire bien autre chose que de l’iconographie. Il nous montre Lénine « là où il est authentiquement : parmi ceux qu’il appelait souvent, lui-même, les petites gens ». C’est là qu’il faut le chercher, parmi les petites gens. Wladimir Ilitch n’était « qu’un membre de leur famille ».
Dans l’image romantique qu’on se fait de lui en Europe, on retrouve facilement les traits caractéristiques du Lénine conventionnel, du Lénine canonisé, tel que nous le montrent les icones officielles et les portraits des biographes bourgeois. Les Candide et les Babbitt des pays d’Occident se plaisent à se le représenter comme un Gengis-Khan prolétarien, se ruant à cheval dans les allées bordées de nymphes et de Dianes des jardins à la française, ou parmi les bouquets d’arbres et les rochers artificiels qui jouent le rôle de nature dans le paradis bourgeois. De même qu’ils ne sauraient concevoir Karl Marx à cheval ou Gengis-Khan en redingote, ils ne peuvent se figurer Lénine, le monstre Lénine, à bicyclette. Mais peut-on se représenter Lénine à cheval ? Les bourgeois d’Occident ont de bonnes raisons d’avoir peur de lui, mais ils ont l’air de dire qu’ils ne sauraient avoir peur d’un cycliste. Et pourtant c’est d’un monstre petit-bourgeois, c’est d’un bonhomme en bras de chemise, c’est d’un grand révolutionnaire à bicyclette, que la bourgeoisie devrait avoir peur. C’est avec le Lénine de la rue Marie-Rose qu’il lui a fallu et qu’il va lui falloir compter. Les monstres qui bouleversent l’Europe, depuis plus d’un siècle, ne sont pas issus des peuplades mongoles de l’Asie centrale, mais du sein de ces petites gens qu’on trouve aussi bien à Montrouge ou dans le voisinage de l’Alexander Plaz, qu’à Witechapel, à Turin et à Kazan. Dans l’Angleterre de Pitt, dans la Russie d’Alexandre Ier, dans l’Autriche de Metternich, on disait volontiers que les « monstres » de 1793 étaient sortis de l’enfer. Cet enfer, c’était pour les Jacobins ce qu’est aujourd’hui l’Asie centrale pour Lénine. Mais Danton venait d’Arcis-sur-Aube, Robespierre d’Arras : et Lénine, ce petit avocat de province, venait de Kazan, de Munich, de Genève, de Londres, et du numéro 4 de la rue Marie-Rose à Paris. Pierre Chasles remarque avec raison que Lénine n’était pas plus mongol qu’Alexandre Dumas ou Pouchkine n’étaient nègres.
Dans le petit logis que la famille Oulianov habitait à Montrouge, les journées s’écoulaient calmes et paisibles sous la garde affectueuse, attentive, de Nadejda Konstantinowna et de sa mère. Assis devant sa grande table de bois blanc, couverte d’une toile cirée noire, (la pièce, éclairée par deux fenêtres, était petite et propre, raconte Alin : le mobilier se composait d’une chaise et d’un divan bas, assez large, couvert d’une housse grise et noyé sous les livres. Partout des livres : sur des étagères, sur une planche, sur le parquet. Il y avait un jeu d’échecs posé sur le divan), Wladimir travaillait toute la journée, souvent jusqu’à une heure avancée de la nuit, à ses articles, à sa correspondance, à ses petits papiers. « Cela ne va pas, avec Volodia, disait sa belle-mère : il travaille sans répit et ne veut pas se reposer. » Lénine, en ce temps-là, collaborait assidûment au quotidien l’Étoile, qui paraissait à Pétersbourg. Il envoyait chaque jour un article, qu’il jetait rapidement sur le papier, et qu’il expédiait sans même le relire. « Vers sept heures du soir, Wladimir Ilitch commençait à écrire son article et le mettait sous enveloppe vers huit heures et demie. Il prenait son chapeau et son pardessus et allait le porter à la gare du Nord, au wagon postal du train de Russie. Il savait que le métro faisait le trajet de la station d’Alésia à la Gare du Nord en vingt-deux minutes, et s’arrangeait pour arriver dix minutes avant le départ du train. Ces voyages quotidiens à la gare privaient Lénine de la possibilité d’aller au théâtre, au concert ou au cinéma. » Il rentrait vers dix heures du soir et s’enfermait dans sa chambre, ou bien allait s’asseoir à la cuisine et jouait aux cartes avec la mère de Nadejda Konstantinowna. « La vieille femme était très contente quand il se mettait à jouer avec elle. » Kamenev raconte que Lénine aidait souvent sa belle-mère à laver la vaisselle.
Les soirées de la rue Marie-Rose rappelaient à Nadejda Konstantinowna les journées paisibles de l’année 1900, à Munich. Lénine vivait alors avec Martov et un typographe russe, Blumenfeld, employé à l’imprimerie de l’Iskra. « Il y avait beaucoup de travail, mais il fallait aussi s’occuper du ménage. On avait décidé d’organiser cette vie en commun selon les principes de la communauté. Nadejda Konstantinowna allait au marché, les hommes aidaient à la cuisine. Ils devaient aussi laver la vaisselle ensemble, ou bien à tour de rôle. Lénine supportait tous ces travaux ménagers humblement et sans plaintes. Martov faisait le travail consciencieusement, mais il gémissait, surtout en lavant la vaisselle. » Peut-être bien que Martov, contrairement à Lénine, se croyait, dans son for intérieur, un personnage de roman. Mais le bonhomme de la rue Marie-Rose n’était plus le même Wladimir Ilitch qu’à Munich. En 1900, sa patience n’était pas de la résignation. C’était une patience violente et préméditée. C’était par fanatisme qu’il supportait les ennuis de ce ménage en commun. Il comptait ces ennuis au nombre de ses devoirs de révolutionnaire. Laver la vaisselle, c’était une manière de lutter, de se révolter. En 1909, à Paris, sa patience était proche de la résignation. Ce n’était plus par fanatisme qu’il lavait la vaisselle, mais simplement pour se rendre utile, pour aider sa femme, pour faire plaisir à sa belle-mère. Son fanatisme étroit et têtu, si violent et cynique jusqu’alors, se nuançait d’une bonhomie résignée, dont ses adversaires s’étonnaient et se méfiaient tout à la fois.
Nadejda Konstantinowna attribuait cette « résignation » à l’excès de travail. En effet, Lénine avait parfois des étourdissements. Mais en dehors de ces crises passagères il était jovial, parlait volontiers, s’intéressait aux petits évènements, aux menus incidents de la vie de chaque jour dans les milieux d’émigrés, se préoccupait de la situation de certains camarades qui cachaient leur misère et ne demandaient pas de secours, et mettait dans ses questions une insistance qui n’était pas seulement de la curiosité et de la compassion. Il semblait fatigué : c’est-à-dire qu’il était cordial et humain. Il commençait à s’intéresser aux hommes autant qu’aux idées : on remarquait que Wladimir Ilitch s’occupait déjà moins des livres que des hommes, et ne faisait à la Bibliothèque nationale que des apparitions de plus en plus rares. Il arrivait à trouver Rykov et Kamenev amusants, ce qui touchait Rykov et ce qui étonnait Kamenev. Il se mêlait à leurs discussions et à leurs querelles, et c’était avec une joie d’enfant qu’il accueillait les trouvailles de Kamenev se moquant de Rykov. Ainsi « ce vieux Parisien » de Kamenev avait conseillé un jour à Rykov, qui venait de s’installer à Paris et manquait de tout pour monter sa maison, d’acheter un certain pot de terre dont il racontait des merveilles. Lénine était sorti un matin avec eux pour aller chercher le fameux pot « qui pouvait servir, disait Kamenev, aussi bien pour faire bouillir de l’eau que pour n’importe quelle cuisson ». Le soir, Rykov avait invité tous ses camarades à prendre le thé chez lui. « L’eau fut mise solennellement dans le pot de terre et le pot fut mis sur le réchaud. Hélas ! un craquement se fit entendre, le pot tomba éclatant en morceaux, l’eau inonda la chambre. Et Rykov de raconter comment le grand connaisseur Kamenev l’avait conduit exprès dans les magasins, à la recherche de ce pot de terre qui venait d’éclater devant eux. » Lénine riait aux larmes. Ce Rykov et ce Kamenev étaient vraiment bien amusants, avec leurs manières de collégiens et leurs barbes de professeurs.
Au troisième étage de la maison qu’habitait Kamenev, 11 rue Rolly, près du Parc Montsouris, le « constructeur de Dieu » Anatole Lounatcharsky avait installé depuis quelque temps un cercle de culture prolétarienne. Wladimir Ilitch n’allait que fort rarement chez Kamenev, de peur de rencontrer dans l’escalier « ce pauvre Anatole », qui ne semblait pas encore complètement guéri de sa fièvre hérétique. C’est à lui que Lénine devait son dégoût de la philosophie : grâce au constructeur de Dieu, il venait de sortir d’une des plus curieuses aventures philosophiques qu’on puisse imaginer. En rentrant à Genève après la triste issue de sa campagne de Russie, Lénine s’était trouvé en présence d’un adversaire qu’il croyait définitivement, et depuis bien longtemps, vaincu par Marx et par Engels. L’hérésie d’Anatole Lounatcharsky avait ressuscité au sein du marxisme le problème de Dieu. C’était une « révolte à genoux » contre le matérialisme dialectique de Marx et d’Engels. La stratégie de Napoléon et de Clausewitz ne pouvait rien contre le Dieu d’Anatole. Pour combattre le néo-idéalisme de Lounatcharsky, de Bogdanov, de Gorki, cette « recherche de Dieu » que Zinoviev appelait une « maraude littéraire », Lénine n’hésita pas à s’enfoncer sans guide, tout seul, dans la sombre forêt de la philosophie.
C’était la lutte de Jacob contre l’Ange. Ce Jacob marxiste était massif, musclé, le cou court, les épaules solides et larges, mais son adversaire appartenait à une race dangereuse, délicate et puissante, qui lui était tout à fait inconnue. Depuis le temps de Robespierre, les petits bourgeois avaient perdu le goût et l’habitude, de mesurer leurs forces contre Dieu ou contre les Anges. Au cours du XIXe siècle, ce genre de lutte était devenu un problème de haute culture, un cas de conscience, parfois même une question de parti ou d’État. Les petits bourgeois en étaient réduits à ne plus pouvoir suivre, individuellement, la vocation de Jacob : ce qui eût pu avoir des conséquences très graves sur leur emploi et leur carrière. Pour Lénine, ce n’était ni un problème de haute culture ni un cas de conscience : c’était simplement une question de parti. Son ignorance en matière philosophique était de la plus noble qualité : une ignorance de grande allure. En dehors du marxisme, des doctrines typiquement marxistes, ses connaissances étaient si limitées qu’il n’hésitait pas à se définir « un ignorant au sens bourgeois du mot ». Ce qui l’avait toujours animé dans sa lutte contre les intellectuels, les professeurs, les philosophes du marxisme, ce n’était pas seulement sa haine pour ses adversaires personnels, c’était aussi son dégoût pour la culture. Il ne prenait jamais part aux discussions théoriques sur les doctrines de Marx si ce n’est en lançant des injures et des calomnies à l’adresse de ses contradicteurs. Il ne faisait aucune différence entre les hommes et leurs idées : comme tous les ignorants, il voyait dans les idées des adversaires personnels. Pour combattre leurs principes et leurs théories il s’en prenait aux hommes. Mais cette fois, pour lutter contre l’hérésie des « constructeurs de Dieu » qui troublait tous les esprits et menaçait de compromettre l’unité du parti, il ne pouvait plus se borner à attaquer personnellement Lounatcharsky, Bogdanov et Gorki. Son ignorance ne lui suffisait plus.
Lénine n’avait pas tort de se méfier du jiu-jitsu dont s’était servi l’Ange pour luxer la cuisse de Jacob. Voilà que ce contempteur des philosophes se trouvait dans l’obligation de devenir philosophe, d’apprendre le jiu-jitsu du Dieu d’Anatole Lounatcharsky. « Pour connaître l’ennemi, disait-il, il faut aller dans son pays. » On a remarqué, à ce propos, que Lénine s’était adonné à la lecture d’ouvrages philosophiques « pour les mêmes raisons qui faisaient étudier le russe aux officiers allemands ». Mais de quelle nature était le Dieu d’Anatole ? « Dieu, écrivait Lounatcharsky, c’est tout ce qu’il y a de plus humain à la plus haute puissance : c’est l’humanité de demain, qu’il faut construire avec l’humanité d’aujourd’hui. » D’après Bogdanov, Lounatcharsky et Gorki, si l’on voulait gagner les paysans russes au marxisme, il fallait inventer une nouvelle religion, construire un nouveau Dieu. Le Dieu d’Anatole était donc de nature humaine : à la base de cette nouvelle religion, il y avait la question paysanne. L’abominable hérésie ! Et Karl Marx ? Et le matérialisme marxiste ? Et le marxisme scientifique ? Pour défendre le matérialisme de Marx et d’Engels, et l’unité du parti, contre cette « révolte à genoux », Lénine n’hésita pas à s’enfoncer dans la forêt de la philosophie. Il fallait chasser le Dieu d’Anatole ainsi qu’on débusque un sanglier.
Le livre de Lénine Matérialisme et Empiriocriticisme, terminé à Genève pendant l’automne de 1908 et paru à Moscou an cours du printemps de 1909, est le récit fidèle de cette extraordinaire aventure philosophique. Ce n’était pas la première fois que Lénine abordait l’étude de la philosophie. Déjà en 1899, dans son exil de Chouchenskoïe, en Sibérie, ayant eu sous les yeux le livre de Stammler, Wirtschaft und Recht, et quelques articles de Strouve, de Bogdanov et d’autres néo-kantiens, qui avaient paru dans le Novoïe Slovo, il avait entrepris, au hasard, la lecture d’Holbach, d’Helvétius et de Kant. « J’ai trouvé, écrivait-il le 27 avril 1899 dans une lettre à Potressov, qu’il faut régler sérieusement notre compte avec le néo-kantisme. Je n’ai pas su me contenir, et j’ai introduit des observations et des attaques contre lui dans la réponse à Strouve. Je n’ai pas su me contenir, dis-je, car j’ai bien conscience de mon ignorance philosophique et je n’ai pas l’intention de traiter ces sujets avant de m’être instruit. C’est pourquoi je m’occupe présentement de cela : j’ai commencé par d’Holbach et Helvétius et je me prépare à passer à Kant ». On ne saurait faire grief à Lénine des difficultés qui l’empêchaient de suivre un cours régulier de philosophie dans le village sibérien de Chouchenskoïe, bien qu’il ajoute naïvement, dans cette même lettre à Potressov, « qu’il s’était procuré les principales œuvres des principaux philosophes classiques ». Mais il n’en est pas moins bien amusant de le voir s’initier à l’étude de la philosophie par la lecture d’Holbach, d’Helvétius et de Kant. Pour ceux qui ne sauraient s’imaginer Lénine autrement que comme un Gengis-Khan à cheval, c’est une bonne occasion de le voir comme Pascal voyait Montaigne. Dans son entretien avec M. de Saci, Pascal disait de Montaigne « qu’il montait à cheval comme un homme qui ne serait pas philosophe ».
À Genève, au début de 1908, peu après son retour de Russie, quand il entreprit sa lutte contre l’hérésie de Lounatcharsky, de Bogdanov, de Gorki et des autres disciples d’Ernst Mach, Lénine n’était pas meilleur philosophe qu’en 1899 : il n’avait pas fait beaucoup de progrès depuis Chouchenskoïe. Sa méthode de travail n’avait fait qu’ajouter, à l’ignorance dont il avait conscience, une confusion d’idées dont il ne se rendait pas compte. Enfermé du matin au soir dans la Bibliothèque de Genève, il compulsait fébrilement des œuvres choisies au hasard, d’après un critérium aussi empirique que possible. Les notes et les observations dont il remplissait ses cahiers révélaient des préoccupations polémiques empêchant chez lui tout respect, toute obéissance à des règles, à des principes, à une discipline de travail strictement philosophiques. Pour réfuter l’empiriocriticisme des disciples d’Ernst Mach, Lénine mettait un langage tout à fait profane au service d’une méthode critique, dont l’empirisme eût fait rougir le plus faible étudiant de n’importe quelle petite Université allemande.
Grisé de philosophie, comme il le disait lui-même, il ne s’occupait que très peu de l’organisation révolutionnaire, de ses « bactéries », de ses « professionnels ». Zinoviev nous raconte que, dans un journal parisien de l’époque, on promettait ironiquement la moitié d’un royaume à quiconque pourrait nommer un quatrième bolchevik après Lénine, Zinoviev et Kamenev. Ceux qui étaient restés fidèles à Wladimir Ilitch, ajoute Henri Guilbeaux, on pouvait les compter. Lénine avait à peu près complètement cessé de collaborer au journal du parti Le Prolétaire. « Jamais encore, écrivait-il à Gorki au mois d’avril 1908, je n’ai autant négligé notre journal ; je passe des journées entières à lire les adeptes cent fois maudits d’Ernst Mach. » La Bibliothèque de Genève ne lui semblant pas suffisante pour lui fournir tous les documents dont il avait besoin, il s’en fut à Paris et à Londres s’enfermer à la Bibliothèque nationale et au British Museum. Mais ce n’est qu’après son retour à Genève, au début de l’été, que Lénine entreprit d’extraire, de ses cahiers de notes, les chapitres de son livre Matérialisme et Empiriocriticisme. « C’était un travail fou, raconte un témoin : il n’avait alors ni secrétaire ni dactylo. Il devait tout faire par lui-même. » Le récit de cette poursuite de Dieu à travers la forêt du matérialisme et de l’idéalisme est le pamphlet le plus étonnant et le plus divertissant qui ait jamais paru contre la philosophie. C’est réellement Jacob luttant contre l’Ange de Dieu, contre tous les anges de Dieu, de Berkeley à Kant, de Hegel à Mach et à Poincaré : philosophes réactionnaires et anges bourgeois.
Ce qui est le plus amusant dans Matérialisme et Empiriocriticisme (et ce qui a l’air d’amuser jusqu’aux Plutarques officiels de Moscou), c’est le langage dont Lénine se sert pour exprimer des idées que seul peut exprimer le langage philosophique. En cette matière Lénine est pire qu’un profane : c’est un petit bourgeois qui n’est plus conscient de son ignorance, et qui se croit devenu philosophe, c’est-à-dire capable de parler et de comprendre la langue de Leibnitz, de Hume ou de Kant, par le seul fait qu’il en a appris quelques mots. Tant qu’il se meut dans le cercle de l’Anti-Dühring d’Engels (Herrn Eugen Dühring Umwälzung in der Wissenschaft) et tant qu’il parle du matérialisme dialectique de Marx et d’Engels, il lui est facile de leur emprunter les formules consacrées par l’usage dans les articles de la presse social-démocratique et dans les brochures des innombrables interprètes de Marx. Mais quand il remonte de Berkeley à Kant, quand il quitte le terrain familier des théories marxistes pour s’enfoncer dans les régions inconnues du kantisme et de l’hégélianisme, voici que le redoutable Dieu des philosophes, bien plus catégorique que celui des croyants, se dresse devant lui, un Dieu qui ne comprend pas son patois. Le hic sunt leones des anciens géographes marque, pour les petits bourgeois, les frontières de la métaphysique.
Le patois que parle Lénine dans Matérialisme et Empiriocriticisme, mêlé de mots empruntés à la politique, à l’économie, à la sociologie, aux mathématiques, à la physique, quelquefois même à la philosophie, a un son bien curieux pour des oreilles un tant soit peu habituées au langage de ce qu’on appelle des philosophes. Kant, le professeur Emmanuel Kant ? Il appartient au centre parlementaire, c’est-à-dire qu’il est, en philosophie, ce que les démocrates constitutionnels sont en politique. Ernst Mach « s’approche ici du marxisme comme Bismarck s’approchait, du mouvement ouvrier ». Büchner, Dühring « et autres coqs, n’ont pas su mieux qu’eux extraire du fumier de l’idéalisme absolu la perle de la dialectique hégélienne ». Et Avenarius, Mach, Schubert-Soldem ? Des « obscurantistes bourgeois, aussi purs que Renouvier ». Leurs raisonnements ne sont que du « charabia philosophico-scientifique ». Henri Poincaré « est un physicien éminent, mais il est incontestable que seul un Jouckhévitch peut le prendre au sérieux comme philosophe ». Et plus loin : « Vous vous trompez, Monsieur Poincaré, vos œuvres prouvent qu’il existe des gens qui ne peuvent penser que les choses qui n’ont pas de sens. » Et Friedrich Adler, privat-docent à l’Université de Zurich ? « Un naïf professeur, qui rend, dans son ingénuité, un fichu service à la doctrine de Mach. » Deux lignes plus haut, Lénine disait de ce même Friedrich Adler, auteur de la Découverte des Éléments du Monde, qu’il était « peut-être le seul écrivain allemand sérieux, désireux de compléter Marx à l’aide de Mach ». Anatole Lounatcharsky, le constructeur de Dieu, fait « des coquetteries avec la religion ». Et Wilhelm Schuppe, professeur à Greifswald ? Oh ! il faut bien convenir que « le baiser de Wilhelm Schuppe, en philosophie, ne vaut pas mieux que le baiser de Pierre Strouve, ou de Menchikov, en politique ». De Socrate à Wilhelm Schuppe, d’Aristote à Lounatcharsky, du Dieu de Kant à celui d’Anatole, quel aventureux voyage !
Il est sans doute regrettable que le récit d’une telle aventure philosophique soit écrit dans un patois qu’un philosophe bien élevé ne saurait comprendre. Mais ce qui, même après les évènements d’octobre 1917, reste incompréhensible pour les philosophes, ne l’est pas, semble-t-il, pour les révolutionnaires professionnels, pour les bactéries de la révolution. En effet, Zinoviev affirme que le pamphlet de Lénine « est un travail théorique énorme, un ouvrage sérieux de philosophie, qui pose les fondements du communisme ». Quand le livre parut, en 1909, la polémique provoquée par l’hérésie de Bogdanov et de Lounatcharsky s’était déjà apaisée. L’auteur de Matérialisme et Empiriocriticisme s’aperçut que tout était depuis longtemps rentré dans l’ordre sans lui. Le Dieu d’Anatole agonisait pour son compte au numéro 11 de la rue Rolly à Paris, dans l’appartement que Lounatcharsky habitait juste un étage au-dessus du petit logement de Kamenev.
« Pendant tout le temps qu’a duré cette brouille, écrit Lounatcharsky, je ne me suis jamais rencontré avec Lénine. » Les deux adversaires s’évitaient, et le brave Anatole, aussi malin que myope, ne manquait jamais, quand il rencontrait Wladimir Ilitch dans la rue, de le regarder sans le voir. Lénine, qui jugeait ces rencontres inutiles, ne traversait que rarement le Parc Montsouris, que Lounatcharsky, comme tous les émigrés russes du quartier, considérait un peu comme son jardin privé. « Du matin au soir, raconte Alin, les allées accueillantes étaient remplies des voix sonores des enfants des émigrés. Lénine avait des amis parmi cette marmaille : le fils de Zinoviev, les enfants de Kauski, Kolia et Seriojka, et le petit garçon de Kamenev, Lioutik. Quand il rencontrait ces petits en traversant le parc, il s’arrêtait toujours pour lier conversation avec eux. Seriojka, vif et agile, le mettait tout de suite, en zézayant, au courant de ses affaires et de ses intérêts relativement à son cerceau et au grand canard qui nageait dans l’étang et qui attirait son attention. L’aîné, Kolia, s’occupait de choses plus sérieuses. Lénine les écoutait, s’attristait de leurs chagrins, admirait le grand canard et partait à ses affaires. » Lounatcharsky, myope et souriant, le suivait des yeux sans le voir.
Les jours de beau temps, quand il n’était pas retenu par ses élèves du cercle de culture prolétarienne, le brave Anatole descendait se promener dans le parc, au milieu des enfants, des bonnes, et des vieilles femmes du quartier. Cet hérétique qui prétendait « construire » un nouveau Dieu et prêcher une nouvelle religion aux moujiks, n’avait pas l’air d’un prophète. « On pouvait souvent le rencontrer dans les allées, poussant la voiture où était son enfant. Mais dans la voiture ne se trouvait pas seulement son fils. Il y avait un nombre inouï de journaux, revues et livres. Il poussait la voiture du ventre, les deux mains prises par un livre ou par un journal, dont la lecture l’absorbait toujours. Une fois Lénine aperçut ce groupe pittoresque. Il regarda avec étonnement Lounatcharsky passer dans une allée voisine et s’écria : mais il peut l’étouffer ! En voilà un fou ! Se rappelant ensuite ce tableau, il riait de cette bibliothèque roulante et répétait : on ne devrait pas lui confier un enfant !
Lénine ne gardait pas rancune au « professeur Lounatcharsky » qu’il jugeait inoffensif et, au fond, bon vivant. « Il n’est pas dangereux, disaient Kamenev et Zinoviev, mais il faut s’en méfier. » Des bruits fâcheux couraient de temps en temps sur les propos tenus par Lounatcharsky, au sujet de Wladimir Ilitch, devant ses élèves du cercle de culture prolétarienne. Sous le prétexte des « malentendus, des irritations d’émigrés et des sérieux désaccords philosophiques » par lesquels le constructeur de Dieu s’est efforcé de justifier, plus tard, son attitude à l’égard de Lénine (« j’étais indigné de son caractère impitoyable, ajoutait-il, quand il se manifestait à nos dépens »), il cachait en lui une sorte d’antipathie agressive qui ne manquait pas de provoquer, parfois, de pénibles incidents.
Un soir, pendant une réunion du groupe bolchevique dans un café de l’avenue d’Orléans, des élèves du cercle de culture prolétarienne se glissèrent dans la salle. Lénine, qui était assis dans un coin (dans les réunions il se tenait toujours à l’écart, blotti sur sa chaise, et il suivait attentivement les discussions, en clignant des yeux, et en jetant autour de lui un regard vif et rieur), se montra fort surpris de cette apparition. « Qu’est-ce qui se passe ? Ça sent le grabuge » s’écria-t-il. La question à l’ordre du jour était l’attitude de la fraction bolchevique à l’égard de la Douma. Lénine s’était déclaré opposé au boycottage : son opportunisme, vivement combattu par Lounatcharsky, Bogdanov, Alexinsky et les autres partisans de l’intransigeance absolue, (opportunistes en philosophie, intransigeants en politique), ne reculait pas devant l’éventualité de reprendre la lutte sur le terrain constitutionnel. Des murmures se firent entendre, des interruptions jaillirent du fond de la salle, des cris retentirent. La réunion devint vite tumultueuse. « Lénine, nous raconte un témoin, était extrêmement ému. Nadejda Konstantinowna, qui voulait calmer les passions déchaînées, se vit traiter d’un mot injurieux. Ce fut la fin. Il fallut lever la séance. Le public s’en allait. J’ai observé Lénine à ce moment. Je ne l’ai jamais vu aussi troublé. Il était pâle. Il saisit son chapeau et quitta la salle au plus vite. » C’est à un bolchevik, à un ami personnel de Wladimir Ilitch, que nous devons ce récit. « Tout le monde partit. Nous allâmes quelques-uns dans un café voisin pour nous entretenir de l’incident. Lénine n’était pas là. C’est seulement tard dans la nuit, vers une heure et demie, que je le rencontrai non loin de l’avenue d’Orléans, rentrant à la maison avec Antonov-Popov. il pleuvait. Lénine marchait vite, tenant son chapeau à la main. Il était encore ému de l’incident. Nous l’accompagnâmes jusqu’à la maison. Il répétait sans cesse, tout le long du chemin : « C’est une infamie ! Être capable d’un pareil scandale ! C’est le comble de tout ! » Il ne pouvait se calmer. On apprit plus tard qu’après avoir quitté la réunion il avait marché dans les rues pendant plus de deux heures, pour arriver à se calmer. »
Les deux premières années de son séjour à Paris, Lénine traversa souvent de véritables crises de dépression nerveuse. Comme une ville dans les sables du désert, la Russie sombrait peu à peu dans « le grand silence du Nord-Est ». Le désordre du parti augmentait de plus en plus, le tirage du journal diminuait à chaque numéro, les esprits s’endormaient dans une sorte de pessimisme égoïste, hanté de rêves, troublé de regrets et de remords. « Il faut savoir attendre », disait Wladimir Ilitch. À de courtes périodes d’activité, véritables accès de fièvre nerveuse, marqués de sursauts d’impatience et de mauvaise humeur, dont il sortait épuisé comme d’une maladie, succédaient de longues convalescences, des périodes de travail méthodique, de vie calme, ordonnée : « la vie de Chouchenskoïe dans un quartier de Paris ». Le goût lui revenait des entretiens familiers, de la fréquentation de ses quelques fidèles, des promenades à bicyclette. Il prenait alors un air simple et cordial, jouait d’interminables parties d’échecs avec sa belle-mère, passait de longues heures en compagnie de Kamenev, de Zinoviev ou des ouvriers typographes du journal, à parler politique, à se plaindre des difficultés qui entravaient le travail d’organisation et de propagande, à s’intéresser à la vie de peine et de misère de la plupart des émigrés. « Et Tchitcherine ? Que fait Tchitcherine ? Voilà bien longtemps qu’on ne le voit plus. »
Tchitcherine, secrétaire du Bureau menchevique à l’étranger, était sans doute, parmi les adversaires de Lénine, un des plus corrects et des plus désintéressés. Wladimir Ilitch ne cachait pas sa sympathie pour cette sorte de philanthrope révolutionnaire aux allures extravagantes, qui avait l’air d’un personnage de Tourgueniev et qui croyait, comme un grand nombre d’idéalistes de notre temps, que l’uniforme de matelot est ce qui convient le mieux à la beauté masculine. Bien que ses amis eux-mêmes ne missent pas en doute sa bonne foi et sa fidélité à la cause de la révolution prolétarienne, on sentait que son marxisme n’était pas sans réserves. Il eût certes été plus orthodoxe si Marx avait eu les joues roses, les lèvres rouges et le menton rasé d’un jeune marin de Toulon ou d’Odessa. Peut-être sa nature secrète était-elle ardente, mais son caractère était froid. Calme et courtois, il parlait lentement d’une voix douce, en caressant l’air de ses mains blanches, qu’il soignait avec un esprit de suite et une bonté d’âme beaucoup plus émouvante chez lui que chez un personnage de Tourgueniev. Il était persuadé qu’il était un révolutionnaire gentilhomme : le trait le plus curieux de son caractère, c’est qu’il se croyait complètement dans la règle, voire dans la normale, et considérait tout le monde, ses adversaires en particulier, comme des exceptions. Il jugeait les bolcheviks « des monstres humains » et il était convaincu « que leur existence constituait un phénomène tout à fait anormal ».
Tchitcherine ne fréquentait personne, n’aimait pas les discussions politiques, et ne prenait jamais la parole au cours des grandes réunions. Son attitude était modeste, ses ambitions étant d’un genre que l’on peut qualifier d’égoïste. Doué de beaucoup d’esprit, il en faisait preuve en se tenant à l’écart, bien que ses fonctions de secrétaire du Bureau menchevique à l’étranger fissent de lui une des personnalités les plus en vue du mouvement révolutionnaire russe. « On pouvait le voir chaque soir, nous raconte le directeur de l’imprimerie du Social-démocrate, dans sa vaste pèlerine, avec une énorme serviette bourrée d’un nombre invraisemblable de papiers, toujours assis à la même petite table devant un lait chaud, au café de Lyon, avenue d’Orléans », occupé à écrire de longues lettres qu’il envoyait aux organisations mencheviques disséminées en Europe et en Amérique. Il gardait copie de chaque lettre, même des papiers les plus insignifiants. Tout en tournant en ridicule son esprit bureaucratique, Lénine s’étonnait qu’il pût accomplir tout seul une telle besogne : « Cent lettres au moins par jour ! » Tchitcherine s’était rendu une fois chez le directeur de l’imprimerie du Social-démocrate et ne l’ayant pas trouvé lui avait laissé un billet : « Je suis venu à 4 heures 37 minutes. » Quelque temps après, le directeur de la typographie du journal bolchevique se trouvait dans le bureau de Tchitcherine. Celui-ci lui rappela sa visite manquée et, comme l’autre n’en avait qu’un souvenir très vague, il alla chercher un dossier sur une de ses nombreuses étagères, tourna quelques feuillets et montra triomphalement la copie du billet qu’il avait laissé à l’imprimerie ce jour-là. « Tchitcherine exagère un peu, disait Lénine en riant, mais il possède des qualités irremplaçables. Il ferait un excellent diplomate. » Cet extravagant personnage, qui rappelait certains bourgeois post romantiques, à barbiche et à pèlerine, comme en dessinait Daumier, était le seul, parmi les mencheviks, avec qui Wladimir Ilitch n’évitât pas d’échanger quelques mots quand il le rencontrait, l’un se rendant au Social-démocrate, l’autre au café de Lyon. Debout sur le trottoir de l’avenue d’Orléans, Tchitcherine parlait d’une voix, douce et caressait l’air de ses mains blanches, comme s’il eût voulu caresser la barbiche rousse de Lénine.
Un des sujets de conversation préférés de Wladimir Ilitch était la musique. Il allait de temps en temps au théâtre ou au cinéma, mais plus souvent au concert. Beethoven le troublait profondément : la Neuvième surtout, ainsi qu’une fièvre printanière, le laissait pâle et nerveux. La tête inclinée sur l’épaule, serrant son poignet gauche dans sa main droite, il écoutait les yeux fermés, les lèvres serrées, le front trempé de sueur. Cependant, quand il parlait de musique, il affectait d’en parler en profane et mettait une espèce de pudeur et d’amour-propre à nier le trouble étrange qu’elle suscitait en lui. Il en arrivait à considérer la musique d’un point de vue marxiste : n’a-t-il pas attribué l’origine des Symphonies de Beethoven « à un phénomène d’ordre économique » ? Qu’il s’agît de Pouchkine ou de Beethoven, il cachait ses goûts artistiques comme une faiblesse. On lui avait reproché, à propos de Pouchkine, son « goût bourgeois » pour ce poète d’un romantisme ardent, d’une imagination fébrile, cette sorte de Lord Byron slave, issu des fureurs érotiques d’un grand-père nègre et des inquiétudes sentimentales de la noblesse russe du XIXe siècle, décadente et réactionnaire. Pour défendre « son goût bourgeois », Lénine affecte de juger Pouchkine et Beethoven en marxiste. Au fond, Kautsky était bien plus compromettant que l’auteur de la Neuvième Symphonie.
En rentrant d’un concert, parfois, il cherchait à cacher son trouble en tournant en ridicule les sophismes de Kamenev ou le penchant de Rykov pour la boisson. Il riait bruyamment, racontait des anecdotes sur Plekhanov et sur Martov et des histoires amusantes sur le Comité central du parti ; il évoquait le souvenir de son séjour à Londres, « au Paradis des Anglais », ou des quelques jours qu’il avait passés à Paris avec Trotsky, au début de l’année 1903. Parmi ces souvenirs, le tour qu’il avait joué à Trotsky était celui qu’il évoquait toujours avec le plus de joie : Martov et la Sadowa ayant décidé de faire entendre un opéra à Lénine, le conduisirent un jour avec Trotsky à l’Opéra-Comique, où l’on donnait Louise de Gustave Charpentier, « un drame lyrique, nous dit Trotsky, dont le sujet est très démocratique ». Wladimir Ilitch n’avait jamais vu un opéra : cette Louise le mit de belle humeur. Assis avec les autres tout en haut, à la galerie supérieure, tenant sous son bras une serviette qu’il avait apportée de Londres pour tout bagage et qui ne le quittait jamais, (il était venu à Paris faire une conférence politique sur la question agraire, dans une salle de l’avenue de Choisy : sa précieuse serviette contenait des cahiers remplis de notes et de statistiques, un peigne, un morceau de savon, quelques mouchoirs et les derniers numéros de l’Iskra), Lénine de temps en temps regardait à la dérobée les souliers de Trotsky, en souriant d’un air malicieux qui n’avait rien à voir avec la musique de Charpentier. Ces souliers avaient une petite histoire : « Wladimir Ilitch, nous raconte Trotsky, avait acheté à Paris des chaussures qui se trouvèrent trop étroites. Il en souffrit pendant quelques heures, puis décida de s’en défaire. Comme par hasard mes chaussures à moi demandaient des remplaçantes. » À ce malheureux hasard, il s’en ajoutait un autre : le pied de Trotsky se trouvait avoir la même pointure que celui de Lénine. Le bon Wladimir Ilitch lui donna ses souliers sans souffler mot des souffrances qu’il avait endurées. « Il me sembla d’abord qu’ils étaient juste à ma pointure, tant j’en étais content. Je décidai de les étrenner le jour même pour me rendre à l’Opéra-Comique. Pour y aller, tout marcha parfaitement, mais une fois au théâtre, je commençai à m’apercevoir que l’affaire se gâtait. C’est peut-être la raison pour laquelle je ne me rappelle pas l’impression qu’a pu produire l’opéra sur Lénine et sur moi-même. Je vis seulement qu’il était très disposé à plaisanter et qu’il riait beaucoup. Au retour, je souffrais déjà cruellement, et Wladimir Ilitch, sans pitié, me narguait tout le long du chemin. Il y avait pourtant une certaine commisération dans ses railleries. » Lénine trouvait peut-être qu’on ne pouvait jouer un meilleur tour à ce jeune Trotsky, qui montrait déjà un si ardent désir de marcher dans les souliers d’autrui. « C’est drôle, n’est-ce pas ? » disait-il en éclatant de rire.
Souvent, le soir, Wladimir Ilitch et Nadejda Konstantinowna, accompagnés de la « troïka » Zinoviev, Rykov et Kamenev, allaient écouter le fameux chansonnier populaire Montéhus, qui faisait alors la joie du bon public du théâtre de Belleville. Rien n’amusait plus Lénine que les chansons de Montéhus, sa verve, son entrain, ses jeux de mots et ses railleries à l’endroit des bourgeois et des faux socialistes. Montéhus, fils d’un communard, se disait révolutionnaire et, dans une certaine mesure, il l’était. (« Pendant la guerre, remarque Nadejda Konstantinowna, il s’est mis à composer des chansons patriotiques ! ») Il mettait en couplets la question sociale, et, contrairement à Lénine, qui considérait la musique d’un point de vue marxiste, il considérait le marxisme d’un point de vue musical, ce qui semblait tout à fait dans le goût du public du théâtre de Belleville, composé en grande partie d’ouvriers et de petites gens aussi enthousiastes de leur chansonnier révolutionnaire, que les bons bourgeois de France l’avaient été de leur Déroulède. Assis au milieu de la foule, la figure rouge de joie, Wladimir Ilitch mêlait sa voix rauque et ses vivats au tonnerre d’applaudissements qui saluait l’apparition de Montéhus. Un soir, « Lénine disparut. On le chercha dans la salle, il n’y était pas. On apprit qu’il était allé dans les coulisses faire la connaissance du chansonnier. Ils s’emballèrent tellement l’un pour l’autre qu’ils restèrent à discuter, sans y prendre garde, jusqu’à quatre heures du matin ». Nadejda Konstantinowna nous raconte « qu’une fois même, Montéhus vint chanter à une de nos petites soirées russes. Il resta très avant dans la nuit à parler avec Wladimir Ilitch de la future révolution mondiale. Le fils du communard et le bolchevik russe, chacun à sa manière, méditaient sur l’avenir ».
Enfermé dans sa chambre de travail, Lénine se mettait souvent à chanter. Il avait une voix rauque et sourde qui se brisait dans l’aigu comme la voix d’un vieillard. Il aimait les anciennes chansons russes, ces vieilles chansons populaires que les émigrés, parfois, entonnaient en chœur, à la fin d’une discussion politique, dans quelque arrière-boutique de café ou quelque petite salle où ils tenaient leurs parlotes. « Je me souviens, nous raconte Alin, d’une petite fête du Jour de l’An près de la porte d’Orléans, dans la cave d’un café dont les murs étaient couverts de chats noirs aux yeux terribles. Un chat noir de dimensions énormes, les yeux plus terribles encore que les autres, fixait le public de la scène. Lénine considérait les dessins muraux avec étonnement. – Vous avez choisi un local bien gai, pour fêter le Jour de l’An, il n’y a pas à dire ! – s’exclama-t-il en riant. Mais ces décors funèbres ne troublèrent pas les bonnes dispositions du public. Tout le monde s’amusa. On chanta. Lénine chanta de tout son cœur quand on entonna Stienka Rasine. Il essaya de chanter la partie du baryton, mais n’y réussit pas et continua comme il put, en agitant désespérément les bras. Vers quatre heures du matin, nous allâmes tous sur le boulevard désert. Nous ne cessions pas d’être animés. La femme de Semaschko et Ilia Zafir commencèrent une danse russe. Mais, des agents cyclistes nous demandèrent poliment de cesser le bruit. La danse fut interrompue. Lénine riait aux éclats : Eh bien ! vous avez eu peur ? C’est terrible, un agent ! »
Quand il nettoyait et graissait les pièces démontées de sa « chère bicyclette » sur le trottoir de la rue Marie-Rose, Wladimir Ilitch ne s’arrêtait pas de siffloter. Des motifs de Beethoven, qu’il répétait à l’infini, accompagnaient ses gestes lents, le dandinement de ses épaules, les détentes en levier de ses coudes. Il s’agenouillait au bord du trottoir, en bras de chemise. « Bonjour, monsieur Oulianov », disaient les voisins en passant devant lui. Il commençait à faire chaud ; le printemps mêlait du rose au gris du ciel parisien. L’heureuse saison des promenades à bicyclette s’annonçait par l’apparition, à la fin des tièdes après-midi et dans les claires matinées de dimanches, de bandes joyeuses de jeunes cyclistes en maillots rouges, verts, bleus, avec de gais tintements de grelots. Nadejda Konstantinowna achetait une bouteille de Vernis noir et tirait du fond d’une armoire un vieux chapeau de paille défraîchie « qu’elle couvrait soigneusement d’une couche de vernis. » Cette opération se répétait à chaque printemps et toujours sur le même chapeau. À la fin, le vernis forma sur le chapeau des couches semblables aux couches géologiques de la terre ». Aux premiers cris d’hirondelles, Wladimir Ilitch quittait son complet d’hiver pour un veston gris foncé, et pendant une journée entière s’évertuait à ôter les taches de son costume et de son vieux chapeau melon. Une odeur de benzine flottait dans l’appartement, au désespoir de la mère de Nadejda Konstantinowna, qui souffrait de migraines. On ouvrait les fenêtres. L’air était doux, le ciel clair ; la rue avait l’aspect des rues de province, le dimanche. Les enseignes de magasins, les feuilles des arbres, les façades des maisons, les pots de fleurs aux fenêtres, les trams, les taxis, les tabliers des enfants revenant de l’école, montraient de vives couleurs comme s’ils avaient été fraîchement peints. Le melon de Wladimir Ilitch avait l’air neuf.
Lénine sortait à bicyclette presque chaque jour, se dirigeant vers les énormes tours des gazomètres et les hautes cheminées de la banlieue. Les premiers avions, miracle du siècle, sillonnaient le ciel de l’Île-de-France. Les Parisiens commençaient de s’habituer à ce miracle de chaque jour. Ils s’arrêtaient sur les trottoirs et levaient le nez avec une mine heureuse, suivant des yeux les oiseaux blancs dans le ciel de mars, qui semblait refléter comme un miroir le visage de la terre, avec ses archipels de nuages, ses mers de turquoise, ses lacs verts, ses fleuves bleus traversant champs et bois. Le bon peuple de Paris regardait en l’air avec cette figure respectueuse et amusée des habitants de la Grèce antique, saluant au passage le messager de Zeus, Hermès, planant les bras ouverts, sur un seul pied, au-dessus des villes blanches et dorées. « Wladimir Ilitch, nous raconte Alin, s’intéressait beaucoup aux avions et suivait passionnément les meetings d’aviation. » Il rôdait autour du camp d’Issy et passait de longues heures assis au bord d’un fossé, son melon sur la nuque, à suivre des yeux les évolutions des appareils.
Un jour, le directeur de la typographie du Social-Démocrate le vit arriver « à pied, à côté de sa bicyclette, dont la roue arrière était un peu tordue. Il s’assit sur un banc dans la cour de l’imprimerie, fatigué et tout en sueur : – Ouf ! dit-il, je suis tombé dans une ornière et j’ai eu du mal à m’en sortir. – Lénine était parti dans la matinée et s’était dirigé, comme d’habitude, du côté d’Issy. En approchant du camp d’aviation, il entendit au-dessus de sa tête le bruit d’une hélice. Il leva les yeux pour suivre les mouvements de l’avion, mais au même instant un autre cycliste qui arrivait par derrière le heurta. Le choc fut assez rude. Lénine et l’autre cycliste furent projetés dans le fossé qui bordait la route. Une dispute s’engagea. L’autre cycliste affirmait que c’était la faute de Lénine. Wladimir Ilitch disait qu’il ne pouvait voir ce qui se passait derrière son dos. Un ouvrier qui avait assisté à la scène prit la défense de Lénine. La querelle dura jusqu’à l’arrivée d’un agent, qui les invita à le suivre au poste de police. Un procès-verbal fut dressé, mais il n’eut pas de suites. Je trouvai, le lendemain, Wladimir Ilitch sur le seuil de sa maison, devant sa bicyclette démontée. Il redressait quelque chose avec des pinces, vissait et dévissait des écrous. Il était fort mécontent de l’incident, mais se consolait à la pensée que la bicyclette de son adversaire ne devait pas être dans un meilleur état. »
Les jours de mauvais temps, quand les avions restaient à l’abri dans les hangars d’Issy et que les routes de l’Île-de-France devenaient impraticables pour les cyclistes, Lénine passait ses après-midi à la Bibliothèque nationale ou à la Sorbonne, où il suivait les cours de Durkheim (faut-il rappeler que pendant son séjour à Paris, de novembre 1908 à juillet 1912, il ne trouva jamais le temps d’entrer au Louvre ?), ou bien restait chez lui à écrire des articles et à aider Nadejda Konstantinowna à chiffrer la correspondance clandestine avec les camarades de Russie. Il aimait la lecture : sa table de travail était toujours encombrée de livres que Ladijnikouw lui envoyait de Berlin. « Il lisait attentivement les œuvres de quelques jeunes écrivains ouvriers, parmi lesquels il remarquait particulièrement Ivan Bibik. » Mais Gorki et Tolstoï demeuraient ses auteurs préférés. « Je l’ai trouvé une fois, raconte un témoin, étendu sur le divan en train de lire La Guerre et la Paix. Il se laissait entraîner par la lecture au point qu’il ne voulait pas aller à la cuisine prendre le thé, malgré plusieurs appels de Nadejda Konstantinowna. Il ne lâcha le livre qu’à regret. – Voilà un chef-d’œuvre ! – disait-il. Combien de fois n’a-t-il pas relu la Guerre et la Paix. Il le faisait toujours avec un nouveau plaisir. » Il sortait parfois le soir, en compagnie de sa femme, pour aller rejoindre Zinoviev et Kamenev dans un petit café de l’avenue d’Orléans, à l’angle de la place Montrouge. C’était un local très modeste et très tranquille, qui a disparu depuis longtemps, remplacé par une succursale du Comptoir d’Escompte. « Quand il avait un soir libre, Lénine y entrait pour boire un bock et faire une partie d’échecs avec un de ses amis. » Il allait aussi de temps en temps au café de Lyon, avenue d’Orléans, que hantaient la pèlerine, les mains blanches et la voix douce du gentilhomme Tchitcherine, et où se trouvait le siège du Club des joueurs d’échecs du XVIe arrondissement. C’était là que se tenaient parfois les réunions des émigrés. « Lénine y venait souvent avec Antonov-Popov, joueur d’échecs passionné, insatiable. » Avant l’arrivée de Martov à Paris, Wladimir Ilitch fréquentait aussi le café d’Harcourt, mais ses rencontres avec Martov, qui était devenu un habitué, lui étant désagréables, il délaissa le café d’Harcourt pour la Closerie des Lilas et les brasseries de Montparnasse.
Lénine n’aimait pas Montparnasse. Cette bohème conventionnelle où les artistes ratés se mêlaient aux petits mouchards, où le véritable talent n’était qu’un préjugé indigne d’une jeunesse libre, révolutionnaire, et, somme toute, prudente et médiocre, (il faut reconnaître que Lénine jugeait cette bohème à la façon de n’importe quel bourgeois du siècle) le dégoûta pour toujours des arts et des lettres. Mais dans la « jeunesse pourrie » de Montparnasse il ne voyait pas seulement ce que pouvait voir un simple bourgeois. Aux yeux d’un émigré russe de ce temps-là, ces peintres et ces poètes à l’allure enfantine, ces femmes stériles aux yeux ternes et aux lèvres pâles, peuple étrange que la guerre a dispersé aux quatre vents et qu’ont remplacé, au cours de ces quatre dernières années, les innombrables sectes du snobisme intellectuel et sexuel, n’étaient pas autre chose que les débris d’une révolution manquée, jetés du fond de la Russie sur le pavé de l’Europe par le raz de marée de 1905. Ce peuple était composé en grande partie de Slaves, d’Italiens, d’Espagnols : « les anges » anglo-saxons n’y représentaient encore qu’une minorité d’allures splendides et méprisées. Mais l’élément véritable de Montparnasse, c’était les Russes : « ces jeunes gens qui avaient à peine flairé la poudre révolutionnaire de 1905 » et qui, saisis d’horreur, avaient quitté la Russie aux premiers signes de la réaction. « Pleins de rancune contre tout et contre tous, ils ne faisaient que baver sur ce qu’ils adoraient peu de temps auparavant. » Ces étudiants, ces jeunes marxistes, qui se disaient prêts naguère à sacrifier leur vie pour la cause ouvrière, étaient maintenant remplis de dégoût pour la politique, les questions sociales et la liberté du peuple. Se découvrant brusquement une âme d’artiste, ils crachaient sur la « misère pouilleuse » des émigrés, et trahissaient la révolution pour se venger des politiciens. L’Apollon de Montparnasse était sans doute un Dieu plus commode que Karl Marx.
« Chaque révolution, disait Lénine, apporte sa sale écume. Pourquoi devrions-nous faire exception ? » Quand il passait devant le café de la Rotonde, « quartier général de l’écume », il jetait un regard triste et lourd sur les jeunes gens assis à la terrasse, devant la nature morte des siphons d’eau de Seltz, des carafes et des verres étalés sur le marbre des petites tables. « Il y avait, parmi ces jeunes gens, des écrivains et des poètes qui passaient leur temps à salir la révolution en vers et en prose. L’écrivain Alexeï Okoulov accusait les émigrés de tous les crimes du monde, avec une haine raffinée. Ilya Ehrenbourg éditait un journal satirique sous le titre Gens du passé. Ces gens du passé, c’étaient les émigrés. Je me rappelle très bien l’expression de dégoût du visage de Lénine, quand il vit ce journal pour la première fois : – Pourriture – dit-il. »
VI
JACOB AU PIED DE L’ÉCHELLE
LES années s’écoulaient doucement, Des nuages gris, poussés par le vent d’Est, s’élevaient à l’horizon de l’Europe. Ce même vent d’Est portait à Candide et à Babbitt, gentilshommes optimistes nourris du lait et du miel de cette Suisse internationale qu’était alors l’Occident, la fraîcheur des prés, des bois et des fleuves de la Russie de Tolstoï. Mais, dans la bouche des émigrés, cette fraîcheur d’herbes et de feuilles avait un goût de sang. Le peuple des moujiks sortait lentement de son lourd sommeil, en ruminant ses rêves et ses haines. Des inconnus, cachant sous de faux noms leurs titres de noblesse révolutionnaire, parcouraient la Russie en murmurant à l’oreille des anciens « partisans » de l’insurrection de 1905 des paroles magiques, qui, désormais, sonnaient funestes et sacrées comme des blasphèmes,
Les débris de cette armée de francs-tireurs qui pendant deux ans, jusqu’à la fin de 1907, avaient combattu, les armes à la main, contre les forces de la réaction, se groupaient secrètement autour de nouveaux chefs, que la police traquait sous leurs faux noms. Ces insaisissables protées dont le plus audacieux, le plus rusé, le plus tenace était un bolchevik de Géorgie qui se cachait sous le nom de Staline, « homme d’acier », répandaient dans toute la Russie la fièvre rouge de la révolte. Des bandes de « partisans » se formaient en Ukraine, en Pologne, en Géorgie, attaquaient les trains, les gares, les postes de police, les banques, les dépôts d’armes et de munitions. Parmi les émigrés de Berlin, de Genève et de Paris, ainsi que dans les milieux social-démocrates de Moscou et de Pétersbourg, ces exploits, que les bolcheviks appelaient « expropriations », étaient considérés comme des actes de banditisme et comme une honte intolérable, dont la responsabilité devait être rejetée sur quelques éléments troubles des bas-fonds du marxisme russe. De toutes parts on criait au scandale, on réclamait violemment un désaveu officiel de ce terrorisme de grands chemins. Mais le Comité central du parti ne se prononçait pas. Les chefs des « partisans » avaient-ils des complices dans ce Comité ? Cette accusation de complicité était surtout dirigée contre Lénine. N’avait-il pas été mêlé personnellement, les premiers temps de son séjour à Paris, au scandale des faux-monnayeurs ?
À vrai dire, dans ce fameux scandale des billets de cinq cents roubles, que la police appelait « l’affaire des faux billets de banque » et Staline « l’expropriation de la Banque de Tiflis », la responsabilité directe de Lénine n’avait jamais été établie de façon précise. Personnellement, il n’aimait pas ce genre d’histoires. Le coup avait été monté en Russie à son insu, dans les « bas-fonds » du marxisme de Moscou et de Pétersbourg. Quand il avait vu de près les cartes que ses « bactéries de la révolution » avaient décidé de jouer sans lui, la partie était déjà engagée. Il était trop tard pour empêcher le scandale. Ne pouvant arrêter le jeu, et n’osant désavouer ouvertement les partenaires de cette partie truquée, qui comptaient parmi les plus sûrs et les plus éprouvés de ses révolutionnaires professionnels, (cerveaux brûlés, sans doute, mais bolcheviks de vieille date, qu’il ne pouvait lâcher sans se compromettre dans un autre sens) Lénine avait accepté sa part de responsabilité. Faux ou volés, ces roubles avaient failli coûter cher à la fraction bolchevique. Sur la dénonciation d’un agent provocateur à la solde de l’Okhrana, le docteur Jitomirski, qui avait su gagner la confiance des émigrés les plus en vue et de Lénine lui-même, quelques-uns des principaux changeurs étaient tombés presque le même jour aux mains de la police, entre autres Litvinov à Paris, Master (Stroïan) à Stockholm, Olga Ravitch (Karpinskaïa) à Munich. Litvinov avait été arrêté à la gare au départ du train pour Londres : il avait les poches bourrées de faux billets de cinq cents roubles.
« Je me trouvais alors à Zurich, raconte un témoin, où vivait Touri (Beksadian), qui avait reçu la mission d’organiser parmi les émigrés Zurichois un groupe de changeurs. C’était le premier groupe, et le premier essai de change. On pensait ; au cas où la première expérience réussirait, organiser une deuxième équipe et l’envoyer dans d’autres villes. La réunion des changeurs devait avoir lieu à Paris. Au jour fixé, Beksadian, Master, Sasonov et Olga Ravitch, qui était arrivée la veille de Genève, quittèrent Zurich. Les changeurs se réunirent à Paris pour la répartition des tâches. Master partit pour Stockholm, Olga Ravitch pour Munich, Sasonov pour Monte-Carlo. Litvinov, qui se trouvait déjà à Paris avant l’arrivée des Zurichois, devait partir pour Londres. Comme c’était le premier essai, on ne donna à chacun qu’un petit nombre de billets. C’était Litvinov qui en avait le plus. Quand les journaux annoncèrent l’arrestation des « faussaires », une terrible tempête se déchaîna dans le parti. De graves accusations tombaient sur les bolcheviks, sur Lénine en particulier. Quelques voix s’élevèrent, pour crier à la nécessité d’exclure du parti tous les bolcheviks. Une réunion spéciale du Comité central, convoqué à ce sujet, décida, sous la pression des mencheviks, de brûler les billets qui restaient. » Il était clair qu’un traître s’était mêlé à l’affaire. Mais où le chercher ? On découvrit quelques années après que le mouchard était le docteur Jitomirski, celui qui s’était chargé de distribuer les billets aux changeurs et de tenir la comptabilité de l’opération.
Entraîné malgré lui dans des évènements qu’il ne pouvait empêcher, Lénine avait, comme toujours, accepté sa part de responsabilité. Bien qu’il fût tout à fait dépourvu de scrupules, ces méthodes lui répugnaient : il n’aimait pas courir certains risques. Dans cette louche affaire, son rôle s’était borné à étouffer le scandale. Mais quelle allait être son attitude en face des évènements de Russie ? Les exploits des partisans, ces actes de banditisme que les bolcheviks appelaient des expropriations, pouvaient devenir aussi compromettants pour le parti que l’affaire des faux billets, Allait-il accepter sa part de responsabilité dans le « marxisme de grands chemins » des expropriateurs ? Lénine, parfois, avait tout d’un homme prudent, même la prudence. Mieux valait attendre, ne pas se hâter de se compromettre. Les nouvelles qu’il recevait de Russie ne lui inspiraient pas confiance dans l’esprit révolutionnaire des masses. La situation du parti était mauvaise. Peu à peu, un grand découragement avait gagné jusqu’à l’élite de l’émigration. Le moment de reprendre la lutte pour la liberté du peuple russe était encore loin. En attendant, il fallait réorganiser les forces du parti et rallier les esprits.
Pour la première fois de sa vie, Lénine se met au travail avec une nonchalance d’amateur. Pendant que Nadejda Konstantinowna essaie de nouer des rapports avec les chefs des « partisans » de Russie, Wladimir Ilitch parcourt la France autant en touriste qu’en conférencier, visitant un à un tous les noyaux d’émigrés, petites colonies d’étudiants et d’intellectuels russes, nombreuses surtout dans le Midi. Sa parole réveille l’espoir, ranime le courage, fouette les endormis, les poltrons et les opportunistes. Ses railleries, son cynisme, cet air malhonnête qu’il prend toujours quand il parle de ses adversaires, laissent derrière lui tout un sillage de polémiques, dont il s’amuse comme d’un jeu. Lénine, vers la fin de 1910, dans sa quarante et unième année, est insouciant et joyeux comme il ne l’a jamais été, ses yeux brillent, sa voix rauque a des éclats de joie, sa figure, semée de taches de rousseur, prend parfois une expression de moquerie juvénile qui enchante ses auditeurs. Il aime bavarder, son melon sur la nuque, sa tête inclinée sur l’épaule, ses courtes mains appuyées sur la table dans une attitude qui a, tout à la fois, quelque chose de gauche et de familier. Gorki l’appelle à Capri, où il a fondé une école communiste dans le genre du cercle de culture prolétarienne que Lounatcharsky avait ouvert à Paris au numéro 11 de la rue Rolly, juste un étage au-dessus du petit logement de Kamenev. Lénine aussi, en 1909, avait organisé à la rédaction du Prolétaire une école communiste, qu’il devait transférer plus tard à Longjumeau. Ces écoles n’étaient qu’autant de parlotes, où on buvait du thé, où on fumait des centaines de cigarettes, où tout le monde parlait à la fois. En attendant le moment favorable à la reprise de la lutte révolutionnaire, il fallait bien faire quelque chose.
Dans l’île de Capri, au milieu du golfe de Naples, Wladimir Ilitch et Gorki se promènent le long de la route d’Anacapri, ou dans les étroits sentiers qui surplombent la mer, du côté des Faraglioni ou des ruines du palais de Tibère. Lénine regarde les pêcheurs démêler patiemment leurs filets embrouillés et déchirés par un requin. « On travaille plus vite chez nous », dit-il. Et comme Gorki exprime quelque doute à ce sujet, il lui répond non sans dépit : « Hum ! Hum ! est-ce que vous n’oublieriez pas la Russie, à force de vivre en Italie ? » Il reste de longues heures assis sur un rocher, le regard perdu au loin, vers le Vésuve couronné de fumée ou vers le golfe de Salerne et les côtes de Calabre. « Il ne parlait pas italien, raconte Gorki, mais les pêcheurs de Capri, qui avaient vu Chaliapine et pas mal d’autres Russes remarquables, mirent immédiatement Lénine, par un flair miraculeux, à une place particulière. Il avait un rire charmeur et franc. Le vieux pêcheur Giovanni Spadaro disait de lui : – Il n’y a qu’un honnête homme pour rire comme ça. – En se laissant balancer par la barque sur l’eau transparente et bleue comme le ciel, Lénine apprenait à pêcher à la main, sans canne à pêche. Les pêcheurs lui expliquaient qu’il fallait ferrer dès que le doigt sentait trembler la ligne : – Cosi : drin, drin ! capisce ? – Il ferra tout dé suite un poisson, l’amena et s’écria avec l’enthousiasme d’un enfant et l’ardeur d’un joueur : – Ah ! ah ! drin ! drin ! – Les pêcheurs éclatèrent de rire, bruyants et joyeux comme des enfants, eux aussi, et ils le surnommèrent Signor Drin Drin. »
Le soir les émigrés russes de Capri se réunissent autour de Lénine et de Gorki à la pension Weber, à la Piccola Marina, ou bien à côté sur la terrasse d’une modeste villa, aux murs blanchis à la chaux. Des fenêtres de la pension Weber, on voit, cinquante mètres plus bas, le récif des Sirènes. C’est là, à la Trattoria delle Sirene, que Kamenev et Lounatcharsky oublient leurs querelles. Bien qu’ils habitent à Paris la même maison, ils ne se rencontrent et ne se disent bonjour qu’à Capri. « On sait de source sûre, dit Gorki à Lénine, que même les matelots d’Ulysse aimaient le vin de Capri. C’est dans cette Trattoria qu’ils racontaient leurs aventures en buvant ce bon vin blanc en compagnie des Sirènes, femmes de pêcheurs de l’île, à la voix dangereuse. » Wladimir Ilitch, qui ne boit jamais, s’amuse à goûter ce vin doré, au parfum violent. « Heureusement, dit-il, que les marins d’Ulysse ne connaissaient pas Karl Marx : quelle curieuse Odyssée eût été le récit de leurs discussions ! » Lénine aime beaucoup Gorki : il a autant d’admiration pour son talent d’écrivain que de mépris pour son dilettantisme politique. « Ah ! ces artistes ! s’écrie-t-il parfois ; des gens qui s’emballent ! Il est difficile de s’entendre avec eux. » Un témoin nous apprend un trait caractéristique de leurs rapports personnels. « Une fois, à Paris, quand Gorki participa au concert organisé par Véra Figuer au profit des exilés, le groupe bolchevique, qui organisait aussi un concert, décida de s’adresser à Gorki pour lui demander son concours et de se servir, à cet effet, de l’entremise de Lénine. Mais quand il fut mis au courant de ce projet, Lénine réfléchit quelques instants et refusa d’aller parler à Gorki : – Non, non, je n’irai pas. Si je le rencontre, nous nous disputerons certainement et je ne veux pas me disputer avec lui. Je ne lui écrirai pas non plus. Il vaut mieux que quelqu’un aille le trouver de ma part. – Je fus désigné. Après trois jours de recherches inutiles, je découvris enfin Gorki le soir même du concert, dans les couloirs de la salle Wagram. Il tressaillit dès qu’il entendit le nom de Lénine. – Il est là ? demanda-t-il. Non, Wladimir Ilitch n’était pas venu au concert. Gorki comprit sans doute la diplomatie de Lénine, et dit d’un air triste : – Il complique lui-même les choses et puis, il se fâche. Il est incorrigible. – Gorki n’accéda pas à notre demande, en motivant son refus par son prochain départ.
Mais le charme de Capri est tel que le Signor Drin Drin et Gorki en oublient de se quereller. « Hum, hum », toussote Wladimir Ilitch chaque fois que l’écrivain s’égare jusqu’à lui parler politique. Tous les jours, à la fin de l’après-midi, ils vont s’asseoir à la terrasse de la Trattoria delle Sirene, en face des Faraglioni, rochers gigantesques en forme de tour où le soleil couchant allume des reflets d’or et de pourpre. Les journées sont chaudes, l’air est étouffant ; d’ici peu, la brise du soir soufflera sur l’île la fraîcheur du large. Autour de Lénine tout le monde, même Gorki, est habillé à la manière des pêcheurs : un léger chapeau de paille sur la tête, un pantalon retroussé aux genoux, une chemise de coton blanc flottant sur la poitrine. Avec sa jaquette et son chapeau melon, le Signor Drin Drin a l’air un peu comique des bons bourgeois qui viennent sur les plages le dimanche. Il rit, bavarde, raille le « Dieu d’Anatole », dont la principale église est l’école communiste de Capri fondée par Gorki, raconte des anecdotes sur sa lutte avec Martov ; puis, peu à peu, la conversation glisse sur la politique du parti, sur les désaccords au sein du Comité central, sur le rôle des ouvriers et des intellectuels dans la révolution. Tard dans la nuit, ils sont encore là à discuter. Quand Lénine et Gorki rentrent se coucher, l’aube n’est pas loin. Les autres, qui ont depuis longtemps adapté leurs habitudes bohèmes au climat de Capri, campent sur la terrasse, s’allongent au milieu des bouteilles vides, des verres, des piles de journaux, dans la fraîcheur de la nuit marine. C’est ainsi que tous les matins, en ouvrant leur fenêtre, les habitants de la pension Weber aperçoivent sur la terrasse de la petite villa d’à côté des hommes demi-nus couchés sur des tapis, des coussins, des chaises longues, comme des noceurs noyés dans le vin et le sommeil. Cette terrasse on l’appelle encore, de nos jours, « le radeau de la Méduse ».
Lorsque Lénine rentre à Paris, ses camarades l’accueillent par des reproches. C’est le moment de reprendre en mains l’organisation révolutionnaire et de se préparer à la lutte : les nouvelles de Russie ne laissent aucun doute sur l’état d’esprit des masses de travailleurs. À la phase des « expropriations » a succédé l’autre, beaucoup plus intéressante du point de vue marxiste, des grèves partielles, aussi bien à Moscou et à Pétersbourg que dans plusieurs villes de province. La politique de Stolypine, qui tend à créer en Russie des petites propriétés, politique dangereuse dont Lénine redoute les effets, provoque chez les moujiks des réactions inattendues. Des révoltes paysannes éclatent un peu partout dans les districts du Sud. Pendant que le prolétariat russe reprend la lutte, que font les émigrés ? Ils se querellent entre eux. Les agents provocateurs de l’Okhrana n’ont pas de peine à semer la discorde dans leur camp. Il faut en finir une fois pour toutes avec ces dissensions de plus en plus fréquentes au sein du Comité central. « Il y a des mouchards parmi nous », dit Bourtsev. Quel rôle jouent les Jitomirski, les Mirone, les Malinovski ? « Ce n’est pas le moment de faire du scandale », répond Lénine. Son fanatisme « unilatéral, entêté, étroit, formaliste, autocratique » se réveille. Les véritables agents provocateurs, à ses yeux, ce sont les mencheviks. Rien n’empêche Bourtsev d’avoir des soupçons sur le compte des Jitomirski, des Mirone et des Malinovski, mais le leader bolchevique est fixé sur le rôle de Martov, de Plekhanov, de Bogdanov et de leurs partisans. Il faut expulser du parti ces dangereux opportunistes, beaucoup plus redoutables que les mouchards de l’Okhrana. L’assassinat de Stolypine, en septembre 1911, crée en Russie, dans les masses de travailleurs, un état d’esprit que Lénine n’hésite pas à appeler « insurrectionnel » et dont il profite pour reprendre la lutte contre ses ennemis personnels. Sa vieille haine, cette haine méticuleuse et fanatique qui constitue depuis 1903 le seul ressort de son « activité » révolutionnaire, n’attend qu’un prétexte pour se donner libre cours. De Longjumeau, où il s’est installé pendant l’été, Wladimir Ilitch rentre à Paris, l’air inquiet et sombre, réunit les plus fidèles de ses « bactéries », distribue les rôles et les mots d’ordre pour la conférence qu’il a décidé de convoquer à Prague au début de l’année suivante. Les ouvriers de Russie ont repris leur lutte contre le tsarisme : Lénine reprend sa lutte contre Martov et Plekhanov. Il reste fidèle à sa tactique : sa grandeur est faite de petites choses. Les grands buts n’excluent pas les petits moyens.
La conférence bolchevique de Prague, en janvier 1912, achève l’œuvre commencée en 1903 au congrès de Londres. La fraction léniniste se proclame indépendante, se refuse à tout compromis avec les mencheviks, décide de faire paraître à Pétersbourg un journal bolchevique « légal », la Pravda, et de reprendre, seule, l’action révolutionnaire, tant sur le terrain constitutionnel que sur le terrain de la lutte de classe. Martov et Plekhanov poussent les hauts cris, accusent Lénine de trahison : « Affaiblir le parti par une nouvelle scission, juste à la veille d’évènements importants, n’est-ce pas trahir la cause de la liberté du peuple ? » Toute la presse social-démocratique d’Europe se rallie au point de vue des mencheviks : Lénine est un traître et, de plus, un opportuniste qui cache une ambition sans scrupules sous le masque de l’intransigeance. Le 4 avril 1912, dans les mines de la Léna, en Sibérie, une grève est noyée dans le sang. Des centaines d’ouvriers tombent sous les coups de fusil des cosaques. À la nouvelle de ce massacre, toute l’Europe est saisie d’horreur. Une vague d’inquiétude passe sur la Russie. C’est quelques jours après l’affaire des mines de la Léna, le 22 avril, que paraît à Pétersbourg le premier numéro de la Pravda. « Nous sommes prêts », dit Lénine.
Au début de juillet, Wladimir Ilitch décida de s’installer à Cracovie « à quelques coups de pédale de la frontière russe », pour surveiller de près le cours des évènements. « Deux jours avant le départ, raconte un témoin, Nadejda Konstantinowna avait acheté de grandes caisses. Lénine, ayant ôté son veston, triait et rangeait des livres. J’entrai chez eux au moment où il enfonçait les derniers clous et s’apprêtait à descendre ses lourdes caisses. Nous nous y sommes mis à deux, en soufflant, car l’escalier était assez raide. Tout à coup Wladimir Ilitch s’aperçut que nous avions sérieusement éraflé une marche de l’escalier. – Diable ! s’écria-t-il qu’est-ce que je vais prendre de la concierge ! » Le soir, des camarades qui sont au courant du départ de Lénine et de Nadejda Konstantinowna les invitent dans un café du Parc Montsouris. « Il n’y a personne dans le café, en dehors de notre groupe. Le patron a mis pour nous une large table dans la grande salle. Nous sommes assis autour de la table et nous bavardons gaiement. Wladimir Ilitch est dans d’excellentes dispositions. Il s’adresse tout le temps à Antonov-Popov en lui réclamant des anecdotes. Puis il rit aux éclats. On improvise un chœur et Lénine chante avec nous. – Allons-y pour le Volga – propose-t-il. Quelqu’un commence. – Il chante faux, le chef du chœur ! – s’écrie Wladimir Ilitch. Le chœur suit. Lénine, de nouveau, proteste : – Le chœur aussi chante faux ! – Alors nous lui demandons de mener le chœur. Renversé sur le dossier de sa chaise, son veston grand ouvert, il cligne des yeux, sourit d’un air narquois ; – Vous pensez que je ne le ferais pas ? – Il ne le fait pourtant pas. Il chante avec le chœur et dit, de temps en temps : – Ah ! qu’ils chantent faux ! Ils chantent admirablement faux ! – Tout à coup il regarde sa montre et se lève : – Il est temps de rentrer : une heure du matin ! Nous partons demain à l’aube. – Nous sortons ensemble. La nuit est belle, on n’a pas envie de rentrer chez soi. On décide de flâner dans les rues. Lénine et Nadejda Konstantinowna prennent congé de nous et s’éloignent rapidement dans la rue Gazan déserte. Wladimir Ilitch se retourne vers nous et crie : – Veilleurs de nuit, allez dormir ! »
De Cracovie, où Zinoviev et quelques autres de ses collaborateurs les plus dévoués avaient eu vite fait de le rejoindre, Lénine, comme un médecin qui ausculte un malade, tendait une oreille attentive vers la Russie. « En Galicie, écrit Zinoviev, nos liens avec Pétersbourg se fortifièrent. Il nous semblait que nous travaillions dans les bureaux mêmes de la Pravda. » Wladimir Ilitch rédigeait des articles pour le journal du parti, des brochures sur le rôle des paysans dans la révolution, des discours que les députés bolcheviques devaient prononcer à la Douma. Parmi les camarades qui traversaient la frontière pour prendre contact avec Lénine, il y avait Krylenko, Soukharine, Staline, Malinowski. Ce dernier, leader du petit groupe des députés bolchéviques et agent provocateur au service de l’Okhrana, se rendait très souvent à Cracovie pour prendre des mains de Lénine le texte des discours parlementaires, que revoyait et corrigeait, avant qu’ils ne fussent prononcés à la tribune de la Douma, le chef de la police de Pétersbourg, Biélétsky. « Il me faut des preuves », disait Wladimir Ilitch à Bourtsev, qui lui faisait part de ses soupçons sur Malinowski. Ce n’est qu’après le coup d’État d’octobre 1917 que Lénine eut la preuve de la trahison du leader de la fraction bolchevique à la Douma. « Naturellement on l’a fusillé », disait-il avec un sourire contraint. D’aucuns ont affirmé « qu’eût-il connu le double jeu de cet agent provocateur, Lénine n’eût pas nécessairement rompu avec lui. De même qu’il n’hésitait pas à utiliser des hommes de la pire moralité, il se serait au besoin servi de policiers ». Faut-il croire que Lénine a joué lui aussi double jeu dans l’affaire Malinowski ? Il y a dans son caractère un trait fort singulier, qui explique ses naïvetés et son incroyable bonne foi : ce petit bourgeois, d’un fanatisme formaliste et sédentaire, nourri de fiches et de statistiques, ne savait pas juger les hommes. S’il fallait ajouter foi à la plupart de ses biographes, qui nous le peignent malin et rusé dans toutes les circonstances, même dans ses erreurs et dans ses plus naïves faiblesses, son machiavélisme nous serait incompréhensible. En réalité, il n’avait de flair et de méfiance que pour les idées. Il triomphait des hérésies et se faisait rouler par les hérétiques. Ce Gengis-Khan pamphlétaire n’était jamais à la hauteur des hommes ni des évènements.
Pendant l’été, Lénine, et ce qu’il appelait son état-major : sa femme, sa belle-mère, Zinoviev et quelques collaborateurs, se rendaient pour trois mois à la montagne, au Nord-Est de Cracovie, dans les Carpathes. J’ai visité moi-même en 1920, dans le village de Poronin, près de Zakopane, joli pays de montagnards dont les costumes rappellent ceux que Michel-Ange a dessinés pour les Suisses du Pape, la petite maison de paysans d’où Wladimir Ilitch, pendant les deux étés de 1913 et de 1914, « surveillait le cours des évènements ». On a prétendu que Lénine passait ses journées à guetter du haut des Carpathes l’approche de la révolution, et à lire l’avenir du peuple russe, comme on lit dans les lignes de la main, dans la plaine immense qui s’étendait à ses pieds jusqu’aux monts Oural. En réalité, cette sorte de Zarathoustra menait à Zakopane une vie bien plus paisible que cela. Il n’avait pas l’air de quelqu’un qui, d’un instant à l’autre, va descendre du sommet d’une montagne pour aller conquérir un royaume interdit. Sans doute la révolution approchait-elle de plus en plus : mais, ne pouvant pas aller à sa rencontre, il l’attendait. Le pays était beau, le temps splendide, les journées s’écoulaient heureuses et calmes. Il n’avait jamais été si peu préoccupé de l’avenir et si peu soucieux du présent. Comme n’importe quel bon bourgeois de n’importe quel pays d’Europe au début de l’été de 1914, Lénine traversait une période d’optimisme dont la candeur eût charmé le Rousseau de la Nouvelle Héloïse. Il se promenait toute la journée dans les montagnes de Zakopane, sac au dos, les poches bourrées de journaux, en compagnie de Nadejda Konstantinowna. Un joyeux sourire éclairait sa figure bronzée par le soleil. À la fin de l’après-midi, assis devant la porte de sa petite maison de paysans, il jouait aux échecs et s’entretenait gaîment avec sa belle-mère et Zinoviev : « Dans le Vorwœrts, j’ai lu que Kautsky... » Mais Kautsky était loin, bien loin, et les journaux étaient si peu intéressants.
À la fin de juillet 1914, la nouvelle de la guerre éclata comme un coup de gong dans le village de Zakopane. Arrêtés par la police autrichienne comme sujets ennemis, et enfermés dans la prison de Nowy-Targ, Lénine et Zinoviev ne furent délivrés quinze jours plus tard que pour être accompagnés à la frontière suisse. Ceux qui approchèrent Wladimir Ilitch à son arrivée à Berne, ne pouvaient pas reconnaître dans cet homme voûté, au visage pâle, aux yeux apeurés, aux mains tremblantes, le leader bolchévique de Genève, de Londres et de Paris, aux gestes vifs ; au rire strident. Lénine n’avait pas prévu la guerre. Jusqu’au dernier moment, c’est Zinoviev lui-même qui le raconte, il avait gardé confiance en la social-démocratie allemande et en la deuxième Internationale. Mais l’Europe bourgeoise agonisait dans la grande fièvre d’août 1914 et la deuxième Internationale était morte. « Beaucoup de ses camarades, écrit Zinoviev, étaient frappés du changement que la guerre avait produit en lui. L’expression même de son visage s’était transformée. » Fini, le rêve de la solidarité internationale du prolétariat, fini, le rêve révolutionnaire. Au mot d’ordre lancé par le capitalisme bourgeois, l’Europe prolétarienne avait marché au massacre : les drapeaux rouges de l’Internationale avaient salué au passage les fifres des empereurs. Comme en 1902 et en 1905, « que faire » ? se demandait Lénine. Bloqué dans cette paisible Suisse comme dans une île, Wladimir Ilitch devint le Robinson Crusoë du marxisme révolutionnaire.
Plekhanov et ses disciples s’étaient rangés du côté du patriotisme bourgeois et proclamaient la nécessité de mener la guerre « jusqu’au bout » pour la liberté démocratique de l’Europe. Le club ouvrier de la rue de la Reine Blanche, à Paris, s’était transformé en bureau de recrutement pour les émigrés, sous la direction d’Antonov-Ovseïenko, le futur chef d’état-major de Trotsky dans le coup d’État d’octobre 1917. Parmi les volontaires russes qui reniaient le marxisme pour aller combattre « leurs frères d’Allemagne », il n’y avait pas seulement des mencheviks : il y avait aussi des léninistes comme Antonov-Popov, Kousnetzov, M. Davidov, Ilia Djaparidsé, les meilleurs, peut-être, de ces révolutionnaires professionnels, de ces bactéries de la révolution, qui suivaient Lénine depuis 1903 et qui l’abandonnaient maintenant « pour répondre à l’appel de la patrie ». Le jour du départ des volontaires, Plekhanov, le lâche Plekhanov, avait composé un discours éloquent et ignoble : « Je vous envie, je voudrais être avec vous. Soyez de bons soldats disciplinés, faites bien votre service, donnez l’exemple ! » Abandonné de tous, Lénine se mit à combattre, tout seul, contre la guerre au nom du « défaitisme intégral ». Pas plus que le sens humain, trop humain du « sermon sur la montagne » de Romain Rolland, presque personne en Europe ne comprenait le sens des sombres prophéties de ce Robinson Crusoë, qui s’acharnait à se construire une cabane avec les débris d’un voilier, dans un îlot battu des flots.
En Russie, le journal du parti, la Pravda, est supprimé. Les députés bolcheviques à la Douma viennent d’être condamnés à la déportation perpétuelle en Sibérie. Des forêts du Nord, des plaines de l’Est, du fond de l’Asie, des masses de paysans surgissent au roulement des tambours. Le tam-tam de la guerre retentit au cœur de l’Europe. Kropotkine lui-même suit l’exemple des Plekhanov, des Kautsky, des Vandervelde, des Guesde. Tout le monde trahit. Le patriotisme, « cette peste noire », se manifeste par des tumeurs au cerveau. Cette étrange maladie prend surtout les hommes de gauche, les marxistes, les internationalistes : beaucoup en meurent. D’autres survivent : ce sont les renégats. Il n’y a rien de mieux que les renégats pour faire de bons patriotes. Seul Lénine demeure indemne au milieu des pestiférés. Il oppose à la peste noire du patriotisme la peste rouge du défaitisme intégral. C’est là que se révèle, pour la première fois, ce qu’il y a d’héroïque dans son fanatisme « étroit, formaliste, entêté ». Ce petit bourgeois timide et violent, qui hurle d’une voix rauque son horreur du sang se révolte moins contre ceux qui ont trahi la paix de l’Europe que contre ceux qui ont trahi la révolution. En réalité, il ne se bat que pour défendre ses idées, ses doctrines habituelles et ses habitudes doctrinaires. Autour de lui, tout s’écroule : il ne pense qu’à arracher ses petits papiers des mains des renégats. Tel un bibliothécaire ne pensant qu’à sauver ses fiches au milieu d’un incendie, Lénine au milieu de cette Europe qui s’effondre ne se soucie que de sauver « l’idée de la révolution. » Le reste, peu lui importe.
Il n’est plus seul, à présent. Zinoviev, Radek, Bronsky, Munzenberg, ont rejoint dans son île ce Robinson Crusoë. À Paris, « Monsieur » Trotsky mène le combat pour son compte, mais se rallie de plus en plus au défaitisme intégral de Lénine. Les renégats, écrit Wladimir Ilitch, savent très bien « qu’on doit comparer la révolution à un accouchement. Mais, lorsque le moment d’agir est venu, ils reculent. La naissance de l’homme a toujours été liée pourtant à un acte sanglant. Et, douloureux ou non, il faudra bien que l’accouchement se fasse ». Cette idée de « l’acte sanglant » Lénine la reprend lors des conférences de Zimmerwald (septembre 1915) et de Kienthal (avril 1916). Combien d’opportunistes, pourtant, parmi ces accoucheurs ! Les adversaires de Lénine, nous dit Guilbeaux, lui reprochaient vivement son radicalisme et ses excès. À les entendre, Wladimir Ilitch était un intellectuel anarchiste et ne comprenait pas les masses. Robert Grimm, président de la conférence de Zimmerwald, disait à Lénine et à Radek : « Ah ! je vous envie de vivre dans les montagnes et de pouvoir lire, étudier et travailler à l’aise et dans le calme. Vous avez à faite avec des livres : moi, j’ai à faire avec les ouvriers. » Tous ces défaitistes français, allemands, suisses, italiens, n’osent pas se poser le problème de la révolution. « Alors, je ne comprends pas, s’écrie Lénine, pour quelle raison vous êtes ici. » En réalité, ils ne sont pas venus à Zimmerwald pour se mettre d’accord sur l’attitude à prendre à l’égard de la guerre : Toute discussion est inutile sur ce point-là. Ne sont-ils pas tous contraires à la guerre, en principe ? Quelle est donc leur attitude, dans la pratique ? Ils ne veulent pas se compromettre dans une aventure dangereuse. Leur pacifisme est tout aussi sincère que leur prudence et leur opportunisme. Il est clair qu’ils ne sont venus à Zimmerwald que pour exprimer dans un langage vague et mesuré leur ferme décision de ne pas se départir d’une ligné de conduite qu’ils jugent la seule capable de conserver à la social-démocratie d’Europe sa dignité, son prestige et son rôle révolutionnaire. « Il faut saboter la guerre pi tous les moyens, s’écrie Lénine, par les grèves, les révoltes, et les mutineries. Notre guerre à nous, c’est la guerre civile, c’est la révolution. » Le député italien Serrati cache ses mains dans sa barbe, d’un air effaré Merrheim et Brizon éclatent de rire. « Vous qui êtes en Suisse, crie Georges Ledebour à Lénine, il vous est commode de faire appel à la révolution. Je voudrais bien voir ce que vous feriez si vous étiez en France ou en Russie. »
Wladimir Ilitch n’a jamais été aussi seul qu’à Zimmerwald. Il a maigri ; son visage est pâle, sa mise peu soignée trahit l’inquiétude de son esprit, cette fièvre qui, depuis quelques mois, lui donne chaque jour la migraine. Avec sa voix cassante, où perce un profond mépris de ces opportunistes chez qui l’opposition à la guerre n’est qu’une forme de prudence, il bafoue le « défaitisme bourgeois » des Grimm, des Serrati, des Rakowsky, des Brizon, des Ledebour. Ses paroles dures, ses brusques interruptions, son rire guttural coupant à chaque instant la parole à ses adversaires, provoquent des incidents que Robert Grimm, en sa qualité de président de la conférence « blâme de tout son cœur ». Les esprits s’échauffent. « Je me souviens, raconte Zinoviev, que le bouillant Rakowsky retroussait presque ses manches pour se colleter avec Lénine et moi, parce que nous déclarions que Martov était un agent de la bourgeoisie. » Le rôle que Plekhanov avait joué au congrès de Londres à l’égard de Wladimir Ilitch, c’est au tour de Trotsky de le jouer à Zimmerwald. Bien qu’il n’appartienne pas formellement à l’extrême gauche, représentée par le petit groupe bolchevique, Trotsky se range du côté de Lénine. C’est lui qui rédige le fameux manifeste de Zimmerwald. Son attitude calme les esprits, apaise les contrastes. Vers la fin de la conférence, Lénine change de tactique : il mesure ses paroles, surveille ses gestes. Le dernier jour, qui était le 8 septembre, la commission chargée d’élaborer le manifeste se réunit en plein air, autour d’une table ronde, dans le jardin de l’hôtel. Wladimir Ilitch, alerte et souriant, fait montre de bonne humeur, ce qui rassure les autres membres de la commission. Il y avait non loin de là, sous un robinet, une grande cuve remplie d’eau. C’est de Trotsky que nous tenons ces détails. « Un peu avant la réunion qui eut lieu le matin de bonne heure, plusieurs délégués étaient venus se laver à ce robinet. J’avais vu Fritz Platten plonger sa tête et son corps dans l’eau, comme s’il voulait se noyer, au grand ébahissement de tout le monde. » Lénine rit avec les autres, en rejetant la tête en arrière et en se tapant sur les genoux. Décidément, ce matin, il n’a pas l’air batailleur : on peut se fier à lui, tout ira bien.
Toutefois, à un certain moment, les travaux de la commission prennent un tour dangereux. « Il y avait des frictions, raconte Trotsky, entre Lénine et la majorité. Survinrent alors deux beaux chiens. Ils appartenaient sans doute au propriétaire de l’hôtel, car ils se mirent à jouer tranquillement sur le sable, sous le soleil matinal. Wladimir Ilitch, brusquement, quitta sa chaise, se mit à genoux, et commença à chatouiller en riant les deux chiens sous le ventre, avec des gestes légers, délicats, attentifs. On eût dit qu’il se conduisait comme un gamin : son rire était insouciant et puéril. On le regardait avec un certain étonnement ; chacun était préoccupé par le tour qu’avait pris la discussion ; Lénine cajola encore les deux chiens, mais avec plus de calme, puis revint vers la table et déclara qu’il ne signerait pas un pareil manifeste. La querelle reprit avec une nouvelle violence. Il est très possible que cette diversion lui ait été nécessaire pour résumer dans sa pensée les motifs d’acceptation ou de refus du manifeste, et pour prendre une décision. »
En avril 1916, à la conférence de Kienthal, le violent cynisme de ses propos jette le désarroi parmi les délégués des différents pays. « Trois Français seulement, écrit Pierre Lafue, paraissent à Kienthal, que Lénine abasourdit aussitôt par la violence de ses paroles. Il leur demande s’ils sont prêts à prendre le pouvoir dans leur pays, et à préparer immédiatement l’insurrection. Ces petits bourgeois de province s’effraient d’abord de tant d’audace. Puis, devant la furieuse logique du forcené, ils donnent une adhésion hâtive à ses thèses, et s’éclipsent. Tandis que la social-démocratie le traite d’aliéné, tandis que Plekhanov appelle sa théorie de la révolution universelle une folie burlesque, Lénine continue plus que jamais à excommunier tous ceux qui ne pensent pas comme lui. » Mais quelque temps après Kienthal, sa fièvre tombe, son inquiétude s’apaise. « Il arrive très souvent, remarque Trotsky, que le fil de l’histoire se casse : il faut alors le renouer. C’est ce qu’on a fait à Zimmerwald. » Il casse encore entre les doigts de Lénine, tout de suite après la conférence de Kienthal. « Que faire ? » se dit-il. « Je n’ai rien à faire qu’à lire, écrire et attendre, déclare Wladimir Ilitch à Pierre Lafue, qui est allé le voir à Lausanne : chaque chose vient à son heure. On ne peut pas forcer un évènement. Il suffit d’en profiter lorsqu’il se produit. » Sa théorie de la révolution tient toute dans ces paroles.
Désormais il attend. La vie qu’il mène à Lausanne est celle d’un petit fonctionnaire retraité, mesurant la fuite du temps par les feuilles du calendrier. Pierre Lafue nous trace un portrait fort caractéristique de ce « petit homme d’aspect bourgeois, assez semblable à quelque rond-de-cuir d’un des bureaux voisins du département de justice » qui se promène fréquemment sur la petite place du château de Lausanne. « À peine levé, il courait d’ordinaire au marché de la place de Rumine et remontait allègrement dans la ville haute, avec son panier plein. Le reste de la matinée et le début de l’après-midi, il les passait à lire et à écrire. On pouvait l’apercevoir, par la fenêtre toujours ouverte, courbé sur sa table. Vers quatre heures, il descendait sans bruit, et, comme un bon bourgeois du quartier, s’en allait à travers les rues en pente, un gros parapluie sous le bras. » On se souvient encore de lui à la Bibliothèque universitaire. Il lit beaucoup : l’Histoire de la Révolution Française, par Aulard, l’Histoire de la Commune, par Lefrançais, les œuvres de Maupassant, des manuels de tactique militaire. De temps en temps, il part pour la montagne, sac au dos, suivi de Nadejda Konstantinowna qui souffle et s’arrête à chaque pas. Plus tard, au Kremlin, le souvenir de ces excursions dans les Alpes reviendra souvent dans sa conversation : ses yeux se tourneront alors vers la fenêtre, vers les coupoles dorées masquant, au loin, les lignes harmonieuses d’une colline, le Mont-des-Moineaux, les Vorobiowy Gory.
À la fin de l’année, Lénine s’installa à Zurich, dans une modeste chambre de la Spiegelgasse, chez un cordonnier. Il suivait assidûment les réunions ouvrières, nous dit un témoin, et prenait part aux travaux des congrès du parti socialiste suisse. Il ne faisait que lire et annoter des journaux, des revues, des livres. En attendant la révolution, il demeurait fidèle à son rôle de scribe. Il traversait parfois de véritables crises de dépression nerveuse : pâle, la barbe en broussaille, débraillé, malpropre, il fuyait alors la compagnie des émigrés et s’enfermait des journées entières, les coudes sur sa table de travail, la tête entre les mains, les yeux fermés. Il restait toute la journée à somnoler ainsi. Le soir, il semblait s’éveiller, et riait à tout instant de son rire guttural, en marquant d’un trait de crayon les nouvelles contradictoires des journaux allemands et français. Il sortait de ces crises périodiques plus dégoûté que jamais du pessimisme opportuniste de la grande majorité des émigrés. « Tous attendent la paix, disait-il : moi, c’est la révolution que j’attends. » Dans les cafés et dans les restaurants de Zurich fréquentés par les Russes, Lénine ne faisait que de rares apparitions. Leurs éternels débats, leurs interminables bavardages le jetaient dans une fureur froide à laquelle il ne donnait d’autre expression que des hum, hum, gutturaux et des éclats de rire. À quoi bon discuter ? Au début de 1917, seuls des renégats pouvaient avoir intérêt à fomenter des discussions. Wladimir Ilitch, lui, avait renoncé depuis bien longtemps à suivre la logique des évènements. D’autre part, il n’y avait plus de « logique des évènements ». Toute discussion était dangereuse, puisqu’elle ouvrait la voie au doute et à l’opportunisme. Le rôle, ou pour mieux dire, le devoir de tout vrai révolutionnaire, c’était de savoir attendre. Tout son fanatisme tenait dans ce mot : « attendre ». Sa foi dans la révolution qui terminerait la guerre était inébranlable. Lloyd George dira plus tard qu’au début de 1917 il n’y avait en Europe que deux hommes qui voyaient juste : Clemenceau et Lénine. Des deux, le « monstre », le Gengis-Khan, le chef d’une volonté de fer, prêt à tout oser pour atteindre son but, pour plier les évènements à la monstrueuse moralité de sa logique, c’était Clemenceau. Lénine n’était qu’un bonhomme de mœurs simples et modestes, au fanatisme étroit, entêté, chicanier, un petit bourgeois qui savait attendre.
Au début de mars 1917, quand la révolution éclate en Russie, Wladimir Ilitch sort de chez lui sans chapeau, suivi de Nadejda Konstantinowna rouge et essoufflée, court les cafés et les restaurants de Zurich en quête de nouvelles, « et embrasse tous ceux qu’il rencontre ». Les émigrés rient et chantent, les larmes aux yeux. Les femmes sanglotent. On trouve le soir, sur les quais, de vieux révolutionnaires de la génération de Plekhanov qui pleurent assis sur des bancs, au bord du lac brumeux, Lénine aussi chante, de sa voix enrouée, sa forte main aux veines saillantes posée sur l’épaule de Nadejda Konstantinowna. Ce n’est plus la main blanche et grassouillette du jeune clerc d’avoué que l’ingénieur Krassine présentait en 1893 à l’ouvrier Chelgounov : quand la révolution du mois de mars 1917 éclate à Petrograd, le leader bolchevique est un homme de quarante-sept ans, l’air fatigué, le visage pâle, les yeux ternes, légèrement voûté. Un certain embonpoint fait disparaître sa nuque et semble raccourcir ses jambes. Autour de lui, tout le monde crie, boit et s’embrasse. Il faut partir tout de suite, il faut rentrer en Russie. Mais la Suisse est une île paisible au milieu d’une mer houleuse. Pour gagner la Suède et, de là, la Russie, il faut négocier avec l’Allemagne. Tous les mencheviks, sauf Martov, s’opposent à ce projet, qu’ils qualifient de trahison. On se réunit, on discute, on se sépare sans avoir rien décidé. « Une trahison ? dit Lénine en riant : il n’arrive pas tous les jours de pouvoir trahir la bourgeoisie. Je saisis l’occasion. » C’est le camarade suisse Fritz Platten qui se charge de négocier, avec la légation d’Allemagne à Berne, le retour en Russie des émigrés bolcheviques.
Pendant les négociations, Wladimir Ilitch s’enferme dans son petit logement de la Spiegelgasse et, tandis que ses camarades organisent des réunions dans les cafés de Zurich, tandis qu’à Genève et à Berne Lounatcharsky et Angelica Balabanova prononcent des discours dans des meetings, tandis que les mencheviks envoient des télégrammes à Kerensky, il attend l’heure du départ en lisant les travaux de stratégie de Clausewitz et les considérations de Marx sur la Commune de Paris. Comme Jacob au pied de l’échelle, il voit des anges monter dans le ciel rouge : les anges, ce sont les Kerensky, les Milioukov, les révolutionnaires bourgeois du gouvernement provisoire. Lénine penche la tête sur l’épaule, cligne des yeux, allonge les bras comme s’il voulait étreindre quelque chose. Il faut ébranler l’échelle faire tomber ces anges bourgeois, ces opportunistes de la révolution. Il sent que son heure est venue : c’est le moment ou jamais. Comme Jacob, il se prépare à lutter contre les anges. Demain peut-être va-t-il partir pour la Russie : il prendra sa casquette, fermera sa porte et s’en ira tout simplement, les mains dans les poches, comme en 1905. La mère de Nadejda Konstantinowna racontait qu’en 1905 Wladimir Ilitch « avait pris son chapeau et était sorti comme tous les jours, en lui disant qu’il allait revenir tout de suite. » Il était parti pour Pétersbourg sans même lui dire adieu, n’emportant qu’une serviette avec des papiers, des journaux, quelques mouchoirs et deux chemises. En attendant l’heure du départ, Lénine se dispose à gravir l’échelle, lui aussi. Il range ses livres, ses coupures de journaux, ses cahiers, ses papiers. Tous ces petits papiers, c’est la révolution, sa révolution. Il emportera avec lui des chemises, des mouchoirs, les ouvrages de Clausewitz, ses cahiers remplis de notes, ses fiches et ses statistiques. Le moment est enfin venu où il va pouvoir classer dans ses fiches tous les hommes et tous les évènements de l’histoire de Russie.
Le 6 avril les négociations de Fritz Platten avec les autorités allemandes aboutissent à la signature d’un accord fixant les conditions du passage des bolcheviks à travers l’Allemagne. « Le droit d’extra-territorialité est reconnu au wagon qui transportera les révolutionnaires russes de la frontière suisse à la frontière suédoise. Aucun contrôle ne pourra être exercé sur les bolcheviks, sur leurs passeports ou sur leurs bagages, ni à l’entrée en Allemagne, ni à la sortie. Aucun d’entre eux ne devra quitter le wagon au cours du voyage. » Le départ est fixé au 8 avril. Lénine est prêt, tous ses « petits papiers » sont en ordre. Il quitte Zurich, se rend à Berne, dirige personnellement, sur place, les derniers préparatifs : formaliste, prudent, méticuleux, il dresse la liste des bolcheviks qui partiront avec lui. Pâle, nerveux, l’œil égaré, il s’enferme le soir dans une chambre de la Volkshaus. Comme chaque fois qu’il est à la veille de s’engager sur le terrain de l’action, de se mêler aux évènements, le doute et le scrupule s’emparent de ce révolutionnaire professionnel, dépourvu de préjugés, mais plein de prudence. Ne vaudrait-il pas mieux attendre ? Ce voyage à travers l’Allemagne, sous la protection des baïonnettes prussiennes, commence à lui paraître aussi dangereux que ridicule. Certes, les Allemands n’ont pas tort : pour transporter les « bactéries de la peste rouge », le wagon plombé est de rigueur. Mais que va-t-on dire de lui en France et en Angleterre ? Que va-t-on dire en Russie ? On ne pourra pas dire qu’il est un traître : il n’a trahi personne, mais on l’accusera d’avoir été payé par l’Allemagne. Traître et vendu, « sottises » ! Les ouvriers russes, non plus que les travailleurs des autres pays, ne croiront pas un seul mot de toutes ces stupides calomnies. La France... l’Angleterre... Ce n’est pas à l’opinion publique de l’Europe bourgeoise qu’il doit rendre compte de ses actes, Le mieux serait, tout de même, de se faire accompagner dans ce voyage par des hommes au-dessus de tout préjugé et de tout soupçon, fût-ce des « pacifistes bourgeois ». Nul n’oserait mettre en doute la « moralité » du wagon plombé.
Le soir même, il envoie à Genève, à l’adresse d’Henri Guilbeaux, le seul Français qui jouisse de son estime et de sa confiance, cet étonnant télégramme : « Partons demain midi Allemagne. Platten accompagne train. Prière venir immédiatement. Couvrirons frais. Amenez Romain Rolland s’il est d’accord en principe. Faites possible pour amener Naine et Graber. Télégraphiez Volkshaus. Oulianov. » Naine et Graber, députés socialistes de la Suisse romande, qui avaient montré quelque sympathie pour le défaitisme intégral de Lénine, n’étaient pas hommes à compromettre leur situation parlementaire par un geste qu’on eût difficilement compris. « Quant à Romain Rolland, raconte Henri Guilbeaux, Lénine l’estimait comme homme et comme écrivain. D’autre part, dans une brochure écrite en collaboration avec Zinoviev, les Socialistes et la Guerre, il avait affirmé que, sans abandonner leur programme, les révolutionnaires peuvent et doivent, dans certaines circonstances, s’allier aux pacifistes bourgeois et les utiliser. » Bien qu’au-dessus de la mêlée, l’auteur de Jean Christophe n’est pas assez exempt de préjugés pour accompagner dans son voyage le leader bolchevique. Il n’osera même pas aller le saluer à la gare de Berne. « J’allai voir à l’hôtel Beauséjour Romain Rolland, qui devait bientôt quitter Genève et s’installer à Villeneuve, écrit Henri Guilbeaux : je lui confiai que j’étais mandé par Lénine, et lui dis pourquoi. Dès les premiers mots, Romain Rolland, m’arrêta : – Exhortez vivement vos amis, me dit-il, à ne pas passer par l’Allemagne. Sans cela, quel tort ils feront au pacifisme et à eux-mêmes ! Rappelez-vous ce qu’on a dit et écrit jadis des communards. – J’estimai inutile de remplir la mission dont j’étais chargé auprès de lui. Nous parlâmes de différentes choses et je partis. J’étais, je l’avoue, peiné et déçu. »
La tête à la portière, en gare de Berne, Lénine laisse errer son regard sur la petite foule groupée sur le quai. Derrière son dos, dans l’étroit couloir, Nadejda Konstantinowna s’entretient avec la femme de Zinoviev ; des enfants pleurent ; dans le compartiment d’à côté un chien aboie ; Radek debout sur le marchepied du wagon, fait l’appel des partants ; tous sont là, hommes, femmes, enfants, une trentaine environ, avec leurs valises de toile déchirée, leurs paquets ficelés, leurs paniers de provisions, leurs parapluies, tout le pittoresque bazar qui depuis des années suit les émigrés russes, d’étape en étape, dans leurs pérégrinations à travers l’Europe. Très pâle, le front emperlé de sueur, sa casquette à la main, Lénine cligne des yeux, penche la tête sur l’épaule. L’heure est triste : on part. Les employés ferment les portières. Parmi le petit groupe d’amis qui sont venus le saluer à la gare, Wladimir Ilitch cherche en vain celui qui lui aurait donné la force de partir sans tristesse : Romain Rolland n’est pas là. Qu’importe ? Il est trop tard. Il faut partir. Le train s’ébranle doucement, dans un silence étrange. Sur le quai, des mains s’agitent, des larmes coulent sur les visages. Lénine se penche à la portière, serrant sa casquette dans son poing crispé. Très ému, il porte trois fois la main à son front, cherchant cette casquette sur sa tête nue. Son geste est si distrait, si nerveux, qu’il s’égratigne avec les ongles. Derrière lui, le petit garçon de Zinoviev sanglote, le chien aboie, Radek rit bruyamment. Adieu Europe, vieille canaille.
VII
UNE PERRUQUE DANS LA FORÊT
LE soir même de son arrivée à Petrograd, le 16 avril 1917, quelques heures après sa réception triomphale à la gare de Finlande, dans l’hôtel particulier de la danseuse Kchessinskaia, ancienne maîtresse du dernier tsar, Lénine prononça un discours si violemment défaitiste qu’une partie des bolcheviks mêmes l’accueillirent par des clameurs et des risées. « J’étais comme assommé. C’était comme si l’on m’avait donné un coup sur la tête avec une barre de fer », raconte Soukanov. « Il est fou », écrit Plekhanov. « C’est un discours traduit de l’allemand », ricanaient les mencheviks. Dès la gare de Finlande, les paroles de Lénine avaient produit une pénible impression aux marins de Cronstadt alignés sur le quai pour lui rendre les honneurs. Tous étaient déçus, indignés. Quelques jours plus tard, ces mêmes matelots de Cronstadt exprimaient dans une adresse publique « leur profond regret d’avoir participé à la réception solennelle qui avait été faite à Lénine lors de son arrivée à Petrograd ». Les jacobins de la flotte de la Baltique, ainsi que la presse favorable à Kerensky, l’accusaient ouvertement d’être au service de l’Allemagne. « Qu’importe ? » disait Lénine en souriant. Assis devant une table encombrée de journaux, dans une pièce du premier étage de l’hôtel de la Kchessinskaia, les mains croisées sur le ventre et la tête rejetée en arrière, il fixait Kamenev de ses yeux mi-clos, un sourire narquois sur ses lèvres pâles. La prudence de ses camarades l’étonnait profondément. Que Kamenev se montrât préoccupé de ce qu’il appelait « les gaffes » de Wladimir Ilitch, c’était tout à fait naturel. Mais les autres ? De quoi avaient-ils peur ? N’était-il pas trop tard, ou trop tôt, pour avoir des scrupules ? Le moment était venu de saisir à la gorge « cette sale révolution bourgeoise » qui grisait les masses par le mirage de la liberté, de l’égalité et de la fraternité, vieux mots éloquents et faciles que Kerensky venait de traduire en russe, du français de Mirabeau et de Poincaré. Il fallait balayer sans pitié tous ceux qui parlaient de liberté et de démocratie. Dans la révolution, il n’y avait qu’un problème : la dictature du prolétariat. « Notre tâche immédiate, disait Lénine à Kamenev, c’est de combattre par tous les moyens la liberté et la démocratie. »
Le bon Kamenev a employé toute sa vie à apprendre par cœur le Capital de Marx. Il ne peut comprendre la logique hallucinée de ce fanatique sédentaire, qui s’imagine pouvoir soumettre à sa volonté abstraite, « du fond de son cabinet », le cours des évènements. Kamenev n’est pas un homme d’action. Avec ses yeux myopes, poissons morts derrière le verre d’un aquarium, sa barbe soigneusement émondée aux ciseaux comme les bordures de buis d’un jardin à la française, ses mains gonflées par la paresse, la lecture et la prudence, il suffit de le regarder pour comprendre que ce professeur marxiste pleure dans son cœur ses paisibles années d’exil, le doux climat de Genève, le ciel gris de l’Île-de-France. Pour rentrer en Russie, il n’a pas choisi la bonne saison. Au milieu de la foule de déserteurs qui remplit les rues de Petrograd, il se sent bien petit, bien faible, bien ridicule. Que diable vient-il faire en cette galère ? Pour la première fois de sa vie, les paroles de Karl Marx lui semblent douces aux lèvres comme un fruit défendu. Debout devant Lénine qui le regarde en souriant, Kamenev se sent toutefois suffisamment fort pour lui conseiller la prudence. Il sait très bien que Wladimir Ilitch non plus n’est pas un homme d’action, qu’il est trop près des évènements pour les juger et les dominer. Au fond, il n’y a pas grande différence entre Kamenev et Lénine, entre ce professeur plein de scrupules et ce petit bourgeois fanatique. Ce qui fait la force de Lénine, c’est son fanatisme violent, têtu, dogmatique et méticuleux. Mais il y a bien des moments où le fanatisme de Lénine se détend comme une voile à la tombée du vent. Il devient alors, tout comme Kamenev, un petit bourgeois sans ressources et sans confiance en l’avenir.
Dans les yeux morts de Kamenev une faible clarté passe comme un nuage. Comme toujours, Wladimir Ilitch ne sait pas « faire le point ». Comment peut-il parler d’une dictature du prolétariat ? Ne s’aperçoit-il pas que son heure n’est pas celle du méridien de Petrograd ? Pour imposer au peuple russe la dictature du prolétariat, il lui faut renverser le gouvernement de Kerensky, s’emparer de l’État. Le moment n’est pas favorable aux aventures dangereuses. On ne fait pas un coup d’État avec des articles, des fiches et des statistiques. Il faut une armée révolutionnaire. Où sont ses partisans, ses « professionnels », ses « bactéries » ? Ils sont noyés dans la foule, perdus au milieu de cette multitude de déserteurs qui campent dans les rues de Petrograd en attendant l’heure du saccage. « Mon heure », dit Lénine. Oui : mais il faut l’attendre. La marée ramènera toutes les épaves de la révolution. On peut toujours fonder une dictature sur les épaves d’une révolution. Pour être à même de profiter du bon moment, il faut savoir rester fidèle au marxisme. C’est alors que Lénine rappelle à Kamenev un passage de Faust : « La théorie est sèche, mon ami, mais l’arbre de la vie est éternellement vert. » Un disciple de Marx doit « tenir compte de la réalité, et non se cramponner à la théorie d’hier ». Il n’y a qu’une manière de tenir compte de la réalité, insiste Kamenev : c’est de rester fidèle aux lois fondamentales de la lutte de classe. « La dictature du prolétariat, affirme Lénine, n’est pas la fin de la lutte de classe, mais sa continuation sous des formes nouvelles. C’est la lutte de classe du prolétariat victorieux contre la bourgeoisie dépossédée, vaincue, mais disposée à résister encore, prête à réagir. » Cela ne se trouve pas chez Marx, objecte timidement Kamenev. « La dictature des ouvriers et des paysans, réplique Lénine, est une parole dure, sanglante, qui signifie la lutte mortelle entre deux classes, deux mondes, deux époques de l’histoire universelle. C’est un pouvoir inflexible, audacieux, illimité, qui s’appuie directement sur la violence, et non sur la loi. »
Kamenev, tout en jugeant les évènements en marxiste, n’oublie pas « de faire le point » de la situation politique : il est effrayé des projets violents de Wladimir Ilitch. Bien qu’il ait l’habitude d’avoir tort, il s’aperçoit, cette fois-ci, qu’il a la raison pour lui. Avec ses discours et ses projets « d’homme de cabinet (comme écrit Pierre Lafue) qui n’a pas éprouvé, en construisant son système, la résistance du réel », Lénine risque d’être abandonné même par ses partisans. On l’accuse déjà ouvertement de compromettre, par son incompréhension des évènements, la situation politique du parti et son rôle d’avant-garde dans la révolution prolétarienne. Quatre jours après son arrivée à Petrograd, quand Wladimir Ilitch publie dans la Pravda ses fameuses « thèses » défaitistes, et lance le mot d’ordre Tout le pouvoir aux Soviets, ses plus fidèles camarades s’indignent de son défaitisme à outrance et de sa « mauvaise foi ». Une note de Kamenev, parue dans la Pravda, déclare que les « thèses » de Lénine sont loin de représenter l’opinion du parti. Livide, les yeux égarés, la mâchoire serrée, Wladimir Ilitch commence à se rendre compte qu’on ne fait pas une révolution avec des « petits papiers ». Tous les visages, autour de lui, expriment la stupeur et l’indignation. Des marins de Cronstadt brûlent dans la rue les numéros de la Pravda. Tout le monde le lâche. Seule Mme Kollontaï, cette Amazone au sein prospère, à gorge de colombe, ose défendre ses « thèses » contre la prudence et les scrupules des opportunistes. Lénine, « le traître, le vendu, l’agent du Kaiser », se rend compte que Karl Marx, au fond, était un homme prudent, un révolutionnaire du genre de Kerensky. « Il délire », dit Bogdanov. « On ne peut pas tout de même, ajoute Kamenev, trahir Marx pour suivre Lénine. »
Marx ou Lénine ? Ce dilemme est à l’origine d’une polémique qui va du congrès de Londres, en 1903, jusqu’à nos jours. Plekhanov, Martov, Kautsky et, plus tard, un peu avant 1914, les Adler, les Pannekobck, les Gorter, veulent rester marxistes, simplement marxistes. Ils récusent Lénine au nom de Karl Marx. Après le coup d’État d’octobre 1917, toute la social-démocratie d’Europe rejette la thèse officielle du léninisme : qu’il ne peut désormais y avoir de marxisme sans Lénine, que Marx sans Lénine n’est plus Marx, que le léninisme est le développement et l’adaptation du marxisme à la vie économique et sociale contemporaine. Adler, et les fauteurs de la deuxième Internationale, reprochent aux bolcheviks, en 1918, d’avoir substitué le léninisme au marxisme. En 1920, un député italien écrit à Zinoviev : « Je ne suis pas bolchevik, mais communiste. » Après la mort de Lénine, quand l’Académie socialiste de Moscou prend le nom d’Académie communiste, Riazanov lui-même, dans un discours qui soulève de vives discussions, affirme qu’il est partisan de ce changement de nom depuis 1919, et il ajoute : « je ne suis ni bolchevik, ni menchevik, ni léniniste, je ne suis que marxiste, et, par conséquent, communiste. » Au cours de la polémique Trotsky-Staline, Zinoviev écrit que « le véritable Marx est maintenant impossible sans Lénine ». Au mois d’avril 1917, quand l’attitude de Wladimir Ilitch, ses thèses défaitistes, ses appels à la violence, son fanatisme aveugle, soulèvent la stupeur et l’indignation du parti, le dilemme qui se pose est encore celui de 1903 et de 1905, le même qui se posera plus tard en 1918, en 1926, en 1928, que l’on trouvera à l’origine du dualisme Trotsky-Staline, et qui subsistera au cours de tout le développement idéologique du bolchevisme : Marx ou Lénine ?
Les raisons qui déterminent, en avril 1917, toute la social-démocratie russe, et même la plupart des bolcheviks, à rejeter Lénine au nom de Marx, peuvent se résumer par ce que Wladimir Ilitch appelle les trois dogmes de la deuxième Internationale, clairement formulés par Staline en 1924 dans une série de conférences faites à l’Université Sverdlovsk de Moscou. Dans sa critique des dogmes de la deuxième Internationale, Lénine affirme que le prolétariat peut s’emparer du pouvoir, et le garder, même s’il n’a pas la majorité, même s’il ne dispose pas d’intellectuels et de techniciens capables d’organiser l’État communiste. « La violence, dit Lénine, voilà la vraie loi du marxisme. » Ce petit bourgeois fanatique ne conçoit la violence que d’une manière abstraite. Le climat sous lequel il mûrit sa conception de la lutte révolutionnaire, de la lutte de classe dans ses deux moments décisifs : la conquête du pouvoir et la dictature du prolétariat, est un climat de clinique : la lumière blanche, immobile et froide, des salles d’opération. Toujours, sa logique violente, hallucinée, qui provoque tant de massacres, de ruines et de misères, reste sans tache et sans défaut. Rien ne pourra souiller l’affreuse innocence de ce bonhomme au fanatisme si méticuleux, si pur, si désintéressé. Même pas le sang. Quand les orateurs mencheviques, à la veille du coup d’État, accusent Lénine d’avoir proclamé que « la dictature du prolétariat marquera le début de la véritable lutte de classe, de la lutte sans quartier contre la bourgeoisie non point détruite, mais renforcée par le triomphe de la révolution prolétarienne », et qu’ils invoquent l’avènement d’une paisible démocratie socialiste bannissant la violence et mettant fin à la lutte de classe, Wladimir Ilitch sourit, tapote ses genoux, regarde autour de lui, d’un air étonné, amusé. Les scrupules humanitaires des marxistes purs le mettent de bonne humeur. Un petit bourgeois fanatique n’est jamais un sentimental. Le trait le plus saillant du caractère d’un Robespierre ou d’un Lénine, c’est qu’ils ne se rendent pas compte des conséquences pratiques de leurs théories, dès calamités sans nom qui naissent de leur logique, de leur violence abstraite, de leur enthousiasme aveugle et froid. La cruauté de Lénine, comme celle de Robespierre, est une cruauté platonique.
« Le problème fondamental de la révolution, proclame Wladimir Ilitch c’est le problème du pouvoir. » Il a le plus profond mépris pour les opportunistes, pour les idéalistes, pour tous ces faux révolutionnaires qui lui conseillent la prudence et la modération : leur marxisme « légal » conduit à la démocratie bourgeoise, aux idéologies libérales et démocratiques, à l’erreur de Struve et de Brentano, qui conçoivent la conquête du pouvoir comme la fin de la lutte de classe. « Vive Kerensky », ricane Lénine. L’État est nécessaire à la révolution prolétarienne, non pas pour fonder le règne de la liberté, mais pour détruire les adversaires du prolétariat. L’État ne saurait tolérer que l’on parle même de liberté : aussitôt qu’on parle de liberté, l’État dépérit. « Là où il y a liberté, il n’y a point d’État. » Cet axiome de Lénine, contient toute sa conception révolutionnaire de l’État. Lorsque Kautsky oppose la démocratie pure à la dictature du prolétariat, le leader bolchevique répond que « la démocratie pure n’est qu’une hypocrisie libérale destinée à tromper le prolétariat », n’est que le paravent de la dictature bourgeoise. Elle aussi, la bourgeoisie, n’a pu s’emparer du pouvoir et se substituer à la société féodale, qu’à travers les insurrections, les guerres civiles et les répressions. Au nom de quels droits les mencheviks, les socialistes révolutionnaires et les partisans de Kerensky réclament-ils de la révolution le respect de la liberté ? Au nom des idéologies libérales et démocratiques ? Mais « dans l’Angleterre de 1699 ou dans la France de 1793, répond Lénine, la bourgeoisie révolutionnaire n’a jamais accordé à ses adversaires la liberté de réunion, de parole ou de presse ». Les marxistes purs, qui se réclament toujours de Marx et d’Engels, doivent se rappeler les paroles d’Engels : « La révolution est le fait le plus autoritaire qui soit : c’est un fait par lequel une partie de la population impose son autorité à l’autre partie par les fusils, les baïonnettes et les canons, à savoir des moyens autoritaires. Le parti victorieux se trouve dans la nécessité de maintenir sa domination par la terreur que ses armes imposent aux contre-révolutionnaires. » À Kamenev, qui lui dit que le peuple russe veut la liberté, que l’expression dictature du prolétariat n’a pas de sens pour lui, Lénine répond : « Le peuple ne demande pas la liberté, il ne comprend pas ce mot : c’est le pouvoir qu’il réclame. »
Le drame de la liberté, en Russie, tient plus de la nature que de la politique. Ce peuple soumis et patient, docile et assoiffé de liberté, inquiet et tourmenté, qui se fait de la terre une image enfantine, naïve, religieuse, (une manière de Crèche où il faut parler à voix basse et marcher sur la pointe des pieds pour ne pas réveiller l’Enfant-Jésus), et de la vie une image sombre, illuminée par le sens du péché, la crainte de la faute et de l’expiation ; ce peuple qui voudrait constamment fuir son ombre, s’évader du cercle de son histoire, briser l’horizon ; ce peuple doux dans ses affections et terrible dans sa colère, qui n’a pas le sens de la propriété et vit dans la crainte continuelle de se sentir un voleur, un intrus dans sa propre maison, un étranger au milieu des siens, c’est de tous les peuples celui qui aime le plus la liberté et se résigne le mieux à l’esclavage. Les Russes ont peur de la solitude : ils ne savent pas vivre seuls. Depuis le travail en commun, la forme primitive du mir, l’instinct de s’associer dans les entreprises, dans les douleurs et dans la joie, jusqu’au suicide collectif, à la facilité de mourir ensemble, en rang serrés sur les champs de bataille ou en foule silencieuse sur les places, les aspects et les formes caractéristiques de l’aversion des Russes pour la solitude sont les aspects et les formes de leur soif de liberté et de leur résignation à l’esclavage.
Un peuple qui a peur de la solitude ne peut concevoir la liberté que collective : la liberté individuelle ne fait pas partie de sa logique. Mais une liberté collective à laquelle la conscience individuelle ne participe pas, est fort semblable à l’esclavage, c’est une manière d’esclavage librement accepté. Même les jours de révolte et de massacre, la foule, en Russie, a des airs de troupeau : elle obéit aveuglément à quelques meneurs. Les tumultes les plus violents ont toujours lieu suivant une certaine règle, avec une certaine discipline excluant toute espèce de déviation et d’imprévu. Le cours de la révolution de 1917, de Kerensky à Lénine, dans la terrible variété de ses alternatives, paraît presque monotone, tant il est régulier : on dirait un déchaînement d’instincts dominé par le calcul. Il révèle l’existence d’un chef, d’un plan, d’une minorité d’hommes résolus, d’exécuteurs attentifs et ponctuels : un désordre qu’on dirait préétabli, surveillé jusque dans ses dernières conséquences et dans ses dernières dérivations.
L’étoffe des rebelles et des apôtres de la liberté, brigands et braves gens, intellectuels ou cosaques, depuis Stienka Rasine jusqu’au pope Gapone, depuis Pougatchev et le Larron de Touchino, jusqu’aux Décembristes, est celle de fanatiques, d’illuminés, d’imposteurs, ou d’utopistes ingénus. Voyez Stienka Rasine, le grand pillard d’Astrakan, le pirate du Volga et de la mer Caspienne, dont le peuple a fait le héros d’une de ses plus belles chansons : les bandes de vagabonds, de moujiks, de serfs rebelles, d’aventuriers, de cosaques, de brigands, qui le suivent tumultueusement, tuant, saccageant et brûlant, se révoltent et se battent autant pour conquérir la liberté que pour mettre à sac les rives du Volga. Stienka Rasine marche sur Moscou au cri de « Mort aux boyards, Vive la liberté cosaque ! » Battu, il s’enfuit dans les steppes du Don. Trahi par les siens, il est pris, emmené à Moscou, et mis à mort le 6 juin 1671 sur la plate-forme ronde du Lobnoïé-Miesto, au milieu de la Place Rouge, devant les murs du Kremlin et les coupoles de l’église Vassili Blajenni. Aujourd’hui la république des Soviets a fait, de ce brigand cosaque, un précurseur du bolchevisme ; le calendrier des saints de la liberté rouge commence par son nom ; celui de Tolstoï est parmi les derniers. Tout le vestibule du Musée de la Révolution, à Moscou, est consacré à ses hauts faits, et le tableau de Pcheline représentant le supplice de Stienka Rasine est là, sous les yeux des ouvriers et des paysans qui remplissent le musée du matin au soir. Mais tous les « précurseurs du bolchevisme », bien que tenus de même pour des martyrs et des héros, n’ont pas au cœur ce même sang noir qui bouillonne dans les veines de Stienka Rasine ou de Pougatchev. Ce ridicule et tragique Pougatchev, qu’un peintre inconnu du XVIIIe siècle, dans le portrait qu’on a trouvé près de Smolensk, nous montre debout, habillé à la polonaise, en veste courte et en bottes écarlates, a l’air d’un fou et d’un imposteur. L’air d’un amant de Catherine.
Si on les rapproche de Stienka Rasine et de Pougatchev, les Décembristes ont le même air, naïf et généreux, que les patriotes et les libéraux français, allemands et italiens de la première moitié du XIXe siècle. Les philosophes, les poètes, les écrivains russes de ce siècle romantique et bourgeois, qui ont consacré leur intelligence, leurs illusions, leur amour du prochain à la liberté de la Russie, depuis Pouchkine, Gogol, Bielinski, Herzen, Ogariov, Bakounine, Dostoïevski, Nekrassov, pour ne parler que de quelques-uns, jusqu’à Tolstoï, au Tolstoï végétarien, comte et moujik, ont tous leur place dans ce drame de la liberté et dans ce Musée de la Révolution. Ce sont des âmes insatisfaites et tourmentées, mais naïves, bien loin, au fond, de l’âme du peuple, des « prophètes sans tradition » et, par conséquent « sans autorité », comme dit Pascal de Mahomet, étonnés et presque affligés que tant d’art, tant de philosophie, tant d’hypocrisie aient amené des faits aussi terribles, un esclavage aussi lourd, un aussi cruel destin. Ils semblent presque ne pas en croire leurs yeux, se demander ce qu’ils font là, dans ce Musée, à côté de Stienka Rasine, du terroriste Karakosov, des nihilistes hâves et pâles aux yeux rêveurs, entre le portrait de Pougatchev et la statue de Lénine. Mais au fond, ce sont eux les vrais précurseurs, les seuls apôtres de la liberté du peuple russe. Ce n’est pas la statue de Tolstoï, ni celle de Plekhanov, qui semblent déplacées dans le Musée de la Révolution de Moscou, dans ce Panthéon de la liberté rouge, ni même la statue de Stienka Rasine. Tous, brigands, cosaques, pirates du Volga et du Don, poètes, philosophes, écrivains, nihilistes, s’y trouvent chez eux, y respirent un air de famille. Ce sont eux les vrais apôtres de la liberté, les seuls qui aient lutté et souffert pour la liberté du peuple russe. La seule statue qui semble déplacée, dans ce Panthéon, c’est la statue de Lénine.
Lénine ne s’est jamais battu pour la liberté. Il s’est battu pour bien autre chose. Les illusions humanitaires et les idéologies démocratiques des patriotes russes du XIXe siècle, les romantiques aspirations libérales des Décembristes, l’esprit de sacrifice des nihilistes, ne font pas partie de sa logique. Il ne lutte pas pour la liberté, mais pour le pouvoir, rien que pour le pouvoir. Pendant ses années d’exil, depuis la première Iskra jusqu’à son retour en Russie, le mot « liberté » sonne faux dans sa bouche. C’est un de ces mots qu’il prononce en souriant et en clignant des yeux. Aux hordes de soldats qui désertent les tranchées pour se déverser sur Petrograd, encombrent les places et les rues, vendent des graines de tournesol le long des trottoirs de la Perspective Newsky, ou bien rôdent et mendient, aux abords des cafés, des théâtres, des usines et des gares, offrant pour quelques kopeks leurs armes aux passants et aux ouvriers, Lénine ne promet pas la liberté, mais la vengeance et la paix. Aux moujiks qui font retentir dans les campagnes le chant du coq rouge, et tendent l’oreille, la nuit, du fond de leur isba, pour écouter si le vent de la révolution n’apporte pas aux villages le mot qu’on attend depuis des siècles, Lénine ne promet pas la liberté, mais la vengeance et la terre. Aux ouvriers qui se pressent autour des orateurs rouges, dans les cours d’usines, préparent leurs armes en silence, et caressent déjà des cartouches dans leur poche, d’une main affectueuse et sensible, Lénine ne promet pas la liberté, mais la vengeance et le pouvoir. Les paroles qu’il jette du balcon de la Kchessinskaia aux ouvriers et aux déserteurs, rebondissent, rouges et retentissantes, de rue en rue, de village en village, jusqu’au fond de l’Asie. « Ce n’est pas le moment de faire des discours, lui dit Trotsky : un chef ne doit jamais se compromettre avant le moment. »
Maigre, pâle, les yeux brûlants de fièvre sous un vaste front toujours mouillé de sueur, Trotsky appuie familièrement sur la table de Lénine ses mains que ronge la gale. Wladimir Ilitch le regarde en souriant, les yeux mi-clos : Trotsky pousse l’astuce jusqu’à paraître malade. L’air du camp de prisonniers d’Amherst, au Canada, a jauni son teint, voûté ses épaules, enroué sa voix. Il frotte de temps en temps, du dos de ses mains galeuses, des yeux enflammés. Trotsky vient à peine de rentrer en Russie, et déjà son regard perçant pénètre au cœur des hommes et des évènements. Comme un plongeur ramène à la surface les coquillages du fond, Trotsky met en lumière les plus menus détails de la situation : on dirait qu’il les pèse dans la paume de sa main avant de les déposer, un à un, sur la table de Lénine. Il bat des paupières, en parlant, comme le plongeur aveuglé par la lumière du jour. Ce pêcheur en eau trouble a vraiment un curieux regard : on dirait que ses yeux claudiquent. L’un, myope et prudent, embrasse tout le panorama de la guerre et de la révolution : Paris, Londres, Moscou, Vladivostok, Vienne, Berlin, Petrograd, Arkhangelsk ; l’autre, rapide et pénétrant, se pose sur les choses, perce, fouille, explore, plonge au cœur des hommes et des évènements. C’est une manière bien équivoque de loucher. Wladimir Ilitch s’étonne en découvrant qu’une situation si simple en apparence cache d’aussi bizarres coquillages, de couleurs aussi surprenantes. Sans doute ne faut-il pas se fier aux apparences. Il a cru, à son retour en Russie, que la république bourgeoise de Kerensky n’était qu’une façade : or voici que le regard de Trotsky découvre des perspectives derrière cette façade. Les problèmes révolutionnaires, que Lénine avait adaptés à la situation sans tenir compte des arrière-plans, voici maintenant qu’il faut les adapter aux perspectives révélées par Trotsky. Il s’agit de régler en profondeur des problèmes qui n’avaient été conçus qu’en surface.
Heureusement que Trotsky est un plongeur extraordinaire. Nul ne sait, mieux que lui, nager entre deux eaux. Quelle pêche miraculeuse, quelles coquilles admirables ! Il y en a de rouges, de vertes, de bleues, de jaunes, de toutes les nuances de l’intransigeance et de l’opportunisme. Ce qu’il lui plaît de ramener à la surface, ce sont surtout les dangers de la situation, ces dangers que Lénine, dans son obstination doctrinaire, ne peut pas voir, qu’un fanatique ne saurait même pas soupçonner. Tel un pêcheur de perles décrivant les merveilles du fond des mers, Trotsky révèle les secrets de la révolution. Lénine a tort de vouloir attaquer de front la république bourgeoise de Kerensky : il faut attendre que cette république ne soit plus qu’une façade. Pour l’instant, la violence ne sert qu’à compromettre le parti et à l’isoler. Les ouvriers ne sont pas prêts, les soldats veulent la paix, l’opinion publique craint la guerre civile, les bolcheviks eux-mêmes ne veulent pas d’aventures. Dans ces circonstances, un parti révolutionnaire ne peut pas défier l’opinion publique. Langage surprenant dans la bouche de Trotsky : l’opinion publique, c’est une bien vieille histoire ! Mais la prudence de Trotsky n’a rien à voir avec celle de Kamenev. Avant de parler d’une dictature du prolétariat, il faut organiser l’insurrection. Les discours, les programmes, les appels de la Pravda, ne servent de rien. « Mes thèses », dit Lénine. Ses thèses ce sont des arguments dont les partisans de Kerensky se servent pour combattre les bolcheviks. Des hommes sûrs et des armes, voilà qui vaut beaucoup mieux que les « thèses » de Lénine. Au début de 1902, dans sa fameuse brochure Que faire ?, Wladimir Ilitch ne s’était-il pas écrié lui-même : « Donnez-nous une armée révolutionnaire et nous bouleverserons la Russie ? » Alors, que prétend-il bouleverser avec ses articles, ses « thèses », ses appels à la violence ? On la connaît, sa violence. C’est une violence de bibliothèque. Heureusement pour lui que ses adversaires sont loin d’imaginer à quel point elle est livresque. Si Kerensky, ce petit bourgeois imbu de préjugés démocratiques, fidèle aux formules parlementaires et respectueux du testament politique de la bourgeoisie française de 1789, pouvait seulement soupçonner qu’il n’a en face de lui qu’un autre petit bourgeois sans ressources, sans amis et sans armes, d’un fanatisme doctrinaire, têtu, bureaucratique, méticuleux, et, somme toute, inoffensif, il le ferait certainement arrêter. Wladimir Ilitch, qui se rend compte de son impuissance, ne cache pas ses inquiétudes. Jaroslavski, le Plutarque officiel du Kremlin, a écrit : « Lénine n’appartenait pas à la catégorie des hommes confiants. Presque chaque soir, il disait : aujourd’hui on ne nous a pas encore arrêtés, ce sera donc pour demain. » L’arrestation de Lénine, après tout, n’eût pas changé le cours des évènements : elle n’eût pu empêcher Trotsky de s’emparer de l’État. L’âme de la révolution n’était donc pas Lénine ? Sans doute, l’âme de la révolution ne pouvait être que Lénine. Mais, jusqu’au milieu de mai 1917, c’est-à-dire jusqu’à l’arrivée de Trotsky, la lutte entre le gouvernement provisoire et le parti bolchevique n’est que le duel de deux petits bourgeois : Kerensky vit dans l’illusion d’assurer l’ordre, la liberté et la démocratie par des discours, Wladimir Ilitch prétend bouleverser la Russie par des articles. À certains égards, ces deux adversaires sont bien dignes l’un de l’autre.
Quand Trotsky, enfin délivré du camp de concentration canadien d’Amherst, débarque à Petrograd en mâchonnant une chique de mauvais tabac anglais, et monte de son pas léger l’escalier de l’hôtel de la Kchessinskaia, Lénine se rend compte tout de suite que l’arrivée de ce Blücher va décider du sort de la bataille. Pour une fois, il se compare à Wellington, mais un Wellington décidé à ne rien accorder au hasard. Son Clausewitz est là, sur la table, sous un monceau de numéros de la Pravda : pour bouleverser la Russie, il lui faut une armée révolutionnaire. Mais comment l’organiser ? Où recruter ses partisans ? Lénine n’a pas le don de l’organisation. Y a-t-il quelqu’un, parmi ses collaborateurs les plus anciens et les plus fidèles, à qui il puisse confier la tâche de mettre sur pied une armée révolutionnaire ? Le professeur Kamenev, qui sait par cœur le Capital de Marx, écarquille les yeux derrière ses lunettes. Lénine commence à se sentir mal à l’aise. Autour de lui, on n’a pas l’air de prendre au sérieux son penchant pour la stratégie. De l’encre, une plume et du papier : c’est tout ce qu’on lui donne pour renverser la république bourgeoise de Kerensky. Son rôle dans la révolution se bornerait-il à celui d’un Marat ? « Donnez-nous une armée.... » Trotsky le regarde en souriant. (Monsieur Trotsky ne s’est pas encore rallié officiellement au parti bolchévique : il peut donc juger Lénine en toute impartialité, avec cette pointe d’ironie qu’il met toujours dans ses jugements objectifs.) L’idée de confier à Lénine le rôle de chef de l’armée révolutionnaire lui semble bien amusante. La stratégie de Lénine, ce mélange de Marx et de Mars, de Clausewitz et de Koutouzov (le somnolent Koutouzov de La guerre et la Paix), il n’est pas le seul à l’apprécier comme elle le mérite. Il faudra bien que quelqu’un se charge, tôt ou tard, d’organiser des équipes de combat (« ça, c’est mon affaire » dit Trotsky) : un millier de techniciens et d’ouvriers armés, pas davantage, qui n’auront guère besoin de lire les articles de la Pravda, pour apprendre leur métier. Mais Wladimir Ilitch est suffisamment encombrant comme cela sans qu’on pense à lui confier le sort de l’insurrection. Lénine n’est que le chef du parti, l’âme de la révolution prolétarienne : qu’il ne se mêle donc pas des petites affaires de ses collaborateurs. Au moment donné on trouvera bien le moyen de le mettre à l’écart des coups de feu et autres histoires de ce genre. Qu’en pense Kamenev ? Le prudent Kamenev est d’accord ; tout le monde est d’accord, sauf Staline, « l’homme d’acier », le sombre et méfiant Staline, qui flaire déjà chez Trotsky « celui qui préfère Bonaparte à Kerensky ».
Certains biographes de Lénine prétendent voir, dans son attitude conciliante à l’égard de Trotsky, la preuve qu’il acceptait de bon cœur de partager avec son « lieutenant » la responsabilité de l’action révolutionnaire. En réalité son attitude était un reflet de sa timidité, tout autant qu’une ruse. En face des hommes et des évènements, il se révèle toujours un timide, mais un timide plein d’astuce et de patience. Pour éventer le plan de Trotsky, cet homme d’action aux projets violents, d’une ambition sans scrupules, animé d’une volonté passionnée qui ressemble parfois à la volonté aveugle des épileptiques (un médecin de New York ne l’a-t-il pas classé parmi les épileptiques ? C’est Trotsky lui-même qui le raconte), Wladimir Ilitch recourt, comme toujours en pareil cas, à la tactique des petits moyens, à la ruse la plus discrète, à la vigilance la plus attentive et la plus sournoise : à cette hypocrisie quelque peu féminine qui est celle de Cromwell, du Grand Frédéric, de Robespierre. Quand autour de lui, dans le petit cercle de ses collaborateurs, les passions s’éveillent, Lénine feint de s’endormir. Insidieuse léthargie. Il se fait petit, modeste, conciliant, surveille les visages et les gestes à travers ses paupières mi-closes, et, parfois, s’éloigne à pas de loup, abandonnant le terrain de la lutte. Il y a du Cunctator chez cet Hannibal petit-bourgeois. À ses yeux, Trotsky n’est qu’un marxiste formé à l’école de Talma (mauvaise école, par laquelle a passé Bonaparte lui-même). Mais, bien que ce « grand prêtre de la phrase révolutionnaire », ainsi qu’il appelle Trotsky, s’impose à lui par ses attitudes déclamatoires, ses projets jacobins, son ambition ardente et ses « préjugés d’homme sans scrupules », bien qu’il supporte, apparemment résigné et soumis, son effronterie, sa houspa juive, il s’en méfie, le surveille, et ne se retire devant lui qu’en brûlant les ponts.
Quand Lénine s’aperçoit qu’à l’exception de Staline tous ses collaborateurs se groupent autour de Trotsky, il se rend bien compte du plan de son « lieutenant », de ce qu’on a nommé « la première conjuration de Trotsky ». Mais, comme toujours, dès qu’il se trouve aux prises avec une volonté plus violente que la sienne, au lieu de réagir ouvertement, il se replie sur lui-même et feint de s’endormir, d’entrer en léthargie. C’est avec un sourire d’homme las, avec un air soumis et conciliant, qu’il accepte le rôle qu’on lui confie dans la préparation du coup d’État : mener contre les partis bourgeois et les faux révolutionnaires une impitoyable campagne de presse, exciter les ouvriers et les moujiks contre le gouvernement provisoire et ses partisans, capitalistes, propriétaires terriens, patriotes, opportunistes, dresser les soldats des tranchées et les masses de déserteurs contre la continuation de la guerre, contre le projet d’offensive annoncé par Kerensky pour la fin de juin. Tandis que Trotsky rassemble autour de lui toutes les têtes brûlées du parti, organise son état-major, fixe les grandes lignes de l’action révolutionnaire, tout en jouant, sur la scène du Soviet de Petrograd, le rôle de Danton avec les gestes de Lassalle, Wladimir Ilitch, au fond de sa petite pièce du premier étage, dans l’hôtel de la Kchessinskaia, s’acharne d’un cœur joyeux, avec des yeux moqueurs dans une face béate, à enfoncer impitoyablement, à grands coups de marteau, les clous de la calomnie dans le dos des cadets, des mencheviks, des socialistes révolutionnaires. N’est-ce pas là le sport de toute sa vie, d’enfoncer des clous dans le dos de ses adversaires personnels ? Il sait bien que les amis de Trotsky le surveillent au nom de l’insurrection, que Kamenev le contrôle au nom de l’opportunisme. Que veut-on de lui ? Le rôle qu’on vient de lui confier, son rôle, c’est de prêcher la révolution. Aux autres de l’organiser ; ou bien de la saboter. Au fond, tous ces hommes, prudents ou impatients, professeurs ou hommes d’action, il les méprise sans joie. Dans ses discours, ses articles, ses lettres, à sa haine pour les adversaires de la révolution se mêle toujours un profond dédain pour la prudence des opportunistes et pour l’opportunisme des hommes d’action. Le jour n’est pas loin où Kamenev, qui lui reproche son « incompréhension des évènements », s’apercevra que sa montre est en retard sur l’heure décisive. Peut-être Lénine est-il au delà des évènements. Mais déjà Trotsky lui-même, poussé par la marée montante des masses de plus en plus bolchévisées, hâte le pas, en s’efforçant de le rejoindre sur la ligne de ce fanatisme doctrinaire qui est à l’avant-garde de l’insurrection. Le seul vrai chef, c’est lui, Wladimir Ilitch, le méticuleux, le têtu, le fanatique, le doctrinaire Wladimir Ilitch.
Au début de juillet, à la nouvelle du sanglant échec de l’offensive ordonnée par Kerensky, sur l’injonction des Missions militaires alliées, une vague de fureur et de lâcheté déferle sur Petrograd. Des milliers de soldats en guenilles abandonnent les tranchées, se jettent sur la capitale, se vautrent ivres morts sur les trottoirs de la Perspective Newsky, horde misérable qui répand dans les rues l’horreur du massacre et de la famine. Des faubourgs de Poutilov et de Viborg, des colonnes d’ouvriers sans armes, pâles dans le reflet rouge des drapeaux, se mettent en marche vers le centre de la ville, fendent en silence les flots pesants et sombres des déserteurs campés dans les rues. Des détachements de marins de Cronstadt, armés de mitrailleuses, défilent vers le palais de Tauride. Dans le ciel brûlé par le vent d’Est, qui souffle du cœur de la Russie, sur l’estuaire de la Neva, l’odeur enivrante des champs de blé et la paresse parfumée des coquelicots, le cri d’alarme des sirènes monte des usines comme un feu d’artifice. Le tam-tam de l’insurrection ébranle le cœur de la ville, comme les coups sourds d’un pic énorme. Tout le pouvoir aux Soviets. Le flux et le reflux de la foule devant les mitrailleuses des junkers roule sur le pavé des grappes de cadavres, qu’un nouveau ressac écumant entraîne vers les carrefours.
Trotsky hésite. Il est trop tôt pour engager la lutte, trop tard pour arrêter le mouvement spontané des masses. « Le parti, dit-il, ne peut assumer la responsabilité d’une émeute. Cette foule, c’est de la boue. » Il n’a pas confiance en l’esprit révolutionnaire de ces troupeaux de déserteurs, de femmes, d’ouvriers sans armes, qui roulent lentement entre les maisons, comme un fleuve bourbeux. De temps en temps, depuis deux siècles, la Neva déborde. De temps en temps, depuis deux siècles, la foule inonde les rues de Saint-Pétersbourg. C’est dans la vase des étangs que Pierre le Grand a jeté les fondations de sa capitale. C’est sur les foules immenses de la sainte Russie, super hanc petram, que les tsars ont fondé, de tout temps, leur despotisme. Quelques centaines de cosaques suffisaient, jadis, à rejeter la foule dans ses bas-fonds. Quelques compagnies de junkers vont suffire à Kerensky pour disperser ces bandes de déserteurs, de femmes et d’ouvriers sans armes. La foule est comme la boue : elle inonde les rues, mais elle ne détruit pas les villes ; elle emporte les hommes, mais elle ne submerge pas les États. Comme la boue alourdit, retarde, arrête l’élan d’un fleuve qui déborde, et c’est le poids mort des inondations, de même la foule alourdit, retarde, arrête l’élan des minorités révolutionnaires, et c’est le poids mort des révolutions. « Cette révolte, s’écrie Trotsky, c’est une honte ! » Mais sa pâleur le trahit : il hésite. Son instinct le pousse à l’action : son orgueilleuse ambition le retient. Doit-il se mettre à la tête de la foule, plonger dans cette boue ? Il ne ramènerait à la surface que des cadavres.
Aux premiers coups de feu, aux premières paroles de Trotsky, Lénine a compris que toute hésitation risque de lui être fatale. Le moment est venu de prendre la responsabilité des évènements ; le chef, c’est lui. « Il doit le prouver », pense Trotsky. Le Comité central du parti est là, réuni autour de la table de Wladimir Ilitch. On entend au loin les clameurs de l’émeute. Lénine, un à un, regarde dans les yeux les membres du Comité central, guette ces visages anxieux et pâles. Faut-il exploiter ouvertement cette ébauche de révolte, ou bien l’exciter en secret, sans prendre la responsabilité directe des évènements ? Tous, sauf Trotsky et Kamenev, se prononcent pour la lutte ouverte. Le parti doit prendre la tête de l’émeute, jouer sa carte. Kamenev, immobile et muet, les lèvres livides, met ses mains dans ses poches comme pour cacher ses gestes. Trotsky seul est d’avis d’exploiter la situation sans en prendre la responsabilité. Au fond, les masses n’obéissent-elles pas aux mots d’ordre que tous les jours, depuis trois mois, Wladimir Ilitch leur donne des colonnes de la Pravda ? Le parti, déclare-t-il, ne doit jouer dans la révolte qu’un rôle d’agent provocateur. C’est la seule tactique à suivre si l’on veut courir la chance d’une victoire sans s’exposer à être battu. « Maintenant, à vous de décider », conclut-il en s’adressant à Lénine. Pour la première fois de sa vie, Wladimir Ilitch se sent acculé, mis au pied du mur. Sur ces visages, où le violent désir de la lutte s’éclaire d’un reflet de sensualité, c’est en vain que ce bonhomme timide cherche une lueur de confiance ou de sympathie. Il se sent méprisé sans méchanceté, plaint sans indulgence. Peu à peu, il commence à se rendre compte que, quelle que soit la décision qu’il va prendre, tous, jusqu’à Kamenev, sont prêts à rejeter sur lui, sur lui seul, toute la responsabilité des évènements. Que cette stupide révolte triomphe, ou qu’elle soit étouffée dans le sang, le responsable, le seul responsable, c’est lui. « Il faut décider », dit Trotsky. Le menton sur la poitrine, Wladimir Ilitch joue avec une clef minuscule qui pend à sa chaîne de montre, laquelle traverse une boutonnière et va d’une poche à l’autre de son gilet. Non, ce n’est pas l’heure décisive. Ce n’est pas son heure, l’heure que marque en ce moment sa vieille montre d’argent, une de ces montres d’ancien système chères aux notaires de province, qui se remonte délicatement avec une petite clef.
Que veut-on de lui ? Une décision immédiate ? Pour décider, il lui faut connaître tous les détails de la situation, dresser un bilan exact des éléments, favorables et défavorables, qui peuvent jouer un rôle décisif dans cette stupide affaire (gagner du temps, pense-t-il). « Dans quelques heures, dit Trotsky d’une voix douce et lente, il sera trop tard. » Lénine lève la tête, fixe droit dans les yeux ces hommes inquiets et troublants. Dans quelques heures, il sera trop tard pour tout le monde, mais pas pour lui. Il ne se laissera jamais entraîner par des évènements qu’on ne peut contrôler. Il ne veut rien savoir, il ne veut rien entendre, il ne veut avoir aucune responsabilité dans cette absurde révolte. Le parti ne doit pas se mêler à semblables histoires. Sa résolution est prise : il faut se tenir à tout prix à l’écart des évènements. Son rôle n’est pas celui d’un meneur d’émeutes. Y a-t-il, parmi les membres du Comité central, quelqu’un osant prendre sur lui, sur lui seul, la responsabilité d’une telle aventure ? Les membres du Comité central se regardent l’un l’autre. Trotsky se lève le premier, se dirige vers la porte : tout le monde le suit en silence. La partie est remise. Pour le moment, il n’y a plus rien à faire, sinon s’efforcer de « canaliser » la révolte. Pourquoi Trotsky n’a-t-il pas osé prendre sur lui la responsabilité de l’action révolutionnaire ? Les chances de renverser le gouvernement de Kerensky sont trop faibles pour qu’il puisse se risquer à conduire en même temps la sédition contre Lénine. Pendant les journées de juillet, Trotsky, qui ne s’est pas encore rallié officiellement au parti bolchévique, joue un rôle d’allié. En de semblables circonstances, c’est moins compromettant que de se poser en rival : En tout cas, l’autorité de Lénine ne sort pas solidement renforcée de cette stupide affaire. Il reste encore bien des cartes à jouer. Dans l’attente, il faut payer de sa personne, ou, tout au moins, montrer qu’on veut payer de sa personne. Tandis que Wladimir Ilitch, accompagné du trop fidèle Zinoviev, se cache dans une maison du faubourg de Viborg pour surveiller de près – mais d’un lieu sûr – le cours des évènements (« Lénine et Zinoviev se cachèrent », raconte-t-il), Trotsky descend dans la rue, se mêle aux bandes d’ouvriers et de déserteurs, harangue la foule, exhorte les masses « à se tenir prêtes pour les luttes prochaines ». Aidé de Raskolnikov, lieutenant de la flotte de la Baltique (le terrible Raskolnikov, un des rares officiers de la marine impériale qui se soient rangés du côté de Lénine : on doit reconnaître qu’il a fait tout son possible pour racheter la réputation du héros de Crime et Châtiment), Trotsky arrache aux insurgés le ministre Tchernov. C’est Raskolnikov lui-même qui nous fait, dans ses mémoires, le récit de cette scène, où l’on voit Trotsky haranguer les ouvriers et les matelots pour soustraire au lynchage un ministre de Kerensky.
Le régiment de Volhynie envoyé du front pour étouffer la révolte, balaie les rues à coups de mitrailleuse. Les junkers occupent et saccagent l’hôtel de la Kchessinskaia, les bureaux de la Pravda, les imprimeries du parti bolchevique. « On va nous fusiller l’un après l’autre, dit Lénine à Trotsky le matin du 5 juillet : on ne pourrait mieux choisir le moment. » Le fanatisme d’un petit bourgeois perdu dans le tumulte de ces évènements tragiques, ne résiste pas à l’épreuve du danger. C’en est fini de cette sale histoire. On va tous les fusiller, l’un après l’autre. Il n’aurait jamais dû se laisser compromettre à ce point par ces aventuriers du marxisme. On l’a fourré dans un beau guêpier. Toujours les mêmes, ces hommes d’action : race dangereuse et fourbe. Toujours les mêmes gâcheurs. Une révolution, même une simple révolte, doit avoir ses papiers en règle pour réussir. Il faut mettre de l’ordre dans cette confusion d’idées, de sentiments de règles. Où peuvent bien s’être fourrés ses fameux « révolutionnaires professionnels ? » Morts ? Prisonniers ? Noyés dans la foule ? « Que faire ? » demande Lénine à Zinoviev. Toujours cette question. Le soir, quelques heures plus tard, Trotsky, Kamenev, Lounatcharsky, Krilenko sont arrêtés. « Il faut montrer que je n’ai pas peur », dit Wladimir Ilitch. Son égarement est si grand qu’il songe à se livrer à la police pour partager le sort de ses collaborateurs. Émouvant esprit de camaraderie, chez un homme dépourvu de ce qu’on appelle le courage physique. En 1903, après le congrès de Londres, n’avait-il pas projeté d’émigrer en Amérique, de renoncer pour toujours à la lutte révolutionnaire ? Pour ce fanatique sédentaire, les crises de découragement sont des « invitations au voyage ». Après la révolution de 1905, le « voyage » qui l’a conduit à Koukalla, en Finlande, ne devait s’arrêter qu’à Paris. Au mois de juillet 1917, comme l’Amérique est trop loin, Lénine se décide pour la forteresse Pierre et Paul. Le trajet est court : toutefois, il n’oublie pas de prendre ses précautions. Du moment qu’il a décidé de se faire pendre, ne peut-on lui laisser le choix de l’arbre où on le pendra ? Sa prudence est digne de Kamenev : il veut se faire arrêter pour se mettre en sûreté. « Il y eut même des négociations, raconte le Plutarque du Kremlin, Jaroslavski, pour obtenir que Lénine fût envoyé à la forteresse Pierre et Paul : il ne devait se laisser arrêter que dans ce cas-là seulement. La garnison de la forteresse étant bolchévisée, nous étions sûrs que les soldats ne laisseraient faire aucune violence à Wladimir Ilitch. » Mais Kerensky vient d’avoir la preuve que son adversaire ne sait pas mordre. Il refuse toute condition. Lénine n’est plus à craindre : on peut bien l’arrêter.
Affublé d’une perruque, la barbe et les moustaches rasées, les yeux cachés derrière d’épaisses lunettes bleues, Wladimir Ilitch prend le chemin de la prudence, c’est-à-dire la route de Finlande. Le fidèle Zinoviev l’accompagne, déguisé en paysan. Ce bolchevik élevé à l’école de Marx et de Clausewitz, ce révolutionnaire féru de stratégie, va pouvoir suivre enfin le cours des évènements tout à son aise, et d’un lieu sûr. Pour juger, on le sait, il lui faut du recul. Il lui faut se sentir en sécurité. La paix et la lente douceur de la solitude soulagent son esprit du souci des décisions immédiates, de la terreur des responsabilités inévitables : elles ouvrent à ses yeux de profondes perspectives. Il n’aime pas prendre de responsabilités directes, personnelles : entre l’action et lui, entre les conséquences de sa logique et sa logique, il lui faut des intermédiaires, que ceux-ci aient nom Nadejda Konstantinowna ou Trotsky, Kamenev ou Raskolnikov. Pour voir loin, très au delà des évènements, il lui est indispensable de s’en éloigner, de s’en écarter bien en deçà, ce qui l’oblige parfois à se trouver en retard sur ce qui s’accomplit en dehors de lui. L’essentiel, c’est qu’il se croie toujours à l’avant-garde. Or, Lénine a confiance en lui, en son coup d’œil, en son fanatisme prévoyant et calculateur. Il est persuadé que tout ce qui se produit a été prévu et déterminé à l’avance par lui, que tout s’accomplit autant par sa logique que par sa volonté. On pourrait, sans ironie, comparer Lénine à un amiral dirigeant les mouvements de sa flotte du haut d’un observatoire situé sur le rivage.
En prenant le chemin de la Finlande, Lénine ne faisait que se diriger vers son observatoire. Il ne se considérait assurément pas comme un fuyard. Se mettre en sécurité, c’est tout autre chose que se sauver. Comme toujours en semblables circonstances, aussitôt qu’il eut décidé de quitter Petrograd, le calme et la présence d’esprit lui revinrent peu à peu. Sous sa perruque de poils roux, il se sentait déjà à l’abri. Quelques heures avant son départ, Lénine se mit à écrire des lettres, à prendre des notes, à inscrire des chiffres, des noms et des dates. Il reprenait ainsi conscience de son rôle véritable. Au moment de quitter la maison du faubourg de Viborg, où il s’était tenu caché les derniers jours, il remit à Staline un message aux ouvriers de Moscou, une ébauche d’article, des lettres pour quelques membres du Comité central. Dans le train qui le conduisait à Rasliw, près de la frontière finlandaise, Lénine montra de la bonne humeur, il fit même preuve d’une certaine crânerie : comme cela arrive chez tous les timides, le déguisement lui donnait du courage. Le camarade Jermelianov, ouvrier de la fabrique de munitions de Sestrorestsk, chargé par Staline d’accompagner Wladimir Ilitch et Zinoviev jusqu’au village de Rasliw et de les cacher en lieu sûr, avait l’air bien plus préoccupé et la figure bien plus sombre que ses deux compagnons de voyage. C’est ce même Jermelianov qui nous a laissé dans ses souvenirs le récit de la courte odyssée de Lénine et de Zinoviev du faubourg de Viborg au fenil, où Lénine et Zinoviev se réfugièrent d’abord, puis du fenil, à la hutte de branchages, de l’autre côté du petit lac de Rasliw, qui devait abriter jusqu’au début de l’automne le général en chef de la révolution prolétarienne et son aide de camp. « On aurait vraiment pu appeler cette cabane le quartier général de la révolution, car c’était là que Lénine et Zinoviev pouvaient travailler en sécurité, combiner des plans, calculer les forces du prolétariat, et envisager paisiblement les différentes solutions de chaque problème. » Dans leur hutte de feuillage ces deux rescapés du naufrage du brigantin Insurrection de Juillet menaient une vie douce et tranquille parmi les prairies, les étangs et les bois de ce coin charmant perdu à l’orée des immenses forêts de Finlande.
On était au cœur de l’été : une lourde chaleur pesait sur les arbres aux feuilles rouges de soleil, une brume légère montait du lac, le parfum enivrant des foins se mêlait à l’odeur des feuillages pourrissant dans l’eau des étangs. « Lénine et Zinoviev profitaient de l’occasion pour faire de l’exercice physique. Je me rappelle fort bien à quel point Lénine s’entendait à manier la fourche à foin et comment il arriva à dresser une meule énorme. Le soir ils allaient souvent pêcher avec les enfants. Ceux-ci entraient dans l’eau jusqu’aux cuisses, tiraient sur la senne et prenaient ainsi assez de poissons pour faire la soupe. Puis ils revenaient du lac à la maison et s’occupaient à préparer la soupe de poissons et le thé. Après le souper, quand nous avions bu notre thé, nous nous asseyions autour du feu, au crépuscule, et le silence n’était interrompu que par le crissement des sauterelles ou le chant de quelque oiselet. Nous demeurions assis de la sorte assez longtemps, parlant de choses et d’autres. Bientôt, le sommeil nous prenait. Les enfants, les premiers, s’endormaient près du feu ; puis, nous-mêmes nous nous mettions à dodeliner de la tête. Nous rentrions alors dans notre hutte. Elle était quelque peu étroite, mais nous ne nous en souciions guère, du moment que nous pouvions échapper aux insupportables moustiques et que nous étions à l’abri du vent et de la pluie en cas de mauvais temps. » Zinoviev, parfois, allait à la chasse : Wladimir Ilitch l’attendait de longues heures, assis au bord d’un étang, sa canne à pêche à la main, un journal ou un livre ouvert sur les genoux. Presque chaque soir, des camarades venant de Petrograd traversaient le lac en barque, accompagnés du fils aîné de Jermelianov, et après un long détour dans le bois parvenaient enfin à la hutte de Lénine. « Le chemin était assez étrange. Beaucoup de camarades envisageaient ce voyage comme un grand amusement. Il faisait tellement noir qu’il était impossible de voir quoi que ce fût. En quittant la berge, le canot s’enfonçait dans les ténèbres. C’est en vain que les yeux fouillaient l’obscurité pour apercevoir simplement le contour du rivage. Ensuite le sentier nous conduisait à travers la forêt, au sein d’un silence absolu. On n’entendait rien si ce n’est le crissement des sauterelles. Au bout d’un quart d’heure on atteignait la prairie et on apprenait qu’on était arrivé à destination. » Cette nuit sombre, cette nature mystérieuse, ce chant d’oiseaux dans le feuillage, ce murmure du vent dans les branches et dans l’herbe, cette immense paix vivante de la forêt endormie, quelle douce tristesse n’eût-elle pas éveillée dans l’âme d’un rêveur solitaire ? Cette hutte au fond d’un bois, quel merveilleux royaume pour un homme fuyant les hypocrisies humaines et cherchant un refuge au cœur de la nature !
Mais Lénine n’était pas un disciple de Rousseau, non plus qu’une âme lamartinienne. Le romantisme de sa vie était fait de choses bien plus banales que cela : tout au moins, d’une banalité n’ayant rien à voir avec celle de la nature. Il aimait la sécurité de cette hutte, aux murs de laquelle, au milieu des chapeaux, des vestes, des chemises, sa perruque et celle de Zinoviev étaient pendues comme au centre d’une panoplie. Il aimait aller à la pêche, écouter le chant des oiseaux, allumer le feu sous la marmite, préparer la soupe avec le poisson qu’il avait pêché lui-même en compagnie des enfants de l’ouvrier Jermelianov, mais le charme de cette vie simple et reposante ne lui faisait pas oublier les difficultés de sa tâche et l’importance fondamentale de son rôle de chef. De sa hutte de feuillages, du fond de ces bois, il pouvait, enfin, suivre sans danger le cours des évènements : ne voyait-il pas mieux de loin que de près ? Tel un général qui du haut d’une colline, hors du tir des obus ennemis, parcourt des yeux le champ de bataille, surveille l’exécution de ses ordres, contrôle sur le terrain l’exactitude de ses calculs et la rigoureuse infaillibilité de ses principes de stratégie, et suit d’un œil satisfait le développement systématique de son plan, tel Wladimir Ilitch, du fond de sa hutte au cœur de la forêt, embrassant du regard tout le panorama de la révolution, jouissait de constater, une fois de plus, que sa méthode scientifique de poser et de résoudre les problèmes révolutionnaires se révélait beaucoup plus fondée sur la réalité que la prudence de Kamenev ou l’empirisme passionné de Trotsky.
Lénine ne perdait pas de vue un seul détail de la situation. Tous les soirs quelque camarade, souvent Staline, lui apportait de Petrograd des rapports, des lettres, des renseignements, des paquets de journaux. « Chaque jour, raconte Jermelianov, Wladimir Ilitch et Zinoviev lisaient tous les journaux qui paraissaient alors. Je me rappelle encore comment les journaux décrivaient la façon dont Lénine et Zinoviev s’étaient échappés à l’étranger. Les uns disaient que c’était dans un sous-marin, les autres en avion. Lénine rit à gorge déployée quand il lut ces hypothèses et traita de parfaits imbéciles les rédacteurs de ces feuilles bourgeoises. » Les nouvelles de Petrograd étaient bien mauvaises, mais Wladimir Ilitch, qui jugeait la situation selon ses idées et non pas selon la réalité, les accueillait avec le sourire épanoui d’un homme qui voit les évènements confirmer ses calculs et ses prévisions. Ce qui le réjouissait, c’était de constater que personne, en dehors de lui, n’avait cette entière liberté de mouvements qui est indispensable aussi bien aux chefs de révolutions qu’aux stratèges ; qu’en dehors de lui, de tous ceux qui se trouvaient mêlés aux évènements, partisans ou adversaires de Kerensky, pas un n’était maître de la situation. Curieuse idée, sans doute : mais c’est là la clef de l’attitude de Lénine aux moments décisifs de l’action révolutionnaire, aussi bien en 1905 qu’en 1917, c’est là le principe fondamental de sa stratégie. Se tenir à l’écart : voilà le secret de sa fortune. Wait and see : cette maxime de la sagesse politique anglaise, Lénine la traduisait par une formule qui avait bien son côté héroïque : « ne pas se compromettre ».
Peu à peu la hutte de branchages s’était transformée : le sol était jonché de livres, de journaux, de brochures ; la canne à pêche, délaissée, traînait dans un coin. Lénine était cerné par les papiers comme Robinson par les flots. Il passait presque toute la journée à écrire, étendu dans l’herbe, la tête appuyée sur la main gauche. Les lettres s’amoncelaient autour de lui par dizaines : il y en avait pour les membres du Comité central, pour les camarades des Soviets de Petrograd et de Moscou, pour sa femme, pour sa sœur Marie, même pour Trotsky, pour Kamenev et pour Lounatcharsky. Le plus souvent, c’était Staline qui se chargeait de remettre ces lettres à leurs destinataires. Sa correspondance terminée, Wladimir Ilitch se jetait sur ses cahiers, consultait ses notes et ses statistiques, rédigeait des articles et des proclamations. « Lénine écrivait infatigablement, dans son coin favori, derrière un grand saule », relate l’ouvrier Jermelianov. Chaque fois qu’il était pris d’une fièvre d’action, ce héros sédentaire empoignait sa plume : sa noble impatience, ses instincts de lutte, son fanatisme ardent, méticuleux, s’épanchaient en lettres et en articles. Tapi au fond d’un bois, tandis que le général Kornilov, ayant à sa gauche l’ancien terroriste Savinkov, parcourait en auto les rues de Moscou, aux acclamations des cosaques de la Dikaïa Divisia, la Division sauvage, Lénine sans détourner les yeux de ses papiers, la main armée d’une plume, cherchait son encrier dans l’herbe. Au défi de Kornilov, qui se préparait à marcher sur Petrograd pour renverser le gouvernement de Kerensky et pour étouffer dans le sang la liberté du peuple russe, Wladimir Ilitch répondait par des articles et des épîtres. Au fond, même aux heures décisives, l’action révolutionnaire de Lénine se borne à poser des problèmes en s’efforçant de les résoudre d’une façon purement théorique. Sa vision de la réalité n’est qu’une vision abstraite et doctrinaire. Qu’il siège dans un congrès ou qu’il se cache au fond d’un bois, il ne cesse jamais de faire de la polémique contre les adversaires de la révolution, c’est-à-dire contre ses adversaires personnels, quand ce n’est pas contre ses propres partisans. Son rôle est de discuter, de mettre les points sur les i. Il ne conçoit la révolution que sous la forme dialectique. Il poursuit la recherche de la vérité de contradiction en contradiction. C’est un Malebranche qui a l’horreur de l’absolu.
Dans les lettres que Lénine écrivait de sa hutte, en juillet 1917, à ses camarades de Petrograd et de Moscou, le diagnostic de la situation, les conseils au sujet des décisions à prendre, de la tactique à suivre, alternaient avec l’énoncé de principes théoriques, les discussions d’idées, de thèses, de programmes, les reproches, les récriminations et les critiques de caractère personnel. Les prétextes y étaient aussi nombreux que les arguments. Ce qui poussait Lénine à harceler ses camarades de reproches dont la plupart étaient injustes et blessants, ce n’était pas seulement la nécessité de poser sans retard le problème révolutionnaire sur le terrain insurrectionnel, de suivre les évènements de près, de guetter le moment favorable aux coups de barre les plus hardis. Ses appels à la violence lui servaient de prétexte pour marquer à ses partisans qu’il ne renonçait pas à son rôle de chef, de stratège et de Caton. Le chef de la révolution, c’était encore lui, c’était toujours ‘lui. Des considérations générales sur la nécessité de se tenir prêt à la lutte armée pour la conquête du pouvoir, il en venait invariablement, avec une monotonie trahissant en lui des préoccupations par trop personnelles, à la nécessité d’accepter ses décisions sans discussion, de se soumettre à sa volonté aveuglément. Fidèle à sa tactique de se maintenir par tous les moyens à la tête du parti pour se trouver un jour, de droit, à la tête de la révolution victorieuse, il se préoccupait moins de contrôler les évènements que de surveiller l’humeur de ses camarades, et leur attitude à son égard. Ne pouvant suivre de près les agissements de la minorité bolchevique au sein du Soviet de Petrograd (sans doute fallait-il conquérir la majorité au Soviet : mais n’avait-il pas déjà vu, en 1905, que celui qui aurait en mains le Soviet de la capitale serait par ce seul fait le véritable maître de la situation ?), Wladimir Ilitch allait jusqu’à tenir à Zinoviev des propos tout à fait étonnants sur le rôle des Soviets. « Lénine, raconte Zinoviev, a même douté à un certain moment que les Soviets, corrompus par les opportunistes, pussent jouer un rôle décisif. Il donnait le mot d’ordre que nous devions peut-être prendre le pouvoir en dehors des Soviets ». C’est-à-dire qu’on eût dû le prendre en dehors de tous ceux qui menaçaient de le compromettre par leur prudence, comme Kamenev, ou par leur imprudence, comme Trotsky. Lénine avait tout à craindre soit d’un accord éventuel avec la majorité menchevique du Soviet de Petrograd, soit d’un coup de tête de Trotsky. Dans un cas comme dans l’autre, il lui eût nécessairement fallu partager avec ses adversaires, ou avec les plus dangereux d’entre ses partisans, son rôle de chef de la révolution. Heureusement pour lui que Trotsky, Kamenev, Lounatcharsky, Krilenko, Raskolnikov, ce médiocre et rusé Krilenko qui avait un tel ascendant sur les soldats, cet affreux Raskolnikov aux yeux trop clairs, aux mains trop blanches pour un honnête homme, étaient en prison, dans l’impossibilité de profiter de son absence. Pour le moment, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Pourquoi Lénine ne profiterait-il pas de l’absence de ses « lieutenants » ? Il fallait agir avant qu’il fût trop tard. Mais sur quelles forces s’appuyer ? Quels pouvaient être les leviers de la situation ? À qui pouvait-il se fier ?
Vers la fin de juillet, les nouvelles de Petrograd devenaient de jour en jour plus mauvaises. Wladimir Ilitch en concluait que la situation favorisait ses desseins. Le désordre, dans la capitale, était épouvantable. Impuissant à contenir la poussée révolutionnaire des masses, le gouvernement de Kerensky s’enlisait de plus en plus dans le jeu des compromis et des chantages. Bien que le parti bolchevique ne fût qu’une faible minorité, son influence sur les masses allait croissant de manière alarmante. Les matelots de Cronstadt, les ouvriers de Poutilov et de Viborg, et cette multitude affamée de deux cent mille déserteurs campés dans les rues, constituaient, avec quelques unités de la garnison de Petrograd, ce que les journaux bourgeois appelaient le « front unique léniniste ». Que pouvait-on opposer à cette redoutable armée bolchevique ? Les socialistes révolutionnaires, les mencheviks, les cadets, c’est-à-dire un état-major sans soldats ? Cet état-major était, pourtant, le seul allié sur lequel le gouvernement provisoire pût compter. Heureusement, le « front unique léniniste » manquait de cadres. C’était là sa faiblesse. Mais comment Kerensky eût-il pu profiter de la faiblesse de ses adversaires ? Le drapeau rouge flottait sur les tranchées : les soldats, ivres morts, jetaient leurs fusils par-dessus les barbelés ou se traînaient dans le no man’s land pour aller embrasser leurs frères d’Allemagne. Le général Kornilov, dont la bravoure n’avait d’égale que la férocité, faisait à Moscou des apparitions de plus en plus fréquentes. L’ancien terroriste Savinkov, ce Machiavel botté à la cosaque qui avait trouvé en Kornilov son César Borgia, parlait ouvertement d’un putsch contre Kerensky. Les articles que Lénine envoyait chaque jour à la Pravda excitaient les masses à la révolte et au pillage. La Pravda, cette torche enflammée, n’allait-elle pas mettre le feu aux poudres ? Les appels à la violence que Lénine faisait répandre à des milliers d’exemplaires dans les usines et dans les casernes sortaient, c’est vrai, de la bouche d’un fou, mais rien n’était plus contagieux que la folie de ce « monstre altéré de sang ».
Tandis que Zinoviev allait à la chasse, le « monstre altéré de sang » restait allongé dans l’herbe, la plume à la main, fort perplexe sur les décisions à prendre. Sa folie était du genre hamlétique. Il fallait agir sans retard. Mais le domaine de l’action était pour lui continent interdit, terre inexplorée, île mystérieuse entourée de sables mouvants. Ses souliers étaient bien trop lourds pour qu’il s’aventurât sur cette vase gluante. L’action, cet art profane, ce non plus ultra de l’empirisme, cette religion mêlée de superstitions vulgaires et d’immortels principes, comment eût-il pu découvrir ses mystères et trouver son secret ? Il répugnait à croire que ce fût le secret de la révolution. L’énigme que ce Sphinx lui proposait d’une voix enchanteresse, serait-il jamais capable de la résoudre ? « Devine ou je te dévore », disait le Sphinx. Cette voix douce remplissait de murmures les bois profonds autour de la hutte de branchages. Elle se mêlait au chant des oiseaux, au ronronnement du samovar, au rire frais des fils de Jermelianov, à la voix grave de Zinoviev. En face du Sphinx, ce monstre demeurait indécis et timide. Quel Œdipe manqué ! À la tombée de la nuit, parfois, il marchait dans la forêt vers la berge du lac de Rasliw, à la rencontre des camarades qui lui apportaient tous les soirs les journaux et les nouvelles de Petrograd. La barque glissait sur les eaux du lac, invisible : on entendait déjà la voix de Jermelianov et le grincement des avirons dans les glissières. N’allait-il pas voir débarquer d’ici peu, sur ce rivage paisible, Monsieur Trotsky, le plus nécessaire et le plus dangereux de ses lieutenants ? Ce Trotsky, tout de même, quel homme extraordinaire ! Si la révolution n’existait pas, il l’inventerait. C’est lui qui proposerait des énigmes au Sphinx. Voilà un Œdipe qui ne rougirait pas de sa situation de famille et n’accepterait pas de se crever les yeux pour faire plaisir à la Fatalité. Si l’art d’agir est un art vulgaire, rien n’est assez vulgaire pour cet homme d’action. Sans doute, si Trotsky était là.....
Au commencement du mois d’août, Lénine renonce enfin à jouer un rôle qui n’est pas le sien. Il se rend compte qu’il n’arrivera jamais, à lui tout seul, à résoudre le problème révolutionnaire sur le terrain insurrectionnel. Il lui faut des lieutenants pour appliquer à la situation les principes de sa stratégie. Le seul homme capable de créer une troupe de choc, d’organiser l’insurrection, de s’emparer de l’État, conformément aux règles immuables de l’art de la guerre, de rester fidèle à Marx sans trahir Mars, c’est Trotsky, ce ne peut être que Trotsky, mauvais stratège mais bon tacticien, c’est-à-dire homme d’action. Il faut donc remettre la partie à plus tard. En attendant, Lénine revient à son rôle de stratège. Ne pouvant résoudre tout seul le problème révolutionnaire sur le terrain insurrectionnel, il se borne, comme toujours, à le poser. Au fond, la situation n’est pas claire. Pour la rendre claire à ses propres yeux, c’est-à-dire pour fixer le destin de la révolution, Lénine va mettre de l’ordre dans ses idées, donner une logique aux évènements. Il faut que tous les détails de la situation soient classés, catalogués, mis en fiches. La révolution prolétarienne sortira un jour tout armée de sa tête, comme Athéna du crâne de Zeus. Le rôle de Trotsky se bornera à donner le coup de hache. Mais pour conduire à terme la tâche qu’il se propose, il lui faut un refuge plus tranquille et plus sûr, un foyer, un climat plus familial : une maison. Ce lac, ces bois, ont trop de charmes pour un marxiste scientifique qui doit « penser » la révolution. Il ne peut pas jouer indéfiniment au Robinson dans une hutte de feuillages. Pour voir clair dans la situation, ce bonhomme a besoin de se sentir chez lui.
VIII
« LA TÊTE ME TOURNE »
À Helsingfors, capitale de la Finlande, encore plus loin, toujours plus loin des hommes et des évènements, ce petit bourgeois qui a besoin, pour bouleverser la Russie de se mettre à l’abri sous un toit et sous une perruque, ce « monstre altéré de sang » et de confort, se sent enfin chez lui. Zinoviev est retourné à Petrograd : c’est Nadejda Konstantinowna qui l’a remplacé auprès de Wladimir Ilitch, la bonne, la pauvre Nadejda, aux gros yeux clairs à fleur de tête, aux mains gonflées, au sourire triste de femme stérile et lasse. Elle a, pour cet Œdipe manqué, des attentions maternelles, une dévotion d’épouse et de sœur. Cet homme si terrible, elle seule sait l’apaiser. Ainsi que toutes les femmes, elle sait très bien que les hommes terribles sont une invention sentimentale des hommes doux.
La ville est sûre, la maison confortable. Comme à Munich, à Genève, à Paris, Lénine s’enferme du matin au soir dans sa chambre, la tête penchée sur sa table de travail. L’ouvrage dans lequel il se propose de donner une logique à la révolution et de jeter les bases d’un nouvel État (il voudrait construire un État qui fut comme une maison, une maison énorme, capable de contenir tout le peuple russe, toute l’histoire de demain, tout l’avenir de la Russie et dans laquelle il pût se sentir vraiment chez lui) cet ouvrage, c’est L’État et la Révolution. En architecte qui connaît les lois des forces, il veut que les murs soient massifs, que les colonnes, les arcs, les voûtes, les poutres et les architraves puissent porter le toit de l’Europe et de l’Asie. Du fond de cette énorme maison, d’une petite pièce du dernier étage de cet État gigantesque, Lénine donnera une logique à la révolution, des lois nouvelles aux hommes, un sens nouveau à la vie humaine. « Il nous faut un pouvoir révolutionnaire, il nous faut (pour une certaine période de transition) un État. » Ces paroles que Lénine écrivait à Zurich en mars 1917 dans un article, De la Milice prolétarienne, destiné à la Pravda, résument le leitmotiv qui revient à chaque page de l’État et la Révolution.
Vers la fin d’août, tandis que le général Kornilov, à la tête de sa Division sauvage, quitte Moscou au son des cloches pour marcher sur Petrograd, Lénine, dans sa confortable maison d’Helsingfors, analyse les leçons que Marx et Engels ont tirées des révolutions de 1848 et de la Commune de Paris, sur la question de l’État. Un camarade envoyé par Staline réveille au milieu de la nuit Wladimir Ilitch, le met au courant de la situation. Pour défendre la « liberté du peuple russe » contre les cosaques de la Division sauvage, Kerensky a fait appel aux matelots rouges de Cronstadt et de Viborg, et aux déserteurs. Pris entre la menace du putsch réactionnaire et le danger bolchevique, le gouvernement provisoire se jette dans les bras de ses ennemis d’extrême-gauche : il oppose aux cosaques de Kornilov le « front unique léniniste ». Ce geste intelligent, Kerensky devait le payer cher. C’est sur l’ordre de Kerensky que les portes de la prison de Kresty s’ouvrent : remis en liberté, les lieutenants de Lénine, les bactéries de la révolution, vont empoisonner la Russie. Aussitôt délivré, Trotsky se rend au siège du Soviet, et, dans un violent discours, proclame la nécessité d’instaurer la terreur jacobine. « La guillotine mène à Napoléon », lui crient les mencheviks, qui ont la majorité au sein du Soviet. « J’aime mieux Napoléon que Kerensky », répond Trotsky. Quand on lui rapporte ces paroles de Trotsky, Wladimir Ilitch fronce le sourcil et repousse d’un geste nerveux les pages manuscrites de l’État et la Révolution amoncelées sur sa table. Il vient d’achever son sixième chapitre, sur « Le marxisme avili par les opportunistes ». Son travail n’ira pas plus loin : il n’écrira jamais de septième chapitre. Que va faire Trotsky ? C’est l’éternelle question. Que faire ? Que vont faire les autres ? Pendant toute sa vie il ne pourra jamais répondre à cette question. Il faut surveiller Trotsky, pense-t-il. « Trotsky aime mieux Napoléon que Lénine », dira plus tard Dzerjinski.
Tel un gentilhomme de Versailles qui eût préféré se faire tuer sur place plutôt que croiser l’épée avec le bâton d’un manant, le général Kornilov, devant la colère menaçante des soldats et des ouvriers de Petrograd, s’arrêta aux portes de la capitale et rebroussa chemin de l’air le plus fier et le plus satisfait du monde. Les cosaques de la Division sauvage s’en retournèrent au petit trot jusqu’à Moscou derrière leurs fifres qui jouaient d’allègres marches. Il y avait de l’Offenbach dans cette tragédie shakespearienne. Pendant que Trotsky se jetait à corps perdu à la conquête du Soviet de Petrograd, Wladimir Ilitch, ainsi qu’il le dira plus tard dans sa préface à la première édition de l’État et la Révolution, se rendait compte brusquement « qu’il est plus utile de faire l’expérience d’une révolution que d’écrire sur elle ». Langage plein d’humour dans la bouche d’un homme d’une prudence aussi fanatique. Laissant là son ouvrage en plan à la fin du sixième chapitre (« j’avais aussi, raconte-t-il, tracé le plan d’un chapitre VII : Expérience des révolutions russes de 1905 et 1917, mais en dehors de ce titre je n’ai pas eu le temps d’en écrire une seule ligne, empêché que j’en ai été par la crise politique, préliminaire de la révolution d’octobre »), Wladimir Ilitch reprit avec ardeur son rôle de stratège : il se mit, comme toujours, à écrire des articles et des lettres, et à faire, comme toujours, de l’opportunisme au nom de l’intransigeance.
« Le soulèvement de Kornilov, écrivait-il vers les derniers jours d’août 1917, dans une lettre sans date adressée au Comité central du parti, à un tel moment et sous une telle forme, est un coup de théâtre formidable pour ne pas dire incroyable. Comme tout revirement brusque, il exige une révision de tactique. Et là, comme dans toute révision, il faut être archi prudent, pour ne pas faillir aux principes. » (archi-prudent, c’est bien le mot). « En quoi consiste, ajoutait-il, notre changement de tactique après l’aventure de Kornilov ? Il faut faire de l’agitation contre Kerensky, mais de l’agitation plutôt indirecte que directe. » Il terminait sa lettre au Comité central en rappelant que « dès demain les évènements peuvent nous obliger à prendre le pouvoir », que « le moment de l’action est venu », que « Kerensky a peur des masses ». Dans un article intitulé Des Compromis, écrit le 3 septembre, Wladimir Ilitch notait : « L’idée que la foule se fait actuellement des bolcheviks, idée entretenue par une presse calomniatrice, c’est que les bolcheviks ne consentent jamais, ni avec personne, à aucun compromis. Cette idée est flatteuse pour nous, mais ne correspond pas à la réalité. Le devoir d’un parti véritablement révolutionnaire n’est pas de proclamer une renonciation impossible à toute espèce de compromis, mais de savoir, à travers tous les compromis, dans la mesure où ceux-ci sont inévitables, rester fidèle à ses principes, à sa classe, à son but révolutionnaire, à la préparation de la révolution et à l’éducation des masses qu’il faut mener à la victoire. » Ce langage ne saurait être plus clair. Tout au plus peut-on dire que c’est là un langage prudent, mais prétentieux.
Candide et Babbitt, à qui le Lénine de septembre 1917 semble de loin, des rives de la Seine et du Potomac, l’unique moteur de la poussée révolutionnaire du peuple russe, ne liront pas sans surprise les déclarations de ce Gengis-Khan opportuniste. « Nous nous trouvons, écrivait Wladimir Ilitch le 3 septembre dans ce même article, Des Compromis, nous nous trouvons maintenant en présence d’un tournant si brusque, si original de la révolution russe, que nous pouvons, en tant que parti, proposer un compromis volontaire non pas à la bourgeoisie, notre ennemie directe et principale, mais à nos adversaires les plus proches, aux partis petit-bourgeois démocratiques dirigeants. » Il insistait sur le fait qu’il s’agissait « non pas d’un compromis forcé, mais d’un compromis volontaire ». Et il ajoutait : « Ce n’est qu’exceptionnellement, ce n’est qu’en vertu d’une situation spéciale qui, vraisemblablement, durera très peu de temps, que nous pouvons proposer un compromis à ces partis et que nous devons, me semble-t-il, le faire. » Quel était donc ce compromis ? « Ce qui est un compromis pour nous, c’est le retour à notre revendication d’avant juillet : tout le pouvoir aux Soviets ! Formation d’un gouvernement de socialistes révolutionnaires et de mencheviks, responsable devant le Soviet. » Mais Candide et Babbitt auraient-ils seuls le droit d’être surpris ? « Un gouvernement semblable, déclarait Lénine, pourrait être créé et consolidé pacifiquement. Il pourrait assurer la progression pacifique de la révolution. » Ce n’est qu’en lisant ces paroles de Wladimir Ilitch qu’on comprend le rôle décisif de Trotsky dans le coup d’État bolchevique.
Pour un petit bourgeois fanatique, il n’y a pas d’idées ridicules. Rien de ce qui est du domaine des principes, des doctrines et des idées, ne saurait offrir matière au ridicule. Les idées, même celles des adversaires, sont toujours dignes de la plus grande considération. Il faut les prendre au sérieux : on peut les combattre, mais les combattre sérieusement. Lénine était-il bien certain, en septembre 1917, qu’aucun de ses adversaires ou de ses amis ne riait de son « compromis volontaire » et de la « progression pacifique » de la révolution ?
Tandis que Trotsky marchait résolument, à la tête d’une faible minorité bolchevique, à la conquête de la majorité au sein du Soviet de Petrograd, Lénine écrivait tranquillement que les bolcheviks, « partisans des méthodes révolutionnaires, pouvaient et devaient accepter un compromis semblable pour permettre le développement pacifique de la révolution ». Tandis que Trotsky renversait Tzeretelli et était nommé, à une très forte majorité, président du Soviet de la capitale, Lénine écrivait d’Helsingfors que « les bolcheviks gagneraient à ce compromis » en ce sens qu’ils obtiendraient la possibilité d’exercer leur influence dans les Soviets, grâce à la réalisation effective de la démocratie intégrale. Tandis que Trotsky créait au sein du Soviet un Comité militaire révolutionnaire et qu’il organisait secrètement des équipes de combat formées de techniciens, d’ouvriers et de matelots, Lénine, au cours d’un article paru dans la Pravda du 14 septembre, déclarait que « le pouvoir aux Soviets était le seul moyen d’assurer l’évolution graduelle, pacifique, indolore des évènements ».
Le Plutarque officiel du Kremlin, Jaroslavski, ne nous cache pas que « Lénine, en septembre, estimait encore possible une issue pacifique : il croyait encore que nous pouvions assurer le développement pacifique de la révolution, la concurrence pacifique des partis au sein des Soviets, le passage pacifique du pouvoir d’un parti à l’autre, à condition que les Soviets prissent le pouvoir en mains ». L’attitude de Wladimir Ilitch ne saurait sembler surprenante qu’à Babbitt, à Candide, et à tous ceux qui voient en lui le Gengis-Khan du marxisme, le Mahomet de la révolution prolétarienne. Il est tout à fait naturel, d’autre part, que les mencheviks eux-mêmes se soient, dès lors, trompés sur son attitude : chez ce petit bourgeois fanatique, chez ce bonhomme qui croyait diriger le cours de la révolution par des lettres et par des articles, qui s’imaginait plier les tragiques évènements de septembre à la loi médiocre et commode de l’opportunisme, ils voyaient bien plutôt un Machiavel qu’un Gengis-Khan. En réalité, ce qu’ils prenaient pour de la ruse, n’était autre chose qu’une naïve incompréhension des évènements. N’étant pas au courant du véritable rôle de Lénine, ils attribuaient au leader bolchevique toute la responsabilité de l’action révolutionnaire du parti : le rôle de Trotsky n’étant qu’un rôle secondaire, un rôle d’exécutant. C’est ainsi que les invitations de Lénine au « compromis volontaire », les propositions qu’il adressait aux mencheviks et aux socialistes révolutionnaires pour la création d’un front unique, en vue d’assurer « l’évolution graduelle pacifique, indolore des évènements » étaient repoussées par ses adversaires avec dédain. Elles ne pouvaient tendre qu’à couvrir les agissements de Trotsky et à masquer les préparatifs de l’insurrection. Mais aux yeux de ses camarades, qui, hélas, avaient appris à le connaître à leurs dépens, Wladimir Ilitch n’était alors qu’un doctrinaire inoffensif, un théoricien à l’écart des évènements depuis trop longtemps, pour se rendre compte de la réalité de la situation.
En fin de compte, tant qu’il restait caché à Helsingfors, Lénine ne gênait personne : on pouvait tout aussi bien le laisser où il était. Mieux valait qu’il restât tranquille en Finlande à écrire des articles que nul ne prenait au sérieux, si ce n’est Kamenev et Zinoviev, plutôt que de le voir s’installer à Petrograd, se mêler de choses qui marchaient fort bien sans lui, brouiller les cartes, donner des conseils et des ordres, gêner tout le monde par l’exercice d’une autorité malheureusement indiscutable et bien dangereuse à discuter alors. Au fond, les articles de Wladimir Ilitch étaient fort amusants. Kamenev et Zinoviev, les seuls à approuver ouvertement la thèse léniniste de l’évolution graduelle, pacifique et indolore de la révolution, ne pouvaient s’empêcher de sourire quand ils lisaient certains articles de Lénine, par exemple celui de la Pravda du 15 septembre, où le leader bolchevique prétendait résoudre, au profit du parti, la question de la liberté de la presse. La mesure proposée par Wladimir Ilitch est bien plus ridicule encore que naïve : et l’on s’étonne de la voir réalisée dans un des premiers décrets du gouvernement des Soviets, en date du 8 novembre 1917, qui déclarait l’insertion des annonces monopole de l’État et limitait l’insertion d’annonces privées aux Izvestia, journal officiel des Soviets. « Pourquoi une démocratie qui se dit révolutionnaire, écrivait Lénine dans la Pravda, ne pourrait-elle pas prendre une mesure comme la monopolisation, au profit de l’État, des annonces privées faites dans les journaux ? Pourquoi n’interdirait-elle pas d’imprimer des annonces ailleurs que dans les journaux édités par les Soviets en province, et par le Soviet central à Petrograd ? Pourquoi une démocratie révolutionnaire serait-elle obligée de tolérer que les journaux bourgeois, qui répandent le mensonge et la calomnie contre les Soviets, s’enrichissent au moyen des annonces privées ? » Lénine, à vrai dire, devait plus tard changer d’idée. Mais cette mesure qu’il demandait dans un article de la Pravda trente jours avant le coup d’État, et mettait en vigueur, dix jours après avoir pris le pouvoir, par un décret du gouvernement des Soviets, afin de résoudre la question de la liberté de la presse (« Le monopole, écrivait-il, serait la restauration et l’extension de la liberté de la presse ») serait une preuve de plus, s’il était nécessaire d’en donner, qu’à la veille du coup d’État Lénine n’avait aucune idée de ce qu’allait être la dictature du prolétariat, l’État communiste. En septembre 1917, et même plus tard, puisque le décret sur le monopole des annonces privées dans les journaux porte la date du 8 novembre 1917, sa confiance dans « l’évolution graduelle, pacifique et indolore des évènements » était donc assez grande pour qu’il jugeât possible, dans l’État communiste, la survivance de la presse bourgeoise et des organisations bancaires et industrielles, qui sont, dans la société capitaliste, la source principale de la publicité des journaux.
Les biographes officiels de Lénine, tout en soulignant sa confiance dans l’évolution pacifique et indolore des évènements, ne se soucient pas d’expliquer et de justifier son attitude à la veille du coup d’État. Ils se contentent d’affirmer que « le moteur de la révolution » c’était Lénine. Ce dogme, ni Babbitt ni Candide ne se sont jamais risqués à le discuter. Ce n’est que plus tard, au cours de la polémique Trotsky-Staline, c’est-à-dire deux années après la mort de Wladimir Ilitch, que la discussion instituée sur le rôle de Trotsky dans la conquête du pouvoir, a projeté sur l’attitude de Lénine pendant la préparation du coup d’État une lumière crue. Si le Gengis-Khan du marxisme sort quelque peu diminué de la polémique Trotsky-Staline, il faut reconnaître en revanche que le bonhomme Lénine, le héros petit-bourgeois, le véritable Wladimir Ilitch, ne peut que bénéficier de cette mise au point. Ce révolutionnaire en perruque qui, « du fond de son cabinet de travail », dans la sûre et confortable maison d’Helsingfors, exprimait en un langage si violent une confiance, à ce point candide, dans l’issue pacifique et indolore de la révolution, nous paraît aujourd’hui bien plus dangereux, bien plus terrible que tous ceux qui croyaient aveuglément, comme Trotsky, à la nécessité de la chirurgie révolutionnaire. C’est en souriant, d’un air gauche et timide, que Lénine a bouleversé la Russie. Il n’a pas soupçonné un seul instant que ses principes, ses thèses, ses doctrines, seraient aussi féconds en misères et en massacres. Sa cruauté, on l’a dit, n’était que platonique. Il ne tirait de ses idées que des conséquences heureuses, « indolores », comme il disait. Ainsi que tous les petits bourgeois fanatiques, race redoutable et actuelle, il poussait le fanatisme à un point tel qu’il avait le plus grand respect pour ses idées, et ce respect pour ses idées il le poussait à un point tel qu’il croyait celles-ci bienfaisantes. Il y avait du philanthrope dans ce monstre à l’état platonique. Les autres, ses « lieutenants », les héros d’octobre 1917, n’ont fait que tirer de ses idées leurs conséquences immédiates. Des conséquences plus logiques, peut-être, mais assurément médiocres et humaines.
Vers la fin de septembre, lorsqu’il s’aperçoit que Trotsky se prépare à tirer les conséquences immédiates des principes et de la logique du léninisme, Wladimir Ilitch quitte brusquement Helsingfors et se rend à Petrograd. On ne trouve pas dans ses biographies une justification de ce revirement. On en trouve dans les articles et dans les lettres qu’il écrivait quelques jours avant son départ pour la capitale. Dans un article intitulé L’Épouvantail de la guerre civile (Pravda du 16 septembre), il avait déjà affirmé que la guerre civile serait inévitable si les mencheviks ne renonçaient pas à leur alliance avec les partis bourgeois. « Si la démocratie continue sa politique d’oscillations et de conciliation, écrivait-il, nous nous disons : rien n’est aussi fatal à la révolution prolétarienne que ces oscillations. Donc, Messieurs, ne cherchez pas à nous effrayer avec le spectre de la guerre civile : cette guerre est inévitable si vous ne vous décidez pas à rompre sur-le-champ, et définitivement, avec la coalition bourgeoise. » Dans un autre article : Les Objectifs de la révolution (Pravda du 26 et du 27 septembre), il revenait encore sur les dangers de la situation. « Si les Soviets prenaient le pouvoir, ils pourraient encore, et c’est probablement la dernière chance, assurer le développement pacifique de la révolution, l’élection pacifique par le peuple de ses députés, la concurrence pacifique des partis au sein des Soviets, le passage pacifique du pouvoir d’un parti à un autre. Si on ne profite pas de cette possibilité, la guerre civile entre la bourgeoisie et le prolétariat est inévitable. » Dans une lettre adressée au Comité central du parti, au Comité de Petrograd et au Comité de Moscou, lettre non datée, mais qui est des derniers jours de septembre, Lénine lance au parti ce mot d’ordre : « Les bolcheviks peuvent et doivent prendre le pouvoir. » Il ne s’agit pas pour lui « de fixer ni le jour ni le moment de l’insurrection : la date exacte ne peut être fixée que par ceux qui sont en contact avec les ouvriers et les soldats, avec les masses ». Il s’agit « de rendre clair au parti sa tâche, qui est de mettre à l’ordre du jour l’insurrection armée à Petrograd et à Moscou ». Son Clausewitz est là sur sa table, à portée de sa main. Le jour de la bataille approche : les gardes rouges de Trotsky crachent sur leurs cartouches en chargeant leurs fusils. Lénine, cet amateur de stratégie militaire, reste fidèle à son Clausewitz sans trahir Marx.
Sa préoccupation de rester fidèle aux principes du marxisme se montre surtout dans une lettre qu’il adressa au Comité central du parti quelques jours avant de quitter Helsingfors, et dans un article, Les Bolcheviks conserveront-ils le pouvoir ?, paru dans la Pravda au début d’octobre. Dans sa lettre au Comité central, Lénine pose le problème de l’insurrection du point de vue marxiste. « L’insurrection est un art », affirme l’auteur du Capital. Peut-on accuser les marxistes de blanquisme parce qu’ils considèrent l’insurrection comme un art ? Les principes stratégiques de Clausewitz n’ont sans doute rien à faire avec les principes de la lutte de classe : mais pourrait-on comprendre Marx, le Marx des considérations sur la Commune de Paris, sans Clausewitz ? « L’insurrection, écrit Wladimir Ilitch, doit s’appuyer non pas sur un complot, non pas sur un parti, mais sur la classe avancée. C’est là le premier point. L’insurrection doit s’appuyer sur la poussée révolutionnaire de tout le peuple. C’est là le second point. L’insurrection doit éclater à l’apogée de la révolution montante. C’est là le troisième point. C’est à ces trois conditions que le marxisme se distingue du blanquisme. » Lénine ne considère pas l’insurrection en tacticien ; il la considère en stratège. Ce n’est pas une poignée d’hommes résolus qu’il veut lancer à la conquête du pouvoir, mais toute l’armée des travailleurs, toutes les masses prolétariennes, tout le peuple de Russie. Quand il écrit « Il faut lancer les régiments fidèles sur les points les plus importants, entourer le théâtre Alexandra, occuper la forteresse Pierre et Paul, mobiliser les ouvriers armés, les appeler au combat suprême », c’est à la foule, aux masses, au prolétariat tout entier qu’il pense. Dans cette tragédie, il ne voit que le chœur.
Trotsky dira plus tard que la stratégie de Lénine consiste « à mobiliser une armée pour occuper un central téléphonique ». Mais Wladimir Ilitch ne s’arrête pas aux détails de la situation. Il la voit de loin, en même temps que de haut. Il ne s’aperçoit pas que là où il se prépare à engager une armée, une patrouille suffirait. Un général regardant un champ de bataille du haut d’une colline ne saisit pas l’action tactique des voltigeurs, des éclaireurs, des patrouilles, des compagnies, des bataillons, des régiments : il ne voit que l’action stratégique des grandes unités, l’ensemble de la situation. De même, lorsqu’il brosse le tableau de la Russie au début d’octobre dans son article, Les Bolcheviks conserveront-ils le pouvoir ?, Lénine ne voit dans la situation que les conditions générales prévues par Marx pour le triomphe de la révolution prolétarienne, c’est-à-dire les circonstances favorables à l’application de la stratégie marxiste. Pour se poser des problèmes de tactique, il lui faudrait s’arrêter aux détails. Wladimir Ilitch, poussé à l’action par une manière d’exaltation lyrique, ne se pose que des problèmes d’ordre général. Chez ce bonhomme en perruque, le Gengis-Khan du marxisme ne va-t-il pas enfin se réveiller ? Des vers lui viennent aux lèvres. Ce sont des vers de Pouchkine, son poète préféré. « En réponse aux injures de nos adversaires, écrit-il dans son article, nous nous bornerons à répéter :
Le son de l’approbation nous l’entendons
Non pas dans le roucoulement de la louange
Mais dans les cris sauvages de la fureur.
Pourtant, dès son arrivée à Petrograd, la fièvre qui, depuis quelques jours lui arrache des cris d’impatience et des vers de Pouchkine, l’abandonne tout à coup. Doit-il se jeter dans la mêlée ? Doit-il ôter sa perruque, se joindre à Trotsky, prendre sa part de responsabilité à la tête de cette poignée d’hommes ardents et imaginatifs, dangereux comme des amateurs, aussi nécessaires pour leur idéalisme que pour leur brutalité ? Caché dans la maison d’un ouvrier du faubourg de Viborg, il envoie à Trotsky des billets pressants, charge Kamenev et Zinoviev de le tenir au courant de la situation, somme Staline de lui dire la vérité sur ce qui arrive, de ne rien lui cacher des projets de Trotsky, de l’attitude de tel ou tel membre du Comité central, de l’état d’esprit des ouvriers. Wladimir Ilitch sait bien que Zinoviev et Kamenev sont hostiles à l’insurrection immédiate, que les membres du Comité central se méfient l’un de l’autre, que Staline surveille de près Trotsky et ses partisans. Tout est prêt pour l’insurrection. Les gardes rouges de Trotsky, ces équipes de combat qu’Antonov-Ovseienko se prépare à lancer sur les points vulnérables de l’organisation technique de l’État, n’attendent qu’un signe pour marcher à la conquête du pouvoir. L’armée insurrectionnelle ne compte qu’un millier d’ouvriers et de matelots. Faible en apparence, elle allonge ses tentacules sur tous les engrenages de l’État. Le moment venu, sur un geste, sous une simple poussée de levier, les dents de ces engrenages sauteront : l’État ne pourra plus mordre. Le problème de l’insurrection, pour Trotsky, n’est qu’un problème d’ordre technique. « Pour s’emparer de l’État, dit-il, il faut une troupe d’assaut et des techniciens : des équipes d’hommes armés, commandées par des ingénieurs. »
Lénine « fait le point ». Mais cette fois-ci il ne se trompe pas sur la situation. « Que faire ? » se dit-il. Éternelle question. Karl Marx n’a-t-il pas écrit « qu’il ne faut jamais jouer avec l’insurrection ? » Il est trop tard pour tricher à ce jeu. Rien ne saurait arrêter l’élan de Trotsky : les rouages de l’organisation insurrectionnelle sont déjà en mouvement. Dans une lettre qu’il adresse directement aux Comités de Petrograd et de Moscou sans passer par le Comité central du parti, Lénine marque enfin son coup : « Les évènements nous prescrivent notre devoir d’une façon si nette, que l’attente devient un crime. La victoire est assurée, et il y a neuf chances sur dix pour que nous l’obtenions sans effusion de sang. Attendre est un crime envers la révolution. » Sa décision est prise : mais, fidèle aux contradictions qui règlent sa conduite depuis son retour en Russie, il garde confiance dans « l’évolution graduelle, pacifique et indolore des évènements ».
Désormais, il partage avec Trotsky la responsabilité des évènements. Mais il la partage à sa manière : en restant, comme il l’écrit lui-même le 8 octobre, à l’écart dès évènements, caché dans le faubourg de Viborg. Dans des lettres, des billets, des colloques où son impatience et son inquiétude éclatent parfois en véritables accès de colère, il flétrit l’opportunisme de certains camarades, défend Trotsky contre les prudentes réserves de Kamenev et de Zinoviev, la méfiance de Staline, la jalousie du Comité central. « La crise approche de son dénouement, écrit-il : tout l’avenir de la révolution russe est en jeu. » Bien qu’il ait une secrète méfiance pour le bovarysme insurrectionnel de Trotsky, bien qu’il ne partage pas ses idées sur l’insurrection en tant que problème d’ordre technique, Lénine se refuse à prêter l’oreille aux critiques de la commission des cinq, constituée par Staline, Boubnov, Sverdlov, Ouritzky et Dzerjinski dans le but de contrecarrer l’autorité de Trotsky. Cette commission ne fait-elle pas partie intégrante du Comité militaire révolutionnaire, dont le président est Trotsky ? Miner l’autorité du chef du Comité militaire révolutionnaire, seul responsable devant Lénine et devant le parti de la préparation du coup d’État, c’est trahir la révolution. Wladimir Ilitch fait preuve, en cette circonstance, d’une farouche énergie, qui ne manque pas de bon sens. « Il faut fixer la date de l’insurrection ! » réclament les cinq. « Avant de fixer cette date, proposent Kamenev et Zinoviev, attendons les décisions du second congrès panrusse des Soviets. » Le congrès ne se réunira que le 25 octobre. C’est trop tard. Attendre est un crime. « La prise du pouvoir par les Soviets dépend de la victoire de l’insurrection, écrit Lénine en réponse aux critiques des adversaires de Trotsky : lier la prise du pouvoir au congrès des Soviets, la subordonner aux décisions du congrès, c’est jouer avec l’insurrection. » Fixer à l’avance la date du coup d’État, ajoute-t-il, c’est faire le jeu de Kerensky.
Tout en se refusant violemment à faire le jeu de Kerensky, ce n’est pas sans effort qu’il se résigne à faire le jeu de Trotsky. Ce qui le préoccupe surtout chez le président du Comité militaire révolutionnaire, c’est son insouciance des règles fondamentales de la stratégie marxiste. « L’insurrection armée, comme la guerre, est un art », écrit l’auteur du Capital. Comme il y a une stratégie militaire, il y a une stratégie révolutionnaire. Mais Trotsky ne conçoit pas la révolution en stratège : il ne la conçoit qu’en tacticien. Il affecte le plus profond mépris pour tous ceux qu’il appelle « les stratèges de la révolution ». Ces stratèges, est-ce uniquement dans la commission des cinq qu’il faut les chercher ? Wladimir Ilitch lui aussi, se sent visé par l’orgueilleux mépris de Trotsky : il n’a pas renoncé à mettre Clausewitz au service de Karl Marx. Son rôle est d’arrêter le plan stratégique de la révolution. Le rôle de Trotsky n’est qu’un rôle de tacticien, un rôle de second plan. Le 8 octobre, dans une lettre qui jette une lumière précise sur son véritable rôle (cette lettre n’a été publiée que le 7 novembre 1920, par la Pravda, sous le titre caractéristique de Conseils d’un absent), Lénine, toujours caché dans le faubourg de Viborg, trace les grandes lignes de son plan stratégique pour la conquête du pouvoir. Le bruit court, depuis la veille, que Trotsky a fixé au jour suivant la date de l’insurrection. Lénine n’en sait rien ; du reste, il ne le dissimule pas dans sa lettre : « J’écris ces lignes le 8 octobre, sans grand espoir qu’elles soient déjà le 9 entre les mains des camarades de Petrograd. Pourtant, je tâcherai de donner mes conseils d’homme à l’écart des évènements, en escomptant que l’action probable des ouvriers et des soldats de Petrograd, qui doit avoir lieu bientôt, ne s’est pas encore produite. » En quoi consiste le plan stratégique de Lénine ? « Dans l’offensive simultanée sur Petrograd, aussi soudaine et aussi rapide que possible, du dehors et du dedans, des faubourgs ouvriers et de la Finlande, de Reval et de Cronstadt, dans l’offensive de toute la flotte, dans la concentration de forces dépassant de beaucoup les 20.000 hommes (élèves-officiers et cosaques) dont dispose le gouvernement. Il faut, ajoute-t-il, combiner nos trois forces principales : la flotte, les ouvriers et les unités militaires, pour occuper en premier lieu et garder à tout prix le téléphone, les gares et les ponts. »
Mais le 10 octobre, au cours d’une réunion du Comité central qui a lieu dans la maison du faubourg de Viborg où Lénine se tient caché, Trotsky ne dissimule pas son manque de confiance dans le génie stratégique de Wladimir Ilitch. « Tout cela est très juste, dit-il, mais trop compliqué. C’est un plan trop vaste. C’est une stratégie qui embrasse trop de territoire et trop de gens. Ce n’est plus une insurrection, c’est une guerre. Pour occuper Petrograd, point n’est besoin de prendre le train en Finlande. Quand on part de trop loin, on s’arrête souvent à mi-chemin. Déclencher une offensive de 20.000 hommes pour s’emparer du théâtre Alexandra, c’est un peu plus qu’il n’est nécessaire. » Trotsky n’a pas tort quand il affirme en souriant que les masses n’ont rien à faire avec l’insurrection. Le problème de la conquête du pouvoir n’est qu’un problème d’ordre technique. Il y a une technique du coup d’État qui n’a rien à voir avec la stratégie militaire de Clausewitz, ni avec la stratégie révolutionnaire de Mars. Il serait absurde de soulever les masses et de mobiliser la flotte, comme le prétend Lénine, pour occuper un central téléphonique. Une troupe de choc suffit : des équipes d’ouvriers et de techniciens, un millier d’hommes tout au plus. Bien que le gouvernement provisoire soit à l’agonie, Kerensky est toujours suffisamment fort pour tenir tête à un soulèvement de masses. Tout en parlant, Trotsky a ôté ses lunettes. Ses yeux myopes se promènent, sans les voir, sur les visages méfiants des membres du Comité central. C’est avec un sourire narquois qu’il compare Kerensky à Napoléon : sait-on jamais, au juste, à quoi se rapportent les comparaisons de Trotsky ? Kerensky, dit-il, se croit un Napoléon : pour le battre, un autre Napoléon serait de trop. Un sous-officier : voilà ce qu’il faut à la révolution prolétarienne.
Du 10 octobre au 24, Lénine se replie sur lui-même. Pendant quatorze jours il demeure « à l’écart des évènements », pâle et fiévreux, dans l’attente de l’insurrection, de ce que Trotsky appelle « un coup de poing à un paralytique ». Dans les lettres, les billets, les messages, qu’il envoie chaque jour à Trotsky, à Staline, à Dzerjinski, à Zinoviev, à Kamenev, sous l’impatience, l’inquiétude perce. Non, heureusement, Kerensky n’est pas un Napoléon. Mais il y a une chose encore plus dangereuse, c’est que Trotsky n’est pas un sous-officier. Quel homme étrange, ce Trotsky ! Est-il vraiment, comme le prétendent ses partisans, un homme d’un courage à toute épreuve, téméraire jusqu’à la folie, ou bien un ambitieux sans scrupules, peureux sous un masque d’orgueil, un aventurier qu’aucune lâcheté ne peut faire reculer ? « C’est un lâche qui n’a peur de rien », pense Lénine. Maintenant, sa décision est prise : il est prêt à tout. La veille du coup d’État, remarque Trotsky, « Wladimir Ilitch était plus calme et plus assuré, je dirais même moins soupçonneux ». Comme toujours quand il est prêt à tout, quand il s’est mis entre les mains de quelqu’un, ce qui veut dire, chez lui, se décider à l’action, Lénine laisse faire les autres : il ne se mêle de rien. C’est la manière la plus hardie de prendre la responsabilité des évènements. C’est le courage des timides.
Dans la nuit du 23 au 24 octobre, Trotsky fait avertir Lénine de se tenir prêt. « Ce sera pour demain. » Vers dix heures du matin le bruit court qu’il se passe quelque chose d’extraordinaire. Wladimir Ilitch envoie prendre des nouvelles. La ville est en proie à un désordre épouvantable. Des autos blindées hissant le drapeau rouge, des camions chargés de matelots et d’ouvriers, fendent à grands coups de sirène la foule massée dans les rues du centre. Des détachements de gardes rouges ont occupé l’hôtel des Postes, le central téléphonique et télégraphique, les gares de chemin de fer, les ponts sur la Neva, les gazomètres, les centrales électriques municipales, tous les points vulnérables de l’organisation technique de l’État. Trotsky ne s’est pas occupé de renverser le gouvernement ; il s’est emparé de l’État. C’est dans cette situation paradoxale qu’est le secret de la technique insurrectionnelle de Trotsky. Les opérations se sont déroulées avec une rapidité et une régularité surprenantes. Aucun évènement sanglant ne marque la première journée de l’insurrection : à peine quelques coups de fusil dans le faubourg de Poutilov. Vers la fin de l’après-midi, le drapeau rouge flotte sur tous les bâtiments publics. Une foule énorme s’entasse du côté de l’Amirauté, devant le Palais d’Hiver, défendu par quelques compagnies de junkers et un bataillon de femmes. Surpris par les évènements, les membres du gouvernement provisoire se sont réfugiés au Palais d’Hiver. Kerensky s’est enfui : on dit qu’il est allé au front rassembler des troupes pour marcher sur Petrograd. Le ciel est gris, l’air froid : des lacs du Nord, les brumes d’automne descendent barrer l’embouchure de la Neva. Le pas des gardes rouges résonne sur le pavé des rues comme sur une plaque de cuivre. Le vent d’Est frappe sur les nuages bas massés à l’horizon, comme sur un tambour. Cronstadt est en marche ; dans la nuit du 24 au 25 octobre les matelots de la flotte de la Baltique s’unissent aux ouvriers de Trotsky. Ils sont conduits par Dybenko, l’athlétique marin Dybenko, calme et souriant, féroce et mélancolique. Les croiseurs Aurora et Tzaria Svobody, ancrés dans la Neva sous les ordres de Raskolnikov, braquent leurs réflecteurs sur le Palais d’Hiver. Raskolnikov, quel nom prédestiné !
« Je ne devais revoir Lénine, raconte Trotsky, que le 25 octobre, à l’Institut Smolny, quartier général de l’insurrection. À quelle heure ? Je n’en ai plus aucune idée ; probablement vers le soir. » Trotsky, dont les souvenirs sont toujours exacts, est indécis sur l’heure où Lénine, le chef de la révolution, fait son entrée à l’Institut Smolny. L’arrivée de Wladimir Ilitch n’est qu’un détail sans grande importance. Trotsky n’a pas le temps de s’occuper de détails inutiles. Ce qui le préoccupe à ce moment, c’est la menace d’une contre-offensive des troupes fidèles à Kerensky, que le général Krasnov rassemble dans les environs de Petrograd, à Kolpino, à Oboukhov, à Poulkov. Il faut hâter l’occupation du Palais d’Hiver. L’insurrection est terminée. Maintenant, c’est la révolution qui commence. De la tactique, Trotsky passe à la stratégie. Le sous-officier s’improvise général. Il n’a pas le temps de préparer une réception officielle au chef de la révolution. Affublé d’une perruque, déguisé en ouvrier, Lénine gravit lentement l’escalier de l’Institut Smolny, parcourt les corridors remplis de gardes rouges, monte au dernier étage, frappe à la porte du cabinet de Trotsky. « Entrez », dit Trotsky. L’arrivée de Lénine a passé inaperçue.
« Wladimir Ilitch, raconte Trotsky, m’aborda en me posant une question anxieuse sur les pourparlers que nous avions avec l’état-major du corps d’armée de Petrograd, au sujet du sort de la garnison. D’après les journaux, les pourparlers approchaient d’une solution satisfaisante. – Vous marchez vers un compromis ? demanda Lénine. Je répondis que nous avions fait lancer exprès par les journaux cette nouvelle rassurante, et que ce n’était là qu’une ruse de guerre au moment où s’engageait la bataille générale. – Ah ! ça c’est bien ! s’écria Lénine d’une voix chantante et gaie : et, retrouvant tout son entrain, il se mit à arpenter la pièce en se frottant les mains. Wladimir Ilitch aimait les stratagèmes. Duper l’ennemi, n’est-ce pas ce qu’on peut imaginer de plus délectable ? Tout à coup Lénine aperçut une affiche fraîchement imprimée, menaçant d’une exécution sommaire quiconque tenterait un pillage. Tout d’abord, Wladimir Ilitch fut comme interloqué : il me sembla même qu’il était en proie à un doute. Mais il dit presque aussitôt : – Bon ! c’est juste ! – Il se jetait avidement sur tous ces petits détails de la grande affaire. Pour lui c’étaient autant de preuves indiscutables que, cette fois-ci, tout marchait, qu’on avait passé le Rubicon, qu’un retour en arrière n’était plus possible. Je me rappelle l’énorme impression que fit sur Lénine le fait que j’avais convoqué, par un ordre écrit, une compagnie du régiment Pavlovski pour assurer la publication de notre journal.
– Alors, la compagnie est venue ?
– Parfaitement.
– On est en train de composer le journal ?
– Oui, ça marche !
Lénine était transporté, ce qui se manifestait chez lui par des rires et des exclamations. Il se frottait les mains. Puis sa mine devint pensive, il réfléchit un instant et dit : – Alors on peut aussi faire les choses de cette manière !... Pourvu que nous prenions le pouvoir ! – Je compris qu’à ce moment-là seulement il admettait de façon définitive l’idée de renoncer à s’emparer du pouvoir par une conjuration. »
Trotsky ajoute que, jusqu’à la dernière heure, Lénine ne dissimula pas ses doutes, ses craintes quant à l’issue des opérations révolutionnaires. « Ce n’est que ce soir-là, le 25 octobre, qu’il se calma et qu’il approuva définitivement la voie dans laquelle les évènements étaient engagés. Je dis qu’il se calma ; mais ce fut pour recommencer aussitôt à s’inquiéter au sujet de toute une série de questions, grandes et petites, concrètes et méticuleuses. »
Vers dix heures du soir, Lénine et Trotsky descendent au premier étage. Dans la grande salle de l’Institut Smolny, le deuxième congrès panrusse des Soviets allait s’ouvrir. Assis devant une petite table, dans une pièce servant de passage, le chef de la révolution et son « sous-officier » regardent défiler les membres du congrès. Au moment où les deux leaders mencheviques, Dan et Skobelev, passent devant Lénine pour se rendre à la salle du congrès, des coups de canon retentissent au loin, suivis d’un crépitement de mitrailleuses. C’est le croiseur Aurore qui a ouvert le feu contre le Palais d’Hiver. Dan s’arrête, regarde l’homme en perruque assis à côté de Trotsky, le reconnaît. « C’est fini » murmure-t-il, affreusement pâle, à Skobelev. Si Lénine quitte sa cachette, s’il ose se montrer, tout est fini. « Cette scène a même été représentée dans un tableau. » Mais Wladimir Ilitch garde sa perruque. Ce n’est pas encore le moment de se démasquer : le Palais d’Hiver n’est pas encore aux mains des gardes rouges. « Lénine ne parut pas à la première séance du congrès, raconte Trotsky : il se tenait à l’écart dans une pièce où il n’y avait presque pas de meubles. Quelqu’un vint ensuite étendre sur le plancher des couvertures et y jeter deux oreillers. Nous nous reposâmes là-dessus, couchés l’un à côté de l’autre, Wladimir Ilitch et moi. Mais au bout de quelques minutes on m’appela : Dan avait pris la parole, il fallait lui répondre. Après avoir répondu à Dan, je revins me coucher à côté de Lénine. Toutes les cinq ou dix minutes quelqu’un arrivait en courant de la salle du congrès, pour nous rendre compte de ce qui s’y passait ; des estafettes venaient de la ville. » On entendait au loin un crépitement de mitrailleuses. Tard dans la nuit, le matelot Dybenko apporte la nouvelle que le drapeau rouge flotte sur le Palais d’Hiver. « Enfin ! » s’écrie Wladimir Ilitch. Il ôte sa perruque, passe la main sur son front. Le visage en sueur, pâle, tremblant, amaigri, cet homme timide et violent, ce petit bourgeois fanatique, jette autour de lui un regard enfiévré d’insomnie. Le chef, le dictateur, le triomphateur, c’est lui, le bonhomme Lénine. L’État, c’est donc lui. « La tête me tourne, dit-il en allemand : es schwindelt » et il décrit un cercle autour de sa tête.
« Après cette remarque, la seule plus ou moins personnelle que j’aie entendue de lui à l’occasion de la conquête du pouvoir, écrit froidement Trotsky, on passa simplement à l’expédition des affaires courantes. »
IX
ENCORE UNE VICTIME DU BON SENS
« ES schwindelt : la tête me tourne. » C’est du 25 octobre 1917, c’est de la conquête du pouvoir que commence ce qu’on pourrait appeler l’éducation sentimentale de Lénine. La fatalité sous laquelle il pliera, lui aussi, comme tant d’autres, c’est le bon sens. Encore une victime du bon sens : voilà ce qu’on pourrait dire, au fond, de Wladimir Ilitch. Ce fonctionnaire ponctuel et zélé du désordre, qui fait consciencieusement tout son possible pour que l’évolution des évènements demeure, malgré tout, graduelle, pacifique, indolore, ce doctrinaire au fatalisme abstrait, violent, méticuleux, se trouve enfin face à face avec la réalité. Mauvaise situation pour un homme quia passé sa vie dans les bibliothèques. Maintenant il est trop tard pour se soustraire à la responsabilité directe, personnelle, quotidienne, des évènements. Bientôt il lui faudra, comme Jacob avec l’Ange, lutter avec les hommes, race maudite et mauvaise (les hommes, pourtant, il les croit bons : têtus mais bons). Il lui faudra s’enfoncer de plus en plus dans la réalité. Comme un homme qui s’enlise dans les sables mouvants, il ne fera, en se débattant, que s’enliser toujours davantage. Dès que son rôle de président du conseil des commissaires du peuple l’oblige à quitter le domaine de la théorie pour celui de l’action, il se révèle incapable de modeler la réalité sur ses doctrines. Il finira par adapter ses doctrines à la réalité. Ce que l’on appelle bon sens n’est parfois que de la résignation.

LÉNINE MALADE EN PROMENADE
DANS LE PARC DE GORKI
La formule « expédier les affaires courantes » par laquelle, le soir du 25 octobre, Trotsky résume la tâche qui attend les chefs de la révolution après la conquête du pouvoir, ne saurait s’appliquer au rôle que Lénine va jouer le lendemain du coup d’État. Pour Trotsky, les problèmes nouveaux qui se posent à partir d’octobre 1917 ne sont que des « affaires courantes » : ils ne sont pas d’un autre ordre que les anciens problèmes. La matière sur laquelle sa volonté s’exerce reste toujours la même : sa volonté ne s’exerce que sur la réalité. Pour un homme d’action, agir c’est de la routine ; de nouvelles occasions d’agir, c’est de la besogne courante. Trotsky n’a pas besoin d’inventer une nouvelle théorie, de créer une nouvelle doctrine pour justifier ses actes. Il ne se donnera la peine de les justifier que le jour où les Occasions d’agir viendront à lui manquer. C’est alors qu’il élaborera sa théorie de la « révolution permanente », c’est-à-dire de la révolution courante. Pour Lénine, au contraire, les nouveaux problèmes qu’il se voit obligé de résoudre sont d’un ordre tout différent des anciens. La matière sur laquelle sa volonté doit s’exercer n’est plus la même qu’avant. Pour justifier ses théories, ses doctrines, il lui faut créer une nouvelle réalité. Il s’agit, pour Lénine, de créer un État nouveau, de donner aux évènements une nouvelle logique : Es schwindelt.
Dès le 26 octobre, lendemain de la conquête du pouvoir, Wladimir Ilitch se terre dans une pièce de l’Institut Smolny. La tête lui tourne : il se cramponne à une table. Une plume, de l’encre et du papier : c’est tout ce qu’il lui faut. Ses cahiers, ses notes, ses statistiques sont là, à portée de sa main. Peu à peu, son esprit se calme, ses nerfs se détendent. Désormais, rien ne saurait plus le troubler. Le hurlement féroce des masses déchaînées, le chant du « coq rouge » dans les plaines immenses de l’Est, le cri de détresse d’une société qui s’effondre, n’atteignent pas ses oreilles. Du fond de son cabinet de travail ; il n’entend pas la clameur des massacres. L’air souriant, l’œil narquois, il ébauche des décrets, rédige des articles, des proclamations, écrit des lettres, griffonne des billets. Sa haine contre la sainte Russie, contre la société bourgeoise, contre les ennemis du peuple, n’est pas féroce. Le mot « détruire » n’a pas pour lui ce qu’on pourrait appeler un mauvais sens. La haine, chez lui, n’est pas un sentiment ; elle n’est même pas un calcul. Elle est une idée. Sa haine est théorique, abstraite, je dirais presque, désintéressée. Ce « monstre » a le sens de l’humour. Les mots les plus terribles, c’est en souriant qu’il les prononce. Il ne faut pas voir du cynisme là où il n’y a que de la bonhomie.
Au début de novembre, quelques jours après le coup d’État, tous les fonctionnaires des ministères et des administrations publiques de la capitale se mettent en grève. Cette fameuse « grève de la bureaucratie » n’est autre chose que de l’obstruction. Les fonctionnaires n’abandonnent pas leur bureau mais comme ils se refusent à reconnaître aux commissaires du peuple autorité de ministres et à se soumette au contrôle des délégués du Soviet, ils se croisent les bras et attendent. Oblomov se révolte contre Lénine. Oblomov, c’est le héros du célèbre roman de Gontcharov, celui qui incarne la paresse, l’inertie, le fatalisme de la bourgeoisie russe. C’est la première fois, dans l’histoire de Russie, qu’Oblomov prend une décision, se résout à faire quelque chose. Ce n’est pas la révolte de Stienka Rasine, de Pougatchev ou de Mazeppa, mais c’est tout de même une révolte. Pour combattre, il se croise les bras. Il n’est armé que de sa paresse. De toutes les armes de la contre-révolution, celle que Lénine redoute le plus, c’est l’inertie, la paresse du peuple russe : l’oblomovstchina. Ce paisible adversaire est capable de pousser l’indolence jusqu’aux pires extrémités : jusqu’à s’endormir au bureau. Il y a du Koutouzov chez Oblomov. Son sommeil arrêterait pour bien longtemps la vie administrative de l’État. Mauvais début pour une révolution qui prêche l’insomnie. Oblomov, qui d’ordinaire n’est capable de rien, se révèle capable de tout. Lorsque Dzerjinski lui apporte la nouvelle de cette grève, au premier moment Lénine s’emporte, tape du poing sur la table, accable Dzerjinski de questions et de reproches. Qu’est-ce que c’est que cette histoire ? Puis il se calme, sourit, se frotte les mains, cligne des yeux. Il ne faut pas brusquer les choses : il ne faut pas faire mine de prendre au sérieux cette grève amusante, cette révolte des ronds-de-cuir. Il réunit les représentants des employés des différentes administrations publiques, paisibles bonshommes à lunettes : cheveux rares, crâne jaune, et joues tombantes.
Cette rencontre d’Oblomov et de Wladimir Ilitch est l’épisode le plus caractéristique de toute la révolution. Le dictateur (Lénine est un dictateur, il ne faut pas l’oublier) se montre conciliant et discret. Mais les ronds-de-cuir se retranchent derrière une intransigeance qui n’est peut-être que de la candeur. Leur obstination est cérémonieuse. Aux questions de Lénine, ils répondent à voix basse, comme des clercs de notaire craignant de trahir le secret professionnel. À vrai dire, ils ne réclament que bien peu de chose : de simples formalités. Leurs réclamations se bornent à demander respectueusement, avec un sourire obséquieux et timide, que la révolution ne s’occupe pas des ministères, des administrations publiques, des « affaires courantes », que le gouvernement de la République des Soviets pour ne pas bouleverser leurs paperasses, leurs fiches, leurs habitudes et leur dignité de ronds-de-cuir, renonce à s’occuper de l’administration de l’État. « Ne vous mêlez pas de nos affaires ; laissez-nous tranquilles. » Dans son for intérieur, Wladimir Ilitch les comprend. La révolution, quel mauvais tour pour des ronds-de-cuir ! Mais cette grève ridicule pourrait devenir dangereuse. Lénine plisse les paupières, éclate de rire, se renverse sur le dossier de son fauteuil. Il « faut rappeler à l’ordre tous ces braves gens », dit-il à Dzerjinski.
Ces paroles n’ont pas un mauvais sens dans la bouche de Wladimir Ilitch. Ce n’est qu’au bout de quelques jours qu’il se rend compte de ce que signifie, pour Dzerjinski, « rappeler tous ces braves gens à l’ordre ». Pour les « lieutenants » de Lénine, la révolution n’est pas ce qu’elle est pour Wladimir Ilitch, une idée, une théorie, une doctrine. Comme tous les petits bourgeois fanatiques, comme ce Robespierre auquel on le compare si souvent, Lénine ne se préoccupe guère des effets que produira la réalisation de ses idées. Il ne se rend pas compte, ou, pour mieux dire, il ne veut pas se rendre compte des massacres et des destructions qu’engendre son fanatisme doctrinaire. Quand il signe un décret, sa conscience est tranquille. Il n’a pas, comme Lady Macbeth, horreur de sa main. Les mots « détruire, exterminer » n’ont, pour lui, qu’une signification qu’on pourrait dire administrative, bureaucratique. Il ne s’arrête pas aux mots qu’il prononce, ou qu’il écrit. Il n’a pas assez d’imagination pour cela. Trotsky remarque que Lénine a l’imagination réaliste. Autant dire qu’il n’a pas d’imagination. Dans un discours sur le partage des terres, Wladimir Ilitch avait exhorté les paysans à « voler ce qui avait été volé ». Les journaux antibolcheviques s’étaient emparés de ces paroles et les exploitaient de toutes les manières. Trotsky raconte qu’il demanda à Lénine si ces mots n’étaient pas une invention de la presse bourgeoise. « Mais non ! répondit Wladimir Ilitch : effectivement, j’ai dit cela un jour. Je l’ai dit pour l’oublier aussitôt. Mais nos adversaires en ont fait tout un programme ! » À l’opposé du cynisme de Robespierre, qui n’a jamais prononcé une parole « pour l’oublier aussitôt », le cynisme de Wladimir Ilitch est purement verbal. Sa cruauté demeure platonique. Le jour où Kamenev, au lendemain du coup d’État, soumet à son approbation le décret abolissant la peine de mort dans l’armée, « Croyez-vous vraiment qu’on puisse faire une révolution sans fusiller les gens ? » s’écrie Lénine indigné, et il déchire le décret. Mais, peu de temps après, lorsque Dzerjinski, après avoir créé la Tchéka, lui donne le chiffre des contre-révolutionnaires fusillés, Wladimir Ilitch pâlit. « Ça ne me regarde pas ! crie-t-il, d’une voix rauque : ce n’est pas mon affaire ! » Chaque fois qu’à l’Institut Smolny, ou plus tard au Kremlin, on lui parle des massacres, de la famine, des effroyables misères qui accablent le peuple russe, Lénine s’emporte, sa voix devient rauque : « Pourquoi me parler de ces histoires-là ? Laissez-moi tranquille ! Je ne veux rien savoir. Ces choses-là ne me regardent pas. » Rien ne doit troubler son fanatisme abstrait, altruiste et désintéressé. Son altruisme est impitoyable. Sa cruauté veut demeurer platonique.
Dans la nature des Russes, le bien et le mal se confondent. On ne voit jamais tout le mal qui germe dans ces bonnes âmes. Les yeux les plus doux cachent de sombres pensées. Au cœur des Russes, les crimes les plus horribles germent comme des lis. L’histoire de ce peuple est remplie de monstres aux ailes de papillon : impossible de reconnaître lequel est Ariel et lequel Caliban. « Il ne faut pas résister au mal », prêche Tolstoï. Noble et généreux propos. Mais Tolstoï peut dormir tranquille : nul, en Russie, ne résiste au mal. La résignation de ce peuple est sans scrupules : le secret de sa nature consiste à se résigner tant au mal qu’au bien. Il respecte le vice autant que la vertu. Il est plein de compassion pour les braves gens et d’indulgence pour les misérables.
Il n’en serait pas moins difficile de décider si Lénine, lui aussi, est incapable de résister au bien et au mal, si son cœur est bon ou mauvais. De tels hommes ne peuvent être jugés d’après leur cœur : il faut les juger d’après leur tête. Tel un soleil violent, la raison dessèche leurs entrailles. Leur moralité est indéchiffrable : sont-ils honnêtes ou malhonnêtes ? Ils sont plus et moins que cela : ce sont des vertueux au sens révolutionnaire du mot, c’est-à-dire des purs. Défiez-vous de leur vertu. Les incorruptibles, ceux qui ne se laissent corrompre ni par l’argent, ni par l’amour, ni par la vanité, ni par les évènements, sont capables de commettre les crimes les plus horribles (justifier les crimes d’autrui, leur donner une logique, un but, en faire les éléments d’une théorie, d’une doctrine, c’est un péché plus grand que de les commettre) sans qu’une goutte de sang vienne tacher leur affreuse innocence. Aux jours sanglants de la guerre civile, quand de tout l’horizon de la terre russe, des rives de la Baltique et de la Caspienne, des vertes plaines de l’Ukraine et des steppes poussiéreuses de l’Asie, l’effroyable tumulte de la révolte et du massacre arrive enfin à ses oreilles, Wladimir Ilitch pâlit. C’est donc par cela que s’achève l’évolution graduelle, pacifique et indolore des évènements ? Le responsable de tous ces massacres, de tout cet immense écroulement, c’est donc lui, lui seul ? Son rôle est de prendre sur lui tous les crimes de la révolution. Regardez-le, cet Atlas, ce Saint Christophe : les misères et les péchés du peuple russe, ses huit siècles d’esclavage, tout son passé, tout son avenir, Lénine les porte sur son dos. Voici Lénine : lupus Dei qui tollit peccata mundi. Le poil de ce loup est plus blanc que la laine d’un agneau. Est-il coupable, après tout, du sang des ennemis du peuple ? Rien au monde ne saurait empêcher ce massacre atroce. La terreur révolutionnaire est inévitable. « Lénine, remarque Trotsky, profitait de toute occasion pour créer l’idée que la terreur était inévitable. »
Ne pouvant se soustraire à la responsabilité des évènements, ce petit homme pâle, au visage en sueur, s’efforce d’accréditer en lui et chez les autres cette idée. La fatalité à laquelle la révolution obéit est plus forte que tout : elle est plus forte que lui-même, que ses théories, que sa logique, que sa volonté. Que peut-il faire contre les lois fatales des révolutions ? Le sentiment de son impuissance à régler le cours des évènements révolutionnaires adoucit sa voix, calme son inquiétude, apaise sa fureur. Il ne peut rien pour arrêter le fleuve de sang qui coule à travers la Russie : c’est là ce qui donne à son fanatisme doctrinaire la grandeur de la fatalité. Que prétend-on de lui ? Qu’il change les ouvriers, les moujiks, les matelots de Raskolnikov, les bandes de Tchapaïevsk, les cavaliers de Budienny en gentilshommes du Jockey Club, en gentlemen de Kensington ou en philanthropes de la Fabian Society ? Jean-Jacques Rousseau, dans ces conditions, ne pourrait agir autrement. Lors même qu’il arriverait à faire de la Russie une Arcadie et de l’armée rouge une Armée du Salut, ce fleuve de sang ne cesserait pas de couler. Wladimir Ilitch, ce Gengis-Khan marxiste, ce Mahomet prolétarien, est bien loin de se croire « un dictateur d’une volonté de fer ». Trotsky raconte que « lorsqu’on parlait devant lui de révolution ou de dictature, surtout dans les séances du conseil des commissaires du peuple, Lénine ne manquait jamais de s’écrier : Mais où la voyez-vous, notre dictature ? Mais montrez-la ! Ça, une dictature ? Mais c’est de la bouillie pour les chats ! »
Ceux qui se font, du Dictateur rouge, comme une sorte d’image d’Épinal : un homme farouche, aux terribles yeux de Mongol, aux gestes violents, au cœur de pierre noire, à la volonté despotique, ne pourront jamais arriver à le voir tel qu’il était réellement : assis derrière une table encombrée de papiers, pâle, hâve, tremblant, l’œil terne, le dos voûté, la voix rauque, s’évertuant à mettre de l’ordre par des coups de téléphone, des décrets et des discours, dans l’effroyable chaos où la Russie sombrait de plus en plus. Après avoir esquissé en quelques lignes un tableau impressionnant de la situation, du geste froid d’un régisseur dévoilant des secrets de coulisse, Trotsky nous montre le désordre épouvantable qui régnait à l’Institut Smolny, siège du gouvernement des Soviets. Une dictature en proie à l’anarchie, c’est une dictature sans dictateur. Ce que Trotsky appelle « l’impuissance de notre appareil gouvernemental », ce n’est que l’impuissance de Lénine à donner à ses collaborateurs des directives précises, pratiques et suivies. Incapable d’affronter directement la réalité, de chercher une solution concrète des problèmes qui intéressaient l’existence même du peuple russe, ce doctrinaire abstrait et méticuleux s’acharnait à dessiner sur le papier les contours idéaux de l’État communiste, à poursuivre dans ses plus menus détails le plan de l’organisation communiste de l’État, à élaborer des décrets, toujours des décrets, rien que des décrets : par dizaines, par centaines, par milliers. L’œuvre législative du conseil des commissaires du peuple, c’est-à-dire de Lénine, au cours des premiers mois de la dictature bolchévique, est énorme. Wladimir Ilitch jouait son rôle de dictateur avec une mentalité d’employé, de fonctionnaire, ramenait tous les problèmes à des chiffres, à des statistiques, à des paragraphes, à des règlements.
« Le conseil des commissaires du peuple, remarque Trotsky, déployait une activité fiévreuse pour élaborer des décrets. Il fallait tout prendre au début, tout bâtir sur terrain neuf. Impossible de trouver des précédents. Il était même difficile, faute de temps, d’aller en quête d’informations. Les questions ne se posaient que dans l’ordre de l’urgence révolutionnaire, c’est-à-dire dans l’ordre du chaos le plus invraisemblable. Les plus grands problèmes s’enchevêtraient aux petits de façon fantastique. Des questions pratiques de second ordre menaient à de complexes questions de principe. Les décrets ne s’accordaient pas tous les uns avec les autres ; et Lénine dauba plus d’une fois, même en public, sur le manque de coordination de notre œuvre législative. Mais, en fin de compte, ces contradictions, bien que très sérieuses du point de vue des nécessités pratiques du moment, étaient noyées dans le travail de la pensée révolutionnaire. » Tandis que le peuple mourait de faim et que les frontières de la Russie craquaient sous la pression des forces contre-révolutionnaires, Wladimir Ilitch élaborait des décrets, toujours des décrets, rien que des décrets. Tout s’effondrait autour de lui. Penché sur ses papiers, il ne levait la tête que pour ironiser sur les difficultés de sa tâche. « Lénine, raconte Trotsky, présidait invariablement les séances quotidiennes du conseil, passant d’une question à une autre, dirigeant les débats, limitant strictement le temps accordé aux orateurs, qu’il contrôlait sur une montre, remplacée plus tard par un chronomètre. En règle générale, les questions étaient posées sans examen préalable, et toujours d’urgence. Très souvent, les membres du conseil et Lénine lui-même ignoraient encore le fond de la question, jusqu’au moment où s’ouvraient les débats. Ceux-ci étaient toujours très succincts, le rapporteur ne disposant que de cinq ou dix minutes, Et malgré cela Wladimir Ilitch trouvait toujours, comme à tâtons, la ligne à suivre. Sur une étroite bande de papier, d’une écriture minuscule (économie !) il inscrivait le nom des orateurs. Tout en surveillant sa montre, il prenait des notes, ou bien griffonnait à la hâte de courts billets » qu’il envoyait à tel ou tel membre du conseil, en les faisant circuler de main en main tout autour de la table. Trotsky ajoute que ces billets auraient pu constituer une vaste et très intéressante documentation épistolaire sur la technique législative de Lénine. « La plupart se sont malheureusement perdus, car la réponse était le plus souvent écrite à l’envers du papier : et le tout était détruit sur-le-champ, et méticuleusement, par Wladimir Ilitch. » Le véritable portrait de Lénine dictateur se trouve dans ces lignes de Trotsky.
C’est ici que Babbitt et Candide, si leurs yeux savaient regarder, pourraient voir percer, chez le little man dont nous parle Wells, chez ce petit bourgeois qui s’acharne à construire un État sur « d’étroites bandes de papier », un monstre d’une nature bien plus dangereuse que celle de Mahomet ou de Gengis-Khan, d’une nature, surtout, bien plus moderne. Lénine est le monstre moderne, l’exemple le plus frappant du petit bourgeois fanatique, du bonhomme déchaîné, du doctrinaire violent dans la dialectique, timide dans l’action, pour oui lés problèmes les plus concrets se réduisent à quelques formules des plus abstraites, les nécessités les plus tragiques à des questions de principe, les réalités les plus sanglantes à une expérience de laboratoire. Ce monstre au cœur médiocre, aux habitudes casanières, aux mœurs paisibles, chez qui le dégoût de l’action s’appuie sur le sentiment de son impuissance à s’opposer aux évènements par l’action, ce bonhomme qui reste indécis, toute sa vie, entre l’ambition de modeler la réalité sur ses théories et la crainte d’être dominé, écrasé, entraîné par les évènements, de voir ses doctrines plier, se déformer sous le poids de la réalité, ce clerc d’avoué fourvoyé dans la carrière révolutionnaire et qui a besoin, pour appliquer ses théories, de ne pas se sentir en contact avec la réalité, ne peut agir que dans le vide, ne peut exercer sa volonté abstraite que sur une sorte de réalité arbitraire qu’il invente, qu’il crée, qu’il impose à lui-même, à ses collaborateurs, au peuple de Russie, à la révolution prolétarienne, à l’avenir de l’Europe.
Sa force n’est pas dans son caractère ni dans ses idées, mais dans son fanatisme doctrinaire, dans ce qu’on pourrait appeler son sens de l’irréalité. Ce qui en fait un monstre beaucoup plus redoutable et dangereux qu’un Trotsky, par exemple, que n’importe quel autre révolutionnaire des temps modernes, je dirais même qu’un Robespierre, ce n’est pas la cruauté, mais la bonhomie. C’est en souriant, le front détendu, la conscience tranquille, la main ferme, que cet illuminé, ce brave petit bourgeois, incendie la Russie. Des décrets, toujours les décrets, rien que des décrets. Les victimes de son fanatisme doctrinaire sont innombrables. Des centaines de milliers d’hommes, des millions peut-être sont morts par sa faute. Mais ce qui compte, pour un biographe, c’est que Lénine, personnellement, est incapable de faire du mal à qui que ce soit. Parfois, c’est vrai, il tâche de se justifier (ce qu’il cherche à justifier, ce ne sont pas ses théories, ses doctrines, mais ses actes : quand il s’engage sur le terrain de l’action, sa confiance en lui-même l’abandonne). On est ahuri devant l’affreuse candeur de ses propos. « Celui qui n’agit pas ne se trompe pas », dit-il. Il ne saurait mieux se justifier : d’une manière plus modeste et plus intelligente. Ce pur connaît ses défauts, réagit contre ses faiblesses. Pendant l’hiver de 1921, Lénine se rend un soir dans un club ouvrier de Moscou : on l’acclame, on lui baise les mains. Wladimir Ilitch rit, il se montre gai, sa bonne humeur et sa cordialité ravissent le cœur simple de ces ouvriers. Quelques travailleurs improvisent un petit orchestre et ils entonnent une vieille romance en son honneur. Lénine se lève brusquement, fait taire les instruments. « Excusez-moi, dit-il, mais je ne peux entendre de musique. La musique me rend bon. »
Au Kremlin, il lui arrive souvent d’ironiser sur son rôle de dictateur, sur la dictature prolétarienne, de comparer « cette bouillie pour les chats » à la dictature féroce des anciens tsars. « Ça c’étaient des hommes, dit-il, de vrais hommes d’action ! » Il regarde en souriant ses collaborateurs, ces hommes d’action qu’il méprise de tout son cœur pour l’empirisme de leurs conceptions révolutionnaires, pour leur brutalité de « sous-officiers ». Quelqu’un lui parle un jour d’Ivan le Terrible. « Quel dommage, remarque Wladimir Ilitch, qu’Ivan le Terrible eût la conscience aussi noire pour si peu ! » On sait qu’il éprouvait pour le chef de la Tchéka, le cruel Dzerjinski, un dégoût quasi physique. Après les massacres de Perekop, où les officiers et les soldats de Wrangel trouvent la mort par milliers, Lénine se refuse à serrer la main de Raskolnikov et de Béla Kun, les tristes héros de La Saint-Barthélemy de Perekop. Mais dans ses propos ironiques sur l’implacable férocité des anciens tsars et sur la conscience noire d’Ivan le Terrible, ne faut-il voir rien d’autre que des allusions à Trotsky, à Dzerjinski, à Raskolnikov, à tous ceux qui suscitent sa jalousie, son mépris, son dégoût ? Ne faut-il pas voir aussi une résignation mêlée de regret ? Ce qu’il admire chez les tyrans de l’ancienne Russie, c’est leur volonté de fer, leur sombre amour de l’action. Il ne cache pas sa sympathie pour Pierre le Grand, pour « cet homme de génie qui savait son métier ». Il n’aime pas qu’on le compare à Cromwell, à Robespierre, à Napoléon, à tel ou tel héros de l’histoire militaire ou politique d’Europe. « De sales bourgeois », déclare-t-il en clignant des yeux. Il rit de ces rapprochements arbitraires. Mais tous ses biographes sont d’accord pour nous dire qu’il n’acceptait de comparaisons qu’avec Pierre le Grand. Un jour de septembre de l’année 1923, quelques mois avant sa mort, tout le Kremlin est en émoi : Wladimir Ilitch a disparu. Les recherches se poursuivent en vain très avant dans la nuit. Mais voici qu’aux yeux ahuris d’un gardien du Musée, dans une sombre salle du Palais des Armes, Lénine apparaît tout à coup, assis sur le lit de camp de Pierre le Grand. Près du lit, debout sur le plancher, à côté de la table sur laquelle s’ouvre la cassette de cuir, en forme de gros livre, qu’on appelle la Bible de Pierre le Grand, (il y avait six bouteilles dans cette Bible, que le tsar portait toujours avec lui dans ses visites au Faubourg Allemand de Moscou), deux bottes énormes soulèvent la curiosité de ceux qui visitent le Musée des Armes au Kremlin. Il y a des heures et des heures que Lénine est là, la tête dans les mains, sourd au bruit et aux appels, les yeux fixés sur les bottes de Pierre le Grand, semblables aux bottes de Gulliver à Lilliput. Ces bottes ont parcouru toute la Russie, de Saint-Pétersbourg à Poltava : elles ont foulé toute la bonne terre russe, piétiné les boyards, les serfs, les courtisans, les ennemis vaincus, les soldats morts sur les champs de bataille pour la gloire du tsar.
L’admiration de Lénine pour le « tsar révolutionnaire », c’est le revers du sentiment de son impuissance à dominer, par l’action, les hommes et les évènements. S’il pouvait chausser les bottes de Pierre le Grand, la dictature prolétarienne ne serait pas cette « bouillie pour les chats » qui menace d’engloutir toute son œuvre révolutionnaire. Incapable d’agir, de dominer son dégoût de l’action, Wladimir Ilitch, comme tous les petits bourgeois, « se cramponne à la crinière du cheval ». N’ayant, pour bâtir l’État communiste, pour créer cette réalité arbitraire qu’il invente d’après des données abstraites, qu’une plume, de l’encre et du papier, il s’accroche à sa table de travail. Il ne veut rien savoir, rien entendre de ce qui arrive autour de lui. Qu’importe si, tous les jours, de nouvelles difficultés surgissent, que ses décrets n’ont pas prévues ? De nouveaux décrets vont tout balayer. Qu’importe que le peuple meure de faim, que la paralysie gagne, petit à petit, tous les rouages de l’État, que les débris de l’ancien régime barrent le chemin à la révolution, que leur poids fasse pencher la balance vers la famine et la révolte ? Pour combattre la paralysie de l’État, la famine qui dépeuple les villes, la contre-révolution qui gronde dans les campagnes, de nouveaux décrets suffiront. Ce bonhomme déchaîné serre les poings. Rien ne peut arrêter l’élan de son fanatisme halluciné, rien ne doit le distraire de son œuvre révolutionnaire. Que Trotsky rêve de reprendre la guerre contre les Allemands, de jouer un rôle de Bonaparte prolétarien, que le chef de la Tchéka, l’incorruptible Dzerjinski, au pâle visage illuminé de cette cruauté métaphysique des poitrinaires, mène pour son compte une lutte impitoyable contre la bourgeoisie, (contre ces classes moyennes que l’historien Zabiéline appelle le continent russe), que les « sous-officiers » s’attaquent, chacun à sa manière, aux difficultés de la situation, cela ne le regarde pas. C’est là de la besogne secondaire, et, somme toute, insuffisante. Trotsky, Dzerjinski, quels bourgeois romantiques ! Trotsky ne pense qu’à imiter Bonaparte, Dzerjinski ne rêve que d’être un Fouché. Or, pour construire l’État communiste, pour sauver la révolution, il ne suffit pas de fusiller les gens, ou de se donner, à Brest-Litovsk, des airs de Bonaparte dictant le traité de Campo-Formio. Trotsky peut bien sourire de lui, le traiter de visionnaire : le salut de la révolution est tout entier dans l’œuvre de Lénine. Le seul danger dont Wladimir Ilitch se garde, c’est de s’embourber dans la réalité. Pour accomplir son œuvre, il doit demeurer en dehors de tout, au-dessus de tout. Rien ne doit troubler son indifférence à l’endroit des évènements, son calme olympien, sa dédaigneuse ignorance des difficultés historiques et matérielles. Le jour où Trotsky, au cours des pourparlers de Brest-Litovsk, propose au conseil des commissaires du peuple de mettre fin aux négociations et de reprendre la guerre révolutionnaire contre les Allemands, Lénine s’emporte, les mots s’étranglent dans sa gorge, une lueur jaune passe dans ses yeux. La guerre ? Encore cette sale histoire ? Mais la guerre révolutionnaire contre les Allemands, c’est du Kerensky, c’est du patriotisme à la Danton, sinon du bonapartisme pur et simple ! Qu’on ne vienne pas l’ennuyer avec cette immonde comédie.
Lénine saisit son poignet gauche de la main droite, penche la tête sur l’épaule. Un rire convulsif brise sa voix rauque. « C’est la paix qu’il nous faut, la paix à tout prix, coûte que coûte, la paix la plus inique, la plus honteuse... mais la paix ! » Les Allemands reprennent l’offensive, s’emparent de Dwinsk, menacent Petrograd. Au Comité central du parti et au conseil des commissaires du peuple, la majorité se prononce pour le patriotisme à la Danton. « Mais vous ne voyez pas que les soldats se sauvent en jetant leurs fusils, que l’armée ne veut plus se battre ? s’écrie Wladimir Ilitch le 23 février 1918 devant le Comité central, réuni pour décider du sort de la révolution. Lénine se refuse à écouter la « phraséologie révolutionnaire » de ses camarades. Il ne veut rien entendre, il ne veut rien savoir. « Vous voulez, comme des gentilshommes, mourir avec honneur. Moi, je ne veux pas mourir avec honneur, mais donner la victoire au prolétariat. » Cette paix ignoble, que les Allemands imposent à la République des Soviets sous la menace des baïonnettes, et que seule une faible majorité du Comité central se résigne à accepter, c’est d’un cœur joyeux que Lénine la signe. Désormais, il va pouvoir travailler tout à son aise. Pourtant, le coup était dur. La menace de la guerre a précipité la Russie dans un désordre épouvantable. « Hier, dit-il, nous étions encore en selle. Aujourd’hui, nous nous cramponnons à la crinière du cheval. Ça nous apprendra. Cette leçon doit guérir la maudite nonchalance des véritables Oblomov que nous sommes. » Candide et Babbitt ne voudront pas croire qu’au moment du danger, Wladimir Ilitch se découvre lui-même l’âme d’un véritable Oblomov.
L’attitude pacifiste de Lénine, son « défaitisme intégral » pendant l’affaire de Brest-Litovsk, révèle la première atteinte du mal qui va le conduire, en 1921, à la nep. Ce mal, c’est le bon sens. C’est en 1920, au cours de la guerre contre la Pologne, que les symptômes du bon sens se manifestent en lui d’une façon qui ne laisse plus aucun doute sur l’approche de la crise. Quand l’armée rouge de Trotsky s’enfonce comme un couteau au cœur de la Pologne, Wladimir Ilitch, dans sa petite pièce du Kremlin, ne veut rien entendre, ne veut rien savoir. Les murs de l’État communiste qu’il est en train d’édifier, tremblent au bruit sourd des canons, aux chants de joie, aux roulements de tambour. Dans l’immense plaine polonaise, le soleil ardent de l’été brûle l’herbe sous le sabot des chevaux de Budienny. Demain, ce soir peut-être, Varsovie va tomber aux mains de Trotsky. Dans les rues de Moscou, le peuple défile au chant de l’Internationale. Le vent de la victoire gonfle les drapeaux rouges sur les tours du Kremlin. « C’est la paix qu’il nous faut, s’écrie Lénine de sa voix rauque : la paix à tout prix, avant qu’il soit trop tard. » Ce dictateur petit-bourgeois n’est pas fait pour un rôle de conquérant, de Napoléon prolétarien, de César marxiste au front ceint de lauriers. Victoire ou défaite, peu lui importe : c’est la paix qu’il réclame. Son défaitisme intégral ne se laisse pas griser par la victoire. La dictature du prolétariat n’est pas encore suffisamment forte pour courir le risque d’une guerre, fût-elle victorieuse. Lénine se méfie de tous ces guerriers qui chantent l’Internationale.
Ainsi à peine l’armée rouge, battue sous les murs de Varsovie, se replie-t-elle vers la Bérézina, que Wladimir Ilitch réunit le Comité central, s’oppose violemment à la continuation de la guerre, réclame la paix. Il sait très bien qu’à ce moment-là la situation militaire n’est pas mauvaise : « Une victoire complète de notre part n’eût même pas été impossible », dira-t-il plus tard à Clara Zetkin. Mais il veut profiter des premiers revers pour imposer la paix aux « patriotes socialistes » du G. Q. G. Victoire ou défaite, ces mots-là n’ont aucun sens pour lui. « Savez-vous, dit-il à Clara Zetkin peu après la signature du traité de Riga, savez-vous que, dans le parti, le traité de paix avec la Pologne s’est heurté, au début, à une vive résistance ? J’ai été violemment combattu parce que j’étais partisan de l’acceptation des conditions de paix, qui sont, sans conteste, très favorables à la Pologne, et très dures pour nous. Presque tous nos experts affirmaient qu’étant donnée la situation intérieure de la Pologne, et particulièrement l’état misérable de ses finances, il eût été possible d’obtenir des conditions beaucoup plus favorables pour nous, si nous avions continué la guerre quelque temps seulement. Je crois même que notre situation ne nous forçait pas à conclure la paix à tout prix. Nous pouvions tenir tout l’hiver. » Mais Wladimir Ilitch ne peut attendre. La révolution a bien autre chose à faire que de se battre pour « la patrie socialiste » de Trotsky. Il faut se remettre au travail. Rien, désormais, si ce n’est le bon sens, redoutable maladie, ne pourra plus troubler le calme olympien de Lénine. Pour un fanatique doctrinaire, le bon sens est un ennemi bien plus dangereux que Fanny Kaplan.
Le 30 août 1918, à Moscou, dans le faubourg de Zamoskvoretsie, tandis que Lénine, sortant d’un meeting, traversait la cour de l’usine Mikelson, une jeune socialiste-révolutionnaire, Fanny Kaplan, avait tiré sur lui quatre coups de revolver à bout portant. Blessé grièvement au poumon, au cou, à l’épaule et à la main gauche, Lénine était resté de longs mois entre la vie et la mort. Quand on lui parlait de cet épisode, le seul épisode romantique de son éducation sentimentale, Wladimir Ilitch souriait d’un air amusé et distrait. Rien ne peut faire dévier le cours arbitraire de sa logique. L’idée de la mort n’effleure même pas son fanatisme halluciné. S’il parle parfois de la mort, c’est pour en rire. Trotsky raconte qu’un jour Wladimir Ilitch lui demanda de but en blanc : « Si on nous tue, vous et moi, croyez-vous que Boukarine et Sverdlov pourront se tirer d’affaire ? » Et là-dessus, rapporte Trotsky, il éclata de rire.
Enfermé du matin au soir dans son cabinet de travail du Kremlin, au fur et à mesure que les échafaudages, sous lesquels se profile la masse énorme de l’État en construction, s’écroulent dans un nuage de poussière, Lénine recouvre sa bonhomie, son humour, ses gestes familiers. Peu à peu, l’imposante architecture de l’État soviétiques se détache sur le fond brumeux de l’Europe. La guerre contre la Pologne vient de prendre fin par le traité de Riga. L’armée rouge de Trotsky a refoulé au fond de l’Asie, culbuté dans la Mer Noire, noyé dans le Volga, dans le Don, dans le Dniepr, les gardes blancs de Koltchak, de Wrangel, de Denikine. L’année 1921 s’ouvre sur un panorama triste et morne ; mais la saison est proche où les souffles tièdes de l’Est vont faire fleurir la paix rouge sur la bonne terre de Russie. Lénine commence à se sentir chez lui dans cet État qu’il a construit pierre par pierre avec une patience si opiniâtre, et un aussi audacieux mépris de la réalité. Son œuvre est enfin terminée. Les derniers échafaudages viennent de tomber. Il lui faut, maintenant, exercer sa volonté sur une matière bien plus dangereuse que les doctrines, les statistiques, les règles de l’architecture marxiste. Le moment est venu de lutter avec les hommes, de prendre contact avec la réalité. Les hommes, race inquiète et mystérieuse.
Dès qu’il embrasse du regard le panorama de ces trois années de guerre civile, de famine et de désespoir, la situation de la Russie se révèle à lui pour la première fois dans toute son horreur. Dès qu’il jette les yeux par delà les frontières de la révolution, l’Europe bourgeoise se montre à lui bien différente de celle que ses calculs lui faisaient prévoir. La IIIe Internationale, ce « revolver appuyé sur la tempe de l’Europe » n’est-elle donc autre chose qu’une arme déchargée ? Aux premiers contacts avec la réalité, son fanatisme doctrinaire s’épointe comme un couteau qui rencontre une pierre. « Je me suis trompé, dit-il : celui qui n’agit pas ne se trompe pas. » Étonnant aveu chez un homme qui s’est, jusqu’alors, constamment refusé à agir dans le domaine de la réalité. Ce n’est donc pas dans son action qu’il s’est trompé, mais dans ses calculs, dans ses prévisions, dans ses théories. « Lénine, écrit Jaroslavski, n’a jamais craint d’avouer ses fautes. » Ce petit bourgeois « entêté, soupçonneux, étroit, bureaucrate, formaliste, unilatéral » n’hésite pas, au Xe congrès du parti, le 8 mars 1921, à reconnaître que le passage de la guerre à la paix, marqué à la fin de 1920 et au début de 1921 par le traité de Riga et les victoires remportées sur Wrangel et sur Denikine, « entraînait des secousses qu’il n’avait pas prévues ». Si Candide et Babbitt avaient pris part à ce congrès, ils n’auraient sans doute pas applaudi le discours de Lénine. Ils auraient été déçus par un langage aussi plein de bon sens. Un Gengis-Khan, un Mahomet, n’auraient jamais fait une semblable déclaration. Ce mea culpa est indigne d’un dictateur rouge, d’un monstre aux yeux de Mongol. Arrivé au sommet de sa gloire et de sa puissance, Wladimir Ilitch se révèle ce qu’il a toujours été : un bourgeois fanatique, un bonhomme capable de tout dans le domaine de la théorie, et même d’une bonne action dans celui de la réalité.
C’est au milieu d’un profond silence que le congrès accueille les paroles de Lénine. Tous les visages sont pâles. « En décembre 1920 nous ne voyions pas encore à quel point non seulement les difficultés techniques, mais toutes les calamités accumulées sur la Russie soviétique, déjà épuisée par la guerre impérialiste et par la guerre civile, devaient s’aggraver au moment de la démobilisation. C’est plus tard seulement que nous avons constaté dans toute leur étendue la ruine et la misère de la Russie. Il faudra longtemps pour cicatriser les blessures. Nous ne pouvons même pas encore nous consacrer entièrement à les guérir. » Les erreurs que nous avons commises, pouvait-on les éviter ? se demande Lénine. « Dans les conditions où nous étions ces fautes étaient inévitables. » Cette idée du caractère inévitable des évènements qu’il ne sait ni prévoir, ni dominer, est toujours unie chez lui au sentiment de son impuissance. « Nous nous sommes trompés », dit-il. Pour sauver la révolution, « il faut savoir assurer notre retraite ». Seule, une nouvelle politique économique, la nep, peut assurer la retraite de la révolution soviétique sur des positions permettant au prolétariat de réunir ses forces. Il faut se mettre sur la défensive ». Un des problèmes posés par la nep, et l’un des plus sérieux, consiste à nous pénétrer profondément de cette idée, que nous ne sommes pas à la veille de donner l’assaut à la forteresse capitaliste. Nous devons être prêts à le donner, mais seulement s’il est nécessaire, et si les évènements, en Europe, tournent de façon à le rendre possible. Nous devons nous armer pour une conquête longue et minutieuse de l’économie petit-bourgeoise. Ces problèmes qu’il énonce de sa voix rauque (premier, second, troisième problème), en martelant les mots, en s’arrêtant sur chaque phrase, ce n’est plus ce qu’il appelait autrefois des « problèmes d’avant-garde ». Au coup de barre de Lénine, la révolution recule. Maintenant, le rôle révolutionnaire du prolétariat est confié à l’arrière-garde. C’est avec son discours du 8 mars 1921 que le dictateur donne le signal de la retraite. Sa tactique est celle de Koutouzov devant Napoléon : dans l’impossibilité de livrer aux forces du capitalisme la bataille décisive, Lénine se retire.
C’est à partir de ce moment que se révèle sa véritable grandeur. Le fond petit-bourgeois de son caractère remonte à la surface. Son fanatisme atteint le plus haut degré du bon sens. Chez lui, comme chez tous les héros petit-bourgeois, les sentiments médiocres se manifestent parfois avec une intensité émouvante et farouche, qui n’est pas sans grandeur. Lénine se laisse emporter par le bon sens comme d’autres par la fureur.
Jusqu’au jour où la paralysie progressive le cloue sur son fauteuil et où son esprit sombre, tous ses discours et tous ses actes sont empreints d’une sagesse, d’une mesure, d’une prudence que l’on pourrait dire fanatiques, d’autant plus étonnantes qu’elles s’exercent au détriment de son œuvre révolutionnaire. Froidement, systématiquement, Lénine s’acharne à démolir une grande partie de ce qu’il a bâti pierre par pierre, pendant quatre années de révolution. Mais cependant même qu’il abat les murs chancelants, il étaye les colonnes, les arcs, les voûtes qui supportent le poids de l’État. Il se révèle, dans ses décisions, aussi courageux que prudent. Le bateau coule, dit-il au Xe congrès du parti, en mars 1921 : pour alléger le navire, il faut tout jeter par-dessus bord. La première chose qu’il jette à la mer, c’est le Capital de Marx. Pour garder le pouvoir, il faut tout lâcher. En attendant que la révolution éclate en Europe « le grand but politique de la nep est de garder le pondoir au prolétariat ». Le 13 novembre 1922, au IVe congrès de la IIIe Internationale, prenant la parole sur « les cinq premières années de la révolution russe et les perspectives de la révolution mondiale », il développe sur une plus grande échelle le thème de la retraite, en tant que seul moyen de garder le pouvoir. Ses paroles s’adressent avant tout aux délégués des différents pays d’Europe, aux camarades d’Occident. Il leur rappelle que, s’ils se préparent à reprendre l’offensive contre les forces du capitalisme, ils doivent prévoir l’éventualité de la retraite et se réserver la possibilité de l’opérer. « Nous n’avions presque pas réfléchi à cette retraite, avoue-t-il : il faut pourtant en tenir compte dans notre œuvre de reconstruction du monde, de destruction du capitalisme et de création du régime socialiste. Il est insuffisant de calculer comment nous agirons, en cas d’offensive et de victoire. À une époque révolutionnaire, ce n’est pas le plus difficile ni le plus important, du moins ce n’est pas le principal. Pendant la révolution, il est des moments où l’adversaire perd la tête, et nous pouvons facilement en venir à bout si nous nous jetons alors sur lui. Mais notre ennemi, s’il a du sang-froid, peut rallier ses forces, se jeter sur nous à son tour et nous refouler pour longtemps en arrière. C’est pourquoi l’idée que nous devons assurer notre retraite à une importance fondamentale. Il faut que non seulement en théorie, mais en pratique, ceux qui se proposent, dans les pays d’Europe, de reprendre l’offensive contre le capitalisme, y réfléchissent sérieusement. »
Au cours des années 1921 et 1922, le thème de la retraite revient constamment dans tous les discours de Lénine. Qu’entend-il par ce mot de retraite ? « De même, écrit Henri Guilbeaux, que les gouvernements capitalistes recourent au socialisme d’État afin d’endiguer le flot du socialisme envahisseur, de même, afin d’annihiler les effets du capitalisme mondial en Russie, Lénine institue le capitalisme d’État. » Cette retraite n’est qu’une évolution vers le capitalisme d’État, qu’une « politique de concessions » vis-à-vis de l’économie bourgeoise. Mais Lénine, comme Koutouzov, se retire en combattant. La nep n’est pas seulement une politique de concessions dans un domaine purement économique : c’est « une continuation de la lutte de classe, sous une autre forme ». À partir du mois de mai 1921, Wladimir Ilitch se jette à corps perdu, de tout le poids de son bon sens violent, implacable, fanatique, dans une lutte dirigée aussi bien contre le romantisme révolutionnaire des « sous-officiers », l’égoïsme des moujiks et l’incompréhension des ouvriers, que contre l’avidité des nepmen et des koulaki, ces petits commerçants, ces paysans riches, ces spéculateurs rapaces qui, déjà, commencent de faire du lard à l’ombre de la nep. Une fois de plus, il s’acharne à « mettre de l’ordre dans ses papiers », à donner une logique à la révolution. Cette fois-ci, sa logique est celle du bon sens.
Du fond de son cabinet de travail du Kremlin, ou du haut de la tribune, dans les meetings, dans les congrès, dans les assemblées, dans les réunions du Comité central du conseil des commissaires du peuple, du Kominterm, il bat en brèche les profiteurs, les spéculateurs, les saboteurs, l’hostilité sourde de la grande majorité du parti, la résistance passive de la bureaucratie, l’ironie de Trotsky, de Dzerjinski, de Radek, de Boukarine. Rien ne peut résister à son énergie farouche. Il faut le voir campé à la tribune, le visage souriant, le regard narquois, le corps penché en avant, les pouces dans les entournures de son gilet. « La tête ne semble pas bien grosse, remarque Trotsky, sur ce corps de petite taille, mais fortement bâti. Ce qui semble énorme, c’est le front, ce sont les bosses dénudées du crâne. Les bras sont très mobiles, mais sans nervosité, sans mouvements inutiles. Le poignet est large, les doigts sont courts, la main est plébéienne, vigoureuse. Dans cette main on retrouve les traits de bonhomie courageuse que l’on voit dans toute sa personne et qui inspirent confiance. »
D’une voix « égale, coulante, très rapide, grasseyante », Wladimir Ilitch flétrit la paresse, la malveillance, la lâcheté, l’insuffisance, l’orgueil de tous ceux qui s’opposent, au nom des principes d’octobre, et dans le sein même du parti, à la politique de concessions, à la nep, à la tactique de la retraite. Peu à peu, sa voix devient rauque, mais « ses pommettes anguleuses s’éclairent d’une sagace indulgence. La partie inférieure du visage, au poil roussâtre, grisonnant, reste en quelque sorte dans l’ombre. La voix s’adoucit, devient d’une grande souplesse, et, par moments, d’une malice insinuante ». Le fils d’un ouvrier du faubourg de Pressnia nous a laissé de Lénine un portrait qui est aussi vivant que celui de Trotsky : « Wladimir Ilitch était monté à la tribune. Il avait un costume foncé, une chemise à col rabattu et une casquette. Il avait tiré de sa poche un mouchoir blanc et s’essuyait le front. Je ne me rappelle pas ce qu’il disait : je faisais surtout attention à la façon dont il parlait. De temps en temps il se penchait sur la tribune et tendait les bras en avant, tout en gardant son mouchoir et en essuyant son crâne chauve. J’observais tout son visage : son nez, ses lèvres, sa petite barbiche. À chaque instant, Lénine était interrompu par des applaudissements et des cris. » Parfois Wladimir Ilitch, en parlant, frappe l’air de son poing fermé comme pour enfoncer un clou à grands coups de marteau. De ce geste, que le bec de sa plume a saisi, Trotsky nous donne une série d’images défilant devant nous au ralenti, comme sur un écran lumineux. « Lénine ajuste la pointe du clou, s’écarte un peu pour mieux voir et, d’un grand geste, assène le premier coup de marteau, puis un autre encore, puis beaucoup d’autres, jusqu’à ce que le clou soit bien enfoncé. Maintenant, il faut l’arracher : Wladimir Ilitch martèle la tête du clou, de droite et de gauche, pour l’ébranler. Quand il l’aura arraché, il le jettera à la ferraille des archives. » Pendant deux ans, jusqu’au jour où la première attaque de paralysie arrêtera son bras levé, Lénine ne fait que planter des clous à grands coups de marteau, pour les arracher immédiatement et les jeter à la ferraille des archives. Il cligne des yeux en souriant, penche la tête sur son épaule. Des bons mots, des plaisanteries, des traits d’humour se mêlent aux invectives, aux expressions cinglantes, aux paroles amères où le mépris grince comme un couteau sur la pierre. « Sa plaisanterie est utilitaire », écrit Trotsky. Quand il parle du « honteux trafic de l’opium bourgeois », sa voix devient âpre, ses mains se crispent comme pour saisir un adversaire à la gorge. Tout à coup, sa voix s’adoucit sur un mot d’humour : d’un dernier coup de marteau, il plante son clou dans le dos des nepmen, des koulaki, des traîtres, des spéculateurs, des profiteurs de la révolution. « La partie inférieure de son visage devient alors plus saillante, surtout la bouche, dont le rire est contagieux. Les traits du front et du crâne semblent alors s’estomper, le regard, cessant de briller, s’éclaire de gaîté, le grasseyement s’accentue, la tension vigoureuse de la pensée s’amollit en belle humeur, en riante bonhomie. »
La politique de la retraite, cette politique du bon sens que Lénine poursuit avec toute son énergie opiniâtre et méticuleuse, n’est pas un climat favorable au romantisme révolutionnaire de ses lieutenants. La fin de la période héroïque de la guerre civile marque le début de leur décadence. Dès que la révolution perd son caractère théâtral provisoire, exceptionnel, changeant, pour rentrer dans l’ordre, dans la routine, dans la régularité des choses établies, leur goût théâtral de la violence ne peut s’habituer aux nécessités nouvelles de la nep, à ce qu’ils appellent la période administrative, bureaucratique, de la révolution. Trotsky, plus qu’aucun autre, se sent étouffer dans cette atmosphère de concessions et de compromis. Jusqu’à ce jour, la dictature du prolétariat avait besoin de lui. Il n’ose pas s’avouer que dorénavant, comme tant d’autres, il a cessé d’être nécessaire à la révolution : il n’est qu’utile. Finis, les grands gestes, les aventures dangereuses, les coups de tête, les tours de main, les jeux de hasard. Finis, les foules massées dans les rues, les mitrailleuses aux carrefours, les drapeaux rouges sur les champs de bataille, le roulement des tambours, l’ivresse de la victoire, l’orgueil de pouvoir « briser d’un coup de poing l’horizon de sa destinée ». Lui aussi, comme tant d’autres, lui va-t-il falloir devenir un fonctionnaire de la révolution, connaître le désœuvrement de ceux qui sont dépassés, la tristesse des jours sans risques et sans gloire ? La nep, c’est la Sainte-Hélène de Trotsky.
Dans ses discours, Lénine n’oublie jamais ses lieutenants. De tous les adversaires de la nep, ce sont eux les plus redoutables. Les clous qu’il leur enfonce dans le dos, il ne se donne pas la peine de les arracher ensuite pour les jeter à la ferraille des archives. Mais quelle prudence, dans ces coups de marteau. « Quand Lénine tape non plus sur l’ennemi, mais sur les siens, remarque Trotsky, quand il dénonce quelqu’un de ses partisans, sa voix arrive au fausset, se brise : sa tirade la plus coléreuse prend alors une soudaine nuance de bonhomie » (c’est cette expression : bonhomie, qu’on rencontre le plus souvent dans les portraits de Wladimir Ilitch par Trotsky). Tous ses lieutenants sont là, autour de lui : Lénine les regarde en souriant, lève lentement son poing fermé, donne un dernier coup de marteau. Un tonnerre d’applaudissements salue la fin de son discours : il ramasse ses papiers, quitte l’estrade, descend au milieu des siens. « Il a l’air d’un ouvrier qui sort épuisé de sa tâche, mais content d’avoir mené sa besogne à bien. De temps en temps, il passe la main sur son crâne chauve où l’on voit perler des gouttes de sueur. » Le voilà : « la tête légèrement rentrée dans les épaules, le menton sur la poitrine, les yeux cachés par les sourcils, tandis que les moustaches se hérissent presque d’un air de colère, sur la lèvre supérieure relevée par une moue de mécontentement ». Le voilà, ce bonhomme, entouré de ses lieutenants comme d’une garde du corps. Tous les yeux sont fixés sur lui. Depuis quelque temps, tous ces regards investigateurs lui causent un malaise inexplicable. « Mais qu’est-ce que vous avez tous à me fixer de cette façon ? » demande--t-il un jour en riant, à une réunion du conseil des commissaires du peuple. Son visage est livide, ses mains tremblent.
Ce n’est qu’au Kremlin, dans son cabinet de travail, que ses nerfs se détendent, que sa voix s’adoucit, que ses yeux s’illuminent. Penché sur ses papiers du matin au soir, il s’acharne à contrôler dans ses plus petits détails toute la vie politique, économique et administrative de l’État. Rien ne lui échappe : il s’occupe de tout, s’enquiert de tout, veut tout savoir, veut tout comprendre. C’est là, dans cette petite pièce voûtée, sombre, mal éclairée, que le dictateur rouge (ce little man, ce petit homme dont nous parle Wells) révèle au monde, pour la première fois, quel formidable instrument révolutionnaire peut être le bon sens. Le fanatisme inspiré d’un Mahomet, l’élan impétueux d’un Gengis-Khan, se seraient déjà brisés sur les récifs des innombrables problèmes d’ordre secondaire, que ce petit bourgeois s’obstine à résoudre un à un, posément, patiemment, comme un pêcheur démêlant, une à une, les mailles de son filet. La grandeur de Lénine est faite de petites choses. Son génie ardent et méticuleux, sa volonté tout à la fois timide et violente, ne sont qu’un ensemble de sentiments et de qualités médiocres. Seule, la médiocrité de son génie et de son caractère a sauvé la révolution bolchévique. Là où César, Cromwell, Napoléon auraient échoué, Lénine a réussi.

DANS LE JARDIN DE GORKI
AUPRÈS DE SA FEMME
Ce bonhomme souriant qui travaille parfois des heures entières un chat sur l’épaule, et qui vit pauvrement, lui sa femme et sa sœur, dans cinq petites pièces où vivaient naguère les domestiques de l’intendant du tsar, ce dictateur qui ne se nourrit que d’un peu de fromage avec quelques tasses de thé, avalant hâtivement ce maigre repas sur le coin de sa table de travail, ce monstre au cœur timide qui ne lève pas la tête de ses papiers et n’abandonne son bureau que pour aller prononcer un discours dans un meeting de travailleurs, pour présider une séance du Comité central, du conseil des commissaires du peuple, du Kominterm, ou bien pour visiter une école, un hôpital, une usine, un club ouvrier, ce little man pâle, amaigri, voûté, brûlé de fièvre et d’insomnie, s’emploie à résoudre les problèmes de l’État et de la révolution avec ce même goût du détail, du cas particulier, de la nécessité immédiate, dont il fait preuve à tout propos, lorsqu’il cherche à venir en aide à quelque camarade besogneux, à secourir une famille de travailleurs, à alléger « au détail » pourrait-on dire, les misères épouvantables qui fondent tous les jours sur le peuple russe.
À ses collaborateurs, qui lui demandent son opinion sur telle ou telle situation générale, il ne répond que par des formules, par des axiomes capables « de renverser des murailles », comme disait Panine des axiomes du Nakaze de Catherine. Ses points de vue sur les problèmes fondamentaux de l’État et de la révolution, il les synthétise en quelques mots. Il n’a pas le temps d’élaborer des programmes, d’arrêter des plans : il se borne à condenser en formules des règles générales. Ce qui le préoccupe, ce sont les détails (« Il est facile de donner des règles générales, écrivait Catherine à Voltaire en 1767 : mais les détails ? »). Au cours d’une discussion sur les spécialistes bourgeois, au Comité central du parti, Lénine expose son point de vue rien que par cet axiome : « Un ingénieur bourgeois vaut dix communistes. » C’est au Comité central, c’est aux commissaires du peuple, c’est aux administrations intéressées, aux organisations industrielles de l’État, de tirer les conséquences pratiques de cet axiome. L’importance fondamentale que le problème de l’électrification de la Russie présente pour l’avenir de la révolution, il la résume dans cette fameuse formule : « République des Soviets + électrification = communisme. » Le Plan Quinquennal, dont l’ingénieur Krijanovsky, un des plus anciens et des plus fidèles camarades de Lénine, fixera les lignes plus tard, après la mort du dictateur, tient tout entier dans cette formule. Pour se rendre compte d’une situation, pour exprimer son point de vue sur tel problème d’ordre général, un coup d’œil et quelques mots lui suffisent. Mais son regard et son attention ne s’arrêtent que sur les questions de second plan. Il aborde les difficultés une à une, par leur côté faible, le plus souvent par un détail d’importance minime. S’il suffit d’un coup d’œil pour mesurer l’étendue d’un problème, c’est à la loupe qu’il faut le regarder quand on veut scruter sa profondeur, se rendre compte de sa complexité. Ses collaborateurs s’étonnent parfois de voir dépenser tant d’énergie dans un travail aussi minutieux. Wladimir Ilitch lève la tête et sourit. La révolution ne pourra reprendre l’offensive contre les forces du capitalisme international, que le jour où les héros d’octobre 1917 s’accommoderont de devenir des « fonctionnaires ». Les problèmes de la révolution ne sont plus, désormais, que des problèmes d’ordre administratif, bureaucratique. La Russie, qui fut en proie à toute époque à un épouvantable désordre administratif, a toujours été exposée, par cela même, au danger des révoltes et des conquêtes. Mais ce ne sont point des généraux à la tête de leurs armées, des cosaques rebelles à la tête de leurs bandes de pillards, Charles XII ou Napoléon, Stienka Razine ou Pougatchev, qu’elle avait à craindre. Celui qui devait s’emparer de la Russie ne pouvait être qu’un « fonction naine », un homme capable de l’administrer. « Je suis ce fonctionnaire », dit Lénine.
Au début de mai 1922, ce bonhomme enfermé dans sa petite pièce du Kremlin, et courbé du matin au soir sur ses papiers afin de regarder la Russie à la loupe, s’abat un jour sans connaissance, la tête sur sa table de travail. Cette première attaque d’hémiplégie lui paralyse tout le côté droit, et lui enlève l’usage de la parole. En juin et juillet, de nouvelles attaques lui tordent la bouche, lui brisent les jambes. Il y avait déjà quelque temps que Nadejda Konstantinowna et Marie, la sœur de Lénine, remarquaient ses pâleurs soudaines, ses accès de rire, cette flamme jaune qui brûlait parfois ses yeux troubles. Souvent, au cours d’une séance, Wladimir Ilitch sentait peser sur lui le regard de ses collaborateurs : « Mais qu’est-ce que vous avez tous à me regarder comme ça ? » demandait-il en riant. « Dans certaines réunions où l’on n’était qu’en petit nombre, raconte Trotsky, il lui arrivait d’être pris d’un fou rire, et cela non seulement aux époques où les choses marchaient bien, mais pendant des périodes extrêmement pénibles. Il essayait de se retenir le plus longtemps possible, mais il finissait par pouffer, et la contagion de son rire se transmettait aux autres. Wladimir Ilitch tâchait alors de ne pas attirer l’attention, de ne pas faire de bruit, de rentrer sous la table. Cette folle hilarité s’emparait de lui surtout quand il était fatigué. D’un geste habituel, battant l’air de la main de haut en bas, il semblait repousser la tentation, mais c’était en vain. Il ne reprenait possession de lui-même qu’en regardant fixement sa montre, avec une tension de toutes ses forces intérieures. Il affectait alors un air sévère et il évitait prudemment les regards. »
À la fin d’octobre 1922, à la stupeur et à la joie de tous, livide, le front constamment trempé de sueur, les jambes tremblantes, la tête courbée sur la poitrine, péniblement, il se remet au travail. Sa main morte abandonnée sur la table, il essaie d’écrire de la main gauche. Il lui arrive parfois de s’endormir sur ses papiers. Dans la pièce sombre on n’entend que le rythme oppressé de sa respiration et le ronronnement de son chat pelotonné sur ses genoux. Il se réveille en criant. On accourt : on le trouve renversé sur le dossier de son fauteuil, haletant, les yeux égarés. Ceux qui entrent chez lui doivent marcher sur la pointe des pieds : le grincement du plancher lui arrache des plaintes étouffées. Le 13 novembre, au IVe congrès de la IIIe Internationale, Lénine monte à la tribune. Un tonnerre d’applaudissements salue l’apparition inattendue de ce petit homme effroyablement pâle, au crâne décharné, au cou frêle, et dont les mains appuyées sur l’estrade tremblent, zébrées de veines qui semblent des balafres. Un long murmure passe dans la salle. Lénine parle. C’est son fameux discours sur la nep, sur la politique de la retraite. En quittant la tribune, il tombe évanoui. On l’emporte. À Gorki, près de Moscou, dans la petite maison de campagne où il vit cloué sur un fauteuil roulant, sous la garde affectueuse de Nadejda Konstantinowna et de sa sœur Marie, ses forces reviennent petit à petit. De nouvelles attaques le terrassent. Brusquement, il sombre dans le noir de la paralysie. Au mois de mai 1923, de faibles lueurs passent dans ses yeux, des paroles sortent de sa bouche. Au début de juin, Wladimir Ilitch se lève en s’appuyant au bras de Nadejda Konstantinowna : il fait quelques pas et tombe évanoui. Quelques jours après il se traîne tout seul à un banc sous les arbres et s’assied. C’est là, sur ce banc, qu’il passe les chaudes journées d’été, son chat sur les genoux, dessinant de la main gauche, sur des morceaux de papiers, des gratte-ciel, des roues de dynamo, des cheminées d’usine. Il s’exerce à parler, répétant cent fois le même mot, toujours le même, d’une voix rauque que sa langue pâteuse adoucit. Des larmes coulent sur ses joues maigres.
Aux premières feuilles jaunes de septembre, Wladimir Ilitch quitte son banc sous les arbres et se promène dans le parc, la tête penchée sur l’épaule, ses yeux rêveurs perdus dans les arabesques d’ombre et de lumière que le soleil dessine sur le gravier. Dans les tièdes après-midi d’automne, assis au bord de l’étang, une canne à pêche à la main, il suit des yeux le frissonnement du vent sur l’eau. Vers la fin du mois il sort tous les jours en auto dans les bois, où le feuillage clair des bouleaux illumine l’herbe alentour. Il se rend aussi à Moscou, franchit l’enceinte du Kremlin, monte à sa petite pièce obscure, s’assied dans son fauteuil devant sa table de travail, effleure de la main ses papiers, ses livres, ses dossiers. Un jour, pendant une de ses courtes visites au Kremlin (ce sera la dernière) Wladimir Ilitch disparaît. On le retrouve, tard dans la nuit, dans une salle du Palais des Armes, assis sur le lit de camp de Pierre le Grand. On le ramène à Gorki brûlant de fièvre. Les jours suivants, il recouvre sa bonne humeur, fait des parties d’échecs avec Nadejda Konstantinowna, lit à haute voix des articles et des lettres, en articulant bien les syllabes et en prononçant les mots à la manière d’un enfant qui apprend à lire. Les premiers mois de l’hiver passent doucement : la blancheur de la neige éclaire la maison sous les arbres, les plaines, les bois, les collines, d’une lumière de crèche.
Vers six heures du soir, le 21 janvier 1924, une dernière attaque lui brise les jambes, le saisit à la gorge. Lénine s’écroule sur le plancher. Tous ses papiers sont en ordre. Ce fonctionnaire ponctuel et zélé peut mourir à son heure.
Maintenant, la momie de Lénine est ici devant moi, dans le sombre mausolée de bois qui se dresse Place Rouge, sous les murs du Kremlin. Étendu dans son cercueil de verre, il dort : tranquille et embaumé. Sur son visage d’une blancheur de cire, semé de taches de rousseur, aux pommettes saillantes, la lumière immobile et froide des lampes électriques casse de violents reflets de cuivre dans sa barbiche rousse. « Son crâne, remarque Wells, a la forme de celui de Balfour. » Son crâne socratique, dit Gorki. Je pose ma main sur le cristal du cercueil, à la hauteur de son visage : j’ai l’impression d’effleurer son sourire tant ses lèvres sont près de mes doigts.
Lénine dort, les yeux mi-clos, la main gauche doucement ramenée sur la poitrine, la paume de la main droite abandonnée le long du corps. Il dort en souriant parmi les drapeaux rouges de la Commune de Paris et de la IIIe Internationale. Sa figure effilée, son cou grêle, ses bras maigres, tout son corps chétif, raccourci par la paralysie, desséché par la fièvre, lui donnent l’air d’un vieux petit bonhomme, d’un modeste employé en retraite, mort dans son lit. Que de fiches, que de dossiers, que de papier buvard dans sa vie : que de taches d’encre sur ses mains ! Quand la mort a brisé sa carrière, Lénine n’avait pourtant que cinquante-quatre ans. Cet honnête fonctionnaire du désordre n’avait pas encore l’âge de la retraite. Quel cruel destin pour un petit bourgeois fourvoyé dans la carrière révolutionnaire ! Mais Wladimir Ilitch dort en souriant : tous ses papiers sont en ordre, sa conscience est tranquille. Comment aurait-il pu mourir en avance ? Sa carrière ne pouvait s’achever que respectueuse de la ponctualité.
« Pourquoi l’avez-vous embaumé ? demandé-je à l’ouvrier communiste qui m’accompagne : vous en avez fait une momie. »
« Nous ne croyons pas à l’immortalité de l’âme », me répond-il.
Curzio MALAPARTE, Le bonhomme Lénine, 1932.
TABLE DES MATIÈRES
_______
Prologue
Note
I. – Le Frère du Pendu
II. – Robinson chez les Vendredis
III. – Maximilien Lénine
IV. – Du côté de chez Swan
V. – Monsieur Lénine, Français moyen
VI. – Jacob au pied de l’échelle
VII. – Une perruque dans la forêt
VIII. – « La tête me tourne »
IX. – Encore une victime du bon sens