NIJOLÉ SADUNAITÉ
UN SOURIRE
AU GOULAG
Journal d’une catholique lituanienne
1975-1983

Préface du Père V. Mincevicius

AIDE À L’ÉGLISE EN DÉTRESSE
BIBLIOTHÈQUE AED – COLLECTION « TÉMOINS »
•
PRÉFACE
« ... Vous n’avez pas été faits pour vivre comme des bêtes, mais pour rechercher la vertu et le savoir... »
Dante
On ne connaît que bien peu d’éléments relatifs à la biographie de Nijolé Sadunaité, auteur de ces lignes émouvantes. En 1975, elle fut condamnée à trois ans de camp à régime sévère et à trois ans d’exil en Sibérie, pour avoir défendu courageusement la liberté religieuse et les droits de l’homme brutalement foulés aux pieds dans sa patrie : la Lituanie. On ne sait que peu de choses de la vie de Nijolé Sadunaité, seulement qu’elle est née en 1938 à Dotnuva, en Lituanie septentrionale, et qu’elle a un frère, Jonas, marié et père d’une petite fille. Son père, décédé en 1963, était professeur à l’Académie d’Agriculture de Dotnuva. Ses parents, l’un et l’autre profondément croyants, s’efforcèrent de bien élever leurs enfants.
En 1955, Nijolé termina ses études à l’école secondaire d’Anylesciai et, bien que dans les écoles soviétiques les croyants soient l’objet constant de discrimination, elle ne manqua jamais d’assister le dimanche à la messe. Lorsque, au cours d’une excursion scolaire, il arrivait que l’on visitât une église, la jeune fille avait le courage de s’agenouiller respectueusement devant le Saint-Sacrement et cela en présence de ses compagnes et de ses professeurs.
Toutefois et toujours en raison de la discrimination religieuse, elle ne fut pas admise à suivre des études supérieures et dut se contenter d’un diplôme d’infirmière. Pendant cinq ans, elle s’occupa de sa mère infirme, qui s’éteignit en 1970. Pendant plusieurs années, elle assista avec dévouement et jusqu’à sa mort le chanoine Petras Rauda, revenu en Lituanie mais gravement malade des suites de plus de dix années passées dans les camps de concentration staliniens. La souffrance humaine a toujours suscité une profonde compassion dans le cœur de Nijolé ; elle a toujours réduit au minimum ses besoins personnels, afin de secourir les autres, allant parfois jusqu’à se priver des choses les plus nécessaires afin d’aider ceux qui souffraient.
En septembre 1970 se déroula, à Moletai, le procès du Révérend Antanas Seskevicius, accusé d’avoir enseigné le catéchisme à des enfants. Pour lui avoir procuré un avocat, Nijolé fut prise pour cible par le K.G.B. À partir de ce moment-là, elle fut l’objet d’une filature continuelle jusqu’au 27 août 1974, où elle fut surprise, lors d’une irruption de tchékistes 1 dans son propre domicile, en train de transcrire le no 11 de la « L.K.B. Kronika » (Chronique de l’Église Catholique de Lituanie) ; elle fut alors arrêtée. Elle fut soumise pendant dix mois à des interrogatoires aussi éprouvants qu’infructueux et dont l’objet était d’obtenir des renseignements concernant les auteurs et les diffuseurs de la publication citée ci-dessus ; les 16 et 17 juin 1975 elle passa en procès devant le Tribunal suprême de la R.S.S. de Lituanie, présidé par le Russe Kudrasov, le ministère public étant représenté par Jurgis Bakucionis ; dans la salle, il y avait seulement six militaires, cinq agents du K.G.B. et son frère Jonas Sadunas. Les témoins tenus à l’écart dans une autre salle après avoir fait leur déposition, étaient éloignés de la salle d’audience, afin qu’ils ne puissent pas assister à tout le déroulement du procès.
Nijolé refusa de répondre aux questions du tribunal en déclarant :
« Puisque ce n’est pas moi la coupable, mais vous seuls qui violez les droits les plus élémentaires de l’homme, droits garantis par la loi, la constitution et la déclaration universelle des droits de l’homme, qui répandez le mensonge, usez de la contrainte et de la violence et puisque, après avoir calomnié et condamné des personnes innocentes, vous les torturez dans les prisons et les camps, je refuse de répondre à toute question du tribunal – comme je l’ai d’ailleurs fait au cours des interrogatoires –voulant ainsi protester contre ce procès. »
En renonçant à l’assistance d’un avocat pour la défendre, elle déclara en particulier :
« Étant donné que, d’après vous, je serais une criminelle particulièrement dangereuse pour l’État, et ne voulant pas attirer votre colère sur celui et ceux qui devraient me procurer un avocat, je déclare renoncer à l’assistance légale. Ceci est une face de la médaille. L’autre face, c’est que la vérité n’a pas besoin d’avocats pour la défendre, car elle est toute-puissante et invincible. Seuls la fourberie et le mensonge, impuissants face à la vérité, ont besoin d’armes, de soldats et de prisons, pour poursuivre leur infâme domination ; de toute manière, cela ne durera qu’un temps. »
L’auto-défense de Nijolé Sadunaité consista en une critique courageuse et impitoyable du système de l’oppression soviétique à l’égard de la religion :
« Vous savez bien que ceux qui soutiennent la « L.K.B. Kronika » aiment le peuple et pour cela luttent en faveur de sa liberté et de son honneur ; ils combattent pour affirmer leur droit de pouvoir jouir de la pleine liberté de conscience – liberté assurée à tous les citoyens, sans tenir compte de leurs convictions – liberté garantie par la constitution, les lois et la déclaration universelle des droits de l’homme. Ils luttent afin que ces droits ne se réduisent pas seulement à de belles paroles transcrites sur du papier et à une propagande mensongère comme elle l’a été jusqu’ici, mais bien pour qu’ils deviennent effectifs. En fait, les textes de la constitution et ceux des lois sont destinés à demeurer lettres mortes s’ils ne sont pas appliqués dans la vie courante et partout on constate des cas de discrimination légalisée à l’égard des croyants. La « L.K.B. Kronika », se propose justement de refléter comme dans un miroir les crimes perpétrés par les tenants de l’athéisme à l’égard des croyants. Et, étant donné que le crime a conscience de sa propre ignominie, il répugne à se regarder dans ce miroir. C’est pour cette raison que vous détestez tous ceux qui tentent d’arracher de votre visage le masque du mensonge et de l’hypocrisie. Mais il n’en reste pas moins que le miroir conserve son pouvoir de réflexion ! Le voleur dépouille la victime de son argent ; vous, vous dérobez à l’homme ce qu’il a de plus précieux : la fidélité à ses propres convictions et la possibilité de transmettre ce patrimoine à ses enfants, à la nouvelle génération... »
L’accusée, après avoir critiqué impitoyablement l’école soviétique, coupable d’avoir détruit l’autorité des parents, en refusant à ceux-ci le droit d’éduquer leurs enfants conformément à leurs propres convictions, demande alors au tribunal :
« Comment se fait-il que, lorsque les enfants chez lesquels l’école a détruit l’autorité des parents prennent le chemin de la perdition, ce soient les parents et non les enseignants qui soient incriminés ? » et elle ajoute que la nouvelle génération est éduquée et instruite par des individus absolument incompétents et qui, profitant de leur situation d’enseignants, inculquent dans l’esprit des élèves des idées fausses concernant la religion.
Rappelant ensuite les méthodes utilisées avec elle lors des interrogatoires, Nijolé déclare :
« Est-il possible que toute la justice soviétique s’appuie seulement sur la peur ? Si j’avais été réellement une malade mentale, il fallait me guérir et non me menacer à cause de ma maladie. De quelle faute est coupable une personne malade ? »
Et elle continua de la même façon :
« En réalité, il vous est indifférent de réparer les injustices ; bien au contraire, vous les tolérez et les encouragez, la preuve en est que, lors de mon procès, les témoins interrogés à mon sujet ont confirmé la véracité des faits mentionnés par la « L.K.B. Kronika » ; il leur a été demandé avant tout s’ils connaissaient ceux qui transmettaient les informations aux éditeurs de la « L.K.B. Kronika » ; à qui ces documents étaient confiés ; qui avaient-ils vu, entendu..., etc. Voilà donc ce que vous craignez par-dessus tout : la voix de la vérité... Et dans le même temps, vous proclamez partout que la religion est une affaire privée concernant les citoyens et que tous, quelles que soient leurs convictions, jouissent des mêmes droits. Votre propagande est aussi belle que répugnante est la réalité de la vie !... »
Parlant de la morale et de l’éthique communistes soviétiques, Nijolé souligne l’interdiction faite aux mourants des hôpitaux d’obtenir l’assistance d’un prêtre, même si les malades ou leurs parents les plus proches la réclament :
« Même aux criminels on accorde le droit d’exprimer leurs derniers désirs ! Par contre, vous osez bafouer les convictions les plus sacrées de l’homme au moment le plus dramatique de sa vie : l’heure de la mort et, comme des bandits, vous dépouillez moralement des milliers de croyants. Voilà ce que sont votre morale et votre éthique soviétiques. »
Rappelant ensuite la campagne de diffamation à l’encontre de l’Église, du Pape, des Évêques, des prêtres et des fidèles, Nijolé ajoute :
« Quand ces calomnies répugnantes ont-elles été démenties ? Jamais, parce que le mensonge et la calomnie sont votre pain quotidien ! »
Après avoir cité d’autres exemples de la persécution religieuse, comme l’hospitalisation en établissement psychiatrique pour « guérir » les individus de leurs convictions personnelles, l’ingérence brutale et impitoyable du gouvernement dans les affaires de l’Église et du droit canon, en dépit du décret « de la séparation de l’Église et de l’État », Nijolé ajoute : « En Lituanie, l’Église n’est pas effectivement séparée de l’État, mais elle lui est assujettie. »
Et elle conclut son discours d’auto-défense en ces termes :
« Ces faits et des centaines d’autres montrent que le but des athées est de faire de chacun leur esclave. Pour atteindre ce résultat, tous les moyens sont bons : le mensonge, la calomnie, la terreur !
Et vous vous réjouissez de votre victoire ! Mais sur quoi se base son triomphe ? Sur la ruine de la moralité ; sur des millions d’enfants assassinés avant leur naissance ; sur la profanation de la valeur de la personne humaine ; sur des hommes misérables et lâches, pourris par la peur et le venin des passions humaines. Voilà ce que vous produisez. C’est ce que le Christ disait : « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». Vos crimes vous poussent de plus en plus vite vers ce qu’il y a d’immonde dans l’histoire.
Grâce à Dieu, tous les hommes ne se sont pas encore soumis. Nous ne bénéficions pas dans la société d’un soutien quantitatif, mais la qualité se trouve de notre côté. Sans craindre ni la prison, ni les camps, il nous faut condamner toutes les actions qui entraînent injustices et humiliations, qui engendrent inégalités et oppression. Lutter pour les droits de l’homme est un devoir sacré pour chacun. Je suis heureuse d’avoir eu l’honneur de souffrir pour la « L.K.B. Kronika », dont je suis convaincue de la vérité et de la nécessité et à laquelle je resterai fidèle jusqu’à mon dernier soupir. Continuez à promulguer autant de lois que vous voudrez ; mais gardez-les pour vous seuls. Il faut distinguer entre ce qui est écrit par l’homme et ce qui est demandé par Dieu. Le tribut à César ne peut être que le reste du tribut dû à Dieu. Ce qui est le plus important dans la vie, c’est de libérer son cœur et son esprit de la peur, car céder au mal est la plus grave des fautes. »
À la fin du procès, Nijolé Sadunaité, usant de son dernier droit à la parole, déclara :
« Ce jour est le plus heureux de ma vie. J’ai été jugée à cause de la « L.K.B. Kronika », qui lutte contre la tyrannie physique et spirituelle envers les hommes. C’est pourquoi je veux dire que j’ai été condamnée aujourd’hui à cause de la vérité et de l’amour à l’égard des hommes ! Que peut-il y avoir de plus important dans la vie que d’aimer les hommes, leur liberté et leur honneur ? L’amour du prochain est l’amour le plus grand ; lutter pour les droits de l’homme est le plus beau chant d’amour. Qu’il résonne dans tous les cœurs ; qu’il ne cesse jamais de résonner ! Ce qui m’arrive est un sort enviable, un destin glorieux : c’est non seulement lutter pour les droits de l’homme et pour la justice, mais c’est aussi être condamnée à cause d’eux ! Ma condamnation sera mon triomphe. Je regrette seulement d’avoir si peu fait pour les hommes. Avec joie, je partirai en esclavage pour la liberté des autres et je suis disposée également à mourir pour que les autres vivent. En m’approchant aujourd’hui de la Vérité éternelle – de Jésus-Christ – il me vient à l’esprit la quatrième des béatitudes : « Bienheureux ceux qui cherchent la justice, parce qu’ils seront rassasiés. » Comment ne pas se réjouir alors que le Dieu Tout-Puissant a promis que la lumière vaincra les ténèbres, et la vérité, l’erreur et le mensonge. Et pour que cela arrive le plus tôt possible, je suis prête non seulement à être emprisonnée, mais aussi à mourir. Qu’on se rappelle ici les paroles du poète Lermontov : « Et pourtant, c’est le juste jugement de Dieu »... Que Dieu fasse que le verdict de ce jugement soit bénéfique pour nous tous. À cette intention je prierai le Seigneur pour vous tous, chaque jour de ma vie.
Au tribunal je demande de libérer des prisons, des camps et des hôpitaux psychiatriques tous ceux qui luttent pour les droits de l’homme et pour la justice. De cette manière, vous manifesterez votre bonne volonté et vous contribuerez à ce qu’il y ait dans la vie davantage d’harmonie et d’amour ; c’est ainsi que cette pensée si belle « l’homme est un frère pour l’homme » deviendra enfin une réalité. »
Cet appel, comme celui de bien d’autres personnes, ne fit cependant guère impression sur l’esprit et le cœur des serviteurs aveugles d’un régime qui n’a presque rien d’humain, qui tend à conquérir le monde entier et à asservir complètement l’homme à une idéologie désuète et dépassée par le cours de l’histoire ; cette idéologie est seulement devenue l’instrument d’un impérialisme des plus impitoyables. En dépit de l’intérêt porté par les gouvernements et les chrétiens, en dépit des innombrables interventions pour sa libération, Nijolé dut accomplir intégralement sa peine : trois ans de camp à régime sévère en Mordovie et trois ans d’exil en Sibérie. Cette modeste et frêle jeune femme faisait peur aux dirigeants du Kremlin. Une fois de plus, le gouvernement soviétique a montré que son unique soutien résidait dans la force brutale.
La solidarité et l’intérêt manifesté par le monde libre ont été cependant d’une grande aide morale pour Nijolé et contribué à ce que le régime n’ose pas l’anéantir physiquement par des moyens plus sournois et détournés, typiques de ces régimes totalitaires qui se proclament « les plus démocratiques du monde ».
Aujourd’hui, la solidarité lui est particulièrement nécessaire, car Nijolé est contrainte de vivre dans la clandestinité, ainsi que l’attestent ces mémoires écrits à la hâte, à des périodes diverses et datés de Moscou, sa patrie lui étant devenue « étrangère ».
Heureusement que rien de ce qui est injuste n’est définitif.
Vincas Mincevicius
MÉMOIRES DE NIJOLÉ SADUNAITÉ
« Que ta miséricorde m’accompagne
tous les jours de ma vie »
(Ps 22, 6)
Aider ceux qui sont persécutés
pour la foi, est un « délit »
En 1970, on intenta un procès au Père Seskevicius pour avoir fait le catéchisme à des enfants. Je lui ai procuré un avocat. Aider ou se solidariser avec les persécutés signifie se trouver bientôt sur la liste même de ces derniers, c’est-à-dire dans le point de mire du K.G.B. Le procès du Père A. Seskevicius se déroula à Moletai les 7 et 8 septembre 1970. Alors que le premier jour de l’audience nous entrions dans la salle, nous pûmes remarquer que toutes les places assises étaient déjà occupées par les agents du K.G.B. qui respiraient la santé, de miliciens en civil et de quelques femmes au maquillage provocateur. Les témoins, les amis et les connaissances du prêtre, dont seulement une partie avait pu pénétrer dans la salle, durent rester debout pendant toute la durée du procès. L’audience se déroula de 9 h à 18 h. Parmi les témoins, on pouvait remarquer des femmes d’un âge avancé, des mères de famille nombreuse exténuées par leur travail au kolkhoze, une mère de quatre enfants relevant d’une opération de l’estomac, un invalide de guerre, privé de l’usage de ses jambes. Rester ainsi longtemps debout était très pénible et à la demande faite à des plus jeunes de céder leur siège, ceux-ci répondirent rageusement : « S’ils sont fatigués, qu’ils s’en aillent !... Personne ne les retient ici ! » Ces malheureux n’avaient pas réussi à comprendre que ce qui poussait toutes ces personnes à assister au procès, n’était pas autre chose que l’affection et le respect qu’ils portaient à ce prêtre, tandis que... eux, ils s’ennuyaient, passaient le temps à feuilleter des journaux, à parler entre eux, à plaisanter cyniquement de la peine des fidèles soucieux du sort du prêtre ; ils se désintéressaient complètement du procès.

Photo de Nijolé Sadunaité, condamnée en 1975 à 3 ans de travaux forcés dans un camp de Mordovie et à 3 ans d’exil en Sibérie.
Pour témoigner, on avait en particulier convoqué 17 garçons entre 7 et 10 ans ainsi que leurs parents. Ces jeunes, à l’approche du procès avaient été terrorisés par la directrice de l’école de Dubingiai, qui, soutenue par quelques tchékistes, avait essayé par des menaces et même par des coups, d’obliger les enfants à signer des déclarations toutes faites dans lesquelles on trouvait par exemple ceci : « Dans la salle de l’église, le prêtre enseignait la religion aux garçons. » Sur les 17 garçons, quatre seulement signèrent et ces derniers, au cours du procès, déclarèrent qu’ils avaient été contraints, par la menace et la force, de signer cette déclaration sans en connaître le texte. Tous les témoins, et parmi eux les enfants, furent séparés jusqu’au moment de la déposition. Les policiers menacèrent les enfants aussi bien que leurs parents, leur enjoignant de déclarer au tribunal que le prêtre avait enseigné la religion à des jeunes. Cependant, lorsqu’arriva le moment des dépositions, tous déclarèrent à l’unanimité que c’étaient les parents ou les proches parents qui avaient enseigné les vérités de la foi et que le rôle du prêtre n’avait été que de contrôler les notions des éducateurs. Ils ajoutèrent que, s’il y avait quelqu’un à châtier, ce n’était pas le prêtre, mais eux-mêmes. Malheureusement, on ne tint pas compte de cette affirmation. Le juge après avoir appelé l’un après l’autre chacun des jeunes témoins leur dit : « Vous avez bien fait d’étudier la religion. Il faut l’étudier. Moi aussi, je l’ai étudiée. C’est bien le prêtre qui vous l’a enseignée... N’est-ce pas ? »
Les enfants, bien que terrifiés et certains en larmes, déclarèrent tous ensemble que ce n’était pas le prêtre qui les avait instruits, mais leur père, leur mère ou leur grand-mère.
Après ce procès, à cause de la peur qu’ils avaient éprouvés, quatre des enfants tombèrent sérieusement malades : saisis d’une forte fièvre, ils étaient agités et pendant leur sommeil criaient en ayant peur des miliciens.

Le prêtre Antanas Seskevecius jugé plusieurs fois et condamné pour avoir enseigné le catéchisme. Cette photo a été prise au cours du dernier procès en septembre 1970.
À la fin de la première journée de l’audience, le Père Seskevicius célébra la messe en présence des paroissiens attristés. Au cours de son sermon, il exhorta tous les fidèles, à l’exemple même du Christ, à répondre par la charité et la prière à la haine et aux injustices. Les enfants, agenouillés devant la croix, remercièrent le Seigneur de les avoir aidés à ne pas céder aux menaces des fonctionnaires et de leur avoir permis de dire au tribunal toute la vérité.
La justice soviétique
Le second jour du procès, moins de personnes encore qu’à l’audience précédente furent admises dans la salle du tribunal. Tous les sièges étaient pratiquement occupés par les agents. Le prêtre mis en accusation n’avait pas le droit d’avoir de témoins. Alors que le président venait de décider une interruption d’audience, surgirent dans la salle deux miliciens qui, sans aucune explication, mirent dehors la seule témoin qui s’y trouvait. Tout de suite après, parut dans la salle le substitut du chef de la milice, Tamasiunas. Les agents de garde du K.G.B. à la porte, en me montrant du doigt, lui dirent « Attrapez celle-ci ! » Le substitut me saisit alors par une main, mais je réussis à me dégager. C’est alors qu’accoururent deux miliciens qui, après m’avoir tordu les bras derrière le dos, me conduisirent dehors sans me laisser le temps de prendre mon sac à main. On nous fit monter dans une auto (moi et l’autre témoin) et Tamasiunas nous conduisit au siège de la milice. À peine arrivées... et à notre vue, les miliciens se mirent à ricaner et comme nous l’apprîmes, notre éloignement brutal de la salle d’audience avait été prévu d’avance afin d’effrayer les autres. La dame arrêtée en même temps que moi était mère de quatre enfants, récemment opérée de l’estomac et dont la troisième fille, Teresélé, était tombée sérieusement malade à la suite de la frayeur de la veille. J’expliquais tout cela à l’un des chefs de la milice, lui demandant de laisser partir cette femme et en lui faisant remarquer quel genre de « criminels » nous étions ! Il commença par me rire au nez, puis environ une demi-heure après, il accompagna cette dame à l’autobus qui se rendait à son kolkhoze et ordonna au chauffeur de ne pas la laisser descendre en route, afin qu’elle ne puisse retourner au tribunal. Très éprouvée, la pauvre femme était toute pâle et pleurait.
Le procès terminé et une fois le prêtre reconduit à la prison de Lukiskés à Vilnius pour purger une peine d’une année de régime sévère, Tamasiunas revint au siège de la milice en annonçant triomphalement : « Nous avons condamné le prêtre ! » Ensuite, il expliqua qu’il m’avait arrêtée pour assurer le calme dans la salle d’audience. À vrai dire personne ne dérangeait l’audience, le juge ne m’avait pas fait une seule remarque et je n’ai pas encore compris de quel « calme » il s’agissait. Puis, Tamasiunas se mit à se moquer de la religion, ce qui m’amena à lui dire qu’on ne se moque pas de ce que l’on ne connaît pas.
La triste fin de l’ex-prêtre Ragauskas
Tout en continuant à parler de religion, Tamasiunas me dit soudain : « Tu es abusée par la religion, mais Ragauskas a été plus malin que toi. As-tu lu ce qu’il a écrit ? » – « Oui, j’ai lu ses livres ; mais il me semble qu’avant de mourir, l’ex-prêtre Ragauskas s’est repenti de ce qu’il avait écrit et qu’il a demandé un prêtre ; mais les deux tchékistes de garde devant sa chambre d’hôpital ont empêché toute visite. Le personnel de l’hôpital rapporte l’avoir entendu prier et réciter à haute voix le psaume pénitentiel de David : « Miserere mei, Deus... » ainsi que d’autres invocations », expliquais-je. Tamasiunas fut décontenancé, mais après un moment de réflexion, il me dit : « Avant de mourir, Ragauskas a prié, parce qu’il était retombé en enfance... » Tout étonnée, je lui dis : « Comment ! Quelques mois à peine avant sa mort, un article signé de lui a été publié dans le Journal de la République ; or tout le monde sait que ce journal ne publie pas les écrits d’individus tombés en enfance. De plus, Ragauskas avait à peine 60 ans et bien qu’il fût atteint d’un cancer à l’estomac, il ne pouvait certainement pas être retombé en enfance seulement deux mois après avoir écrit cet article ! » Tamasiunas n’insista pas et préféra changer de conversation. En dépit de cela, il fut le premier des chefs athées à témoigner, en présence de nombreux autres miliciens, que l’ex-prêtre Jonas Ragauskas avait prié avant de mourir. Que le Seigneur ait pitié de son âme !
Les agents du K.G.B. essayent de noyer
leur conscience dans l’alcool.
Tout de suite après, Tamasiunas me rendit le sac à main et le passeport qu’il avait enlevés au moment de me faire sortir de la salle du tribunal, mais non sans avoir pris des notes pour le K.G.B. de Vilnius. Je m’apprêtais à sortir quand voilà que s’ouvre toute grande la porte et que surgit dans la pièce, ivre-mort, le chef du K.G.B. de Moletai. M’apercevant, il se dirige vers moi en titubant, frappe du poing sur la table et crie en hurlant : « Pourquoi es-tu venue ici ? Qu’est-ce que tu veux ? Pourquoi le défends-tu ? Qu’est-ce qu’il est pour toi ? Tu ne sais donc pas que ses mains ruissellent de sang ?... » Sa rage était telle que, en hurlant, la salive lui sortait de tous les coins de la bouche. Les miliciens présents, intimidés par cette fureur, s’étaient écartés dans les divers coins de la salle. Je lui répondis calmement que ma défunte mère et le Père Seskevicius avaient fait ensemble leurs études au lycée de Birzai et que par conséquent elle l’avait bien connu ; elle l’avait toujours estimé et moi, à mon tour, j’avais de l’estime pour tous les prêtres. Il continua à crier, disant qu’il savait tout de moi, qu’il avait enregistré mes conversations avec le prêtre..., etc. « Ce que vous savez de moi ne m’intéresse pas », lui répondis-je. Puis après quelque temps, face à mon attitude ferme et sereine, le chef du K.G.B. se calma. Quand je fus relâchée par la milice, il était déjà minuit. Pour la première fois, je réalisais clairement combien ceux qui n’ont ni foi ni amour sont à plaindre.
Je compris que les souffrances de la prison, acceptées pour eux avec amour par le Père A. Seskevicius finiraient par toucher leur cœur et leur conscience. Ah, s’il y avait davantage de monde prêt à monter au Golgotha et à mourir pour eux !
Menaces pour avoir défendu un prêtre
Une fois le procès du P. Seskevicius terminé, je fus immédiatement convoquée au K.G.B. de Vilnius, où les tchékistes Gudas et Kolgov (russe) me reprochèrent d’avoir osé trouver un avocat pour la défense du P. Seskevicius. Gudas menaça de me faire licencier de mon emploi, de m’enlever l’appartement communal, de m’éloigner de Vilnius et de « s’occuper » de mon frère Jonas Sadunas. Constatant qu’il ne m’avait finalement pas ébranlée, le tchékiste décida d’aller plus loin : « Nous te ferons un procès comme nous l’avons fait à Seskevicius, comme ça tu pourras le retrouver en prison ! » – Je lui répondis que j’étais prête à souffrir avec joie au nom de la vérité. Alors, les nerfs de Gudas ne purent tenir plus longtemps et il sortit en claquant la porte. Après s’être rendu compte que je n’étais nullement intimidée, les miliciens me relâchèrent. Cependant, à partir de ce moment-là, conformément à la menace de Kolgov, j’étais tout le temps suivie. Je me rendis compte seulement en été 1974, peu de temps avant mon arrestation, que j’étais partout prise en filature par deux ou trois agents du K.G.B. Je commençais donc, en raison d’une imminente perquisition, à détruire ou à cacher tout ce qui, après mon arrestation, serait de nature à porter préjudice à d’autres personnes et à les conduire à des interrogatoires : lettres reçues, adresses, numéros de téléphone du travail ou du domicile de tierces personnes, etc.
Perquisition à l’improviste
Le 27 août 1974, après avoir prié dans la petite chapelle de la Vierge, Mère de Miséricorde, à la Porte de l’Aurore (est ainsi appelée la porte de l’antique enceinte des murs de la capitale lituanienne de Vilnius et dans laquelle se trouve exposée, depuis la moitié du XVIe siècle, une image miraculeuse de la Vierge, placée en cet endroit pour préserver la ville des invasions tartares et moscovites2), je retournais chez moi avec le no 11 de la « L.K.B. Kronika » (Chronique de l’Église Catholique de Lituanie), avec l’intention de la copier. Je portais également la machine à écrire dont m’avait fait cadeau le chanoine Petras Rauda, disparu. En entrant chez moi, au 27/2, rue Architektu, je croisai mon frère qui sortais pour se rendre à la polyclinique et je n’eus pas même le temps de lui parler. Arrivée dans ma chambre, je commençais à copier la « L.K.B. Kronika ». Au bruit de la machine à écrire, ma voisine d’appartement – une informatrice du K.G.B., ce que je n’avais jamais pensé jusque-là – téléphona au K.G.B., l’informant de ce qui se passait. Je devais apprendre cela par un tchékiste, le major Vytautas Pilelis, qui, au cours de l’interrogatoire auquel je fus ensuite soumise, déclara entre autres : « Tu as eu pitié de tous, mais tous n’en ont pas eu pour toi ; à peine t’étais-tu mise à taper la Kronika que ta voisine m’a téléphoné. » – À cela je répondis : « Si elle l’a fait avec la conviction de bien faire je la respecte ; mais si elle l’a fait par intérêt, j’en éprouve de la pitié ! » Alors que les tchékistes déjà postés avaient cerné la maison, cette même voisine, professeur, fut envoyée par eux à la polyclinique pour savoir si mon frère serait rapidement de retour, car les tchékistes avaient l’intention d’entrer dans l’appartement en même temps que lui et de me prendre sur le fait, en train d’écrire. Et c’est ce qu’ils firent : à peine mon frère était-il rentré qu’un groupe de tchékistes fit irruption dans notre appartement. Trois d’entre eux forcèrent la porte de ma chambre, et en me voyant devant la machine à écrire, parlant avec Broné Kibickaité (ma meilleure amie), ils crièrent à haute voix : « Halte-là ! Que personne ne bouge ! Haut les mains ! » C’est alors qu’en souriant, je leur demandai : « Pourquoi criez-vous si fort ?... Auriez-vous vu une bombe atomique ?... » Je dis cela avec tant de naturel que Broné pensa qu’il s’agissait de quelques-unes de mes connaissances en veine de plaisanteries de mauvais goût, au point qu’elle leur demanda : « Et vous, comment êtes-vous entrés ? » Les intrus ne fournirent aucune explication, ils déclarèrent seulement qu’ils étaient en possession d’un mandat de perquisition. Ils me conseillèrent de déclarer immédiatement tout ce que j’avais comme choses interdites. Alors, je me levai et leur dis : « Ce qui vous intéresse surtout, c’est la « L.K.B. Kronika »... eh bien la voilà !... Ici, vous ne trouverez rien d’autre ! » – « Assieds-toi devant ta machine – me hurlèrent les tchékistes – et on va faire une photo. » – « Si vous voulez vous photographier, faites comme chez vous », répondis-je et je mis à l’écart. Alors, ils nous ordonnèrent à moi et à Broné de nous mettre dans un coin de la pièce et de ne plus bouger. Alors commença la perquisition, tandis que toutes les deux, pour ne pas perdre notre temps, nous nous mîmes à réciter à haute voix le chapelet après leur avoir dit : « Pendant que vous ferez votre travail, nous prierons. » Les malheureux tchékistes se sentaient quelque peu mal à l’aise, du fait que, nullement effrayées, nous priions tranquillement sans leur prêter la moindre attention. Pendant l’opération, les tchékistes emmenèrent Broné Kibickaité dans son appartement situé à Tiesos 11 bt 38, où ils effectuèrent également une perquisition sans rien trouver « d’illégal ». Plus tard, ils conduisirent mon frère au siège (irstva) du K.G.B. pour pouvoir, par la suite, perquisitionner sa chambre et cela sans moi, sans lui et sans mandat. Ils ne tinrent aucun compte de mes protestations énergiques contre la peur imposée à mon frère malade, comme quoi tout est permis aux tchékistes.

Couverture du numéro 7 de, la « Chronique de
l’Église Catholique de Lituanie », clandestine.
Au cours de l’opération, les tchékistes confisquèrent trois numéros de la « L.K.B. Kronika ». Ensuite, ils prirent d’autres choses sans me les montrer et sans les noter sur le procès-verbal de la perquisition. Disparurent ainsi de nombreuses notes à caractère religieux, quelques photos, etc., tandis que les adresses, que j’avais soigneusement dissimulées, leur échappèrent. L’un des tchékistes, ayant fortuitement découvert des lettres qui m’étaient adressées, s’écria, tout fier de lui : « Des lettres ! »... Dans un bond subit, je me lançai sur lui, et après lui avoir arraché les lettres, les déchirai en petits morceaux, tandis que le tchékiste s’écriait : « Donne-les-moi ! » Rapidement je courus aux toilettes qui se trouvaient du côté du couloir et jetai le tout dans la cuvette en faisant couler l’eau. Les tchékistes ne s’attendaient pas à une réaction aussi rapide et quand ils se rendirent compte du fait, il était trop tard. J’ai ainsi réussi à éviter aux auteurs de ces lettres, interrogatoires et perquisitions. Les tchékistes, remis de leur surprise, m’entourèrent en hurlant qu’ils me conduiraient au K.G.B. et continueraient la perquisition en mon absence. « Vous pouvez m’emmener où vous voudrez, répondis-je tranquillement, car maintenant, je sais que personne n’aura à souffrir à cause de moi. » Ils ne m’emmenèrent pas, car la perquisition touchait à sa fin. Le tchékiste Kolgov entra dans la chambre et déclara, très satisfait : « Il y a quatre ans, on t’avait avertie... depuis, on t’a suivie partout... Tu ne t’es pas corrigée... Maintenant tu vas payer pour tout... » Je lui répondis : « D’après le proverbe russe selon lequel une promesse doit être tenue avant trois ans, constatez que vous êtes en défaut, car voilà quatre ans que vous m’aviez promis de m’emprisonner ! » Kolgov, pris à contre-pied, parut déconcerté, déclarant qu’il n’avait jamais dit une telle chose et que j’avais rêvé. « Ça suffit, lui répondis-je, car vous m’avez fait comprendre à temps voulu à qui j’avais affaire, et c’est pourquoi je refuse maintenant de parler avec vous, pour ne pas courir le risque d’être de nouveau accusée de « rêver »... » À partir de ce moment-là, je pris la résolution de ne plus parler de ces faits pendant les interrogatoires avec les tchékistes, esclaves du mensonge.
L’interrogatoire au K.G.B.
La perquisition achevée, quelques-uns des tchékistes me conduisirent au siège du K.G.B., pendant que les autres, demeurés chez moi et en mon absence et celle de mon frère, effectuèrent une dernière perquisition sans trouver quoi que ce soit « d’illégal ». Le lieutenant-colonel Petruskevicius, qui avait dirigé la perquisition, commença l’interrogatoire. Alors qu’il me demandait : « De qui as-tu reçu la Kronika ? », je déclarais : « Je ne répondrai à aucune question relative au procès, car les premiers coupables, c’est vous, vous qui violez brutalement les droits les plus élémentaires des croyants, droits garantis par la Déclaration universelle des droits de l’homme et les lois. Je proteste également contre cette procédure. Je n’aiderai pas les coupables à commettre un délit ! » – « Alors, on t’enfermera en hôpital psychiatrique, menaça Petruskevicius, là cela sera cent fois pire qu’en prison ! »
Voyant qu’il ne réussissait pas à m’intimider, il m’offrit de me remettre en liberté, à condition que je lui indique de qui j’avais reçu la « L.K.B. Kronika ». Je refusai de répondre. Et c’est ainsi que les tchékistes commettent de continuels délits durant les interrogatoires, faits pour lesquels ils devraient être tous condamnés, en vertu de l’article 187 du droit pénal qui dit ceci : « La contrainte exercée pour obtenir des aveux par la personne qui exécute la perquisition, ou qui mène l’enquête, la coercition en vue d’obtenir des aveux au cours de l’interrogatoire à l’aide de menaces ou d’autres manières illégales sont passibles d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois années. Si les dites actions sont réalisées avec recours à la violence ou moquerie à l’égard de la personne interrogée, l’emprisonnement peut aller de 3 à 8 années. » Ceci est vrai seulement sur le papier et l’est peu dans la pratique, et durant toute la période d’occupation de la Lituanie, les tchékistes ont régulièrement violé cet article sans que personne n’ait songé à les inculper, parce que toutes leurs activités étaient basées sur le mensonge et la fourberie.
En cellule d’isolement
N’ayant pas réussi à obtenir quoi que ce soit pendant mon interrogatoire, le tchékiste Petruskevicius donna l’ordre à un soldat de me conduire dans les sous-sols du K.G.B., c’est-à-dire dans l’isoloir destiné aux interrogatoires, d’où je fus transférée en cellule d’isolement. Peu de temps après, arriva une femme qui me fouilla, m’enleva tout, y compris la petite croix du cou, mon chapelet et une médaille. Puis je fus conduite dans une cellule où je devais passer 17 jours. Bien que dans cette cellule il fasse très chaud et que je manquais d’air, mon moral était assez bon du fait que j’avais été arrêtée seule, sans avoir impliqué qui que ce soit dans cette affaire. Pour remercier le Seigneur, je me mis à chanter des hymnes religieux, ce qui amena les soldats de garde à frapper à ma porte et à crier pour que je m’arrête. Puis voyant que je ne leur prêtais aucune attention, ils firent un rapport au chef, tandis qu’ils se plaignaient entre eux : « On nous a amené un disque longue durée et il n’y a pas moyen de l’arrêter ! » Peu de temps après, je commençais à perdre mes cheveux et à maigrir. Le K.G.B. dispose de tous les moyens pour briser physiquement ses victimes, pensant qu’avec le déclin des forces physiques, il en sera de même de la volonté. Mais ils ne savent pas que la personne la plus faible mais qui s’appuie sur le Christ, devient indomptable.
L’échec des interrogatoires
Petruskevicius me soumit pendant deux mois à des interrogatoires. Puis, comme il n’avait pas réussi à me faire parler de ce qui concernait le procès, il cessa d’insister. Ce fut alors Rimkus, responsable de la section des interrogatoires, qui me prit en charge.
Lui aussi me menaça continuellement de l’épouvantail de l’hôpital psychiatrique, tout en se moquant des croyants : « Vous êtes tous des peureux. À peine êtes-vous arrivés ici que vous vous comportez comme des lièvres tapis dans les fourrés : vous vous taisez, vous refusez de répondre aux questions, de faire des dépositions... Les vrais révolutionnaires ont fait du tribunal une tribune, ils criaient la vérité à la face des juges, tandis que vous, vous n’êtes que des lâches... ! » « Ne vous moquez pas des croyants », lui répondis-je, « prenez plutôt la Sainte Écriture et lisez le chapitre concernant le combat de David et de Goliath, qui reflète si bien la situation présente. Vous, le K.G.B., vous êtes aujourd’hui le symbole de Goliath, avec vos milliers de membres et vos centaines de milliers d’agents informateurs ; vous disposez de tous les moyens les plus perfectionnés d’espionnage et d’écoute ; vous avez à votre service des forces immenses : l’armée, la milice, les prisons, les hôpitaux psychiatriques, sans compter que, pour tromper les gens, vous avez suivi des cours spéciaux et que vous avez une expérience qui date de plus de vingt ans. Quant à nous, les croyants, nous sommes encore plus faibles que David, n’ayant pas même à notre disposition la fronde et le caillou... et, en plus, vous nous arrachez même les petites croix du cou. Cependant, comme David, nous vous affrontons au nom du Seigneur des Puissances et, si Dieu le veut, nous parlerons de la tribune (discours au moment du procès) ; ayez seulement un peu de patience... » Le Seigneur m’a aidée : les conditions du procès qui se déroula exceptionnellement en secret (il n’y avait que quelques tchékistes dans la salle) et les paroles que je prononçai pour ma défense : « Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? », tout cela fut bientôt connu dans le monde entier. C’est que Dieu choisit ce qu’il y a de plus faible pour confondre ceux qui se croient puissants. À Lui seul la gloire, la reconnaissance et l’amour pour les siècles !
Pendant deux mois environ, Rimkus se donna un mal fou, et puis comme il n’avait rien réussi à obtenir de moi, il me confia pour l’interrogatoire à Kazyo, substitut du chef de la section pour les interrogatoires. Le premier jour, le tchékiste Kazyo, n’ayant pas reçu de réponse à une question relative au procès, se mit à crier : « Tu n’es qu’une schizophrène ! » – « À ce qu’il paraît, vous n’êtes pas seulement un inquisiteur mais aussi un psychiatre remarquable ! », observais-je, admirative, « vous me connaissez à peine et vous exprimez déjà, et avec beaucoup d’assurance, votre opinion sur mon cas ! » – « Oui, je suis psychiatre, assura Kazyo, et si quelqu’un doit être enfermé à l’hôpital, c’est moi qui dois signer le premier. » – « Cependant, d’après ce que je sais, les schizophrènes sont habituellement atteints de la manie des grandeurs et comme vous paraissez vous considérer comme un génie, vous feriez bien de commencer par vous soucier de votre santé », lui conseillais-je. Kazyo devint pâle de colère et se mit à marcher de long en large dans la pièce. Puis il reprit l’interrogatoire utilisant intimidation et menaces, me montrant quelques photos de partisans lituaniens qui n’avaient pourtant rien à voir avec mon propre cas. Après avoir été interrogée pendant toute la journée, alors que le soir un soldat me reconduisait au cachot de la Sécurité, je réclamais du papier et j’adressais au Procureur une plainte, dont copie fut remise, pour information, au président du K.G.B. et au chef de la section des interrogatoires.
La dénonciation des abus
au cours de l’interrogatoire
Dans mon exposé, je protestais contre le banditisme moral auquel avaient eu recours les tchékistes pendant les interrogatoires : le lieutenant-colonel Petruskevicius, le major Rimkus et Kazyo, menaçant de me faire interner en hôpital psychiatrique, dans l’intention de me contraindre à des déclarations forcées.
Je déclarais en outre que je ne m’opposais pas à une expertise psychiatrique, mais ce que je ne pouvais accepter, c’était uniquement cette violence continuelle à l’encontre de ma dignité humaine et j’ajoutais que j’aurais préféré plutôt être rouée de coups, car les plaies physiques se cicatrisent plus vite que les chocs d’ordre moral. Je terminais en disant que tant que les individus chargés des interrogatoires n’auraient pas mis fin à leurs procédés de bandits, je refuserais de me rendre aux interrogatoires. Pendant deux semaines environ, je ne fus plus conduite aux interrogatoires, après quoi je reçus cette réponse du procureur du K.G.B., Bakucionis : « Les inquisiteurs ont pleinement le droit d’exiger un examen psychiatrique, mais dans votre cas, il n’en ont pas vu la nécessité. » Kazyo m’interrogea de nouveau, mais pendant un seul jour. Après la réponse de Bakucionis à ma lettre de protestation, l’interrogatoire fut alors mené par le bon serviteur tchékiste Pilelis. À peine le soldat m’avait-il accompagné près de lui qu’il m’apostropha : « Alors, tu te plains ? » – « Non, je ne me plains pas, mais par contre je proteste », lui répondis-je. « Écoute – poursuivit le tchékiste – je travaille ici depuis plus de vingt ans et j’ai vu toutes sortes d’hommes qui se croyaient solides. Pendant quelques semaines, ils réussissaient à maintenir ce genre de comportement, mais par la suite, tous ont fini par capituler... Et toi, dans ta situation, après cinq mois tu demeures souriante du matin au soir. On n’a jamais vu de cas pareil. » « C’est que vos collègues tchékistes m’ont menacée de l’hôpital psychiatrique, non pas à cause de ma bonne humeur, mais parce que je refusais de parler », dis-je en interrompant Pilelis.
Les promesses, le chantage, les menaces
« Il est sûr que si tu réponds au moins à quelques-unes des questions, on te ramènera chez toi... », me dit sournoisement Pilelis. « Même si vous pouviez m’accorder mille années de jeunesse et tout ce qu’il y a de plus beau en ce monde pour une seule de mes paroles susceptible de causer des ennuis à quelqu’un, ces années seraient pour moi un enfer. Par contre, si vous me mettez en hôpital psychiatrique pour toute ma vie, sachant que personne n’a souffert à cause de moi, alors je continuerai à me promener en souriant. La tranquillité de ma conscience m’importe plus que la liberté, voire la vie elle-même. Je ne parviens pas à comprendre comment vous, qui avez sur la conscience tant de sang, tant de larmes versées par d’honnêtes gens, vous puissiez dormir la nuit ? Je préférerais mourir mille fois plutôt que de jouir d’un seul instant de liberté avec une conscience comme la vôtre ! »
Le major Pilelis pâlit et baissa la tête. Pendant un instant, il demeura comme pétrifié. À ce moment, je compris qu’il se rendait compte de la profondeur de sa bassesse et de n’avoir pas eu la force ou la volonté d’émerger de la bourbe dans laquelle il était plongé. (Après mon retour de Sibérie, j’ai appris des choses épouvantables sur le passé de Pilelis.) Après un certain temps le pauvre tchékiste releva la tête et déclara avec rage : « Puisque les choses sont ainsi, alors aujourd’hui même on te renverra chez toi, mais en ton nom et comme si tu avais effectivement dénoncé certaines personnes, on commencera à perquisitionner et à arrêter... (et là il énuméra une série de noms de personnes absolument innocentes). Pour nous, rien de plus facile que d’imiter ta signature au bas d’un procès-verbal. Alors tes amis te tourneront le dos pour avoir trahi et nous-mêmes nous ne te dirons plus « bonjour ». – « Oh, comme vous m’avez effrayée, répondis-je en souriant. Vous voulez simplement tourner tout le monde contre moi ! Mais je n’ai pas besoin de la gratitude des gens : une seule chose m’est nécessaire : la tranquillité de ma conscience. Et quant à votre « bonjour » vous pouvez vous le garder ! » – « Nous sommes au courant de tout cela même sans que tu avoues », reprit Pilelis – « Si vous savez tout, alors pourquoi m’interrogez-vous ? », objectais-je. – « Peut-être pas tout », corrigea le tchékiste, « mais pas mal de choses. » Et pour prouver qu’il ne mentait pas, il commença à dire : « Tel jour, à telle heure, un tel et un tel sont venus chez toi (tout cela était exact) et tu leur as offert des prunes cuites... » Je fus saisie d’une certaine inquiétude en pensant qu’il aurait bien pu impliquer des personnes innocentes.
Un éclat de rire
déconcerte l’inquisiteur du K.G.B.
À cette pensée, je demandais au Seigneur de m’aider et tout d’un coup, me souvenant d’une histoire assez amusante survenue quelques jours auparavant alors que je me trouvais en prison, je me mis à rire aux éclats. Pilelis, qui ne s’attendait pas du tout à cette réaction, fut tellement décontenancé et confus qu’il demeura muet, bouche bée, me regardant pendant quelques minutes, tout surpris et de toute évidence n’ayant rien compris aux raisons de ma joie. Il était bien convaincu que ce qu’il venait de me redire n’avait en rien de quoi me faire rire ; par contre, cela aurait dû me causer de la peur et de l’inquiétude. Il a certainement pensé que j’essayais de recourir à cette échappatoire judiciaire selon laquelle tout ce que les tchékistes parviennent à découvrir par l’espionnage n’a de valeur que si l’inculpé en reconnaît les faits. Or, en réalité, je ne savais rien. À partir de ce moment et au cours des six mois qui suivirent, Pilelis, au cours des interrogatoires ne fit plus aucune allusion aux faits qu’il avait appris par espionnage. Un jour, tout d’un coup, il commença à me faire des compliments : « Au cours de toute ma carrière, je n’ai jamais trouvé une personne comme toi qui ait tant d’amour pour son prochain. » Alors, je lui demandais le pourquoi de telles louanges et il m’expliqua : « Il ne s’agit pas de te faire des compliments, mais c’est la vérité. » – « Et, bien que je me sois efforcée de faire du bien à tout le monde – fis-je observer –, vous m’infligerez au cours du procès une peine supérieure à celle imposée à un assassin... » – « Oui, tu attraperas davantage qu’un assassin, parce que tu sais trop de choses... » confirma Pilelis. Le lendemain, il me dit que moi et les autres personnes arrêtées : Virgilijus Jaugelis, prêtre décédé depuis, et Petras Plumpsa, nous n’étions que des « fanatiques », ce à quoi je rétorquai : « Cette appellation vous convient beaucoup mieux à vous qui essayez par la force de rendre athées tant de gens. Les croyants, au contraire, aiment tous les hommes, car le Christ a dit : « Tout ce que vous ferez pour l’un d’eux, c’est à moi que vous le ferez. » Nous luttons seulement contre le mal et nous vous pardonnons ; et s’il le fallait, nous donnerions notre vie pour vous. Et cela vous le savez bien ! » Bien sûr Pilelis le savait, mais malgré cela sur les procès-verbaux établis par les témoins, après qu’ils eussent signé et aient été congédiés, il avait ajouté sur une ligne laissée volontairement libre qu’ils avaient déclaré que j’étais une « fanatique ». Je me rendis compte de cette falsification quand j’eus connaissance des motifs de mon procès. Revenue de Sibérie, je demandais aux témoins s’ils avaient effectivement déclaré que j’étais une fanatique. Tous me répondirent négativement ; certains même d’entre eux ne savaient même pas ce que signifiait ce mot. Les tchékistes accusent de « fanatisme » religieux toux ceux qui sont poursuivis à cause de la religion. En fait, nous avions été classés dans cette catégorie par des ordres secrets provenant de Moscou.

Virgilijus Jaugelis, premier prêtre du Séminaire clandestin de Lituanie, ordonné en 1978. Condamné à deux ans de prison à cause de la « Chronique de l’Église Catholique de Lituanie », il fut libéré en raison d’une maladie incurable et mourut le 17 février 1980 à l’âge de 32 ans.
La peur de l’inquisiteur
Un jour, un soldat me conduisit pour l’interrogatoire dans le bureau de Pilelis où, en plus de ce dernier, étaient assis deux autres tchékistes. Depuis un certain temps, cela se produisait souvent parce que Pilelis avait appris à se défier de moi ; en effet il savait que durant la perquisition j’avais réussi à détruire les lettres malgré la présence de nombreux tchékistes.
« Je ne sais plus ce qu’elle pourrait faire », aurait-il dit. Pour cette raison, il n’était plus seul dans le bureau. En présence des deux tchékistes, Pilelis déclara : « Vous les croyants, vous n’êtes jamais contents : tantôt c’est ceci, tantôt c’est cela ; rien n’est bien. Croyez-vous que vous seriez mieux avec des fascistes ? » – « Je ne sais pas ce qui me serait arrivé avec des fascistes – répondis-je – mais je sais que vous êtes pire que les fascistes ! » À ce moment-là Pilelis bondit et hurla : « Comment ? !... Nous serions pires que les fascistes ?... » « Oui – répondis-je – les fascistes ont accompli une opération délibérément criminelle, mais eux au moins, ils ne s’en sont pas cachés. Vous, vous commettez les mêmes crimes, essayant de vous présenter sous le masque de « libérateurs », de « frères »... tandis que par derrière, vous cachez le même poignard taché de sang. N’y a-t-il pas quelque chose de plus répugnant dans l’homme que le pharisaïsme ? Et, étant donné que vous êtes des pharisiens, vous êtes sûrement pire que les fascistes ! » « Je mettrai tout cela dans le procès-verbal ! », cria Pilelis, tirant une feuille de papier de son bureau. « Faites-le, lui répondis-je tranquillement, je vous redirai tout point par point et je signerai ce procès-verbal. » Mais Pilelis n’eut pas le courage de mettre sur le papier mes paroles et il se garda bien d’en écrire une seule virgule. Lors du dixième mois de mes interrogatoires, Pilelis me montra l’une de mes photographies, me demandant ce que j’avais à dire à ce sujet. Je vis pour la première fois une de mes photos, format carte-postale, et je compris que c’était un agrandissement d’une plus petite, exactement de celle qui figurait sur mon passeport, lequel m’avait été dérobé lors de la perquisition. Afin que personne ne soit compromis, je lui répondis : « Si cela n’a aucun rapport avec mon procès et que vous ne portiez pas mes explications sur le procès-verbal, je vous dirai ce que je pense de cette photo. » Pilelis déclara : « Tu as ma parole d’inquisiteur que cela ne concerne pas ton affaire et que je ne porterai pas sur le procès-verbal ce que tu me diras. » Je lui expliquai alors que c’était la première fois que je voyais l’une de mes photos dans un tel format et que d’après-moi quelqu’un l’avait agrandie à partir de celle figurant sur mon passeport et l’avait ensuite diffusée de façon à ce qu’elle puisse être en possession de personnes qui ne me connaissaient pas.
La « subtilité » juridique de l’inquisiteur !
Alors que je finissais de parler, le tchékiste commença à rédiger un procès-verbal relatif à mes déclarations – « Alors qu’est devenue votre parole ? » lui demandais-je – Pilelis, en souriant ironiquement, me répondit : « C’est justement ici qu’intervient la subtilité juridique ! » – « Si pour vous le mensonge est une subtilité juridique, alors, pour protester, à partir de maintenant je refuse de continuer à parler avec vous. » – Dans les deux semaines qui suivirent, chaque jour, deux à trois tchékistes avec en plus le procureur Bakucionis me conduisirent aux interrogatoires, mais je demeurais ferme dans mon attitude de silence. Enfin, les inquisiteurs constatant qu’il n’y avait rien à tirer de moi, décidèrent de clore l’instruction. Pilelis qui, pendant tout ce temps, s’était moqué de moi, disant que je ne comprenais rien aux subtilités juridiques, grommela avec ironie, alors que venaient de se terminer les interrogatoires : « Eh bien, toi, tu es très forte !... »
Les témoins terrorisés
Dès que l’instruction fut close, je poussais un soupir de soulagement en pensant que « grâce à Dieu, les témoins cesseraient d’être terrorisés ». Dans cette opération, les tchékistes Gudas et Vincas Platinskas s’étaient particulièrement distingués tandis que Pilelis s’acharnait sur mon frère. Le tchékiste Vincas Platinskas était parvenu à terroriser Broné Kibickaité jusque dans la rue : « Ta place est avec Nijolé, en prison ! » En général, les personnes les plus proches restées en liberté craignaient plus leur propre arrestation que celui qui a été arrêté. Étant donné que j’avais refusé l’assistance d’un avocat, c’est moi-même qui pris connaissance de l’enquête me concernant. Tous les nombreux témoins interrogés (au sujet des trois faits relatifs à la « L.K.B. Kronika »), tous, à l’unanimité et malgré les lourdes menaces des tchékistes, déclarèrent que les faits répondaient à l’exacte vérité.
Escortée par six soldats
Les 16 et 17 juin 1975 se déroula le procès contre moi pour « calomnie », l’instruction ayant été faite sans la participation d’un seul témoin. Je fus conduite dans la salle d’audience par six gardiens, alors que les assassins ne sont escortés que par un ou deux gardiens au maximum. De toute évidence, ils étaient inquiets, car ils savaient que mon autodéfense et ma dernière intervention seraient publiées. En ouvrant l’audience, le procureur Bakucionis, qui tournait entre ses mains une enveloppe contenant ma propre défense et ma dernière intervention que j’avais réussi à faire sortir secrètement des souterrains du K.G.B., s’adressa à moi avec gravité : « Si tu es disposée à ne pas parler, le procès terminé, tu pourras rentrer chez toi libre ! » – Cette proposition faite, je me mis à réfléchir : le procureur du Tribunal Suprême en personne m’offrait la liberté afin que je me taise ! Elle devait être bien grande leur peur d’entendre la vérité. C’est alors que je répondis : « Je ne suis pas une opportuniste et je n’ai pas l’intention de changer mes convictions. Aujourd’hui, je parlerai. »
Le désarroi du procureur
Le procureur blêmit et, la tête basse, s’assit à son siège. Dans la salle, il n’y avait que six tchékistes et les soldats russes qui m’avaient escortée et qui ne savaient pas le lituanien. On les avait de toute évidence choisis afin qu’ils ne comprennent rien de ce qui serait dit au tribunal. Alors que je demandai au juge pourquoi la salle d’audience était vide. Celui-ci, mentant, déclara qu’il avait décidé que le procès se déroulerait à huis clos...
« Comment se fait-il que les témoins, après leur déposition, soient aussitôt congédiés alors qu’il est prévu, dans le cas d’un procès à huis clos, qu’ils doivent rester, car je pourrais avoir besoin d’eux ? » – Le juge cria rageusement : « Tais-toi ! Ici, le patron c’est moi et je fais ce que je veux ! » – Je lui fis remarquer que les patrons, ce n’étaient ni lui ni moi, mais que tout le monde était tenu d’observer la loi. Alors le juge me menaça : « Encore une parole et je te fais expulser de la salle. On te condamnera sans toi ! » – « Bien sûr, vous pouvez me mettre dehors, répliquais-je, mais ce faisant, votre procès sera par trois fois illégal : sans public, sans témoins et finalement sans l’accusée. Quel genre de procès cela aura été alors ? »
Le malaise de la cour
pendant l’auto-défense
Quoi qu’il en soit, on me laissa dans la salle, ce qu’ils auraient à regretter amèrement un peu plus tard. Tandis que je commençais à prononcer ma défense, le procureur, le juge et les conseillers baissèrent la tête et les yeux. Pendant tout le temps, ils restèrent assis, le visage terreux, n’osant pas lever les yeux une seule fois, comme s’ils étaient des coupables condamnés à mort. Je ne sais pas ce que j’aurais donné pour qu’ils soient photographiés dans cet état. Les malheureux, ils se rendaient évidemment compte qu’ils commettaient un crime. Cela fut remarqué également par les soldats russes qui, après le procès, me dirent : « Mais quelle espèce de procès s’est donc déroulé ? Voilà deux ans que nous assumons le service d’escorte des prévenus au tribunal, mais jamais nous n’avons assisté à un tel genre de procès ! Vous paraissiez être le procureur, tandis que les juges avaient l’air de criminels déjà condamnés à mort. Qu’avez-vous donc pu leur dire pour qu’ils soient aussi désemparés ? » – Le second jour du procès, lors de ma dernière intervention, les juges étaient pareillement assis, pâles et la tête basse. Prions que le Seigneur soit miséricordieux à leur égard comme il l’est à notre égard.
Nouvelles méthodes de torture
dans les souterrains du K.G.B.
Dans les souterrains du K.G.B. destinés à assurer l’isolement lors des interrogatoires, les anciennes méthodes de torture utilisées jadis et décrites dans « L’Archipel du Goulag » ont été remplacées par de nouvelles méthodes. Dans les souterrains du K.G.B., il y a des cellules où règne la chaleur et d’autres où il fait froid. Moi-même ainsi que Vladas Lapienis, le prêtre Alfonsas Svarinskas (1983) et bien d’autres ont été enfermés dans ces cellules à forte chaleur, où la plupart du temps on suffoque par manque d’air, on transpire constamment comme si on venait de sortir d’un bain. Par contre, Genuté Navickaité, Onuté Vitkauskaité et d’autres ont été enfermés dans des cellules froides, humides à tel point que les murs ruisselaient d’eau. Dans ces cellules, le froid pénétrait jusqu’à la moelle des os et les articulations devenaient douloureuses.

Onuté Vitkauskaité, condamnée le 25 novembre 1980 à 1 an et demi de camp de concentration à cause de la « Chronique de l’Église Catholique de Lituanie ».

Genuté Navickaité, condamnée également le 25 novembre 1980 à 2 ans de camp de concentration à cause de la « Chronique de l’Église Catholique de Lituanie ».
Ceux qui ont été ainsi enfermés, ont déclaré être tombés dans un tel état de faiblesse qu’ils avaient du mal à se mouvoir. Un autre tourment était constitué par d’inexplicables forts maux de tête et d’estomac, si bien que parfois, alors qu’ils étaient étendus, ils n’arrivaient plus à se relever et même à bouger les mains. C’est seulement après beaucoup d’efforts douloureux qu’ils parvenaient à se reprendre. C’est ainsi que Vladas Lapienis fut détenu longuement dans une cellule et des démangeaisons apparurent sur son corps et, comme pendant la nuit il se grattait, se formèrent des plaies qui ne se refermèrent plus. Il commença à saigner abondamment du nez, sa tension nerveuse augmentant chaque fois qu’on ouvrait la porte. Alors qu’il était à bout de forces, au cours d’un interrogatoire il avait demandé qu’après sa mort on envoie sa dépouille mortelle à sa femme. C’est alors que les tchékistes le transférèrent dans une autre cellule où ses malaises disparurent peu à peu. Bien que Vladas Lapienis souffrît d’hypertension artérielle, depuis ses interrogatoires et en particulier après son retour de Sibérie sa tension artérielle descendit au plus bas. Seul Dieu sait les moyens auxquels recoururent les tchékistes pour briser la volonté de leurs victimes soumises aux interrogatoires. De plus, on adjoignait aux détenus dans les cellules des informateurs du K.G.B., ordinairement des criminels de droit commun qui, une fois découverts, se mettaient à commander et à torturer de toutes les manières l’individu confié à leurs « soins ». Les cellules du K.G.B. se trouvaient presque sous terre et seulement la partie la plus haute avait une petite fenêtre collée au plafond, donnant au ras du sol, sur les dalles de la cour du K.G.B.
Cette lucarne, protégée par un grillage, comporte deux châssis de verres sales, de sorte qu’il est bien difficile d’apercevoir un petit coin de ciel. Pour parvenir à la fenêtre, il faut monter sur une petite table, ce qui est formellement interdit. Une fois par jour, les détenus en attente d’interrogatoire, sont conduits dans une petite cour pour la promenade d’une demi-heure (régulièrement ils devraient bénéficier de 45 minutes d’air, mais les soldats, le plus souvent, mordent sur ce temps). Cette petite cour a tout l’air d’une cage : hautes murailles, sol en ciment, le tout couvert d’un grillage serré. Ces cours sont généralement longues de quatre à cinq pas et seules quelques-unes sont un peu plus grandes. Tout autour se dressent les hautes murailles du siège du K.G.B. Pendant toute la période des interrogatoires, il est pratiquement impossible d’apercevoir un arbuste ou un brin d’herbe. Dans les couloirs du secteur d’isolation, passent continuellement trois soldats de garde qui surveillent sans cesse les détenus à travers un « œil » installé sur chaque porte.
Le blasphème et la grossièreté :
produits de la nouvelle morale soviétique
En parlant entre eux, les gardiens usent d’un langage obscène et souvent entremêlé de jurons. Particulièrement fréquente est la répugnante expression, typiquement russe, à l’égard de la mère. Tandis que j’exprimais mon dégoût à Pilelis pour les jurons des jeunes militaires communistes, il m’expliqua en souriant qu’ils ne savaient pas parler autrement et que les jurons étaient comme des refrains.
Voilà ce qu’est leur morale communiste : maudire tout ce qu’il y a de noble et de sacré, mais dans les relations internationales revêtir un masque d’hypocrite politesse. Il est navrant de constater qu’à l’étranger, il y a des hommes qui croient aux fausses promesses des communistes, aux accords signés par eux, à leur « bonne volonté ». Les communistes promettent beaucoup aux autres afin qu’ils relâchent leur surveillance et ils peuvent ainsi les avaler facilement d’une seule bouchée. Tous les accords et tous les actes qu’ils signent ne sont que supercherie, car ils sont vite violés et de la manière la plus cynique. Dialoguer avec Satan ou avec ses esclaves conscients constitue une faute. L’amour véritable ne doit pas les aider à faire le mal : il faut croire à leur mensonge, mais combattre uniquement le mal. Les communistes ressemblent au serpent du Paradis terrestre : ils promettent beaucoup, mais ils apportent la mort.
La dernière rencontre avec mon frère
Le 17 juin 1975, après la sentence du tribunal, la « corneille » noire (c’est ainsi que l’on appelle la voiture cellulaire de couleur noire) me ramena dans les souterrains du K.G.B. où je devais rester plusieurs jours. Le jour suivant, on m’accorda une brève entrevue avec mon frère Jonas. Avant cette rencontre, un soldat me conduisit dans une cellule où une infirmière du K.G.B. me déshabilla complètement, et m’examina sur toutes les coutures. La même « procédure sanitaire » fut répétée après notre entrevue. Mon frère m’avait apporté une rose d’intense couleur : les contrôleurs du K.G.B. l’examinèrent attentivement, effeuillant chaque pétale pour voir s’il n’y avait pas quelque chose de caché.
Au moment de la rencontre, ils nous firent asseoir l’un et l’autre à une certaine distance et nous étions séparés par une plaque de verre posée au centre d’une longue table. L’un des geôliers ne nous quittait pas des yeux et il nous interrompait continuellement, nous enjoignant de parler de choses ordinaires et insignifiantes, sous peine d’interrompre la visite. À la fin de l’entretien, mon frère essaya de me faire passer un paquet contenant des vivres et des vêtements pour le voyage au camp de concentration de Mordovie, mais tout fut repoussé. Le tchékiste déclara qu’il pourrait m’apporter tout cela le lendemain, mais quand mon frère revint, on lui dit que j’étais déjà partie, ce qui était un mensonge évident : en réalité mon transfert ne s’effectua que le jour suivant. Mais cela est une torture de l’administration : que durant le voyage, elle souffre de la faim !
Les préparatifs pour la déportation
au camp de concentration
Avant d’entreprendre le voyage vers le camp de concentration le 20 juin 1975, l’infirmière habituelle du K.G.B. m’examina de nouveau, tandis que dans le même temps les soldats vérifiaient mes misérables réserves de vivres et de vêtements. Ils m’enlevèrent jusqu’au papier des bonbons et confisquèrent toutes mes notes. Après m’avoir dit : « Salue une dernière fois la Lituanie, car tu ne la reverras plus ! Tu es entre nos mains ; nous ferons de toi ce que nous voudrons », ils me conduisirent avec la « corneille » à la prison de Lukiskes à Vilnius. Ils m’enfermèrent dans une cellule d’isolement, c’est-à-dire dans une sorte d’armoire en ciment, dans laquelle il n’est possible que de se tenir assis. Au bout d’un certain temps, je me mis à suffoquer par suite du manque d’air, ce qui n’inquiétait personne : « Ce n’est pas une station balnéaire », disaient en plaisantant les surveillants. Après être restée quelques heures dans cette armoire, les soldats me conduisirent de nouveau dans la « corneille », qui ressemblait à une barque métallique, où il manquait d’air et où l’on suffoquait en raison de la chaleur. Ils m’amenèrent ensuite à la gare de Vilnius. La « corneille » n’a pas de glaces, et de l’intérieur on ne voit rien, à tel point que l’on se croit enterré vivant. Dans l’empire soviétique, le détenu n’est pas considéré comme un être humain ; on le traite plus mal que les animaux : c’est un esclave privé de tout droit, il est détesté et sans cesse torturé moralement et physiquement par les soldats de l’escorte et les geôliers.
L’affreux voyage vers la Mordovie
Après nous avoir conduits à la gare de Vilnius, les soldats avec leurs chiens en laisse nous firent sortir de la « corneille ». Afin que les gens ne nous voient pas, un wagon mis à l’écart nous avait été réservé. Ils nous rangèrent sur une ligne et comme j’étais « une criminelle des plus dangereuses pour l’État » (c’est ainsi qu’étaient qualifiés les prisonniers de conscience), je fus mise au premier rang, surveillée par quatre soldats et deux chiens. Tous les autres, quelques dizaines d’hommes, tous les criminels de droit commun, furent mis en file derrière moi, surveillés par quelques soldats et deux chiens. Les détenus étaient surpris par mon aspect, me demandant où j’avais pu être détenue pour paraître aussi pâle et aussi épuisée, alors que eux aussi ne paraissaient guère en meilleur état.
Après dix mois de séjour dans les cachots souterrains du K.G.B., je pus revoir le vert des arbres et de l’herbe, le grand air et le ciel immense, ce qu’on ne voit pas à travers les grillages d’une lucarne. Quelle joie à cette vue ! Grâces soient rendues au Créateur pour toute cette beauté. Mais nous ne pûmes jouir longtemps du spectacle, car nous fûmes poussés, en hâte et brutalement, vers le wagon qui se trouvait un peu plus loin. Dans ce wagon entouré de grosses barres, il y avait des boxes fermés par des grilles de fer, munies de fortes serrures. Je fus enfermée dans un box à deux places, tandis que les hommes furent entassés à 8 et jusqu’à 12 dans des boxes prévus pour quatre personnes. Une planche de bois servait de lit pour la nuit et je pus m’étendre sur celle-ci. Par contre, les hommes serrés comme des anchois dans un tonneau, non seulement ne pouvaient s’étendre, mais ils n’avaient pas même la place de s’asseoir. Dans le couloir, les geôliers allaient et venaient devant les boxes. Devant mon box se tint pendant tout le temps un soldat avec un fusil ; il ne me perdait jamais de vue afin que je ne puisse pas « m’évaporer ». Les soldats étaient relevés toutes les trois heures. Les détenus leur demandèrent ce que j’avais bien pu faire pour être si surveillée. Ces individus, pour la plupart déjà condamnés quatre et jusqu’à six fois, n’avaient jamais vu de personnes si surveillées. Ils furent très étonnés d’apprendre que dans l’empire soviétique, il pouvait encore exister des prisonniers de conscience, et à l’unanimité, ils maudissaient ce gouvernement soviétique qui, selon eux, était l’unique responsable de leur déshumanisation.
Sans cesse, les soldats défendaient de parler puisque cela était interdit, mais par la suite eux aussi finirent par s’intéresser à de telles conversations. Dans le cœur de la plus grande partie de ces détenus, il restait encore quelques lueurs d’humanité, même si cela était quelque peu étouffé par les cendres de la haine et de la méchanceté, conséquences de l’éducation athée. Durant le voyage du transfert, on distribua aux prisonniers une petite miche d’un pain noir, aigre et mal cuit (le même pain que celui des souterrains du K.G.B. et des camps de concentration ; il s’agit d’un pain préparé spécialement pour les détenus). À peine l’a-t-on mangé qu’il provoque des douleurs d’estomac, comme si c’était du feu. Il y avait également quelques petits poissons très salés et avariés de la dimension d’un doigt. Je m’abstenais de manger ces rations afin de n’être pas gênée ensuite, alors que quand j’étais en liberté, je pouvais manger de tout sans être incommodée. Les détenus par contre, après avoir mangé les poissons, réclamaient de l’eau pour calmer leur soif, mais les soldats se moquaient d’eux et la leur refusaient : qu’ils souffrent ! Alors dans le wagon s’élevait un tel vacarme accompagné de tant de jurons que l’on se serait cru en enfer. Après s’être bien amusés, les soldats portèrent enfin les bidons d’eau. Les détenus, après avoir bu, demandèrent peu de temps après à être conduits aux toilettes. Encore une fois, les soldats torturèrent les prisonniers et, pendant plusieurs heures, les laissèrent crier. Quelle cruauté chez des soldats à peine âgés de 18 à 20 ans ! Presque tous portaient l’insigne du komsomol « petit-fils de Lénine ». Eux aussi, par leurs grossièretés et leurs jurons, n’étaient pas en reste avec les condamnés. Voilà ce qu’est la morale communiste !
Quelque temps après notre départ de Vilnius, notre wagon s’arrêta pendant vingt-quatre heures.
Les vivres du jour suivant ne furent pas distribués, parce que le voyage vers les cachots de Pskov était prévu ne durer que deux jours. C’est ainsi que les détenus déjà exténués eurent de plus à souffrir de la faim. Après bien des supplications, les soldats acceptèrent de distribuer mes provisions, mais ce ne fut qu’une goutte d’eau dans la mer ! Le transfert au camp constitue une autre forme de torture pour les prisonniers : le voyage est volontairement prolongé et il peut durer un mois et même deux, alors qu’il pourrait se faire en 2 ou 3 jours. Les wagons de prisonniers sont surchargés. Ces derniers fument presque tous et sans interruption le pire des tabacs, le « marchorka », tandis que les petites fenêtres du couloir du wagon ne sont jamais ouvertes pendant la journée et les glaces sont obscurcies afin que personne ne puisse voir de l’extérieur les prisonniers épuisés derrière les grillages. Le wagon est donc sans cesse rempli d’une fumée bleuâtre, si épaisse que l’on ne distingue plus rien à quelques mètres. Pour ceux qui ne sont pas habitués à la fumée, la tête commence à tourner et surviennent des nausées, comme s’il s’agissait d’une intoxication. Pendant la nuit, il fait froid parce qu’on ouvre les glaces et la plupart des prisonniers sont insuffisamment vêtus, d’autant que les nuits, même pendant l’été, sont souvent humides et fraîches, sans parler de celles de l’hiver. Les hommes détenus politiques sont mélangés avec les criminels de droit commun qui se moquent d’eux, leur enlèvent ce qu’ils ont, et ce qui n’est pas rare, les frappent. De leur côté, les soldats les excitent et s’amusent, car les détenus pour raison de conscience sont considérés par les Soviétiques comme des « fascistes », et alors qu’ils soient donc rossés ! Ces criminels de droit commun sont si souvent tombés dans un tel abîme d’abjection, que se trouver avec eux dans le même wagon est une lourde épreuve morale, sans parler de ceux auxquels il arrive de demeurer avec eux en camps de concentration. C’est ce qui est devenu ces derniers temps chose courante chez les Soviétiques. Les tchékistes ont pris maintenant l’habitude de menacer de cette façon : « On te mettra avec les bandits »... ou encore « On t’enfermera en hôpital psychiatrique » ou « On va payer des assassins et tu seras assommé cette nuit même. Et ce sera fini pour toi... »
Les terribles haltes dans les prisons de
Pskov, Iaroslavl, Gorki,
Rouzaïerka et Potma
Avant de parvenir au camp de concentration pour femmes à régime sévère réservé aux prisonniers politiques de la Mordovie, on fit des haltes de quatre à six jours dans les prisons de Pskov, de Iaroslavl, de Gorki, de Ruzaierka et de Potma, tous lieux de transit. Après quelques jours de voyage, les soldats nous chassaient littéralement des wagons, donnant souvent des coups de pied aux plus faibles afin de les obliger à aller plus vite. Puis, enfournés dans la « corneille », nous étions conduits en prison. La « corneille », où les détenus avaient été entassés, avec ses tôles noires, surchauffée par le soleil, semblait être une fournaise ; on y suffoquait, on y souffrait de la soif et les membres étaient si engourdis que l’on était incapable de faire le moindre mouvement. Je fus enfermée avec une autre détenue dans un box à une place et, hoquetant et en sueur, nous parvînmes à la prison. Mais comme les prisons sont habituellement surchargées, le nombre des détenus dans les cellules excédait le chiffre normal ; il en résultait que les nouveaux arrivés, obligés d’attendre qu’on libère une cellule, devaient rester une demi-journée à haleter dans la « corneille ». Une fois descendus, les détenus étaient concentrés dans une grande pièce, puis après un certain temps, on les appelait l’un après l’autre suivant les articles du code pénal selon lesquels ils avaient été condamnés. Après une perquisition minutieuse, ils étaient dirigés vers la cellule qui leur avait été attribuée. Ces cellules étaient invariablement déprimantes, sales et remplies de parasites de toute espèce : punaises, poux, puces, cafards et dans les petites cours destinées à la promenade quotidienne d’une demi-heure, couraient des rats. Les cellules étaient froides et humides, car elles ne voyaient jamais le soleil. Les fenêtres étaient munies de barres de fer rouillé, tandis qu’à l’extérieur, il y avait une tôle trouée qui non seulement ne laissait pas passer la lumière, mais également empêchait l’air de pénétrer. C’est pourquoi, de jour comme de nuit, les lampes électriques étaient toujours allumées. À Pskov, on m’enferma pendant une semaine dans une cellule d’isolement située dans un souterrain. La cellule avait un plafond bas, des murs ruisselants d’humidité, un sol en ciment auquel on avait fixé un lit de fer rouillé. En entrant, on me remit un vieux matelas, sale et déchiré. Un trou dans le sol servait de latrines. De plus, la fenêtre étant obstruée par une plaque de tôle, la lumière électrique fonctionnait jour et nuit. Dans les camps de concentration et dans les cachots, on donne juste la nourriture suffisante pour ne pas mourir de faim : le matin, dans un gobelet en fer, quelques cuillerées d’une soupe d’orge de la pire espèce, faite à l’eau et sans aucune matière grasse et une écuelle d’eau trouble qui devrait être du thé ; à midi, une louche de soupe de légumes liquide et de nouveau, quelques cuillerées d’une soupe d’orge dans laquelle on a mis des matières grasses de mauvaise odeur. D’autres fois, on distribue des petits morceaux de poisson qui, assez souvent, provoquent chez les détenus des intoxications. Moi-même, plusieurs fois, j’ai été intoxiquée par ce genre de nourriture. Le soir, quelques cuillerées de soupe d’orge et de thé. De plus, on donne à chaque prisonnier une demi-boule de pain pour la journée, mais en raison de sa mauvaise qualité, je n’ai pas pu en manger. La nourriture nous est remise par une petite ouverture découpée dans la porte de la cellule, et ceux qui servent, accompagnés souvent par les soldats, ont la défense formelle de parler aux détenus. Tous les détenus, exténués, sont réduits à des squelettes recouverts d’une peau terne et violacée. Souvent, les geôliers s’amusent d’eux : « L’important, c’est qu’il reste les os ; la chair reviendra ! » En quittant la prison, c’est de nouveau la perquisition, la « corneille », la gare, les barres de fer du wagon, tandis que mon compartiment se trouve bondé d’une manière invraisemblable de femmes prisonnières de droit commun. Et le voyage recommence. Outre Pskov, j’ai séjourné dans les prisons de Iaroslavl, Gorki, Ruzaierka et de Potma, où je fus incarcérée dans la même cellule que de malheureuses détenues pour crimes : assassinats, vols, etc.
La femme déshumanisée
par le communisme
Les femmes emprisonnées sont très nombreuses. Je me suis trouvée en contact avec de très jeunes criminelles de 15 ans, condamnées pour vol ou homicide, ainsi qu’avec des femmes enceintes et d’autres, d’âge mûr ou parfois d’âge avancé. Leur immoralité, leur incapacité de distinguer le bien du mal, leur déshumanisation, étaient effrayantes. C’est seulement ici que l’on peut se rendre compte combien est misérable l’homme sans Dieu et que les plus grands criminels sont ceux qui systématiquement par la force et leur insistance empoisonnent l’âme humaine par le mensonge ; c’est-à-dire tous les athées soviétiques qui gouvernent le pays.
Le dernier arrêt fut celui de la prison de Potma où je fus enfermée dans une pièce en compagnie de femmes prisonnières de droit commun. Là, comme à la prison de Gorki, mais au lieu de lits, nous avons dormi sur un dallage légèrement rehaussé. Pendant la nuit nous étions dévorées par des punaises, à tel point que nous décidâmes de protester. Les surveillants affirmèrent qu’il n’y avait pas de punaises dans la chambre. Alors, nous en attrapâmes quelques-unes et adressèrent une plainte au chef, avec preuve à l’appui. Dans l’après-midi, on nous transféra dans un autre local où il y avait moins de parasites. Dans la petite cour et aux latrines du cachot, couraient de gros rats de couleur rousse (jusqu’à présent je n’en avais vu que des gris). Quelques jours après, on nous fit sortir des cellules et on nous conduisit toutes au train. Cette fois, je ne fus pas mélangée aux détenues de droit commun avec lesquelles j’avais passé quelques jours dans la même chambre ; puis on déclara que « les criminels particulièrement dangereux pour la sûreté de l’État », c’est-à-dire ceux qui me ressemblaient, devaient être enfermés dans un box séparé et être mis sous surveillance spéciale. Ils me ramenèrent donc à la prison et je dus passer encore quelques jours à Potma. Pour ce dernier séjour, je fus enfermée dans une cellule à deux places. Les geôliers s’étonnaient de ce que je ne poussais pas de jurons et ne disais jamais de paroles grossières, et ils me dirent : « Mais, d’où est sortie une fille comme toi ? »... « Mais, rassure-toi, quand on t’amènera du camp pour aller en exil, tu auras tout appris ! » Cependant, à leur grand étonnement, leur prophétie ne s’est pas accomplie ; en effet lors de mon transfert du camp à l’exil, j’ai retrouvé certains d’entre eux qui ont pu se rendre compte que je n’avais pas changé de manières.
L’arrivée à destination
Le jour de la dernière étape arriva enfin. Embarquée dans un wagon du petit train à voie étroite qui, de Potma à travers la forêt et les marécages, conduit les détenus à leur destination, je fus placée encore cette fois dans un box séparé. Pendant tout ce parcours, l’unique paysage qu’il m’était possible d’apercevoir à travers la lucarne, c’était des clôtures de fils barbelés – les camps de concentration – et des soldats tenant des chiens en laisse. L’un après l’autre, je comptai plus de vingt camps dans lesquels se trouvaient des prisonniers dont le nombre était le double de la capacité du camp : toute une « république d’esclaves » des soviets. Le camp à régime sévère destiné aux femmes détenues politiques était le dernier sur cette ligne ferroviaire utilisée uniquement pour le transport des prisonniers. Pour cette raison, les vitres n’étaient plus fermées ; nous nous trouvions désormais dans l’État des esclaves. Le train faisait halte devant chaque camp pour faire descendre ceux qui y étaient destinés. Pendant le trajet, on conduisit dans mon box une détenue politique ukrainienne, Stefaniia Michailovna Sabatura, retirée de prison après y avoir purgé un certain temps de sa condamnation. Étant donné que dans le camp réservé aux femmes, il n’y a pas de prison, il en résulte qu’une détenue qui a été condamnée doit accomplir sa peine dans les prisons des camps réservés aux criminels de droit commun. Stefaniia Michailovna Sabatura, née en 1938, peintre, diplômée de l’école supérieure des Beaux-Arts, aux cheveux tout blancs et réduite à l’état de squelette, était ramenée au camp où elle avait déjà passé presque un an, à l’exception de brefs intervalles où, en prison et en cellule à régime sévère, elle avait été torturée et cela uniquement parce qu’elle avait protesté : elle avait refusé en effet de travailler parce que la direction du camp, sur l’ordre du K.G.B., lui avait confisqué puis brûlé tous les dessins qu’elle avait faits au crayon pendant les temps libres. Le régime soviétique, comme on le sait, ne redoute pas seulement les paroles de vérité, les vers de poésie, mais également d’innocents dessins : dès qu’ils suspectent un danger, ils confisquent tout aux détenus et le font brûler. Alors que, dans le wagon, Stefaniia Sabatûra avait tenté d’échanger quelques paroles avec une concitoyenne enfermée dans un autre box, les soldats l’avaient brutalement insultée et menacé de lui mettre les menottes.
Dans la « république » des esclaves
Nous parvînmes enfin à destination. Une fois descendues du train, on nous dispersa un peu partout. Moi et Stefaniia furent conduites au bureau de répartition du camp de femmes. On nous soumit toutes les deux à une perquisition au cours de laquelle on m’enleva, sous prétexte d’un « contrôle », le texte même de ma condamnation par le tribunal, texte qui ne me fut jamais rendu, en dépit de mes lettres adressées au chef du camp et réclamant qu’on me restitue ce texte. Les fonctionnaires soviétiques, habituellement, n’autorisent pas les condamnés à conserver le texte de leur condamnation établi par le tribunal et ils le confisquent soit immédiatement après le procès, soit à l’arrivée au camp. Une fois la perquisition terminée, on porta mes vêtements au dépôt et on me remit la tenue de prisonnière : une robe à rayures. Après quoi, avec Stefaniia, on nous conduisit dans le secteur qui nous avait été assigné. Le voyage de Vilnius jusqu’en Mordovie avait duré un mois entier ! Les autres prisonnières nous accueillirent avec sympathie et cordialité, nous offrant ce qu’elles avaient, tandis qu’une détenue ukrainienne fit avec des fleurs, devant mon assiette, le drapeau tricolore de la Lituanie indépendante, et cela à ma grande surprise et à ma grande joie. Dans le camp, le secteur réservé aux femmes est restreint : une petite cour de forme triangulaire entourée d’une double ceinture de fils barbelés et d’une troisième constituée de planches suffisamment hautes pour que nous ne puissions rien voir. Au-dessus, s’élevait une petite tourelle de garde, occupée par des soldats qui se relayaient toutes les trois heures. Il était interdit aux détenues de parler avec eux. Au milieu de la cour, s’élevait une petite et vieille construction en bois : la baraque, divisée en deux parties : d’une part, le dortoir et d’autre part le réfectoire. Tout à côté, se trouvait une petite salle de travail, dénommée « établissement » où nous devions confectionner chacune 60 paires de gants par jour. Celle qui ne respectait pas cette norme était conduite au cachot. Les machines à coudre étaient très anciennes et tombaient souvent en panne ; le fil, de mauvaise qualité, se cassait toutes les 5 à 10 minutes. Confectionner 60 paires de gants dans de telles conditions était une opération ardue. Je parvenais à soutenir le rythme en travaillant dès 6 heures du matin jusqu’à 10 heures du soir, avec de brefs intervalles pour manger, me promener et prier. Et comme nous avions la chance d’être peu nombreuses, nous pouvions travailler sans interruption ; autrement, avec le temps perdu lors des changements et ces machines sans cesse en panne, je n’aurais pas pu soutenir le rythme et aurais passé pas mal de mon temps en prison. L’établissement était petit et sans ventilateur ; il en résultait que, par suite du fonctionnement des machines à l’électricité, l’air était surchauffé, tandis que la confection des gants produisait beaucoup de poussières, parmi lesquelles des poussières de verre présentes dans la toile utilisée pour la confection de la paume pour la rendre plus résistante. Ces gants étaient destinés à des ouvriers travaillant dans la construction ou à d’autres travaux en général pénibles. Actuellement le rythme du rendement a été augmenté et les détenus doivent fournir jusqu’à 110 paires de gants par jour. Les Soviétiques n’ont aucune pitié pour leurs esclaves !
L’exploitation des détenus
Sur la somme que gagne le détenu, la moitié retenue par l’État pour la solde des gardiens, des policiers du K.G.B. et autres, tandis que sur l’autre moitié, on défalque les frais de nourriture, soit 12 roubles par mois dans le cas de camps à régime sévère. Vu le montant de cette somme, on peut en déduire qu’elle pouvait être la qualité de la nourriture, sans compter que les préposées à la cuisine et les détenues de droit commun qui nous préparaient à manger dérobaient, se les partageant avec les gardiens, les vivres destinés aux prisonniers. D’autres sommes étaient également déduites pour le vestiaire, les couvertures, les chaussures, etc., de sorte qu’il ne restait presque plus rien à la détenue. Si l’on avait réussi à suivre la cadence et si l’on n’avait pas commis de « fautes », on était autorisé une fois par mois à acheter à la boutique du camp des vivres, du matériel pour écrire, du savon, pour la somme maximum de cinq roubles. Cependant, en général, on ne trouvait rien de tout cela à la boutique, mais seulement des biscottes moisies, des caramels rances, de vieilles et mauvaises conserves, du thé, parfois de la margarine ou de l’huile ainsi que de la machorka à fumer. Pendant toute la période de ma détention, il ne m’est que rarement arrivé d’avoir du pain qui fut mangeable. On ne pouvait se rendre à la boutique que si l’on était escorté par les gardiens et, une fois là, ne pouvait acheter que celui qui avait de l’argent sur son propre compte, autrement c’était rien. Il n’est pas permis d’utiliser l’argent envoyé par la famille, mais seulement l’argent gagné au travail. Les détenus qui refusent de faire le travail qu’on leur a donné sont punis de la façon suivante : pour trois fois de suite, on lui inflige 15 jours de prison, puis c’est la cellule de rigueur pour des périodes de 3 à 6 mois. D’une condamnation à l’autre, s’écoulent de brefs intervalles, généralement d’une semaine, puis tout recommence à nouveau jusqu’à la fin de la détention. Ceux qui sont complètement invalides sont les seuls à être exemptés du travail forcé. Quant à ceux qui sont couchés parce que malades, on leur demande de confectionner des petites boîtes en carton ou d’autres choses du même genre.
Le supplice de la nuit
Quand je suis arrivée au camp de travail de Mordovie, il y avait déjà 21 détenues ; j’étais la vingt-deuxième. Ces jours-là, on faisait des réparations dans le camp, si bien que l’on nous fit dormir en plein air dans la cour pendant une semaine, étendues sur des planches. Quelle joie, après avoir passé presqu’un an dans les souterrains nauséabonds des prisons, de pouvoir de nouveau respirer l’air pur et contempler le ciel étoilé. Mais tout cela, comme je l’ai dit, ne dura qu’une semaine, après quoi il fallut réintégrer le dortoir étroit et bas de plafond du baraquement. Les lits étaient superposés et je dormais sur celui du haut, juste sous le plafond jusqu’à ce qu’une place se libérât en bas où l’on était un peu mieux. Dans cette chambrée, on manquait d’air, car les fenêtres restaient fermées, les détenues plus âgées souffrant du froid. Le dortoir était petit et les lits, très rapprochés, n’étaient séparés que par un étroit passage. Ces nuits représentaient l’une des plus grandes souffrances du camp et on attendait anxieusement le matin pour pouvoir sortir dans la cour et respirer une bouffée d’air pur avant le début du travail. À cause de la chaleur étouffante, beaucoup de détenues souffraient d’insomnies ; pendant la journée, il était interdit, même aux détenues les plus âgées, d’aller se reposer. Cela n’était possible que pour les malades munies d’une autorisation médicale ; dans les autres cas, on était puni.
La triste histoire de « Baba Tania »
La détenue la plus âgée du camp était Tatiana Karpovna Kasnova dite « Baba Tania », née en 1904. Menue, de taille moyenne, maigre, cette vieille pravoslave 3 analphabète ne savait ni lire ni écrire. Quel crime si terrible avait-elle donc pu commettre pour que les fonctionnaires du gouvernement soviétique l’aient condamnée à sept ans de camp à régime sévère et à 3 ans d’exil comme « criminelle particulièrement dangereuse pour l’État » ? Eh bien, son « crime », comme celui des neuf autres femmes pravoslaves russes enfermées dans le camp, consistait à avoir glissé dans les boîtes aux lettres de quelques personnes des poèmes écrits à la main et qui condamnaient les moqueries et les persécutions à l’encontre des croyants. En d’autres termes, elles étaient coupables de « calomnies contre le gouvernement soviétique... ». À cause de son attitude à l’égard de la religion, ces femmes parlaient ouvertement du gouvernement soviétique comme étant le « gouvernement de Satan ». « Baba Tania » se faisait remarquer par sa propreté et, pendant une grande partie de la journée, comme le faisaient les autres pravoslaves, elle priait. Elles condamnaient les concessions coupables de la hiérarchie ecclésiastique pravoslave faites au gouvernement athée, sa collaboration avec ce dernier et la trahison des intérêts des croyants. Elles se considéraient comme d’authentiques pravoslaves, jeûnaient rigoureusement, ne mangeant alors ni viande ni graisse animale, ne se nourrissant alors que de pain. Souvent, dans la bouillie d’orge ou dans la soupe de légumes, se trouvaient quelques petits morceaux de lard rance ou de viande, alors elles n’en mangeaient pas, bien que de graisse il n’y eut souvent que l’odeur. À cause de cela, nous avions souvent demandé à la direction du camp de donner des ordres aux cuisinières, afin qu’elles ne mettent plus de petits morceaux de gras dans la bouillie d’orge et dans la soupe ; autrement les pauvres vieilles pravoslaves étaient condamnées à jeûner, tandis que nous aussi, nous éprouvions assez souvent des indispositions après en avoir mangé. À nos demandes, il était invariablement répondu : « Si ça ne vous plaît pas, ne mangez pas ! Ici ce n’est pas une station climatique. » Et tout continua comme avant. Quand, à l’occasion du 1er mai ou du 7 novembre, fêtes appelées par les pravoslaves « fêtes du diable », aux rations ordinaires des détenus on ajoutait un petit pain, aucune des pravoslaves ne l’acceptait. Une fois, nous avons protesté contre le fait qu’une femme aussi âgée que « Baba Tania » et complètement analphabète soit encore détenue dans un camp à régime sévère. Dans l’histoire de l’humanité, on n’a jamais vu le cas d’une vieille femme de 74 ans, et de plus analphabète, qui ait été considérée comme « particulièrement dangereuse pour l’État ». À la suite à notre protestation, une espèce de commission vint au camp ; elle convoqua « Baba Tania » pour un entretien, mais cette dernière répondit qu’elle n’avait pas l’intention de solliciter une grâce quelconque à « des représentants d’un gouvernement satanique ». Elle demeura en camp encore un an et c’est en 1979, à l’âge de 75 ans, que la vieille Tania fut acheminée vers son lieu d’exil. Pendant le trajet, les prisonniers de droit commun lui dérobèrent tout ce qu’elle avait : ses pauvres provisions, ses vêtements et jusqu’à une veste fourrée. On approchait alors de la fin octobre et le début de novembre se montrait froid et humide. Le pénible voyage qui se déroula pendant près d’un mois d’une prison à l’autre, la faim et le froid, épuisèrent les dernières forces de la vieille femme, transportée à travers les steppes du Kazakhstan au milieu de populations qui lui étaient totalement étrangères. Le 23 novembre 1979, elle rendit son âme à Dieu. Qu’elle repose dans le Seigneur ! « Baba Tania » avait emporté avec elle l’adresse de mon lieu d’exil en Sibérie et une personne ayant bon cœur m’avait écrit à sa demande une lettre m’annonçant que « Baba Tania » était arrivée à destination très malade. Quelques temps après en effet, elle mourut. La milice enleva son corps et l’emporta dans un lieu inconnu. « Baba Tania » est morte loin des siens et nul ne sait où sont ses restes. Mais le sacrifice de sa vie n’a sûrement pas été inutile : la mort des martyrs sont des étoiles lumineuses dans la nuit terrestre et une bénédiction pour l’Église militante.
Dans son passé « Baba Tania » avait subi une période d’incarcération dans des conditions épouvantables : pendant trois ans, elle avait été enfermée dans une cellule sale, surchargée, sans sortir une seule fois à l’air libre, couchant sur le ciment et ne recevant qu’un peu de pain et d’eau pour la journée.
Une autre martyre sans tombe
La deuxième martyre pravoslave, Irina Andreevna Kireeva, née en 1912, mourut au camp le 26 mai 1980. « Baba Ira », ainsi l’appelait-on familièrement au camp, était une femme d’une grande cordialité, sensible, toujours prête à aider les autres, à les réconforter et à leur donner tout ce qu’elle pouvait. Elle était atteinte d’une forme grave de cancer, de sorte que six mois environ avant sa mort, elle fut envoyée à l’hôpital du camp, où elle déclina complètement, sans avoir eu l’autorisation d’aller mourir chez elle, autorisation accordée normalement aux prisonniers de droit commun lorsqu’il s’avère qu’ils sont devenus incurables. « Baba Ira » est partie du camp vers le Seigneur, et comme pour « Baba Tania », personne ne sait où est sa tombe. Les corps des détenus politiques sont ensevelis en secret ; on leur attache au bras une petite plaque portant seulement le numéro de leur procès et ce numéro est ensuite transcrit sur un piquet fixé sur le lieu de la sépulture : c’est la seule indication. N’ont accès à ces cimetières que les tchékistes et les fonctionnaires. J’ai appris tout cela des soldats qui nous gardaient. Certains d’entre eux, qui avaient également subi dans les casernes de nombreuses injustices et cruautés, commencèrent peu à peu à nous plaindre et même à nous respecter, bien qu’on leur répétait sans cesse que nous étions de « terribles criminelles ». Ils s’indignaient des injustices commises à notre égard, et déclaraient que c’était les meilleures qui étaient enfermées dans les camps, tandis que les plus grands criminels et les plus dévoyés occupaient les postes de commandement. Et ils avaient parfaitement raison.
Des gardiens inhumains
La détenue pravoslave Aleksandra Akimovna Tchvatkova, née en 1906, était très malade. Condamnée déjà par deux fois pour motifs religieux, elle avait passé beaucoup de temps dans les prisons, car comme toutes les pravoslaves, en signe de protestation contre l’injuste condamnation, elle refusait d’exécuter le travail obligatoire imposé au camp. Les longues tortures, le froid et la faim avaient épuisé ses forces ; elle éprouvait des douleurs dans tous les membres et de fortes migraines en raison d’une tension élevée. Elle était en outre très pâle, décharnée et avait continuellement froid. Aidée par d’autres vieilles femmes, elle s’était confectionnée, avec quelques vestes fourrées hors d’usage, des couvertures plus chaudes, sortes de couvre-pieds, que, très vite, les gardiennes réquisitionnèrent pour les faires ensuite brûler. « Qu’elle gèle... et qu’elle crève ! Elle n’est pas dans une station climatique !... », avaient déclaré haineusement les gardiennes. Pour nous couvrir, on nous avait remis une légère couverture de coton guère plus épaisse qu’un drap. Toutes, nous souffrions du froid, car les nuits en Mordovie sont fraîches même pendant l’été, et en automne comme au printemps, s’y ajoute l’humidité. Pendant l’hiver, le chauffage était faible ou nul, et, à cause du froid, c’était surtout les vieilles pravoslaves qui tombaient malades ; elles supportaient très vaillamment ces souffrances et essayaient de se consoler en disant en russe : « Tchem stroje tiem doroje ! » (« Plus c’est dur, meilleur c’est ! »).
Vers la fin de l’année 1982, ce fut le tour de « Baba Tchvatkova » d’être transférée en exil dans le Kazakhstan. Je ne reçus aucune lettre d’elle, car à cette époque je me trouvais déjà à Vilnius et presque toutes les lettres qui m’étaient adressées étaient confisquées par le K.G.B. Ce que j’ai su d’elle m’a été communiqué par les autres ; aujourd’hui encore, je ne suis pas parvenue à obtenir son adresse. Que le Seigneur l’aide, elle et toutes les autres, à ne pas faiblir dans son amour !
La détenue pravoslave Klaudia Grigorievna Volkova dite « Baba Klava », née en 1907, était une personne très calme, bonne et silencieuse. Lors de mon arrivée au camp, je dormis pendant quelque temps sur le lit situé au-dessus du sien. Les lits sont à deux étages, en fer et très incommodes. Si l’on se retourne ou si l’on se met d’un côté ou de l’autre, que ce soit celle du haut ou celle du bas, le châssis qui soutient les deux couchettes fait un bruit énervant et pénible si bien que l’on finit par se réveiller mutuellement. Mais « Baba Klava » ne se plaignait jamais, quand suffoquant, écrasée contre le plafond, je remuais comme un poisson hors de l’eau à cause du manque d’air. Elle passait une grande partie de son temps à prier avec ferveur.
La prière secrète en commun
Parfois, toutes les pravoslaves réunies à l’écart dans un coin se mettaient à chanter tout bas. Ayant appris leurs cantiques, je pris l’habitude de m’unir à elles. Dans ces moments-là, il me semblait être dans une église, tant étaient grands la sérénité et le réconfort qu’éprouvait mon âme. Ce n’est pas par hasard que l’on dit que la prière en commun vient du ciel. Mais prier en commun est interdit au camp et assez souvent nous étions obligées d’arrêter, mais après un certain temps, on arrivait à se retrouver à nouveau pour adorer et remercier Dieu de Son amour pour nous, pauvres pécheresses. La prière en commun est sans conteste le moment le plus lumineux et le plus heureux de la vie en camp.
« Le gouvernement
le plus humain du monde ! »
La prisonnière pravoslave Anastassia Andreevna Volkova, dite « Baba Nastia », est née en 1908. Elle n’avait aucun rapport de parenté avec l’autre Volkova, n’ayant de commun que le nom. Toutes les deux furent condamnées en même temps et libérées ensuite ensemble du camp. « Baba Nastia » était infirme et, bien qu’ayant les mains et les jambes malades, elle était très travailleuse et en particulier brodait d’une façon merveilleuse. Du fait que les deux Volkova n’avaient été condamnées qu’à une peine de détention, sans exil, celles-ci, une fois libérées, furent accueillies par de braves personnes de la ville de Gorki. Cependant, le gouvernement soviétique, qui se targue d’être « le plus humain du monde », ne leur laissa pas de répit et elles furent obligées d’aller ailleurs. L’adresse de la personne qui les a accueillies est la suivante : Gorkovskaia obl., Dzerzinskovo r-n, p. Iugonec, ul. Novaia 6-37, Vasincina Daria Fiodorovna.
Reniée par son mari communiste,
à cause de sa foi en Dieu
La prisonnière pravoslave Glafira Lavrentievna Kuloeva est née en 1924. Lorsqu’elle fut arrêtée, elle dut abandonner ses enfants mineurs et son mari, membre du parti. Ce dernier l’avait incitée à renoncer à ses croyances pour obtenir la liberté, mais elle refusa tout compromis. C’est alors que son mari la répudia et, une fois qu’elle fut au camp, il ne lui fit aucune visite, ne lui apporta aucune aide et finit par trouver une autre femme. Mais Glafira pardonna tout ; elle priait continuellement, les larmes aux yeux et elle était très humble. Étant atteinte de polyarthrite, elle transpirait et souffrait beaucoup, mais ne se plaignait jamais, souriait toujours, remerciant Dieu pour tout. Ayant purgé sa peine au camp, elle fut envoyée en Sibérie pour trois autres années, et maintenant elle se trouve avec sa mère à l’adresse suivante : Vladimirskaia obl. Jurev-Polskoi r-n. p/o Nebyloe, selo Andreevskoe, Norevoi Praskov-ie Petrovne.
La prisonnière pravoslave Tatiana Michailovna Sokolova est née en 1933. Très réservée et cordiale, elle était atteinte de diabète, de maux d’estomac et d’intestin et de fortes migraines. En dépit de tout cela et pour la seule raison qu’elle avait refusé de travailler, elle fut continuellement torturée, en prison comme en cellule à régime sévère. Quand elle était transférée en prison pour des périodes de trois et parfois de six mois, elle me laissait son lit du bas. Elle est actuellement revenue chez les siens.
La profondeur des sentiments humains
et religieux des femmes pravoslaves
La détenue pravoslave Ekaterina Petrovna Aliosina, appelée « Baba Katia », est née en 1912. « Baba Katia » était gentille, silencieuse, toujours souriante, elle réparait très adroitement les chaussures de toutes les détenues, assistait les malades, priait avec ferveur. Actuellement, elle est retournée chez elle.
La détenue pravoslave Mariia Pavlovna Semionova est née en 1923. Jugée trois fois pour l’habituelle faute « d’activités antisoviétiques », elle a été prisonnière pendant plus de vingt ans et a souffert plusieurs années dans diverses prisons. Elle était gentille, silencieuse et elle aimait les pigeons qu’elle nourrissait des restes de pain de ses repas. Elle était en plus très douée sur le plan artistique et elle modelait la terre glaise très habilement. Elle priait beaucoup. En 1982, elle fut envoyée en exil dans le Kazakhstan, en même temps que « Baba Tchvatkova ».
La plus jeune des détenues pravoslaves était Nadejda Mikhaïlovna Usoieva, née en 1942. Elle avait été condamnée pour le même délit que celui des autres pravoslaves, diffusion de poèmes, à six années de camp à régime sévère et à trois ans d’exil. Comme toutes les autres détenues pravoslaves, elle avait refusé d’exécuter le travail obligatoire et, de ce fait, elle avait été incarcérée et torturée pendant six ans. Elle ne passa au camp que l’espace de quelques jours ou semaines, puis elle retournait à la prison où elle souffrait du froid et de la faim. Nadejda était complètement exténuée, réduite à l’état d’un squelette recouvert d’une peau grisâtre, mais elle demeurait toujours calme et sereine et, s’isolant dans un coin, elle priait pendant des heures. Après avoir passé ainsi quelques jours de « repos », la gardienne arrivait toute joyeuse pour l’avertir que c’était le moment de retourner en prison. Alors, elle se préparait tranquillement, esquissait un aimable sourire à la gardienne et partait pour une période de nouveaux tourments. Dieu seul peut accorder de telles forces surhumaines et un si grand amour pour ses bourreaux !
La vie dans le cachot du camp
Le cachot du camp consiste en une étroite et basse cellule en ciment, souterraine, très humide et froide, à peine chauffée pendant l’hiver, si bien que la température ne s’élève qu’à quelques degrés au-dessus de 0°. Une petite fenêtre se trouve juste en dessous du plafond. À son entrée dans le cachot, on enlève tout au prisonnier ; s’il s’agit d’un homme, on lui laisse son linge de corps ; s’il s’agit d’une femme, on lui donne une légère robe d’été à rayures. Pendant les quinze premiers jours de présence, il n’est prévu aucune sortie pour prendre l’air. L’ameublement de la cellule se résume en un seau de fer (pour les besoins naturels), d’un tabouret et d’une petite table fixés au sol. Aux parois du mur extérieur, toujours humide et froid, est fixée une planche vernie d’un pouce et demi de largeur qui sert de lit. Dès six heures du matin, ce lit est replié et fixé au mur par des chaînettes munies de cadenas, de manière que le détenu ne puisse s’étendre pendant la journée.
À dix heures du soir, le lit est dégagé et abaissé pour la nuit. Pour ne pas tomber de cette planche étroite, le prisonnier est contraint d’appuyer son dos sur la paroi glaciale et humide. Le détenu, affamé et vêtu d’une simple chemise, passe 3 à 4 nuits sans pouvoir dormir à cause du froid. Plus tard, il tombe dans un état de semi-conscience. L’ordinaire consiste en une tranche de pain, de l’eau froide et du sel ; tous les deux jours, on y ajoute une louche de bouillon de légumes tiède. Au cachot, on n’est autorisé ni à lire ni à écrire, mais seulement à souffrir de l’isolement, du froid, de la faim et il faut ajouter à cela les continuelles perquisitions, les railleries et des cruautés de toute espèce. Beaucoup de prisonniers, n’arrivant pas à supporter ce genre de vie, se suicident. Et c’est de cette manière que sont torturées les vieilles pravoslaves infirmes, uniquement parce qu’elles refusent le travail forcé. Pendant des années et des années, elles doivent supporter de tels tourments jusqu’au jour où elles sont réduites à un tel état qu’on les range dans la catégorie des « invalides ». À partir de ce moment, le travail n’est plus obligatoire, mais restent les souffrances de maladies pour lesquelles n’existent ni remèdes, ni assistance médicale sérieuse.
Les prisonniers sont condamnés au cachot pour les moindres « délits », comme par exemple de ne pas se lever immédiatement et de ne pas saluer le gardien lors de son passage ou pour d’autres choses du même genre. Tout prétexte est bon pour punir l’individu. C’est ainsi qu’ont été enfermées des prisonnières qui, en raison de leur état de faiblesse provoqué par la maladie, ne parvenaient pas à suivre le rendement de travail imposé. Tel fut le cas de Nina Strokatova et de bien d’autres.
La détention à régime sévère
En quoi consiste la cellule prévue pour le régime sévère ? Dans ce cas, les conditions sont légèrement meilleures que dans celui de la prison ordinaire, car il y a un matelas pour dormir et le prisonnier n’est pas dépouillé de ses vêtements, même si on ne lui donne pas de vêtements plus épais. Le détenu reçoit chaque jour quelques cuillerées de bouillie de farine de maïs, une écuelle d’eau tiède et une louche de soupe de légumes. La nourriture est pire que celle du camp ; de plus, il demeure enfermé pendant tout le temps sans air ni soleil : c’est un véritable tombeau en maçonnerie.
Nadiia, comme du reste toutes les autres pravoslaves, réussit avec l’aide de Dieu à supporter ces tortures et à rester ferme jusqu’à ce que, après tant de supplices, elle soit déportée pendant trois ans en Sibérie. Après avoir connu beaucoup d’autres épreuves dans l’Altaï, elle est retournée chez les siens, la santé démolie mais l’âme toujours aussi forte et indomptable. Quand je pense parfois à l’extraordinaire force d’âme de Nadiia Usoieva, cette chétive femme aux cheveux noirs, toujours aimable, je me rappelle la parole de l’Évangile : « Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? » Je me suis rendu compte alors qu’on peut tout supporter quand on est complètement attaché à Dieu et que l’on vit de son amour. L’amour est invincible !
Des Ukrainiennes courageuses
En 1975, il y avait au camp six Ukrainiennes. L’une d’elles, Nina Strokatova, juste à l’époque où j’arrivais au camp, fut enfermée au cachot de détention à régime sévère, d’où elle fut remise en liberté ; mais elle ne fut pas ramenée dans le même secteur, pour qu’elle ne rencontre pas les détenues, n’apprenne pas les dernières nouvelles, qu’elle aurait pu divulguer une fois libérée. C’est la raison pour laquelle on ne la revit plus. J’ai su qu’elle se trouvait maintenant avec son mari Karavaskii, à l’étranger, où elle aura certainement raconté son odyssée et celle de ses compatriotes détenues.
Nadiia Alekseevna Svetlicnaia, née en 1936, après avoir passé quatre ans en camp de concentration, revint chez elle puis, après de nombreuses difficultés, réussit à émigrer à l’étranger. Nadiia était une femme qui avait bon cœur et qui avait beaucoup souffert, car au moment de son arrestation elle avait dû laisser son enfant, âgé de moins d’un an, et que les tchékistes refusèrent pendant longtemps de confier à la famille de Nadiia, menaçant de le laisser définitivement dans une « Maison de l’Enfance ». Il est difficile d’imaginer ce que peut endurer le cœur d’une mère dans de telles conditions. Au camp, Nadiia se montrait très gentille et calme, serviable, et d’ailleurs, comme toutes les Ukrainiennes, elle participait activement à toutes les grèves de la faim et à toutes les formes de protestation organisées pour la défense des détenus politiques persécutés. Je lui suis particulièrement reconnaissante pour sa gentillesse et l’aide qu’elle m’a apportée soit au camp, soit lorsqu’après sa libération, je me trouvais en exil en Sibérie. Que le Seigneur Tout-Puissant répande ses grâces sur elle et sur tous ceux qui font du bien à leur prochain !
Blessée alors qu’elle tentait de fuir
Oksana Zenonovna Popovic, née en 1926, venait d’être condamnée pour la seconde fois. La première fois, on l’avait jugée alors qu’elle n’avait pas encore vingt ans. N’ayant pu supporter les tourments du camp, elle avait tenté de fuir, mais elle avait été atteinte par balles à l’intestin et au fémur. Elle survécut miraculeusement et fut condamnée à dix ans de camp et, une fois la peine achevée, à un exil d’une durée indéterminée. En dépit d’inénarrables souffrances et après avoir vécu l’enfer du Goulag, Oksana put revenir en Ukraine, ruinée dans sa santé mais pas dans son esprit. Hospitalisée pour une intervention à la jambe blessée, elle fut ensuite reprise par les tchékistes. Elle fut de nouveau jugée et condamnée à sept ans de camp à régime sévère et à cinq d’exil. Son unique « délit » était son amour de l’Ukraine et de la vérité, ce pour quoi elle refusait de devenir l’esclave des occupants. Oksana était particulièrement sensible au souci de la vérité et elle la disait ouvertement et à la face de tous. Cela lui attira bien des ennuis mais elle refusa sans cesse toute compromission avec le mensonge. Au camp de concentration, elle marchait avec des béquilles en raison de ses blessures à la jambe, elle souffrait d’hypertension, était très faible et en proie à divers malaises. En dépit de cela, elle se montrait extrêmement compatissante aux souffrances des autres. Elle se trouve actuellement en exil dans la région de Tomsk où elle a été transférée fin 1982. Son adresse est la suivante : Tomskaia obl. Nolcanovskii r-n. selo Malcanovo, ul. Dimitrova 71-1 ; Popovic Oksana Zenonovna.
Si quelqu’un pouvait lui envoyer du sucre de raisin, du bouillon concentré, des potages préparés en sachets, des fruits secs, des bonbons vitaminés, tout cela l’aiderait beaucoup, car dans les magasins de Sibérie on ne trouve rien ; il en est d’ailleurs de même dans toute l’Union Soviétique, sauf dans les grandes villes.
Irina Michailovna Senik, ukrainienne, est née en 1926. Elle a déjà été jugée deux fois. La première fois, alors que, comme Oksana, elle n’avait pas encore vingt ans, elle fut condamnée à dix ans de camp et à l’exil pour une période indéterminée. Pendant l’interrogatoire, elle subit toutes sortes de sévices : brûlures, fractures des os, coups de toute espèce, bien que la jeune Irina ne fut alors qu’une jeune étudiante n’ayant commis aucun délit. Son père avait été militaire et c’est pourquoi, après l’avoir martyrisé, les occupants s’étaient ensuite attaqués à sa famille. Ce qu’a souffert Irina, ainsi que des milliers d’autres personnes absolument innocentes, a déjà été amplement relaté dans « L’Archipel du Goulag » de Soljenitsyne. Après tous ces tourments, Irina put rentrer en Ukraine. Lors d’une perquisition, on trouva quelques poèmes qu’elle avait écrits pendant son séjour au camp et dans lesquels elle décrivait ses souffrances et celles des autres. Pour ce motif, elle fut de nouveau condamnée à 6 ans de camp et à 5 d’exil. Après avoir purgé ces peines, elle est rentrée depuis peu en Ukraine, mais elle ne réussit pas à trouver un asile. Que le Seigneur lui vienne en aide ! Les soviets avaient torturé et fusillé son père ; sa mère avait été déportée et, en raison des mauvais traitements subis au camp, était décédée loin de sa patrie. Qu’elle repose dans le Seigneur ! Même son petit frère Roman, âgé de 13 ans, fut persécuté pendant dix ans dans les camps pour avoir refusé de renier son père. Actuellement, il se trouve loin de sa patrie, à l’adresse suivante : Kemerovskaia obl. Anzero – Sudzensk Ul. Mira 12 Kv. 10, Senik Roman Michaïlovic. Les tchékistes ont recommencé à l’espionner et s’il n’est pas accordé à Irina de résider en Ukraine, elle devra probablement rechercher asile chez son frère. Les responsables des bureaux de passeports ont reçu des ordres secrets de ne pas accorder le droit de résidence aux détenus politiques qui reviennent chez eux après avoir accompli leur peine. De cette manière, on cherche à effrayer tout le monde, même les plus courageux, et à les soumettre au mensonge, ou bien alors on détruit physiquement tous ceux qui demeurent fidèles à la vérité et sont sensibles aux souffrances d’autrui. « Il faudrait vous fusiller tous », déclarent ouvertement les tchékistes aux détenus politiques, donnant libre cours à leur propre haine depuis que leur chef Andropov est devenu le maître de l’empire soviétique.
J’ai connu Stefaniia Michailovna Sabatura, Ukrainienne née en 1938, lors du transfert au camp. Stefa était très attachée à la vérité et d’un caractère ouvert. Elle avait pris une part active à toutes les protestations contre la discrimination à l’égard des détenus politiques. Et comme je l’ai déjà écrit, elle avait beaucoup souffert dans les cachots, uniquement parce que, suite à la confiscation de ses dessins, en guise de protestation, elle avait refusé de travailler. Après le séjour au camp, elle dut encore souffrir pendant trois ans en exil au Kazakhstan. Une fois rentrée à Lvov, on lui refusa pendant un an un permis de séjour, alors qu’elle disposait d’un appartement acheté de ses propres deniers où elle habitait avec sa mère infirme. En dépit de toutes les menaces du K.G.B. de l’emprisonner à nouveau (pour infraction relative à son passeport, dont la validation avait été refusée, pour pouvoir disposer dans la suite d’un moyen de pression), Stefa ne s’effraya pas et finalement on lui accorda un permis de séjour pour un an, et elle put ainsi trouver du travail. Elle demeure actuellement avec sa mère à Lvov, Kutuzov 116, ap. 2.
Irina Onufrievna Kalynec, ukrainienne, née en 1940, écrivait des poèmes ; au camp, elle se montrait très entreprenante et active. Après son temps d’exil qu’elle passa avec son mari (ils avaient été condamnés en même temps), elle revint à Lvov près de ses parents et de sa fille. Ils se trouvent actuellement près de Sabatura à Lvov, Kutuzov 118-12.
Au camp, j’ai rencontré également l’une de mes compatriotes, Veronika Kodiené, née en 1916 : elle était gravement malade et son système nerveux était sérieusement atteint. Le K.G.B. l’avait fait sortir du service des maladies nerveuses de l’hôpital ; elle avait été condamnée à 10 ans de camp à régime sévère pour l’unique raison que, après la guerre, un « striba », brigand soviétique, avait été tué chez elle, ce qu’elle n’avait pas déclaré, et qu’elle l’avait enterré en secret. Cependant, si elle avait fait cette déclaration, c’est non seulement elle et sa maison, mais c’était tout le village qui aurait été brûlé. La folie meurtrière des « stribi » (troupes spéciales soviétiques constituées des rebuts de la société et de malfaiteurs de toute catégorie, pour lutter après la guerre contre les partisans lituaniens 4) à cette époque est bien connue. Veronika est actuellement chez ses parents et je ne connais pas son adresse.
Interdiction de sortir
du « paradis soviétique »
Galina Vladimirovna Silivoncik, russe, née en 1937, mariée avec un biélorusse, a été condamnée au camp de concentration ainsi que son mari et son frère de onze ans plus jeune, pour avoir essayé de passer à l’étranger. Au cours de cette tentative, son mari fut tué à coups de mitraillette. Elle et son frère furent repris et, dans un petit sentier, on lui fractura plusieurs dents. Après qu’elle eut passé un certain temps dans les prisons du K.G.B., se déroula son procès auquel participa son père. Ce dernier avait abandonné sa famille alors que les enfants étaient encore petits ; il avait refait sa vie avec une autre femme et s’était complètement désintéressé de son ancienne famille, si bien que sa première épouse en était morte de chagrin. Cet homme, qui était un membre « émérite » du parti, demanda la peine de mort pour ses propres enfants. L’audience terminée, la cour prononça la sentence : Galina fut condamnée à trente ans de camp à régime sévère et à cinq d’exil, tandis que son frère Juri Vladimirovic, né en 1948, recevait une peine de onze ans de camp à régime sévère et de trois ans d’exil. « Il est interdit de fuir du “paradis soviétique” ! » Au camp, Galina restait silencieuse et ne participait jamais aux protestations ni aux grèves de la faim. Lorsque j’arrivais au camp, elle avait déjà accompli plus de dix ans de détention. Elle se trouve actuellement en exil à l’adresse suivante : Komi ASSR, Vorkuta, Glavpoctamp c/o vostrebovanija, Silivoncik Galina Vladimirovna.
Les espionnes du K.G.B. au camp
Au camp, j’ai eu également l’occasion de connaître deux collaboratrices du K.G.B. ; c’étaient deux juives : Nataliia Francern Griunvald, ukrainienne, et Anna Kogan. La Griunvald avait travaillé avec la Gestapo qui avait tué tant de monde et pour cela elle avait été condamnée à 25 ans de camp à régime sévère. Au camp, elle s’était mise avec zèle au service de la Gestapo rouge : le K.G.B. Elle a dénoncé et calomnié des détenues ; elle espionnait et dénaturait les faits ; elle déployait en somme une bien triste activité, ce qui lui permettait de jouir de certains privilèges : colis supplémentaires, nourriture analogue à celle destinée aux malades, cures médicales, vitamines, etc. La Griunvald était une personne âgée d’environ 60 ans et elle avait un regard si glacial que j’en étais comme frappée dès que je la voyais. Ce n’est pas hasard que l’on dit que les yeux sont le miroir de l’âme. Parfois, j’ai entendu dire que pour s’attirer les sympathies des tchékistes, elle s’offrait, quand il en était besoin, pour témoigner comme quoi l’une ou l’autre des détenues était une malade mentale... Que le Seigneur ait pitié d’elle. Après avoir purgé une peine de 25 ans, elle vit dans une maison pour femmes âgées où elle se vante d’avoir de la nourriture à profusion.
Quant à Anna Kogan, on l’avait retirée du secteur des détenues de droit commun pour l’introduire parmi nous afin d’espionner. Elle et la Griunvald nous épiaient constamment pour savoir quelles étaient nos relations, de quoi nous parlions, qui étaient les responsables des grèves et de l’envoi des protestations. De plus, elles faisaient tout pour nous empêcher d’avoir des contacts avec les détenus des autres camps et suivaient pas à pas les tchékistes. Quand ceux-ci nous demandaient comment nous avions appris ce qui s’était passé dans les autres camps, nous répondions : « Nous avons un téléphone par lequel nous communiquons »... Juste avant que j’arrive au camp, en même temps que les pravoslaves, fut condamnée une jeune Russe : Raia Ivanova, mère de deux enfants. Les tchékistes n’ayant pas réussi à la « rééduquer » avec l’aide de la Griunvald et de la Kogan, ils rédigèrent un procès-verbal où ils déclarèrent que Raja était une malade mentale. En conséquence, cette personne pourtant très saine d’esprit, calme et ayant bon cœur, fut enfermée à l’hôpital psychiatrique de Kazan, où, au bout d’un an, elle mourut n’ayant pas supporté les tortures qu’on lui avait imposées. Qu’elle repose dans la paix du Seigneur ! C’est une martyre de la foi et de l’amour de Dieu. En une certaine occasion, le médecin du camp avait déclaré : « Si Ivanova est une malade mentale, alors nous le sommes tous trois fois plus qu’elle ! » Plus tard, le K.G.B. éloigna ce médecin de son poste. En attendant, les « pauvres » agents du K.G.B., Griunvald et Kogan, grâce à leurs « témoignages », bénéficiaient de tous les privilèges accordés au camp : tous les jours, elles buvaient du lait, mangeaient du pain blanc et du beurre (aliment réservé aux malades), aliments que les authentiques malades ne voyaient jamais. En « récompense » des services rendus, la Kogan fut libérée six mois plus tôt, c’est-à-dire au bout de six ans et demi, alors qu’elle avait été condamnée à sept ans. C’est ainsi que les tchékistes achètent les services et, du fait qu’ils sont eux-mêmes des scélérats, ils recourent tout naturellement à l’aide des ex-brigands, compagnons inséparables.
Le poète ukrainien V.S. Stus,
sauvagement piétiné
Non loin de nous, à quelques centaines de mètres, se trouvait la 5e zone, réservée aux détenus politiques. Alors que j’arrivais au camp, s’y trouvait déjà Petras Paulaitis, tandis qu’actuellement y sont également Vytautas Skuodis et Anastazas Janulis (tous lituaniens). Nous entretenions avec ce camp une correspondance secrète. À mon arrivée en 1975 nous apprîmes qu’un agent des tchékistes avait sauvagement piétiné le poète ukrainien Vasilii Semionovic Stus, né en 1938, pour se venger de n’avoir pas réussi à le briser moralement. Après cette affaire, le poète encore tout sanguinolent fut jeté au cachot et on fit courir le bruit que c’était lui qui avait occasionné cette rixe. En récompense, le bandit reçut un colis. Lorsque nous apprîmes cette nouvelle, les Ukrainiennes et moi-même, nous décidâmes une grève de la faim, réclamant l’intervention du procureur afin que le vrai coupable soit puni et qu’il ordonne le transfert de Stus à l’hôpital. Dans notre déclaration, nous affirmions que nous étions prêtes à jeûner jusqu’à ce que notre réclamation soit satisfaite. En représailles, nous fûmes toutes enfermées dans le secteur psychiatrique de l’hôpital. Cependant, après cinq jours de grève de la faim, le procureur arriva sur place et ordonna le transfert de Stus à l’hôpital. Ayant diagnostiqué une hémorragie de l’estomac, les chirurgiens l’opérèrent et il fut reconnu invalide au second degré, ce qui l’exempta désormais de tout travail pénible. Peu de temps après, le poète fut transféré au lieu d’exil, mais pendant le voyage on déclara qu’il était guéri et donc qu’il n’était plus invalide. Il fut conduit à Magadan et là il dut travailler dans les mines. De retour dans son pays après avoir subi tant de souffrances, il fut à nouveau jugé. Plusieurs agents du K.G.B. que l’on avait fait venir de Magadan déclarèrent pendant le procès que Stus, pendant son séjour, avait tenu des propos antisoviétiques... Le poète, malade, martyrisé et complètement épuisé (lors des interrogatoires il avait été torturé physiquement), sans avoir la possibilité de se défendre au cours du procès, fut condamné à dix ans de camp à régime sévère, à cinq ans d’exil et à payer la somme de dix mille roubles pour faux témoignages. Les tchékistes, disciples d’Andropov, suivent avec zèle les directives de leur ancien chef.

Petras Paulaitis, né en 1904, condamné en 1947 à 25 ans de travaux forcés pour avoir produit de la littérature clandestine, et pour avoir participé à la résistance contre les Soviétiques. Il fut amnistié en 1956 pour ses activités contre les Nazis. Il fut arrêté à nouveau un an après et condamné à purger les 15 ans qui avaient été amnistiés, auxquels on ajouta encore dix ans à cause de ses idées nationalistes et religieuses. Il fut libéré en octobre 1982.

Le professeur universitaire Vytautas Skuodis, citoyen américain de naissance, fut condamné le 19 décembre 1980 à 7 ans de camp à régime sévère et à 5 ans d’exil pour avoir écouté les radios étrangères et collaboré à la diffusion des Samizdats.

Anastazas Janulis, condamné le 27 novembre 1980 avec Pauvilas Buzas, à cause de la « Chronique de l’Église Catholique de Lituanie » et de la littérature religieuse, à 3 ans et demi de camp à régime sévère.
La peur des Soviétiques,
c’est que leurs crimes soient dévoilés
Les tchékistes voulaient éviter à tout prix que les détails de mon procès entrent dans le domaine public. Pour cette raison, aucun témoin n’avait été autorisé à rester dans la salle d’audience et après la lecture de la sentence, on m’avait immédiatement dirigée sous bonne escorte vers le camp. En Lituanie, le K.G.B. fait arrêter le courrier de tous ceux qui sont soupçonnés avoir des relations avec la « L.K.B. Kronika » (Chronique de l’Église Catholique de Lituanie). Ils eurent recours à tous les moyens pour que rien ne filtre de mon procès. Les tchékistes fuient l’opinion publique comme la peste ; ils ont peur de la vérité ; ils font tout ce qu’ils peuvent pour maintenir les gens dans l’ignorance ou bien ils les paralysent par la peur. Mais le Seigneur est venu à mon aide ; d’une manière ou d’une autre, j’ai réussi à décrire mon procès et à faire sortir ce compte rendu qui fut remis de la main à la main jusqu’à son dernier destinataire, évitant ainsi les pièges du K.G.B. Le petit David du XXe siècle, luttant au nom du Seigneur, a vaincu Goliath. Pour tout cela rendons gloire et grâce à Dieu seul !
Cette affaire a été pour les tchékistes un camouflet qui leur a valu les foudres du K.G.B. de Moscou. Pauvres tchékistes de Vilnius commandés par le lieutenant-colonel Markevicius. Ceux-ci, durant l’été de 1975, peu de temps après mon arrivée au camp, vinrent sur place. Convoquée au bureau du commandant du camp, j’y trouvais Markevicius accompagné de quelques tchékistes et d’un rédacteur de je ne sais quel journal et auquel je fus présentée. Markevicius commença aussitôt à me dire : « Nous sommes venus pour te ramener chez toi. Ta condamnation sera entièrement annulée, mais à une seule petite condition : sans rien dire comment à qui que ce soit. Nous voudrions seulement savoir comment tu as réussi à faire passer le compte rendu de ton procès. Dis-le et tu seras libre de retourner chez toi. » Je lui répondis : « J’ai voyagé pendant un mois avant d’atteindre votre « paradis soviétique » et je n’ai pas l’intention de le quitter avant l’accomplissement de ma peine. Quant à ce que vous voulez savoir, je ne vous le dirai jamais ! » Sans n’avoir rien obtenu, ils partirent de la Mordovie et j’eus ainsi la certitude que le Seigneur avait béni mes efforts. Grâces lui soient rendues !
La « rééducation »
après l’expiration de la peine
Une fois terminée la peine en camp, les détenus politiques les plus actifs sont soumis à la soi-disant « rééducation ». D’une manière générale, on les ramène pour une période d’environ deux mois à l’endroit où ils ont été jugés. Les tchékistes pensent que le prisonnier exténué finira par mordre à leurs promesses. Les principaux moyens auxquels ils recourent pour dérouter les gens sont le mensonge, camouflé sous les aspects d’une hypocrite générosité, et, quand cela ne réussit pas, ce sont les menaces et la terreur. Toute la politique des communistes soviétiques n’est qu’une politique de mensonge, de tromperie, de violence et de terreur.
Au camp de concentration, j’ai toujours pris une part active à toutes les plaintes et protestations et souvent j’ai été amenée à prendre contact avec les détenus politiques de l’autre camp, si bien que la vie dans le secteur, en dépit de toutes les difficultés qu’elle nous apportait, avait parfois quelque chose de romantique. Ce dicton est absolument exact : quand l’estomac est vide, l’esprit est plus clair. Et l’esprit des détenus est ainsi et il est aussi très ingénieux. Les pauvres tchékistes, en dépit de tous leurs moyens, ne parvenaient pas à savoir comme nous ce qui s’était passé dans les autres camps. Aussi, à titre de représailles et bien qu’ils n’aient jamais pu me découvrir, on me priva, vers la fin de ma détention, du droit de recevoir le paquet périodique de 5 kg. Pendant mes trois années de camp, je n’ai reçu qu’un seul paquet de 5 kg. Les détenus à régime sévère, pendant la première moitié de leur détention, ne peuvent rien recevoir ; ensuite, s’ils n’ont pas commis « d’infractions » et toujours à la condition que la direction du camp soit d’accord, ils peuvent recevoir un paquet de 5 kg par an, ce dernier ne devant contenir que des provisions : pain, beurre, viande, poisson. Mais que peuvent représenter ces 5 kg de vivres pour une année, surtout qu’après avoir enlevé l’emballage, ils se réduisaient à 4 kg ? Cependant, aux prisonniers « gênants », on n’accordait pas le droit à ces paquets, sous prétexte qu’ils violaient le régime de détention. La grâce de Dieu seule réconfortait ces malheureux, et tous sont reconnaissants à ceux qui se souvenaient d’eux dans leur prière.
En avril 1977, on vint me chercher ainsi que Galina Silivoncik sans nous dire où nous devions être conduites ni pourquoi. C’est un fait courant ; le gardien arrive et commande au détenu de se préparer en un quart d’heure, ou encore moins, pour un transfert. On ne fait pas savoir à la victime où on la conduit et pour quel motif. C’est ce qui nous arriva à Galina et à moi ; nous fûmes emmenées comme des chats dans un sac, après qu’on nous eût rendu nos vêtements personnels déposés à la consigne, comme si nous ne devions plus retourner dans ce camp. Quand la « corneille » qui nous avait transportées s’arrêta, il faisait déjà nuit. Nous fûmes conduites au 2e ou 3e étage d’une grande construction et on nous renferma dans une petite cellule. Peu de temps après, on vint nous chercher pour nous amener au médecin. Je pensai tout de suite que nous nous trouvions dans un hôpital psychiatrique, dont les tchékistes menaçaient à tout bout de champ les éléments les plus « récalcitrants ». Mais il s’avéra que nous étions parvenues à l’isoloir destiné aux inquisiteurs du K.G.B. de Saransk, en vue d’être soumises à un traitement de « rééducation ». Une infirmière nous demanda de quoi nous avions à nous plaindre et elle prit notre température, tandis que les soldats fouillaient tous nos « biens ». Après quoi, on nous enferma dans une cellule plus grande que la précédente. Puis commença l’opération de « rééducation ». Les soldats nous conduisirent auprès de l’inquisiteur, dans un bureau où étaient assis deux tchékistes. L’un de ceux-ci me dit : « On va te renvoyer chez toi en supprimant ta condamnation à l’exil, mais à condition qu’une fois rentrée en Lituanie, tu te taises et ne parles jamais de ce qui s’est passé pendant les interrogatoires ni au cours de ton séjour dans le camp. » Je répondis que si je m’étais tue au moment de mon arrestation, c’est que je n’avais rien à dire ; mais que si c’était maintenant, j’aurais parlé, parce que j’ai beaucoup de choses à dire. Alors, ils me menacèrent de me rendre l’exil cent fois plus dur que celui du camp, ce à quoi je répondis : « Plus ce sera difficile, plus ce sera intéressant. » Après s’être échangé des coups d’œil éloquents, ils dirent ébahis : « Quelle race de caractère ! Tu nous plais ! » Ceci dit, ils essayèrent autre chose. Une femme professeur de marxisme-léninisme d’une école supérieure fut convoquée pour me démontrer la fausseté de mes idées. Le tchékiste me laissa seule dans le bureau, afin que nous puissions parler plus tranquillement. Ce professeur, une dame d’à peu près mon âge, demeura en admiration en me voyant ainsi : elle ne s’attendait pas à trouver devant elle une personne de si bonne humeur et si disponible. Nous commençâmes à parler et elle m’avoua qu’elle n’avait pas la moindre connaissance religieuse. Je lui dis alors : « Excusez ma sincérité, mais chez nous en Lituanie, les enfants de 6 à 7 ans qui font leur première communion connaissent la religion beaucoup mieux que vous qui enseignez l’athéisme. Comment peut-on nier et lutter contre ce que l’on ne connaît pas ? »
Elle admit aussitôt et sans difficulté qu’elle était dépourvue de culture religieuse et qu’elle n’avait même pas lu l’Évangile. Elle parut intéressée par mes explications concernant la prière et la miséricorde divine à l’égard des hommes, puis, toute pensive, elle ajouta : « Je n’arrive pas à croire qu’une personne puisse être condamnée pour la pratique de la religion. » « Je regrette, lui dis-je, que vous ne puissiez pas prendre connaissance du fascicule concernant mon procès, fascicule qui se trouve aux archives du palais du K.G.B. de Vilnius. Au cours de dix mois d’interrogatoires et d’enquêtes, les tchékistes ont minutieusement vérifié presque tous les faits cités dans les trois numéros de la « L.K.B. Kronika », confisqués durant la perquisition à mon domicile et qui ont trait à des persécutions à caractère religieux. Eh bien, ils n’ont rien trouvé, même pas une virgule, qui ne correspondit pas à la vérité. Vous n’avez pas la possibilité de consulter le livret qui me concerne, mais cela n’est pas nécessaire. Il vous est facile de vérifier le bien-fondé de tout ce que je vous ai dit. » Le professeur me regarda, surprise : « Et comment ? » – « C’est très simple, lui expliquais-je, par exemple, essayez d’aller prier dans l’église orthodoxe de Saransk comme si vous étiez une croyante quelconque et vous verriez qu’en peu de temps, et avec grand bruit... on vous aura fait valser de vos fonctions. » Après un moment de réflexion, elle convint que, évidemment, les choses se passeraient comme cela. Et nous terminâmes notre entretien. À ce moment-là, les tchékistes, qui évidemment avaient suivi notre conversation, entrèrent dans le bureau et déclarèrent que l’entrevue était terminée. Le professeur demanda qu’on l’autorisât à venir parler avec moi un autre jour, mais les tchékistes lui répondirent sèchement : « Ce n’est pas possible. En fin de compte, ce n’est pas vous qui l’avez rééduquée, mais c’est elle qui est en train de vous rééduquer. » Je ne l’ai plus revue et parfois, dans ma prière, je pense à elle et à sa fille dont elle m’avait parlé au cours de l’entretien.
Une autre surprise m’était réservée au siège du K.G.B. de Saransk. Galina et moi, nous avions été logées dans une cellule relativement confortable et claire, car elle était située non au sous-sol, mais au 3e étage et, à travers la fenêtre, on apercevait la cime des arbres. Afin que nous puissions dormir un peu plus à notre aise sur les planches qui nous servaient de lit, on nous apporta deux matelas absolument neufs et on nous en offrit un troisième que toutes les deux nous refusâmes. Entre autres privilèges, on nous donna beaucoup à manger. En outre, alors qu’au camp on avait le droit de n’acheter des denrées alimentaires que pour une somme maximum de 5 roubles, le K.G.B. de Saransk nous autorisa à en acheter pour 30 roubles et plus, avec notre argent bien sûr. Les soldats nous apportaient du lait frais, du pain, du fromage, du beurre et tout ce qu’ils pouvaient trouver dans les magasins. Au camp, nous n’avions jamais rêvé de telles friandises. Galina et moi, nous nous amusions de tout cela en nous disant : « C’est bientôt Pâques et peut-être que les Soviétiques, n’ayant pas de viande, nous gavent pour faire ensuite “la fête”. » Quand il faisait beau, on nous laissait nous promener dans la petite cour autant de temps que nous le voulions, même pendant trois heures, mais avec la seule recommandation du chef de ne le dire à personne, ce que toutes les deux nous refusâmes de promettre. Après l’entretien que j’avais eu avec le professeur sur l’athéisme, on ne me convoqua que rarement pour d’autres entretiens de « rééducation ».
Soins prodigués
dans un but de propagande
Au camp, ma santé avait été complètement démolie ; saisie d’une toux permanente, ma température dépassait les 37,4°. Pendant quelques mois, on m’avait soignée à l’hôpital du camp où la nourriture était plus que mauvaise. Le seul avantage, c’était l’exemption du travail. À Saransk, par contre, on chercha à me soigner sérieusement. Je fus conduite à la polyclinique pour les divers examens. Ensuite, chaque jour, la secrétaire m’apportait les remèdes à prendre (tous d’origine étrangère) et, avant mon sommeil, elle me faisait des thoracentèses et me mettait des cataplasmes. Nous ne devions faire aucun travail, et durant la journée, nous pouvions lire les ouvrages sortis de la bibliothèque du K.G.B. La fenêtre de la cellule n’avait qu’un seul grillage et nous pouvions l’ouvrir autant que nous le voulions. L’air était bon. Je passai ici presque deux mois, au cours desquels je repris des forces et, bronzée par le soleil, je n’avais plus alors l’allure d’une détenue.
Mais voilà qu’un jour le chef du secteur d’isolation me fit appeler. Arrivée chez lui, accompagnée d’un soldat, le fonctionnaire me dit : « On veut vous photographier, parce que votre frère est très inquiet au sujet de votre santé... » Je répondis : « Mon frère m’a vue au camp, il y a peu de temps. D’autre part, je vais partir bientôt pour l’exil, où il pourra me voir à nouveau. Je n’ai pas l’intention de me faire photographier. » Je lui proposais alors de photographier Galina qui depuis 11 ans n’avait pas rencontré son frère. Le chef mâchonna quelque chose entre ses dents, disant que cela n’était pas nécessaire, puis il insista à nouveau pour que je me fasse photographier. Je persistai dans mon refus. Le soldat me ramena à la cellule, mais à peine une demi-heure après, je fus convoquée chez l’inquisiteur. Au K.G.B. de Saransk, on ne portait plus la tenue à rayures des détenus, mais nos vêtements qui nous avaient été restitués lors de notre départ du camp. Le soldat m’introduisit dans le bureau des interrogatoires. Je fus émerveillée en entrant dans une grande et luxueuse pièce, meublée de divans moelleux, aux larges fenêtres sans grilles. Derrière une petite table laquée, étaient assis deux tchékistes tandis qu’un troisième se tenait à l’écart, et tous les trois me souriaient amicalement. Mon « rééducateur » commença en disant : « Quelle bonne mine vous avez ; on dirait que vous venez juste d’arriver de Paris »... « Quelle différence y a-t-il donc entre Saransk et Paris ? », lui répliquai-je. Il m’invita ensuite à m’asseoir sur le divan proche d’eux, ce que je refusai. Alors, ils approchèrent de la table un luxueux fauteuil sur lequel je pris place. Le tchékiste se mit alors à raconter : « J’étais à peine rentré chez moi que je me rendis compte que mon voisin lui aussi était de retour. Je me rends chez lui et quelle n’est pas mas surprise de constater que sa porte était fermée à clé ! Ah, j’ai compris, pensais-je en moi-même ; il a probablement réussi à trouver un peu de viande, et il se dépêche de la manger tout seul, afin de ne pas la partager avec moi ! » – J’esquissai un sourire, en pensant qu’après tout, en Union Soviétique, même les tchékistes étaient touchés par le manque de denrées alimentaires. Mais au même moment, je perçus une forte lumière : le jeune tchékiste qui se trouvait à côté de moi venait de me photographier. C’est alors seulement que je saisis le vrai sens de toute cette mise en scène. « Il me semble, lui dis-je, que vous abusez de votre situation. Pourquoi m’avez-vous photographiée sans mon autorisation ? Dieu veuille que vous ne réussissiez pas à développer cette photo ! » Mais le photographe, très satisfait de son « coup », me répondit : « Voilà quatre ans que j’opère et il n’y a pas eu un seul cas où j’ai manqué une photo ! » Cela dit, il sortit de la salle. Mon « rééducateur » expliqua alors au tchékiste qui s’était tenu à l’écart : « À l’étranger, on a fait d’elle une divinité. Ils ont protesté, criant sur tous les toits qu’elle était mourante. Qu’ils voient au contraire qu’elle va bien ! » Pendant deux mois, les tchékistes m’avaient installée dans une sorte de « villégiature » pour désarmer l’opinion publique de l’étranger : « Voyez un peu comment sont traités les prisonniers soviétiques ! »
Un matin de l’un des jours suivants, je fus à nouveau convoquée chez le chef du secteur d’isolement, qui, dès qu’il me vit, tout agité, me déclara : « Votre photo n’a pas été réussie », et il me montra une photo format carte postale de la plus grande dimension, sur laquelle j’apparaissais assise dans le fauteuil et souriante. Mais, juste en face de moi, on apercevait une sorte de filet qui donnait l’impression d’une grille. Je souriais derrière cette espèce de grille qui couvrait toute la photo. Le chef m’expliqua que ce défaut était dû au fait que le photographe s’était trompé de pellicule, et il me demanda de me laisser photographier à nouveau. Je refusai. Le soldat me ramena à ma cellule, mais à peine quelques minutes après, il revint pour me conduire chez l’inquisiteur. Dans le bureau de l’inquisiteur, je retrouvai le photographe de la veille qui me conduisit dans son laboratoire. Il me fit asseoir sur une simple chaise devant une table et il me supplia de me laisser photographier à nouveau, autrement ce serait pour lui une catastrophe. J’eus pitié de ce pauvre tchékiste et prenant une revue qui se trouvait sur la table, je la mis sur mes genoux en baissant la tête, comme si j’étais en train de la lire. « Voilà, je suis prête. » Après avoir fait ses préparatifs, il me dit : « Levez la tête et souriez. » Ce à quoi je répondis : « Prenez-moi comme je suis en train de lire, autrement je refuse. » Et il fit la photo. Puis son travail terminé, il s’approcha de moi et, très ému, il me dit : « Soyez gentille, et ne demandez pas à Dieu encore une fois que la photo ne soit pas réussie. Moi aussi, je crois en Dieu, mais je n’ai ni la force, ni le courage de le confesser... » Puis, il m’avoua que dans la réalisation de la première photo, il n’avait commis aucune erreur technique et que la mauvaise qualité du tirage était exclusivement due à la puissance de la prière. Comme le Seigneur est bon ! Il cherche à ramener à Lui ceux qui L’ont quitté.

Nijolé Sadunaité, en mauvaise santé, à la sortie du camp.
Après un certain temps, je fus convoquée chez le tchékiste Tresumov arrivé du camp de la Mordovie. Il était assez éméché et il me déclara avec satisfaction qu’il venait de fêter son 40e anniversaire. Il me proposa de me faire photographier avec lui et même de partir ensemble à Vilnius pour faire une promenade et autres sottises du même genre. Je refusai énergiquement de l’écouter. Alors, dans un désespoir plein de rage, il m’apostropha : « À quoi sert ton sacrifice ? Prends donc de la vie tout ce qu’elle peut offrir en ce moment ; demain peut-être tu seras « crevée » et personne ne se souviendra de toi... » Je lui répondis que seul le corps peut mourir, mais non l’esprit. Ce à quoi il répliqua rageusement : « Que ce soit toi ou moi, nous sommes peut-être déjà atteints du cancer, et bien sûr nous crèverons un jour ou l’autre, et alors, après nous avoir enterrés, nous serons même oubliés par nos parents ! » Quel tragique désespoir dans le cœur d’un tchékiste d’à peine 40 ans !
Les détenus réclament l’application
du statut de prisonnier politique
Deux mois après, Galina et moi fûmes ramenées de Saransk au camp et le voyage fut très éprouvant. Pendant ce voyage je pris froid et ma bronchite chronique se manifesta de nouveau : je toussais et avais de la fièvre. Arrivée au camp, j’appris que les détenus politiques avaient commencé une grève de trois mois du travail forcé pour exiger que leur soit appliqué le statut de détenus politiques. Les femmes de notre camp étaient exténuées car, en effet, le régime de cachot et celui du camp épuisent les forces. Endurer de nouvelles souffrances pendant trois mois, c’est-à-dire en cachot, n’était pas possible. Le nombre des jours de détention qui me restaient était inférieur à celui des autres et la Sibérie qui m’attendait était déjà presque à la porte. Dès mon retour de Saransk, j’avais écrit au chef du camp pour exiger qu’on nous appliquât le statut des détenues politiques et pour protester contre les nouvelles arrestations en Lituanie (je venais d’apprendre qu’on avait arrêté Vladas Lapienis) ; je refusais de faire le travail forcé jusqu’à la fin de ma détention, le 27 août 1977. Je fus immédiatement convoquée à la direction du camp, où on essaya de me faire retirer ma plainte, car celle-ci n’aurait aucun résultat et entraînerait de nouvelles souffrances, c’est-à-dire le cachot. On mit en avant mon mauvais état de santé et la perspective de mon prochain voyage en Sibérie qui serait très fatigant. « Toutes vos plaintes et protestations ne sont qu’une goutte dans la mer ; avec tout cela, vous n’obtiendrez rien et vous ne ferez que ruiner votre santé », s’efforça de me persuader le chef. « Ce sera au moins une goutte pour le bien des autres, répondis-je, mais goutte après goutte, même la pierre finira par se fendre... Et si cela pouvait soulager un tant soit peu la vie des autres, je suis prête à tout, non seulement à aller au cachot, mais même à mourir. » La réapparition de ma bronchite avec une température de 37,8° me sauva du cachot, tandis que les tchékistes m’interdirent tout soin. Cependant, les détenus politiques avaient fait savoir à la direction du camp que si, en dépit de ma fièvre, on m’avait enfermée au cachot, ils auraient entamé une grève de la faim. Pendant toute cette période, on ne me remit aucune lettre et on confisqua toutes les lettres que j’écrivais à mon frère.
Crise cardiaque
pendant le voyage vers la Sibérie
Ayant fini de purger ma peine au camp, je fus conduite au lieu d’exil, dont naturellement on ne m’avait pas indiqué la destination. Le voyage dura un mois, marqué par des étapes à Potma, Tcheliabinsk, Novossibirsk et Krasnoïarsk. Pendant le voyage vers Novossibirsk, le 5 septembre 1977, dans le wagon surchargé de façon invraisemblable, je fus victime d’un infarctus. Les détenues de droit commun qui se trouvaient dans mon compartiment, en me voyant pâlir, se mirent à crier que j’étais en train de mourir. Je me rendais compte moi-même que la mort était toute proche. Je ne sentais plus ni mes mains ni mes jambes, c’était comme si ce n’était plus les miennes, comme si elles étaient devenues du bois. Mes yeux se voilèrent, je ne sentais plus rien, mais au fond de moi-même, j’éprouvais une grande paix, comme de la joie : « Grâces à Dieu ! voilà que tout se termine ! », pensai-je. Je m’inquiétais pour mon frère qui serait peiné en ne sachant pas où et comment j’avais quitté ce monde... Mais le Seigneur avait décidé que ce n’était pas encore le moment. Les soldats accoururent aussitôt avec des médicaments, de l’eau et ils ouvrirent la fenêtre. Alors je revins à moi et leur demandai ce qu’ils auraient fait de mon corps après ma mort ; ils me répondirent qu’ils l’auraient laissé à la prison de Novossibirsk.
La cohabitation
avec les détenues de droit commun
Le voyage se poursuivit en compagnie des détenues de droit commun avec lesquelles j’avais déjà vécu dans les mêmes prisons, à l’exception de celle de Pskov où je suis demeurée seule.
Je n’avais rien emporté avec moi, ni provisions ni vêtements : j’avais laissé au camp tout ce que j’avais de meilleur, afin que les plus démunis puissent s’en servir. En conséquence, il n’y avait rien à m’enlever. Il arriva que ces prisonnières de droit commun, constatant ma misère, m’offrirent quelque chose à manger. Elles s’intéressèrent alors à mon sort et aux raisons pour lesquelles on me conduisait en exil, car, pour elles, la peine d’exil n’existait pas, et elles croyaient que ce genre de choses n’était arrivé qu’à l’époque des tsars. « Alors, tu iras en exil comme Lénine », disaient-elles. Vivant pendant un mois dans la même cellule, nous eûmes ainsi l’occasion de nous confier les unes aux autres. Je n’ai rien caché de mes convictions ; avant et après les repas, je faisais le signe de croix ; durant la journée, je priais et quand l’occasion s’en présentait, je ne manquais pas de les amener à réfléchir sur leur vie gaspillée, leur disant qu’en vivant de cette manière, elles ne seraient jamais heureuses. J’essayais de leur manifester beaucoup de gentillesse, car je réalisais combien elles étaient malheureuses. Elles se rendirent probablement compte que mes sentiments à leur égard étaient sincères et elles se comportèrent toujours bien avec moi ; je peux dire que je n’ai jamais eu à souffrir de violences ou de mépris de leur part. Pendant toute la durée de mon temps de détention, j’ai eu quatre mois de contact avec les détenues de droit commun : deux mois de voyages et deux mois à l’hôpital.
« S’il n’y a pas de Dieu, tout est permis ! »
À la prison de Novossibirsk, où je devais rester une semaine, je me suis trouvée avec trois jeunes filles de 15 ans, accusées d’assassinats et déjà condamnées. À peine avaient-elles 13 ans qu’elles s’étaient associées avec un garçon de 14 ans et livrées au banditisme. Le soir, en se postant dans de petites rues, cette bande attaquait les passants isolés, les frappait jusqu’à les tuer, leur dérobait seulement leur argent qui le plus souvent était bien menu. « Nous aussi, il faut bien que l’on vive, m’expliquaient-elles, boire, fumer, se maquiller... » Elles avaient commencé à fumer dès l’âge de 10 ans. Elles se plaignaient, prétextant qu’on leur avait infligé des condamnations trop sévères, et que, selon elles, « il n’y avait pas de motifs »... L’une d’elles était condamnée à deux ans, l’autre à deux ans et demi, et la troisième, reconnue comme chef de la bande, à trois ans et peut-être plus, me sembla-t-il. De toute manière, en tant que mineures, elles n’auraient pas même à accomplir la moitié de leur peine, puisque d’ailleurs on accordait fréquemment des amnisties aux condamnés de droit commun. Ce qui est tragique, c’est qu’elles ne se sentaient nullement coupables de leurs agissements, les justifiant en disant : « Il faut bien que nous aussi on vive ! » Tout cela, ce sont les résultats de l’athéisme : « S’il n’y a pas de Dieu, tout est permis ! » Qui pourrait dénombrer les millions de détenus qui, complètement déshumanisés, mènent derrière les fils barbelés une vie d’enfer, marquée d’une effroyable amoralité, de cruauté et de haine. Il est tout à fait vrai de dire que l’Union Soviétique est un immense camp et que la différence ne réside que dans la diversité du régime. L’individu auquel on a arraché Dieu du cœur s’enfonce de plus en plus dans un marécage de putréfaction morale qui le conduit à considérer le mal comme un bien et vice-versa. C’est seulement après avoir été en contact avec tous ces malheureux que j’ai compris quel trésor inestimable était le don de la foi en Dieu et quelle était notre responsabilité. Je me demandais : « Faisons-nous vraiment tout notre possible pour aider les autres ? »
Vers la taïga sibérienne
pour des travaux de déboisement
Mon voyage se termina à la prison de Krasnoïarsk, où je devais rester une semaine entière dans une cellule au sous-sol, remplie de détenues de droit commun. Les vastes prisons des lieux de transit sont toujours surchargées. Je crois que c’est l’unique secteur où les Soviétiques réussissent à dépasser les prévisions du plan, le nombre des malheureux étant en croissance constante.
De Krasnoïarsk – afin que l’exil me soit cent fois plus dur que le camp, comme me l’avaient promis les tchékistes de Saransk – sur l’ordre du K.G.B., je fus dirigée vers la taïga, en compagnie de huit condamnés alcooliques, pour des travaux de déboisement. Dans la taïga, l’ours se substitue au procureur et le loup à l’avocat... et on laisse aux criminels la plus grande liberté. De cette manière, les tchékistes se proposaient de réaliser la menace que l’on m’avait faite à Vilnius : « Dis au revoir à la Lituanie, tu ne la reverras plus jamais ! Tu es entre nos mains ; nous ferons de toi ce que nous voudrons ! » Mais, ces pauvres malheureux ignoraient que nous sommes tous entre les mains de Dieu et que sans sa permission, il ne tombe pas un seul cheveu de notre tête. Qu’elles sont différentes les pensées des personnes aveugles sur le plan divin ! De la prison de Krasnoïarsk, on nous transféra, moi et les huit autres condamnés, par avion jusqu’à Bogucani, localité située à 400 km plus au nord. Une voiture automobile nous conduisit au siège de la milice, d’où un autre véhicule devait nous emmener à 60 km de là, dans la taïga. Mais ce jour-là, c’était le 19 septembre 1977, ce véhicule tomba en panne et nous passâmes la nuit à Bogucani. À peine arrivée dans la cour de la milice, trois miliciens se mirent à se quereller à mon sujet, en vue de s’approprier le « butin ». Quant à moi, je me confiai à la protection du Seigneur et je me sentis rassurée. Le bâtiment de la milice se trouvait directement sur les bords du fleuve Angara. Je fus en admiration devant la beauté du fleuve, qui, en cet endroit, est large de 2 km et serpente majestueusement à travers la taïga et les collines boisées. En cette période de l’automne, les feuilles des arbres, de couleurs jaune, verte et rouge, me rappelaient les trois couleurs de la Lituanie. Les journées étaient ensoleillées. En moi-même, je remerciais le Seigneur pour toute cette beauté et son amour pour moi, indigne de tout cela. Peu de temps après, on m’appela et on me fit savoir que, suite à la demande des prisonniers, mes compagnons, la personne chargée du nettoyage des salles destinées à la désintoxication alcoolique avait accepté de m’héberger pour la nuit. On voulait ainsi m’éviter de dormir sur le sol nu de l’étroite pièce de désintoxication, en compagnie des huit alcooliques, mes compagnons d’aventure. Le chef accorda cette autorisation, mais à condition que je sois de retour au siège de la milice, le lendemain matin pour 9 h, heure du départ pour la taïga. On ne me permit pas d’aller à la poste voisine d’où je voulais envoyer un télégramme à mon frère à Vilnius, pour lui dire où j’étais, car depuis quatre mois, il n’avait reçu aucune nouvelle de moi.
« Quand tu seras parvenue à destination, tu pourras lui écrire de là... », me répondit un fonctionnaire de la milice. La femme de ménage m’emmena chez elle. La maisonnette se trouvait juste en face du bâtiment de la milice, du côté opposé de la rue. Elle me dit que nous serions conduits dans une région de la taïga, où, dans un rayon de 40 à 50 km, il n’y a aucune habitation, ni moyens de communication ; incidemment seulement passaient quelques voitures. Si par hasard des parents essayaient de venir me voir, ils devraient se rendre à pied dans la taïga et, de toute évidence, ils ne me trouveraient pas.
Un arrangement inespéré à Bogucani
Je demandais si, à Bogucani, on n’aurait pas besoin d’une femme de ménage ou de quelqu’un pour laver la vaisselle, car si je parvenais à rester là, il serait plus facile pour ma famille de me retrouver. C’est alors que j’appris qu’il y avait sur place une école de deux étages pour laquelle il aurait fallu sept femmes de ménage, l’école fonctionnant par deux roulements. Or, il n’y avait plus que deux femmes de ménage, la troisième venant d’être licenciée pour ivrognerie. Alors que nous parlions de tout cela, sans qu’on l’ait appelée, survint Ania, l’une des deux femmes de ménage de l’école, qui avait le même âge que moi. Nous nous mîmes d’accord pour nous rendre le lendemain matin à 8 h chez l’économe et lui demander s’il pouvait m’engager en tant que chargée de ménage. « S’il ne veut pas te prendre, déclara Ania, je quitterai de suite le poste. Je fais le travail de trois personnes et demie, et on me paye pour une personne et demie. J’en ai assez ! » Je fus accueillie à bras ouverts, mais comme ces gens boivent beaucoup, il m’était difficile de trouver une personne en qui je puisse avoir confiance. Le fonctionnaire de la milice, responsable des exilés, accepta que je travaille et que j’habite à Bogucani, ce qui valut à ce pauvre malheureux un blâme du K.G.B. : comment avait-il osé me garder à Bogucani sans leur autorisation ?

Nijolé Sadunaité en exil à Bogucani, en Sibérie, comme femme de ménage à l’école secondaire de Bogucani.
À partir du 20 septembre 1977, je commençai à travailler dans l’école de Bogucani comme femme de ménage et je demeurai près d’Ania, dans l’appartement attribué par l’école. Quant à mes huit compagnons de voyage, prisonniers de droit commun, ils ne furent conduits dans la taïga que dans la soirée. Ayant réussi à se procurer, on ne sait comment, de l’alcool distillé secrètement, ils s’enivrèrent, ce qui ne tarda pas à déclencher une rixe. Après avoir tué l’un d’entre eux, ils le découpèrent en morceaux, tandis qu’ils en blessèrent deux autres, leur brisant les côtes et leur fracturant le crâne. J’eus plus tard l’occasion de revoir l’un d’eux qui avait été hospitalisé à Bogucani pour y être soigné. J’ai également retrouvé les autres par hasard dans la rue. Tous me dirent que j’avais eu de la chance de ne pas être venue avec eux dans la taïga, car je n’aurais pas survécu plus de vingt-quatre heures. « Nous étions complètement ivres et on ne se rendait plus compte de ce que l’on faisait... La milice est arrivée seulement quatre jours après la rixe, alors que les blessés s’étaient mis à la recherche d’un médecin et que le cadavre répandait déjà une odeur nauséabonde... » me dirent-ils. Je me rendis compte alors de ce qu’était le plan du K.G.B. pour m’éliminer physiquement, mais tout cela était tombé à l’eau !
Le travail à l’école était pesant ; en effet, dehors il y avait beaucoup de boue et quand les élèves rentraient dans les classes après les récréations, ils ramenaient avec eux cette boue et ainsi il fallait travailler durement du matin au soir pour nettoyer. La cuisinière de l’internat, ayant remarqué mon épuisement, eut pitié de moi et elle me fit savoir qu’à l’hôpital on avait besoin de personnel sanitaire et que là, la vie serait plus facile.
Dans le courant d’octobre 1977, je reçus la visite de Broné Kibickaité et de Liudas Simutis ; ce dernier avait passé 23 ans dans les camps. Quelle joie de nous retrouver ! Tous les trois, après avoir nettoyé les salles de classe et les couloirs, nous allâmes nous promener et nous remerciâmes le Seigneur dans une prière commune. Ensuite la Kibickaité et moi, nous nous rendîmes à l’hôpital. Je fus acceptée et on m’engagea dans le service de maternité, ayant un diplôme d’aide-soignante et ayant déjà travaillé à ce titre dans un jardin d’enfants. On me promit également de m’obtenir une chambre dans une pension. C’est ainsi qu’à partir du 1er novembre 1977, je commençai à travailler à l’hôpital régional de Bogucani. Le médecin-chef de l’hôpital était le Lituanien Mecislovas Butkus, ancien détenu qui, à la période où je fus engagée, était en vacances loin de Bogucani. Malgré cela, le K.G.B. l’accusa plus tard de m’avoir engagée et lui ordonna de me licencier. Le courageux médecin répondit : « Elle travaille bien et je n’ai aucun motif de la licencier. Si elle ne doit plus travailler à l’hôpital, envoyez-moi un ordre écrit de licenciement et je l’exécuterai... »
Les menées du K.G.B.
et la solidarité des baptistes
Dans ses diverses actions, le K.G.B. s’efforce de ne pas se mouiller et dans la mesure du possible, il utilise des agents qu’il paye ou qu’il menace. C’est ainsi que n’ayant pas réussi à intimider le médecin-chef, ils firent répandre de fausses accusations. Les miliciens parcouraient Bogucani, disant aux gens qu’il y avait à l’hôpital une croyante qui, ayant trouvé du travail, empoisonnait les femmes et les nouveau-nés en leur donnant, avec des images saintes, des pilules empoisonnées ; de plus, qu’elle possédait un poste émetteur et qu’elle communiquait à l’étranger tous les secrets de l’État...
Étant donné que j’étais une criminelle dangereuse, personne ne devait avoir de rapports avec moi, me parler ou me vendre quoi que ce soit. Dans le cas contraire, eux aussi seraient jugés coupables d’activités contre l’État.
Pendant un certain temps, les gens avaient peur et m’évitaient, mais cela ne devait durer que quelques mois. Les premiers à se rapprocher de moi à l’hôpital furent des baptistes. On se lia d’amitié et on pria ensemble. À Bogucani, ils étaient aux alentours d’une cinquantaine et parmi eux beaucoup de jeunes et de personnes courageuses. Je leur suis très reconnaissante de l’appui moral qu’ils m’ont apporté et de l’amitié qu’ils m’ont manifestée, m’accueillant toujours comme une sœur. Que le Seigneur les récompense ! Ils faisaient remarquer en souriant que sans les calomnies du K.G.B., ils ne m’auraient jamais connue. C’est, en effet, quand les miliciens se sont mis à propager de fausses accusations contre moi qu’ils se sont intéressés à moi et ont pris contact. Ce qui prouve que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu...
La persécution du K.G.B.
Le K.G.B., trouvant que j’étais trop bien installée à Bogucani, donna l’ordre, par l’intermédiaire du chef de la milice, de me retirer dans les deux jours mon autorisation de résidence, de me licencier et de m’envoyer dans le village d’Irba, à 100 km plus au nord, pour y être employée comme vachère. Nous étions en décembre 1977 et dans cette région la température varie entre 40 et 50 degrés en dessous de zéro. L’ex-détenu politique Ilia Gleizer, alors exilé à Bogucani et qui actuellement se trouve en Israël, me conseilla d’essayer de retarder mon départ jusqu’à la fin de janvier 1978, car le 3 janvier il terminerait son temps d’exil. Une fois rentré à Moscou, il tâcherait de faire quelque chose pour que je ne sois pas obligée de me rendre dans ce second lieu d’exil, au sovkhoze d’Irba. Je le remerciai de cette attention mais lui répondis que ce qui arriverait serait conforme à la volonté de Dieu et que cette volonté était pour moi la plus importante des choses.

Nijolé Sadunaité dans son studio à Bogucani (Sibérie).
On me licencia de mon travail et je me rendis chez le responsable de tous les sovkhozes afin qu’il me remît un certificat de travail en qualité de vachère pour le sovkhoze d’Irba. Ce dernier, tout étonné, me demanda pourquoi on m’envoyait à ce genre de travail forcé. Il m’expliqua que ce sovkhoze était des plus arriérés, qu’on y manquait de fourrage, que les employées étaient des alcooliques et qu’il faudrait travailler pour soi et pour les autres tous les jours de l’année, y compris les jours de fête, depuis l’aube jusqu’à la nuit... Je lui répondis que j’avais déjà été menacée d’une forme très dure d’exil et que je n’avais pas peur du travail. Je lui expliquai ensuite qu’étant sujette à des accès de fièvre, je ne serais probablement pas une bonne vachère et qu’il y avait des chances pour que je ne travaille pas longtemps.
De la fièvre et à nouveau le salut
À ces paroles, la figure du président s’illumina et, étant de toute évidence disposé à m’aider, il déclara que l’on n’avait pas besoin de vachères malades. Après quoi il décida de m’envoyer à l’hôpital pour un contrôle de santé. Munie de la demande de contrôle de santé, je retournai à la milice pour leur faire savoir qu’on m’avait ordonné des examens à l’hôpital. Le chef de la milice était absent ; je me rendis donc chez son substitut. En entrant dans le bureau, je me rendis compte que ce dernier parlait de moi à un jeune homme aux cheveux noirs. Je me présentai alors et le substitut dit : « Voilà justement la nouvelle vachère dont nous parlions. Elle est instruite, travailleuse et ne s’adonne pas à l’alcool. » Je demandai alors au substitut comment il se faisait que, possédant tant de qualités, on m’envoyait ailleurs en exil : « C’est peut-être le K.G.B. qui ne vous laisse pas en paix à cause de moi ?... » Alors, il se tourna vers moi, me mit la main sur la bouche afin que le président de la circonscription d’Irba présent n’entende rien et il me dit : « Si tu le sais, pourquoi le demandes-tu ? »... Je leur fis savoir ensuite que je n’étais pas acceptée comme vachère et qu’on m’envoyait à l’hôpital pour un contrôle. Le substitut me répondit que, même si je n’étais pas en état de faire un travail quelconque, il me faudrait de toute façon quitter Bogucani. Ainsi, leur but n’était pas d’avoir une vachère de plus, mais de me mettre dans les conditions les plus dures. En cela, ils ne faisaient qu’exécuter les ordres du K.G.B.
M’étant présentée à l’hôpital pour des examens, on me mit dans le service de « thérapie ». L’infirmière-chef du service vérifia personnellement ma température toutes les trois heures, car elle n’avait confiance en aucune autre. C’était un membre « émérite » du parti et, de ce fait, elle croyait toute les calomnies inventées par le K.G.B., elle bouillait de haine pour cette « fasciste ». Ma température était normale pendant la nuit ; le matin, elle était à 37,1° et le soir elle montait à 37,7° – 38°. Bien que je souffrisse d’une toux persistante, on ne me donna aucun calmant. D’autre part, le médecin du service « thérapie » qui aurait dû s’occuper de moi, me fuyait comme la peste et, au cours de ses visites, il ne s’est pas approché de moi une seule fois. Bien sûr, quand il s’agit d’un « ennemi du peuple », d’une « fasciste »... il vaut mieux se tenir à distance ; il aurait pu s’attirer les foudres du K.G.B. Il valait mieux éviter un élément de ce genre. L’infirmière-chef me soumit pendant près de six heures à des examens endoscopiques de l’estomac et de la bile, si bien que la sonde finit par me provoquer une hémorragie. Une infirmière de passage me sauva de ces tortures. Effrayée, elle me retira la sonde disant que celle-ci n’aurait pas dû rester plus de trois heures. Cette affaire de sonde fut par la suite la cause de la « maladie de Botkin » qui me frappa un mois après. Quant à la température, l’infirmière-chef déclarait : « Songez donc, 38° seulement ; peut-on appeler ça de la fièvre ? Mais c’est la température idéale pour travailler comme vachère... »
Un drame bouleversant à la veille de Noël
Je me souviens encore de l’horrible tragédie qui se déroula la veille de Noël 1977. Une très jeune infirmière, qui était venue dans notre salle, raconta, la voix coupée par l’émotion, à l’une de ses amies qui était parmi nous, comment, dans le service de gynécologie, on avait abandonné une nouveau-née dans un recoin glacial. La petite qui pleurait depuis deux jours n’était pas encore morte. Je demandai à l’infirmière de me conduire près d’elle et j’emmenai avec moi de l’eau pure. Sur une petite table blanche vernie gisait, enveloppé d’une légère bande de pansement, un petit être dont le visage était violacé par le froid. Je le touchai et il se mit à pleurer faiblement. Après l’avoir baptisé, je me rendis dans la salle des infirmières, qui jacassaient joyeusement. Il faisait déjà nuit. Bouleversée, je leur demandai pourquoi elles avaient abandonné et condamné une créature innocente à mourir de froid et de faim. Elles me répondirent très sèchement : « Ce n’est pas ton affaire ! La doctoresse sait mieux que toi qui doit vivre et qui doit mourir. » Je répondis que le devoir d’un médecin est de sauver la vie et non de la supprimer, et j’ajoutai qu’en tuant leurs propres enfants, ils étaient pire que les fascistes, qui eux ne supprimaient que les enfants des autres peuples ! Les infirmières se mirent alors à crier : « Va-t’en... Tu es probablement sortie d’un hôpital psychiatrique pour avoir autant de compassion pour les autres. Tout cela est notre affaire et nous faisons ce que nous voulons ! »
Je sortis, le cœur meurtri. Je fis une autre tentative auprès de la doctoresse de garde, mais cela ne servit à rien. Et dire qu’il s’agissait d’un service de maternité où il y avait des berceaux prévus pour les prématurés, où la température était suffisante et l’alimentation surveillée. Cependant, pour cette petite créature, il semble qu’il n’y avait pas de place ! De toute ma vie, je n’ai jamais passé un Noël aussi triste. La petite fille s’éteignit le lendemain matin et alors que nous demandions des nouvelles à la gynécologue qui passait dans notre salle, celle-ci répondit : « Il y a longtemps que l’on aurait dû la jeter à la poubelle ! » Et voilà ce qu’il en est de la « très pure morale » communiste ! Ils n’ont pas même pitié de leurs propres créatures innocentes ! Il est alors facile de s’imaginer la haine qu’ils peuvent avoir à l’égard de ceux qui ne pensent pas comme eux !
Le transfert à Irba conjuré
À l’hôpital je rencontrai la personne chargée de l’élevage des veaux au sovkhoze d’Irba. Elle était également hospitalisée. Elle me décrivit le désordre qui régnait au sovkhoze : il n’y avait pas de fourrage, tout était dans un état d’abandon, les veaux périssaient et l’administration prétendait retirer une partie de salaire aux employés, qui eux étaient pourtant libres, à cause des veaux qui n’avaient pas survécu. « Et pourtant, ce n’est pas de notre faute s’il n’y a pas de fourrage... », me dit-elle. Je suis venue à Irba parce qu’on m’avait promis une maison ; mais maintenant comme je le regrette amèrement. » Cette femme m’avoua que, alors qu’on était déjà en décembre, elle n’avait pas été payée depuis le mois de mai. La plus grande partie des travailleurs du sovkhoze étaient des alcooliques, on n’y travaillait plus et souvent il y avait des rixes et des meurtres. Elle me conseilla de tout faire pour ne pas aller à Irba, car je serais allée au-devant d’un procès pour négligences dans le soin des vaches et condamnée à rembourser à l’État des sommes qu’il m’aurait été impossible de régler, même si j’avais payé chaque jour jusqu’à ma mort. Je la remerciai de ses conseils, mais aller ou ne pas aller à Irba ne dépendait pas de moi. Le 10 janvier 1978, je fus renvoyée de l’hôpital, ayant été déclarée guérie et capable d’effectuer n’importe quel travail, malgré une température constante de 37,7°. Je me présentai donc à la milice. Comme le chef était occupé avec d’autres tchékistes arrivés de Krasnoïarsk, on me dit d’attendre à la porte. Après avoir attendu un bon quart d’heure, je décidai d’entrer pour demander quand le chef serait disposé à me recevoir. Étant entrée dans le bureau, je trouvai le chef de la milice en conversation avec deux tchékistes. Il se leva et, me tendant les mains, il vint à moi tout souriant et me dit : « C’est bien vous qui allez rester et vivre avec nous ? » Toute surprise de ce changement subit, je lui répondis qu’en ce qui me concernait je ne voulais pas partir, mais que c’était lui qui m’avait imposé ce départ. Le chef de la milice m’interrompit en disant : « Vous resterez et travaillerez à Bogucani ! » De toute évidence, le Seigneur était intervenu encore une fois pour que je reste à Bogucani jusqu’à la fin de mon temps d’exil. L’amour du Seigneur se manifeste particulièrement dans les moments les plus difficiles de la vie. À Lui honneur, amour et grâces pour les siècles !
La solidarité réconfortante des braves gens
Pendant mon séjour à Bogucani, j’ai reçu de nombreuses lettres et paquets en provenance de l’étranger. L’employé du bureau de poste était étonné par l’abondance de ce courrier et il me demanda pourquoi il y avait tant de gens qui m’écrivaient ainsi d’une vingtaine de pays étrangers. « Ils m’écrivent parce qu’ils me veulent du bien et prient pour moi », lui expliquai-je. J’ouvrais les paquets que je recevais et en confectionnais d’autres selon les besoins et les envoyais aux détenus politiques dont les conditions de vie étaient encore plus dures que les miennes. J’en connaissais plus d’une vingtaine. L’employé de la poste s’étonnait encore qu’au lieu d’envoyer ces colis en Lituanie, mon pays, je les adressais à des personnes de nationalités des plus diverses, et dans les coins les plus reculés de la Sibérie, de la Yakoutie et jusqu’à Magadan. « Qui sont ces gens pour toi ? » – « Ce sont seulement des frères et des sœurs qui se trouvent dans la misère », répondis-je. « D’ailleurs, vous-mêmes, vous proclamez que l’homme doit être un frère pour l’homme. » Les jeunes Komsomols étaient étonnés et me demandèrent : « Eh bien, s’il nous arrivait de tomber dans la misère, est-ce que tu nous enverrais également des colis ? » – « Certainement, si j’avais votre adresse », répondis-je. Bien que tout cela leur soit incompréhensible, ils me croyaient cependant. Une fois rentrée en Lituanie, j’ai reçu d’eux quelques lettres très cordiales, où ils me disaient qu’ils se rappelaient toujours de moi. Comme quoi, le véritable amour est plus fort que la haine !

Nijolé Sadunaité sous la Porte de l’Aurore à Vilnius avec un groupe de fidèles et le frère Hieronymus Petrasukas (OFM) de Jérusalem. Nijolé est au centre derrière l’enfant.
Je rentre dans mon pays
Le 7 juillet 1980, je terminais mon temps d’exil et rentrais chez moi, à Riga. À l’aéroport de Riga, au moment où je descendais de l’avion, une voiture « Volga » blanche vint à ma rencontre. De cette voiture descendirent deux tchékistes qui, sans exhiber aucun mandat, me conduisirent à Vilnius. Par la suite, j’ai appris que le Père Alfonsas Svarinskas et un certain nombre de prêtres ainsi que des fidèles étaient venus m’accueillir à Riga. Leur intention était de me conduire assister avec eux à la solennité de la Vierge à Zemaiciu Kalvariia. Mais les tchékistes avaient dispersé et chassé de l’aéroport tout ce monde, afin qu’à mon arrivée il n’y ait pas d’accueil. En dépit des menaces du K.G.B., il fut organisé plus tard dans de nombreuses paroisses de Lituanie des cérémonies en mon honneur, en présence de nombreux enfants, jeunes gens et adultes. Je leur racontais mon odyssée : l’arrestation, les interrogatoires, la prison, le camp et la Sibérie, soulignant que pendant ces six années, j’avais eu la preuve constante que, sans la volonté de Dieu, aucun de nos cheveux ne peut tomber. Je les exhortais à se confier à Lui, à ne craindre aucune persécution, et à travailler de toutes leurs forces pour le bien des autres et la gloire de Dieu. La peur est déjà le commencement de la trahison. Une seule chose est à craindre : ne pas s’occuper suffisamment des affaires du Christ et de l’Église et avoir trop peu l’esprit de sacrifice. Ne nous ménageons pas ; appuyons-nous sur le Christ et nous serons invincibles.

Nijolé Sadunaité, après son exil à Bogucani, retrouve la liberté.
Le K.G.B. passe à l’attaque
Le K.G.B. confisquait la majorité de mes lettres et me menaçait, par l’intermédiaire du parquet, de me faire emprisonner avec les détenus de droit commun. Ces menaces commencèrent à se concrétiser lorsque l’ex-chef du K.G.B., Andropov, devint le nouveau souverain des Soviets. Les tchékistes se déchaînèrent alors comme jamais ils ne l’avaient encore fait.
Tout d’abord, pour essayer de se venger à mon égard, ils décidèrent de liquider en temps voulu mon frère : ils inventèrent un procès préfabriqué et mon frère fut envoyé en hôpital psychiatrique. Ils réalisèrent un peu plus tard que je pouvais être pour eux un obstacle – ils redoutent tout particulièrement la publicité et les protestations du monde libre –, ils laissèrent donc la paix à mon frère et s’intéressèrent de nouveau à moi pour me remettre en prison. Le K.G.B. se montre particulièrement sensible quand ses actions criminelles sont découvertes et divulguées à l’étranger. Alors, ces pauvres malheureux se lamentent d’être calomniés quand on les accuse d’emprisonner des innocents et d’en envoyer en hôpital psychiatrique.
Et voilà ce qui se passa : mon frère venait à peine d’être interné à l’hôpital psychiatrique que le jour suivant, c’est-à-dire le 19 novembre 1982, j’envoyais de Vilnius un télégramme urgent avec accusé de réception à mon oncle (le frère de ma mère décédée) qui habitait à Chicago. Dans ce télégramme, il y avait ces mots. « Ils ont enfermé Alius à l’hôpital psychiatrique – Nilé ! » Mon frère avait été baptisé sous deux noms : Jonas – Aloyzas, et mon oncle dans ses lettres l’appelait « Alius » et moi, c’était « Nilé ». Il est probable que l’oncle ne reçut jamais ce télégramme, car l’accusé de réception ne me parvint jamais et pourtant j’avais dépensé 21 roubles et 64 kopecks, c’est-à-dire tout le salaire d’un mois (à mon retour de Sibérie, j’avais cherché du travail comme femme de ménage dans un magasin, mais à l’office des cadres, on me fit savoir que ce travail était bien trop bon pour moi et que, si la directrice m’avait acceptée, j’aurais été licenciée. Ensuite, je trouvai un emploi d’auxiliaire à l’église de Paberze : je devais laver et remettre en ordre les vêtements liturgiques, nettoyer le parvis, entretenir la pelouse. Comme tous ceux qui travaillaient dans l’église, je payais régulièrement les impôts fixés par l’État).
Le télégramme envoyé à mon oncle fut intercepté par le K.G.B. de Vilnius qui, en guise de vengeance, organisa le 22 novembre 1982 une sorte de complot contre moi. Ce jour-là, alors que je venais voir mon frère à l’hôpital psychiatrique, je fus assaillie par la responsable du secteur, agent du K.G.B., la doctoresse R. Razinskiené (juive) qui me chassa en hurlant : « Va-t’en ! Tu n’as pas le droit de venir ici ! » J’étais à peine sortie que, suite à son coup de téléphone, un tchékiste arriva en incognito (c’était le même, qui, en octobre 1982, avait dirigé une perquisition dans notre maison). Il était accompagné de quelques miliciens. Ils avaient espéré m’arrêter avant que je ne sorte de l’hôpital, et ils regrettèrent d’être arrivés trop tard. Quoi qu’il en soit, sous la dictée du tchékiste, un procès-verbal fut établi à mon encontre, affirmant que j’avais offensé la doctoresse Razinskiené en disant qu’elle aurait terrorisé son personnel. Deux Polonais seulement signèrent ce faux témoignage : l’infirmière Jadvyga Stasinskaia et l’infirmier Ceslov Cernevskii. Tous les autres employés et les personnes qui se trouvaient à l’hôpital refusèrent de signer, ce qui dans la suite leur attira des ennuis et plus particulièrement à ceux qui avaient échangé quelques paroles avec moi.
Les « cures » psychiatriques
Le même jour, on transféra du service de psychanalyse au service no 1, qui se trouvait sous le contrôle du K.G.B., Dovydas Seveliov, venu d’Angleterre en Lituanie à l’invitation de son frère. Ce dernier travaillait au service du K.G.B. et espérait bien recruter le nouvel arrivé pour ce service. L’affaire n’ayant pas réussi, on avait enfermé Dovydas à l’hôpital psychiatrique. Dans le service no 1, les « cures » étaient telles qu’au bout de deux mois le patient ne se rappelait plus ni de son nom ni de son prénom. On n’accorda à personne l’autorisation de rendre visite à Seveliov ni de lui faire parvenir des provisions. Ceux qui étaient hospitalisés avec lui, dont un jeune d’une vingtaine d’années de nationalité allemande et venant de Maïsiogala (Lituanie), avaient été enfermés là en raison de leurs croyances religieuses. Sur les ordres de la Razinskiené, on avait injecté à cet Allemand des doses massives « d’aminazine », ce qui l’amenait à dormir continuellement. Peu de temps après, il fut transféré à l’hôpital psychiatrique de Tcherniachovsk. C’est de cette manière que la Razinskiené, avec l’appui du K.G.B., traitait les récalcitrants. Que le Seigneur pardonne !
Le jour suivant, trois miliciens, munis d’un mandat d’arrêt, se présentèrent chez moi, mais avec l’aide du Seigneur, je réussis à m’enfuir. Par la suite, en plusieurs occasions, le K.G.B. et la milice m’ont recherchée sous divers prétextes. J’ai fait en sorte d’éviter ce genre « d’amis », uniquement parce que je voulais, si c’était la volonté du Seigneur, me rendre encore utile un certain temps à tous ceux qui luttent pour la vérité et pour leurs droits. Pour cela, je suis toujours prête à aller avec joie en prison et, si le Seigneur m’accorde cette grâce, à y mourir.
Jonas Sadunas
est condamné au travail obligatoire
Le 8 juin 1983, le Tribunal Suprême de Vilnius, suite à la demande d’appel présentée en cassation par mon frère, modifia la sentence du 24 mai 1983, la ramena à 18 mois, mais sous condition et avec l’obligation de trouver un travail. Le 6 juillet il fut embauché à l’agence nationale de Giedraiciai en qualité de chef d’équipe dans le secteur de la protection des plantes. Ce poste était libre depuis longtemps parce que personne ne voulait travailler au contact des produits chimiques utilisés comme désherbants et dangereux pour la santé. Cela me fut communiqué par le coup de téléphone que me donna mon frère le 24 juillet. Deux jours après, le 26 juillet, suite à un télégramme envoyé en urgence au Ministère de l’Intérieur, mon frère fut envoyé travailler à des constructions dans la ville de Jonava. Le responsable des entreprises de construction du secteur auquel il s’était présenté s’étonna que mon frère, qui n’avait pourtant commis aucun délit, ait été transféré de Giedraiciai et affecté à des travaux physiquement très pénibles, alors qu’on n’avait pas besoin d’ouvriers ; spécialiste en agronomie, il aurait été bien plus utile où il était. Mon frère venait d’être opéré il y a à peine trois mois d’une hernie ; de plus il était atteint de bronchite et d’angine chroniques et de santé très délicate. Autrefois, les médecins lui avaient déjà interdit, en raison de son mauvais état de santé, de travailler dans les champs. C’est alors qu’il était entré à l’Institut de la Recherche. Et maintenant, il devait travailler dans la construction avec des détenus de droit commun et vivait dans un internat où il devait rentrer aussitôt après le travail. C’est seulement aux jours de fête qu’il était autorisé à se rendre auprès de sa femme et de sa fille Marija de 7 ans. Périodiquement, il devait se présenter à la milice pour signer le registre des exilés. Le 15 septembre 1983, il fut hospitalisé à Ionava dans le service des maladies infectieuses : à la suite de plusieurs radios, on lui avait découvert plusieurs taches au poumon. De plus, le soir, sa température prise sous la langue montait à 38°, il n’avait plus de voix et il était atteint d’une bronchite aiguë. Le jour suivant, il reçut une convocation du K.G.B. : il devait se présenter le 19 septembre à Vilnius chez le tchékiste Vidas Baumila pour un interrogatoire. La doctoresse Matulioniené du service TBC, chargée de mon frère, l’autorisa verbalement à se rendre à l’interrogatoire, bien que le voyage aller et retour de Ionava à Vilnius durât environ six heures. Le 19 septembre, le tchékiste Baumila soumit Jonas à un interrogatoire de trois heures. Il lui montra un certain nombre de copies de mes lettres, de celle de Vladas Lapienis et de Petras Paulaitis, lettres que mon frère avait copiées de sa main et qu’il avait déposées dans une cantine afin qu’elles ne soient pas perdues. Évidemment, la cantine avait été forcée et les lettres soustraites. Le tchékiste accusa Jonas d’avoir remis les copies de ces lettres au Père Sigitas Tamkevicius, ces documents ayant été retrouvés chez le Père lors d’une perquisition. Mon frère répondit qu’il ne savait absolument pas qui avait bien pu forcer la cantine et pris possession des lettres et affirma également qu’il ne connaissait pas celui qui les aurait portées chez le prêtre. Il affirma que, de son côté, il n’avait pas remis ces copies au Père Sigitas Tamkevicius et demanda que, si le tchékiste prétendait les avoir trouvées dans cet endroit, il lui montre le procès-verbal de la perquisition. Le procès-verbal ne fut pas montré, et pour toute réponse Baumila se mit à hurler, menaçant Jonas de lui intenter un nouveau procès. Puis, le tchékiste commença à l’interroger à mon sujet. Mon frère répondit que je travaillais et que j’habitais dans le même appartement que sa femme. Malgré les menaces qui lui furent faites, mon frère refusa de signer le procès-verbal de l’interrogatoire. « Dans le passé vous avez déjà falsifié ma signature au bas de déclarations inventées par vous et, plus tard, vous vous en êtes servis comme chef d’accusation pour m’intenter un procès. » En le congédiant, le tchékiste ordonna à mon frère de revenir le lendemain pour poursuivre l’interrogatoire, car le temps prévu était passé. Le 20 septembre, Baumila interrogea à nouveau mon frère pendant deux heures et cinquante minutes, renouvelant ses menaces de le soumettre à un nouveau procès pour avoir transmis des informations à la « L.K.B. Kronika ». Il continua à mentir, affirmant que le Père Sigitas Tamkevicius avait avoué que c’était bien lui, mon frère, qui lui avait remis les copies de lettres. Mon frère demanda alors à être confronté avec le prêtre. Le tchékiste, mis au pied du mur, commença à crier et détourna l’entretien sur un autre sujet. Baumila fit de nouvelles menaces de représailles à mon frère pour avoir révélé un « secret d’État », à savoir une plainte écrite au président du K.G.B. de Lituanie dans laquelle mon frère Jonas dénonçait les manœuvres des tchékistes pour l’amener à collaborer avec eux. Mon frère répéta ce qu’il avait écrit dans cette plainte et ajouta qu’il était prêt à tout pour demeurer fidèle à sa conscience de chrétien. Alors, le tchékiste prit le compte rendu de mon procès et il essaya de convaincre Jonas que je n’étais qu’une « monstrueuse criminelle ». Il affirma que j’avais transmis des informations à l’étranger et que le lendemain je serais arrêtée et condamnée ensuite pour cette raison à de longues années de détention. Il se montra particulièrement irrité de ce que la plainte de mon frère adressée au K.G.B. ait été divulguée à l’étranger et il lui enjoignit de dire à qui il l’avait donnée. Une nouvelle fois, mon frère refusa de signer le procès-verbal de l’interrogatoire, soutenant que le K.G.B. serait capable d’imiter sa signature. Il déclara de plus qu’ils auraient pu se passer de tous ces dérangements et qu’il était inutile de lui envoyer d’autres convocations pour des interrogatoires ou pour témoigner au procès engagé contre le P. Sigitas Tamkevicius, parce qu’en aucun cas il n’aurait témoigné dans le sens voulu par les tchékistes. Baumila menaça Jonas de le retenir là jusqu’à 22 heures, à moins qu’il ne signe le procès-verbal. Enfin, constatant que mon frère n’était nullement intimidé, on le relâcha non sans ajouter qu’on lui ferait « payer » tout cela...

À partir de la gauche : Maryte Saduniene, Marija Sadunaité (au milieu) et Jonas, frère de Nijolé, après la « cure » psychiatrique en 1983.
Le 22 juillet 1983, à 15 h, plusieurs tchékistes vinrent chercher à son travail la femme de Jonas, Maryté Saduniené, et l’ayant fait monter dans une « Volga » noire, ils l’emmenèrent. Elle travaillait comme oculiste à la polyclinique de Vilnius. Conduite au siège des tchékistes, on lui donna l’ordre de remettre tous les documents clandestins en sa possession et que, d’après les tchékistes, elle avait reçus deux semaines auparavant. Maryté répondit qu’elle n’avait rien reçu et que s’ils étaient déjà au courant, ils n’avaient qu’à chercher eux-mêmes ces documents. En outre, les tchékistes refusèrent de donner leur nom, disant : « C’en est bien fini du temps où nous déclinions nos noms et prénoms... » Ensuite, ils essayèrent d’obliger Maryté à déclarer que je n’étais jamais à la maison, que je vivais comme une vagabonde. Elle répondit que je couchais et vivais dans ma chambre, mais que souvent je rentrais tard alors qu’elle dormait et que je me levais tôt, avant qu’elle-même ne soit debout. Et en effet, cela correspondait à la vérité. Ma belle-sœur finit par signer le procès-verbal de l’interrogatoire, car on l’avait menacée de ne pas la laisser partir avant qu’elle eût signé ; or il lui fallait aller chercher sa fille qui était restée à la polyclinique. Elle fut ensuite très inquiète en pensant que les tchékistes étaient capables de falsifier le texte de sa déposition. En la relâchant, on la menaça de lui intenter, comme à son mari, un procès et de ne pas la laisser en paix. Maryté ne fut plus interrogée et cela jusqu’à la fin octobre 1983.

Le Père Sigitas Tamkevicius, membre du Comité Catholique pour la Défense des Droits des Croyants, fut condamné à ce titre le 2 décembre 1983 à 6 ans de camp à régime sévère et à 4 ans d’exil.
Le 13 juin 1983, j’avais expédié de la poste de Moscou, en recommandé, un nombre considérable de signatures de croyants de Lituanie à destination d’Andropov et du Procureur de l’U.R.S.S. Ces signataires protestaient contre l’injuste condamnation du Père Alfonsas Svarinskas et l’arrestation illégale et l’emprisonnement dans les souterrains du K.G.B. du Père Sigitas Tamkevicius, accusé calomnieusement d’activités antisoviétiques. Cette protestation était signée par des dizaines de milliers de croyants de Lituanie. En envoyant ce courrier, j’avais écrit mon nom et mon adresse sur le bulletin d’expédition. Ce fut probablement pour cette raison que le K.G.B., jugeant inopportun de se venger directement sur moi, se mit à persécuter ma belle-sœur. Que le Seigneur soit miséricordieux pour tous !

Le Père Alfonsas Svarinskas, membre du Comité Catholique pour la Défense des Droits des Croyants, fut condamné le 6 mai 1983 à 7 ans de camp à régime sévère et 3 ans d’exil. Il fut ordonné prêtre en 1954 dans le camp d’Abez (Sibérie) par l’évêque lituanien P. Ramanauskas, qui s’y trouvait aussi. Le Père Svarinskas aida à survivre le futur Cardinal ukrainien Joseph Slipyi, qui lui en fut très reconnaissant et intervint pour le défendre à son procès par une lettre publique.
Les souvenirs que j’évoque ont été écrits à des moments très divers et souvent à la hâte. C’est pourquoi je m’excuse des fautes d’orthographe éventuelles et de la mauvaise écriture. J’autorise ceux qui voudraient les publier à en corriger le style et à les utiliser en partie, s’ils le désirent.
Je me redis souvent les paroles de ma Protectrice : sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, paroles qui sont imprimées sur l’image-souvenir de ma confirmation :
« Je ne veux rien d’autre que ce que Tu veux, Ô Amour et comme Tu le veux,
Ce que je reçois de Toi est mien et en retour qu’il soit Tien,
Tu me l’as donné et Tu le reprends et Tu en fais ce qu’il Te plaît,
Conduis-moi comme Tu veux et comme Tu l’entends, car Tu es vraiment l’Amour ! »
J’ai été confirmée à Telsiai le 10 juin 1945 par l’évêque martyr de Lituanie, Vincentas Borisevicius. Exactement trente ans plus tard, j’ai été jugée. Je crois que, par son intercession, l’évêque martyr m’a toujours accompagnée et qu’il m’accompagne encore. Quelle chance d’avoir des saints et des martyrs qui prient pour nous. Ainsi fortifiés, même les plus faibles deviennent capables de supporter les épreuves.

Mgr Vincentas Borisevicius, évêque titulaire de Telsiai, fusillé par les Soviétiques en janvier 1947 sans aucun procès. Dernière photo de l’évêque, prise dans la prison de Lukiskes à Vilnius.
Je remercie tous ceux qui m’ont aidée par leur prière et qui continuent à le faire. Prions les uns pour les autres et plus particulièrement pour ceux qui n’ont pas d’amour, qui ne connaissent pas Dieu, car ce sont nos frères et nos sœurs les plus malheureux.
Rendons grâces et réjouissons-nous tous pour la Lituanie qui, en cette année du jubilé de la Rédemption, a eu deux nouveaux martyrs : le Père Alfonsas Svarinskas et le Père Sigitas Tamkevicius. Ces géants de l’esprit, puissants phares de lumière chrétienne : pendant de longues années et sans mesurer leur peine, ils ont éclairé et réchauffé le cœur de milliers de Lituaniens et maintenant de millions de chrétiens dans le monde entier.
Souffrir pour le Christ est le signe d’une spéciale prédilection.
Je désire conclure la relation de ces souvenirs par un hymne d’actions de grâce :
« Dieu, nous Te louons
Seigneur, nous T’acclamons,
Ô Père Éternel
Toute la terre T’adore.
Les Anges et toutes les puissances du Ciel
Te chantent :
Saint, Saint, Saint,
Le Seigneur, Dieu de l’univers. »
Moscou, le 7 octobre 1983 en la fête de Notre-Dame du Rosaire
ANNEXES
I. Les « camps », les « prisons », l’« exil intérieur » et les « hôpitaux psychiatriques » en URSS.
● LES CAMPS
Quand un prisonnier est condamné à un temps de camp de travail, on lui spécifie aussi son type de régime. Il existe quatre degrés de sévérité :
● régime ordinaire (OBCHI) ;
● régime intensif (OUSILIENI) ;
● régime strict ou sévère (STROGUI) ;
● régime spécial (OSOBI).
Chaque camp correspond à un de ces régimes, si bien que des prisonniers condamnés à des régimes différents sont toujours séparés les uns des autres. Les régimes diffèrent d’après le nombre de « privilèges » octroyés aux prisonniers, les normes de travail, la quantité et la qualité de nourriture et la sévérité de la surveillance.
Dans les quatre catégories de camp, le nombre de visites annuelles qu’un prisonnier peut recevoir de ses proches diminue suivant le degré de sévérité (respectivement : 3, 2, 1 visites).
De même le nombre de lettres que le prisonnier peut écrire par mois (respectivement : illimité, 3, 2, 1 lettres) et celui des colis de 5 kg qu’il peut recevoir par an (respectivement : 3, 2, 1, aucun colis).
Certaines visites de proches peuvent être « privées », c’est-à-dire le prisonnier et ses visiteurs sont enfermés dans une cabane pendant un jour. On leur donne de la nourriture et on les laisse seuls. Mais de telles visites sont inversement proportionnelles à la sévérité du régime. Dans les camps à régime spécial, de telles visites sont interdites et toutes les rencontres avec des proches sont surveillées.
Toutes les lettres envoyées ou reçues sont censurées. Les colis que les détenus peuvent recevoir ne doivent contenir que de la nourriture, mais les produits riches en vitamines et en calories, comme le chocolat, le beurre, les fruits, etc., sont interdits.
Dans les camps à régime ordinaire et intensif, les prisonniers travaillent généralement dans des entreprises situées hors du camp. Ils travaillent 8 heures par jour, sans jour de congé. Ils doivent faire des heures supplémentaires, si les objectifs du plan ne sont pas atteints.
Dans les camps à régime strict ou sévère, le travail est exécuté dans une usine ou sur des chantiers en plein air, exigeant des travaux particulièrement durs : abattages d’arbres et traitement du bois.
Les camps à régime spécial abritent des « récidivistes particulièrement dangereux ». Les prisonniers sont enfermés toute la journée dans leurs cellules et n’ont qu’une heure d’exercice par jour. Ils travaillent à l’intérieur du camp.
Les punitions dans les camps vont de la privation de certains « privilèges », à l’isolement plus ou moins long ou à la prison intérieure du camp.
Étant donné la pénurie alimentaire qui règne dans le pays, surtout en province, les autorités des camps volent la nourriture allouée aux prisonniers. Par exemple, la viande n’arrive jamais dans la gamelle du détenu. Tous sont donc réduits à la même diète, consistant en aliments que personne n’est tenté de voler : poisson pourri, choux pourris, pommes de terre pourries et pain. Une telle diète est totalement insuffisante pour le genre de travail demandé au prisonnier.
Les prisonniers dans les camps reçoivent un peu d’argent, mais la moitié de leur « salaire » est retenue pour l’entretien de leur prison. Sur ce qui reste, on retient encore une certaine somme pour la nourriture et l’uniforme. Avec ce qui lui reste le prisonnier peut dépenser, dans la boutique du camp, de 7 à 3 roubles selon le régime, pour acheter de la nourriture, du dentifrice, du savon, etc.
● LES PRISONS
La prison est encore plus sévère qu’aucun régime de camp de travail. La santé des prisonniers s’y détériore rapidement faute d’exercice physique et de nourriture.
Un détenu de camp peut être transféré en prison pendant 3 ans pour infraction aux règlements du camp, ou bien un inculpé peut être directement condamné à la prison.
Il existe deux régimes de prison :
● régime ordinaire (OBCHI) ;
● régime strict ou sévère (STROGUI).
Au régime ordinaire, le prisonnier est enfermé dans une cellule pendant 23 heures par jour. Il est autorisé à faire une heure d’exercice ; à écrire une lettre par mois ; à dépenser 3 roubles par mois dans la boutique de la prison et à recevoir deux visites par an (pendant deux heures, sous surveillance, derrière une séparation électrifiée).
Au régime strict ou sévère, il est enfermé 23 heures 30 par jour ; il peut écrire une lettre tous les deux mois et dépenser 2 roubles par mois. Il ne reçoit aucune visite.
Quand un prisonnier arrive en prison, il est d’abord mis au régime strict pendant deux mois, ou six mois s’il a déjà été en prison auparavant. Pour le premier mois, il reçoit une ration alimentaire réduite à – officiellement – 1 200 calories, mais en fait bien inférieure.
● L’EXIL INTÉRIEUR
L’exil intérieur peut être prononcé comme une sentence de jugement ou comme un complément de peine au terme d’un séjour dans un camp de travail ou de prison.
Dans ce cas, il n’y a aucune séparation entre les deux sentences. Le prisonnier est transféré, comme détenu, jusqu’au lieu de son exil, où il est remis entre les mains des autorités locales. Celles-ci lui assignent une ville ou un village où il est assigné à résidence et lui attribuent un travail. Ce dernier est généralement le moins bien payé et le plus pénible qui soit.
Il n’est soumis à aucune autre mesure, sinon de venir régulièrement (chaque semaine ou tous les 15 jours), pointer au commissariat. Mais les autorités locales peuvent venir à n’importe quel moment du jour ou de la nuit pour vérifier si le détenu est bien présent et, éventuellement, effectuer une perquisition à son domicile.
Il peut recevoir autant de visiteurs, de lettres et de colis qu’il désire et, officiellement, ses lettres ne sont pas soumises à la censure. De fait, même les lettres en provenance de l’étranger arrivent pratiquement toutes.
N’importe quel membre de la famille de l’exilé peut venir avec lui, mais il se trouve alors, lui aussi, assigné à résidence. Les autorités locales peuvent éventuellement accorder une permission pour un voyage exceptionnel (au chevet d’un parent mourant, par exemple), mais ceci n’est qu’une faveur et non un droit.
● LES HÔPITAUX PSYCHIATRIQUES
Une autre forme d’emprisonnement consiste en un internement dans un hôpital psychiatrique. Les hôpitaux psychiatriques ordinaires sont administrés par le Ministère de la Santé, mais la police peut y amener pour des « traitements » individuels ceux qu’ils accusent de comportement anormal.
Cette procédure ouvre la porte aux abus de la police, et en particulier du KGB, qui peut ainsi emprisonner des gens sans aucune sorte de procédure légale. Généralement de tels emprisonnements sont de durée relativement courte (quelques jours ou quelques semaines) et ils ont pour but de soustraire les dissidents aux visites de personnalités venant de l’étranger, par exemple, ou à tout autre évènement important. Cependant une telle incarcération peut se prolonger pendant des années.
Ces incarcérations à long terme ont généralement lieu dans des « Hôpitaux Psychiatriques Spéciaux », administrés par le Ministère des Affaires Intérieures, en tant que section du système pénitencier. Ces hôpitaux sont destinés aux criminels atteints de folie et les prisonniers peuvent y être envoyés sur simple décision de la cour.
Un détenu en cours d’instruction peut être envoyé pour examen, soit dans un hôpital psychiatrique ordinaire, soit à l’hôpital de la prison, soit à l’Institut de Psychiatrie Légale Serbsky, à Moscou. Cet institut a la sinistre réputation d’arriver, avec des diagnostics absurdes, à « traiter » des gens parfaitement sains d’esprit. Par exemple, la foi religieuse, considérée en tant que force motrice de la vie d’une personne, est considérée comme un signe d’anormalité psychologique. Enfin, si le prisonnier est déclaré mentalement irresponsable, le tribunal est habilité, sans que l’inculpé comparaisse, à le condamner à un internement à perpétuité dans un hôpital psychiatrique spécial.
Cette forme d’incarcération est la pire de toutes. L’usage de médicaments violents, sans remèdes pour atténuer les effets secondaires, cause généralement des ravages physiques et intellectuels souvent irréversibles.
Des gens sains d’esprit sont placés dans les mêmes salles que des malades réellement fous et souvent violents. Les visites familiales peuvent être arbitrairement supprimées « dans l’intérêt du malade » ou devenir terriblement démoralisantes pour les familles, quand elles voient les effets secondaires des médicaments sur le malade. De plus, ni le prisonnier, ni la famille n’ont aucune idée sur la durée du « traitement ». En théorie, chaque cas est examiné par une commission médicale deux fois par an, mais en fait il ne s’agit que d’une formalité et souvent le prisonnier n’est pas libéré, mais transféré dans un hôpital psychiatrique ordinaire.
(Chrétiens de l’Est, no 41, 1er tr. 1984, pp. 32-35)
II. LA R.S.S.A. de Mordovie
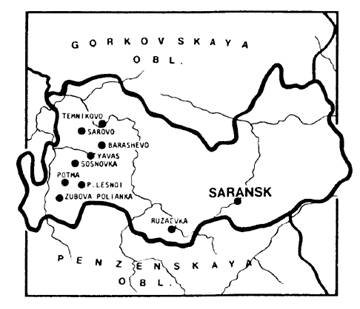
LA R.S.S.A. DE MORDOVIE
(superficie : 26 200 km2 ;
population : 990 000 habitants)
L’histoire des camps mordoviens et de leurs origines au cours des années qui suivirent immédiatement la révolution de 1917, est largement oubliée. En ces jours, on employa de la main-d’œuvre forcée pour construire une route – que jouxta plus tard un chemin de fer spécial – entre Potma et Temnikov. Aucune carte soviétique ne mentionne ces itinéraires ; officiellement, ils n’existent pas. Le long de cette route, dite du Dubrovlag, il n’y a qu’une file de camps de travail, et rien d’autre.
Il y a peu de temps encore, la plupart des camps du Dubrovlag étaient peuplés de prisonniers politiques ; actuellement, cependant, on est en train de transférer ces gens dans les camps de la région de Perm et de l’Oural. On peut néanmoins rencontrer des prisonniers politiques à Sosnovka, à Lesnoi (camp no 19, commandé par le capitaine Boroda), et à Barasevo. Ces camps renferment également des étrangers.
Nous sommes actuellement informés de l’existence, le long de la route du Dubrovlag, de huit camps et d’une prison. Sept de ces camps sont à régime sévère spécial (en fait, il s’agit d’une prison). Les prisonniers de ces établissements, 500 à 2 500 par camp, sont employés à l’abattage, à la manutention et au traitement des grumes, à la fabrication de meubles et de boîtiers de radio, à la construction de machines, à la confection de souvenirs pour l’exportation (horloges à coucou), et à la fabrication de volants et de châssis d’automobiles.
À Barasevo, vous pouvez voir l’hôpital du réseau des camps et un camp de femmes.
Ruzaevka contient une prison de transit pour 1 500 détenus, et un camp à régime ordinaire hébergeant environ 1 200 prisonniers employés dans une usine d’éléments en bois.
À Saransk, on trouve une prison préventive, une prison spéciale du K.G.B. et un camp à régime ordinaire comptant 600 détenus travaillant dans les industries locales.
Des générations entières de prisonniers sont passées dans les camps du Dubrovlag ; parmi elles, des milliers d’étrangers, dont beaucoup avaient été enlevés et transportés en Union Soviétique.
Les détenus du camp à régime « sévère spécial » no 7 revêtent des tenues rayées et numérotées ; ils sont enfermés dans des cellules. Leur travail consiste à polir du verre sur des disques de carborundum dans des ateliers non ventilés. Beaucoup d’entre eux contractent ainsi la silicose.
Beaucoup parmi les prisonniers des camps du Dubrovlag purgent les peines infligées en raison de leurs pratiques religieuses. Les détenus trouvés en possession de textes des Saintes Écritures, de croix ou – dans le cas des Juifs – de calottes rituelles se les voient arracher, puis sont liés par les poignets et jetés en cellule d’isolement.
En 1960, les camps mordoviens furent le théâtre d’une révolte et de grèves. Contrairement à ce qui se passa au terme des révoltes de Kingir, de Noril’sk et des camps de la rivière Vorkuta, où les détenus qui s’étaient rebellés furent fusillés, ici la grève se termina « pacifiquement », par la condamnation de ses « instigateurs » à des prolongations de peine.
(A. Sifrin, « Premier guide des camps
de travail et des prisons en URSS »,
1980, pp. 114-118).