VIE
D’ANNE CATHERINE EMMERICH
PAR
LE PÈRE K. E. SCHMŒGER
DE LA CONGRÉGATION DU TRÈS-SAINT RÉDEMPTEUR
TRADUITE DE L’ALLEMAND
PAR
E. DE CAZALÈS
VICAIRE GÉNÉRAL ET CHANOINE DE VERSAILLES
_______
TOME PREMIER
(1774-1819)
REPRODUCTION OFFSET
D’APRÈS L’ÉDITION ORIGINALE
DE 1868, BRAY et RETAUX
TÉQUI
82, RUE BONAPARTE – PARIS VIe
APPROBATIONS
_______
Le premier volume de l’ouvrage intitulé : Vie d’Anne Catherine Emmerich, par le P. Schmœger, de la congrégation du Très-Saint-Rédempteur, qui nous a été présenté en manuscrit, ne contenant rien de contraire à ce qu’enseigne l’Église catholique, quant au dogme et à la morale, mais, au contraire, paraissant plutôt propre à affermir la foi et à exciter la piété, nous lui accordons avec plaisir l’approbation demandée par l’auteur.
Limbourg, le 26 septembre 1867.
PIERRE-JOSEPH
Évêque de Limbourg.
_______
Nous autorisons M. l’abbé de Cazalès, notre vicaire général et chanoine de notre cathédrale, à faire imprimer sa traduction de la Vie d’Anne Catherine Emmerich, publiée en Allemagne par le R. P. Schmœger, de la congrégation du très saint Rédempteur, avec l’approbation de Mgr l’Évêque de Limbourg.
Versailles, le 18 janvier 1868.
PIERRE, Évêque de Versailles.
NOTE DE L’ÉDITEUR
C’est un précieux privilège pour un éditeur de faire connaître des auteurs comme Anne-Catherine Emmerick maintenant célèbre dans le monde entier par ses Visions traduites dans un grand nombre de langues. Celles-ci se présentent comme un commentaire vivant et passionnant de la vie de Jésus mais aussi des principaux personnages de l’Ancien Testament, auxquels elle rendait visite en compagnie de son ange gardien.
Anne-Catherine a reçu des grâces extraordinaires que Jean Guitton a longuement analysées dans la postface accordée au livre de mademoiselle Loutrel, Jésus parmi les siens. Tout naturellement, A.-C. Emmerick remontait le cours de l’histoire en décrivant tout le passé et son regard avait en même temps la possibilité de discerner prophétiquement les évènements futurs.
Anne-Catherine Emmerick fut incontestablement une des plus grandes mystiques du XIXe siècle, comme le disait Raïssa Maritain. Sans jamais quitter son grabat de Dülmen, elle parcourait la planète et son corps participait aux fatigues de ces voyages.
La Vie d’Anne-Catherine Emmerick étant épuisée, nous désirons répondre aux nombreuses demandes de nos lecteurs en la rééditant une nouvelle fois. Elle est d’un très grand intérêt, car si Anne-Catherine Emmerick est surtout connue par ses célèbres Visions éditées en 1864 chez Bray, prédécesseur de Téqui, sa Vie écrite par le même auteur, le père Schmœger, o.s.r., éditée chez Bray en 1868, contient un très grand nombre de faits et de visions précises qu’on ne trouve nulle part ailleurs.
Le procès de béatification de Catherine Emmerick a été introduit à Rome en 1892 et repris récemment en 1973. Il se poursuit très activement. Nous offrons donc cette nouvelle édition en hommage reconnaissant à celle qui a tant aimé le Seigneur, lui vouant toute sr : vie et pénétrant tellement dans son intimité, que toutes ces pages sont des témoignages de tout ce qu’elle a vu, entendu et ressenti dans son cœur, témoignages confiés à Clemens Brentano, le pèlerin de Dülmen.
*
* *
En ce qui concerne les Visions d’Anne-Catherine Emmerick, nous pensons utile de reproduire ici les précieuses indications données par mademoiselle M.-T. Loutrel dans l’ouvrage intitulé Anne-Catherine Emmerick racontée par elle-même et par ses contemporains.
Alors qu’elle était encore toute petite, debout entre les genoux de son père, elle lui relatait d’une façon très vivante et précise toutes sortes d’histoires bibliques ; et comme il n’avait jamais rien vu ni entendu de semblable et raconté de cette façon, il se mettait à pleurer.
« Ses grosses larmes tombaient sur moi et il me disait : Enfant, d’où tiens-tu tout cela ? Et je lui répondais : Père, c’est ainsi, je le vois ainsi. Sur quoi, il devenait silencieux et ne disait plus rien ».
Elle raconte encore : « J’ai eu ces visions non seulement la nuit mais encore en plein jour, dans les champs, à la maison, en marchant, en travaillant, en me livrant à toutes sortes d’occupations. Comme une fois, à l’école, je disais tout naïvement d’autres choses que celles qu’on nous enseignait sur la résurrection, et cela avec assurance, croyant que tout le monde devait savoir cela comme moi, les autres enfants stupéfaits se moquèrent de moi et portèrent plainte au magister qui me défendit sévèrement de me livrer à de pareilles imaginations. Mais je continuai à avoir ces visions sans en rien dire ; j’étais comme une enfant qui regarde des images et qui s’en rend compte à sa manière, sans trop demander ce que signifie ceci ou cela. »
C’est bien plus tard, dans les dernières années de sa vie, alors qu’elle était littéralement crucifiée et dans des douleurs sans nom du corps et de l’âme qu’Anne-Catherine racontait à Clemens Brentano ces frais souvenirs de son enfance :
Je pensais que les visions que j’avais étaient mon livre d’images et je les contemplais en paix. En fait de choses spirituelles, je n’ai jamais rien cru d’autre que ce que le Seigneur Dieu a révélé et qu’il propose à notre croyance dans la sainte Église catholique, que ce soit expressément écrit ou non. Et jamais je n’ai cru selon le même degré de foi ce que j’ai vu dans mes visions ; je les considérais sur le même plan que ces crèches de Noël, toutes différentes les unes des autres, devant lesquelles j’allais çà et là me recueillir, sans me troubler de ce que toutes n’étaient pas faites sur le même modèle, et dans chacune d’elles, c’est toujours le même Enfant-Jésus que je prie.
AVANT-PROPOS DU TRADUCTEUR
_______
C’est sur l’obligeante invitation du R. P. Schmœger que celui qui écrit ces lignes a entrepris de traduire en français la Vie d’Anne Catherine Emmerich, publiée tout récemment en Allemagne 1. On lui pardonnera de mentionner cette circonstance qui prouve que ses traductions précédentes ont été jugées suffisamment fidèles de l’autre côté du Rhin et qui lui permet, à certains égards, de placer son nouveau travail sous le patronage du juge le plus compétent et le plus intéressé dans la question. Le traducteur ne juge pas nécessaire de faire précéder le présent volume d’une introduction ou d’une préface, le père Schmœger ne lui ayant rien laissé à dire sur les raisons qui ont déterminé le savant religieux à écrire cette nouvelle biographie de la sœur Emmerich, sur les circonstances qui en ont retardé pendant des années l’achèvement et la publication, sur les documents nombreux, inconnus à Clément Brentano lui-même, qui lui ont servi de base, enfin sur les caractères particuliers qui la distinguent.
Il croit pourtant devoir dire quelques mots sur le genre d’utilité que peut avoir un livre comme celui-ci dans un moment où ce qu’on appelle « la question du surnaturel » préoccupe et passionne les esprits les plus divers. Il ne se propose nullement de traiter la question en elle-même, car il faudrait pour cela un travail approfondi dont ce n’est pas ici la place. Il veut seulement appeler l’attention du lecteur sur la conduite que tient l’Église catholique quand elle se trouve en présence de faits présumés surnaturels : or, rien n’est plus propre à en donner une idée juste et claire que la biographie d’Anne Catherine Emmerich. Qu’y voyons-nous en effet ? Des phénomènes fort extraordinaires, notamment celui de la stigmatisation, se produisent chez une pauvre religieuse, jetée sur le pavée, si l’on peut s’exprimer ainsi, par suite de la suppression de son couvent. Malgré ses efforts pour cacher ces phénomènes, la petite ville de Dulmen qu’elle habite en a bientôt connaissance et ils deviennent le sujet de toutes les conversations. Le vicaire général capitulaire, administrateur du diocèse de Munster où le siège épiscopal est vacant depuis des années, est à peine informé de ce qui se passe qu’il arrive inopinément à Dulmen, pour dévoiler l’imposture, s’il y en a une, ce qu’il est tout d’abord porté à croire. Frappé de ce qu’il voit, mais non encore convaincu, il ordonne aussitôt une enquête dirigée par des prêtres expérimentés et des médecins habiles. Cette enquête, dont le compte-rendu remplit une grande partie du présent volume, dure longtemps, et elle est conduite avec une sévérité qui va presque jusqu’à la cruauté. La pauvre malade est soumise à l’examen le plus rigoureux, non seulement sur son état actuel, mais sur toute sa vie antérieure ; ses plaies sont bandées et mises, en quelque sorte, sous les scellés, ce qui amène pour elle des souffrances indicibles. On la met en surveillance, pendant dix jours, sous la garde de vingt bourgeois notables de Dulmen qui se relayent jour et nuit auprès de son lit : enfin on ne lui épargne aucune torture physique et morale. Et quand on est arrivé au terme, quand tous les rapports ont été faits, tous les procès-verbaux dressés, croit-on que les supérieurs ecclésiastiques vont crier au miracle, proclamer comme une œuvre divine les faits merveilleux qu’ils ont constatés de la manière la plus certaine ? Telles ne sont pas les habitudes de l’Église. L’enquête a prouvé jusqu’à la dernière évidence qu’il n’y a là ni fraude ni illusion : c’était tout le résultat auquel le vicaire général voulait arriver. Quant aux stigmates et aux autres phénomènes extraordinaires, il incline à penser qu’ils ont une cause surnaturelle, mais il ne va pas plus loin ; c’est pour lui une probabilité, rien de plus.
Il faut bien reconnaître que c’est là de la prudence et de la discrétion ; mais, quelque part qu’il y ait à faire au caractère personnel du vicaire général de Munster, on doit en faire honneur avant tout aux règles de conduite tracées par l’Église. Tout autre, en pareil cas, aurait fait comme lui, se serait considéré, non comme un juge, mais comme un simple rapporteur, ayant tout au plus une opinion à exprimer. Il n’y a qu’un juge qui puisse prononcer en matière de faits surnaturels et miraculeux ; c’est l’Église universelle, par l’organe de son chef suprême, lorsqu’il rend des décrets de béatification ou de canonisation. Hors de là, quelques fortes que soient les présomptions en faveur de la sainteté d’un serviteur ou d’une servante de Dieu, quelque surprenants que soient les faits qui se rencontrent dans sa vie, on raconte ces faits sans les qualifier, ou du moins on n’attribue aux qualifications qu’on leur donne qu’une autorité purement humaine. C’est ce que fait le père Schmœger pour sa Vie d’Anne Catherine Emmerich, en déclarant dans sa préface qu’il entend se conformer en tout aux décrets du pape Urbain VIII sur ces matières.
Ceci dit, il est permis de faire observer que les faits exposés dans la biographie de la sœur Emmerich, quelque jugement qu’on porte sur leur nature et leurs causes, sont au moins fort étonnants et fort extraordinaires, qu’il s’agit ici, non d’une légende remontant à une obscure antiquité et, pour laquelle manquent les moyens de contrôle, mais de choses qui se sont passées en plein XIXe siècle et attestées par une masse de témoins dont la véracité est au-dessus du soupçon. Ce livre aura donc pour tout le monde au moins un intérêt de curiosité, et, de plus, il édifiera les lecteurs pieux en leur présentant l’histoire d’une grande et belle âme et d’admirables exemples de toutes les vertus chrétiennes.
La publication du second et dernier volume, qui sera peut-être plus intéressant encore que le premier ne se fera pas attendre. D’après la dernière lettre du père Schmœger, il ne tardera pas à être mis sous presse et peut-être y est-il déjà. Le traducteur fera de son mieux pour qu’il puisse être offert au public français dans le plus bref délai possible.
_______
PRÉFACE ET INTRODUCTION
_______
Lorsque l’auteur de la présente biographie publia, il y a huit ans, le dernier volume de la Vie de notre divin Sauveur d’après les visions d’Anne Catherine Emmerich, il promit d’y donner pour complément, aussitôt que possible, un récit de la vie de la servante de Dieu emprunté aux sources les plus authentiques. Mais des devoirs d’état, des maladies, des empêchements de toute espèce qu’il n’était pas en son pouvoir d’écarter, sans parler des difficultés que présentait le travail lui-même, en ont retardé la publication jusqu’à ce jour. Si Clément Brentano, qui avait résidé à Dulmen depuis l’automne de 1818 jusqu’au mois de février 1824 et qui avait noté jour par jour ses observations sur Anne Catherine, n’a pas voulu plus tard s’imposer la tâche de donner le tableau complet de cette vie si simple extérieurement et si peu faite pour frapper les yeux, mais si riche, si variée, si extraordinaire quant à sa signification intérieure, personne ne reprochera à celui qui écrit ces lignes de n’avoir pas été plus tôt en mesure de livrer le présent volume à la publicité. Il se serait même trouvé satisfait de la courte esquisse biographique dont Clément Brentano a fait précéder, en 1833, sa première édition de la Douloureuse Passion, si un ami bien cher, dont le souvenir ne s’éteindra jamais dans son cœur, le docteur Krabbe, doyen de la cathédrale de Munster, qui a si bien mérité de son pays natal, ne lui avait procuré, avec la faculté d’en faire l’usage qu’il lui plairait, la communication de tous les actes originaux de l’enquête ecclésiastique à laquelle Anne Catherine fut soumise en 1813 et s’il ne l’avait plus tard accompagné à Dulmen, à Coesfeld et à Flamske, pour y recueillir de la bouche du petit nombre des contemporains encore vivants d’Anne Catherine et de ceux qui l’ont connue particulièrement des renseignements malheureusement bien incomplets sur sa vie. La reconnaissance lui fait encore un devoir de mentionner les peines qu’a bien voulu se donner M. Aulike, conseiller intime de régence à Berlin, mort aussi depuis, pour rechercher partout et transmettre à l’auteur les notices et particulièrement les brochures ayant trait à Anne Catherine publiées depuis l’an 1813. Ces deux hommes étaient pleins d’une vénération touchante pour la servante de Dieu et attendaient avec impatience la publication de sa biographie qu’ils n’étaient pas destinés à voir paraître de leur vivant.
Grâce au dépouillement consciencieux des actes de l’enquête, lesquels n’avaient jamais passé sous les yeux de Clément Brentano, il a été possible à l’auteur d’appuyer son récit sur des témoignages d’un tel poids qu’on n’en peut trouver de plus concluants dans la biographie d’aucune personne favorisée de grâces semblables. Les riches matériaux fournis par ces documents lui ont aussi ouvert la voie à une intelligence plus approfondie de la mission de la sœur Emmerich : car il y a reconnu avec certitude la reproduction d’un fait dont l’importance est généralement admise dans l’Église et qui a été plusieurs fois observé et apprécié dans chaque siècle, fait consistant en ce que Dieu, dans tous les temps, a choisi certaines âmes qui, soit dans une retraite cachée à tous les regards, soit publiquement et sous les yeux du monde, lui ont servi d’instruments destinés à souffrir et à combattre pour son Église et pour la sainte foi catholique. Les circonstances de la vie extérieure de ces personnes sont quelquefois très dissemblables, et leurs souffrances elles-mêmes ont un caractère par lequel elles diffèrent complètement les unes des autres. Ainsi, par exemple, Lidwine de Schiedam ou de nos jours Domenica Lazzari se montrent avant tout comme de pures victimes corporelles, semblables aux anciennes vierges martyres, tandis que d’autres, comme Madeleine de Pazzi ou Colombe de Rieti, combattent et souffrent pour l’Église d’une manière spirituelle ; mais toutes se ressemblent en ce point que leur vie est un sacrifice continuel, une souffrance sans interruption où tout est abandonné sans réserve à la conduite et aux desseins de Dieu. Par leurs souffrances, elles doivent expier ou faire pénitence à la place des coupables pour les manquements qui ont eu lieu dans l’Église et le dommage qu’elle a éprouvé par la faute des différentes classes de personnes dont elle se compose. Par leurs prières et leurs supplications, ou plutôt par un don extraordinaire de la grâce qui fait de leur prière une action, elles ont à détourner les tribulations et les dangers qui menacent l’Église, son chef, telle ou telle de ses parties et des personnes qui y tiennent une place, à obtenir pour les pécheurs la grâce de la conversion, pour les égarés et les faibles la pureté et la fermeté de la foi, pour les pasteurs et les gardiens l’intrépidité et le zèle infatigables ; enfin elles ont à lutter pour les âmes qui se perdraient par la négligence des pasteurs. Outre la tâche de prière et d’expiation, il y a encore la tâche militante qu’ont à remplir des âmes favorisées de dons extraordinaires. Celle-ci consiste à prendre sur sa personne des dangers menaçant l’âme et le corps, des maux, des tentations, l’entraînement à certains péchés : ici donc, ce n’est plus simplement une souffrance ou un sacrifice dont les fruits doivent profiter à autrui, il s’agit de s’exposer personnellement à un danger déterminé menaçant le corps ou l’âme ; il s’agit de prendre complètement sur soi un mal, une maladie, une attaque ou une tentation, ce qui exige, de la part de celui qui se substitue, le combat réel et la victoire complète au profit de ceux desquels il a détourné le danger ou le mal. Un des exemples les plus grandioses et les plus frappants de ce combat à la place d’autrui se trouve dans l’action de Judith qui alla au-devant d’Holopherne et de ses hordes pour empêcher la profanation du sanctuaire et l’opprobre du peuple de Dieu.
Même quand chez certains de ces privilégiés, il peut sembler que la prière est leur tâche unique ou principale, ce n’est pourtant pas d’une manière exclusive, car le martyre de la pénitence accomplie par l’innocent est précisément ce qui fait que la prière est surabondamment exaucée et obtient pour l’Église de si riches bénédictions. La tâche d’expier et celle de combattre ne sont jamais séparées l’une de l’autre et toutes deux, comme celle de prier, se rencontrent avec une étendue vraiment surprenante dans la vie de la sœur Emmerich. Elle y fut préparée par Dieu dès sa plus tendre enfance ; bien plus, le commerce avec son ange gardien, l’intuition d’un autre monde, en un mot le don de contemplation commencèrent pour elle dès le premier jour de sa vie, afin qu’aucun instant de la courte durée de son existence ne restât inutile. Trois grands maux faisaient courir des dangers terribles à l’Église à l’époque où vécut Anne Catherine ; savoir, la profanation de toutes les choses saintes, les fausses doctrines et la corruption des mœurs ; elle leur fut opposée par Dieu pour les combattre sans relâche par la prière, par l’expiation et par des luttes incessantes, et pour venir au secours de l’Église livrée pour ainsi dire sans défense à ces ennemis.
Tous les fidèles se sentiront consolés et fortifiés en trouvant dans la vie de cette servante de Dieu tant de preuves de la miséricorde avec laquelle le Seigneur, à une époque si remplie de tribulations, vint en aide à son Église, et en voyant quel instrument sa sagesse s’était préparé dans la pauvre petite bergère de Flamske. C’est cette vue qui a encouragé l’auteur à reprendre sans cesse une œuvre si souvent interrompue par des dérangements de toute espèce et à n’épargner aucune peine pour arriver à bien comprendre cette vie si simple et si pauvre pour qui n’en voit que l’extérieur, par la comparaison de tous les faits qui s’y produisent avec ceux que présente la vie de quelques autres personnes favorisées de grâces semblables.
Ceux des lecteurs que leurs études ont familiarisés avec les principes posés par Benoît XIV et avec les grandes autorités théologiques aux décisions desquelles ce savant Pape se réfère habituellement dans son ouvrage De servorum Dei beatificatione reconnaîtront bientôt, sans qu’il soit besoin de citer ces autorités, que l’auteur a pris sa tâche au sérieux, et ils conviendront sans doute avec lui que la vie d’Anne Catherine est un modèle frappant des qualités et des vertus exigées par les sévères prescriptions de l’Église comme marques et preuves de la vérité, là où il s’agit de grâces extraordinaires.
Comme on a vu de nos jours se produire bien des imposteurs et des hypocrites soi-disant favorisés de dons extraordinaires, lesquels ont parfois trouvé créance chez beaucoup de personnes, l’auteur a cherché à reproduire aussi fidèlement que possible jusqu’aux moindres des renseignements sur Anne Catherine qu’il a pu trouver dans les documents mis à sa disposition. Il en est résulté pour cette biographie beaucoup de développements et une grande abondance de détails ; mais cela même lui vaudra un accueil d’autant plus favorable de la part des lecteurs qui veulent se former une opinion sûre quant à la vérité ou à la fausseté des voies et des grâces extraordinaires.
L’ami le plus dévoué de Clément Brentano, M. Édouard Steinle, a dessiné le portrait dont la gravure est placée en tête de ce volume, d’après des dessins à la plume esquissés à différentes époques par Brentano lui-même pendant les années qu’il a passées à Dulmen près du lit de douleurs de la sœur Emmerich. M. Steinle a réussi à rendre avec une grande fidélité les traits de la pieuse fille, comme le prouve la profonde émotion dont se sont trouvées saisies à la première vue de ce portrait des personnes qui autrefois avaient eu des relations fréquentes avec Anne Catherine.
En terminant, l’auteur déclare qu’il se soumet entièrement aux décrets d’Urbain VIII, en date du 13 mars 1625 et 5 juin 1634, et par conséquent ne prétend attribuer à tous les faits et incidents extraordinaires rapportés dans le présent livre qu’une crédibilité purement humaine.
Du couvent de Gars sur l’Inn (Bavière), le 17 septembre 1867.
P. SCHMŒGER.
VIE
D’ANNE CATHERINE EMMERICH
___________________________________________
I
MŒURS ET COUTUMES POPULAIRES EN WESTPHALIE AU COMMENCEMENT DE CE SIÈCLE.
1. On lit sur le registre baptismal de la paroisse Saint-Jacques, à Coesfeld : « Le 8 septembre 1774 a été baptisée Anne Catherine, fille de Bernard Emmerich et d’Anne Hillers, son épouse. Les parrains ont été Henri Huning et Anne Catherine Heynick, femme Mertens. » Le jour du baptême était aussi le jour de la naissance. Des neuf enfants qu’eurent ses parents, Anne Catherine fut le cinquième. Il y avait en tout six frères et trois sœurs : le plus jeune des frères, Gérard, resté célibataire, vivait encore en septembre 1859, lorsque l’auteur de la présente biographie visita le lieu de naissance d’Anne Catherine, au hameau de Flamske, près de Coesfeld. Ce Gérard ne sut rien lui dire, si ce n’est que sa sœur avait été une nonne d’un excellent cœur, mais éprouvée par des souffrances continuelles, et qu’il était allé la voir souvent à Dulmen. « Elle était, ajouta-t-il, toujours si bonne et si aimable pour moi et nos autres frères et sœurs que c’était toujours pour nous une grande joie de pouvoir aller la visiter à Dulmen. »
2. Le vieux et respectable pasteur de l’église de Saint-Jacques, M. Hilswitte, vivait encore : il se souvenait d’avoir vu Anne Catherine, pour la dernière fois, en l’an 1812. Il rendit témoignage qu’elle avait toujours passé pour une personne très estimable : mais les circonstances particulières de sa vie ne lui étaient pas connues. Il avouait qu’à l’époque où s’étaient produits les phénomènes extraordinaires signalés chez Anne Catherine, on n’était guère en état de comprendre les choses de ce genre, en sorte que peu de prêtres avaient cherché à prendre connaissance de ce qui la concernait et des circonstances de sa vie. De là était venu, selon lui, qu’Anne Catherine, après sa mort, avait été plus vite oubliée dans sa patrie que dans d’autres pays où Clément Brentano et l’évêque Wittmann avaient appelé sur elle l’attention et l’intérêt. Plusieurs années avant sa mort, elle-même s’était exprimée en ces termes : « Ce que le pèlerin recueille, disait-elle, il l’emportera loin d’ici, car ici il n’y a aucune disposition à en profiter. Là-bas cela fera son effet et cet effet reviendra de là se faire sentir jusqu’ici. »
3. La petite maison où elle était née se trouvait encore, en 1859, dans le même état où Clément Brentano l’avait trouvée quarante ans auparavant. C’est une vieille petite grange, où hommes et bêtes vivent paisiblement ensemble et où le fourrage et les grains qu’on y ramasse recouvrent les compartiments, séparés par de méchantes cloisons en planches, où les divers habitants de la maison prennent leur repos. La porte vermoulue s’ouvre sur une petite pièce sans autre pavé que de la terre battue et qui sert de chambre commune. Là se trouve la cheminée, sous cette forme simple et primitive qui n’exige rien de plus qu’une pierre ou une plaque de fer encastrée dans la terre glaise, pour y allumer le feu, et une barre de fer pour pendre la chaudière. La fumée est libre de sortir par une ouverture quelconque du toit ou de la muraille et de laisser autant de suie qu’il lui convient sur la charpente et le mobilier de la grange. Autour du foyer on voit quelques vieilles chaises et une vieille table dont l’apparence doit faire croire qu’elles servaient déjà aux parents de notre Anne Catherine. À gauche de cette pièce sont les cloisons en planches formant les compartiments qui servent de chambres à coucher : le reste est livré aux vaches qui ne sont séparées des habitants appartenant à l’espèce humaine que par quelques perches et par leurs mangeoires. Plus tard on a adjoint au bâtiment principal une maisonnette contenant deux pièces qui servent de chambres. Devant cette maisonnette, s’élèvent encore quelques vieux chênes, ombrageant la petite pelouse qui a été le premier théâtre des jeux de la merveilleuse enfant.
4. Écoutons maintenant ce que dit Clément Brentano de la visite qu’il fit à la maison paternelle d’Anne Catherine, lorsque celle-ci vivait encore, et de ce qu’étaient à cette époque les mœurs et les coutumes populaires du pays de Munster :
« J’allai à trois lieues de Dulmen, au hameau de Flamske, pour visiter la maison paternelle d’Anne Catherine, qu’habite maintenant son frère aîné Bernard Emmerich avec sa femme et ses enfants. Cet endroit dépend de la paroisse Saint-Jacques, à Coesfeld, ville éloignée d’une demi-lieue. Je voulais voir la place où elle est née et où a été son berceau. Je trouvai une grange délabrée, avec des murs de terre et un vieux toit de chaume tout couvert de mousse. Étant entré par une porte souvent rapiécée qui était entrouverte, je me trouvai au milieu d’un nuage de fumée où je pouvais à peine distinguer quelque chose à un pas devant moi. Le frère d’Anne Catherine et la femme de celui-ci me saluèrent avec un peu de surprise, mais très amicalement, lorsque je leur portai les compliments de leur sœur : les enfants, d’abord effarouchés, s’approchèrent sur l’ordre de leur père et baisèrent leurs petites mains pour me saluer. Dans l’espace compris entre les quatre murs de la maison, je ne vis pas de chambre ou d’endroit auquel on put donner ce nom : cependant il y avait un coin séparé où se trouvait le grossier métier à tisser de l’un des frères ; quelques vieux coffres noircis par la fumée laissaient voir, quand on les ouvrait, de grands cadres pleins de paille sur lesquels étaient quelques coussins de plume. C’était là qu’on dormait. Du côté opposé, le bétail regardait derrière des pieux.
« Le mobilier et les ustensiles sont posés ou accrochés à l’entour : à la charpente qui soutient le toit sont suspendus de la paille, du foin, de l’étoupe noircis par la fumée et la suie, et il y avait partout tant de fumée qu’on ne voyait pas au travers. C’était dans cette sombre atmosphère, au milieu de ce désordre et de cette pauvreté qu’était née et qu’avait été élevée cette créature si pure, si éclairée, si riche des dons de l’intelligence : c’est là et non ailleurs qu’elle se conserva innocente dans ses pensées, ses paroles et ses actions. Je me souvins de la crèche de Bethléem. Je mangeai devant la porte, sur un bloc de bois, du gros pain bis 2, du beurre et du lait. Le pieux Bernard Emmerich ne prononçait pas un mot sans y ajouter « avec l’aide de Dieu ». Je pris une vieille image de la sainte Vierge, tout enfumée et toute déchirée, qui était attachée à la porte de l’endroit où Anne Catherine prenait son repos, et je leur en donnai une autre à la place. Je cueillis ensuite quelques rejetons de chêne sous les deux grands arbres qui s’élèvent devant la chaumière : puis je pris congé de ces bonnes gens qui me dirent que j’étais la première personne qui fût venue pour voir le lieu de naissance d’Anne Catherine.
« J’allai une demi-lieue plus loin, à Coesfeld, pour voir la place où elle avait reçu les stigmates de la couronne d’épines.
« C’est dans cette ville qu’elle a été baptisée, à l’église paroissiale de Saint-Jacques, le 8 septembre 1774. Ce jour de la Nativité de Marie a été celui de sa naissance 3. Je visitai avec beaucoup d’émotion cette vieille et belle église : j’allai ensuite chez le curé Hartbaum qui lui a fait faire sa première communion. Je trouvai en lui un vieillard vert et robuste, mais qui ne me parut pas apprécier à sa valeur son ancienne paroissienne. Le vif intérêt que je prenais à elle avait pour lui quelque chose d’étrange et il semblait être de ces hommes qui n’ont d’autre désir que de voir toutes choses rester comme par le passé ou plutôt suivre ce train de chaque jour où rien ne dépasse la portée de leur vue. Je visitai aussi la principale église paroissiale, celle de Saint-Lambert, où l’on honore la croix miraculeuse, dite croix de Coesfeld, devant laquelle Anne Catherine a beaucoup prié dès sa plus tendre jeunesse et reçu de Dieu des grâces de toute espèce. Suivant la tradition, cette croix est venue de la Palestine au VIIIe siècle et elle a la forme fourchue de celle qu’Anne Catherine elle-même porte empreinte sur l’os de la poitrine. C’est dans cette église qu’elle a été confirmée. – J’allai ensuite à l’église des Jésuites, dans laquelle, à l’âge de vingt-quatre ans (en 1798 probablement), elle priait très dévotement devant un crucifix, dans la tribune de l’orgue, lorsque vers midi la couronne d’épines lui fut posée sur la tête par une apparition de son fiancé céleste.
« J’éprouvais un sentiment de tristesse qui gâtait pour moi l’impression de cette belle église en pensant : que la petite communauté protestante d’une centaine de personnes qui s’est formée ici, depuis qu’un comte de Salm médiatisé y a fixé sa résidence, a sa table de communion dressée devant l’autel où sortit du tabernacle l’apparition du Sauveur qui présenta la couronne d’épines à Anne Catherine ; qu’on annonce ici, dans la chaire, la fête de la Réformation, triomphe de l’apostasie ; que cet orgue riche et élégant, dans la tribune duquel elle reçut cette grâce pendant sa prière, a été rejeté comme n’étant pas d’assez bon goût et remplacé par un buffet d’orgue à la mode du jour. L’église maintenant sert simultanément aux catholiques et aux protestants.
« On m’a dit que la comtesse cherchait à en chasser tout à fait les catholiques, quoiqu’elle soit propriétaire de l’église et du cloître des capucins, situés à deux cents pas, et que le cloître serve d’habitation à ses gens. Elle se serait plainte, dit-on, d’être incommodée par le son des cloches et les prières matinales des catholiques dans l’Église des Jésuites. Cette église, par l’unité de sa décoration intérieure et par l’ensemble harmonieux des élégantes sculptures en bois qui ornent les autels, le banc de communion et le vieux mobilier, est une des plus tranquilles et des plus favorables au recueillement que j’aie jamais vues, bien qu’elle ne soit pas très élevée. À chaque place de l’église, on croit s’agenouiller sur le bord d’un riche tapis descendant du tabernacle et la couvrant tout entière. Aussitôt que cette église, qui peut contenir deux mille personnes, appartiendra uniquement aux cent protestants, ils jetteront dehors tous les autels et les objets artistement travaillés qui ne leur paraissent pas de bon goût et qui pourraient leur rappeler trop souvent la grande habileté et la piété du frère Jésuite qui y a consacré tant de travail et de fatigue en l’honneur de Dieu vivant dans le saint Sacrement.
« Quand la bonne Anne Catherine était enfant, Coesfeld était sa Jérusalem. C’était là qu’elle visitait tous les jours le Dieu vivant dans le saint Sacrement ; c’était de ce côté qu’elle regardait avec amour lorsqu’elle priait en travaillant aux champs ou en gardant son troupeau ; c’était dans cette direction qu’elle tournait son visage lorsqu’elle priait la nuit dans la campagne. C’était de là que le son des cloches du petit couvent des Annonciades, qui avait éveillé de bonne heure ses aspirations vers le cloître, arrivait à l’oreille de la petite paysanne pendant ses travaux rustiques. J’ai vu ce couvent des Annonciades désert et dévasté.
« À Coesfeld, elle a pendant plusieurs années travaillé comme couturière chez une personne pieuse ; puis, pendant trois ans, servi un chantre pour apprendre à jouer de l’orgue et pouvoir entrer par ce moyen dans un couvent. C’est de là aussi qu’elle alla au couvent. Il n’est point étonnant qu’elle prenne un vif intérêt à cet endroit et s’afflige profondément de voir dans ses visions les vieux sentiments catholiques de respect et de crainte de Dieu s’effacer à bien des égards dans cette petite ville et même chez plusieurs de ses prêtres, par suite du progrès des prétendues lumières et des rapports avec les protestants.
« Elle y voit diminuer la simplicité et la régularité des mœurs, et malheureusement on entend aussi des personnes pieuses de l’ancienne roche gémir souvent sur certains désordres. Du reste, il règne encore de la piété et une grande pureté de mœurs dans le pays de Munster pris en général.
« Ce qui conserve encore dans la jeunesse la fidélité envers Dieu, c’est moins l’instruction que la conscience et l’esprit de foi qui les fait recourir aux remèdes que leur offre l’Église catholique. Je n’ai trouvé l’Écriture sainte chez aucun laïque ; on n’entend pas citer la Bible à tout propos, mais on voit pratiquer ce qu’elle enseigne. La piété des paysans, leur vie réglée suivant les prescriptions de l’Église catholique sont elles-mêmes des textes de la Bible. Une instruction populaire plus appropriée à l’époque a commencé avec la génération actuelle, au moyen des instituteurs et des institutrices formés à l’école d’Overberg, lequel est honoré dans tout le pays comme un père et comme un saint. Je n’ai rencontré personne qui ne se soit montré plein de reconnaissance pour les travaux d’Overberg, mais personne non plus qui m’ait affirmé que les gens étaient devenus par là plus pieux que leurs pères. Tous étaient bien plus touchés de la simplicité, de la piété et de la charité d’Overberg qu’enthousiasmés de ses œuvres. La sœur Emmerich, qui est remplie de la plus profonde vénération pour Overberg, m’a souvent dit avoir le sentiment, confirmé par ses visions, que les vieux maîtres d’école de village, si pauvres, si laborieux, obligés, pour gagner leur vie, de faire en outre le métier de tailleurs, recevaient plus abondamment de Dieu la grâce d’élever pieusement l’enfance que les nouveaux instituteurs des deux sexes avec la petite vanité qu’ils tirent souvent de l’examen qu’ils ont passé. Chaque œuvre produit son fruit suivant une certaine mesure : mais quand l’instituteur trouve dans son œuvre une jouissance, un sentiment personnel, il consomme en quelque sorte pour son propre usage une partie de ce fruit de bénédiction qui lui est attribué. C’est ce qui arrive maintenant sans qu’on puisse s’en apercevoir au dehors. Les instituteurs se disent : « Nous enseignons bien », les enfants : « Nous apprenons bien », les parents se réjouissent de ce que leurs enfants sont instruits et avisés : dans tous naît un effort pour briller de plus en plus et pour se donner l’importance. Certainement on lit et on écrit beaucoup mieux qu’autrefois : mais avec cet accroissement de capacité, l’ennemi sème journellement plus de mauvaise herbe dans la voie, et la piété et la vertu diminuent de jour en jour.
« J’ai trouvé la source de la pureté de mœurs et de la dévotion qui vivent encore dans le pays de Munster bien plus dans le fidèle attachement à la foi traditionnelle, dans l’imitation de la vertu des pieux parents, dans le grand respect pour les prêtres et leur bénédiction, dans la fréquentation de l’Église et l’usage habituel des sacrements, que dans l’extension de l’instruction. Je ne puis oublier comment un matin, de très bonne heure, passant près d’une haie, j’entendis une voix d’enfant : je m’approchai tout doucement et je vis une petite bergère en haillons, d’environ sept ans, qui marchait derrière quelques oies dans une prairie, une baguette de saule à la main. Elle disait avec un accent inimitable de piété et de sincérité : « Bonjour, cher seigneur Dieu ! Loué soit Jésus-Christ ! Bon père qui êtes dans le ciel ! Je vous salue, Marie, pleine de grâce ! Je veux être bonne, je veux être pieuse ! Bons saints du paradis, bons anges, je veux être bonne. J’ai un morceau de pain à manger, je vous remercie pour ce cher pain ! Ah ! protégez-moi aussi pour que mes oies n’aillent pas dans les blés, et que quelque méchant garçon n’en tue pas quelqu’une à coups de pierre ! Protégez-moi donc, je veux être une bonne fille, cher Père qui êtes au ciel ! »
« Certainement la pauvre enfant avait composé cette prière avec de vieilles prières conservées par la tradition dans les familles. Une maîtresse d’école moderne aurait difficilement toléré chez l’enfant une prière ainsi faite.
« Quand je songe au peu d’instruction et aux façons rustiques de bien des prêtres, quand je vois tant d’églises où l’on ne s’inquiète ni du bon ordre, ni de la décoration convenable, ni de la propreté, ni même de la décence dans le culte divin ; quand je pense que tout le peuple parle le patois bas-allemand et que, depuis quelques années, l’instruction doit être donnée et la prédication faite en haut-allemand, ce qui fait qu’elles arrivent difficilement au cœur des auditeurs ; quand je considère l’éducation simple jusqu’à la grossièreté de la plupart des enfants, et qu’avec tout cela je constate journellement la pureté, l’innocence, la foi pieuse, le sens droit des moindres de ces gens et leur aptitude à comprendre beaucoup de choses très profondes, je sens très vivement que le Seigneur et sa grâce sont plus vivants dans son Église que dans la parole et l’écriture ; car ils y existent et y vivent avec une force créatrice dans les saints sacrements, lesquels se perpétuent et se renouvellent éternellement par la vertu sacrée et merveilleuse que Dieu a attachée à la consécration sacerdotale et qui se transmet de main en main. L’Église est là avec sa bénédiction, son influence salutaire, son pouvoir de sanctifier et de faire des miracles : elle se maintient comme la création, et survivra à la nature ; car elle est une force et une création de Dieu, et tous ceux qui croient en Jésus et en son Église ont part à ses dons.
« En général il y a encore beaucoup d’innocence dans ce pays. La corruption, la débauche et même le luxe sont rares dans le peuple ; la bonne conduite, l’humilité et la diligence des gens de service m’ont souvent surpris. Ce qui contribue beaucoup à conserver au peuple des campagnes son caractère particulier et ses bonnes mœurs, c’est qu’il y a peu de villages formant une de ces agglomérations où les habitants, vivant les uns près des autres, s’entraînent réciproquement au vice et à la médisance. Ici, chaque paysan, avec sa famille dont le bétail aussi fait partie, habite une maison isolée, entourée de quelques vieux chênes très rapprochés qui la défendent contre le vent et la pluie : tout autour sont ses champs souvent garantis par des haies ou des retranchements en terre. À environ un quart de lieue de là, se trouve une autre propriété du même genre, plus grande ou plus petite : un certain nombre de ces fermes forment un hameau, et plusieurs hameaux une paroisse. Le pays est parsemé de charmants bouquets d’arbres et d’une infinité de haies verdoyantes et de coins ombragés. Souvent, quand j’allais de maison en maison par les sentiers verdoyants et à travers des bocages, je ne pouvais m’empêcher de me dire : Quel pays pour une douce et innocente vie d’enfant ! Quelles solitudes et quelle quantité de charmants buissons couverts de baies ! L’arrangement des maisons de paysans et en partie aussi des maisons bourgeoises a un caractère tout à fait patriarcal. Toute la maison est d’une certaine façon rassemblée autour du foyer. Le feu est posé sur une plaque de fer, contre un mur, et ce qui appartient au foyer est toujours ce qu’il y a de mieux ordonné dans toute la maison. On entre d’abord dans cette cuisine qui est aussi le lieu où se passe toute la vie. Les couches sont établies dans les parois, comme dans des compartiments maçonnés dont les portes sont fermées pendant le jour. Souvent dans la cuisine même, plus souvent dans une aire adjacente, se tiennent à droite et à gauche des vaches et des chevaux sur un sol un peu plus bas, en sorte que leurs mangeoires sont de plain-pied et qu’en mangeant ils avancent leurs têtes à travers des barreaux. Un bras mobile de fer ou de bois porte de la pompe à eau sur le feu le chaudron où l’on fait cuire les aliments. Dans une maison je vis un enfant qu’on voulait empêcher ainsi de tomber dans le feu, tourner en rond dans l’échancrure circulaire d’une planche mobile attachée à un poteau par une perche transversale. À l’autre extrémité de cette grande pièce, dans l’aire qui en est séparée par une porte, on bat le blé ou l’on casse le lin : en haut, au-dessus, sont placés le foin, la paille et les grains ; la ménagère, qui se tient près du feu, surveille tout. Les fenêtres à petits carreaux contiennent souvent de petites peintures sur verre de l’ancien temps, des devises, des armoiries, ou même de petites figures de saints. Ordinairement on trouve les instructions familières de Goffiné, le catéchisme d’Overberg et l’histoire sainte sur une planche ou dans un coffre où sont les habits du dimanche avec une couple de pommes pour leur donner une bonne odeur. Devant la fenêtre, le vent murmure dans les arbres. Ces gens sont simples, laborieux, hospitaliers et pieux. – Chez les riches paysans, tout cet aménagement s’élève jusqu’à la commodité, et même jusqu’à l’élégance : il y en a chez lesquels j’ai vu une jolie cuisine d’hiver où pendant l’été, à la place du feu, un gros bouquet de fleurs brillait devant le foyer garni de petites plaques de porcelaine. Chez les paysans pauvres tout cela est plus grossier et plus simple, mais toujours avec le cachet de la vie de famille et des mœurs locales. Une seule chose, qui, du reste, devient de plus en plus rare, incommode ceux qui n’y sont pas habitués dans les demeures des pauvres gens : c’est le manque d’un tuyau de cheminée. La fumée sort, comme il lui plaît, par toutes les ouvertures, ce qui, les jours de pluie, est très désagréable, parce qu’alors l’habitation est souvent remplie d’une épaisse fumée. »
Tel est le récit de Clément Brentano.
II
BAPTÊME ET PREMIÈRE JEUNESSE D’ANNE CATHERINE.
1. La fille de Bernard Emmerich, de Flamske, pouvait dire d’elle-même, comme sainte Hildegarde : « Dès le commencement de mon existence, lorsque Dieu m’éveillait dans le sein maternel par le souffle de la vie, il a implanté dans mon âme le don de contemplation. Dès ma première enfance, lorsque mes os, mes nerfs et mes veines n’avaient pas encore pris leur consistance, mon âme a eu constamment des visions » ; car Anne Catherine, aussi, avait été pourvue d’une telle force d’âme et de si magnifiques dons spirituels que, dès le premier jour de sa vie, elle s’était trouvée capable d’exercer activement son intelligence. Peu d’heures après sa naissance, ayant été portée à Coesfeld, pour y être baptisée à l’église de Saint-Jacques, elle reçut, en chemin, sur les personnes et les objets, des impressions distinctes qu’elle put conserver dans sa mémoire ; mais, dans le baptême lui-même, avec la grâce sanctifiante et les vertus théologales, la lumière prophétique surnaturelle lui fut infuse avec une plénitude qui ne peut se rencontrer dans l’Église que chez un très petit nombre d’âmes privilégiées. Elle-même rendait ce témoignage quelques années avant sa mort :
« Comme je suis née le 8 septembre, j’ai eu aujourd’hui (8 septembre 1821) une vision relative à ma naissance et à mon baptême et j’étais là présente avec une impression tout à fait étrange. Je me sentais enfant nouveau-né sur les bras des femmes qui devaient me porter à Coesfeld pour y être baptisée. J’avais honte de me sentir si petite, si faible, et d’être cependant si vieille : car, tout ce que j’avais éprouvé et senti alors comme enfant nouveau-né, je le vis et je le reconnus de nouveau, mais mêlé avec mon intelligence actuelle. J’étais toute craintive et embarrassée ; trois vieilles femmes qui venaient au baptême et aussi la sage-femme me déplaisaient. Ma mère ne me déplaisait pas et je m’abreuvais à son sein. Je voyais tout autour de moi ; je voyais la vieille grange dans laquelle nous habitions, et toutes ces choses, je ne les vis plus de même, quand je fus plus avancée en âge, car on avait déjà fait plusieurs changements.
« Je me sentis avec la pleine conscience de moi-même portée pendant tout le chemin depuis notre chaumière à Flamske jusqu’à l’église paroissiale de Saint-Jacques à Coesfeld : je sentais tout et je voyais tout autour de moi. Je vis accomplir en moi toutes les saintes cérémonies du baptême et mes yeux et mon cœur s’y ouvrirent d’une façon merveilleuse. Je vis, lorsque je fus baptisée, mon ange gardien et mes patronnes, sainte Anne et sainte Catherine, assister à l’administration du saint baptême. Je vis la mère de Dieu avec le petit enfant Jésus et je fus mariée avec lui par la présentation d’un anneau.
« Tout ce qui était saint, tout ce qui était bénit, tout ce qui tenait à l’Église, devint alors aussi sensible et aussi vivant pour moi que cela peut l’être aujourd’hui quand le cas se présente. Je vis des images merveilleuses de l’Église quant à son essence. Je sentis la présence de Dieu dans le très saint sacrement ; je vis resplendir les ossements des saints qui étaient dans l’Église et je reconnus les saints qui apparaissaient au-dessus d’eux.
« Je vis tous mes ancêtres jusqu’au premier d’entre eux qui reçut le baptême et une longue série de tableaux symboliques me fit connaître tous les dangers de ma vie à venir. Au milieu de tout cela j’avais les impressions les plus singulières sur mes parrains et sur les membres de ma famille qui étaient là, et ces trois femmes dont j’ai parlé m’étaient toujours un peu antipathiques.
« Je vis mes ancêtres dans une série de tableaux qui avaient des ramifications dans plusieurs pays, en remontant jusqu’au premier qui fut baptisé dans le VIIe ou VIIIe siècle et qui construisit une église. Je vis parmi eux plusieurs religieuses et entre autres deux stigmatisées restées inconnues ; je vis aussi un ermite qui avait tenu auparavant un rang élevé et qui avait eu des enfants. Il se retira du monde et vécut saintement.
« Lorsque je fus rapportée de l’église à la maison, en passant par le cimetière, j’eus un très vif sentiment de l’état des âmes appartenant aux corps qui reposaient là jusqu’à la résurrection ; parmi eux je remarquai avec vénération quelques saints corps brillant de clartés magnifiques. »
Ainsi donc, de même que d’autres enfants ressentent le froid et le chaud, ou la douleur et la faim, de même qu’ils demandent le sein maternel, Anne Catherine avait le sentiment de tous les rapports et de toutes les influences de l’ordre supérieur dans lequel elle était entrée par le baptême, c’est-à-dire de l’Église de Dieu en tant que communion des saints et corps mystique de Jésus. Tout lui était sensible d’une manière corporelle, en sorte qu’étant encore au maillot, quand on la portait à l’Église, elle trempait ses petites mains dans le bénitier pour s’arroser avec l’eau bénite et s’en approprier les effets bienfaisants. Sa qualité de membre de l’Église était aussi sensible pour elle que les membres de son propre corps et, avant de pouvoir parler, elle comprenait les solennités des saintes fêtes, ainsi que les pratiques et les pieuses coutumes qu’elle voyait présider à toute la vie de ses bons parents. Elle célébrait et observait tout cela avec eux, en tant que la faiblesse de la première enfance lui permettait d’obéir à l’impulsion de son esprit miraculeusement éclairé.
2. L’accord entre des choses si diverses, comme du reste toute la vie mystérieuse, cachée aux regards des hommes, qui se développait de si bonne heure dans cette enfant était réglé par la direction du saint ange gardien, lequel instruisait Anne Catherine à servir le Dieu un en trois personnes par la pratique des vertus infuses, dans la mesure possible, à un âge aussi tendre. Il résulta de là que les premiers mouvements de son âme furent dirigés vers Dieu et qu’avant qu’un bien créé pût toucher son cœur, Dieu, le souverain bien, en prit possession. Dans la première splendeur de la sainte grâce du baptême qui ne fut jamais ternie chez elle, elle devait appartenir pour toujours à son Sauveur, lequel avait fait choix du cœur de cet enfant pour le rendre conforme au sien par la pureté, la charité et la souffrance. L’Esprit-Saint, qui avait pris sa demeure en elle, mettait en mouvement par son souffle toutes les puissances de son âme, et, avant même que sa bouche pût articuler des paroles intelligibles, donnait un sens et une signification à l’élan de son cœur complètement tourné vers Dieu. Aussi, dès qu’Anne Catherine, à peine entrée dans sa deuxième année, put prononcer quelques mots, elle commença à faire des prières vocales avec le zèle d’un enfant qui en aurait eu déjà l’habitude. Ce fut grâce à la piété de son père que les premières paroles qui sortirent de sa bouche furent les demandes de l’oraison dominicale. Elle en parlait encore avec reconnaissance à une époque plus avancée de sa vie.
« Mon père, disait-elle, se donna beaucoup de peine avec moi. Il m’enseigna à prier et à faire le signe de la croix. Il me tenait sur ses genoux, fermait ma petite main et m’apprenait à faire le petit signe de la croix. Il l’ouvrait aussi et m’apprenait le grand signe de la croix. Étant encore toute petite, lorsque de très bonne heure je pus dire à moitié le Pater ou même encore moins que cela, je répétais plusieurs fois le peu que j’en savais jusqu’à ce qu’il me semblât qu’il y en avait autant que dans le tout. »
3. À ce don de lumière correspondait une autre grâce dont Anne Catherine fut favorisée également à son baptême et qui se développa toujours plus éclatante avec les années. C’était le don de la plus parfaite pureté du corps et de l’âme, dont les effets se manifestaient déjà quand elle était à la mamelle. On ne l’entendit jamais crier ; on ne la vit jamais en colère, mais toujours paisible, douce et aimable, comme la bienheureuse Marie Bagnesi de Florence ou comme sainte Colombe de Rieti. Aussi était-elle la consolation et la joie de ses parents et devint-elle bientôt la favorite des simples campagnards parmi lesquels devaient s’écouler les années de son enfance. Comme autrefois parents et voisins se disputaient Catherine de Sienne enfant, parce que sa seule vue rendait les cœurs tout joyeux, ou comme on voyait briller un tel attrait chez Marie Bagnesi, que les religieuses des couvents où on la portait pour visiter ses sœurs ne voulaient pas laisser partir, de même la pauvre petite paysanne de Flamske était la joie de tous ceux qui la voyaient. L’éclat de pureté ineffable qui reposait sur elle prêtait un charme irrésistible à chaque regard, à chaque mouvement, à chaque parole de la timide enfant et, lorsqu’elle fut plus âgée, donnait à toutes ses actions comme un caractère sacré qui, sans qu’elle en eût elle-même la conscience, exerçait une influence sanctifiante sur son entourage. Lorsque plus tard Anne Catherine entra dans la phase la plus pénible de sa tâche de souffrance, la pureté de son âme rayonna au dehors en proportion de l’accroissement de ses peines, et plus elle approcha du terme de sa vie, plus la vertu mystérieuse qui émanait d’elle se rendit sensible. Lorsque ses stigmates devinrent l’objet d’une enquête faite par l’autorité ecclésiastique, des médecins et des prêtres rendirent témoignage de cette pureté et ce fut la plus forte impression que reçut le comte de Stolberg lorsqu’il vit Anne Catherine pour la première fois.
4. Un effet de cette pureté fut qu’Anne Catherine, jusqu’à sa mort, conserva la simplicité naïve d’un enfant plein d’humilité et d’innocence, ne sachant rien d’elle-même ni du monde parce que sa vie était toute en Dieu. Et cette simplicité plut tellement à Dieu qu’elle se montrera à nous comme le but des opérations de la grâce dont cette âme d’élite fut favorisée. Le Seigneur la traita toujours comme un enfant, et dans son admirable sagesse, il fit en sorte qu’avec la plénitude de lumière versée dans son âme, elle conservât la simplicité ; avec le courage héroïque qui la faisait aspirer toujours à de nouvelles souffrances, une aimable timidité ; enfin avec la terrible austérité de sa mission, la naïveté d’un enfant ; car, ayant encore les yeux pleins de larmes, elle pouvait revenir en un instant à la joyeuse sérénité de cet âge qui ne connaît pas les soucis parce qu’il ne connaît pas le péché, aussitôt qu’un rayon fugitif du soleil de la consolation adoucissait les tourments qui, comme des vagues furieuses, s’étaient déchaînés sur elle. Ces rayons de soleil étaient souvent les tableaux de son enfance que le Dieu de bonté faisait passer devant son âme pour la soulager : alors Anne Catherine redevenait enfant, se sentait une petite paysanne gaie et affectueuse dans la maison paternelle et reconquérait le courage tranquille qui lui était nécessaire pour marcher en avant sur la voie toujours plus escarpée de la croix.
5. Ce don de pureté était pour Anne Catherine un trésor qu’il fallait acheter par les souffrances et la pénitence et qui ne pouvait être conservé qu’autant que sa valeur et son éclat étaient rehaussés par une lutte sans relâche contre elle-même, une abnégation et une mortification incessantes. C’est pourquoi la pratique de la patience dans la souffrance fut l’exercice par où elle dut commencer dès la première année de sa vie.
« Je retourne bien loin en arrière par la pensée », disait-elle. « Dans ma première année, je tombai rudement par terre. Ma mère était à Coesfeld, à l’église, mais elle eut le pressentiment qu’il m’était arrivé quelque chose et elle revint en grande hâte et tout inquiète à la maison. Pendant longtemps, on ne put pas me faire marcher, car ce ne fut que dans ma troisième année que je fus tout à fait guérie ; on me tira la jambe, on la laça et on l’enveloppa dans des bandages si serrés qu’elle devint toute sèche. »
Le souvenir distinct de cet accident de la première enfance, conservé encore dans un âge avancé, prouve combien Anne Catherine en avait eu la parfaite connaissance lorsqu’il était arrivé et qu’elle avait eu à en supporter les conséquences. Dirigée comme elle l’était par son saint ange, on peut présumer qu’il en était d’elle dans de pareils cas comme de Marie Bagnesi, si semblable à elle en beaucoup de choses. Celle-là aussi, dès sa première enfance, n’étant encore âgée que de quelques mois, commença sa tâche de souffrance en endurant la faim la plus cruelle. Confiée à une nourrice sans conscience qui ne lui donnait ni lait, ni nourriture, il lui fallait, pour apaiser sa faim, ramasser par terre des miettes de pain ; mais elle posa par là le fondement de cette vie de mortifications extraordinaires et de souffrances librement voulues qui fit d’elle, comme d’Anne Catherine, une source de bénédictions pour une infinité d’âmes.
6. Aussitôt que commença à exister pour Anne Catherine la possibilité de se refuser quelque chose et de s’imposer une mortification ou une victoire sur elle-même, elle commença aussi à s’y exercer avec une grande ardeur, en tant que cela était possible à un âge aussi tendre. Elle suivait en cela la direction constante de son ange qui lui donnait les lumières nécessaires et elle se livra à ces exercices avec une constance et une prudence qui frappent d’étonnement. Elle avait suspendu dans un coin de la grange une petite image de la Mère de Dieu avec l’enfant Jésus et placé devant cette image un morceau de bois qui devait figurer un autel. Elle portait là tous les petits objets donnés par des parents et amis qui voulaient lui faire plaisir, objets qui ordinairement rendent si heureux les enfants de son âge. Elle était fermement convaincue que tout ce dont elle se privait faisait plaisir à l’enfant Jésus ; aussi lui donnait-elle joyeusement et en se renonçant énergiquement elle-même tout ce qu’elle recevait en cadeau. Elle faisait cela avec tant de simplicité et si peu d’ostentation que personne ne trouvait rien de singulier dans cette manière d’agir tout enfantine en apparence et qu’on ne la troublait en rien à cet égard. Il arrivait souvent que les dons placés par elle devant la petite image disparaissaient et cela lui donnait la joyeuse assurance que l’enfant Jésus lui-même les avait pris pour lui. Cette consolation était d’autant plus grande qu’il lui avait fallu se vaincre et se renoncer davantage, car, avec tous les dons de la grâce qui lui avaient été départis, elle n’en n’était pas moins une enfant qui se serait régalée de fruits, de gâteaux, etc., aussi volontiers que les autres. Même les fleurs, les images, les rubans, les guirlandes, les anneaux, les jouets et les autres choses de ce genre qui ont une valeur incomparable aux yeux d’un enfant, devaient être sacrifiés au saint élan de son cœur : elles étaient posées sur le petit autel et quand elle revenait, il se trouvait que tout avait disparu.
7. Grâce à une mortification si persévérante, la pureté de son âme s’accroissait de telle sorte qu’Anne Catherine, dans sa troisième année, pouvait adresser à Dieu cette fervente prière : « Ah ! mon cher Seigneur et Dieu, faites-moi mourir : car quand on devient grand, on vous offense par de grands péchés. » Et quand elle sortait de la chaumière paternelle elle pouvait dire dans sa ferveur ainsi que l’atteste Overberg : « Puisses-tu tomber morte devant la porte pour n’être plus exposée à offenser Dieu. »
8. Lorsqu’elle fut plus grande et put frayer avec d’autres enfants de son âge, elle leur donnait pour l’amour de Dieu tout ce dont elle pouvait disposer. Les plus pauvres étaient ceux qu’elle préférait, et, fille elle-même de parents nécessiteux, elle était inépuisable dans ses dons. Elle n’avait pas encore accompli sa quatrième année qu’elle s’interdisait de manger à sa faim dans aucun repas. Chaque fois qu’elle était à table avec ses parents, elle mortifiait son goût de toutes les manières ; car ou elle s’arrangeait pour avoir les plus mauvais morceaux ou elle mangeait si peu qu’on ne pouvait comprendre comment elle se soutenait.
« Je vous donne cela, Ô mon Dieu », disait-elle dans son cœur, « afin que vous en fassiez part aux pauvres qui en ont le plus besoin. »
9. Les pauvres, les indigents, les souffrants de toute espèce possédaient son amour à un si haut degré que les peines causées par la compassion furent les premières douleurs spirituelles d’Anne Catherine. Si elle entendait parler d’un malheur, d’une maladie ou d’un mal, quel qu’il fût, elle était émue d’une si vive compassion qu’elle pâlissait, s’asseyait et restait sans mouvement comme quelqu’un qui va tomber en défaillance. Les questions de ses parents inquiets, qui lui demandaient si elle était prise d’une maladie subite, la faisaient revenir à elle ; mais le désir d’assister son prochain était si fortement réveillé dans son âme qu’elle s’offrait elle-même à Dieu avec de ferventes prières pour qu’il voulût bien la charger des souffrances et des misères des autres et les secourir à cette condition. Si elle voyait un affamé ou un indigent, elle courait à lui et lui criait avec une simplicité touchante : « Attendez, attendez, je vais prendre un pain pour vous à la maison... » Et sa bonne mère la laissait faire et ne refusait jamais à l’enfant ce qu’elle demandait quand les malheureux venaient pour recevoir ses dons. Elle se dépouillait même d’une partie de ses vêtements pour les donner et elle parvint une fois par ses douces supplications à obtenir de ses parents la permission de donner à un petit mendiant sa dernière chemise.
10. Anne Catherine ne pouvait pas voir un enfant pleurant ou malade sans demander à Dieu de la charger de ce qui causait ces pleurs, de lui envoyer cette maladie ou ces souffrances afin que les autres en fussent délivrés. Cette prière était toujours immédiatement exaucée. Anne Catherine éprouvait les douleurs et voyait les enfants redevenir tranquilles. Elle priait ainsi dans ces occasions : « Quand un pauvre ne prie pas et ne demande pas, il ne reçoit rien ; mais vous, ô mon Dieu, vous venez en aide même à ceux qui ne prient pas et qui ne veulent pas souffrir. Voici que je vous prie et vous invoque pour ceux qui ne le font pas eux-mêmes. »
Voyait-elle un enfant qui avait de mauvaises habitudes et commettait souvent des fautes, elle priait pour qu’il se corrigeât : mais pour être exaucée, elle s’imposait une punition et demandait à Dieu qu’il lui fût permis de faire la pénitence à la place de l’enfant. Quand, bien des années après, on lui demanda d’expliquer comment, dès sa tendre enfance, elle en était venue à faire de semblables demandes, elle répondit simplement :
« Je ne puis dire qui me l’a enseigné : mais cela se trouve compris dans la compassion. J’ai toujours eu le sentiment que nous sommes tous un seul corps en Jésus-Christ, et le mal de mon prochain me faisait souffrir comme si c’eût été le doigt de ma main. Dès mon enfance j’ai demandé pour moi les maladies des autres. J’avais la pensée que Dieu n’envoie pas des souffrances sans une cause particulière, et qu’il y a toujours quelque chose à payer par là. Que si la souffrance souvent pèse si cruellement sur l’un de nous, cela vient, me disais-je, de ce que personne ne veut l’aider à acquitter sa dette. Alors je priais Dieu de me laisser payer pour lui ; je demandais à l’enfant Jésus de m’aider et de cette manière j’avais bientôt mon comptant de douleurs. » « Je me souviens », racontait-elle dans une autre occasion, « que ma mère eut un érésipèle au visage et qu’elle était couchée sur son lit tout enflée. J’étais seule auprès d’elle et bien triste de la voir ainsi. Je m’agenouillai dans un coin et priai Dieu avec ferveur : puis je nouai un linge autour de la tête de ma mère et je priai de nouveau. Je ressentis alors un grand mal de dents et tout mon visage s’enfla. Lorsque les autres revinrent à la maison, ils trouvèrent ma mère tout à fait remise, et moi aussi, je ne tardai pas à me trouver mieux. »
« Quelques années après je souffris des douleurs presque intolérables. Mes parents étaient bien malades. Je m’agenouillai près de leur lit contre le métier à tisser et je priai Dieu : alors je vis mes mains jointes au-dessus d’eux et je fus poussée à les poser en priant sur mes parents malades afin qu’ils fussent guéris. »
11. Si elle voyait commettre un péché ou si elle en entendait parler, elle était saisie d’une vive affliction et versait des larmes amères. Interrogée par ses parents inquiets sur la cause d’un chagrin qu’ils ne pouvaient s’expliquer, elle n’était pas en état de leur donner une réponse satisfaisante. Elle recevait à cause de cela beaucoup de reproches et on la traitait de fantasque : mais cela n’arrêtait point l’élan de son cœur brûlant d’amour qui la portait à prier et à faire pénitence pour les besoins spirituels du prochain. Ainsi, dans sa quatrième année, elle se trouvait un jour près du berceau d’un enfant mortellement malade ; la mère de l’enfant était à ses côtés. Le père qui était ivre, dans un accès de colère, lança sur elle une hache qui allait briser la tête de l’enfant. Anne Catherine se jeta rapidement devant le coup ; la hache effleura sa propre tête et se détourna du berceau. L’enfant fut sauvé et les terribles conséquences de cet acte insensé furent prévenues.
Une autre fois Anne Catherine vit des enfants blesser la décence dans leurs jeux. Elle en conçut un tel chagrin qu’elle se cacha dans les orties, priant Dieu d’accepter ses souffrances en expiation des péchés de ces enfants.
Elle ressentait aussi une vive compassion pour les Juifs. « Lorsque j’étais petite » raconta-t-elle, « mon père me prenait souvent avec lui quand il allait à Coesfeld acheter quelque chose chez un marchand juif. J’étais toujours saisie de pitié à la vue de ce malheureux homme et souvent je ne pouvais m’empêcher de pleurer amèrement de ce qu’ils sont si endurcis et ne veulent pas du salut qui leur est offert. Combien ils sont à plaindre ! Ils n’ont aucune idée des vieux saints Juifs tels que je les vois. Les Juifs actuels descendent des anciens Juifs pervertis par le pharisaïsme. La misère et l’aveuglement de ces hommes ont toujours fait sur moi une profonde impression et pourtant j’ai souvent trouvé qu’on peut très bien parler de Dieu avec eux. Pauvres, pauvres Juifs ! Ils ont autrefois possédé vivant le germe du salut : mais ils n’en ont pas reconnu le fruit et ils l’ont rejeté. Et maintenant ils ne le cherchent même pas. »
12. Mais ce qui est plus étonnant chez Anne Catherine que toute autre mortification, c’est la pratique, commencée de si bonne heure et jamais interrompue, de la prière nocturne. Dès sa quatrième année, elle commença à prendre sur le temps du repos de la nuit, si nécessaire à un enfant, afin de se livrer à l’oraison. Quand ses parents étaient endormis, elle se levait de son lit et priait avec l’ange deux ou trois heures de suite, parfois jusqu’au crépuscule du matin. Elle aimait à le faire en plein air : aussi, quand le temps le permettait, elle se glissait jusqu’à un champ situé devant la maison paternelle et où le sol s’exhaussait un peu, parce qu’elle se croyait là plus rapprochée de Dieu que dans le bas fond, et elle priait, les bras étendus et les yeux tournés vers l’église de Coesfeld. On ne peut pas supposer qu’Anne Catherine ait entrepris une pareille chose sans l’inspiration de son ange et, si nous devons reconnaître là une disposition de Dieu qui voulait recevoir la prière nocturne de l’innocente créature et lui donnait la force nécessaire, il ne faut pourtant pas s’imaginer qu’en raison du secours particulier que lui apportait la grâce, cette pratique fût devenue pour la tendre enfant une chose facile et comme allant de soi-même. Certes il n’en était pas ainsi : car c’est le propre de la direction à laquelle obéissent les âmes de cette sorte qu’elles ont à conquérir graduellement la perfection à laquelle Dieu les appelle par une très fidèle coopération aux grâces reçues et par un combat incessant et douloureux contre l’infirmité de la nature. Ainsi Dieu permettait que chez Anne Catherine, la nature réclamât journellement ses droits et que son faible corps exigeât impérieusement le repos qui, selon l’ordre accoutumé, était indispensable à sa croissance et à l’augmentation de ses forces : mais la courageuse enfant résistait et obéissait promptement à la voix de l’ange qui l’appelait à la prière, quoiqu’elle ne pût s’empêcher d’éprouver le tressaillement involontaire de la faiblesse humaine et de pleurer souvent à chaudes larmes. Anne Catherine cherchait des moyens pour procurer à son corps la facilité de se lever à toute heure de la nuit, mais elle n’en trouva pas de meilleurs que des morceaux de bois ou des cordes qu’elle mettait dans son lit pour se rendre le repos incommode et pénible et des ceintures de pénitence munies de gros nœuds qu’elle tressait elle-même, afin de trouver dans un surcroît de souffrance la force que la nature ne pouvait pas lui fournir. Dieu récompensa par le succès le plus complet tant de fidélité et de persévérance. Elle gagna peu à peu sur elle de pouvoir se passer entièrement du sommeil naturel, en sorte que jusqu’à la fin de sa vie, elle se montra jour et nuit, sans relâche et sans repos, la servante infatigable de son Seigneur.
13. Bien des lecteurs trouveront peut-être plus surprenante chez une enfant de quatre ans la possibilité de persévérer deux ou trois heures de suite dans la prière que cette faculté de pouvoir si longtemps se priver de sommeil et ils demanderont quelle était donc la substance de cette prière si prolongée. Elle était aussi abondante et aussi variée que les causes et les occasions pour lesquelles Dieu voulait que la prière de l’enfant lui fût adressée. Tous les jours Anne Catherine voyait en vision la tâche qu’elle avait à accomplir dans sa prière. Elle voyait dans une série de tableaux des malheurs et des dangers, menaçant l’âme et le corps, qu’il lui fallait détourner et conjurer. Elle voyait des malades impatients, des prisonniers accablés de tristesse, des mourants non préparés ; elle voyait des voyageurs, des égarés, des naufragés ; elle voyait des gens dans la détresse et l’abattement, d’autres qui chancelaient au bord des abîmes et auxquels la clémente providence de Dieu voulait par l’effet de sa prière faire arriver l’assistance, la consolation et le salut. C’est pourquoi il lui était aussi montré dans ces tableaux que, si elle négligeait ses pénitences et ses supplications, personne ne la suppléerait, et que ces gens en péril et dans la détresse resteraient alors sans rien qui pût les sauver. Le saint ange la soutenait dans sa prière et le brûlant amour du prochain la rendait si hardie, si éloquente et si persévérante dans les supplications qu’elle adressait à Dieu que les heures lui semblaient plutôt trop courtes que trop longues.
14. Ces visions furent particulièrement variées et effrayantes lors de l’explosion de la Révolution française. Anne Catherine fut conduite en esprit dans la prison de Marie Antoinette, reine de France, et elle eut à demander pour elle force et consolation. L’impression qu’elle en ressentit fut si vive qu’elle raconta à ses parents et à ses frères et sœurs la détresse de la reine, les exhortant à prier avec elle pour cette infortunée princesse. Mais ils ne comprirent pas ce qu’elle voulait dire par là, traitèrent ses paroles de rêveries et lui donnèrent à entendre que, pour aller ainsi partout et voir tout, il fallait être une sorcière. Ces propos inquiétèrent tellement Anne Catherine qu’elle alla se confesser et ne put être tranquillisée que par son confesseur. Il lui fallut assister en esprit à beaucoup d’exécutions afin de porter par sa prière aide et consolation aux mourants, particulièrement au roi Louis XVI. « Quand je vis ce roi et beaucoup d’autres », racontait-elle, « souffrir la mort avec tant de résignation, je me disais toujours : Ah ! il est bon pour eux d’être retirés du milieu de ces abominations. Mais, quand je parlais de cela à mes parents, ils croyaient que j’avais perdu la tête. J’étais souvent à genoux, priant et pleurant afin que Dieu voulût bien sauver telles et telles personnes que je voyais en grand danger, et j’ai vu et appris par l’expérience comment des périls menaçants et encore éloignés peuvent être détournés par la prière confiante en Dieu. »
15. Lorsque, quelques années plus tard, Anne Catherine eut à rendre compte à son directeur extraordinaire Overberg de ce qu’avait été sa prière dans sa première jeunesse, elle lui répondit ainsi :
« Dès ma petite enfance, je priais moins pour moi-même que pour d’autres, afin qu’on ne commît pas de péchés et qu’aucune âme ne se perdît. Il n’était rien que je ne demandasse à Dieu, et plus j’obtenais, plus je demandais ; je n’en avais jamais assez. J’étais avec lui hardie à l’excès et je me disais : Tout est à lui et il voit avec plaisir que nous l’implorions de tout notre cœur. »
16. À quel degré de perfection s’éleva la pureté du cœur chez la courageuse enfant, à l’aide de semblables pratiques, c’est ce qu’Overberg nous apprend en ces termes :
« Dès la sixième année de son âge, Anne Catherine ne connaissait de joie qu’en Dieu ; et la seule chose qui la fît souffrir et l’attristât était que ce Dieu plein de bonté fût offensé par les hommes. Lorsqu’elle eut commencé à se livrer à la mortification et au renoncement, il s’alluma dans son cœur un tel amour de Dieu qu’elle disait souvent dans sa prière : « Quand même il n’y aurait ni ciel, ni enfer, in purgatoire, je voudrais pourtant, ô mon Dieu, vous aimer de tout mon cœur et par-dessus toute chose. »
17. Anne Catherine consacrait une grande partie de ses prières aux pauvres âmes du purgatoire qui venaient souvent lui demander son secours. Quand c’était en hiver, elle se mettait à genoux la nuit dans la neige et priait pour elles, les bras étendus, jusqu’à ce qu’elle fut toute raidie par le froid. Elle prenait aussi pour s’y agenouiller un morceau de bois à arêtes presque tranchantes ou bien elle se mettait à genoux au milieu des orties et s’en flagellait, pour rendre par ces pénitences sa prière plus efficace. Elle avait très souvent la consolation de recevoir les remerciements des âmes délivrées par elle. Voici ce qu’elle rapportait plus tard à ce sujet :
« Quand j’étais encore enfant, je fus conduite par une personne inconnue à un endroit qui me sembla être le purgatoire. J’y vis beaucoup d’âmes souffrant cruellement qui me demandèrent instamment des prières. C’était comme si j’eusse été conduite dans un profond abîme. Je vis un lieu très étendu dont l’aspect était à la fois terrible et touchant ; car on y voyait des personnes silencieuses, affligées, dont le visage semblait pourtant indiquer qu’elles avaient encore de la joie dans le cœur et qu’elles pensaient à la miséricorde de Dieu. Je n’y vis pas de feu ; mais je sentis que ces pauvres gens étaient en proie à de très grandes souffrances intérieures.
« Quand je priais avec beaucoup d’ardeur pour les pauvres âmes, j’entendais souvent autour de moi des voix qui disaient : Je te remercie ! Je te remercie ! Un jour j’avais perdu sur le chemin de l’Église un petit sachet que ma mère m’avait donné. J’en avais beaucoup de chagrin et je croyais avoir péché en n’y faisant pas plus d’attention. Cela me fit oublier de prier le soir pour ces pauvres âmes si chères à Dieu. Comme j’allais prendre un morceau de bois dans le hangar, une figure blanche avec quelques taches noires m’apparut et me dit : « Tu m’oublies. » Je fus très effrayée et je repris aussitôt la prière interrompue. Le jour suivant, ayant bien prié, je retrouvai le sachet dans la neige.
« Quand je fus devenue plus grande, j’allais de grand matin à la messe à Coesfeld. Afin de pouvoir mieux prier pour les âmes en peine, je prenais un chemin solitaire. S’il faisait encore noir, je voyais de pauvres âmes planer devant moi, deux par deux, comme des perles brillantes dans une flamme sombre. Le chemin s’éclairait à mes yeux, et je me réjouissais de ce qu’elles étaient autour de moi, parce que je les connaissais et que je les aimais : car, pendant la nuit aussi, elles venaient à moi et imploraient mon assistance. »
III
ANNE CATHERINE EST CONDUITE PAR DIEU À L’AIDE DE VISIONS.
1. La richesse des tableaux qui se présentaient dans la lumière infuse à l’âme d’Anne Catherine se révéla à son entourage aussitôt qu’elle put parler. Lorsque son père Bernard, après le travail de la journée, se reposait près du foyer, sa récréation favorite était de prendre sur ses genoux sa spirituelle petite fille et de lui faire raconter quelque chose : « Anne Catherinette, lui disait-il, te voilà dans ma petite chambre ; raconte-moi quelque chose. » Alors elle lui décrivait d’une manière très animée les tableaux relatifs aux évènements de l’Ancien Testament qui avaient passé sous ses yeux, si bien que le père fondant en larmes lui demandait : « Mon enfant, d’où t’est venu tout cela ? » Et elle répondait : « Père, cela est ainsi ! je le vois ainsi. » Sur quoi il se taisait et ne l’interrogeait plus.
Elle voyait ces tableaux, étant éveillée, à toutes les heures du jour et au milieu de ses occupations, quelles qu’elles fussent. Et comme elle croyait que tout le monde avait, comme elle, de ces contemplations, elle en parlait tout naïvement et quelquefois se fâchait quand d’autres enfants la contredisaient ou se moquaient d’elle. Il arriva une fois qu’un ermite qui prétendait être allé à Rome et à Jérusalem, parla des lieux saints tout de travers et au rebours de la vérité. La vive enfant, qui avait écouté tranquillement le narrateur, à côté de ses parents, ne put plus se contenir, le taxa hardiment de mensonge et se mit à décrire les saints lieux comme quelque chose qui lui était parfaitement connu. Les parents mécontents lui reprochèrent cette vivacité et Anne Catherine devint plus réservée.
Comme elle était à l’école du village à la tête de laquelle se trouvait un vieux paysan, elle décrivit un jour la résurrection de Notre-Seigneur comme elle lui était montrée en vision : mais là aussi on l’exhorta sévèrement à ne plus se livrer à de semblables imaginations. Ces expériences fermèrent successivement la bouche à l’enfant intimidé, qui s’abstint dès lors de communiquer ce qui se passait secrètement en elle : toutefois les visions ne cessèrent pas, mais les faits sur lesquels repose la foi avec ses mystères passaient toujours plus nombreux devant ses yeux en grands tableaux historiques liés les uns aux autres et Anne Catherine, en quelque lieu qu’elle se trouvât, était continuellement occupée à les contempler.
2. C’étaient les douze articles du symbole des apôtres qui, suivant le cours de l’année ecclésiastique, passaient devant elle sous forme de tableaux infiniment variés. Elle contemplait la création du ciel, la chute des anges, la création de la terre et du paradis : elle voyait Adam et Ève, et leur chute : puis dans des visions qui se succédaient sans interruption, elle suivait, à travers les siècles et les générations, tout le développement des saints mystères de l’Incarnation et de la Rédemption, en sorte que le théâtre de l’histoire sainte et les personnages de l’Ancien Testament lui étaient mieux et plus distinctement connus que le cercle de son entourage ordinaire. Dans ces visions se montraient aussi, dans un rapport plus intime avec elle, les saints qui, par leurs relations plus étroites avec la sainte humanité de Jésus-Christ, sont à certains égards plus rapprochés des fidèles. Parmi eux, c’étaient surtout les saintes familles de Joachim et d’Anne, de Zacharie et d’Élisabeth avec lesquelles Anne Catherine entretenait des rapports plus familiers et plus affectueux : c’était avec elles qu’elle célébrait les fêtes des temps de la promesse, allait en pèlerinage à Jérusalem et à d’autres lieux sanctifiés, demandait ardemment l’avènement du Sauveur, le saluait et l’adorait à sa naissance.
Le temple de Jérusalem 4, la splendeur et la magnificence du culte qu’on y rendait à Dieu, l’arche d’alliance avec ce qu’elle contenait, les mystères du Saint des Saints intelligibles pour un petit nombre seulement, le chant des psaumes, les prescriptions et les observances si multipliées du rituel de l’ancienne loi, tout cela lui était parfaitement connu jusque dans les plus petits détails, aussi bien que les coutumes et les pieuses traditions conformément auxquelles les vrais et fidèles Israélites pratiquaient la loi et réglaient leur vie de famille.
3. Or ces contemplations n’étaient pas pour Anne Catherine un vain spectacle, mais elle vivait avec ce qu’elle voyait, elle frayait avec les contemporains de ces évènements remontant à des milliers d’années. Il lui arrivait en cela quelque chose de semblable à ce qui était arrivé à sainte Catherine de Sienne qui, elle aussi, avait été préparée au grand rôle qu’elle devait jouer plus tard par des visions pour lesquelles il lui fallait une telle liberté d’esprit à l’endroit de toutes les créatures et un recueillement si imperturbable de toutes les forces de l’âme en Dieu qu’étant dans l’entourage des Papes et des princes et au milieu de tout le tumulte du monde, elle pouvait y rester aussi inaccessible et en être aussi peu émue qu’elle l’eût été dans l’asile silencieux d’une cellule monastique. Mais cette force, elle ne la puisait qu’à l’école des anciens pères et des pénitents de la Thébaïde. C’est pourquoi, pendant des années, elle eut pour compagnie leur contemplation si claire et si vivante qu’elle tressait avec eux des corbeilles et des nattes, priait, chantait des psaumes, jeûnait, faisait pénitence, observait le silence, enfin pratiquait toutes les abstinences et les mortifications qui devaient la conduire à une séparation complète d’avec les créatures et à l’union la plus intime avec Dieu. Saint Paul, saint Antoine, saint Pacôme, saint Hilarion étaient ses modèles et ses maîtres et elle était en rapport familier avec eux comme Anne Catherine avec saint Joachim, sainte Anne et leurs saints ancêtres.
4. En même temps qu’Anne Catherine célébrait en esprit les solennités de l’ancienne loi, comme si elle en eût été contemporaine, elle faisait cela en enfant de la sainte religion catholique qui, dans toutes les figures et les mystères prophétiques, contemplait leur accomplissement. Dans les fêtes de l’Ancien Testament, elle voyait à la fois les faits actuels et les évènements historiques qui étaient la cause et l’objet de la fête, en sorte que ses merveilleuses intuitions embrassaient l’histoire de la Rédemption tout entière. Elles occupèrent les premiers temps de sa jeunesse jusqu’au moment où leur succédèrent des visions non moins compréhensives et non moins complètes touchant la vie du Saint Rédempteur. Cette disposition était en rapport avec la tâche d’Anne Catherine qui était de souffrir pour la foi catholique à une époque où les hommes, dans leur malice insensée, contestaient jusqu’à la possibilité d’une révélation divine, niaient les mystères de l’Incarnation et de la Rédemption, insultaient par des blasphèmes diaboliques les prophètes, les apôtres et les saints de l’Église, et où l’on voyait la foule des ennemis de Dieu se recruter journellement dans les rangs des prêtres égarés. Dans cette terrible époque, Dieu donnait à l’âme d’Anne Catherine, par l’infusion de la lumière prophétique, la faculté de contempler les faits de la révélation divine et tout le cours de l’histoire de la Rédemption plus clairement et plus complètement encore que les contemporains de ces faits ; il l’appelait à confesser et à glorifier l’accomplissement dans le temps des décrets divins cachés de toute éternité, avec un cœur dont la pureté et l’ardent amour étaient pour lui une compensation aux outrages que l’impiété prodiguait à ses miséricordes.
5. Le Sauveur lui-même daignait se faire le guide de cette âme privilégiée dans le cercle immense de ces visions et lui communiquer l’intelligence des mystères les plus cachés. Il parcourait avec elle les lieux sanctifiés par sa présence sur la terre et lui montrait comment il y avait accompli ce qu’il avait travaillé à préparer d’avance dès le commencement des temps pour le salut de l’humanité déchue. Il lui révéla le mystère de la Conception immaculée de sa très sainte mère et lui montra toutes les personnes, les familles et les races élues dont il s’était servi dans les anciens temps de la promesse pour conduire à terme la plénitude du salut. Cette assistance toujours présente du divin Sauveur donnait à Anne Catherine la force d’esprit nécessaire pour porter et embrasser la richesse infinie de ses visions et pour maintenir sa vie intérieure et son action contemplative en harmonie avec sa vie et ses actions extérieures. Elle était, des jours entiers, livrée à une contemplation continuelle, par conséquent son esprit était incessamment abstrait du monde extérieur : et pourtant toutes les occupations et tous les travaux qui, dès son jeune âge, lui étaient imposés par ses parents allaient leur train avec autant de promptitude et de précision que si elle n’avait pas eu à penser à autre chose. Aucune espèce de dérangement extérieur ne devait troubler le calme et le recueillement profond de ses facultés intellectuelles dans la contemplation : c’est pourquoi elle reçut comme un don de Dieu l’aptitude aux travaux manuels et toutes les connaissances nécessaires pour la vie ordinaire, sans être obligée de les acquérir peu à peu par l’enseignement ou la pratique. De même qu’elle sut lire aussitôt qu’elle ouvrit un livre, de même tout travail domestique ou champêtre auquel ses mains s’appliquaient lui réussissait à l’instant. Il semblait que tout ce qu’elle touchait ou tout ce qu’elle faisait se tournât en bénédiction et son entourage était tellement accoutumé à voir la faible enfant toujours prête à entreprendre joyeusement un travail pénible et toujours parvenant à le mener à bien, qu’on respectait son calme et son recueillement intérieur, et qu’on ne cherchait pas à troubler par des questions fatigantes le profond silence de son âme. La tâche pénible de rendre compte de ses visions n’était pas encore venue pour Anne Catherine : elle n’était pas encore appelée à faire entrer dans le cadre étroit du langage humain des richesses spirituelles tellement surabondantes qu’elle-même ne pouvait les percevoir que par les rayonnements de la lumière prophétique, mais non sous une forme qui pût se traduire en paroles. Quoique les peines et les souffrances fussent des compagnes qui n’abandonnaient jamais la pieuse enfant, elles ne pouvaient pourtant troubler en aucune sorte le recueillement profond de son esprit dans la vie contemplative : et c’est pourquoi Anne Catherine, à un âge plus avancé, soupirait si souvent en se reportant à cette paix silencieuse et cachée de sa jeunesse et témoignait fréquemment en ces termes sa joyeuse reconnaissance envers Dieu :
« Dans mon enfance, disait-elle, j’étais continuellement absorbée en Dieu. Je faisais tout ce que j’avais à faire sans cesser d’être abstraite intérieurement et j’étais toujours en contemplation. Si j’allais avec mes parents aux champs ou à quelque autre travail, je n’étais jamais sur la terre. Tout y était pour moi comme un songe pénible et confus : ailleurs tout était clarté et vérité céleste. »
6. Notre Seigneur voulait être le guide et le maître d’Anne Catherine, non seulement dans la sphère de la contemplation, mais plus encore dans la pratique de la piété ; c’est pourquoi il entrait avec elle dans des relations d’une familiarité tout enfantine, pour la conduire pas à pas à la perfection et à la plus entière conformité avec lui. Tantôt il se montrait à elle sous la forme d’un enfant portant la croix sur ses épaules, et il la regardait sans rien dire afin que, touchée de sa patience, elle se chargeât aussi d’une lourde pièce de bois et la portât en priant aussi longtemps que ses forces le lui permettraient. Tantôt elle le voyait pleurer sur les mauvais traitements que lui faisaient souffrir des enfants insolents et indociles : et cette vue la faisait souvent se jeter au milieu des ronces et des orties afin d’apaiser le Seigneur par sa pénitence pour des fautes qui n’étaient pas les siennes. Quand elle faisait le chemin de la croix, il venait à elle et lui donnait sa croix à porter. Si elle était au champ ou occupée à garder les vaches, ce à quoi on l’employa dès l’âge de cinq ans, il la visitait sous la forme d’un enfant qui vient trouver ses compagnons afin de prendre part à leur travail et à leurs récréations : car il voulait lui apprendre par la parole et par l’exemple comment toutes ses actions devaient avoir pour but la gloire de Dieu. Il mettait en elle l’intelligence et l’aptitude à tout faire en vue de Dieu et lui apprenait à diriger vers le ciel jusqu’aux plaisirs et aux jeux du jeune âge.
7. Plus tard elle racontait à ce sujet des choses singulièrement gracieuses :
« Quand j’étais enfant, disait-elle, le petit garçon travaillait avec moi. Je me souviens qu’à l’âge de dix ans, je faisais déjà comme à présent. Je savais qu’il devait me naître un frère, je ne puis dire d’où je le savais : je désirais faire pour ma mère quelque chose qui pût servir à l’enfant et je ne savais pas encore coudre, mais le petit garçon vint me trouver ; il m’enseigna tout et m’aida à préparer un petit bonnet et d’autres objets à l’usage des enfants. Ma mère fut très étonnée que j’eusse pu en venir à bout, mais elle prit tout cela et s’en servit.
« Quand je commençai à garder les vaches, le petit garçon venait aussi me trouver et il faisait en sorte que les vaches se gardassent d’elles-mêmes. Nous parlions ensemble de toute espèce de bonnes choses, comme quoi nous voulions servir Dieu et aimer l’enfant Jésus et comme quoi Dieu voyait tout. J’étais souvent avec le petit garçon et rien ne nous était impossible quand nous étions ensemble. Nous causions, nous faisions des bonnets et des bas pour des enfants pauvres. Tout ce que je voulais, je le pouvais : j’avais aussi tout ce dont j’avais besoin. Souvent aussi des religieuses venaient nous trouver et c’étaient toujours des Annonciades. Chose singulière, j’arrangeais toujours tout et je croyais tout faire, mais en réalité c’était le petit garçon qui faisait tout. »
8. La bénédiction de ce commerce merveilleux se communiquait par Anne Catherine à tous ceux avec lesquels elle se trouvait en contact : c’étaient en particulier les enfants de son âge avec lesquels elle mettait en pratique les enseignements qu’elle avait reçus. Quand elle était parmi eux, elle savait parler d’une manière si attrayante de la présence de Dieu, de l’enfant Jésus et du saint ange gardien, que les autres enfants l’écoutaient avec grand plaisir et se pénétraient de ses paroles. Quand elle allait avec eux le long des sentiers champêtres sur lesquels ils recueillaient les chaumes, elle engageait la petite troupe à aller comme en procession en se souvenant que les saints anges étaient présents.
« Nous devons, leur disait-elle souvent, représenter le ciel sur la terre ; nous devons tout faire au nom de Jésus et nous rappeler toujours que l’enfant Jésus est au milieu de nous. Nous devons ne rien faire de mal et, quand nous le pouvons, empêcher que le mal se fasse ; si nous trouvons des collets pour prendre les lièvres et des pièges pour les oiseaux placés par de jeunes vauriens, nous les enlèverons afin qu’on ne fasse plus de ces voleries. Nous voulons peu à peu commencer un monde tout différent, afin qu’il y ait un ciel sur la terre. »
Jouait-elle dans le sable avec des enfants, ses adroites mains le façonnaient à l’imitation des saints lieux de Jérusalem tels qu’elle avait coutume de les voir dans ses visions. Plus tard elle racontait à ce propos :
« Dans mon enfance, si j’avais eu quelqu’un pour m’aider, j’aurais certainement été en état de reproduire la plupart des chemins et des lieux de la terre sainte, car je les avais toujours si présents sous les yeux qu’il n’y avait pas d’endroits que je connusse aussi bien. Quand j’étais aux champs ou que je jouais avec les enfants sur du sable humide ou sur un fond de terrain argileux, je façonnais dans le sable le mont Calvaire, le saint sépulcre avec son jardin, un petit cours d’eau avec un pont et des maisons sur ses bords. Je me souviens encore comment je joignais ensemble les maisons carrées vides et comment je découpais avec un copeau de singulières ouvertures représentant les fenêtres. Je me souviens aussi qu’une fois j’eus envie de faire les figures du Sauveur, des larrons, et de la sainte Mère au pied de la croix, mais je m’en abstins dans l’idée que ce serait une irrévérence. Un jour je jouais dans les champs avec deux enfants ; nous aurions bien voulu avoir une croix pour la placer dans la petite chapelle que nous avions faite en terre glaise et faire notre prière devant ; comme nous en avions grande envie et que pourtant nous ne savions comment en venir à bout, je m’écriai : « Je sais ce qu’il faut faire, tu vas en faire une avec du bois et en marquer l’empreinte dans la terre glaise ; j’ai un vieux couvercle d’étain, nous le ferons fondre sur des charbons et nous coulerons une belle croix. Je courus à la maison prendre le couvercle et des charbons, mais comme nous nous mettions à l’ouvrage, ma mère vint et je fus punie. »
9. Saint Jean-Baptiste aussi venait prendre part aux jeux d’Anne Catherine, tel qu’il était dans son enfance quand il vivait dans le désert sous la garde des anges et entretenait un commerce familier avec les créatures privées de raison. Quand elle gardait les vaches, elle l’appelait : « Je veux voir le petit Jean avec sa peau de mouton », disait-elle, et il venait lui tenir compagnie. Elle eut les visions les plus détaillées sur sa vie dans le désert ; dans leurs rapports enfantins, elle était instruite par lui à imiter dans toutes ses actions la simplicité et la pureté ineffables qui l’avaient rendu si agréable à Dieu. Fêtant avec lui le souvenir des évènements merveilleux de son enfance, elle était conduite dans la maison paternelle du Précurseur et dans tout le cercle de sa sainte parenté. Anne Catherine avait de tous ces personnages une connaissance si distincte et si vive qu’elle se sentait attirée à une touchante intimité avec eux et qu’elle se trouvait plus à l’aise dans leur compagnie que dans la chaumière paternelle.
10. Comment ce commerce mystérieux avec les personnages de l’histoire sainte s’intercalait-il dans la vie extérieure de l’enfant et comment lui donnait-il sa direction, c’est ce qu’on peut facilement reconnaître d’après les propres aveux d’Anne Catherine. Lorsque, dans ses dernières années, elle raconta les visions de la vie de Jésus, elle rendit ainsi compte de ce qui se passait en elle par rapport à ces sortes de contemplations.
« Depuis mon enfance, disait-elle, j’ai tous les ans, pendant le temps de l’Avent, accompagné pas à pas saint Joseph et la sainte Vierge dans leur voyage de Nazareth à Bethléem et je l’ai toujours fait jusqu’à présent de la même manière. La sollicitude qu’étant enfant j’éprouvais pour la sainte mère de Dieu à cause de son voyage et la part que je prenais à toutes les difficultés qu’elle rencontrait sur sa route étaient pour moi quelque chose d’aussi réel et d’aussi vivant que tout autre incident de ma vie extérieure. J’en étais même plus émue et j’y prenais un bien plus grand intérêt qu’à tout ce qui pouvait m’arriver d’ailleurs ; car Marie était pour moi la mère de mon Seigneur et de mon Dieu et portait sous son cœur mon salut. Tout ce qu’on célèbre dans une fête de l’Église n’était pas seulement pour moi un simple souvenir ou l’objet d’une méditation attentive, mais mon âme était conduite et attirée dans ces fêtes pour s’y mêler, comme si les mystères et les évènements qu’elles rappellent eussent été sous mes yeux et je voyais et sentais tout comme réel et présent devant moi. »
11. Une intuition si vivante ne pouvait demeurer renfermée dans l’intérieur de l’âme ; aussi l’influence s’en faisait-elle sentir dans toutes les actions d’Anne Catherine. Poussée par son tendre amour envers Marie, elle faisait avec un zèle enfantin tout ce qu’elle aurait pu faire si elle eût été réellement contemporaine de la sainte famille et si elle eût entretenu avec elle des rapports intimes. Si, par exemple, elle voyait Marie avec saint Joseph en voyage vers Bethléem, c’était de là qu’elle tirait l’intention et la pensée particulière dans laquelle elle faisait ses exercices de pénitence et ses mortifications. Quand elle allait prier pendant la nuit, elle s’arrêtait pour attendre Marie et elle s’était retiré la nourriture pour pouvoir l’offrir aux saints voyageurs fatigués. Elle prenait sur la terre nue son court repos de la nuit parce que son petit lit devait rester à la disposition de la mère de Dieu. Elle courait à sa rencontre sur le chemin, ou veillait en priant sous un arbre, parce qu’elle savait que Marie devait s’arrêter sous un arbre. Dans la nuit d’avant la naissance de Jésus, elle avait une si vive intuition de l’arrivée de la sainte Vierge dans la grotte de la crèche à Bethléem que, dans sa tendre sollicitude, elle allumait du feu afin que Marie ne souffrît pas du froid ou qu’elle pût s’apprêter de la nourriture ; tout ce qu’Anne Catherine pouvait prendre sur sa pauvreté pour le dépenser en dons charitables, elle le tenait prêt afin de l’offrir à la divine mère.
« Le bon Dieu », disait-elle un jour, « doit avoir pris plaisir à cette bonne volonté enfantine, car depuis mon enfance jusqu’à présent, chaque année, pendant l’Avent, il m’a tout fait voir de la même manière. Je suis toujours assise à une bonne petite place et je vois tout. Étant enfant, j’étais libre et familière avec lui : mais, devenue religieuse, j’étais beaucoup plus timide et plus réservée. La sainte Vierge, quand je le lui ai demandé avec beaucoup de ferveur, a mis souvent l’enfant Jésus dans mes bras. »
12. Ces tendres et intimes rapports avec Dieu et ses saints allumaient dans le cœur de l’enfant un désir, ou plutôt une soif ardente de pureté et de pénitence qui ne pouvait être apaisée que par le renoncement et la souffrance ; et les contemplations sanctifiantes dont son âme était nourrie fortifiaient puissamment en elle un sentiment infiniment délicat pour tout ce qui était pur, innocent et saint, tandis que d’un autre côté elle était remplie de répugnance et d’horreur pour tout ce qui était faute ou corruption, souillure ou impureté et pour tout ce qui pouvait y conduire. Ce saint instinct était pour elle un guide infaillible auquel elle pouvait se fier en toute sûreté comme à son ange gardien. Il augmentait en délicatesse et en énergie à mesure qu’Anne Catherine suivait avec plus de zèle l’impulsion intérieure par laquelle l’Esprit-Saint l’excitait à exercer sur ses sens et sur sa conscience une surveillance scrupuleuse, correspondante à l’abondance des grâces dont son âme était enrichie. Avant que la corruption du monde déchu eût pu toucher ses yeux, elle avait connu par ses visions l’état d’innocence tel qu’il existait dans le paradis et la splendeur de la grâce sanctifiante ; elle avait le sentiment de la valeur infinie des mérites du saint Rédempteur qui a voulu rendre aux hommes tombés la pureté qu’ils avaient perdue, avant de savoir quels dangers menacent cette innocence : c’est pourquoi son amour pour la pureté ressemblait à une flamme qui dévorait tout ce qui aurait pu troubler son âme avant qu’elle en pût être touchée.
Le directeur de sa conscience, Overberg, a rendu ce témoignage : « Anne Catherine, depuis son enfance, n’a jamais ressenti un mouvement sensuel, et elle n’a jamais eu à s’accuser d’une faute contre la pureté, même en pensée. Interrogée de nouveau sur cette absence complète de toute tentation d’impureté, l’obéissance lui a fait avouer que, d’après ce qui lui avait été montré une fois en vision, elle y aurait été portée par nature, mais qu’à l’aide de ses mortifications précoces et de sa persévérance à surmonter toutes ses autres inclinations et à réprimer tous ses désirs, elle avait déraciné les mauvais penchants avant qu’il eussent pu se faire sentir chez elle. »
13. Son sentiment constant à l’égard de la pureté se manifestait dans sa première jeunesse d’une manière singulièrement touchante comme on peut le voir par la communication suivante qu’elle fit un jour qu’elle avait à raconter ses contemplations touchant le Paradis.
« Je me souviens qu’à l’âge de quatre ans, un jour que mes parents me conduisaient à l’Église, j’avais la ferme confiance que j’y verrais Dieu et des personnes tout autres que celles que je connaissais, bien plus belles et plus brillantes. Lorsque j’y entrai, je regardais de tous les côtés et il n’y avait rien de ce que je m’étais figuré. Le prêtre à l’autel, me disais-je, ce pouvait être Dieu ; mais je cherchais la sainte vierge Marie ; je pensais que là, ils devaient avoir tout le reste au-dessous d’eux, car telle était mon idée ; mais je ne trouvai rien de ce que je m’imaginais. Plus tard j’eus encore ces pensées et je regardais toujours deux bonnes dévotes qui portaient des capuchons et semblaient plus modestes que les autres : je me disais que ce pourrait bien être ce que je cherchais, mais ce n’était pas cela. Je croyais toujours que Marie devait avoir un manteau bleu céleste, un voile blanc et là-dessous une robe blanche très simple. J’eus alors la vue du Paradis et je cherchai dans l’Église Adam et Ève avant la chute, beaux comme ils étaient alors : et je me disais : « Quand tu te seras confessée, tu les trouveras. » Mais même alors je ne les trouvai pas. Je vis enfin dans l’Église une pieuse famille noble ; les filles étaient habillées tout en blanc. Je pensais qu’elles avaient un peu de ce que je cherchais et je me sentis un grand respect pour elles, mais ce n’était pas encore cela. J’avais toujours l’impression que tout ce que je voyais était devenu très laid et très sale. J’étais continuellement plongée dans des pensées de ce genre et j’en oubliais le boire et le manger, en sorte que j’entendais souvent mes parents dire : « Qu’a donc cette enfant ! qu’est-il arrivé à Anne Catherinette ? »
« Souvent, dans mon enfance, je me plaignais à Dieu très familièrement de ce qu’il avait fait telle ou telle chose. Je ne pouvais pas comprendre comment Dieu avait pu laisser naître le péché, lui qui avait tout dans sa main ; surtout l’éternité des peines de l’enfer me paraissait d’une dureté incompréhensible. Mais alors je voyais des tableaux qui m’avertissaient et m’instruisaient si bien que je fus parfaitement convaincue que Dieu est infiniment bon et infiniment juste, et que, si j’avais voulu faire quelque chose selon mes idées, c’eût été bien misérable. »
14. Après tout ce que nous avons fait connaître d’Anne Catherine, il sera permis de lui appliquer ce que maître Sébastien de Pérouse a dit de la bienheureuse Colombe de Rieti :
« Cette enfant était née pour être soustraite à toute sensualité, se fondre au feu de la charité et s’enflammer de l’amour de Dieu et du prochain. Elle était si bien affermie dans cette sainte vocation qu’elle ne pouvait être ni déconcertée par les insinuations de l’esprit malin, ni troublée par les excitations de l’orgueil, ni atteinte par l’aiguillon de la chair. » Comment en effet l’âme d’Anne Catherine aurait-elle pu recevoir la lumière dans sa plénitude, si elle n’avait pas habité un corps qui, chaste comme un lis, ne pouvait jamais sentir dans ses membres une autre loi que celle qui en faisait la propriété du Seigneur ?
IV
SON ÉDUCATION DANS LA MAISON PATERNELLE.
1. En apprenant à connaître les heureux parents à la garde et au soin desquels le Seigneur avait confié un trésor si précieux, nous rencontrons un nouveau témoignage de la merveilleuse sollicitude avec laquelle sa Providence dispose jusque dans les plus petits détails les circonstances et les relations au milieu desquelles doivent vivre ses instruments choisis, afin que tout puisse servir à l’accomplissement de la tâche qui leur a été assignée de toute éternité.
Anne Catherine était l’enfant de parents vraiment pieux pour lesquels les bénédictions répandues sur une pauvreté toujours contente, parce qu’elle était dévouée à Dieu, suppléaient ce qui leur manquait du côté du bien-être matériel. Toute leur vie offrait à l’enfant le tableau d’un ménage ordonné d’après les prescriptions de la foi chrétienne, et elle reçut, grâce à leur douce fermeté, l’éducation la mieux appropriée à ses dons et à sa vocation. La maison paternelle était pour Anne Catherine une école de piété et, dans ses dernières années, elle se rappelait encore avec un cœur reconnaissant les avis qu’elle avait reçus de ses bons parents et les habitudes pieuses et réglées auxquelles elle avait été formée par eux. C’était pour elle une douce consolation que d’en parler et de là vient qu’on peut décrire toute la vie des parents avec les propres paroles de leur fille.
2. « Mon père avait beaucoup de piété et de droiture. Il était d’un caractère sérieux, mais sans tristesse. Sa pauvreté l’obligeait à se donner beaucoup de peine et il était très laborieux : cependant il n’était pas âpre au gain. Il remettait tout entre les mains de Dieu avec une confiance d’enfant, et faisait son rude travail, comme un serviteur fidèle, sans inquiétude et sans cupidité. Sa conversation était pleine de beaux et simples proverbes et de pieuses et naïves locutions. Il nous racontait un jour, pendant notre enfance, l’histoire d’un grand homme appelé Hun, qui avait parcouru le monde, et alors je rêvais que je voyais ce grand homme parcourir la terre et, avec une grande pelle, retourner, ici du bon terrain, là du mauvais. Comme mon père était fort laborieux, il me fit beaucoup travailler dès ma petite enfance. Été comme hiver, il me fallait avant le jour sortir dans le champ pour aller chercher le cheval. C’était du reste un méchant animal : il ruait, mordait et s’enfuyait souvent devant mon père ; mais il se laissait prendre par moi sans difficulté ; il courait même quelquefois à ma rencontre. Bien souvent je montais sur son dos à l’aide d’une pierre ou d’une élévation de terrain et je revenais ainsi à la maison. Il tournait quelquefois la tête et voulait me mordre, mais je lui donnais un coup sur le nez et alors il allait tranquillement jusqu’à la maison. Je me servais aussi de lui pour transporter certains produits des champs ou des engrais. Maintenant je ne peux pas comprendre comment une aussi faible enfant que je l’étais pouvait en venir à bout.
3. « Quand mon père, de grand matin, m’emmenait avec lui aux champs, au moment où le soleil se levait, il ôtait son chapeau, priait et parlait de Dieu qui fait lever si magnifiquement son soleil sur nous. Souvent aussi il disait que c’était une mauvaise chose et dont il fallait avoir horreur que de rester assez tard au lit pour que le soleil brille sur nous pendant que nous dormons : car de là viennent bien des choses qui amènent la ruine des maisons et des familles, des pays et des gens. Là-dessus je lui dis une fois : « Cela ne me regarde pas, car le soleil ne peut pas arriver jusqu’à mon lit. » Et il me répondit : « Quand même tu ne vois pas le soleil lorsqu’il est levé, lui voit tout et brille partout. » Cela me fit beaucoup réfléchir.
« Quand nous sortions ensemble le matin avant qu’il fît jour, mon père me disait aussi : « Vois ! personne encore n’a marché dans la rosée ! nous sommes les premiers et, si nous prions bien dévotement, nous attirerons des bénédictions sur la terre et sur les champs. Il est si bon de pouvoir marcher dans la première rosée à laquelle on n’a pas encore touché : il y a là encore une bénédiction toute fraîche, aucun péché n’a encore été commis dans les champs, on n’y a dit aucune mauvaise parole. Lorsqu’on sort quand la rosée a été partout foulée aux pieds des gens, c’est comme si tout était sali et gâté. »
4. « Quoique je fusse toute petite et bien faible, on m’employait pourtant, tantôt à la maison, tantôt chez des parents, à un pénible travail. Et les choses s’arrangeaient toujours pour que j’eusse à travailler rudement. Je me souviens qu’une fois j’eus à placer sur la charrette environ vingt charges de blé, et je fis cela sans m’arrêter et plus vite qu’un fort garçon. Je travaillais aussi vigoureusement à couper et à lier.
« Il me fallait aller aux champs avec mon père, conduire le cheval, recueillir les œufs et faire toute espèce de travaux manuels. Quand nous nous retournions ou que nous nous arrêtions un moment, il disait : « Comme cela est beau ! regarde ! nous pouvons voir droit devant nous, à Coesfeld, l’Église où est le Saint-Sacrement et adorer notre Seigneur. Il nous voit de son côté et bénit tout notre travail. » Quand on sonnait pour la sainte messe, il ôtait son chapeau, faisait une prière et disait : « Maintenant il nous faut suivre toute la sainte messe. » Et pendant le travail, il disait encore : « Maintenant le prêtre en est au Gloria : maintenant il en est au Sanctus, et nous devons à présent faire avec lui telle et telle prière et nous signer. » Après cela il chantait quelquefois un verset ou sifflait un petit air. Et quand je prenais les œufs, il disait : « On parle beaucoup de miracles et pourtant nous ne vivons que de miracles et de la pure grâce de Dieu. Vois le petit grain de blé dans la terre ! Il est là et il en sort une longue tige qui le reproduit au centuple ! N’est-ce pas là aussi un grand miracle ? »
« Les dimanches après le dîner, mon père nous redisait toujours le sermon et nous expliquait tout de la manière la plus édifiante. Il nous lisait en outre l’explication du saint Évangile. »
5. Tels étaient aussi les sentiments et la piété de la mère d’Anne Catherine qui, dans l’espace de vingt et un ans, avait donné neuf enfants à son mari. Elle avait eu le premier en 1766 et le dernier en 1787. Le travail incessant et la peine qu’elle avait eue à prendre pendant sa vie de mère de famille, que rendait du reste heureuse et contente le fidèle attachement de son mari, lui avaient donné quelque chose de grave et d’austère, mais son cœur avait conservé une grande douceur et une bienveillance inaltérable envers tout le monde. Plus elle avait de peine à se donner, ainsi que son mari, afin de procurer à eux et à leurs enfants l’entretien convenable, moins elle paraissait connaître la sollicitude inquiète ou l’insensibilité, moins elle pensait à se plaindre de sa pénible position. Bien plus, cette mère, toute remplie de l’esprit de prière, en était venue à regarder comme une grâce les travaux et les fatigues et ne pensait qu’à se mettre en mesure d’être trouvée au jugement de Dieu une fidèle ménagère : Voici ce que plus tard Anne Catherine disait d’elle :
« C’est ma mère qui m’a donné les premières leçons de catéchisme ; sa maxime favorite était : « Seigneur, que votre volonté se fasse et non pas la mienne ! » et encore cette autre : « Seigneur, donnez-moi la patience et alors frappez fort. » Je ne les ai jamais oubliées. Quand je jouais avec d’autres enfants, ma mère disait toujours : « Lorsque les enfants jouent ensemble bien pieusement, les anges sont là avec eux ou même le petit enfant Jésus. » Je prenais cela comme une vérité certaine et ne m’en étonnais pas du tout ; je regardais souvent le ciel avec un désir curieux, pour voir s’ils venaient ; je croyais même souvent qu’ils étaient au milieu de nous. Afin qu’ils ne manquassent pas à venir, nous jouions toujours à des jeux innocents et pieux. – Quand je devais aller à l’église ou ailleurs avec d’autres enfants, je marchais en avant ou en arrière, afin de ne rien voir ou entendre de mauvais sur la route. Ma mère me l’avait recommandé et m’avait exhortée à faire tout en marchant, tantôt une prière, tantôt une autre. Lorsque je faisais le signe de la croix sur le front, sur la bouche et sur la poitrine, je me disais que c’étaient là des clefs grâce auxquelles rien de mauvais ne devait entrer dans les pensées, la bouche et le cœur. Seulement c’est l’enfant Jésus qui doit avoir ces clefs : alors tout ira bien. »
6. Anne Catherine n’apercevait rien dans toute la vie de ses parents qui ne fût réglé suivant les commandements de Dieu et les pratiques de l’Église, et elle voyait que les seules joies et les seules consolations qui fissent diversion à leur travail et à leurs soucis continuels leur venaient des saintes fêtes de l’Église, dont la célébration remplissait leur cœur d’une piété joyeuse. Ces âmes simples étaient si bien faites pour ce bonheur surnaturel que, malgré les peines et les fatigues dont leur existence était remplie, elles conservaient toujours une sympathie prête à tous les sacrifices pour les nécessités corporelles et spirituelles de leurs semblables. Son père Bernard, quelque las qu’il fût des travaux de la journée, n’oubliait jamais d’avertir ses enfants à l’entrée de la nuit de prier pour les voyageurs, pour les pauvres soldats et les compagnons ouvriers délaissés, et il leur lisait des prières à cette fin. Pendant les jours du carnaval, la mère ordonnait aux enfants de dire quatre fois le Pater, prosternés et les bras étendus, pour prévenir les atteintes portées à l’innocence pendant ces jours-là : « Enfants, leur disait-elle, vous ne savez pas et ne comprenez pas cela, mais moi je le sais bien. Priez. »
La communication suivante d’Anne Catherine montre comment le bon Dieu faisait fructifier la parole et l’exemple des parents dans les âmes bien disposées des enfants :
« Quand j’étais encore toute jeune, mon frère aîné et moi couchions dans la même petite chambre. Il était pieux et souvent la nuit nous priions ensemble, agenouillés devant nos lits et les bras étendus en croix. Je vis plusieurs fois la petite chambre tout éclairée. Souvent, quand nous avions longtemps prié, j’étais relevée violemment et j’entendais une voix qui disait : « Va-t’en dans ton lit ! » Alors mon frère avait grand-peur, mais moi je prolongeais ma prière. Mon frère aussi fut souvent dérangé et effrayé par l’esprit malin pendant qu’il priait ; une fois mes parents le trouvèrent à genoux, les bras étendus et tout raidi par le froid. »
7. De même que l’humble simplicité de ces bons parents ne leur permettait pas de rien voir d’extraordinaire dans la manière dont ils pratiquaient sans relâche les devoirs de vrais chrétiens, de même il ne leur venait pas dans l’esprit de s’enorgueillir de beaucoup de phénomènes étonnants qu’ils avaient vus de bonne heure dans leur enfant. Ils éprouvèrent sans doute une profonde émotion, qui leur fit verser des larmes de reconnaissance, quand l’abondance des grâces déposées dans l’âme de leur enfant se manifesta à eux ; mais ils s’efforcèrent de cacher leur étonnement, et leur conduite resta la même avant comme après. Ce que la mère trouvait de défectueux dans Anne Catherine, elle le blâmait aussi sévèrement que chez ses autres enfants et, dès son plus jeune âge, on ne la dispensa d’aucun travail ni d’aucune participation aux occupations de la famille. C’est ainsi qu’elle fut maintenue dans la plus heureuse ignorance d’elle-même, et jamais la naïveté de sa candide humilité ne fut troublée par des louanges, par des marques d’admiration ou par une curiosité indiscrète. Sa vie intérieure si riche resta inconnue et cachée au dehors, mais elle s’épanouit avec une beauté toujours croissante, sous la conduite et la sévère direction de son ange, qui réglait tous ses sentiments, toutes ses pensées, toutes ses paroles, et maintenait son esprit ardent dans la pratique continue d’une parfaite obéissance.
8. Son père et sa mère lui portaient une affection plus qu’ordinaire, mais il n’était pas dans leur nature de la manifester par des tendresses particulières. Bernard, son père, éprouvait le besoin d’avoir près de lui, quand il travaillait aux champs, son enfant si gentille et si avisée ; il trouvait dans ses paroles, dans ses réponses, dans toute sa manière d’être, une si vive satisfaction, qu’il ne pouvait pas se passer d’elle longtemps. La mère était trop absorbée par les soins à donner à ses plus jeunes enfants pour pouvoir s’occuper autant que lui d’Anne Catherine. L’humeur enjouée du père s’était transmise à celle-ci et elle s’entendait à récréer par un aimable badinage les travaux journaliers de cet homme laborieux. Elle était naturellement gaie, comme ne pouvait manquer de l’être une enfant innocente et pure, favorisée d’un commerce si intime et si merveilleux avec Dieu et avec les saints. Sous son front élevé et bien conformé brillaient des yeux d’un brun clair, dont le doux éclat rehaussait la sérénité qui reluisait dans toute sa personne. Sa chevelure, de couleur foncée, était rejetée en arrière du front et des tempes sans être partagée, arrangée en tresses ou roulée autour de la tête. Sa jolie voix argentine et sa parole facile trahissaient la vivacité de son esprit, et elle parlait sans embarras de choses qui paraissaient mystérieuses et énigmatiques à l’entourage au milieu duquel elle vivait : mais sa réserve pleine de simplicité et d’humilité adoucissait promptement l’impression que pouvait produire l’éclat subit de ses dons supérieurs. Nul ne pouvait s’empêcher de l’aimer, mais elle ne laissait à personne le temps de s’émerveiller d’elle. Elle était si douce, si bonne ; son empressement à aider, à rendre service était si aimable et si engageant, que jeunes et vieux venaient à la petite Anne Catherine, près de laquelle, en toute occasion, ils trouvaient assistance et conseil. Tous savaient qu’il n’y avait aucun bien ni aucun plaisir qu’elle ne fût prête à sacrifier pour les autres ; et ces simples campagnards étaient accoutumés à la bénédiction qui sortait de cette enfant comme à la senteur du romarin qu’ils cultivaient dans leurs jardins. Elle-même racontait un jour :
« Dès mon enfance, les voisins avaient recours à moi pour bander toute espèce de blessures, parce que je le faisais doucement et avec précaution, et que j’étais adroite de mes mains. Quand je voyais un abcès, je me disais : Si tu le presses, il deviendra pire, mais pourtant il faut que le mal sorte. Et ainsi j’en vins à les sucer doucement, et les plaies guérissaient. Personne ne m’avait appris cela ; j’y fus poussée par le désir de me rendre utile. Dans le premier moment, je sentis du dégoût ; mais cela me porta à me surmonter, parce que le dégoût n’est pas une compassion véritable. Quand je le surmontais promptement, j’étais pleine de joie et d’émotion. Je pensais à Notre-Seigneur, qui a fait cela pour tout le genre humain. »
9. La couleur de son visage changeait parfois, passait du vermeil fleuri à une pâleur livide, et ses yeux brillants s’éteignaient si subitement qu’elle était à peine reconnaissable. Un profond sérieux faisait disparaître sa gaieté naïve, et une tristesse inexplicable pour ceux qui l’entouraient passait sur son front, en sorte que ses parents inquiets se demandaient souvent ce qui adviendrait de cette enfant. La cause de ce changement subit était la vue de misères et de souffrances étrangères qui s’offraient à l’œil intérieur et non à celui du corps. De même qu’Anne Catherine ne pouvait entendre prononcer le nom de Dieu ou d’un saint sans tomber en contemplation, de même pour peu qu’on parlât d’un accident ou d’un malheur, elle était prise d’une telle compassion et d’un tel désir de secourir le prochain et de s’offrir pour lui comme victime expiatoire, que son âme était emportée avec une force irrésistible jusqu’au lieu où l’on souffrait. Bientôt elle éprouvait les atteintes de la souffrance du prochain comme si c’eût été la sienne propre : toutefois, la certitude que cette compassion procurerait soulagement et secours la consolait et la fortifiait, et le feu de la charité allait toujours croissant dans son cœur. Mais ses parents, ses frères et ses sœurs avaient peine à se rendre compte des singulières allures de l’enfant ; c’était surtout la mère, dont la sollicitude et l’angoisse pouvaient facilement devenir du mécontentement quand elle voyait que la langueur et la maladie disparaissaient aussi vite que l’avaient fait précédemment la santé et la fraîcheur. Il lui arrivait assez fréquemment de prendre ces rapides changements pour du caprice et de la fantaisie et elle croyait par des blâmes sévères et des punitions prémunir Anne Catherine contre ces défauts. C’est pourquoi elle allait quelquefois, dans son irritation, jusqu’à repousser ou châtier rudement Anne Catherine quand celle-ci, par l’effet de la compassion et des souffrances intérieures, était à peine en état de se tenir debout. Mais ce châtiment immérité était supporté avec tant de patience et de soumission, Anne Catherine restait si affectueuse et de si bonne humeur, que le père et la mère se disaient l’un à l’autre : « Quelle étrange enfant c’est là ! qu’adviendra-t-il d’elle, et n’est-il pas à craindre qu’elle perde la raison ? » Ce n’étaient pas seulement les avis intérieurs de l’ange qui portaient Anne Catherine à accepter tout cela simplement pour l’amour de Dieu, car son sentiment à elle-même était qu’elle méritait toute espèce de punition.
« Dans ma jeunesse, disait-elle, j’étais irritable et fantasque, et j’ai souvent été punie par mes parents à cause de cela. J’avais beaucoup de peine à me donner pour mortifier mon humeur capricieuse. Comme mes parents me blâmaient souvent et ne me louaient jamais, tandis que j’entendais d’autres parents faire l’éloge de leurs enfants, je me regardais comme la plus méchante enfant du monde et souvent j’étais très inquiète à la pensée que j’étais mal avec Dieu. Mais, un jour, ayant vu d’autres enfants se mal comporter envers leurs parents, quoique cela me fît de la peine, je repris courage et je me dis : Je dois pourtant avoir encore de l’espérance du côté de Dieu, car je ne pourrais jamais rien faire de pareil. »
10. Rien ne pouvait être plus difficile pour Anne Catherine que de maîtriser sa grande vivacité et de briser son sens et sa volonté propre de façon à ne paraître vivre que selon la volonté d’autrui. La sensibilité exquise de toute sa personne, la tendresse de son cœur, qui était blessé continuellement par mille choses auxquelles d’autres n’eussent pas fait attention, son zèle ardent pour la gloire de Dieu et le salut du prochain l’obligeaient à des efforts sans relâche pour arriver à une douceur fondée sur l’oubli d’elle-même et à une obéissance si humble que le premier mouvement de résistance fût vaincu dès sa naissance. Cependant son âme courageuse parvint à remporter cette victoire et sa fidélité persévérante fut récompensée de Dieu à ce point qu’elle put dire plus tard :
« L’obéissance était ma force et ma consolation. Grâce à l’obéissance, je pouvais prier joyeuse et contente ; je pouvais être avec Dieu et mon cœur restait libre. »
Non seulement elle se jugeait la moindre et la dernière des créatures, mais encore elle se sentait telle, et c’était conformément à ce sentiment vivant au fond de son âme qu’était réglée toute sa conduite, à l’extérieur et à l’intérieur. Le saint ange ne tolérait en elle aucune imperfection : il punissait chaque faute par des réprimandes et des pénitences qui étaient fort douloureuses et laissaient toujours dans l’âme une profonde humiliation. De là venait qu’Anne Catherine se jugeait elle-même avec une grande sévérité et s’imposait des punitions corporelles pour chaque manquement tandis que son cœur surabondait de bonté et d’indulgence envers les autres. Dans sa cinquième année, elle regarda un jour à travers la haie d’un jardin une pomme tombée sous l’arbre avec le désir enfantin de la manger. À peine en avait-elle eu la pensée qu’elle éprouva un vif repentir de cette convoitise, au point de s’imposer pour pénitence de ne plus toucher à une pomme, résolution qu’elle observa toujours de la manière la plus consciencieuse.
Une autre fois, elle eut un mouvement d’aversion pour une paysanne, parce que celle-ci avait mal parlé de ses parents, et se proposa de passer devant elle sans la saluer. Elle le fit avec un serrement de cœur. Mais elle en eut un tel repentir, qu’elle revint sur ses pas et demanda pardon à la paysanne de son impolitesse. Lorsqu’elle commença à s’approcher du sacrement de pénitence, sa conscience délicate ne retrouvait le repos, après des manquements de ce genre, que quand elle s’en était accusée à son confesseur avec un repentir sincère, sans rien adoucir ni dissimuler, et, quand elle avait reçu de lui pénitence et absolution.
11. Pour que des souffrances intérieures si précoces et la rigueur d’une vie si pénitente laissassent subsister dans le cœur d’Anne Catherine la gaieté innocente de l’enfance, Dieu, dans sa bonté, lui donna une compensation : ce fut la joie qu’excitait sans cesse en elle la contemplation de la grandeur et de la magnificence divines dans la création et le commerce qu’elle entretenait avec les créatures privées de raison. Était-elle seule dans les bois ou dans les champs, elle appelait les oiseaux, chantait avec eux les louanges de Dieu et les caressait pendant qu’ils se posaient familièrement sur ses bras et sur ses épaules. Si elle trouvait un nid, elle regardait dedans avec une joie qui faisait battre son cœur et adressait aux petits ses plus douces paroles. Elle connaissait tous les lieux où se montraient au printemps les premières fleurs et elle allait les cueillir pour en tresser des couronnes à l’enfant Jésus et à la vierge Marie. Mais son œil éclairé par la grâce pénétrait encore plus loin. Pendant que d’autres enfants s’amusaient à feuilleter des livres d’images et se plaisaient plus à regarder des fleurs et des animaux coloriés que les riches couleurs de la nature vivante, pour Anne Catherine les créatures elles-mêmes étaient les images dans lesquelles elle admirait avec un regard joyeux la sagesse et la bonté de Dieu. Elle connaissait leur nature et leurs propriétés : aussi disait-elle en communiquant ses visions touchant la vie de saint Jean-Baptiste :
« Je n’ai jamais pu m’étonner de voir comment Jean avait appris tant de choses des fleurs et des animaux dans le désert, car pour moi-même, lorsque j’étais enfant, chaque feuille, chaque petite fleur était un livre dans lequel je savais lire. J’avais le sentiment de la signification et de la beauté de toutes les couleurs et de toutes les formes ; mais, quand je voulais en parler, on se moquait de moi. Quand j’allais dans la campagne, je pouvais m’entretenir avec toutes choses. J’avais reçu de Dieu un sens pour tout comprendre et je voyais dans l’intérieur des fleurs et des animaux. Combien cela m’était doux ! Étant encore très jeune, j’eus une fièvre qui ne m’empêchait pourtant pas d’aller et de venir. Mes parents croyaient que je mourrais bientôt ; alors un bel enfant vint à moi et me montra des herbes que je devais cueillir et manger pour guérir. Il y avait entre autres le doux suc des fleurs du liseron. Je mangeai de ces herbes et, assise près d’une haie, je pris des liserons que je suçai. Je fus bientôt guérie. J’aimais surtout les fleurs de camomille. Leur nom même a pour moi je ne sais quoi de doux et d’aimable. J’en ramassais dès mon plus jeune âge et je les tenais prêtes pour de pauvres malades qui venaient volontiers me trouver, me montraient un mal ou une plaie et me demandaient ce que j’en pensais. Il me venait alors à l’esprit toutes sortes de remèdes innocents qui opéraient leur guérison. »
12. Une autre communication nous montre comment la belle et sainte ordonnance de l’Église lui était manifestée avec ses invisibles merveilles.
« Dès mon enfance, dit-elle, le son des cloches bénites me faisait l’effet de rayons de bénédiction, qui, partout où ils atteignent, chassent l’influence nuisible des puissances ennemies. Je crois fermement que les cloches bénites effraient Satan. Quand, dans ma jeunesse, je priais la nuit dans les champs, je sentais et je voyais souvent de mauvais esprits autour de moi : mais, aussitôt que les cloches sonnaient les matines à Coesfeld, je m’apercevais qu’ils s’enfuyaient. Mon impression était toujours que, quand la langue des prêtres se faisait entendre au loin, comme dans les premiers temps de l’Église, il n’y avait pas besoin de cloches ; maintenant il faut ces langues de bronze pour appeler les fidèles. Tout doit être au service du Seigneur Jésus pour multiplier les moyens de salut et nous protéger contre l’ennemi des âmes. Il a donné sa bénédiction aux prêtres, afin que, sortant d’eux, elle pénètre toutes choses, pour faire tout servir à sa gloire et qu’elle exerce son efficacité de près et de loin. Mais, quand l’esprit s’est retiré des prêtres et que les cloches seules répandent encore la bénédiction et chassent les puissances mauvaises, c’est comme un arbre dont le sommet fleurit, recevant encore la sève par l’écorce, mais dont la moelle est desséchée. Le son des cloches bénites me frappe comme essentiellement plus saint, plus joyeux, plus fortifiant, plus doux que tous les autres sons, lesquels me paraissent sourds et confus en comparaison ; même le son de l’orgue de l’église, comparé au leur, manque d’énergie et de grandeur. »
13. Le langage de l’Église faisait sur Anne Catherine une impression encore plus vive que le son des cloches. Les prières latines de la messe et de toutes les cérémonies de l’Église lui étaient aussi intelligibles que sa langue maternelle, si bien qu’elle crut longtemps que toutes les personnes pieuses et croyantes devaient les comprendre comme elle.
« Jamais, disait-elle un jour, je ne me suis aperçue de la différence des langues dans le service divin, parce que je ne percevais pas seulement les mots, mais les choses elles-mêmes. »
14. En ce qui touche la force et l’action bienfaisante de la bénédiction sacerdotale, Anne Catherine en avait le sentiment si vif et si profond, qu’elle se sentait attirée involontairement quand un prêtre passait dans le voisinage de la demeure paternelle. Elle courait au-devant de lui et lui demandait sa bénédiction. Si elle se trouvait occupée à garder les vaches, elle les recommandait à l’ange gardien et courait au prêtre qui passait pour avoir sa bénédiction.
15. Elle portait sur sa poitrine dans un sachet le commencement de l’Évangile de saint Jean. Voici ce qu’elle dit à ce sujet :
« Dès mon enfance, l’Évangile de saint Jean était pour moi une source de lumière et de force et comme une bannière. Toutes les fois que j’avais une crainte ou que je courais un danger, je disais avec une ferme confiance : Et le Verbe s’est fait chair, et il a habité parmi nous. Je ne pus comprendre plus tard certains ecclésiastiques auxquels j’entendis dire que cela était inintelligible. »
16. De même qu’Anne Catherine était saisie d’une vive émotion et d’un profond sentiment de respect envers les choses bénites et les lieux sanctifiés, de même qu’elle en ressentait l’effet comme celui d’une nourriture et d’un réconfort spirituels, de même il y avait des lieux où elle sentait avec horreur et épouvante qu’il s’y était fait du mal et qu’une malédiction y reposait. Puis elle était saisie d’une profonde compassion et se sentait poussée à y prier et à y faire des pénitences expiatoires. Elle racontait ainsi un incident de sa jeunesse :
« À peu de distance de notre maison, au milieu de champs fertiles, se trouve un coin de terre où il ne vient jamais rien. Quand je passais là, étant enfant, j’avais toujours un frisson ; c’était comme si j’eusse été repoussée, et plusieurs fois je fis là des chutes que rien de particulier n’occasionnait. Je vis une fois deux ombres noires qui erraient à l’entour, et je m’aperçus que les chevaux, lorsqu’ils s’approchaient de là, se montraient effrayés. Ayant eu souvent l’impression de ce qu’il y avait de sinistre dans cet endroit, je pris des informations auprès de gens qui prétendaient, mais faussement, avoir vu là des choses de toute espèce. Plus tard, mon père me dit qu’à l’époque de la guerre de Sept-Ans, un soldat hanovrien avait été fusillé dans cet endroit, après sa condamnation par le tribunal militaire, mais que cet homme était innocent et que deux autres avaient été les auteurs de son malheur. Lorsque j’appris cela, j’avais déjà fait ma première communion. J’allai prier la nuit dans cet endroit, les bras en croix. La première fois, il me fallut prendre fortement sur moi : la seconde fois, il vint un horrible fantôme semblable à un chien, qui mit par derrière sa main sur mon épaule. Je me retournai et je vis ses yeux flamboyants et son museau. Je fus saisie d’effroi, cependant je ne me laissai pas déconcerter et je dis en moi-même : « Seigneur, vous aussi, étant dans l’angoisse, sur le mont des Oliviers, vous vous êtes remis plusieurs fois à prier ; vous êtes près de moi. » Le malin esprit ne put rien me faire. Et je recommençai à prier de nouveau : alors l’horrible objet s’éloigna. Lorsque je retournai prier en cet endroit, je fus violemment enlevée comme si j’allais être jetée dans une fosse qui était près de là. Je mis toute ma confiance en Dieu et je dis : « Satan, tu ne peux rien sur moi ! » Et il disparut. Je continuai à prier avec ardeur. Depuis, je ne vis plus les ombres, et tout resta tranquille.
« J’avais aussi, quoiqu’on ne m’eût rien raconté à ce sujet, un sentiment d’horreur et de repoussement aux endroits où il y avait eu des tombeaux de païens. Ainsi, il y a, à peu de distance de notre maison, une prairie et une butte de sable où je n’aimais pas à garder les vaches, parce que j’y voyais toujours une vapeur noire et sinistre, semblable à celle que produisent des chiffons qui brûlent, ramper à ras de terre sans jamais s’élever. Je remarquai aussi souvent là un obscurcissement particulier et je vis de sombres figures, répandant les ténèbres autour d’elles, errer çà et là et disparaître sous la terre. Je me disais souvent en moi-même comme une enfant que j’étais : « Il est bon que vous ayez d’épais gazons sur la tête, parce qu’ainsi vous ne pouvez rien nous faire. » Plus tard, j’ai vu souvent que, quand on bâtissait des maisons neuves dans des places comme celles-là, il sortait une malédiction de ces sombres ossements, si les habitants n’étaient pas pieux, s’ils ne menaient pas une vie sanctifiée par la bénédiction de l’Église et s’ils n’arrêtaient pas par là les effets de cette malédiction. Mais quand ils se servaient pour détourner le mal de moyens superstitieux et condamnés par l’Église, ils entraient, sans le savoir, en rapport avec les puissances de ténèbres, et l’esprit malin acquérait plus de pouvoir sur eux. Je ne puis guère rendre ces choses claires pour d’autres, parce que je les vois de mes yeux, tandis qu’ils ne les perçoivent que par la pensée. Mais je trouve souvent plus difficile à comprendre comment pour tant de personnes il n’y a pas de différence entre ce qui est saint et ce qui est profane, entre le croyant et l’incrédule, entre ce qui est purifié et ce qui ne l’est pas : ils ne voient partout que l’apparence extérieure, la couleur ; ils ne s’inquiètent que de savoir si l’on peut manger d’une chose ou si on ne le peut pas, si on peut en faire de l’argent ou non, tandis que je vois et sens tout autrement, et cela d’une manière très claire. Ce qui est saint et béni, je le vois lumineux et répandant la lumière, guérissant et secourant ; ce qui est profane et maudit, je le vois ténébreux, répandant les ténèbres et produisant la corruption. Je vois la lumière et les ténèbres sortant comme des choses vivantes de ce qui est bon ou mauvais et agissant dans le sens de la lumière et des ténèbres. Cela m’est ainsi montré.
« À une époque postérieure, comme j’allais à Dulmen, je passai devant un ermitage dans la direction d’un bocage où demeure le paysan H... Il y a là une prairie. Quand je me trouvai avec ma compagne près de cette prairie, je vis s’élever une vapeur qui me causa de l’horreur et du dégoût. Il montait au milieu de la prairie plusieurs de ces courants de vapeur ; se tenant près du sol, ils formaient des ondulations ou comme des flots. Comme je ne voyais pas de feu, je demandai en les montrant du doigt à ma compagne : « Qu’est-ce donc qui brûle là ? je ne vois pas de feu. » Mais elle ne vit rien, fut très étonnée de ma question et crut que j’étais malade. Je me tus, mais je continuai à voir la sombre vapeur et sentis croître mon terrible malaise ; quand il nous fallut passer tout près de cet endroit, je vis bien distinctement la vapeur se dégager du côté opposé à celui où nous étions. Je sentis alors très clairement que des ossements profanes et ténébreux étaient enterrés là et j’eus la vue rapide d’abominables pratiques idolâtriques qui avaient eu lieu là autrefois. »
V
ANNE CATHERINE REÇOIT LES SAINTS SACREMENTS DE PÉNITENCE ET D’EUCHARISTIE.
1. Vers la septième année de son âge, Anne Catherine fut conduite pour la première fois à confesse avec d’autres enfants ; elle s’y était préparée avec tant d’ardeur et elle était pénétrée d’une si vive contrition que les forces lui manquèrent sur le chemin de l’église et que les autres enfants qui l’aimaient beaucoup furent obligées de la porter jusqu’à Coesfeld. Elle avait sur la conscience, non seulement des actions de ses premières années expiées par de fréquentes et douloureuses pénitences, mais aussi ses visions incessantes qu’on lui avait tant de fois reprochées comme « des imaginations et des rêveries ». Comme c’était particulièrement sa mère qui la mettait sans cesse en garde contre les rêveries et les superstitions, cela la mettait dans une grande angoisse et elle s’était proposé de se confesser assez clairement et assez longuement sur ses « rêves » pour recevoir du prêtre des avis et des directions. Elle le fit, quoiqu’il n’y eût pas là de péché à confesser : mais il faut admirer les vues de Dieu, qui, ayant donné à Anne Catherine le don de contemplation pour l’édification des fidèles, c’est-à-dire pour toute l’Église, commença dès lors, au moyen de sa délicatesse de conscience, à mettre ce don sous la garde de l’Église et à le soumettre à son jugement. En faisant son examen de conscience, Anne Catherine craignait par-dessus tout que l’amour-propre ou la fausse honte ne lui fît cacher ou pallier quelque chose ; c’est pourquoi elle se disait souvent :
« Ce que l’esprit malin m’a pris, il peut le garder. S’il m’a ôté la honte avant le péché, je ne veux pas la lui reprendre avant la confession. »
L’amour-propre lui paraissait plus à craindre que le démon lui-même : car elle avait retiré de ses contemplations intérieures la conviction « que nous serions tombés moins bas, si Adam n’avait pas rejeté la faute sur Ève et celle-ci sur le serpent ». Aussi s’accusa-t-elle avec le plus grand chagrin de prétendus péchés mortels pour lesquels elle voulait à peine accepter une atténuation de la bouche de son confesseur. Elle se souvenait de s’être une fois querellée avec un enfant et d’avoir répondu à un autre par un proverbe satirique ; elle était fermement persuadée que c’étaient là des péchés mortels, car elle avait entendu dire au maître d’école que Dieu avait commandé de tendre l’autre joue à l’offenseur qui vous aurait donné un soufflet.
De même, au témoignage d’Overberg, sa charité pour le prochain était, dans un âge aussi tendre, arrivée déjà à un si haut degré, que c’était toujours un très grand plaisir pour elle que de pouvoir donner une marque d’affection à quelqu’un dont elle avait reçu une offense. C’est pourquoi elle confessa ses soi-disant péchés mortels avec une contrition si vive, qu’elle croyait, dans son effroi, que le confesseur allait lui refuser l’absolution ; mais il lui dit pour la consoler : « Enfant, tu ne peux pas encore faire de péché mortel », et elle fondit en larmes, au point qu’il fallut l’emporter du confessionnal.
Ses parents lui avaient donné sept pfennigs pour acheter du pain blanc comme les autres enfants après sa confession : mais elle les donna à un pauvre, afin que Dieu lui accordât le pardon de ses péchés. Plus tard, quand elle retourna à confesse, ses parents lui donnèrent chaque fois sept pfennigs pour avoir du pain blanc. Elle en achetait bien, mais non pas pour elle, et elle rapportait le tout à la maison pour ses parents.
2. Dans une des confessions suivantes, elle fut encore fort troublée et fort tourmentée. Elle avait entendu sa mère parler avec une autre femme d’une certaine défunte dont l’âme, disaient-elles, ne pouvait trouver de repos. Sa compassion pour cette âme fut si vivement excitée par là qu’elle s’en occupait continuellement dans son cœur et dans ses prières et qu’involontairement elle cherchait aussi pour elle d’autres intercesseurs. Un jour, elle était au moment de communiquer ce qu’elle avait entendu, disant : « La défunte n’a pas... », mais alors elle fut saisie d’une telle angoisse, qu’elle se trouva hors d’état de prononcer un mot de plus. La pensée lui était venue tout à coup qu’elle ne serait plus en mesure de réparer ce péché de médisance, puisqu’elle ne pourrait pas demander pardon à une morte. Elle ne put retrouver le calme tant qu’elle n’eut pas confessé cette inadvertance. Or, cette frayeur n’était pas un scrupule exagéré chez Anne Catherine, mais l’effet de sa grande pureté de conscience, comme on le voit par le fait suivant, que son père Bernard se plaisait à raconter.
« Lorsqu’elle commença à lire, disait-il, elle aimait à se mettre par terre, près du foyer, avec un livre de prières, et à rassembler les copeaux enflammés. Un jour, son père travaillait à réparer l’établi d’un voisin où il voulait ajuster un nouveau morceau de bois. Anne Catherine ramassa les copeaux qui tombaient, mais elle prit seulement ceux du morceau de bois neuf pour les mettre au feu. Son père lui ayant demandé pourquoi elle ne ramassait pas aussi les autres copeaux, elle répondit : « Je prends seulement ceux du nouveau morceau de bois, car les autres qui tombent de l’établi ne nous appartiennent pas. » Là-dessus, le père tout ému regarda la mère et dit : « C’est vraiment une singulière enfant. »
Quand le feu ne flambait plus au foyer et que ses parents étaient allés se coucher, Anne Catherine cherchait souvent de petits morceaux de bois brûlant encore, pour pouvoir lire dans son livre de prières. Elle regarda d’abord cela comme une chose permise, mais plus tard elle s’en confessa avec un vif repentir, et il ne lui arriva plus jamais de s’approprier la plus petite chose sans en avoir demandé la permission à ses parents.
3. Ce fut dans sa douzième année qu’Anne Catherine fit sa première communion. Depuis le jour de son baptême, son âme se trouvait si fortement attirée vers le très saint Sacrement qu’elle éprouvait dans son voisinage un merveilleux sentiment de joie et de bonheur qui se communiquait même à son corps. Elle n’était jamais dans la maison de Dieu sans être accompagnée de son ange et sans voir, dans la manière dont celui-ci adorait le très saint Sacrement, le modèle du respect avec lequel l’homme mortel doit s’en approcher. Elle avait appris dans ses visions, et le Sauveur lui-même lui avait enseigné, quelle était la magnificence, la grandeur de ses mystères : cela lui avait inspiré un tel respect pour le sacerdoce de l’Église catholique, que rien sur la terre ne lui paraissait comparable en dignité et que, comme nous le verrons plus tard, il n’y avait aucune offense qu’elle se chargeât d’expier par de plus terribles souffrances que les péchés des prêtres. S’agenouillait-elle devant l’autel, elle n’osait pas regarder d’un autre côté. Son cœur et ses yeux s’attachaient au très saint Sacrement et le silence du lieu saint correspondait au recueillement solennel de son âme. Elle parlait à Jésus dans le sacrement avec une ferveur pleine de confiance et lui chantait les jours de fête les hymnes de l’Église. Mais, comme elle ne pouvait s’arrêter dans les églises aussi souvent ni aussi longtemps qu’elle l’eût désiré, en faisant sa prière nocturne, elle se tournait comme involontairement vers le point de l’horizon où elle savait qu’était le tabernacle d’une église.
4. L’ardent amour qui enflammait son cœur l’avait poussée, dès ses premières années, à faire la communion spirituelle : mais quand vint le moment où elle eut à se préparer à la réception réelle de l’Eucharistie, elle ne crut jamais en pouvoir faire assez. La grandeur de son désir n’était égalée que par le soin avec lequel elle s’efforçait de rendre son âme digne de recevoir l’hôte céleste. Elle s’appliqua à repasser de nouveau dans sa mémoire tous les instants de sa vie, afin de paraître pure devant son Seigneur et son Dieu. Plus encore qu’à sa première confession, elle était pénétrée de la crainte de porter en elle une tache par suite d’une ignorance coupable : et elle n’était pas peu tourmentée par la pensée qu’elle n’avait peut-être pas confessé ses fautes aussi sincèrement et aussi complètement que Dieu le voulait, car elle n’avait jamais cessé de se regarder comme la pire de tous les enfants et son humilité ne tolérait ni échappatoire ni excuse. Elle pria instamment son père et sa mère de lui venir en aide pour arriver à la parfaite connaissance de ses péchés ; elle leur disait :
« Je ne veux pas de secret, pas de replis dans mon cœur. S’il venait à moi un ange dans lequel je verrais un repli, je ne pourrais m’empêcher de dire qu’il a part avec le mauvais esprit, lequel cherche à se cacher dans les recoins et les replis des cœurs. »
Le jour de la communion, elle tint ses yeux fermés en allant à l’église, afin qu’aucun objet ne pût les frapper et troubler le recueillement de son esprit. Elle était si remplie du désir de se donner entièrement et parfaitement à Dieu et de consacrer à son service toutes les puissances de son âme et de son corps, qu’elle s’offrait sans cesse au Seigneur pour se sacrifier à sa gloire et au salut du prochain. Voici ce que rapporte Overberg à ce sujet :
« Lors de sa première communion, Anne Catherine n’a pas demandé beaucoup de choses à Dieu : elle priait par-dessus tout pour qu’il fît d’elle une enfant tout à fait bonne, qu’il la fît devenir telle qu’il la voulait. Elle se donna à Dieu tout entière et sans réserve. »
5. On peut juger combien fut sérieuse l’offre dévouée de cette enfant et combien fut agréable à Dieu le zèle ardent avec lequel elle se prépara à recevoir la très sainte Eucharistie, en considérant les effets surprenants que le sacrement produisit dans son cœur. L’amour divin s’y alluma si fortement qu’Anne Catherine se sentit poussée à une vie de mortification et de renoncement telle que la règle la plus rigoureuse n’aurait pu la prescrire avec plus de sagesse à un moine pénitent dans le cloître ou à un anachorète dans le désert. Quand nous ne posséderions touchant Anne Catherine d’autre témoignage que celui d’Overberg sur l’influence de sa première communion, cela seul suffirait pour reconnaître quelque chose d’extraordinaire dans les lumières, l’énergie héroïque et l’ardent amour d’une âme qui, dès sa douzième année, sans direction ni suggestion venue du dehors, sous la seule influence de la lumière et de l’action du Saint-Sacrement, put s’imposer une lutte intérieure et extérieure et un renoncement de soi-même aussi complet, et y persister avec une fidélité aussi opiniâtre que le fit Anne Catherine. Toutes les voies par lesquelles un bien créé peut gagner l’attachement de l’homme et éloigner son cœur de Dieu furent strictement fermées par elle aux créatures et à leurs appâts, de façon à ce que Dieu, son Seigneur, qui avait daigné entrer en elle, possédât seul et gouvernât son cœur. Overberg s’exprime ainsi à ce sujet :
« À dater de ce jour, ses efforts pour se renoncer et se mortifier devinrent encore plus constants et plus sérieux qu’auparavant, car elle avait la ferme persuasion que, sans la mortification, il est impossible de se donner entièrement à Dieu. Ce fut son amour pour Jésus-Christ qui lui apprit cela, et c’est pourquoi elle disait : « J’ai souvent vu que l’amour des créatures peut porter beaucoup de personnes à des œuvres grandes et difficiles ; pourquoi l’amour de Jésus ne pourrait-il pas faire beaucoup plus encore ? » Anne Catherine mortifiait ses yeux en les fermant ou en les détournant lorsqu’il y avait à voir quelque chose de beau et d’agréable ou qui pouvait piquer la curiosité ; dans les églises spécialement, elle n’accordait à ses yeux aucune liberté. Elle se disait : « Ne regarde pas ceci et cela ; cela pourrait te troubler, ou tu pourrais y prendre trop de plaisir. Et à quoi te servirait de le voir ? Abstiens-toi pour l’amour de Dieu. » Si l’occasion se présentait d’entendre quelque chose d’agréable, de nouveau ou d’amusant, elle se disait : « Non ! je ne prête pas mes oreilles à cela. Je m’abstiendrai de l’entendre pour l’amour de Dieu. »
« Elle mortifiait sa langue en taisant ce qu’elle eût aimé à dire : elle ne mangeait rien à quoi elle eût trouvé bon goût. Quand ses parents s’en apercevaient, ils prenaient cela pour du caprice et la forçaient par leurs reproches à manger quelquefois de ces aliments. Elle mortifiait ses pieds quand elle avait envie d’aller en tel ou tel endroit, sans y être appelée par le devoir ou par un motif charitable ; elle se disait alors : « Non ! je n’y vais pas : il vaut mieux m’en abstenir pour l’amour de Dieu, car j’aurais peut-être à m’en repentir. » Elle avait aussi coutume de faire pieds nus le grand chemin de la croix de Coesfeld. Elle refusait au penchant intérieur qui l’y poussait bien des plaisirs qu’elle aurait pu prendre sans danger. Elle châtiait son corps avec des orties, des cordes et des ceintures de pénitence. Pendant longtemps elle se servit, pour prendre son sommeil, d’une double croix de bois, ou bien elle posait deux traverses sur deux pièces de bois plus longues, afin d’y prendre le court repos de la nuit. »
6. Après la sainte communion, Anne Catherine eut une vision dans laquelle elle assista avec sainte Cécile, comme si elle eût été sa contemporaine, au service divin dans les catacombes.
« Je m’agenouillai, raconta-t-elle, dans une salle souterraine : cela ressemblait à une mine. Beaucoup de personnes étaient agenouillées par terre. Des flambeaux étaient attachés aux murs et il y avait aussi deux flambeaux sur l’autel de pierre qui avait un tabernacle également en pierre avec une porte. Un prêtre disait la sainte messe et le peuple lui répondait. À la fin, il tira du tabernacle un calice qui me parut être de bois. Il y prit le Saint-Sacrement et le donna aux assistants sur de petits linges blancs qu’ils placèrent avec soin sur leur poitrine. Ensuite ils se séparèrent. »
Cette vision devait être pour Anne Catherine la confirmation que Dieu l’avait exaucée en acceptant le sacrifice de son âme et de son corps qu’elle voulait lui offrir. La pureté de son cœur et l’austérité de sa vie la rendaient digne de figurer dans cette sainte cohorte des premiers chrétiens qui puisaient dans le Saint-Sacrement la force de mourir dans les supplices. Sa vie aussi devait être un martyre incessant pour lequel elle avait à puiser à la même source le courage et la force. Semblable à Cécile, il lui faudra souffrir pour la foi à une époque de persécution non sanglante, mais tout aussi pleine de périls pour l’Église, et glorifier le Sauveur avec l’héroïsme des anciennes Vierges martyres, quand il sera renié et abandonné par des multitudes d’hommes.
7. Suivant le témoignage d’Overberg, Anne Catherine divisait le temps qui s’écoulait d’une communion à l’autre de manière à ce que la première moitié de ce temps fût consacrée à l’action de grâces, la seconde moitié à la préparation pour la communion future. Elle appelait tous les saints à remercier Dieu et à prier Dieu avec elle. Elle conjurait Dieu, au nom de son amour pour Jésus et pour Marie, de daigner préparer son cœur à recevoir son Fils bien-aimé. Lorsqu’elle reçut la sainte communion pour la seconde fois, il lui arriva quelque chose où l’on peut voir un symbole de son rapport intime avec le Saint-Sacrement et des grâces qu’elle y recevait pour elle-même et pour d’autres. Elle devait partir avant le jour avec sa mère pour aller communier à Coesfeld. Ses plus beaux habits étaient dans le coffre de sa mère. Comme elle voulait les prendre, elle y vit de beaux pains très blancs. Elle crut d’abord que sa mère les avait mis là pour la mettre à l’épreuve, mais elle en trouva une telle quantité, qu’il lui fallut tout dépaqueter pour les voir tous ensemble. À peine les avait-elle remis dans le coffre, que sa mère, impatiente de ce qu’elle tardait, vint à elle et la fit sortir en telle hâte qu’elle oublia de mettre un mouchoir autour de son cou. Elle ne s’en aperçut que hors de la maison, mais elle n’osa pas revenir sur ses pas et suivit sa mère, craignant beaucoup qu’elle ne se retournât et ne découvrît ce qui manquait à son habillement. Elle pria de tout son cœur pour que Dieu lui vînt en aide ; et, lorsque sa mère arriva à un endroit glissant du chemin, Anne Catherine sentit qu’on lui enveloppait le cou d’un mouchoir, avant que celle-là se retournât vers elle pour lui tendre la main et la tirer à sa suite. La joie et l’étonnement que causa à Anne Catherine une assistance venue si soudainement la bouleversèrent à ce point qu’elle pouvait à peine suivre sa mère, et que celle-ci la gronda à cause de son étrange attitude. Arrivée à l’église, elle se confessa en pleurant de la curiosité qui lui avait fait tirer les pains du coffre. Mais son désir amoureux du Saint-Sacrement devint semblable à une flamme, en sorte qu’elle ressentit dans la poitrine et sur la langue une ardeur inexprimable. Elle regarda ce feu comme une punition de sa curiosité, perdit presque connaissance dans son inquiétude, et fit toucher à sa langue une petite image en parchemin des cinq plaies du Sauveur, afin d’y trouver un soulagement, qui lui fut accordé en effet. Mais, lorsqu’elle alla à la sainte table, elle vit le Saint-Sacrement venir à elle sous une forme lumineuse et disparaître dans sa poitrine pendant qu’elle le recevait sur la langue de la main du prêtre. Sa poitrine et sa langue s’enflammèrent plus violemment qu’auparavant, et sa bouche resta brûlante lorsqu’elle revint de l’église, en sorte qu’elle essaya de la rafraîchir avec ses gants restés frais. Alors revint son inquiétude à l’endroit du fichu, d’autant qu’elle avait découvert qu’il était beaucoup plus beau que le sien. « Il a des franges, se dit-elle ! Que va dire ma mère ? » Arrivée à la maison, elle le posa, toute tremblante, sur son lit : mais lorsqu’elle voulut le regarder de nouveau, il avait disparu, à sa grande consolation, sans que sa mère l’eût aperçu.
La provision de beaux pains, qui n’avaient été visibles que pour Anne Catherine, se rapportait aux riches dons qu’elle devait recevoir, grâce à sa bonne préparation à la sainte communion, pour les distribuer et en nourrir spirituellement des indigents et des affamés. Ils étaient placés près de ce qui lui appartenait, cachés sous ses habits, en signe qu’elle-même en ferait la distribution et que ses mérites s’en accroîtraient. Elle devait en faire la part la plus large aux plus nécessiteux, c’est-à-dire aux pauvres âmes du purgatoire, pour lesquelles elle avait coutume d’offrir tous ses actes. C’est pourquoi elles lui témoignaient leur gratitude par la prière et l’assistance, autant que cela leur était possible, et c’est à elles qu’Anne Catherine était redevable du mouchoir qui l’avait si promptement recouverte.
8. À cette époque, son confesseur de Coesfeld était un ancien Jésuite, le vieil et respectable père Weidner. Voici ce qu’elle en racontait :
« Le père Weidner était mon confesseur. Il logeait avec ses sœurs à Coesfeld. Les jours de dimanche, il me fallait aller à la première messe et ensuite faire la cuisine, afin que les autres pussent aller à l’église. Le café n’était pas alors aussi commun qu’aujourd’hui et, quand j’avais mis de côté deux stuber, j’allais, après la messe du matin, chez les sœurs du père Weidner, deux pieuses filles qui vendaient du café. J’y allais avec plaisir, car le vieux monsieur et ses sœurs vivaient ensemble bien paisiblement et bien pieusement, et ils étaient bien doux et bien unis. Quand mes parents revenaient de l’église à la maison, ils trouvaient un peu de bon café que je leur avais préparé, ce qui leur était très agréable. »
VI
EMBÛCHES DU MAUVAIS ESPRIT.
1. Aussitôt qu’Anne Catherine eut reçu l’esprit de force pour résister victorieusement aux attaques du démon à l’aide d’une ferme et inébranlable confiance en Dieu, le Seigneur permit qu’elle fût persécutée par lui. Il employa tous les moyens possibles pour la faire reculer dans sa marche soutenue vers la perfection, mais ce fut inutilement. Elle méprisait son astuce, sa malice et son pouvoir, et plus son humilité devenait profonde, moins elle pouvait comprendre comment le malin pouvait intimider ou effrayer une âme. Les premiers assauts du diable consistèrent en ce qu’il chercha à exposer à des dangers mortels la vie corporelle d’Anne Catherine. Elle disait à ce sujet :
« Dans mon enfance et plus tard, j’ai été très souvent exposée au danger de perdre la vie, mais j’en ai été sauvée par le secours de Dieu. J’ai bien des fois reçu à ce sujet l’avertissement intérieur que ces dangers ne venaient jamais de l’aveugle hasard, mais que, par une permission divine, ils avaient pour cause les embûches de l’esprit malin, et spécialement dans des moments d’oubli, lorsque je ne me tenais pas en présence de Dieu ou que je consentais à une faute par négligence. C’est pourquoi je n’ai jamais pu croire à un pur hasard. Dieu est toujours notre gardien et notre protecteur quand nous ne nous éloignons pas de lui : son ange est toujours à nos côtés, mais il faut que notre bonne volonté et notre conduite nous rendent dignes de sa protection. Nous devons, comme des enfants reconnaissants, implorer son assistance et ne pas nous écarter de lui, car l’ennemi du salut est aux aguets et travaille toujours à nous perdre. – Je n’avais encore que peu d’années ; mes parents n’étaient pas au logis ; j’étais seule. Ma mère m’avait ordonné de garder la maison et de ne pas sortir. Il vint alors une vieille femme qui, peut-être pour espionner ou pour faire quelque chose qu’elle ne voulait pas me laisser voir, me dit : « Va prendre des poires à mon poirier, bien vite, avant que ta mère vienne ! » Je tombai en tentation, j’oubliai l’ordre de ma mère et courus au jardin de cette femme si précipitamment que je me heurtai violemment la poitrine contre une charrue couverte de paille et que je tombai par terre sans connaissance. C’est dans cet état que me trouva ma mère et elle me fit revenir à moi par une correction bien appliquée. Je me ressentis longtemps du coup que je m’étais donné. Je fus instruite plus tard que le diable s’était servi de la volonté malicieuse de la vieille femme pour m’induire en tentation par la convoitise et, qu’entrant dans la tentation, j’avais couru risque de perdre la vie. Cela me donna une grande crainte des dangers de la convoitise et je reconnus combien il est nécessaire à l’homme de se priver et de se vaincre. »
2. Lorsqu’Anne Catherine commença l’exercice de la prière nocturne, les attaques de l’esprit malin devinrent plus fréquentes et plus manifestes. Il cherchait à l’empêcher de prier par de grands bruits, par des apparitions effrayantes, même par des coups et des mauvais traitements. Elle sentait souvent des mains froides comme la glace qui l’empoignaient par les pieds, la jetaient par terre ou l’élevaient en l’air. Lors même qu’elle se sentait prise d’une terreur involontaire, elle ne perdait pourtant pas contenance, mais continuait sa prière avec un redoublement de ferveur, ce qui forçait l’ennemi à se retirer. Elle allait à l’endroit même où elle avait été maltraitée par lui ou jetée par terre et prolongeait sa prière, disant : « Misérable, tu ne me chasseras pas d’ici ! Tu n’as pas de part en moi ! Tu ne m’empêcheras pas de prier ! » Ces sortes d’attaques se renouvelaient surtout lorsqu’Anne Catherine priait pour les âmes du purgatoire ou accomplissait des œuvres de pénitence. Mais, comme elle n’était jamais sans avertissement intérieur sur ce qu’elle avait à faire pour résister à l’ennemi, comme, en outre, les pauvres âmes qu’elle aimait si tendrement étaient visiblement auprès d’elle et la réjouissaient par leur reconnaissance et par la consolation qu’elle voyait croître chez elles avec l’assistance qu’elle leur donnait, chaque attaque du mauvais esprit redoublait son courage et ses efforts.
3. Parfois Anne Catherine faisait sa prière nocturne devant une croix rustique qui s’élevait au milieu du territoire de Flamske. Le chemin qui y conduisait passait par un étroit sentier, sur lequel une horrible bête, semblable à un grand chien avec une tête énorme, venait souvent se mettre en face d’elle pour la forcer à se retirer. Au commencement, elle frissonnait d’horreur et faisait quelques pas en arrière ; mais bientôt elle reprenait courage, se disant : « Pourquoi reculerais-je devant l’ennemi ? » Elle faisait le signe de la croix et marchait hardiment sur le monstre. Elle était prise d’un tremblement qui lui faisait dresser les cheveux sur la tête et elle volait plutôt qu’elle ne marchait sur le chemin qui conduisait à la croix. La bête courait auprès d’elle et la frappait dans le côté. Plus tard elle surmonta entièrement sa frayeur, marcha sans hésiter au-devant de l’ennemi et le mit promptement en fuite par sa prière.
Comme il ne pouvait par ces visions effrayantes la détourner de ses exercices de pénitence, il excita un jour un méchant homme à l’assaillir près de la croix. Mais il ne put rien contre elle ; avec l’aide de son ange gardien Anne Catherine se défendit courageusement et força ce misérable à se retirer.
C’était aussi le saint ange qui la sauvait des dangers innombrables par lesquels le diable, en toute occasion, menaçait sa vie. Tantôt il essayait de la jeter à bas d’une échelle dans la grange, tantôt il la poussait dans une mare profonde ou dans une fosse et la faisait plonger jusqu’au fond, afin de la noyer ; mais l’ange la retirait et la déposait saine et sauve sur le bord.
4. Ces attaques du mauvais esprit ont une signification plus profonde qu’on ne peut le reconnaître à première vue : car il y faut voir non seulement la rage et la malice de l’enfer travaillant sans relâche à perdre l’instrument choisi de Dieu, mais encore une partie essentielle de la tâche assignée à Anne Catherine, laquelle doit attirer sur elle les fureurs de l’enfer et s’exposer à ses assauts pour les détourner de certaines âmes, qui, par suite de leurs fautes, n’y pourraient pas résister. Elle prend la place de ceux qui ont encouru un châtiment et qui se sont mis en danger, des faibles, des misérables qui se perdront si une âme plus innocente, douée de plus de force et de vertu, ne paie pas leur dette, ne combat pas et ne souffre pas pour eux. De même qu’Anne Catherine prend sur elle les maladies des enfants qui pleurent, ou souffre les douleurs du prochain pour l’en délivrer, de même elle prend aussi sur elle les attaques du démon que d’autres se sont attirées et auxquelles ils succomberaient, soutient le combat à leur place et prépare leur délivrance. Or, elle ne prend pas seulement la place des membres de l’Église, mais aussi des biens, des trésors, des joyaux de l’Église exposés aux embûches de l’enfer, et que Dieu a placés sous la garde et la surveillance des sentinelles et des pasteurs établis par lui. C’est pourquoi la nature et le mode des exercices si pénibles pour elle de son oraison nocturne ne sont pas réglés arbitrairement selon sa volonté, mais ils le sont par son ange ou conformément à des avertissements intérieurs qu’elle reçoit dans ses visions. Ce n’est pas non plus par son propre choix qu’elle fait la nuit le long chemin de la croix, ou qu’elle s’agenouille devant la chaumière paternelle, ou qu’elle cherche çà et là un lieu pour prier, car tout cela se fait dans la mesure de la tâche, déterminée d’avance, qu’elle a à accomplir pendant la nuit. C’est ainsi qu’elle parcourt le chemin qui mène à la croix plantée au milieu du hameau, afin d’expier la négligence d’un pasteur muet et endormi qui laisse le loup pénétrer dans le bercail, et qu’elle livre elle-même combat à l’animal ravisseur pour l’empêcher de dévorer le troupeau. Si elle est jetée par le démon du haut d’une échelle ou précipitée dans une fosse, elle souffre cette attaque pour une personne à l’agonie et arrache ainsi à l’enfer une proie assurée à laquelle il croyait avoir déjà droit. Si le malin remplit son âme de crainte et d’horreur par des visions effrayantes et d’affreux fantômes, ce sont des terreurs dont elle délivre les mourants, afin qu’ils puissent se préparer avec plus de calme à leur dernier moment.
5. Les attaques de Satan redoublent de fureur quand Anne Catherine doit détruire les effets de sa malice, déconcerter ses plans et empêcher des crimes déjà résolus à son instigation et tout près de leur accomplissement.
« Une fois, disait-elle, j’allais à l’église dans l’obscurité. Une figure semblable à un chien passa devant moi et, pendant que je portais la main en avant, je reçus dans le visage un coup qui me jeta presque hors du chemin. Dans l’église, mon visage et ma main s’enflèrent par suite de ce coup et tous deux étaient couverts de petite vérole. À mon retour à la maison, j’étais devenue tout à fait méconnaissable. Je me lavai avec de l’eau prise aux fonts baptismaux. » – « Le chemin de l’église me conduisait à une haie où il me fallait passer par-dessus une palissade. Le jour de saint François, étant arrivée à cet endroit de grand matin, je sentis qu’une grande figure noire voulait me retenir en arrière. Je luttai avec elle et je finis par passer, mais je restai calme et ne me laissai pas épouvanter par l’ennemi. Il se place toujours au milieu de la route où l’on passe pour forcer à prendre des chemins détournés ; mais c’est ce qu’il ne pourra pas obtenir de moi. »
6. Le démon cherchait aussi à égarer Anne Catherine par des suggestions et des attaques purement spirituelles. La mortification précoce et opiniâtre, à l’aide de laquelle elle avait conquis une telle force pour lui résister, lui était très odieuse : aussi s’efforçait-il d’exciter Anne Catherine à se traiter avec plus d’indulgence et de mollesse. Mais aussitôt qu’elle découvrit ses artifices, elle redoubla ses austérités. Toutefois, s’il lui suggérait de les pousser jusqu’à l’excès, elle y mettait plus de discrétion et demandait conseil au directeur de sa conscience.
7. La suite de cette biographie montrera que Satan ne cessa à aucune époque de tourmenter Anne Catherine de toutes les manières : cependant il ne réussit jamais à exciter en elle le moindre mouvement contraire à la pureté. Il ne pouvait et n’osait pas présenter cette tentation à une âme dans laquelle Dieu avait versé la lumière angélique de prophétie et qu’il avait confiée à la garde et à la direction de son ange, afin qu’elle marchât par une voie douloureuse sur laquelle toutes les amorces de la concupiscence devaient s’éteindre. Le diable, il est vrai, s’efforça souvent de lui donner en spectacle les tableaux les plus immondes : mais il ne put jamais obtenir qu’elle y jetât un regard. Il lui arriva aussi d’induire de méchants hommes à tenter sur la jeune vierge d’odieuses violences : mais, forte comme une lionne, elle terrassait ces misérables et les mettait en fuite. « Mon Seigneur et mon Dieu ne m’abandonne pas ! disait-elle. Il est plus fort que l’ennemi ! » C’était là son bouclier et nul ne put jamais porter sur elle une main téméraire.
VII
SES RAPPORTS AVEC SON ANGE GARDIEN.
1. Le commerce intime qu’Anne Catherine entretenait incessamment avec son saint ange, visible pour elle, est un fait qui se reproduit chez toutes les personnes favorisées par Dieu de la lumière contemplative et appelées à suivre des voies extraordinaires. Le don de l’intuition surnaturelle est pour l’homme mortel si lourd à porter, il est exposé chez lui à de tels risques et requiert une si grande pureté d’âme, qu’il faut, pour en user, une assistance particulière et un guide spécial dans les sphères infiniment étendues qui se découvrent à l’œil du contemplatif. Dès le sein maternel, tout homme sans exception est accompagné d’un ange qui, comme instrument ou comme serviteur et délégué de la divine Providence, exerce une action sur lui et lui ménage tout ce qui lui est nécessaire pour que, mettant à profit la somme de grâces, de secours et de lumières qui lui a été attribuée suivant les décrets éternels du Tout-Puissant, il arrive à la foi, à la qualité d’enfant de Dieu et par là à la béatitude céleste. C’est pourquoi chaque âme est ouverte par Dieu à l’influence de l’ange et rendue naturellement capable de recevoir de celui-ci des impressions, des idées, des impulsions dont elle doit faire des actes méritoires par sa libre coopération. Cette capacité s’accroît d’autant plus que l’âme est plus pure, ou élevée à un plus haut degré de grâce. Mais rien ne la rapproche plus de la lumière angélique et ne la rend aussi digne de l’union et du commerce avec l’ange que la splendeur de l’innocence baptismale quand rien ne l’a ternie. Cette éminente beauté surpassant toute description était chez Anne Catherine ce qui ravissait son ange, en sorte qu’envoyé des rangs les plus élevés de la hiérarchie céleste, il regardait comme une tâche correspondante à sa haute dignité d’éclairer et de conduire une créature qui, tout enfant qu’elle était quant à ses relations avec les choses de la terre et du temps, était pourtant déjà mûre pour l’intelligence des biens éternels et invisibles et préparée par les vertus infuses à devenir la dépositaire des secrets divins.
2. La première action de l’ange avait eu pour objet la lumière de la foi, en ce sens qu’il instruisait Anne Catherine touchant la foi catholique, non par des paroles et des explications, mais par des intuitions intérieures et des images symboliques ; il lui faisait acquérir par là une vue incomparablement plus claire et une plus profonde intelligence des mystères de la foi que ne peuvent la donner l’enseignement ordinaire et l’étude réfléchie. À cette illumination de la foi se liait la pratique de l’amour de Dieu, lequel devint promptement si fort et si pur chez Anne Catherine qu’elle pouvait maintenir son cœur dans une union continuelle avec Dieu et qu’il lui était devenu comme naturel de chercher Dieu en tout, de tout rapporter à Dieu et de tout considérer en Dieu. Dieu était le premier bien dont son âme eût eu le sentiment et il en avait pris si complètement possession qu’aucune créature ne pouvait plus la détourner de lui. La splendeur de l’ange qui, semblable à celle d’un soleil, l’environna dès les premiers jours de sa vie et qui était comme l’atmosphère dans laquelle elle vivait, cacha à ses yeux toutes les séductions terrestres et les biens passagers qui ordinairement attirent, occupent et dissipent l’homme, jusqu’à ce que son âme fût assez confirmée dans la charité pour qu’aucune créature ne pût l’émouvoir, sinon en vue de Dieu. Chaque regard que l’ange jetait sur elle était un rayon de lumière et comme un souffle qui augmentait l’ardeur de son amour : c’était une impulsion qui ne pouvait avoir d’autre but que Dieu. Aussi toutes les puissances et même tous les mouvements de son âme étaient si bien ordonnés et si paisiblement réglés qu’aucune passion ne pouvait y porter le trouble et que la plus forte impression du dehors n’était pas capable de l’ébranler. De même qu’Anne Catherine arriva, en s’y exerçant de très bonne heure, à supporter avec une fermeté calme les souffrances physiques les plus cruelles, de même son esprit, malgré la délicatesse extrême de sa nature sympathique et la timidité propre à l’enfance, possédait une énergie incroyable qui la rendait capable de surmonter promptement les impressions les plus violentes de crainte, de terreur, de douleur, et de recouvrer en un instant la paix et le repos. Comme l’ange ne laissait pas cet esprit se dissiper, parce que sa sévère vigilance n’y souffrait pas la moindre attache à un bien passager, quel qu’il fût, aucun nuage ne pouvait en ternir la splendeur, rien de terrestre en diminuer la beauté, aucun poids en faire fléchir le ressort et aucune chaîne en gêner la liberté. Sa force devait toujours s’accroître et rendre Anne Catherine de plus en plus capable d’accomplir ses étonnantes pratiques de pénitence et ses œuvres de charité héroïque envers le prochain.
3. Elle savait et elle sentait que tout son être était à découvert devant le regard de l’ange, et qu’il pénétrait dans le plus intime de son cœur : c’est pourquoi elle travaillait sans relâche à maintenir le miroir de son âme aussi pur et aussi limpide que l’ange l’exigeait d’elle. Aussi resta-t-elle jusqu’à sa mort une enfant d’une simplicité incroyable, véridique, sans détour, pleine de droiture et de candeur. Quand nulle autre chose n’aurait parlé pour elle, son humble et enfantine simplicité eût garanti suffisamment qu’elle était gouvernée par l’esprit de vérité et que les dons si extraordinaires qui reposaient en elle venaient réellement de Dieu : car le don de contemplation est d’un moindre prix encore que la profonde humilité qui tenait cachés à Anne Catherine les dons et les privilèges qui lui avaient été si richement départis ; c’était à tel point qu’elle ne soupçonnait même pas qu’il pût y avoir en elle quelque chose qui ne fût pas ordinaire et que, quand sa pensée se reportait sur elle-même, elle était remplie de confusion et d’inquiétude. Une telle manière de sentir n’est point l’œuvre de la nature, ni du mauvais esprit, mais elle provient d’un haut degré de grâce et d’une fidélité extraordinaire.
4. La direction de l’ange avait été accordée à Anne Catherine comme un don qu’elle devait faire fructifier par la perfection avec laquelle elle en userait. Plus elle travaillait à se rendre digne de cette faveur, plus elle recevait abondamment la lumière de l’ange et plus devenait fort et intime le lien qui l’attachait à lui. Or, ce lien ne pouvait être autre chose que l’obéissance née de l’amour de Dieu : car il n’y en a point de plus élevé et de plus méritoire et c’est le seul qui attache l’ange lui-même à Dieu. Dès sa première enfance, Anne Catherine s’était efforcée de pratiquer l’abandon complet à Dieu de sa volonté et de toutes ses forces physiques et morales, par cela même qu’elle s’offrait incessamment en sacrifice pour autrui. Dieu avait accepté cet abandon, c’est pourquoi, par le ministère de son ange, il réglait la conduite de sa vie dans tous ses rapports et jusque dans les plus petits détails avec une telle sagesse, que toutes les circonstances les plus indépendantes en apparence de la volonté devaient devenir pour elle des actes méritoires d’obéissance. Elle donna sa volonté à l’ange pour qu’il la gouvernât, son intelligence pour qu’il l’éclairât, son cœur pour qu’il l’aidât à le conserver à Dieu seul, pur et libre de toute attache terrestre, au moyen de la pénitence et de l’abnégation. Docile à ses avertissements intérieurs, elle refusait à son corps le sommeil et la nourriture, le châtiait rudement, demandait pour elle-même les douleurs et les maladies des autres, et telle était sa constance dans ces œuvres de charité qui consumaient ses forces, que des bénédictions et des effusions de grâces surnaturelles et célestes venaient suppléer pour elle ce qu’elle retranchait sur les besoins, et même sur les conditions indispensables de l’existence terrestre.
5. C’était par l’effet de cette charité qu’elle se substituait à ceux qui ne pouvaient pas supporter leurs souffrances et qu’elle était envoyée au secours de ceux qui imploraient la miséricorde. C’était l’ange qui la conduisait aux lieux où son assistance était le plus nécessaire. Comme la flamme obéit au souffle du vent, ainsi son âme embrasée par l’amour suivait l’appel de l’ange lorsqu’il l’accompagnait dans les séjours du malheur et de la souffrance : car, guidée par lui, la puissance de l’âme s’étendait comme des mains qui s’étendraient à l’infini pour donner, pour bénir, pour secourir, et se porteraient partout où les pousserait l’élan irrésistible d’une sainte compassion. Et de même que pour la compassion il n’y a ni distance, ni limites dans l’espace, de même il n’y en avait point qui pussent arrêter le souffle de cette âme. Semblable aux rayons partant d’une langue de feu, qui portent jusqu’à l’horizon le plus lointain l’éclat de la lumière et rentrent de nouveau au foyer d’où ils sont partis, sa charité pénétrait par toute l’Église, portant l’assistance sur tous les points où, suivant l’ordre marqué par Dieu, son ange devait la conduire. Elle disait à ce sujet :
« L’ange m’appelle et me mène en différents lieux. Je suis souvent en voyage avec lui. Il me conduit auprès de personnes que je connais ou que j’ai déjà vues une fois, et aussi près d’autres personnes qui me sont entièrement inconnues. Il me conduit même au-delà de la mer, mais cela est rapide comme la pensée, et alors je vais si loin, si loin ! C’est lui qui m’a conduit près de la reine de France (Marie-Antoinette) dans sa prison. Quand il vient à moi pour me faire faire quelque voyage, le plus souvent je vois d’abord une lueur ; puis sa forme lumineuse se dégage tout à coup de l’obscurité, comme lorsque dans la nuit on ouvre une lanterne sourde. Quand nous voyageons, il fait nuit au-dessus de nous, mais une lueur plane sur la terre. Nous voyageons à partir d’ici à travers des pays connus jusqu’à d’autres de plus en plus éloignés et j’ai le sentiment d’une immense distance. Le voyage se fait tantôt sur des routes, tantôt à travers des plaines, des montagnes, des rivières et des mers. Je dois mesurer tout le chemin avec les pieds, souvent gravir avec effort des montagnes escarpées. Mes genoux sont alors fatigués et douloureux, mes pieds sont brûlants, je suis toujours pieds nus. Mon guide marche quelquefois devant moi, quelquefois près de moi. Je ne le vois jamais remuer les pieds. Il est très silencieux, fait peu de mouvements, sinon qu’il accompagne ses courtes réponses d’un geste de la main ou d’une inclination de tête. Comme il est transparent et resplendissant ! Il est souvent grave et sérieux, souvent il se mêle à sa gravité quelque chose d’affectueux. Ses cheveux sont unis, flottants et brillants. Il a la tête découverte et porte une longue robe de prêtre avec un reflet blond. Je parle avec lui très hardiment, mais je ne puis jamais le bien regarder en face, tant je suis inclinée devant lui. Il me donne toute espèce d’indications. Je n’ose pas lui faire beaucoup de questions ; j’en suis empêchée par le contentement tranquille que j’éprouve auprès de lui. Il est toujours très bref dans ses paroles. Je le vois, même à l’état de veille. – Quand je prie pour d’autres personnes et qu’il n’est pas près de moi, je l’appelle, afin qu’il aille trouver leur ange. Souvent aussi, quand il est près de moi, je dis que je veux rester ; je le prie d’aller en tel ou tel endroit porter des consolations, et je le vois partir. Quand j’arrive au bord des grandes eaux et que je ne sais comment aller plus loin, je me trouve quelquefois tout d’un coup de l’autre côté, et je regarde étonnée derrière moi. Nous passons souvent par-dessus des villes. Pendant un rude hiver, j’avais quitté le soir fort tard l’église des Jésuites à Coesfeld, et il me fallut revenir par les champs à notre maison de Flamske à travers la pluie et les tourbillons de neige. J’eus peur et je priai Dieu : alors je vis planer devant moi une lueur semblable à une flamme qui avait la forme de mon guide avec sa longue robe. Aussitôt le chemin se sécha sous mes pieds, il fit clair autour de moi, il ne tomba sur moi ni pluie, ni neige, et je revins à la maison sans être mouillée. »
6. Le commerce d’Anne Catherine avec les âmes souffrantes avait aussi lieu par l’intermédiaire de l’ange qui la conduisait dans les vastes espaces du purgatoire afin qu’elle rafraîchît, pour ainsi dire, celles qui étaient sans secours avec les fruits de sa pénitence innocente.
« J’étais avec mon guide, dit-elle, près des pauvres âmes, dans le purgatoire : je voyais leur grande désolation, comment elles ne peuvent pas s’aider elles-mêmes et comment, de nos jours, elles sont si peu secourues par les hommes sur la terre. Ah ! leur misère est inexprimable ! Comme j’avais cette détresse sous les yeux, je me trouvai séparée de mon conducteur par une montagne, et je soupirais après lui comme affamée, si bien que je tombai presque en défaillance. Je le voyais à travers la montagne, mais je ne pouvais pas aller à lui, et il me dit : « Vois quel est ton désir ; ce que tu ressens, les pauvres âmes le ressentent aussi dans leur désir d’être secourues. »
« Il me conduisait souvent devant des cavernes et des cachots pour y prier, et je me prosternais devant ces sombres réduits ; je pleurais, et je criais vers Dieu, les bras étendus, pour qu’il se laissât fléchir. L’ange m’exhortait à offrir pour les pauvres âmes toute espèce de privations et de renoncements. Elles ne peuvent pas s’aider elles-mêmes et sont si cruellement négligées et oubliées ! J’envoyais souvent mon ange gardien à l’ange de certaines personnes que je voyais dans la souffrance, afin qu’il les excitât à offrir leurs douleurs pour les pauvres âmes. Ce que l’on fait pour elles, prières ou souffrances, leur profite à l’instant et les rend si joyeuses, si heureuses, si reconnaissantes ! Quand j’offre des souffrances pour elles, elles prient pour moi. Je suis effrayée en voyant à quel point on néglige et on dissipe les grâces que l’Église offre aux hommes si abondamment, mais dont ils tiennent si peu de compte, tandis que les pauvres âmes aspirent ardemment à ces grâces et languissent de désir. »
7. Dès sa première enfance, aussi loin que remontaient ses souvenirs, Anne Catherine avait toujours prié Dieu de la préserver de tout péché, de la traiter en père aimant comme une faible et naïve enfant, de lui faire en tout et partout connaître et accomplir sa très sainte volonté. Dieu dans sa miséricorde avait exaucé cette prière : il avait fait accompagner pas à pas, protéger et éclairer par son ange cette enfant docile et pleine de bonne volonté dans son long voyage à travers une vie de travaux, de combats et de souffrances ; il lui avait fait enseigner comment elle devait régler sa conduite, suivant les occurrences de chaque jour, pour affronter les dangers, supporter les souffrances et soutenir les combats. L’ange montrait tout d’avance à Anne Catherine en visions ou sous forme de tableaux symboliques, de peur que, surprise sans préparation par le changement incessant et souvent subit des circonstances, elle ne se rendît coupable de quelque action ou omission dont sa conscience pût être blessée. L’ange la préparait par des visions symboliques à des souffrances prochaines ou éloignées, afin qu’elle demandât la force de les prendre sur elle : tout évènement de quelque importance, toute rencontre avec les personnes, tout accident fâcheux qui devait arriver soit à elle-même, soit à ceux qui lui touchaient de près, lui était tantôt montré d’avance d’une manière claire et complète, tantôt seulement indiqué, et elle devait se comporter en conséquence. Elle recevait des avertissements précis sur la manière dont elle devait se comporter envers les personnes avec lesquelles elle entrait en rapport ; elle savait si elle devait frayer avec elles ou s’en tenir à distance. Si les circonstances le demandaient, l’ange lui prescrivait jusqu’aux termes dans lesquels elle devait s’exprimer.
La sollicitude du conducteur céleste s’étendait à tous les objets, à tous les travaux, à toutes les affaires dont Anne Catherine devait s’occuper. Elle devait vivre dans deux mondes, le monde extérieur et sensible, et le monde invisible, inaccessible aux sens : il lui fallait agir incessamment dans tous les deux et au profit de tous les deux. La tâche immense qu’elle avait reçue de Dieu portait avec elle que, dans l’ordre extérieur de la vie commune, Anne Catherine fît et accomplît parfaitement tout ce que demandaient d’elle son état et sa vocation ; bien plus, qu’elle l’accomplît au milieu de fatigues et de souffrances qui à elles seules suffisaient à remplir toute une vie. Mais à cela venait s’ajouter l’action à exercer dans les visions, action en vue de laquelle tout ce qui intéressait en tous lieux l’Église universelle lui était manifesté. Alors, toutes les souffrances et les oppressions de la chrétienté, tous les dangers que courait la foi et les blessures qui lui étaient portées, toutes les entreprises sacrilèges coure les biens ecclésiastiques, toutes les profanations des choses saintes lui étaient mises devant les yeux, et la tâche qui en résultait peur elle l’absorbait par fois si longtemps de suite que des jours et des semaines se passaient sans qu’elle pût revenir, avec l’usage de ses sens extérieurs et de ses facultés intellectuelles, dans ce monde visible qui l’entourait, mais qui lui devenait toujours plus étranger, répondre à ses exigences et satisfaire aux devoirs que lui imposait la vie de chaque jour. Comment aurait-elle pu suffire à tout, comment même aurait-elle pu être supportée par ceux qui vivaient avec elle, si la conduite de l’ange n’eût ménagé et protégé cette double vie, n’eût suppléé à l’activité extérieure par une intervention secourable qui portait avec elle la bénédiction, et n’eût maintenu dans un accord imperturbable cette double opération dont les actes étaient souvent séparés par une distance infinie ?
8. Tant qu’Anne Catherine n’eut point part à la direction spirituelle qui se donne par les prêtres de l’Église, l’ange fut le seul guide dont les avertissements réglassent sa vie. Mais lorsqu’elle en vint à s’approcher des sacrements et par suite à se mettre sous la conduite d’un confesseur, le respect et la soumission qui lui étaient habituels envers l’ange devinrent la règle de ses rapports avec le prêtre : elle fut en cela d’autant plus soigneuse et plus scrupuleuse qu’elle remarqua que l’ange lui-même subordonnait sa direction à celle du prêtre. Il semblait que l’ange n’intervint plus qu’en qualité de protecteur et de gardien de sa pupille, de trésorier et d’ordonnateur des grâces et des dons extraordinaires qui étaient accordés à celle-ci pour le bien des fidèles, tandis que l’Église, par l’intermédiaire de son sacerdoce, avait à prendre la conduite spirituelle d’une âme qui devait arriver à son but final par les moyens de salut et les voies accessibles à tous et selon l’ordre établi pour tous dans l’Église de Dieu. Les dons singuliers de la grâce, que nous verrons se déployer avec la plus riche variété chez Anne Catherine, n’étaient pas le but de sa vie, mais seulement des moyens d’accomplir sa mission de souffrance expiatoire pour l’Église : c’est pourquoi aussi ces dons ne devaient pas plus être soustraits au jugement et à la décision de l’Église que la vie intérieure d’Anne Catherine elle-même. Nous constaterons avec surprise le pouvoir immense que le sacerdoce possédait sur Anne Catherine et sur tous ses dons, et nous verrons que l’ange lui-même paraissait être aux ordres et sous la puissance de l’Église. Car c’était lui qui portait à Anne Catherine l’appel du confesseur ou des supérieurs ecclésiastiques quand elle était entièrement séparée du monde extérieur et ravie en esprit dans d’autres sphères, si bien qu’étant absolument inaccessible à toute impression naturelle, paraissant paralysée et sans vie, elle revenait à l’instant à la vie naturelle et à l’état de veille quand l’ordre du prêtre l’y rappelait.
« Quand je suis, disait-elle une fois, introduite dans une vision, absorbée dans une contemplation ou livrée à un travail spirituel qui m’a été confié, je suis souvent tout d’un coup rappelée irrésistiblement dans ce monde ténébreux par une force lointaine, vénérable et sainte. J’entends le mot « obéissance » ; cela sonne douloureusement, mais pourtant l’obéissance est la racine vivante d’où est sorti tout l’arbre de la contemplation. »
Toutefois l’appel du confesseur n’aurait pas pénétré si profondément, s’il n’eût été porté par l’ange auquel la pratique de l’obéissance paraissait plus méritoire pour Anne Catherine que la contemplation. Aussi il ne tardait jamais à la ramener sur la terre, quoiqu’un ordre si subit et si pressant dût pénétrer comme le dard d’une flèche acérée dans son âme livrée à un profond et paisible recueillement.
Nous rencontrerons dans la suite de cette histoire plusieurs cas où la direction du prêtre, en tant qu’homme faible et borné, se trouve en contradiction avec celle de l’ange : mais jamais nous ne verrons la moindre infraction à l’ordre établi de Dieu pour protéger la foi et la conserver pure, ordre selon lequel nulle mission, nulle vocation, nul don, nul privilège, ne doivent exempter de la soumission à l’autorité et au jugement des supérieurs ecclésiastiques. Aucune faveur céleste, aucune distinction spirituelle, aucun degré de sainteté ne surpasse en dignité intrinsèque et en grandeur le caractère sacerdotal ; et il n’existe entre Dieu, chef invisible de l’Église, et les fidèles d’autre médiateur visible que le sacerdoce. C’est pourquoi les grâces, les secours, les trésors de miséricorde que Dieu offre à l’Église dans les mérites et les dons extraordinaires de ses favoris choisis, doivent être contrôlés par les prêtres, reçus en dépôt par eux et transmis ensuite au reste des fidèles. Il en fut ainsi pour Anne Catherine. Du côté de son ange, rien ne fut omis pour préparer en elle une source de bénédiction pour l’Église : mais cette bénédiction devait se répandre dans l’Église par l’intermédiaire du pouvoir sacerdotal, et c’est pourquoi l’abondance plus ou moins grande des fruits qu’elle devait produire dépendait aussi de l’usage qui serait fait de ce pouvoir.
VIII
ANNE CATHERINE EST APPELÉE PAR DIEU À L’ÉTAT RELIGIEUX, ET ELLE Y EST PRÉPARÉE PAR UNE DIRECTION PARTICULIÈRE.
1. Le désir de vivre pour Dieu seul allait toujours croissant dans le cœur de cette enfant si merveilleusement conduite : aussi songeait-elle sans cesse au genre de vie qui pourrait le plus sûrement lui faire atteindre ce but. Longtemps Anne Catherine pensa à quitter secrètement la maison paternelle pour trouver dans quelque contrée lointaine un lieu où elle pût rester inconnue et mener une vie pénitente. En dehors de Dieu, ses parents et ses frères et sœurs étaient les seuls objets auquel elle fût attachée par une tendre affection : c’est pourquoi sa fidélité à Dieu lui paraissait imparfaite si elle restait plus longtemps dans sa patrie. Il lui fut impossible d’exécuter ce projet, mais son désir d’une vie cachée et contemplative en devint d’autant plus ardent, et elle avait toujours cette vie devant les yeux comme l’objet unique et suprême de tous ses vœux. Elle avait un tel attrait pour les personnes vouées à la vie religieuse, que, comme elle l’avouait souvent plus tard, elle n’était pas maîtresse de son émotion, même à la simple vue de l’habit d’un ordre sévère : mais elle osait à peine penser qu’elle pût jamais avoir le bonheur de porter un jour un pareil habit.
Dieu avait mis cette aspiration dans son âme et il daigna être son guide pour la conduire à ce but si désiré. Cette direction qui lui fut donnée, si l’on considère son caractère intrinsèque ainsi que les circonstances extérieures et l’ensemble de la situation où l’Église se trouvait alors, est un fait singulièrement remarquable. Notre œil débile peut y reconnaître les voies mystérieuses par lesquelles Dieu vient en aide aux besoins et aux tribulations de son Église : et il y a là une preuve consolante et encourageante que les miracles de sa toute-puissance et de sa sagesse ne font point défaut à l’Église, même quand l’infidélité, la défection et la trahison d’une quantité innombrable de ses membres s’unissent, pour la détruire, aux efforts de ses ennemis. Lorsqu’Anne Catherine fut appelée à l’état religieux et pourvue par la grâce divine de moyens qui la rendaient capable d’exercer une action de l’ordre le plus élevé, on allait voir ou l’on voyait déjà s’accomplir des évènements qui devaient ravager de telle sorte la vigne de l’Église que la pieuse vierge ne pouvait pas, comme avait fait, par exemple, sainte Colette, travailler à la restauration de la discipline religieuse ou à l’établissement de nouvelles communautés, mais qu’il ne lui restait que la tâche, peut-être plus pénible encore, de servir Dieu en qualité d’instrument d’expiation, comme l’avait été Lidwine de Schiedam dans un temps également désastreux, de satisfaire pour des péchés qui lui étaient étrangers et de prendre sur elle les souffrances et les blessures du corps de l’Église pour en préparer la guérison.
2. Dieu donna à cette enfant une direction en rapport avec cette immense tâche de souffrances embrassant toute l’Église, par cela même qu’il daigna, semblable à un prétendant, rechercher Anne Catherine comme sa fiancée, et dans cette recherche la préparer au plus haut degré de perfection spirituelle. L’Église considère toute âme qui fait les trois vœux de religion comme contractant par là avec Dieu des fiançailles spirituelles ; mais la vocation extraordinaire qui échut à Anne Catherine, la somme de dons inaccoutumés dont elle fut gratifiée, et la fidélité toute particulière avec laquelle elle en devait user sont une preuve que sa qualité de fiancée devait être une prérogative tout à fait unique et qu’elle était choisie pour réparer envers le fiancé de l’Église les outrages que lui faisaient d’innombrables infidélités. La divine libéralité de Dieu tient toujours en réserve pour les enfants de l’Église une surabondance de dons spirituels : mais quand ils sont repoussés, mal employés ou dédaignés, sa justice les retirerait nécessairement à l’Église, si, dans son infinie miséricorde, il ne se préparait pas, comme des vases d’élection, de saintes âmes dans lesquelles il puisse recueillir les trésors méprisés de sa grâce et les conserver à l’Église pour un temps meilleur. Or la bonté de Dieu veut faire de cette conservation un mérite pour ses fidèles serviteurs ; c’est pourquoi il les rend aptes à conquérir par une mesure proportionnée de fatigues, de luttes et de souffrances, ces trésors plus que suffisants pour acquitter la dette contractée par la légèreté, la paresse, l’infidélité et la malice d’autrui. À aucune époque ces instruments choisis des miséricordes de son chef invisible ne font défaut à l’Église et ils lui sont d’autant plus nécessaires que ceux qui ont pour mission d’être les médiateurs entre Dieu et son peuple, ceux qui sont revêtus du sacerdoce suffisent moins à leur tâche et ont moins de zèle pour l’honneur de sa maison. Jamais l’Église n’avait été si profondément abaissée, jamais le fléau de l’incrédulité n’avait produit des ravages aussi universels, jamais les ennemis de la foi et leurs efforts pour l’anéantir n’avaient trouvé si peu de résistance qu’au temps où Dieu choisit Anne Catherine pour sa fiancée. Pauvre faible enfant qu’elle était, il lui fallait livrer bataille aux puissances ennemies : mais Dieu lui avait mis en main les armes avec lesquelles lui-même, dans sa très sainte humanité, avait vaincu l’enfer, et il la formait peu à peu à cette manière de combattre qui rend la victoire certaine. C’est pourquoi nous la verrons conduite par lui sur des voies qui ne sont pas celles de la prudence humaine, de la prévoyance et des calculs humains, mais qui sont tracées par les décrets de son impénétrable sagesse. Plus Anne Catherine était fortifiée spirituellement par cette direction, plus s’étendait la sphère de son action bienfaisante, jusqu’au moment où nous la voyons enfin embrasser toutes les parties et tous les rangs de l’Église.
3. Ce fut dans sa cinquième ou sixième année qu’elle reçut de Dieu son premier appel à l’état religieux. Voici ce qu’elle a dit à ce sujet :
« J’étais encore une très petite fille et je gardais les vaches, ce qui était pour moi une tâche pénible et fatigante. Un jour que le désir me vint, comme cela m’arrivait souvent, de quitter la maison et les vaches et d’aller servir Dieu dans une solitude où personne ne me connaîtrait, j’eus une vision dans laquelle il me sembla que j’allais à Jérusalem. Là il vint à moi une religieuse en qui j’appris plus tard à reconnaître sainte Jeanne de Valois : elle avait l’air très grave et près d’elle était un petit garçon de ma taille qui était merveilleusement beau. Elle ne le conduisait pas par la main : je sus ainsi que ce n’était pas son fils. Elle me demanda ce que j’avais et, quand je lui eus raconté ce qui me préoccupait, elle me consola et me dit : « Sois sans inquiétude ! regarde cet enfant ! veux-tu de lui pour fiancé ? » Je lui répondis que oui ; sur quoi elle me dit de rester en paix et d’attendre que l’enfant vînt à moi, m’assurant que je serais religieuse. Cela me paraissait une chose impossible ; mais elle me dit que j’entrerais certainement au couvent parce que rien n’était impossible à mon fiancé. J’y comptai alors avec une pleine assurance. Quand je revins à moi, je ramenai tranquillement les vaches à la maison. J’eus cette vision en plein midi. Ces sortes de visions ne me troublaient pas : je croyais que tout le monde avait des relations et recevait des avertissements de ce genre. Je n’ai jamais pensé à une différence entre les visions et le commerce réel avec les humains. »
4. Quelque temps après survint un autre incident qui encouragea Anne Catherine à faire le vœu de se rendre à l’invitation du fiancé divin, c’est-à-dire d’entrer en religion, quand elle serait plus avancée en âge. Elle le raconta ainsi :
« Mon père avait fait vœu de donner tous les ans un veau gras au couvent des Annonciades de Coesfeld. Lorsqu’il y portait le veau, il avait coutume de me prendre avec lui. Quand nous étions arrivés au couvent, les nonnes badinaient avec moi comme on fait avec un enfant. Elles me mettaient dans le tour et tantôt me faisaient tourner vers elles dans l’intérieur du couvent, pour me faire quelque cadeau, tantôt me faisaient tourner du côté extérieur, puis me demandaient en plaisantant si je ne voulais pas rester avec elles. Je répondais toujours que oui et je ne voulais pas m’en aller. Alors elles disaient : « La prochaine fois nous te garderons. » Toute petite que j’étais, je pris pourtant en affection ce couvent où la règle était encore bien observée. Quand j’entendais les cloches de son église, je priais avec la pensée d’unir mes prières à celles des pieuses recluses et je me trouvais ainsi en rapport intime et vivant avec le couvent des Annonciades.
« Une fois, par une chaude journée d’été, vers deux heures après midi, j’étais près du troupeau de vaches. Le ciel était noir, un orage allait éclater, il tonnait déjà. Les vaches étaient très inquiétées par la chaleur et les mouches et j’étais dans un grand embarras pour savoir comment je viendrais à bout du troupeau. Il y avait environ quarante vaches qui ne donnaient pas peu de souci à une faible enfant comme moi, quand elles couraient dans le bocage. Elles appartenaient à tout le hameau : autant un habitant du hameau possédait de vaches, autant de jours il devait garder le troupeau. Quand j’en étais chargée, j’étais toujours en prière et en contemplation : je voyageais à Jérusalem et à Bethléem et j’y étais plus connue qu’à la maison. Le jour dont je parle, quand l’orage éclata, je me retirai derrière un monticule de sable où croissaient des buissons de genévriers et je pus me mettre à l’abri. Je priai et j’eus une vision. Il vint à moi une religieuse âgée portant l’habit des Annonciades qui s’entretint avec moi. Elle me dit que ce n’était pas honorer véritablement la mère de Dieu que de se borner à parer et à promener ses images ou à lui adresser toute espèce de pieux discours ; qu’il fallait imiter ses vertus, son humilité, sa charité et sa pureté. Elle me dit aussi que dans le danger et dans l’orage, il n’y avait pas de meilleur abri que de se réfugier par la prière dans les plaies de Jésus ; qu’elle avait toujours eu pour ces plaies sacrées une vénération profonde et qu’elle avait eu la grâce d’en recevoir l’empreinte douloureuse, mais que jamais personne ne l’avait su. Elle me raconta qu’elle portait toujours en secret sur la poitrine un cilice de crin avec cinq clous et une chaîne autour des reins, et qu’il lui avait toujours fallu tenir cachées ses pratiques de piété. Elle parla aussi de sa dévotion particulière envers l’Annonciation de la Sainte Vierge et me dit qu’il lui avait été révélé que Marie, dès sa plus tendre enfance, avait ardemment soupiré après la venue du Messie ; elle désirait seulement devenir la servante de la mère du Seigneur. Elle me raconta encore comment elle avait vu la salutation de l’archange et je lui dis de mon côté comment je l’avais vue : nous devînmes ainsi très bonnes amies.
« Il était environ quatre heures quand je revins à moi. La cloche des Annonciades sonnait la prière : l’orage était passé et je trouvai mon troupeau paisiblement rassemblé : je n’avais pas été mouillée du tout. C’est alors que je fis pour la première fois le vœu de me faire religieuse. Je désirais au commencement entrer chez les Annonciades, mais je réfléchis bientôt qu’il valait mieux être tout à fait éloignée de ma famille. Je gardai le silence sur cette résolution. Dans la suite, je sus intérieurement que l’amie avec laquelle je m’étais entretenue était sainte Jeanne ; je sus aussi qu’on l’avait forcée à se marier. Je la vis encore souvent dans la suite, spécialement dans mes voyages en vision à Jérusalem et à Bethléem : elle m’y accompagnait comme firent plus tard les bienheureuses Françoise et Louise. »
À dater de ce moment, Anne Catherine fut fermement et irrévocablement résolue à entrer dans un couvent. Elle n’y voyait encore aucune possibilité humaine, elle ne pouvait pas non plus imaginer où elle pourrait s’adresser pour être admise, quand le temps serait venu : mais, pénétrée de son vœu comme elle l’était, elle espérait avec une confiance inébranlable que Dieu accomplirait en elle ce qu’il avait commencé en se faisant son guide. C’est pourquoi ses efforts tendaient toujours de plus en plus à mener la vie d’une religieuse, selon l’idée qu’elle en avait et autant que les circonstances le permettaient. Ses parents et ceux qui avaient autorité sur elle étaient pour elle comme des supérieurs ecclésiastiques auxquels elle obéissait de la manière la plus ponctuelle, et quant à ce que peut prescrire la règle d’un couvent en fait de mortification, de renoncement à soi-même et de vie retirée, elle l’observait, à l’aide d’avertissements intérieurs, aussi parfaitement qu’elle le pouvait.
5. Une de ses compagnes de jeunesse, Élisabeth Wollers, née Weermann, déposa ce qui suit devant l’autorité ecclésiastique, le 4 avril 1813 :
« Je connais Anne Catherine Emmerich depuis son enfance ; nous avons grandi ensemble et nous habitions sous le même toit. Elle était sévèrement tenue par ses parents, mais pourtant sans dureté. Elle avait un très bon naturel. Tout ce que je sais, c’est qu’elle avait beaucoup d’affection pour ses parents et ses frères et sœurs. Elle était toujours sage et réservée. Déjà, étant enfant, elle voulait devenir nonne. Dès son plus jeune âge, elle avait de l’attrait pour l’église et pour la dévotion, mais elle n’aimait pas les compagnies et les divertissements. Elle les quittait ordinairement pour s’en aller à l’église. Elle était très recueillie, très réservée, sobre de paroles, très active et très travailleuse. Elle était polie et avenante pour tout le monde, en sorte qu’on lui faisait des cadeaux à cause de sa gentillesse. Elle avait aussi très bon cœur ; elle avait bien quelquefois des vivacités, mais cela lui faisait de la peine tout de suite après. Elle n’était pas recherchée dans ses vêtements, mais seulement convenable et propre. »
6. Dans la douzième année de son âge, elle entra comme fille de service dans la famille d’un paysan de ses parents, qui s’appelait aussi Emmerich. La femme de celui-ci, Élisabeth, née Messig, déposa le 8 avril 1813 :
« Lorsqu’Anne Catherine avait douze ou treize ans, elle habitait ma maison et gardait les vaches. Elle était polie et bienveillante pour toutes les personnes de la maison, et je n’ai jamais rien trouvé à reprendre chez elle. Nos rapports ont toujours été très amicaux. Elle n’allait jamais à une réunion de plaisir ; elle aimait mieux aller à l’église, car elle était très pieuse, très active, très sincère et fort recueillie en elle-même. Elle parlait bien de tous et disait toujours qu’elle ne voulait pas avoir de bien-être dans ce monde : elle portait, au lieu de chemise, une robe de laine grossière. Elle avait très bon cœur, jeûnait beaucoup et disait pour s’excuser qu’elle n’avait pas d’appétit. Quand je lui conseillai de renoncer à son projet de se faire nonne, parce qu’il faudrait y sacrifier tout ce qu’elle avait, elle me répondit : « Ne me parlez pas ainsi, autrement nous ne serons plus amies. Je dois faire cela et je le ferai. »
7. Dès ses premières années, Anne Catherine avait eu des relations fréquentes dans cette maison de paysans aisés : ses parents le voulaient ainsi, dans l’espoir que leur enfant deviendrait peu à peu moins silencieuse et moins recueillie si elle voyait plus souvent d’autres personnes. Ils ne pouvaient s’expliquer un détachement si précoce de toutes les choses du monde chez cette enfant dont la vie était en Dieu ; d’autant moins qu’ils avaient tous les jours de nouvelles preuves de la vivacité de son esprit, de son habileté et de sa capacité et qu’ils craignaient que cette vie si retirée ne nuisît plus tard à son établissement dans le monde. Mais plus on envoyait Anne Catherine chez d’autres personnes, plus le détachement et l’éloignement du monde et de ses relations croissaient en elle. Elle était toujours à l’état de contemplation qui pourtant ne l’empêchait pas de faire aussi bien que possible ce qu’elle avait à faire. Quand elle travaillait aux champs avec les siens, elle disait quelques mots, sans sortir de ses visions, lorsque la conversation avait trait aux choses de Dieu : mais le plus souvent elle gardait le silence, et le travail dont elle était chargée, si pénible qu’il fût, se faisait avec promptitude, sans secousse et sans dérangement. Si on l’interpellait soudainement, il arrivait souvent qu’elle n’entendait pas ou que, semblant s’éveiller d’un songe, elle faisait une réponse qui n’avait pas de rapport à la question. Elle regardait alors le questionneur avec des yeux dont l’expression faisait deviner, même à ces gens simples, qu’ils n’étaient pas tournés vers les objets extérieurs : cependant sa cordialité touchante et son humeur serviable réussissaient promptement à prévenir les conséquences ultérieures d’une impression si étrange.
8. Après qu’elle eut passé trois ans dans la maison d’Emmerich, on la plaça chez une couturière parce que sa faiblesse physique fit penser à sa mère qu’une occupation de cette nature serait plus propre à lui assurer un jour une existence convenable dans le monde. Avant que ce plan fût mis à exécution, elle revint passer quelque temps encore dans la maison paternelle pour aider aux travaux des champs. À cette période se rattache un incident qui donna occasion à Anne Catherine de déclarer à ses parents qu’elle était fermement et irrévocablement résolue à entrer au couvent. Elle travaillait aux champs, une après-midi, avec ses parents et ses frères et sœurs. Il était environ trois heures lorsque la cloche du couvent des Annonciades de Coesfeld sonna les Vêpres. Souvent déjà elle avait entendu la cloche par un vent favorable ; mais cette fois ce son la remplit d’un désir si extraordinaire d’entrer au couvent qu’elle fut au moment de tomber en faiblesse. C’était comme si une voix lui eût crié : « Va au couvent, il le faut quoi qu’il en advienne ! » Elle ne put continuer son travail et il fallut la ramener à la maison.
« À dater de ce moment, raconta-t-elle, je commençai à être malade, je vomissais souvent et j’étais très triste. Comme j’allais de côté et d’autre, languissante et soucieuse, ma mère me demanda ce que j’avais et ce qui me rendait si sérieuse. Je lui déclarai nettement que je voulais aller au couvent. Elle fut très mécontente et me demanda comment je voulais entrer dans un couvent, ne possédant rien et étant d’une mauvaise santé. Elle se plaignit aussi à mon père et ils firent l’un et l’autre tout leur possible pour me dissuader de la pensée du couvent. Ils me représentèrent la vie qu’on y menait comme devant être très pénible pour moi, car j’y serais méprisée en ma qualité de paysanne et à cause de ma pauvreté. Mais je répondis : « Si je n’ai rien, Dieu n’en est pas moins riche pour cela. Il fera réussir la chose. » Le refus de mes parents m’alla tellement au cœur que j’en devins plus malade et qu’il me fallut garder le lit.
« Pendant cette maladie, un jour, à midi, comme le soleil donnait dans ma chambrette par la petite fenêtre, je vis un saint homme s’approcher de mon lit avec deux religieuses qui étaient éblouissantes de lumière. Elles me donnèrent un gros livre semblable à un livre de messe et me dirent : « Si tu peux étudier ce que contient ce livre, tu sauras ce qui convient à une religieuse. » Je répondis que je voulais le lire dès à présent et je pris le livre sur mes genoux. Il était en latin, mais je compris tout et j’y lus avec beaucoup d’attention. Ils me laissèrent le livre et disparurent. Les feuillets de ce livre étaient en parchemin et écrits en lettres rouges et dorées. Il s’y trouvait aussi des images de saints de l’ancien temps. Il avait une reliure jaune, mais pas de fermoirs. J’avais ce livre avec moi quand j’entrai au couvent et j’y lisais avec ardeur. Quand j’en avais lu une partie, il m’était toujours retiré. Je l’avais un jour sur ma table, quand plusieurs religieuses entrèrent chez moi et voulurent le prendre, mais il leur fut impossible de l’ôter de sa place. Plus d’une fois il me fut dit : « Tu as maintenant tant et tant de feuillets à lire encore. » Je vis ce livre dans les dernières années, lorsque je fus ravie en esprit à un endroit qui se rapporte à la prophétie et aux écrits d’anciens prophètes : il me fut montré là, parmi beaucoup d’autres livres prophétiques de tous les lieux et de tous les temps, comme étant la part que j’aurais dans ces trésors. D’autres présents que j’avais reçus en diverses occasions pour me consoler et m’aider et que j’avais eus longtemps en ma possession me furent montrés comme conservés là. Maintenant (20 décembre 1819) je n’ai plus que cinq feuillets à lire, mais il me faut pour cela du repos afin que je puisse en laisser après moi le contenu. »
9. Ce livre mystérieux n’était donc pas un pur symbole, mais un écrit réel, ayant la forme d’un volume et contenant des choses prophétiques. Il provenait, comme il sera rapporté en son lieu, du trésor des saints écrits qui sont conservés sur ce qu’Anne Catherine appelle la montagne des prophètes et transmis par des voies extraordinaires à des personnes que l’infusion de la lumière prophétique a rendues capables de comprendre ce qui s’y trouve. Ce livre traitait de l’essence et de la signification de l’état religieux, de sa place dans l’Église et de sa mission dans tous les temps, en sorte que toute personne à laquelle il était donné d’en prendre connaissance pouvait y apprendre de quel bien elle devait être l’instrument pour l’Église de son temps. La lecture qu’y faisait Anne Catherine donnait lieu pour elle à des visions où ce qu’il contenait se développait sous ses yeux dans une série de tableaux. Même quand il lui arrivait de réciter un psaume, le Magnificat, le Benedictus, le premier chapitre de l’Évangile de saint Jean, une prière de la liturgie catholique ou les litanies de la sainte Vierge, les mots s’ouvraient, pour ainsi dire, comme des enveloppes où la graine est renfermée et les contemplations les plus variées touchant leur contenu historique et leur sens le plus profond venaient se présenter à elle : il en était de même pour ce livre. Elle y voyait comme but et objet principal de l’état religieux le mariage avec le fiancé céleste, mais dans ce tableau général elle apercevait distinctement sa propre participation à cette tâche, ainsi que les voies et les moyens, les empêchements et les encouragements, les travaux, les peines, les mortifications, les victoires sur elle-même qui devaient l’aider à l’accomplir ; et cela, non seulement en ce qui se rapportait à sa sanctification personnelle, mais aussi en ce qui touchait la situation et les besoins de l’Église elle-même. Car Anne Catherine ne devait pas recevoir la grâce de la vocation uniquement pour elle et pour sa propre perfection, mais le Père céleste l’avait destinée à être un instrument au moyen duquel il voulait sauver cette grâce avec tous les dons et les effets qui s’y rattachent et la conserver à l’Église, dans un temps de défection universelle où la vigne du Seigneur était livrée à la dévastation. C’est pourquoi tout ce qu’Anne Catherine apprenait dans le livre de prophétie et tout ce qu’elle pratiquait d’après ses indications avait toujours le caractère de substitution, d’expiation et de satisfaction pour les fautes et les manquements d’autrui ; et tous les travaux qu’elle avait à accomplir en vision se faisaient plus pour d’autres que pour elle-même. Ils étaient une plantation, une récolte, une préparation, une conquête, un combat, une réparation dont le fruit et le profit étaient destinés à toute l’église par le fiancé céleste.
10. Plus Anne Catherine pénétrait profondément dans ce livre, plus ses contemplations devenaient riches et plus elles devenaient la règle de toute sa vie intérieure et extérieure. Elle percevait l’accord de tous ces tableaux, soit entre eux, soit avec toute la mission de sa vie : elle voyait clairement qu’ils embrassaient, dans leur ensemble, l’histoire d’une fiancée engagée au fiancé céleste, qui soupire après lui, tend vers lui, qui doit préparer laborieusement pour lui tout ce qu’il faut pour se mettre en ménage, mais qui est incessamment retardée et dérangée par des choses qui manquent, par d’autres qui se perdent ou se détruisent, par des travaux faits en sens contraire. De temps en temps une série des évènements de sa vie dans un avenir prochain lui était montrée d’avance dans des tableaux symboliques qui ne manquaient jamais de se réaliser : même tous les empêchements qui provenaient de ses propres péchés, de sa tiédeur, de ses omissions, de sa trop grande condescendance pour autrui se montraient là comme des avertissements. Mais tout cela ne lui était pas représenté de façon qu’elle n’eût qu’à suivre en aveugle ou qu’il ne dût pas lui en coûter des résolutions sérieuses, des combats et des efforts ; car ces tableaux symboliques étaient comme une similitude, comme une parabole qui la fortifiait et l’éclairait, l’aidant à faire ce qui était convenable, à éviter ce qui ne l’était pas ou à parer à un danger, mais non comme une chose toute faite ou comme un présent pour lequel elle n’eût qu’à ouvrir la main. Ils lui montraient en outre, dans le détail, les misères et les besoins divers qu’elle n’eût pu embrasser d’un coup d’œil mais pour lesquels elle avait à lutter et à prier, et ils lui indiquaient ce qu’elle avait à faire dans tel ou tel cas. Ces tableaux la consolaient aussi et, en lui faisant voir ses fautes, lui apprenaient comment elle pourrait les éviter ou les réparer.
11. Les travaux et les arrangements qui occupaient Anne Catherine en vision et qu’elle avait à mener à bien sans manquements et sans fautes se rapportaient à la préparation de la parure et du trésor nuptial d’une fiancée accordée avec le fils d’un roi. Ce qu’une mère soigneuse et intelligente ferait en pareil cas pour sa fille promise à un tel fiancé était précisément ce qu’Anne Catherine devait faire en vision. Elle avait à mettre toutes choses en état par des travaux comme ceux qui se font pour la vie ordinaire et pour ses besoins, mais qui avaient ici une signification plus élevée et d’autres effets. Ainsi elle devait préparer le champ, semer du lin, sarcler les mauvaises herbes, cueillir le lin, le rouir, le briser, l’affiner, le filer, le tisser et blanchir le linge destiné à la fiancée. Elle devait tailler, coudre, broder de la façon la plus variée, suivant la signification spirituelle des diverses pièces d’habillement, lesquelles étaient en très grand nombre et dont la confection exigeait de grandes fatigues. Ces travaux en vision étaient les symboles de ses fatigues, de ses mortifications, de ses victoires sur elle-même dans la vie de chaque jour. Chaque coup d’aiguille pour la confection du vêtement nuptial était la piqûre d’une douleur supportée patiemment qui augmentait ses mérites et la rapprochait du but. Un acte de vertu imparfait, défectueux, se montrait dans la vision comme une couture ou une broderie mal réussie qu’il fallait supprimer et refaire à nouveau. Toutes les impatiences, toutes les vivacités, tous les manquements, jusqu’au plus léger, étaient représentés par des défauts, des avaries et des taches qu’il fallait réparer ou effacer par un redoublement d’efforts et de fatigue. Tous ces travaux s’élevaient, variant suivant les années, depuis le plus simple vêtement jusqu’à la parure de fête de la fiancée et à tout ce qui constituait un trousseau complet. Chaque pièce particulière devait être achetée par des sacrifices et soigneusement conservée jusqu’au moment du mariage. Il résultait de la tâche imposée à Anne Catherine que la vision relative aux fiançailles qui lui servait de guide devenait chaque jour plus étendue et plus variée parce que toutes les circonstances et les influences de l’époque qui avaient trait à l’Église venaient s’y produire. Tout le monde laïque et ecclésiastique qui l’environnait venait s’y montrer, suscitant des obstacles ou apportant des encouragements : de même toutes les tentatives avortées, toutes les démarches inutiles, toutes les prières non exaucées, toutes les attentes trompées lui étaient montrées d’avance dans des tableaux symboliques.
12. Les travaux qu’elle faisait en vision s’entremêlaient si simplement et si naturellement à sa vie extérieure qu’ils n’y apportaient jamais de trouble ; bien plus, il n’existait pour elle aucune différence sensible à son esprit entre cette double action : toutes deux étaient une même chose parce que les mêmes vues et les mêmes pensées y présidaient et parce qu’elles étaient également dirigées vers le même but. Le travail en esprit passait avant le travail extérieur de chaque jour, semblable à la prière et aux bonnes résolutions par lesquelles un pieux chrétien commence son œuvre journalière, offrant toutes ses actions à Dieu pour sa gloire et pour l’acquisition de quelque vertu : et de même que celui-ci a coutume de renouveler son intention dans le courant de la journée pour se fortifier dans ses bonnes dispositions et ses bons propos, de même il pouvait arriver qu’Anne Catherine eût à faire un seul et même travail pour obéir à sa maîtresse ou à ses parents et pour suivre des instructions reçues dans sa vision. Elle s’expliqua ainsi une fois à ce sujet.
« Je ne puis dire de quelle manière la contemplation de ces tableaux se liait à mes actions, mais c’était d’après elle que je faisais avec une grande ponctualité ou que j’évitais de faire ce qui se présentait à moi dans le cours ordinaire de la vie. Cela a toujours été très clair pour moi, quoique je n’eusse personne autour de moi qui eût pu comprendre mes explications à ce sujet. Je crois qu’il en arrive autant à toute personne qui, dès sa jeunesse, travaille avec zèle pour arriver à son but, la béatitude éternelle ; seulement la manière dont Dieu daigne la diriger reste invisible pour elle. Une autre personne éclairée d’en haut pourrait s’en rendre compte d’après la marche des choses comme je l’ai fait moi-même constamment en ce qui touchait les autres. Celui qui ne voit pas la direction divine agit pourtant d’après elle et il en recevra l’influence bénie, tant qu’il obéira à toutes les impulsions, les aspirations et les avertissements que Dieu lui fait arriver par l’ange gardien, par la prière, par le confesseur, par les supérieurs, par le sacerdoce de l’Église, aussi bien que par les évènements et les circonstances de la vie journalière. De quelque côté que je portasse mes regards, la vie ordinaire ne me montrait que l’impossibilité d’entrer dans un couvent mais la vision m’y conduisait toujours et sûrement, et je recevais intérieurement l’assurance que Dieu, qui peut tout, me conduirait au but. Et cela me donnait une ferme confiance. »
13. À peine Anne Catherine était-elle remise de sa maladie que sa mère la mit en apprentissage à Coesfeld, chez la maîtresse couturière Élisabeth Krabbe, dite Notthof : elle espérait que ce nouveau genre de vie et le commerce plus fréquent avec toute sorte de personnes qui en résulterait la distrairait un peu et la ferait revenir sur son projet d’entrer au couvent. Mais Dieu avait disposé que précisément ce court espace de moins de deux ans pendant lequel Anne Catherine fut en apprentissage serait le temps le plus tranquille de sa vie quant à l’extérieur. Elle n’eut pas besoin de commencer par apprendre à coudre ; car, de même que précédemment elle avait fait tout ce dont elle était chargée, soit aux champs, soit à la maison, sans sortir de la contemplation, de même maintenant sa main savait manier adroitement l’aiguille, pendant que son œil était dirigé vers de tout autres objets. Dieu lui donna une telle aptitude pour cette sorte de travaux qu’elle pouvait venir à bout des ouvrages les plus difficiles sans y appliquer son esprit. Ses mains seules étaient actives et, comme conduites par l’ange, poursuivaient leur travail avec précision et sûreté quoique son œil, détourné des choses du monde extérieur, ne pût même plus y jeter un regard. Au commencement, Anne Catherine se mettait avec inquiétude à la table de travail parce qu’elle savait bien qu’elle ne pourrait résister à l’invasion des visions ni s’empêcher d’avoir l’esprit absent, et elle était très tourmentée par la crainte d’attirer par là sur elle l’attention soupçonneuse de l’entourage. Mais elle pria Dieu de venir à son aide et elle fut exaucée : l’ange lui mettait dans la bouche les paroles qu’il fallait, chaque fois qu’on s’adressait soudainement à elle, en même temps qu’il veillait sur ses mains afin qu’elles ne laissassent pas tomber l’ouvrage. Anne Catherine alla bientôt si loin dans cette voie que, jusqu’à la fin de sa vie, elle put consacrer ses douloureuses nuits non seulement à la prière et à un travail purement spirituel, mais aussi à faire des travaux de couture pour des enfants pauvres, des malades et des femmes en couches, sans avoir besoin pour cela du secours de ses yeux ni d’une application particulière de son esprit.
14. Il est facile de comprendre que pendant les rudes travaux des champs qu’il lui fallait faire précédemment, en y employant toutes ses forces, il avait été plus facile à Anne Catherine de résister à une profonde absorption dans la contemplation que maintenant où, assise tranquillement devant une table, elle avait à faire des choses qui n’exigeaient d’elle ni effort ni attention : aussi toute son âme était-elle attirée dans des contemplations qui la saisissaient plus profondément et plus puissamment que les scènes de l’histoire sainte, parce qu’elles avaient presque continuellement pour objet sa propre vie et la tâche qu’elle avait à remplir. Dieu lui montra quelles grandes choses il accomplit dans une âme qui est appelée à l’état religieux conformément à ses décrets éternels. Il lui fit connaître toute la série de grâces et de directions dont a besoin la faible et inconstante créature humaine pour arriver au but sublime que Dieu lui a marqué, malgré ses manquements et ses infidélités sans nombre. Et elle admirait et louait, le cœur plein de reconnaissance, cette sollicitude et cette bonté si touchantes du Seigneur qui daigne ainsi prodiguer des dons d’une valeur inestimable aux âmes qu’il veut rendre capables de recevoir ses plus hautes faveurs. Plus son cœur aimant était pénétré de ces sentiments, plus sa douleur était grande à la vue de la triste situation de l’Église dans laquelle il ne semblait plus possible que personne voulût désormais embrasser la vie religieuse avec ses saints vœux. Cette situation, ainsi que les persécutions et les dangers qui menaçaient encore la foi catholique, était montrée à Anne Catherine, parce que Dieu voulait agréer ses prières, ses souffrances et ses sacrifices afin de conserver par là à l’Église ces dons qu’alors peu de chrétiens voulaient accepter et conserver fidèlement et que toutes les puissances ennemies, conjurées contre elle, voulaient anéantir. Il remuait son cœur par ces contemplations, afin qu’elle demandât pour elle-même avec un désir plus ardent la grâce de la vocation et s’offrît sans relâche à souffrir toutes les peines qui pouvaient être une compensation pour l’ingratitude, le mépris et les outrages que cette grâce rencontrait maintenant partout.
15. Le Sauveur lui montra en outre ce qu’il avait dû faire et souffrir pour conférer à son Église la parure de l’état religieux, comment il avait placé ce joyau sous la garde et la tutelle spéciale de sa très pure Mère, et comment, pour rehausser sa gloire dans l’Église, il lui avait remis le pouvoir de planter dans sa vigne les diverses familles religieuses et de les renouveler selon les besoins. Aussi, c’était à cette très sainte Mère qu’Anne Catherine dans ses visions avait à présenter successivement chaque pièce de la parure nuptiale, pour corriger et améliorer, d’après ses avis, ce qui était défectueux. Si nous nous souvenons que, dès sa quatrième année, Anne Catherine avait coutume de se flageller avec des orties quand elle voyait Dieu offensé par des enfants mal élevés, nous pourrons mesurer l’irrésistible puissance de l’amour qui lui faisait maintenant chercher à dédommager Dieu des injures de ses fiancées infidèles. Ce désir devenait plus ardent à mesure que lui était révélée plus clairement la haute dignité à laquelle est élevée une âme qui s’unit à Dieu par la profession des vœux de religion. Plus elle considérait avec admiration la perfection et le mérite que les vœux communiquent à toutes les actions, même les plus insignifiantes, d’une personne consacrée à l’état religieux, plus elle aspirait ardemment à cette faveur, dans l’espoir que par là elle pourrait honorer Dieu davantage et le servir plus parfaitement. Elle arriva à une conviction si assurée touchant l’incomparable efficacité des vœux de religion qu’elle ne croyait pas pouvoir se montrer assez reconnaissante envers Dieu, si elle ne lui offrait jusqu’à son dernier soupir une vie remplie de labeurs et de souffrances. C’est pourquoi son âme vaillante ne se laissait pas décourager, quand, pour le présent, elle ne voyait encore aucune possibilité humaine d’entrer dans un couvent et quand tous ceux devant lesquelles son désir se manifestait s’élevaient contre elle. Mais ses forces physiques n’étaient pas en état de supporter tout ce qu’elle éprouvait intérieurement. Elles s’épuisèrent tout à fait, et Anne Catherine se montra si malade et si affaiblie qu’il fallut lui faire quitter son apprentissage.
16. La maîtresse couturière déposa en ces termes, devant l’autorité ecclésiastique, le 14 avril 1813 :
« J’ai connu Anne Catherine Emmerich quand elle avait douze ans et qu’elle habitait chez Zeller Emmerich, dans le district rural de Flamske appartenant à la paroisse de Saint-Jacques de Coesfeld : ce fut de là qu’elle vint chez moi, à l’âge de quinze ans, pour y apprendre la couture. Elle n’y resta pas tout à fait deux ans, car elle tomba malade et, avant que sa guérison fût complète, elle alla à Coesfeld où elle resta.
« Tout le temps qu’elle demeura chez moi, elle s’est toujours très bien conduite : elle était très laborieuse, toujours prête à faire ce que je lui disais, sans jamais contredire. Elle ne parlait pas beaucoup et se montrait plutôt silencieuse et réservée. Elle n’était chez moi que les jours ouvriers : elle passait les dimanches et les jours de fête chez ses parents. Je n’ai rien trouvé à reprendre chez elle, si ce n’est qu’elle aimait à être bien habillée. »
Lorsqu’Overberg, le 21 avril 1813, demanda à Anne Catherine qui faisait avec lui son examen de conscience, s’il était vrai que dans sa jeunesse elle eût été recherchée dans son habillement, elle lui répondit :
« J’aimais toujours à être habillée convenablement et proprement ; toutefois, ce n’était pas en vue des hommes, mais en vue de Dieu. Ma mère souvent ne pouvait satisfaire en cela mon désir ; alors j’allais près de l’eau ou devant un miroir pour m’arranger. S’habiller décemment et proprement est bon, même pour l’âme. Quand j’allais communier le matin, avant l’aube, je m’habillais avec autant de soin qu’en plein jour, car c’était pour Dieu et non pas pour le monde. »
IX
ANNE CATHERINE SÉJOURNE TROIS ANS À COESFELD, DEPUIS SA DIX-SEPTIÈME JUSQU’À SA VINGTIÈME ANNÉE.
1. Jusqu’alors Dieu s’était servi de voies extraordinaires pour diriger Anne Catherine vers l’état religieux ; maintenant elle devait suivre la route ordinaire, c’est-à-dire apprendre à connaître et s’exercer à surmonter les obstacles et les dangers contre lesquels tous ceux qui sont appelés à la vie religieuse ont plus ou moins à lutter. Tant que son âme put rester occupée à contempler l’excellence et la dignité surnaturelle de l’état religieux, elle en était si vivement saisie que son désir n’avait d’égal que la douleur qu’elle ressentait en voyant la profonde décadence de ce saint état et les efforts du monde pour le détruire entièrement. Ses combats intérieurs consistaient proprement dans la peine qu’elle se donnait pour maîtriser son ardent désir et dans l’inquiétude avec laquelle elle se demandait comment elle triompherait par la patience et la confiance en Dieu de difficultés extérieures qui paraissaient insurmontables. Maintenant, Dieu voulait qu’Anne Catherine apprît par sa propre expérience quelle est la faiblesse d’une personne livrée uniquement à ses propres forces, et qu’elle restât fidèle, même quand le témoignage sensible de ses illuminations et de ses consolations extraordinaires lui ferait défaut et quand les influences extérieures auraient pleine liberté de lui susciter des empêchements.
2. C’est pourquoi on voit commencer ici, pour elle, quant à sa direction, une nouvelle période comprenant l’intervalle de sa dix-septième à sa vingtième année. Pendant ce temps, elle habita Coesfeld, où elle était entrée au service d’une maîtresse couturière dans l’espoir d’amasser, à force de travail et d’économie, le montant de la dot qui pourrait être exigée pour son admission dans un couvent. Mais ce but ne put être atteint, car ses petits gages de la semaine s’en allaient le plus souvent le jour même où elle les avait touchés. Tout ce qu’elle gagnait appartenait aux pauvres. Quelque vif que fût son désir d’entrer en religion, l’amour des pauvres était encore plus fort, et Anne Catherine n’hésitait jamais à se dépouiller de tout. Un jour, ayant rencontré une vieille femme couverte de misérables haillons, elle fut saisie d’une telle compassion qu’elle prit aussitôt une pièce de son vêtement et en couvrit la mendiante, quoiqu’elle n’eût rien à mettre à la place. Elle voulait secourir les autres à ses dépens, et plus une privation lui était pénible, plus elle était prompte à se l’imposer. Elle espérait recouvrer par là la force d’âme et l’ardente charité dont elle se sentait dépouillée depuis qu’elle habitait Coesfeld. Toutes les consolations qu’elle était accoutumée jusqu’alors à ressentir dans ses prières et ses pratiques de piété lui avaient été retirées et elle croyait apercevoir en elle-même un grand refroidissement et un dégoût de toutes les choses spirituelles. Cela la tourmentait beaucoup, et son inquiétude s’accrut d’autant plus que le délaissement intérieur lui rendait toute pratique de plus en plus pénible. Dans son humilité, elle ne donnait place qu’à une pensée, c’était qu’elle avait mérité ce refroidissement par son infidélité dans l’usage des grâces reçues et par son manque de ferveur ; elle se sentait maintenant si indigne de la grâce de la vocation qu’aucune pénitence ne lui semblait trop dure pour expier ses fautes. Elle redoublait ses austérités et ses mortifications accoutumées, et s’appliquait scrupuleusement à n’omettre aucune pratique, quoique souvent il lui fallût un effort extrême pour surmonter sa répugnance apparente. Elle se considérait comme étant dans l’état de tiédeur et, quoiqu’elle n’eût pas à avouer à son confesseur le moindre consentement ou la moindre négligence quant à l’éloignement pour les choses spirituelles, cependant le sentiment de sa culpabilité et la crainte qu’il lui inspirait étaient parfois si grands en elle, qu’elle n’osait pas recevoir la sainte communion aussi souvent qu’auparavant et qu’elle ne put y être décidée que par l’ordre de son confesseur. Elle continua durant trois ans environ à soutenir courageusement cette lutte, jusqu’au moment où Dieu lui fit sentir de nouveau son voisinage et son assistance ; alors le courage ferme et joyeux, ainsi que le zèle ardent de la charité, se réveilla plus puissamment dans son cœur.
3. Elle eut aussi dans ce temps beaucoup d’ennuis et de contrariétés extérieures à supporter, parce que son entourage, ses parents, ses frères et sœurs, employèrent tous les moyens possibles pour la détourner de nouveau de son projet d’entrer au couvent. La maîtresse chez laquelle Anne Catherine travaillait avait conçu pour elle une telle affection qu’elle lui offrit plusieurs fois avec instance de rester dans le célibat et de tout partager avec elle si Anne Catherine de son côté pouvait se résoudre à ne jamais la quitter. Elle était tellement touchée de la piété d’Anne Catherine que son désir était de mener avec elle, jusqu’à leur mort, une vie retirée et consacrée à des pratiques pieuses. Jamais elle n’avait gêné Anne Catherine par une curiosité indiscrète et ne l’avait entravée en rien ; elle trouvait même bon que d’autres jeunes filles vinssent chercher près d’elle de bons conseils et des encouragements à la piété ; elle pouvait donc croire qu’Anne Catherine adhérerait à un projet qui semblait devoir offrir comme un équivalent de la vie religieuse. Mais celle-ci ne se laissa pas détourner et elle déclina ces offres bienveillantes par des arguments si persuasifs que la bonne intelligence entre elles ne fut pas troublée un instant.
4. Il lui fut plus difficile de résister aux efforts redoublés de ses parents, lesquels s’imaginaient qu’elle perdrait le désir d’entrer au couvent, si l’on pouvait la contraindre à prendre plus de part aux divertissements mondains. Il fallait pour cela la forcer à aller davantage dans les compagnies et même dans des lieux de récréations publiques. Les personnes de son âge et ses connaissances se réunirent à ses parents pour l’y décider. Il était toujours difficile à Anne Catherine de refuser à quelqu’un ce qu’il lui demandait ; aussi lui parut-il absolument impossible de repousser toujours ses parents contristés, chaque fois qu’ils tentaient de la faire aller à une réunion dansante avec l’un de ses frères ou l’une de ses sœurs. Elle céda deux fois, quoique avec une grande répugnance, parce qu’elle espérait que cette condescendance lui épargnerait des instances ultérieures. Voici ce qu’elle raconta à ce sujet :
« Un jour, mon frère aîné voulait absolument que j’allasse avec lui à la danse ; mais, comme je n’en fis rien et que je refusai nettement, cela le mit de mauvaise humeur ; il se querella avec moi et courut à la maison très irrité. Mais il revint tout de suite, pleura à chaudes larmes, s’agenouilla devant moi en présence de nos parents et me demanda pardon de sa vivacité. Nous n’avions, du reste, jamais eu de dissentiments, et nous n’en avons jamais eu depuis.
« Mais un jour que, par une condescendance mal entendue, je m’étais laissé persuader d’aller à une réunion de ce genre, je fus prise d’une tristesse extrême et je les y suivis dans un état approchant du désespoir. Mon âme n’y était véritablement pas présente, mais j’étais à la torture comme si j’eusse été en enfer. J’étais violemment tirée au dehors, au point que je n’étais plus maîtresse de moi. Pourtant je restai encore, par crainte de manquer aux convenances et de faire un éclat. Alors il me sembla que mon fiancé divin m’appelait et je m’enfuis de là ; je regardai autour de moi, je cherchai et trouvai sous des arbres mon fiancé plein de tristesse et d’indignation : son visage était défait et même tout ensanglanté. Et il me dit : « Comme tu es infidèle ! comme tu m’oublies ! comme tu m’as maltraité ! ne me reconnais-tu donc plus ? » Alors j’implorai mon pardon et j’appris ce que j’avais à faire pour prévenir les péchés d’autrui. Je devais m’agenouiller dans un coin et prier, les bras étendus, ou bien aller dans des endroits où il y avait des péchés à empêcher.
« M’étant encore une fois laissé entraîner par une complaisance blâmable à un divertissement du même genre, la force qui m’en arrachait devint irrésistible, quoi que fissent mes compagnes pour me retenir. Je m’enfuis, et il me semblait que la terre voulait m’engloutir. J’étais en proie à une tristesse inexprimable. À peine étais-je hors de la porte de la ville et sur le chemin de la maison, qu’une femme d’un aspect majestueux vint à moi et me dit d’un ton sévère : « Qu’as-tu fait ? quelle est ta conduite ? tu t’es engagée à mon Fils, mais tu ne dois plus avoir part avec lui ! » Alors le jeune homme vint aussi à nous, triste et défiguré ; ses reproches me percèrent le cœur, quand je pensai que j’étais en si mauvaise compagnie pendant qu’il m’attendait accablé de souffrances. Je crus mourir de douleur ; je suppliai sa mère de demander grâce pour moi et je promis de ne plus jamais céder. Elle intercéda pour moi, j’obtins mon pardon et je promis encore une fois de ne plus me laisser conduire dans de telles assemblées. Alors ils me quittèrent. J’étais à l’état de veille, avec pleine conscience de moi-même, et ils s’étaient entretenus avec moi comme l’auraient fait des personnes vivantes de la vie ordinaire. J’étais triste jusqu’à la mort et je revins à la maison en sanglotant. Le lendemain on me fit de grands reproches de m’être ainsi échappée toute seule.
« On finit pourtant par me laisser en repos. Il tomba entre les mains de mon père un petit livre où il lut que les parents ne devaient pas obliger leurs enfants à de pareils divertissements. Cela lui fit tant de peine qu’il en pleura amèrement et dit : « Dieu sait pourtant que j’avais bonne intention. » Il me fallut le consoler moi-même du mieux que je pus. »
5. L’opposition de ses parents à son projet ne cessa pourtant pas, elle en devint même d’autant plus vive. On est d’abord très étonné de voir ces pauvres gens de la campagne, qui ne pouvaient jamais espérer de voir leur fille dans une position bien avantageuse, montrer une répugnance invincible à son entrée au couvent ; mais on a une impression différente quand on se représente quel trésor elle était pour eux. Depuis que Dieu la leur avait donnée, ils n’avaient trouvé en elle que joie et consolation. Cette enfant, guidée par son ange gardien et éclairée d’en haut, était devenue pour eux dès son plus jeune âge, par sa sagesse et son intelligence, ainsi que par le don de conseil qu’ils trouvaient en elle sans le chercher et comme sans le savoir, une ressource dont ils ne pouvaient se passer. En outre, une bénédiction merveilleuse était répandue sur elle et sur tout ce qu’elle faisait, et ils s’en apercevaient surtout quand elle n’était pas auprès d’eux.
Devenue jeune fille, Anne Catherine, grâce à l’inexprimable bonté de son cœur et à la sérénité d’une âme dont rien ne troublait jamais la paix, avait en elle quelque chose de si attrayant que ses parents ne voulaient jamais se séparer d’elle pour longtemps. À cela s’ajoutait la sollicitude ingénieuse et infatigable avec laquelle Anne Catherine prévenait tous les désirs et tous les besoins de ses parents qui trouvaient là l’assurance des soins les plus affectueux et de l’assistance la plus fidèle pour leurs vieux jours ; aucune pensée ne pouvait donc leur être plus pénible que celle d’être privés en un instant de tout leur bonheur. Bien qu’Anne Catherine eût déjà résidé pendant des années hors de la maison paternelle, elle en avait toujours été si peu éloignée que le commerce journalier n’était jamais interrompu. Mais la clôture d’un couvent menaçait de leur tout enlever, car ils connaissaient trop bien le zèle ardent de leur fille pour ne pas savoir d’avance que, fût-elle même dans une maison un peu relâchée, elle y vivrait comme une parfaite religieuse et voudrait observer scrupuleusement la règle. C’est pourquoi ils auraient vu plus volontiers chez elle de l’inclination pour le mariage, parce qu’il n’eût pas supprimé tout d’abord la possibilité de rapports fréquents. La volonté d’Anne Catherine d’obéir à Dieu qui l’appelait à l’état religieux, devait donc imposer à ces pauvres parents le renoncement à tout ce qui leur était le plus cher et le plus précieux et à ce que rien ne pouvait remplacer pour eux. En outre, en considérant l’état où se trouvaient alors les couvents, ils étaient préoccupés de la pensée que leur pauvreté serait reprochée à leur fille pendant toute sa vie et que personne ne comprendrait l’étendue du sacrifice qu’ils feraient en donnant leur enfant à une communauté religieuse. C’est pourquoi ils la pressaient avec des prières, avec de tendres reproches, avec des larmes, avec des explosions de douleur violente, même avec des blâmes sévères, d’abandonner son dessein, où ils cherchaient à lui montrer, tantôt l’effet de la présomption et du caprice, tantôt la crainte des charges d’une vie besoigneuse dans le monde ; aussi, son cœur si tendre et si aimant en était-il violemment oppressé, au point que souvent elle savait à peine que leur répondre. Dans cette situation, elle avait recours à la prière la plus fervente, afin d’obtenir la force et la lumière dont elle avait besoin pour arriver à son but.
« Mes parents, dit-elle plus tard devant Overberg, me parlaient aussi du mariage, pour lequel j’avais une grande répugnance. Mais la pensée me vint que cette répugnance pouvait bien avoir sa source dans la crainte des charges de l’état conjugal. Si c’était pourtant la volonté de Dieu que je me mariasse, me disais-je, je devrais accepter ces charges. Je me mis alors à prier Dieu de m’ôter cette répugnance pour le mariage si c’était sa volonté que je cédasse au désir de mes parents et que je prisse cet état ; mais mon désir d’entrer au couvent ne fit qu’augmenter.
« J’exposai aussi mon embarras à mon curé et à mon confesseur et leur demandai conseil. Tous deux me dirent que si je n’avais pas de frères ni de sœurs qui pussent prendre soin de mes parents, je ne devrais pas entrer au couvent contre leur volonté ; mais que, comme ils avaient plusieurs enfants, j’avais à cet égard toute liberté. Je persévérai donc dans ma résolution. »
6. C’est un fait très remarquable qu’Anne Catherine, quoiqu’ayant si souvent reçu dans ses visions la connaissance bien positive que Dieu l’appelait à l’état religieux, était pourtant toujours renvoyée aux voies ordinaires pour y trouver la confirmation et l’assurance de ce qui lui était communiqué extraordinairement par Dieu. De même que les obstacles extérieurs qui s’accumulaient contre son projet ne disparaissaient pas miraculeusement et subitement, mais devaient être surmontés par elle-même à force de luttes et d’efforts, de même les lumières acquises surnaturellement ne la dispensaient pas de l’obligation de faire en outre certifier sa vocation par les moyens qui sont à l’usage de tous les fidèles. Anne Catherine était appelée à l’état religieux pour le bien de l’Église ; elle devait être un modèle pour les personnes engagées dans cet état, et montrer en sa personne, à une époque où la vie spirituelle était en pleine décadence, à quelle perfection de fidélité peut arriver une âme qui a pris Dieu pour époux ; c’est pourquoi elle devait être soumise à la direction de l’Église, c’est-à-dire aux représentants de Dieu, aux prêtres et aux confesseurs. Comme les autres fidèles, il fallait qu’elle réglât sa conduite d’après leurs décisions et leurs jugements, et c’était par cette voie, commune à tous, qu’elle devait atteindre le but que Dieu lui avait marqué. C’est précisément cette parfaite soumission à la conduite et à l’ordre accoutumé de l’Église qui est la pierre de touche la plus sûre, quant à la réalité de tous les dons extraordinaires qui avaient été départis à Anne Catherine. Aussi verrons-nous dans la suite de sa vie des preuves de plus en plus nombreuses que tout ce que Dieu lui avait accordé était placé sous la garde et soumis au jugement des supérieurs ecclésiastiques pour recevoir de là le sceau qui en certifiait l’authenticité.
7. Anne Catherine reçut dans sa dix-huitième année le sacrement de confirmation des mains de Gaspard Max de Droste-Vischering, alors évêque suffragant de Munster. Cette sainte cérémonie eut lieu au temps de son délaissement intérieur, lorsqu’elle était si tourmentée de la crainte d’être tombée dans l’état de tiédeur. C’est pourquoi l’appel à la confirmation fut pour elle comme une voix du ciel ; elle s’y prépara avec le soin le plus scrupuleux et la ferme confiance qu’elle recouvrerait par la vertu de cet admirable sacrement la force et la joie spirituelles pour le retour desquelles elle croyait n’avoir fait que de vains efforts depuis un an. Lors de sa première communion, elle avait prié Dieu de faire d’elle une enfant bonne et docile ; cette fois elle demanda une fidélité assez constante et un amour assez persévérant pour la rendre capable de souffrir jusqu’à son dernier jour pour Dieu et pour le prochain. Elle offrait incessamment à Dieu toutes les forces de son corps et de son âme, afin qu’il voulût bien les faire servir à accomplir la pénitence qui ne pourrait pas être faite par d’autres. Et, pour obtenir cette grâce, non seulement elle multipliait ses pratiques de pénitence, mais elle s’efforçait aussi d’exciter les autres confirmants à se préparer avec ferveur au sacrement. Pendant cette préparation, elle sentit se renouveler fortement dans son âme le désir de vivre solitaire et cachée dans une terre étrangère et de s’y consacrer à la méditation et à la pénitence ; et comme, un jour, dans une conversation intime avec une amie, elle disait à ce propos qu’un véritable imitateur de Jésus-Christ doit tout quitter comme l’ont fait les saints, ces paroles firent sur cette amie une telle impression qu’elle se déclara prête à la suivre en quelque lieu qu’elle voulût aller pour imiter l’exemple des saints. Anne Catherine accepta cette offre avec joie et toutes deux se concertèrent pour s’enfuir loin de leur pays : mais il leur fallut bientôt reconnaître que leur projet n’était pas exécutable.
8. Voici ce que racontait Anne Catherine à propos de sa confirmation :
« J’allai avec les autres enfants de la paroisse à Coesfeld, où nous devions être confirmés. Je me tins devant la porte avec mes compagnes avant que nous parussions devant l’évêque. J’avais un sentiment très vif de la solennité qui s’accomplissait dans l’église et je vis ceux qui sortaient changés intérieurement à divers degrés. Je les vis aussi marqués d’un signe extérieur. Lorsque j’entrai dans l’église, je vis l’évêque tout lumineux. Il y avait autour de lui comme des troupes d’esprits célestes. L’onction resplendissait et la lumière brillait sur le front des confirmés. Lorsqu’il me fit l’onction, un trait de feu pénétra à travers mon front jusqu’à mon cœur, et je me sentis fortifiée. J’ai souvent revu plus tard l’évêque suffragant, mais je l’ai à peine reconnu. »
On peut juger de ce que furent les effets de ce sacrement pour Anne Catherine par sa déclaration faite plus tard qu’à dater de ce moment elle eut à supporter, pour expier des fautes commises par d’autres, des châtiments et des supplices qui lui étaient infligés par des voies surnaturelles et accompagnés d’apparitions. Souvent l’expiation s’accomplissait sur elle par des incidents qui paraissaient purement fortuits ; ainsi elle était jetée à terre, violemment heurtée, blessée, meurtrie, arrosée d’eau bouillante par suite de la maladresse d’autrui, ou bien saisie tout à coup d’une maladie inexplicable dont on se moquait comme d’une comédie ou d’une folie. Il lui fallait supporter tout cela avec une douceur et une patience sans bornes ; elle devait se taire et tout laisser tomber sur elle, lorsqu’en outre, comme il arrivait fréquemment, elle avait à subir la contradiction, le blâme, des paroles dures ou injurieuses et des accusations injustes. Étant d’un naturel irritable, bouillant, prompt à s’émouvoir violemment, elle avait alors à soutenir une lutte intérieure d’autant plus pénible qu’il lui fallait non seulement rester parfaitement maîtresse d’elle-même et pardonner du fond du cœur à la personne qui l’outrageait, mais en même temps prier Dieu de lui faire porter la peine qu’aurait méritée la personne coupable envers elle. Elle reçut dans le sacrement de confirmation l’onction et la force nécessaire pour en arriver là et nous verrons bientôt combien furent grands et rapides les progrès qu’elle fit dans cette voie.
9. Le caractère de l’expiation fut dès lors celui qui domina dans toutes les maladies et les souffrances corporelles qui assaillaient Anne Catherine sans relâche, et cela sous les formes les plus diverses, avec des variations continuelles et subites. Ces souffrances étaient dans une relation intime et une proportion connue de Dieu seul avec certaines offenses pour lesquelles elles devaient satisfaire. Plus Anne Catherine marchait fidèlement, dans son état de fiancée spirituelle, suivant la direction qui lui avait été donnée dans sa grande vision, plus elle devenait digne de remplir devant Dieu la place de la fiancée par excellence qui est l’Église, de représenter plus parfaitement le corps mystique de l’Église, jusqu’à ce qu’enfin cette représentation, par l’impression des stigmates de Jésus crucifié, arrivât à son plus haut degré ou comme à une complète assimilation.
Le corps d’Anne Catherine devint, devant Dieu, comme le corps de l’Église ; il put, en cette qualité, être exposé aux dangers, subir les persécutions, recevoir les blessures qui menaçaient l’Église dans son ensemble ou dans ses diverses parties, et les détourner par là de l’Église elle-même. De même qu’à l’âge de quatre ans, elle s’était mise devant la hache lancée sur un nourrisson endormi et l’avait préservé d’un danger mortel, ainsi maintenant elle était livrée aux souffrances et aux dangers qui menaçaient le chef de l’Église, ou de grands dignitaires ecclésiastiques, ou des personnages influents, dangers dont les conséquences auraient été funestes pour tout le corps, s’ils n’avaient pas été prévenus ou détournés. C’étaient aussi les maladies et les blessures spirituelles de l’Église qu’Anne Catherine subissait en son corps par d’indicibles souffrances, afin d’expier par les mérites de sa patience la faute de ces membres de l’Église qui, par leur infidélité, par l’oubli de leurs devoirs et surtout par leur incrédulité et leur immoralité, préparaient à l’Église de tels malheurs et auraient attiré les châtiments de la justice divine si une expiation ne lui eût pas été offerte.
10. Anne Catherine reçut dans le sacrement de confirmation les armes nécessaires pour accomplir cette immense tâche ; par ce sacrement, la plénitude de l’onction et de la vertu du Saint-Esprit descendit sur elle, et il lui arriva ce qui, suivant l’explication du catéchisme romain, s’accomplit dans les apôtres le jour de la Pentecôte, où « ils furent remplis d’une telle force de l’Esprit-Saint qu’ils pensaient que rien ne pouvait leur arriver de plus heureux que d’être jugés dignes de souffrir pour le nom de Jésus-Christ les outrages, les chaînes, le martyre et la mort de la croix ». Anne Catherine révéla un jour avec une touchante simplicité le secret de sa force dans les paroles suivantes, adressées au directeur de sa conscience :
« Depuis le jour de ma confirmation, mon cœur a eu cela de singulier qu’il n’a pu cesser un instant de demander pour moi le châtiment dû à tout péché qui m’était montré ou que je voyais moi-même. »
Quel merveilleux respect pour la sainteté et la justice de Dieu, quelle adoration du précieux sang comme prix de notre rédemption, quelle haine irréconciliable du péché et quelle pitié sans bornes pour les pécheurs devaient résider dans un cœur qui ne pouvait plus vivre que pour souffrir à la place d’autrui !
11. Ajoutons qu’Anne Catherine devint encore plus zélée qu’auparavant, quant aux pratiques volontaires de pénitence. Chaque journée s’écoulait dans un travail sans relâche mais les nuits étaient consacrées à la prière et, de plus, elle martyrisait son corps avec des disciplines, des ceintures de pénitence et des cordes. Elle s’y était accoutumée dès son enfance ; mais elle avait été obligée de le cacher autant que possible à son entourage. Maintenant encore, son humilité l’empêchait de révéler tout cela à son confesseur : toutefois celui-ci en eut connaissance par la maîtresse couturière et interrogea Anne Catherine à ce sujet. Elle avoua tout, non sans une grande confusion, et suivit ponctuellement depuis lors les avis qu’il lui donna pour modérer son ardeur. Elle lui déclara de nouveau qu’elle était appelée à l’état religieux ; et, quand elle lui témoigna la crainte où elle était de ne pouvoir être reçue nulle part, faute de dot, il la consola en lui rappelant la bonté et la toute-puissance de Dieu et lui promit de s’entremettre pour elle auprès des Augustines de Borken. Il tint parole, et bientôt il put porter à Anne Catherine l’agréable nouvelle qu’elle pouvait aller à Borken se présenter à la supérieure, laquelle, sur sa recommandation, était disposée à l’admettre. La supérieure la reçut avec bonté ; mais Anne Catherine fut tout à coup saisie d’une tristesse si vive que ses larmes lui permettaient à peine de parler. Sa douleur était causée par l’état spirituel de la communauté qui venait de lui être révélé et elle ressentit spécialement un profond chagrin de ce que le saint patron de l’ordre et sa règle étaient tellement tombés en oubli. La supérieure, fort surprise, l’ayant interrogée sur la cause de ces larmes inexplicables pour elle, Anne Catherine lui fit une réponse vraie, quoique évasive. « Je pleure, dit-elle, parce que je reconnais que j’ai trop peu de respect pour saint Augustin et que je ne suis pas digne de devenir Augustine. » On la congédia en l’engageant à réfléchir plus mûrement à son projet et à ne revenir qu’après y avoir longtemps pensé : mais elle ne put jamais s’y résoudre.
Voici ce que rapporte Overberg sur les mortifications qu’elle pratiquait à cette époque :
« Anne Catherine, avant d’entrer au couvent, s’est livrée à plus d’austérités que dans la suite, parce qu’alors elle ne savait pas encore qu’on ne doit rien faire en ce genre sans la permission de son confesseur. Les instruments de pénitence dont elle me parla, comme en passant, étaient des chaînes, des cordes qu’elle serrait autour de son corps et un rude vêtement de dessous qu’elle confectionnait elle-même avec l’étoffe la plus grossière qu’il lui fût possible de trouver. »
12. Parmi les pratiques de pénitence auxquelles elle se livrait alors, il faut placer aussi la visite des stations du chemin de la croix, placé sur les limites du territoire de Coesfeld. Quoiqu’elle ne s’arrêtât que quelques minutes devant chaque station, il lui fallait pourtant au moins deux heures pour parcourir, à travers des bosquets de sapins, le grand espace sur lequel les stations sont réparties. Son travail habituel commençait avec le jour et durait jusqu’à une heure avancée du soir, en sorte que, les jours ouvriers, elle n’avait que la nuit pour se livrer à cette pratique de dévotion. Aussi avait-elle coutume de se mettre en route un peu après minuit et, quand les portes de Coesfeld étaient fermées, il lui fallait en outre passer par-dessus les murs en partie écroulés de la ville. Avec la timidité qui lui était naturelle et que sa vie si réglée et si retirée avait encore augmentée, cette course nocturne était pour elle quelque chose de très rude et de très pénible : cependant elle n’y manqua jamais quand elle en était priée par des âmes en peine ou quand cela lui était ordonné dans ses visions. Aucune intempérie des saisons ne pouvait l’arrêter ; seulement elle se faisait quelquefois accompagner par une amie qui partageait ses sentiments.
« Une fois, raconta-t-elle, j’allai avec une amie faire le chemin de la croix à trois heures du matin. Il nous fallut, pour sortir, passer par-dessus le mur ruiné de la ville. Comme, à notre retour, nous priions devant l’église, je vis la croix avec toutes les offrandes en argent qui y étaient suspendues sortir de l’église et venir à nous. Je le vis clairement et distinctement ; ma compagne ne le vit pas, mais elle entendit comme le cliquetis des objets en argent pendus à la croix. Du reste, j’allais le plus souvent derrière le grand autel prier devant la croix miraculeuse qui s’y trouve, et il m’est souvent arrivé de voir le Sauveur crucifié s’incliner vers moi. Cela me faisait une étrange impression. »
13. Une autre fois Anne Catherine fit cette dévotion du chemin de la croix pour demander à Dieu la paix d’un ménage.
« La haine qui existait entre deux époux à Coesfeld, raconta-t-elle, me chagrinait beaucoup. Je priai pour ces pauvres gens et je fis le chemin de la croix, le vendredi saint, à neuf heures du soir, en partant du saint tombeau. Alors le mauvais esprit, sous une forme humaine, se jeta sur moi dans une rue étroite et voulut m’étrangler. Mais je criai vers Dieu de tout mon cœur et il s’enfuit. Depuis ce temps, le mari se conduisit mieux avec sa femme. »
Elle éprouva une opposition semblable de la part du démon dans d’autres circonstances du même genre. Voici ce qu’elle rapporta à ce sujet :
« J’éprouvais une grande pitié pour une jeune fille qui avait été séduite par un jeune homme et qui ne pouvait obtenir de lui qu’il ne l’abandonnât pas. J’étais dans une tristesse mortelle de ce qu’un si grand péché avait été commis, et je m’entendis avec deux compagnes pour faire, pendant la nuit du dimanche au lundi de Pâques, cinquante-deux fois le tour du cimetière de Coesfeld, en priant pour les âmes du purgatoire et en demandant à Dieu de venir en aide à la pauvre fille. Le temps était mauvais, la nuit était sombre, et nous marchions pieds nus. J’étais entre mes deux compagnes. Comme j’étais au plus fort de ma prière, l’esprit malin, sous la forme d’un jeune homme, se rua sur moi et me jeta de côté et d’autre, ce qu’il fit plusieurs fois. Je n’en mis que plus de ferveur dans ma prière, puisqu’elle était si odieuse à l’ennemi de tout bien. Mes compagnes tremblaient et pleuraient. Je ne sais pourtant pas si elles virent ce qui m’arrivait. Lorsque nous eûmes fini notre course, nous étions si épuisées par les efforts qu’il avait fallu faire que nous n’en pouvions plus. Comme nous revenions à la maison, la même apparition me jeta, la tête la première, dans une fosse de tanneur profonde de vingt pieds. Mes compagnes se mirent à crier et crurent que je m’étais cassé le cou ; mais je tombai tout doucement. Je leur criai : Me voici ! et aussitôt je me sentis enlevée en l’air et remise à ma place, sans savoir comment cela s’était fait ; nous poursuivîmes notre marche vers la maison, continuant nos prières, sans que rien vînt nous troubler. Le mardi de Pâques, la pauvre fille vint me trouver toute joyeuse et me dit que le jeune homme consentait à l’épouser. Il l’épousa en effet et tous deux vivent encore (1818).
« Un jour qu’avant l’aurore je traversais un champ pour aller prier avec une amie, Satan, sous la forme d’un chien de couleur foncée, aussi grand que moi, vint à notre rencontre sur un sentier où nous devions passer et voulut nous empêcher d’aller plus loin. Toutes les fois que je faisais le signe de la croix en face de lui, il se retirait à quelque distance sur le chemin, puis il s’arrêtait de nouveau. Ma compagne était tellement effrayée qu’elle m’embrassait toute tremblante et me retenait en arrière. Enfin, j’adressai la parole au malin et je m’avançai en lui disant : « Au nom de Jésus, nous voulons aller plus loin ! nous sommes envoyées par Dieu, ce que nous avons à faire est pour Dieu ! si tu étais de Dieu, tu ne chercherais pas à nous en empêcher. Va ton chemin, nous voulons aller le nôtre. » À ces paroles, le monstre disparut. Quand mon amie vit cela, elle se remit et me dit : « Ah ! pourquoi n’as-tu pas parlé ainsi tout de suite ? » Je lui répondis : « Tu as raison, mais je n’y ai pas pensé tout d’abord. » Nous continuâmes alors notre route sans être troublées.
« Un jour que j’avais prié avec beaucoup de ferveur devant le très saint sacrement, le malin se jeta si violemment près de moi, sur le banc où j’étais agenouillée, qu’il y eut un fort craquement. La frayeur que j’en eus me donna chaud et froid, cependant il ne put me troubler. Je repris ma prière avec plus d’ardeur et il se retira aussitôt. »
14. Durant trois années, Anne Catherine avait supporté avec une patience inébranlable son délaissement intérieur ; mais enfin son fiancé céleste la consola de nouveau par sa présence et, dès lors, il daigna la favoriser d’un commerce habituel et merveilleusement intime avec lui. Sans un tel secours, elle n’aurait pas pu remplir la terrible tâche de sa vie d’expiation. Mais combien les voies de Dieu sont mystérieuses ! Maintenant Anne Catherine vit dans une contemplation presque continuelle du divin Rédempteur ; elle est éclairée, fortifiée, consolée par lui, l’invisible chef de l’Église ; elle reçoit de lui constamment la promesse de son assistance, mais tous ses essais, toutes ses tentatives pour entrer dans un couvent échouent. Elle a travaillé sans se lasser pendant trois ans pour mettre de côté une somme qui puisse lui servir de dot, et elle se trouve aussi pauvre qu’auparavant. Son fiancé lui a envoyé tant d’indigents et lui a offert si souvent l’occasion de soulager les besoins de son prochain qu’elle n’a rien pu garder pour elle-même. Chose plus grave encore et qui semble lui ôter toute espérance, elle a des maladies continuelles. Des visions lui montrent à la vérité ce qu’elle a à souffrir et pourquoi elle souffre ; mais la connaissance de ces causes cachées est une faible consolation pour sa vie quotidienne et pour ses soucis, car les douleurs des maladies sont là, si réelles et si sensibles qu’elles consument toutes ses forces. Anne Catherine ne peut presque plus faire son travail accoutumé ; et, lorsqu’après la tentative manquée d’entrer chez les Augustines de Borken, elle demande à son confesseur de parler en sa faveur aux Trappistines de Darfeld, celui-ci lui déclare qu’il ne peut autoriser une personne faible et maladive comme elle l’est, à se faire admettre dans un ordre aussi sévère. En voyant le bouleversement involontaire que trahit son visage à cette déclaration, il la consola en lui promettant qu’il essaierait de la faire recevoir chez les Clarisses de Munster. On lui fit là une réponse favorable et Anne Catherine alla elle-même présenter sa requête. Mais on lui déclara que, le couvent étant très pauvre et elle-même n’ayant point de dot à apporter, elle ne pouvait être admise qu’à condition qu’elle apprendrait à jouer de l’orgue, afin de se rendre par là utile à la communauté. Elle s’y décida en effet, mais l’affaiblissement toujours croissant de sa santé lui rendit nécessaire auparavant un séjour dans la maison paternelle pour s’y rétablir.
15. Elle avait été accompagnée à Munster par une amie qui fit la déposition suivante devant l’autorité ecclésiastique, le 8 avril 1813 :
« Je m’appelle Gertrude Ahaus, du hameau de Hammern, paroisse de Billerbeck ; je connais Anne Catherine Emmerich depuis quatorze ans. Je l’ai d’abord connue à Coesfeld ; nous étions très intimes et, comme elle me communiqua son désir de devenir nonne, je l’accompagnai chez les Clarisses de Munster, parce que j’y avais deux parentes. Elle montrait une telle envie d’être au couvent que, lorsque je lui représentai que bientôt ces maisons seraient supprimées partout, elle me répondit que si elle pouvait entrer dans un couvent avec la certitude d’y être pendue huit jours après, il faudrait qu’elle y entrât. Et l’ordre le plus sévère était celui qu’elle aurait préféré. Je n’ai jamais rien vu à blâmer en elle, et comme je la trouvais parfaitement bonne et honnête, j’avais toute confiance en elle. Nos entretiens étaient toujours sur la religion, et elle m’y instruisait de beaucoup de choses touchant les devoirs du chrétien ; elle me racontait ordinairement quelque trait de la vie de saintes religieuses, comme les saintes Mathilde, Catherine, Gertrude, Claire, etc.
« Elle allait recevoir la sainte communion tous les dimanches et les jours de fête. Quand elle travaillait dans notre maison, le soir, elle faisait à genoux de longues prières. Elle m’a souvent dit qu’elle avait une dévotion particulière aux cinq plaies du Sauveur et aux trois plaies que Jésus-Christ avait eues sur l’épaule, parce que celles-ci l’avaient fait souffrir au delà de tout.
« Elle portait sur son corps, au lieu de chemise, une robe rouge. Les vendredis, elle jeûnait et ne mangeait qu’à midi, mais non le soir si elle pouvait le faire sans être remarquée. Elle allait souvent la nuit faire le chemin de la croix et passait toujours en prière les dimanches et jours de fête.
« Sa patience était extraordinaire ; quand j’avais quelque chose à souffrir, elle me consolait toujours en me parlant des souffrances du Christ. Et, comme les gens prétendaient qu’elle voulait se faire nonne par orgueil, elle disait qu’il lui était agréable qu’on parlât ainsi d’elle, parce que le Christ aussi avait souffert quoique innocent. Elle était très avenante, bienveillante pour tout le monde et très travailleuse ; quand elle était dans notre maison comme ouvrière, ou bien elle travaillait, ou bien elle avait avec moi des conversations qui faisaient du bien. Elle avait si bon cœur qu’elle donnait tout ; elle était très sincère dans ses discours ; avec d’autres personnes, elle parlait peu. »
16. Ici peuvent aussi trouver place les autres dépositions que les compagnes de jeunesse d’Anne Catherine firent, touchant l’époque qui vient d’être racontée, devant les supérieurs ecclésiastiques, lorsque ceux-ci, en l’an 1813, firent recueillir des renseignements détaillés sur sa vie : car ces simples et véridiques dépositions non seulement font parfaitement connaître la grande bénédiction qui se répandait sur tous ceux qui se trouvaient en contact avec Anne Catherine, mais, en outre, elles présentent un portrait très vivant de toute sa personne. Nous commençons par les dires de son frère aîné, dont la déposition est du 11 avril 1813 :
« Anne Catherine est ma sœur et je suis l’aîné des enfants qui vivent encore. Elle a habité quelques années hors de la maison, mais elle venait souvent nous voir et elle demeurait à peu de distance. Je m’entendais toujours bien avec elle ; cependant elle avait le caractère un peu vif et moi aussi ; mais cela passait tout de suite chez elle et elle cherchait avec beaucoup de soin à se corriger de ce défaut, si bien que, dans les derniers temps, il n’existait plus. Elle n’était pas vaine, mais elle aimait à s’habiller convenablement et décemment. Elle se tenait à l’écart des sociétés et des divertissements. Envers nos parents, elle était bonne et prévenante.
« Elle parlait peu de choses mondaines, mais cherchait ordinairement à donner aux autres des enseignements concernant la foi et les bonnes mœurs ; elle nous rapportait des prédications qu’elle avait entendues ou des histoires de saints et cherchait par ses discours à nous faire aimer le bien. Elle avait très bon cœur envers tout le monde, si bien qu’elle donnait tout ce qu’elle gagnait. Elle ne souffrait pas qu’on parlât des fautes du prochain et nous donnait souvent à ce sujet de bons avertissements. Quand d’autres personnes la blâmaient, elle disait que c’était bien fait. Et, lorsque nous lui demandions comment elle pouvait rester si calme et si bienveillante en face de telles injures, elle répondait : « Cela doit être ainsi, et, si vous le vouliez, vous feriez de même, vous aussi. » Elle consacrait beaucoup de temps à la prière. Souvent, quand nous étions allés nous coucher depuis longtemps, elle était encore debout, lisait des livres et priait à genoux, les bras étendus. Elle priait aussi pendant son travail.
« Elle jeûnait très souvent et, quand nous l’engagions à s’en abstenir, à cause de la faiblesse de sa santé, elle répondait qu’elle le pouvait parfaitement. Elle le faisait particulièrement les jours consacrés à la Passion de Jésus-Christ. Elle se mortifiait, en outre, de bien d’autres manières et portait, au lieu de chemise, une robe d’étoffe grossière. Elle mettait sur son lit des morceaux de bois sur lesquels elle se couchait ; elle y mettait aussi des orties au milieu desquelles elle dormait. »
17. Le 7 avril 1813, Clara Soentgen déposa en ces termes :
« Anne Catherine, étant à l’école, se distinguait déjà tellement parmi les autres enfants que le maître disait souvent à ses parents qu’il ne pouvait pas lui faire une question à laquelle elle ne sût pas répondre. Elle n’a été régulièrement à l’école que quatre mois ; elle a appris le reste dans ses heures de loisir et en gardant le bétail. Quand les autres enfants jouaient, elle s’asseyait dans un coin avec un livre.
« Quand elle est devenue plus grande, il lui a fallu prendre part aux travaux les plus pénibles. Même lorsqu’elle était bien fatiguée, il lui arrivait, en outre, quand ses parents et tout le monde étaient au lit, de se glisser en secret dans la salle commune et d’y passer plus de la moitié de la nuit à lire des livres de piété. Souvent ses parents se levaient et lui ordonnaient d’aller se coucher. Quand elle est devenue couturière, dans les maisons où elle a travaillé, elle a donné aux gens des instructions de toute espèce et leur a raconté ce qu’elle avait lu de beau.
« Beaucoup de gens, principalement parmi les jeunes filles et les jeunes garçons de la campagne, venaient la trouver, lui confiaient l’état de leur conscience et lui demandaient ce qu’ils avaient à faire. Les dimanches, dans l’après-midi, elle engageait les jeunes gens, surtout quand elle savait qu’ils s’écartaient un peu du bon chemin, à faire avec elle le chemin de la croix où elle priait à haute voix. Souvent elle se levait la nuit, se glissait hors de la maison et faisait, pieds nus, le chemin de la croix. Quand la porte de la ville était fermée, elle grimpait par-dessus des murs très hauts pour aller faire son chemin de la croix. Il lui est arrivé quelquefois de tomber du haut des murs, mais elle ne s’est jamais fait de mal.
« Sa plus grande joie était quand venait le dimanche qui était le jour où elle pouvait se confesser et communier. Quand plusieurs fêtes se suivaient, son confesseur lui permettait de recevoir la sainte communion chacun de ces jours. Les trois derniers jours de la semaine sainte, elle ne mangeait absolument rien jusqu’au dîner du jour de Pâques. Elle ne trouvait jamais au-dessus de ses forces de faire, les jours où elle jeûnait, les travaux les plus fatigants. »
18. Anne Gertrude Schwering, de la paroisse Saint-Lambert, hors Coesfeld, a ainsi déposé, le 16 avril 1813, sur la réquisition de l’autorité ecclésiastique :
« Je connais Anne Catherine Emmerich depuis environ quinze ans ; je l’ai beaucoup fréquentée et j’ai même eu avec elle des rapports d’amitié, parce que je remarquais en elle beaucoup de bonté et de vertu. Elle était très pieuse ; ses entretiens roulaient toujours sur la sainte Écriture, sur la vie des saints et sur les vérités de la foi. Elle ne parlait jamais des défauts d’autrui et extrêmement peu des choses de ce monde. Elle était très assidue au travail. Le soir, elle priait à genoux. Elle était indulgente envers les autres et ne murmurait jamais ; elle était généreuse autant qu’elle pouvait l’être avec le peu qu’elle avait. Je n’ai jamais rien trouvé de blâmable en elle. »
19. Marie Feldmann, de la paroisse Saint-Jacques, hors Coesfeld, déposa ainsi le 11 avril 1813 :
« À l’âge de quatorze ans, je vins près d’Anne Catherine comme écolière, c’est-à-dire pour apprendre à coudre. Nous vivions ensemble très intimement, autant que le permettait la différence d’âge. Je fus près d’elle plus de deux ans et j’avais une très grande inclination pour elle, parce qu’elle avait beaucoup de piété et qu’elle m’instruisait avec la plus grande douceur, malgré ma lenteur à comprendre.
« Je connaissais sa piété par les nombreuses prières qu’elle faisait le soir, le matin et dans la journée, et par sa manière de vivre paisible et retirée. Ordinairement, le matin, elle était déjà levée et en prière quand je m’éveillais ; le soir, quand je dormais déjà, elle était encore en prière, la plupart du temps à genoux et les bras étendus. Je voyais souvent sur son lit des morceaux de bois placés en forme de croix, sur lesquels elle s’était couchée. Elle parlait habituellement des offices de l’Église et m’instruisait dans la foi et les bonnes mœurs. Elle ne parlait jamais du prochain et m’enseignait toujours qu’il ne fallait pas dire de mal des autres et même que nous devions faire du bien à ceux qui nous avaient fait du mal. Elle donnait tout aux pauvres, à tel point qu’elle-même n’avait plus rien et s’était dépouillée de tout ; elle avait rarement de l’argent, parce qu’elle donnait ce qu’elle gagnait aussitôt qu’elle l’avait reçu. Elle fuyait aussi les assemblées et allait avec moi seulement quand nous travaillions dans d’autres maisons. »
X
ANNE CATHERINE ESSAIE, EN APPRENANT À JOUER DE L’ORGUE, DE SE FAIRE ADMETTRE DANS UN COUVENT. SON SÉJOUR DE TROIS ANS CHEZ LE CHANTRE SOENTGEN, À COESFELD.
1. Lorsqu’Anne Catherine eut recouvré dans la maison paternelle les forces suffisantes pour pouvoir se livrer à un travail suivi, elle ne recula devant aucun effort, afin de gagner, comme couturière, de quoi faire les premiers frais qu’exigerait son projet d’apprendre à jouer de l’orgue. Ses doigts ne quittaient pas un moment l’aiguille durant le jour ; puis, à l’entrée de la nuit, elle prenait la quenouille, afin de pouvoir apporter, comme dot, dans un couvent, au moins quelques pièces de toile. Son travail fut tellement béni de Dieu que, dans le cours d’une année, elle put mettre de côté plus de vingt écus, comme salaire de ses travaux à l’aiguille, et une provision assez notable de belle toile. Ces vingt écus lui paraissaient une si forte somme qu’elle n’aurait jamais osé les garder pour elle, si une autre voie lui eût été ouverte pour entrer en religion.
Pendant tout le temps qu’elle passa avec ses parents, ceux-ci renouvelèrent leurs tentatives pour la détourner de la pensée du couvent et sa mère lui représenta très souvent avec émotion qu’étant aussi faible qu’elle l’était et presque toujours maladive, elle ne pouvait espérer de s’acquitter des nombreux et pénibles travaux qu’on lui imposerait dans un couvent à cause de sa pauvreté !
« Ma chère mère, répondait-elle alors, quand même les choses iraient aussi mal que possible et quand je devrais faire les travaux les plus pénibles et les plus répugnants, je n’en aurais pas moins l’avantage d’échapper aux dangers et aux inquiétudes du monde. »
Mais sa bonne mère ne comprenait pas cette raison, car elle avait toujours vu son enfant tellement étrangère au monde qu’elle ne croyait pas possible une séparation plus grande encore. Elle ne cessait donc pas de lui adresser des prières et des représentations toujours plus pressantes ; mais Anne Catherine savait répondre avec tant de douceur et de tendresse que sa mère ne pouvait se fâcher, et que celle-ci ne fit aucune opposition sérieuse lorsque sa fille alla s’établir dans la maison de l’organiste Soentgen, à Coesfeld, pour y apprendre de lui à jouer de l’orgue.
2. Un témoin très important, que nous retrouverons souvent plus tard, le docteur Wesener, de Dulmen, rapporte à ce sujet :
« J’ai traité la vieille mère d’Anne Catherine dans sa dernière maladie. Elle m’a souvent raconté en versant des larmes qu’elle avait aperçu dans sa fille, dès son plus jeune âge, quelque chose d’extraordinaire et qu’elle l’avait beaucoup aimée. Mais il lui avait été très pénible qu’Anne Catherine qui, comme l’aînée de ses filles, aurait dû être son unique appui dans sa vieillesse, voulût absolument entrer au couvent. « C’est, assurait la mère, le seul chagrin qu’elle m’ait jamais donné. Je n’ai pas été aussi heureuse avec mes autres enfants. Dès sa dix-huitième année, elle fut demandée en mariage par un jeune homme, fils de parents aisés, et ceux-ci désiraient beaucoup qu’Anne Catherine y consentit, parce qu’ils savaient combien elle était bonne et que, malgré sa faiblesse corporelle elle faisait promptement et à merveille toute espèce de travaux. Mais je ne pouvais pas encore me séparer d’elle, à cause de la mauvaise santé de son père, et parce que deux autres de mes enfants me donnaient beaucoup de soucis ; je ne l’engageai point alors à accueillir cette demande en mariage. Lorsque quelques années plus tard, il s’offrit un autre parti encore plus avantageux, son père et moi nous la pressâmes fort d’accepter, parce que ce mariage nous semblait devoir être très profitable. Mais elle nous pria si instamment de l’en dispenser, qu’il nous fallut céder et lui laisser sa liberté : seulement nous lui dîmes que, si elle entrait au couvent, nous ne voulions pas en faire la dépense. Elle avait mis de côté quelques pièces de toile et croyait pouvoir avec cela couvrir les frais de son entrée dans un pauvre couvent qui vivait d’aumônes ; mais elle fut refusée partout, parce qu’on la regardait comme trop faible de santé. Là-dessus elle se mit en condition chez l’organiste Soentgen, de Coesfeld, pour apprendre de lui à jouer de l’orgue, ce qui devait, pensait-elle, lui ouvrir la porte d’un couvent. Mais elle s’aperçut bientôt qu’elle était bien mal tombée, car, dans la maison de l’organiste, il y avait une telle pauvreté et une telle détresse qu’il lui fallut sacrifier tout ce qu’elle possédait pour les aider. Elle donna ainsi toute sa toile. Il y avait sept à huit pièces qui pouvaient bien valoir quatre-vingts écus. Quand elle eut passé un certain temps dans cette maison, la fille de l’organiste, Clara, prit aussi du goût pour la vie de couvent. »
Mais écoutons Anne Catherine elle-même :
« Quant à jouer de l’orgue, déposa-t-elle devant Overberg, il n’en fut pas question ; je fus la servante du logis. Je n’appris pas l’orgue, car, à peine entrée dans la maison, je n’y vis que misère et détresse et je cherchai à y venir en aide. Je fis alors l’office de servante, je m’occupai du ménage, je fis toute la besogne et je dépensai tout ce que j’avais. Je n’en vins jamais à jouer de l’orgue. »
Et pourtant elle y serait parvenue avec la plus grande facilité, elle chez qui le sens de l’ouïe était si délicat, qui, dès son enfance, avait un si profond sentiment de l’harmonie musicale et qui avait dans les doigts une adresse pour laquelle il semblait qu’il n’y eût pas de difficultés. Il lui arrivait parfois de dire :
« Quand j’entendais l’orgue ou le chant, rien ne me touchait autant que l’accord des différents tons. Quelle belle chose, me disais-je alors, lorsqu’il y a harmonie parfaite ! Quand des choses inanimées forment ensemble de si charmants accords, pourquoi nos cœurs n’en font-ils point autant ? ah ! combien ce serait beau et aimable ! »
3. Mais Dieu voulait amener sa fidèle servante à une harmonie d’un ordre plus élevé que celle qui règne dans la sphère musicale, c’est-à-dire à la plus parfaite conformité avec sa très sainte volonté ; c’est pourquoi elle avait maintenant à marcher par de tout autres voies que celles qui auraient semblé répondre à l’ardent désir de son cœur. Sa tentative si bien et si soigneusement préparée d’arriver au but par l’étude de l’orgue échoua avant même d’avoir reçu un commencement d’exécution, car il régnait une si affreuse pauvreté dans la maison de l’organiste qu’Anne Catherine, sans hésiter, donna toutes ses épargnes à la famille et n’employa son temps et ses forces qu’à l’aider dans la douloureuse tache de se procurer le pain de chaque jour.
« Comme j’appris là ce que c’est que la faim ! raconta-t-elle une fois. On restait souvent huit jours sans voir un morceau de pain ! Les pauvres gens ne trouvaient pas crédit pour six deniers. Je n’appris rien du tout. J’étais la servante. Tout ce que j’avais gagné par mes travaux de couture s’en alla et j’en étais presque à mourir de faim. Je donnai ma dernière chemise. Ma bonne mère fut touchée de compassion : elle m’apporta des œufs, du beurre, du pain et du lait, et cela les fit vivre. Un jour, elle me dit : « Tu m’as donné un grand chagrin, mais tu es toujours mon enfant. Quand je vois la place où tu t’asseyais, mon cœur se brise ! mais tu es toujours mon enfant. » Je lui répondis : « Dieu vous le rende, chère mère ! Pour moi, je n’ai plus rien, mais ç’a été la volonté de Dieu de soutenir par moi ces pauvres gens. Maintenant Dieu pourvoira. Je lui ai tout donné et il saura bien comment nous assister tous. » Et la bonne mère aussi ne se plaignit plus. »
Même dans l’ordre le plus sévère, Anne Catherine n’aurait pas pu pratiquer la pauvreté d’une manière aussi pénible que dans la maison de Soentgen : car, plus elle se dépouillait pour soulager les besoins d’autrui, plus elle s’éloignait de son but et plus son désir d’y arriver allait croissant et la faisait souffrir. Elle dépensait ses épargnes, elle servait sans gages, elle était dans le dénuement le plus complet et cela ne la menait à rien, car il n’était pas question de jouer de l’orgue : cependant sa confiance restait inébranlable.
« Je me disais souvent : « Comment ferai-je maintenant pour entrer dans un couvent ? Je ne possède plus rien, et tout est contre moi. » Je disais souvent à Dieu : « Je ne sais que faire pour m’aider. C’est vous qui avez arrangé tout cela. C’est donc vous qui devez me tirer de là. »
Alors il lui fat montré en vision quel riche accroissement avait reçu sa parure de fiancée par suite de toutes ces peines et de tous ces efforts qui semblaient avoir échoué. Elle vit les fruits de ses victoires sur elle-même, de sa patience et de son dévouement, comme des vêtements dont la beauté était infiniment variée : elle vit comment chaque jour le trésor nuptial s’enrichissait de précieux ornements par le renoncement et les œuvres de charité qu’elle pratiquait : et il lui fallut reconnaître que ses larmes et ses prières, ses luttes et ses privations rendaient des sons plus agréables à Dieu que les accords les plus savants de l’orgue. Puis, convenait-il à la dignité de son fiancé qu’elle arrivât à l’union nuptiale à l’aide de moyens qui, par eux-mêmes, n’étaient pas faits pour conduire à lui ? Dans les couvents de cette époque, on ne faisait plus attention aux signes de vocation surnaturelle ; c’étaient les avantages selon le monde, les qualités extérieures, les considérations personnelles qui décidaient de tout, d’où il résultait qu’on rencontrait rarement de véritables religieuses. Mais Anne Catherine, qui avait à expier ce mépris pour le fiancé céleste, devait se frayer de la manière la plus pénible et la plus humble l’accès d’une communauté religieuse, parce que Dieu voulait recevoir par là une réparation pour l’injurieux dédain avec lequel étaient traitées ses grâces de vocation.
3 bis. Le chantre Soentgen fut profondément touché de la charité désintéressée et du dévouement d’Anne Catherine et, par reconnaissance, il lui promit de faire tout son possible pour l’aider à entrer dans un couvent. Il avait une fille du même âge qui, étant organiste habile, ne pouvait manquer d’être bien accueillie partout ; il résolut donc de ne l’accorder à un couvent qu’à condition qu’on prendrait Anne Catherine avec elle. Il fut aussi poussé à cette résolution par sa sollicitude pour sa fille : car il avait coutume de s’exprimer ainsi devant Anne Catherine : « Ma Clara ne doit pas entrer au couvent sans toi. Les couvents n’ont plus aujourd’hui leur stricte discipline d’autrefois : mais si tu es avec Clara, tu la maintiendras dans la bonne voie. »
Les deux jeunes filles frappèrent donc à la porte de plusieurs maisons religieuses, demandant à y être admises, mais presque toujours inutilement. Les unes trouvaient que la dot se réduisait à trop peu de chose, les autres ne voulaient prendre que Clara. Ainsi firent les Augustines de Dolmen qui avaient besoin d’une organiste. Mais le chantre Soentgen tint bon, et, comme il ne voulait pas laisser entrer sa fille sans Anne Catherine, elles se résignèrent, bien à contrecœur, à accepter aussi celle-ci.
4. Le 7 avril 1813, Clara Soentgen fit la déposition suivante, à la requête du vicaire général Clément Auguste de Droste :
« Anne Catherine a demeuré avec nous près de trois ans. Je remarquais qu’aux repas elle prenait toujours ce qu’il y avait de plus mauvais. Nous couchions dans une chambre où deux petits enfants couchaient aussi dans un autre compartiment. Je remarquai qu’au lieu de chemise elle portait une robe de laine grossière et, là-dessous, une rude ceinture, fortement tordue et garnie de plusieurs nœuds ; elle la serrait tellement autour de son corps que la peau se gonflait souvent jusqu’à passer par dessus. Son confesseur le sut et lui défendit de la porter. Elle dit plus tard qu’après qu’elle eut quitté cette ceinture par obéissance, il lui était resté autour du corps quelque chose comme un ruban rouge qui s’était imprimé de lui-même sur la peau. Souvent elle sortait seule le soir et, à son retour, je m’apercevais qu’elle avait toute la peau du corps déchirée comme avec des clous.
« Avant de se mettre au lit, elle allait prier seule, le plus ordinairement dans le jardin. Quand elle revenait, je remarquais que sa peau était gonflée et couverte d’ampoules, et elle était obligée de m’avouer qu’elle s’était frottée avec des orties. Elle disait que souvent une grosse bête noire était venue à elle, faisant mine de vouloir la chasser ; mais, comme elle ne se laissait effrayer par cet animal, il passait sa tête par-dessus ses épaules et la regardait en face avec des yeux terribles ; après quoi il disparaissait. Un animal semblable s’est mis aussi une fois devant elle comme elle allait chez ses parents de grand matin, après avoir reçu la sainte communion. »
À propos de cet incident et de quelques autres du même genre, voici ce que raconta un jour Anne Catherine elle-même :
« Suivant l’habitude que j’avais prise dès mon enfance, je continuai chez Soentgen à aller prier la nuit en plein air. Il m’y arriva, comme du reste bien d’autres fois dans ma vie, que Satan chercha à me chasser par des bruits effrayants. Mais, comme je ne m’appliquai qu’avec plus d’ardeur à prier, il vint derrière moi sous la forme d’une affreuse bête, semblable à un énorme chien, et mit sa tête sur mon épaule. Je tins bon, avec la grâce de Dieu ; je ne quittai pas ma place et je lui dis : « Dieu est plus puissant que toi. Je suis à lui ; je suis ici pour lui. Tu ne peux rien me faire. » Alors je n’eus plus aucune peur et l’ennemi fut obligé de me laisser. Souvent aussi le malin esprit me saisissait par le bras et me tirait comme s’il eût voulu m’arracher de mon lit. Je lui tenais tête alors avec la sainte croix et avec la prière. Dans une maladie, il m’attaqua d’une manière terrible, et il fallut me défendre contre lui. Il était furieux et semblait vouloir m’étrangler et me mettre en pièces. Il ouvrit contre moi sa gueule enflammée : je fis le saint signe de la croix et lui présentai hardiment la main en lui disant : « Mords-la ! » mais il disparut.
« Un soir que je priais avec Clara pour les âmes souffrantes, je lui dis : « Récitons encore quelques Pater pour ta mère défunte, dans le cas où elle en aurait encore besoin. » Je priais de tout mon cœur avec elle et, après chaque Pater, je répétais : « Encore un, encore un ! » Comme nous étions ainsi à prier, la porte de la chambre s’ouvrit et je vis entrer une grande lumière. Plusieurs coups furent frappés sur la table qui était devant nous ; nous eûmes peur toutes deux, surtout Clara. Plus tard, lorsque son père revint à la maison, nous lui racontâmes la chose : il fut très ému et pleura beaucoup. »
« Souvent, continue Clara dans sa relation, quand nous avions fini nos prières – jamais avant – l’oreiller était pressé sur notre visage comme si on eût voulu nous étouffer et il semblait que quelqu’un donnât de violents coups de poing sur l’oreiller d’Anne Catherine. Parfois impatientée de ce que nous ne pouvions pas avoir de repos, elle portait la main à l’oreiller, mais elle ne sentait rien : à peine se tenait-elle de nouveau tranquille que la chose recommençait de la même manière. Cela durait souvent jusqu’à minuit. Anne Catherine se levait aussi quelquefois et courait jusque dans le jardin pour voir d’où cela pouvait venir, mais elle ne voyait rien. Cela ne lui est pas arrivé seulement dans notre maison, mais aussi avant qu’elle y fût, et plus tard encore dans le couvent où il me fallut, dans les commencements, habiter avec elle dans une même cellule.
« Souvent, le soir, quand nous étions au lit, nous priions ensemble pour les âmes du purgatoire. Il arriva une fois, comme nous venions de finir notre prière, qu’une gloire lumineuse plana devant notre lit. Anne Catherine me dit avec une joie extrême : « Vois ! quelle brillante lumière ! » Je fus effrayée et je ne regardai pas. »
5. Le révérend père Jacques Reckers, professeur à l’école latine de Coesfeld, déposa aussi, comme confesseur d’Anne Catherine :
« J’ai été, dit-il, pendant environ neuf mois, le confesseur d’Anne Catherine Emmerich, immédiatement avant son entrée au couvent. Hors du tribunal de la pénitence, elle venait quelquefois me demander conseil et assistance pour arriver à entrer dans un couvent. Ce qui me semblait la caractériser plus particulièrement était la simplicité, la bonté de cœur et la droiture. Je ne trouve rien à dire d’elle qui puisse lui être défavorable, si ce n’est que, pour satisfaire à ses penchants charitables, il lui est arrivé quelquefois d’acheter ce qu’elle ne pouvait pas payer tout de suite. Je dois dire à sa louange qu’elle assistait tous les matins à la sainte messe autant que cela lui était possible, qu’elle se confessait et communiait ordinairement tous les dimanches et jours de fête, que, dans la ville, on la considérait généralement comme une très bonne et très pieuse personne, enfin que, dans plusieurs occasions où son espérance et son désir d’être admise dans un couvent parurent déçus, elle a toujours montré une résignation édifiante à la volonté du Seigneur.
XI
ANNE CATHERINE REÇOIT DE DIEU LES DOULEURS DE LA COURONNE D’ÉPINES. – SON ENTRÉE AU COUVENT DES AUGUSTINES DE DULMEN.
1. Lorsqu’Anne Catherine eut complété l’achèvement de son trésor nuptial par les pratiques de la pauvreté la plus humble et de l’abnégation la plus parfaite, le fiancé divin y ajouta lui-même un dernier et plus précieux joyau dont elle devait se montrer parée le jour des noces. Ce n’était rien moins que la couronne que lui-même avait daigné porter sur la terre. Pendant la dernière année de son séjour dans la maison Soentgen, il arriva qu’un jour, vers midi, elle était en contemplation devant un crucifix placé dans la tribune de l’orgue de l’église des Jésuites, à Coesfeld. Clara Soentgen se trouvait avec elle dans l’église. Anne Catherine vit son fiancé céleste sortir du tabernacle sous la forme d’un jeune homme resplendissant. Il tenait de la main gauche une guirlande de fleurs ; de la main droite, une couronne d’épines. Il les lui présenta pour qu’elle choisît. Anne Catherine prit la couronne qu’il lui posa sur la tête et qu’elle-même y enfonça plus fort avec ses deux mains. Elle ressentit des douleurs inexprimables qui depuis lors ne la quittèrent plus. L’apparition s’évanouit et, quand Anne Catherine sortit de sa vision, elle entendit le cliquetis des clefs avec lesquelles le sacristain de l’église allait la fermer. Elle revint à la maison avec sa compagne qui n’avait aucune idée de ce qui était arrivé : souffrant à l’excès au front et aux tempes de douleurs inexplicables pour elle, elle demanda à son amie si elle ne voyait rien à sa tête et celle-ci répondit que non. Mais, le jour d’après, la tête s’enfla beaucoup au-dessus des yeux et depuis les tempes jusqu’aux joues : cependant il n’y eut pas encore d’effusion de sang. Elles ne commencèrent que dans le couvent où Anne Catherine s’appliqua soigneusement à les cacher à ses compagnes.
2. De même que sainte Thérèse voyait sur elle, à l’état naturel de veille, les bijoux, l’anneau et la ceinture dont elle avait été parée en vision, de même aussi, les jours consacrés à la passion du Sauveur, la couronne d’épines était visiblement présente pour Anne Catherine. Elle la décrivait comme composée de trois différentes tresses d’épines. L’une des tresses provenait d’un arbuste épineux où elle voyait des fleurs blanches avec des étamines jaunes ; la seconde d’un arbuste qui avait des fleurs semblables, mais des feuilles plus larges ; la troisième lui paraissait comme d’églantier sauvage. Souvent, dans l’ardeur de la prière, elle pressait fortement cette couronne contre sa tête, et, chaque fois, elle sentait les épines s’enfoncer plus profondément. Lorsque, dans le couvent, les plaies commencèrent à saigner, et quelquefois, traversant les bandeaux, y laissèrent voir des points rouges, plusieurs des religieuses prirent cela pour des taches de rouille du linge et ne cherchèrent pas à se l’expliquer autrement ; seulement une des sœurs surprit une fois Anne Catherine comme elle essuyait le sang qui coulait de ses tempes ; mais elle lui promit le secret.
3. Enfin le moment approchait où Anne Catherine devait atteindre le but si longtemps désiré ; et cela, dans des circonstances qui étaient devant Dieu le terme le plus convenable de sa longue et laborieuse voie de souffrance et le sceau de la fidélité avec laquelle la fiancée avait attendu son fiancé. Quelques jours avant qu’Anne Catherine dît adieu au monde, pour se rendre avec Clara Soentgen au couvent des Augustines de Dulmen, elle alla une dernière fois à Flamske, dans la maison paternelle, afin de prendre congé de ses parents affligés. Elle les remercia avec l’émotion la plus profonde de toute la tendresse qu’ils lui avaient témoignée et leur demanda pardon du fond du cœur, ainsi qu’à ses frères et sœurs, de ce qu’elle ne pouvait pas condescendre à leurs désirs, ni se rendre infidèle à l’appel de Dieu qui la voulait dans l’état religieux. Sa mère ne lui répondit que par des larmes, mais son père, ordinairement si bon, se laissa tellement dominer par l’amère douleur d’une séparation désormais irrévocable que, lorsqu’elle lui demanda humblement quelque argent pour son voyage, il lui répondit :
« Si tu veux te faire enterrer demain, je paierai volontiers les frais de l’enterrement, mais pour aller au couvent, je ne te donnerai rien. »
Versant des larmes abondantes et pourtant pleine de joie au fond de l’âme, pauvre et dépouillée de tout pour pouvoir voler à la rencontre de son fiancé, elle quitta Flamske, voulant le jour d’après se faire conduire avec Clara à Dulmen, qui n’est éloigné de Coesfeld que de quelques lieues. Mais à la dernière heure, il surgit tout à coup un nouvel obstacle. L’organiste Soentgen n’avait pu obtenir la promesse d’un prêt de dix écus que sous la condition qu’Anne Catherine s’engagerait pour lui. Il lui exposa son embarras et ne cessa de la supplier jusqu’à ce que, dans la confiance que Dieu lui viendrait en aide, elle eût donné sa signature. Elle n’avait pas le moindre argent et ne possédait que le strict nécessaire en fait de vêtements. Ceux-ci, avec une maigre fourniture de lit, se trouvaient dans un coffre de bois où sa mère avait mis en secret une pièce de toile pour ne pas laisser son enfant bien-aimée se séparer d’elle sans avoir rien reçu. Lorsqu’Anne Catherine découvrit la pièce de toile, elle n’osa pas la garder pour elle, mais la donna à Clara Soentgen, pour la remercier de ce qu’elle lui avait fait obtenir son admission. Elle reçut pour cela un riche dédommagement ; car le mystérieux livre prophétique lui fut remis pour qu’elle le portât avec elle au couvent de Dulmen.
Depuis la fondation de ce couvent, jamais il n’était entré dans ses murs une vierge aussi pauvre des biens de la terre, aussi riche en biens spirituels. D’une voix suppliante, elle pria la révérende mère de la recevoir pour l’amour de Dieu, comme la dernière de la maison, qui voulait se soumettre avec joie à tout travail et à tout emploi que l’obéissance lui imposerait ; mais elle ne réussit pas à apaiser le mécontentement général soulevé contre une personne qui, réduite à un dénuement inouï et affligée d’une si mauvaise santé, avait la hardiesse d’imposer de nouvelles charges au pauvre couvent.
4. Le couvent des religieuses Augustines de Dulmen, fondé dans la seconde moitié du XVe siècle 5, avait recru ses premières religieuses du couvent de Marienthal à Munster. Il resta jusqu’à sa suppression sous la direction spirituelle des chanoines Augustins de Frenswegen, et en dernier lieu de ceux de Thalheim, près de Paderborn. Il s’était toujours trouvé dans une situation très gênée ; pendant la guerre de Sept-Ans, il était tombé dans une extrême détresse et la communauté n’avait pu être préservée de sa dissolution que par les charités des habitants de Dulmen. La situation ne devint guère plus favorable dans la suite, et le couvent ne se trouva plus jamais en état de pourvoir à tous les besoins de ses habitants non plus que de restaurer parfaitement la vie commune. Les diverses religieuses, chacune de son côté, devaient s’entretenir en partie à l’aide de la dot qu’elles avaient apportée ou de ce qu’elles gagnaient par leur travail ; en sorte que celles d’entre elles qui ne pouvaient recourir qu’aux ressources du couvent ou à la charité des étrangers avaient souvent à supporter de cruelles privations.
Sous le rapport spirituel, le couvent d’Agnetenberg, lors de l’entrée d’Anne Catherine, se trouvait dans le même état que la plupart des pauvres couvents de femmes de ce temps au pays de Munster. L’observation ponctuelle de la règle n’existait plus ; bien plus, la règle elle-même était tombée dans l’oubli. La porte du cloître, autrefois si rigoureusement fermée, était ouverte indistinctement à tous les visiteurs, et on n’y trouvait plus guère le silence et la paix d’une maison religieuse. Les sœurs vivaient plutôt comme des commensaux qui, s’étant trouvés ensemble par hasard, se seraient arrangés de leur mieux pour le reste de leur vie, que comme les membres d’une famille religieuse, étroitement liés par une règle et par des vœux, et obligés à une vie de perfection. La coutume et la nécessité maintenaient encore à la vérité un certain ordre et des mœurs régulières : mais c’était l’habit seul, et non pas un plus haut degré de piété, qui distinguait les religieuses des chrétiens ordinaires vivant dans le monde. Maintenant, Anne Catherine est placée par Dieu au milieu de tout ce relâchement pour y atteindre à la plus haute perfection de la vie religieuse. Ce que les circonstances ont de défavorable ne doit pas plus y faire obstacle pour elle que l’insuccès de ses nombreuses tentatives ne l’a empêchée d’entrer au couvent. Sa tâche, comme instrument d’expiation des fautes d’autrui, a cela de particulier que tout ce qui serait pour d’autres une occasion de chute et de perdition, doit devenir pour elle un moyen de se montrer d’autant plus fidèle envers Dieu. La décadence de la discipline claustrale et de la régularité, le relâchement de tous les liens de l’obéissance, la transgression de la règle passée en coutume, l’absence de direction éclairée pour les âmes, en un mot, toutes les misères des familles religieuses de cette époque, misères qui ont attiré la terrible sentence de la suppression générale des monastères, deviennent pour Anne Catherine autant de voies pour arriver à la perfection, car tout cela ne fera que l’exciter à servir Dieu avec un zèle toujours croissant.
5. Elle arrive maintenant à une nouvelle section de son livre prophétique, et la vision des fiançailles, qui l’a accompagnée depuis sa seizième année et d’après les instructions de laquelle elle a travaillé à se faire une dot spirituelle, prend un nouveau caractère. Elle se voit maintenant dans la maison du fiancé, ou, comme elle avait coutume de la nommer, dans la maison des noces spirituelles ; c’est là aussi que son trésor nuptial est transporté. Elle s’est déterminée à entrer dans les murs du couvent avec une bourse vide et un coffre vide, et ce dépouillement si agréable à Dieu, a attiré sur elle le mécontentement et le mépris de personnes consacrées à Dieu ; c’est là ce qui lui a ouvert les portes de la maison nuptiale, et aussi ce qui lui a montré clairement à quoi elle devait s’attendre dans le couvent. Elle habite non plus seulement dans les tableaux symboliques de la vision qui lui sert de guide, mais réellement et corporellement, une maison de Dieu, c’est-à-dire une maison religieuse au centre de laquelle Dieu lui-même réside dans le Saint-Sacrement, où il appelle celles qui l’habitent à le servir jour et nuit, aux heures marquées par l’Église, et d’où il règle, au moyen des constitutions monastiques, non seulement les diverses pratiques de piété et de mortification, mais encore chaque occupation particulière de la journée, bien plus, chaque pas, chaque regard, chaque geste, en un mot, tout l’ensemble de la vie à laquelle il imprime ainsi le sceau qui la consacre à son service. Tout cela apparaît clairement et sans voile aux yeux d’Anne Catherine, et plus elle approfondit l’incomparable dignité d’une vie dirigée suivant un si bel ordre, plus elle ressent douloureusement chaque déviation, chaque violation de la règle et jusqu’à chaque marque d’indifférence, d’indolence et de mondanité ; mais aussi elle se sent elle-même d’autant plus indigne d’habiter une telle maison. Ce n’était donc pas par une simple manière de parler qu’à son entrée elle demandait à la supérieure d’être traitée dans le couvent comme la dernière et la moindre de toutes : et Dieu arrangea les choses de façon à ce que, durant tout le temps qu’elle y vécut, elle n’y fut jamais traitée autrement.
XII
NOVICIAT D’ANNE CATHERINE.
1. Anne Catherine eut à passer les premiers mois de son séjour au couvent en qualité de postulante et en habit séculier. Elle habitait une même cellule avec Clara Soentgen, et ne pouvait jamais avoir l’assurance qu’elle ne serait pas renvoyée : mais Dieu lui donna pendant ce temps assez de force pour qu’elle pût se rendre utile au couvent par le travail manuel et gagner, en outre, au moyen de la couture, de quoi subvenir à ses besoins, d’ailleurs peu nombreux, et aux frais de la vêture. Elle échappa par là au danger d’être congédiée sous prétexte d’inutilité, et, le 13 novembre 1802, elle prit l’habit de l’ordre et fut admise formellement comme novice.
On lui assigna la plus mauvaise cellule du couvent, avec une chaise sans dossier et une autre sans siège : à défaut de table, elle avait, pour y suppléer, l’appui de la fenêtre. « Mais, déclarait-elle plus tard, ma pauvre cellule était pour moi si bien remplie et si magnifique que le ciel tout entier me semblait y être. »
On peut aisément se figurer ce que pouvait être l’éducation spirituelle des novices dans une communauté où étaient tombés en désuétude tous les exercices au moyen desquels, à une meilleure époque, on éprouvait et on affermissait les vocations. Anne Catherine aspirait aux mortifications sévères, aux humiliations, aux épreuves touchant l’obéissance que prescrivait l’ancienne règle du couvent, mais il n’y avait personne pour les lui imposer. Il lui paraissait infiniment plus fructueux et plus méritoire d’être humiliée en vertu de l’obéissance que de s’imposer des pénitences volontaires : mais personne ne lui aurait fourni l’occasion de mériter ainsi, si le divin fiancé lui-même n’était intervenu comme maître et instituteur pour conduire la docile écolière au plus haut degré de perfection, précisément à l’aide des circonstances au milieu desquelles elle vivait et de sa situation si peu favorable au progrès spirituel. Tout devait lui servir de moyen, les choses comme les personnes, pour atteindre ce but et procurer par là la gloire de Dieu et le bien de toute l’Église. Une maîtresse des novices clairvoyante et expérimentée dans la vie spirituelle aurait bientôt découvert dans Anne Catherine sa tendance aux choses les plus hautes, y aurait accommodé sa direction et n’aurait rien toléré en elle qui ressemblât à une imperfection ou à un défaut. Elle était par nature d’un caractère très vif et pouvait facilement s’emporter à la vue d’une injustice. La mortification de cette vivacité était une chose à laquelle Anne Catherine ne pouvait atteindre sans direction : c’est pourquoi Dieu permit que, dès les premiers temps de son noviciat, elle fût injustement soupçonnée, accusée et, quoiqu’innocente, réprimandée publiquement, ce qu’il lui fallut endurer sans murmurer, sans s’excuser, ni se détendre.
2. Voici, entre autres, une épreuve de ce genre. Le couvent, ne tirant qu’un mince revenu du produit de quelques champs, donnait à manger, moyennant une modique rétribution, à quelques pensionnaires qui étaient de pauvres religieuses françaises émigrées et un homme âgé, frère de la supérieure. On demandait à ce dernier moins qu’aux autres ; et les pauvres nonnes françaises, qui l’apprirent par hasard, en ressentirent tant de chagrin qu’elles s’en plaignirent à la supérieure comme d’une grande injustice. On voulut alors savoir qui avait révélé ce secret aux étrangères. Aucune des sœurs ne s’avoua coupable, et la faute tomba sur Anne Catherine, parce qu’on savait qu’elle portait un tendre intérêt aux Françaises, en leur qualité de religieuses bannies à cause de leur profession et réduites au plus grand dénuement. Elle pouvait bien affirmer en toute vérité qu’elle ne s’était jamais inquiétée ni de ce que payait pour sa pension le frère de la supérieure, ni de ce qu’on exigeait des nonnes étrangères, et qu’ignorant tout cela, elle n’avait pu par conséquent en rien révéler. Mais l’inculpation de trahison ne cessa pourtant de peser sur elle. Il lui fallut subir une sévère réprimande de la supérieure et du chapitre et se soumettre à la pénitence qui lui fut imposée, et plus que jamais l’on entendit dans le couvent tout le monde se plaindre hautement de ce que cette pauvre paysanne, admise sans dot, répondait à ce bienfait par la plus blessante ingratitude. Anne Catherine non seulement souffrit en cette occasion l’amère douleur de se voir, malgré son innocence, si durement soupçonnée et punie, mais ce fut encore pour elle une peine indicible d’avoir été, quoique sans le vouloir, l’occasion d’une si grande injustice. Comme il n’y avait dans le couvent personne à qui elle pût s’ouvrir, il lui fallut renfermer en elle-même tout ce qu’elle ressentit dans cette circonstance d’émotions douloureuses. Elle sut promptement prendre assez sur elle pour conserver dans son cœur une affection sincère envers toutes ses compagnes, pour leur pardonner sans rancune, et même pour rendre grâces à Dieu de l’injure qui lui avait été faite comme d’un châtiment mérité : mais, peu de temps après, elle tomba dans une grave maladie dont elle ne guérit que lentement.
3. Ce fut à Noël de l’an 1802 qu’elle ressentit autour du cœur et particulièrement au creux de l’estomac des douleurs assez violentes pour l’empêcher de se livrer à ses travaux accoutumés. Vainement rassembla-t-elle toutes ses forces pour résister à ce mal qui n’avait que l’apparence d’une maladie ordinaire et pour ne pas tomber à la charge du couvent : les douleurs ne firent qu’augmenter. Il lui semblait qu’elle était percée de traits qui se succédaient sans relâche ; à la fin elle ne put plus quitter son lit. Anne Catherine, dans sa profonde humilité, n’osait pas s’avouer à elle-même et encore bien moins aux autres religieuses la vraie cause de cette maladie : elle la connaissait pourtant par la vision qui, lors de sa prise d’habit, lui avait montré la signification intérieure de cette cérémonie et celle de tous les vêtements religieux qu’elle reçut alors avec infiniment de respect et de reconnaissance. Saint Augustin, comme patron de l’ordre, l’avait revêtue de l’habit, l’avait acceptée pour sa fille et lui avait promis sa protection spéciale : il lui avait fait voir son cœur enflammé d’amour et avait allumé par là un tel feu dans celui d’Anne Catherine qu’elle se sentit alors plus intimement unie à sa famille religieuse qu’à ses parents et à ses frères selon la chair. Depuis lors elle vit la signification spirituelle de l’habit religieux et en eut le sentiment aussi intime et aussi vif que celui que peut faire éprouver à une personne ordinaire l’effet d’un vêtement qui la protège : elle sentit et s’assimila en quelque sorte la nature de l’union spirituelle que l’habit établissait entre elle et les autres religieuses. C’étaient comme des courants spirituels ou comme des fils tressés ensemble qui, passant à travers toutes, revenaient à elle comme au foyer ou au centre. Son cœur était maintenant devenu le centre spirituel de cette communauté : car elle avait la terrible mission de ressentir dans son corps toutes les blessures que les fautes et les péchés de la famille conventuelle faisaient au cœur du fiancé céleste. Or Anne Catherine ne pouvait avancer que par degrés dans cette voie, car l’ardeur de la charité ne la soulevait pas, pauvre mortelle qu’elle était, jusqu’à la rendre insensible aux peines et aux douleurs qui maintenant sous toutes les formes pressuraient son cœur sans relâche. Ce qui se faisait dans la maison contre la règle et les vœux, toutes les paroles et tous les actes, toutes les omissions et toutes les négligences frappaient son cœur comme avec un dard, en sorte qu’elle pouvait à peine résister à l’excès de cette douleur.
4. Elle n’avait personne de qui elle se pût faire comprendre ou à qui elle pût dire seulement qu’elle avait le cœur torturé par un mal cruel. On fit venir le médecin du couvent qui la traita comme pour des spasmes. C’était la première fois de sa vie qu’elle avait à subir un traitement médical et des remèdes empruntés à la médecine : car, dans la maison paternelle, l’emploi de certaines herbes salutaires qu’elle savait trouver elle-même et le repos extérieur amenaient promptement sa guérison, en sorte que personne ne pensait à faire venir un homme de l’art. Maintenant il en était tout autrement : les règlements du couvent lui faisaient un devoir de se déclarer malade et de recevoir les soins du médecin appointé. Comme novice obéissante, elle ne doit rejeter aucun remède, quand même elle a la certitude que la cause de sa maladie est une cause spirituelle et que ses souffrances ne peuvent être soulagées que par des moyens spirituels. Elle se laisse docilement traiter comme une malade ordinaire et elle est heureuse, au milieu de ses souffrances, de trouver l’occasion de pratiquer l’obéissance.
5. Pour rendre cette soumission encore plus complète, Dieu permet que l’esprit malin la dresse et lui dresse toute espèce d’embûches. Il vient à elle comme un ange de lumière, l’exhortant à retourner dans le monde, parce qu’elle doit bien voir qu’on lui demande l’impossible. Ce serait donc un péché, lui dit-il, que de vouloir plus longtemps se courber sous un fardeau qui est au-dessus de ses forces, qui est même au-dessus de ce que Dieu veut qu’elle ait à supporter. Il lui décrit aussi les souffrances futures qui doivent lui venir de la part de ses sœurs ; mais Anne Catherine chasse le tentateur par le signe de la croix avant qu’il ait fini son astucieux discours.
D’autres fois il cherchait à l’exciter au ressentiment et aux murmures contre les supérieures ou à lui inspirer une grande crainte de celles-ci, afin de la pousser à quitter le couvent. Une fois, pendant la nuit, il la jeta ainsi dans une grande angoisse. Il lui semblait que la supérieure et la maîtresse des novices s’approchaient tout à coup de son lit, l’accablaient de très vifs reproches et finissaient par lui déclarer qu’étant absolument indigne d’être appelée à la vie religieuse, elle devait être expulsée de la communauté. Anne Catherine reçut en silence toutes ces réprimandes, disant seulement qu’elle-même se sentait indigne d’être admise dans un couvent et priant qu’on voulût bien user à son égard d’indulgence et de patience. Là-dessus, ces femmes irritées quittèrent la cellule en l’injuriant : pour elle, elle pleura et pria jusqu’au matin. Alors elle fit venir son confesseur pour lui raconter ce qui s’était passé pendant la nuit et lui demander conseil sur ce qu’elle avait à faire pour apaiser le courroux de la supérieure. Mais, lorsque celui-ci alla aux informations, il fut constaté que ni la supérieure ni aucune autre religieuse n’était entrée dans la cellule d’Anne Catherine. Il reconnut dans ce qui était arrivé une attaque de l’esprit malin et Anne Catherine remercia Dieu de ce qu’il lui avait donné la force de se sentir en toute sincérité indigne d’être religieuse et de vaincre par là le tentateur.
6. Lorsqu’au bout de quelques semaines, on cessa le traitement médical, la communauté put se convaincre aisément qu’à proprement parler, il n’y avait pas eu de guérison. Elle paraissait si faible et si languissante qu’il s’éleva un murmure général contre la charge que le couvent allait s’imposer en admettant à la profession une personne aussi maladive et aussi incapable de travail : il valait mieux, disait-on, la renvoyer tout de suite que de se mettre, en attendant plus longtemps, dans la nécessité de la conserver. Quand de semblables propos se tenaient, même à voix basse et à l’extrémité de la maison, ils arrivaient à Anne Catherine aussi clairement et aussi distinctement que si on les avait tenus en face d’elle dans sa cellule : bien plus, tous les desseins et tous les complots, tous les sentiments qui animaient intérieurement contre elle telle ou telle d’entre les religieuses, pénétraient en elle comme des étincelles de feu ou des lames de fer brûlant et faisaient incessamment à son cœur de douloureuses blessures. Le don de lire dans les cœurs qu’Anne Catherine avait possédé dès son enfance, mais qui n’avait pas été pour elle une occasion particulière de chagrins, vivant, comme elle faisait, au milieu de gens de la campagne, simples, droits, et la plupart du temps bien disposés en sa faveur, ce don, disons-nous, devint maintenant pour elle une source de peines infinies, parce qu’aucune des pensées ou des sentiments des sœurs à son égard ne lui restait caché. Tout cela lui était manifesté d’après les desseins de Dieu, parce qu’il voulait que, par la perfection de ses vertus, elle surmontât tous les obstacles et toutes les difficultés que lui préparaient sur sa voie d’expiation les circonstances défavorables ou le mauvais vouloir des personnes. Elle voyait les passions de son entourage parce qu’elle devait lutter contre elles, comme contre des puissances ennemies, à l’aide de la mortification et de la prière, et désarmer par l’humilité, la douceur, la charité et la patience tous ceux qui s’opposaient à ses efforts pour arriver aux saints vœux de religion. Lui échappait-il un soupir, un mot de plainte, un signe de mécontentement, se trouvait-elle impuissante à prévenir un premier mouvement d’irritation provoqué par un mauvais traitement immérité ou par une injustice, elle demandait pardon à chaque sœur en pleurant et avec l’expression d’un si profond repentir que toutes se radoucissaient et redevenaient bienveillantes pour elle. Elle courait alors à l’église devant le Saint-Sacrement, afin d’obtenir la force nécessaire pour travailler ; elle redoublait ses efforts pour se rendre utile au couvent de toutes manières et apaisait l’angoisse de son cœur avec ces paroles : « Je persiste à rester ici, quand même je devrais être martyrisée. »
7. Un vendredi du mois de février de l’an 1813, comme elle était ainsi à genoux devant le Saint-Sacrement, priant seule dans l’église du couvent, elle vit tout à coup devant elle une croix haute de deux palmes à laquelle était suspendu le Sauveur tout couvert de sang.
« Je fus, raconta-t-elle plus tard, toute bouleversée par cette apparition : j’avais tour à tour chaud et froid, car je distinguais tout ce qui était dans l’église autour de moi, et je voyais la croix ensanglantée devant moi, non par une intuition intérieure, mais les yeux du corps. Alors la pensée que Dieu, par cette apparition, voulait m’annoncer de grandes souffrances se présenta à moi d’une manière très vive. Je tremblai et frissonnai ; mais l’aspect lamentable de mon Sauveur surmonta toute ma répugnance à souffrir et je me sentis fermement résolue à tout accepter, même les plus cruelles douleurs, pourvu que le Seigneur voulût bien me donner la patience. »
Son pressentiment ne l’avait pas trompée : car le don des larmes venait de lui être accordé, afin que, livrée à la douleur la plus amère, elle versât des torrents de pleurs sur les outrages prodigués à son divin fiancé, et ce don devait être pour elle une source d’humiliations sans fin. À dater de ce moment il lui fut impossible de retenir ses pleurs qui éclataient violemment toutes les fois qu’à ses sens extérieurs ou intérieurs se présentait une chose qui pouvait motiver la douleur surnaturelle de la pénitence. Si elle voyait les souffrances et les tribulations de l’Église, s’il lui était montré qu’un sacrement fût conféré ou reçu indignement, son cœur était saisi d’une telle douleur qu’un torrent de larmes amères coulait de ses yeux ; si elle voyait dans un cœur l’aveuglement spirituel, la fausse piété voilant des fautes non expiées et des dispositions perverses, si elle voyait la grâce de Dieu méprisée ou repoussée obstinément, les saintes vérités de la foi orgueilleusement dédaignées, et en général tous ces péchés de l’esprit qui sont si rarement reconnus et expiés par ceux qui s’en rendent coupables, elle était émue d’une telle compassion, priait si ardemment pour le salut de ces malheureux que ses larmes brûlantes ne pouvaient s’arrêter. Elles coulaient sur ses joues, sur son cou et sur sa poitrine, et elle en était baignée avant de s’en apercevoir. Dans l’église, à la sainte table, pendant le repas, pendant le travail, dans ses rapports avec la communauté, elle était surprise par ces larmes et elle éprouvait chaque fois combien cela la rendait à charge à la communauté. Elles lui venaient aux yeux très fréquemment pendant la sainte messe, au chœur, et lors que la communauté faisait la sainte communion : toutefois, au commencement, les autres n’en étaient pas frappées ; mais, comme ces pleurs devenaient de plus en plus abondants, Anne Catherine fut prise à partie et on lui reprocha cela comme une marque de mécontentement et d’humeur bizarre. Elle promit à genoux de se corriger et de s’abstenir de pleurer : mais, bientôt, le lendemain peut-être, les nonnes, devenues de plus en plus soupçonneuses, remarquèrent que, pendant la sainte messe, le banc même où elle s’agenouillait était trempé de larmes et elles crurent trouver là une nouvelle preuve que les pensées de la novice ne se portaient que sur des choses dont son amour-propre se sentait blessé. Cependant Anne Catherine accepte sans s’excuser la réprimande et la punition qui lui sont infligées, et cela avec tant d’humilité et de résignation que la supérieure est forcée de reconnaître que les pleurs de la pauvre novice sont pour elle un plus grand ennui que pour les autres : donc, c’est peut-être une faiblesse de nerfs ou une disposition particulière, mais non une marque de mécontentement ou un caprice. Quant à Anne Catherine, elle est si loin de considérer ses larmes comme quelque chose d’extraordinaire qu’elle examine avec beaucoup d’inquiétude et de scrupule si quelque aversion secrète ou si une haine profondément cachée contre les sœurs n’a pas pris racine dans son cœur et n’est pas la vraie cause de ces pleurs. Elle-même n’osa rien décider sur ce point, mais elle exposa ses inquiétudes à son confesseur pour qu’il jugeât ce qu’il fallait en penser. Celui-ci la tranquillisa en lui expliquant que c’était la compassion et non la haine qui la faisait pleurer.
8. Anne Catherine pouvait croire qu’avec le temps la vivacité de cette compassion s’affaiblirait et que les larmes tariraient peu à peu : mais il n’en fut pas ainsi. Il y eut dans l’un et l’autre cas plutôt accroissement que diminution. Dans sa détresse, elle cherchait assistance auprès de tous les confesseurs qui, pendant le temps qu’elle vécut au couvent, furent chargés de la diriger. Mais tous lui répétèrent la même chose. Overberg, de son côté s’est ainsi exprimé à ce sujet :
« Anne Catherine aimait tellement ses sœurs en religion qu’elle aurait volontiers versé son sang pour chacune d’elles. Quoiqu’elle sût que plusieurs d’entre elles n’étaient pas bien disposées à son égard, elle faisait pourtant tout ce qu’elle pouvait pour leur être agréable. Elle éprouvait une très grande joie lorsque quelqu’une lui demandait un service charitable, parce qu’elle espérait alors que ses compagnes deviendraient plus indulgentes à son égard.
« Dieu permit qu’elle fût méconnue de la supérieure et des sœurs ; car elles voyaient dans tout ce qu’elle faisait, soit de l’hypocrisie, soit de la flatterie ou de l’orgueil, et elles ne manquaient pas de le lui reprocher. Au commencement, elle cherchait à s’excuser : mais, comme cela ne servait à rien, elle se borna par la suite à répondre qu’elle tâcherait de se corriger. Quand elle voyait les sœurs hors de l’église et surtout dans l’église, elle ne pouvait s’empêcher de pleurer tout le temps ; on la réprimanda souvent à cause de ces pleurs, parce qu’on les considérait comme une marque de mécontentement et comme l’effet du caprice. On la blâmait surtout quand elle pleurait pendant la sainte messe. Les souffrances qui lui venaient de la part des sœurs lui étaient d’autant plus sensibles qu’elle voyait et entendait en esprit ce qu’elles avaient dans le cœur, ce qu’elles se disaient d’elle en secret les unes aux autres, leurs délibérations sur ce qu’il y avait à faire pour l’humilier et la guérir de ses caprices et de sa paresse.
« Elle m’assura qu’elle avait su tout ce que les sœurs disaient d’elle ou projetaient à son égard. « Je voyais, me dit-elle, et je connaissais alors mieux qu’à présent (le 22 avril 1813) ce qui se passait dans les âmes. Je leur laissais voir parfois que je savais tout ce qu’elles disaient ou complotaient secrètement contre moi. On voulait alors me faire dire d’où je le savais, mais je n’osais pas le leur avouer. Elles s’imaginèrent alors que quelqu’une d’elles me révélait tout. Je demandai à mon confesseur ce que j’avais à faire. Il me dit de leur répondre seulement que j’avais parlé de cela en confession ; que, par conséquent, je devais en rester là et m’abstenir de leur donner d’autres explications à ce sujet. »
Dans une occasion postérieure, Anne Catherine s’exprima ainsi sur les larmes qu’elle versait, étant au couvent :
« Je ne pouvais m’empêcher de pleurer quand je voyais si irritées contre moi ces compagnes pour lesquelles j’aurais volontiers donné ma vie. Comment ne pas pleurer quand, dans la maison de la paix, parmi des personnes consacrées à Dieu et entièrement séparées du monde, on sent qu’on est une pierre d’achoppement pour tous, sans avoir aucun moyen d’y remédier ? Je ne pouvais m’empêcher de pleurer sur la pauvreté, la misère, l’aveuglement de cette vie où on languit, le cœur fermé, dans le voisinage de la grâce surabondante du saint Rédempteur. »
9. Lorsqu’en 1813, l’autorité ecclésiastique voulut avoir le témoignage de la communauté touchant Anne Catherine, la supérieure, la maîtresse des novices et cinq autres religieuses déposèrent unanimement :
« Anne Catherine était toujours très facile à vivre et très pacifique. Dans ses relations avec les autres, elle était humble, condescendante, jamais querelleuse et excessivement serviable. Pendant ses maladies elle était extraordinairement douce et affable, résignée à la volonté de Dieu et patiente. Quand elle avait eu à souffrir quelque mauvais procédé, elle se réconciliait promptement et de bon cœur, et demandait pardon si elle avait montré un peu de vivacité ; elle ne haïssait personne et elle cédait toujours. »
Clara Soentgen dit à Overberg :
« Elle n’était jamais plus contente que quand elle pouvait rendre quelque service charitable à ses compagnes. On pouvait lui demander ce qu’on voulait, elle donnait toujours avec joie, même ce qui lui eût été le plus nécessaire. Elle faisait du bien de préférence aux personnes qu’elle savait lui être contraires. »
10. Le doyen Rensing de Dulmen déposa ainsi le 24 avril 1813 :
« J’avais appris qu’Anne Catherine avait rendu de grands services à l’une des sœurs pendant une maladie et je lui demandai de m’en donner la raison. Elle répondit : « Cette sœur avait des plaies aux pieds, et les servantes ne la soignaient pas volontiers à cause de son humeur bizarre. Je pensai que c’était pourtant là une œuvre de miséricorde et je demandai qu’on me chargeât de laver les linges pleins de sang et de pus qui lui avaient servi de bandages. Elle avait aussi la gale et je fis son lit, parce que les servantes craignaient de gagner la maladie. Comme il pouvait arriver que j’en fusse atteinte, je m’encourageai moi-même en me disant que c’était, après tout, une œuvre de miséricorde et que Dieu me préserverait. Il me vint aussi la pensée que cette sœur, qui était bizarre, ne me remercierait guère de mes services quand elle serait guérie et qu’elle ne cesserait pas de me traiter d’hypocrite, comme elle le faisait souvent : mais je me dis que j’en aurais d’autant plus de mérite devant Dieu et je continuai à laver son linge, à faire son lit et à la soigner du mieux que je pus. »
11. Anne Catherine avait reçu de Dieu une si parfaite connaissance de la signification et de l’effet des vœux de religion que son âme énergique aspirait ardemment à pratiquer en tout l’obéissance et ressentait une douleur toute particulière de ce que, par suite du relâchement de la discipline conventuelle, les supérieures s’attachaient si peu à l’éprouver à cet égard par des ordres sévères et des prescriptions pénibles à remplir. Dans son désir, elle s’adressait souvent à la révérende mère et la suppliait de lui commander quelque chose en vertu de l’obéissance, afin qu’elle pût, en l’exécutant ponctuellement, se montrer fidèle au saint vœu. Mais ses prières n’aboutissaient à rien, et on n’y voyait que des singularités ou des scrupules : elle recevait pour toute réponse de la faible et débonnaire supérieure : « Tu as assez d’intelligence pour savoir toi-même ce que tu as à faire. » Et tout restait comme auparavant livré à sa seule appréciation. La privation de ces exercices affligeait la fervente novice jusqu’aux larmes : car il lui semblait que, par là, la bénédiction attachée au saint état religieux lui était retirée et elle ne croyait pas pouvoir servir parfaitement son fiancé céleste en dehors d’une obéissance aveugle envers les autorités instituées par l’Église qui tenaient sa place.
La supérieure dit dans sa déposition, en 1813 :
« Anne Catherine a toujours rempli avec beaucoup de bonne volonté, d’exactitude et d’empressement les devoirs de l’obéissance, spécialement dans toutes les choses que je lui enjoignais particulièrement. »
La maîtresse des novices dit de son côté :
« Elle a très bien pratiqué l’obéissance : seulement quelquefois elle était peinée de ce que la révérende mère, en beaucoup d’occasions, ne lui disait pas ce qu’elle avait à faire. »
12. Mais si les occasions extérieures de pratiquer l’obéissance lui manquaient la plupart du temps, elle cherchait à y suppléer par la soumission intérieure et par l’application incessante à diriger ses sentiments, ses vues et même tous les mouvements de son âme selon l’esprit et la lettre de la sainte règle de son ordre. Elle ne voulait pas vivre dans la communauté religieuse comme un membre qui s’obligeât seulement à la pratique matérielle de l’observance en tant qu’elle subsistait encore : mais il fallait que tout son intérieur et toute sa vie spirituelle, de même que ses actions extérieures, fussent ordonnés d’après la sainte règle. Aussi s’appliquait-elle à en acquérir la connaissance bien exacte, et ne la lisait-elle qu’à genoux par respect. Il arriva plusieurs fois, pendant cette lecture, que la lumière s’éteignît et que le livre fût fermé par une puissance invisible. Elle savait quel était celui qui cherchait à la troubler ainsi dès sa jeunesse : aussi rallumait-elle tranquillement sa chandelle et se remettait-elle à lire plus longtemps et avec un redoublement de ferveur. En outre les attaques plus violentes et plus sensibles de l’ennemi étaient pour son zèle la compensation au manque d’autres exercices. S’il la maltraitait et la frappait à cause de l’étude attentive qu’elle faisait du livre de la règle, elle s’y livrait d’autant plus assidûment : s’il parvenait à exciter coutre elle un orage dans la communauté, cela servait à prouver combien était profond et sincère son désir de pratiquer une humble et aveugle obéissance. Il en fut ainsi dans l’incident qui suit.
13. Une riche famille de négociants d’Amsterdam avait mis sa fille en pension dans le couvent. Celle-ci, devant retourner chez ses parents pour un temps assez long, fit présent à chaque religieuse d’un florin de Hollande : or, Anne Catherine, pour qui elle avait une prédilection marquée, en reçut deux qu’elle remit aussitôt à la supérieure. Peu de jours après, il s’éleva des murmures à ce sujet dans le couvent tout entier, et Anne Catherine fut appelée devant le chapitre, où la supérieure lui fit savoir qu’elle était accusée par toute la communauté d’avoir reçu cinq écus de la jeune Hollandaise et de n’en avoir remis que deux à la révérende mère, ayant donné le reste au chantre Soentgen qui s’était trouvé là à l’occasion d’une visite qu’il faisait à sa fille. Comme on faisait appel à sa conscience pour qu’elle s’avouât coupable, Anne Catherine affirma la vérité des faits tels qu’ils s’étaient passés et, quoique toutes les religieuses redoublassent alors de violence, elle refusa constamment d’avouer qu’elle eût reçu les prétendus cinq écus. Là-dessus elle fut condamnée à demander pardon à genoux à chacune des religieuses. Elle accepta de tout son cœur cette punition non méritée, priant Dieu de vouloir bien faire en sorte que les sœurs lui pardonnassent sincèrement tout ce qui pouvait leur déplaire en elle. Quelques mois après, la fille du négociant revint et Anne Catherine demanda à la supérieure de s’enquérir auprès d’elle de ce qui s’était passé en réalité ; mais elle reçut pour réponse l’ordre de ne plus s’occuper de cette vieille histoire tout à fait oubliée. Et ainsi le grand sacrifice de l’humiliation subie lui resta tout entier.
14. On voit, par ce fait, avec quelle promptitude s’élevaient chez ces faibles femmes l’aversion et le soupçon contre leur innocente compagne, mais aussi combien l’orage s’apaisait vite avant qu’on en vînt aux extrémités. L’impression que faisait éprouver à ces religieuses sans expérience et ne connaissant que leur vie quotidienne toute la manière d’être et la conduite de leur novice était tellement mélangée que nous ne pouvons nous étonner de ce qui a été raconté. La douceur et la patience admirables que montrait Anne Catherine lorsqu’elle était soumise à des pénitences publiques, la gravité touchante et cordiale avec laquelle elle demandait pardon ne pouvaient manquer d’adoucir les plus irritées ; mais plus tard bien d’autres choses se produisaient chez elle qui faisaient naître aisément de nouveaux soupçons dans ces âmes portées à la défiance. Il y avait dans la richesse de sa vie intérieure, dans la variété infinie des dons extraordinaires qui lui étaient départis, en un mot dans l’ensemble de toute sa personne, quelque chose de trop singulier pour qu’elle pût tenir tout cela caché et rester elle-même renfermée dans les limites de la vie habituelle. Quelque simplicité et quelque modestie qu’il y eût dans tout son extérieur, cependant on y voyait briller un caractère si sacré et même si sublime que toutes se sentaient infiniment surpassées par elle, quoiqu’elles ne voulussent pas l’avouer et aimassent mieux représenter Anne Catherine comme une personne étrange, gênante et embarrassante. Elle était souvent attirée vers le Saint-Sacrement avec une force à laquelle elle essayait vainement de résister. Lorsqu’elle avait à traverser l’église, elle s’agenouillait ou se prosternait tout à coup, comme frappée de paralysie, sur les marches de l’autel ou dans le chœur, et cela, avant qu’elle eût pu y penser. Elle était continuellement en contemplation et dans des états de souffrance intérieure qui, malgré tous ses efforts, ne pouvaient entièrement rester secrets. Cela faisait d’elle pour son entourage comme une énigme pénible et produisait même chez quelques-unes une impression qu’elles ne pouvaient supporter. Clara Soentgen déposa à ce sujet :
« Anne Catherine cherchait toujours à cacher l’élan qui la portait à une piété et à une dévotion au-dessus de l’ordinaire ; mais, comme je la connaissais à fond, bien des choses ne m’échappaient pas. Je la trouvais souvent dans l’église à genoux et prosternée sur son visage devant le Saint-Sacrement. Elle était surtout adonnée à la contemplation à tel point que je remarquais parfois qu’étant dans la compagnie d’autres personnes, son esprit s’occupait de choses plus hautes. Elle était très portée à la mortification corporelle, et j’ai souvent remarqué qu’à table elle prenait ce qu’il y avait de plus mauvais, laissait passer les bons plats sans y toucher ou donnait sa part aux autres, surtout quand celles-ci n’étaient pas bien avec elle. Et cela se faisait toujours avec un air de contentement et de joie qui m’émerveillait. »
La maîtresse des novices dit à son tour :
« Lorsqu’Anne Catherine était au noviciat, j’ai plusieurs fois retiré de son lit des morceaux de bois. J’ai remarqué en général qu’elle avait beaucoup de penchant pour la mortification. Quelquefois, à dix heures du soir, pendant l’hiver, je l’ai fait sortir de l’église, où elle était prosternée devant l’autel et où elle serait restée trop longtemps si on l’avait laissée faire. »
15. À une époque postérieure, Anne Catherine, dans diverses occasions, avait parlé des premiers temps de son séjour au couvent. Clément Brentano, qui recueillait avec grand soin toutes ses communications, nous a conservé aussi celles-là et les a ainsi rédigées :
« Dès le commencement de mon noviciat, je me trouvai dans d’incroyables états de souffrance intérieure. Un jour, mon cœur était entouré de roses et tout à coup il n’y avait plus que des épines qui le transperçaient : en outre, je sentais dans le cœur et dans la poitrine une quantité de pointes et de traits qui les traversaient. Cela venait de ce que dans mon état de clairvoyance et de perception sensible qui était alors bien plus marqué qu’à présent, je connaissais et ressentais toutes les choses blessantes qu’on faisait, disait ou pensait contre moi, quand même cela se faisait derrière mon dos. Aucune des personnes qui vivaient avec moi, pas une des religieuses, pas un ecclésiastique, n’avaient la moindre idée de l’état de mon âme et de la conduite particulière à laquelle ma vie était soumise ; moi-même je vivais tout entière dans un autre monde dont je ne pouvais rien faire connaître. Mais comme pourtant, dans beaucoup de cas et d’occasions extérieures, il se produisait des choses qui, provenant de ma direction intérieure, se mêlaient d’une façon étrange et faite pour surprendre à la vie que je menais en commun avec d’autres, je devais nécessairement par là être pour les personnes qui vivaient avec moi une cause fréquente de tentations qui les poussaient aux soupçons haineux, aux médisances et aux paroles malveillantes. Tous ces discours blessants et même les pensées qui n’arrivaient pas à exécution, je les voyais, je les entendais, je les connaissais, je les sentais entrer dans mon cœur comme des flèches aiguës, et il n’y avait pas en moi un petit coin qui ne fût atteint : souvent je sentais mon cœur percé de milliers de coups. Au dehors, je paraissais sereine et amicale comme si je n’eusse rien su de tout cela ; et, à proprement parler, je n’en savais pas grand-chose extérieurement, car tout était dans mon intérieur et ne m’était manifesté que pour m’exercer à l’obéissance, à la charité et à l’humilité. Et quand j’y manquais, j’en étais sévèrement punie à l’intérieur. Mon âme m’apparaissait comme transparente, et quand une nouvelle souffrance venait l’assaillir, j’y voyais comme des points rayonnants et des places rouges et enflammées où il fallait éteindre le feu à force de patience.
« Mon état dans le couvent était si étrange et si complètement en dehors des choses de ce monde qu’on ne pouvait pas savoir mauvais gré à mes compagnes de ce qu’elles ne me comprenaient pas et ne me voyaient qu’avec méfiance et soupçon. Cependant Dieu leur a caché beaucoup de choses qui eussent pu les inquiéter encore davantage à mon endroit. Du reste, je n’ai jamais été si riche intérieurement ni si parfaitement heureuse quelles que fussent mes souffrances et mes peines. Je vivais en paix avec Dieu et avec toutes ses créatures et, quand je travaillais dans le jardin, les oiseaux venaient à moi ; ils se posaient sur ma tête et sur mes épaules et nous louions Dieu ensemble.
« Mon ange gardien marchait toujours à mes côtés et, quoique le mauvais esprit rodât partout autour de moi et excitât les passions contre moi, quoique même, dans ma cellule, il m’accablât de mauvais traitements et de coups et cherchât à m’effrayer par un tapage affreux, il ne pouvait cependant me nuire sérieusement et le secours m’arrivait toujours.
« Je croyais souvent, pendant des heures entières, avoir l’enfant Jésus dans mes bras ; ou bien, quand j’étais avec les sœurs, je le sentais marcher à côté de moi et j’étais tout heureuse. Voyant tant de choses qui m’apportaient soit de la joie, soit de grandes souffrances, et n’ayant personne à qui je pusse m’ouvrir là-dessus, il me fallait comprimer en moi, avec de grands efforts, même les impressions les plus soudaines et les plus violentes, et souvent dans ces moments je changeais de couleur et de visage. On disait parfois alors que j’avais l’air d’être amoureuse. Ils avaient raison, je ne pouvais jamais aimer assez mon fiancé, et quand ses amis parlent bien de lui ou de ceux qu’il aime, mon cœur palpite de joie. »
XIII
ANNE CATHERINE FAIT SA PROFESSION RELIGIEUSE LE 13 NOVEMBRE 1803.
1. L’année du noviciat touchait à son terme : mais la communauté n’était pas encore décidée à conserver la novice et à l’admettre à la profession. La maîtresse des novices à la vérité pouvait lui rendre ce témoignage : « Je remarque en elle qu’elle est toujours satisfaite de la volonté de Dieu : cependant elle pleure souvent et ne veut pas dire pourquoi parce qu’elle n’ose pas. Je ne connais chez elle rien en particulier qui soit à blâmer. »
Mais cela ne suffisait pas pour faire cesser toutes les résistances de la part de la communauté. Quand on délibéra dans le chapitre sur les motifs qu’il pouvait y avoir de la congédier ou de la garder, les sœurs ne purent présenter d’autre raison pour son renvoi que la prévision, certaine selon elles, qu’Anne Catherine serait bientôt incapable de tout travail et deviendrait une charge perpétuelle pour le couvent ; cependant la révérende mère fut obligée de reconnaître que la novice était très intelligente et montrait en toutes choses tant d’aptitude et d’entendement qu’elle pouvait certainement se rendre encore très utile à la communauté. Cette déclaration eut pour effet d’obtenir des opposantes l’aveu qu’Anne Catherine se comportait toujours et en tout comme une bonne religieuse et qu’au fond il n’y avait aucune raison suffisante pour la renvoyer.
2. Tous les obstacles paraissaient donc avoir disparu et le jour de la profession ne devait pas être retardé plus longtemps ; mais la sincérité scrupuleuse de la novice remit de nouveau tout en question. Elle n’avait pas encore retiré la garantie qu’elle avait donnée au chantre Soentgen pour dix thalers et craignait, non sans raison, d’être elle-même astreinte au payement par le créancier. Elle s’ouvrit à ce sujet à la révérende mère, laquelle reçut bientôt de Soentgen l’aveu qu’il ne pouvait pas s’acquitter lui-même. La communauté résolut alors à l’unanimité de ne pas laisser Anne Catherine faire ses vœux jusqu’à ce qu’elle fût libre de l’engagement qu’elle avait pris. Celle-ci alors exposa à Dieu avec d’instantes prières sa pénible situation : mais elle ne fut exaucée qu’après avoir épuisé tous les moyens humains pour parvenir à se procurer la somme exigée.
« Je ne possédais pas un denier, raconta-t-elle. Je m’adressai à mes parents et à mes frères, mais personne ne voulut me donner la moindre chose, pas même mon bon frère Bernard. Tous m’accablèrent de reproches et firent autant de bruit que si j’avais commis le plus grand crime du monde en donnant cette caution. Mais la dette devait être payée avant que je pusse être admise à faire mes vœux. Comme je ne cessais pas de crier vers Dieu, il eut pitié de moi et toucha le cœur d’un homme charitable qui me donna les dix thalers. Mon frère, plus tard, a souvent pleuré d’avoir été si dur envers moi.
« Ce grand obstacle étant heureusement écarté, et tous les préparatifs pour la profession étant faits, il survint une dernière difficulté. La révérende mère nous annonça, à Clara Soentgen et à moi, qu’il manquait encore quelque chose qu’elle et moi devions faire venir de Munster par un messager et pour quoi chacune avait à payer trois thalers. J’en fus très affligée parce que je n’avais pas le moindre argent. Dans ma détresse, j’allai trouver l’abbé Lambert et je lui racontai ma peine. Il me donna deux couronnes et, comme je revenais toute joyeuse à ma cellule, j’y trouvai six thalers bien comptés sur la table. Je portai alors les deux couronnes à mon amie qui, elle aussi, ne savait comment se procurer les trois thalers, parce que, comme moi, elle ne possédait rien.
« Trois ans après, je me trouvai encore dans l’embarras, parce que je n’avais pas de quoi acheter la moindre chose pour le déjeuner que chaque religieuse du couvent devait se procurer elle-même. Je trouvai alors, comme j’entrais dans ma cellule fermée à clef, deux thalers posés sur l’appui de la fenêtre. Je les montrai à la supérieure et il me fut permis de les garder.
« L’an 1803, huit jours avant la fête de la Présentation de la sainte Vierge, le second jour de la semaine préparatoire à cette fête, qui était le jour où, l’année d’avant, Clara Soentgen et moi avions pris l’habit, nous fîmes profession comme Augustines dans le couvent d’Agnetenberg de Dulmen : nous fûmes donc, à partir de ce jour, des fiancées consacrées à Jésus-Christ sous la règle de saint Augustin. J’étais alors dans ma vingt-huitième année. Après la profession, mes parents redevinrent bons pour moi. Mon père et mon frère vinrent me voir à Dulmen et m’apportèrent deux pièces de toile. »
3. L’abbé Jean-Martin Lambert que nous rencontrons ici pour la première fois, ancien vicaire de la paroisse de Demuin, dans le diocèse d’Amiens, avait été, comme tant d’autres bons prêtres, forcé de quitter sa patrie, pour avoir refusé le fameux serment à la Constitution. Muni des recommandations de l’archevêque de Tours et de l’évêque d’Amiens, il vint, l’an 1794, dans le diocèse de Munster, obtint de M. de Furstenberg, alors vicaire général, des pouvoirs comme confesseur, et fut appointé comme tel, avec un petit traitement, pour la maison du duc de Croy, qui résidait à Dulmen. Dans le couvent d’Agnetenberg qui avait son propre confesseur, il avait l’emploi de chapelain, ce qui lui donnait la jouissance d’un logement dans les dépendances du couvent. Lorsqu’Anne Catherine était chargée du service de la sacristie, elle fit connaissance avec lui et prit une grande confiance en lui en voyant la piété et le profond recueillement avec lesquels il célébrait la sainte messe.
Dans les détresses et les tribulations intérieures où elle se trouvait fréquemment par suite de la disposition hostile des religieuses du couvent et parce que son état n’était pas compris du confesseur ordinaire, elle se décida un jour à s’ouvrir à l’abbé Lambert et à lui demander ses conseils et son assistance sacerdotale. Mais, comme il ne possédait pas bien l’allemand, les communications mutuelles ne pouvaient être que très restreintes. Toutefois, le pieux et clairvoyant ecclésiastique parvint bientôt à acquérir une connaissance suffisante de la direction intérieure et de toute la personne d’Anne Catherine pour se considérer comme obligé de venir en aide de tout son pouvoir à une âme si favorisée de la grâce. Il décida, en outre, le confesseur ordinaire à permettre à Anne Catherine de recevoir plus fréquemment la sainte communion, et même à la lui ordonner lorsque celle-ci s’y refuserait par humilité : c’était lui qui se tenait prêt dès le point du jour à lui donner le Sacrement adorable dont le désir la faisait défaillir. Quoique lui-même vécût fort pauvrement, il se trouvait heureux quand Anne Catherine, réduite à la détresse, voulait bien accepter de lui un don charitable. Quant à elle, elle l’honorait comme son plus grand bienfaiteur sur la terre, et nous verrons plus tard de quel prix elle paya la bonté qu’il lui avait témoignée.
4. Le lecteur peut aisément s’imaginer quels furent les sentiments d’Anne Catherine lorsqu’elle prononça au pied de l’autel les vœux solennels auxquels elle aspirait depuis si longtemps et pour lesquels elle avait tant eu à souffrir. Elle s’était préparée pour cet heureux moment avec le même zèle et le même désir qu’elle l’avait fait seize ans auparavant pour sa première communion. Quoique, pendant les derniers jours, elle eût multiplié ses pratiques de pénitence et qu’elle fût très affaiblie par les inquiétudes et les tribulations qu’elle avait eues à supporter peu auparavant, elle se montra pourtant le jour de sa profession avec toutes les apparences de la force et de la santé. La joie de son âme et le sentiment de bonheur infini que lui causait son union prochaine avec le fiancé céleste se manifestaient au dehors et la faisaient paraître comme lumineuse. Elle avait l’intuition continuelle de la signification intime de cette cérémonie, ainsi que de toutes les voies, les directions et les épreuves par lesquelles elle avait passé depuis son premier appel à l’état religieux, et son cœur surabondait de joie et de reconnaissance pour tout ce que Dieu avait opéré jusqu’alors en elle et par elle. Elle se trouvait revêtue de la parure de fiancée et des habits de fête qu’il lui avait fallu préparer si laborieusement depuis des années d’après les indications de sa grande vision ; elle reconnaissait comment le fruit et l’effet de chaque pas en avant, de chaque victoire sur elle-même, de chaque soupir, de chaque pratique de patience, de chaque souffrance y figuraient comme des fleurs d’or, ou comme des pierres précieuses, des perles et des broderies merveilleuses. Elle sentait maintenant combien tout cela lui avait été nécessaire pour pouvoir arriver bien préparée à ces noces auxquelles son fiancé céleste lui-même assistait visiblement dans l’église du couvent avec les saints de l’ordre de S. Augustin. De même qu’à son baptême elle s’était vue mariée avec l’enfant Jésus par Marie, ce fut aussi cette fois la reine des vierges qui la remit à son fiancé. Pendant que sa bouche prononçait les paroles de la profession, elle vit cette tradition solennelle de sa personne à Dieu s’accomplir comme d’une double manière : car ce fut l’Église sur la terre qui la reçut et ce fut le céleste fiancé qui daigna l’accepter par l’Église et des mains de l’Église, et qui scella son acceptation en lui octroyant des dons et des ornements magnifiques. Anne Catherine vit alors la nouvelle et haute position qui lui était faite, en vertu des vœux, dans la sainte hiérarchie de la société ecclésiastique : mais elle vit et ressentit aussi d’une manière inexprimable comment, dans son corps et dans son âme, dans son cœur et dans son esprit, elle était munie de forces, de bénédictions et de grâces abondantes, et gratifiée de la dignité insigne attachée à sa qualité de fiancée, dignité que, dès lors, elle ne pouvait considérer en sa personne qu’avec respect. Il lui arrivait ce qui arriverait à un prêtre pieux pour lequel, lors de la réception des saints ordres, sa propre âme deviendrait visible avec toute la splendeur communiquée par le caractère indélébile, et qui verrait les grâces et les facultés surnaturelles qui en émanent se communiquer aux puissances de l’âme. Elle sut et sentit comment désormais elle appartenait à l’Église et par l’Église au fiancé céleste d’une manière toute nouvelle, comme un don consacré, offert à Dieu en corps et en âme : et, de même que Colombe de Rieti, Lidwine de Schiedam et la bienheureuse Colette, elle connut la signification spirituelle de toutes les parties et de tous les membres de son corps de fiancée consacré à Dieu et leur relation symbolique avec toutes les parties du corps de l’Église.
5. Certainement il n’y avait personne dans le couvent d’Agnetenberg qui eût le moindre soupçon de ces merveilleuses opérations. Mais Dieu voulait que ce jour des noces spirituelles fût pour tous un jour de joie et de douce paix. Anne Catherine, grâce au reflet de la béatitude intérieure que ne pouvaient obscurcir les larmes de joie coulant sans relâche sur son visage, fit une si aimable impression sur toute la communauté, et les paroles affectueuses avec lesquelles elle remerciait continuellement les sœurs pour l’avoir admise à la profession excitèrent une telle émotion que ce jour fut embelli, même extérieurement, par la joie et la paix répandues dans tous les cœurs. Après la grande messe solennelle, il y eut dans le réfectoire du couvent un repas auquel les parents d’Anne Catherine furent invités. Jamais son cœur n’avait ressenti avec amertume la grande souffrance que lui avait causée le refus de ses parents de la laisser aller au couvent : mais elle avait souvent prié Dieu d’accorder à ces êtres si chers de consentir du fond du cœur au sacrifice qui leur était imposé. Elle était maintenant exaucée. Son père et sa mère furent si profondément touchés à la vue de leur fille le jour de ses noces spirituelles que, s’unissant à son sacrifice, ils la donnèrent à Dieu de tout leur cœur. Il devint clair et certain pour eux qu’elle était appelée par Dieu à cet état, et ils craignirent de résister à Dieu lui-même s’ils persistaient plus longtemps dans leur opposition. C’est pourquoi, ce jour-là, une grande joie entra dans leurs cœurs, et ils la témoignèrent si vivement à leur fille que le souvenir de cette mémorable solennité fut pour elle, tout le reste de sa vie, une grande consolation.
6. Le commencement de cette année 1803 avait amené en Allemagne, pour l’Église catholique, des spoliations et des persécutions qui, dans l’intention de leurs promoteurs, devaient avoir pour résultat sa destruction complète et l’anéantissement de la foi chrétienne, et qui l’auraient eu sans doute si l’Église n’avait pas Dieu lui-même pour fondateur et pour défenseur. De même qu’au temps de l’ancienne alliance, il avait permis la dévastation de sa ville sainte et de son saint temple, pour punir son peuple de ses infidélités et de son apostasie, de même aussi cette fois les puissances ennemies devaient lui servir de fléau et de pelle pour nettoyer son aire. Tant que dure l’exécution de cette sentence et l’abomination de la désolation, le Seigneur tient cachées en lieu sûr, comme les prêtres de l’ancien temple firent autrefois par son ordre pour le feu sacré, les choses saintes de son Église, jusqu’à ce que, le crime étant expié, elles puissent la faire resplendir d’un nouvel éclat. Les puits dans lesquels est sauvé le feu sacré retiré de l’Église sont les âmes saintes, bien peu nombreuses, de cette époque, chargées de cacher sous les eaux de la souffrance et de la tribulation les trésors qui furent jadis la joie et la parure de la fiancée de Jésus-Christ, et qui maintenant sont foulés aux pieds dans la poussière par ceux pour lesquels ils brillent, livrés et trahis par leurs gardiens, pillés et dissipés par ceux qui devaient les conserver et les défendre. Anne Catherine doit partager cette tâche si difficile avec un petit nombre de fidèles serviteurs : c’est pourquoi le Seigneur emploie le feu des souffrances et le marteau de la pénitence à faire d’elle un vase assez pur, assez ample et assez solide pour recevoir en lui les incommensurables richesses de l’Église et les protéger contre les entreprises de l’ennemi, jusqu’à ce qu’ils soient de nouveau rapportés dans l’Église au temps marqué par Dieu.
7. Quand nous nous représentons le long et pénible chemin qu’Anne Catherine fut forcée de parcourir depuis le premier appel jusqu’à l’instant où elle put enfin faire ses vœux solennels, nous voyons que toute liberté fut laissée à l’ennemi du salut pour la détourner de son but et rendre inutiles ses peines et ses luttes. Mais enfin elle a triomphé de sa malice et de sa ruse par l’humilité et la patience ; elle est arrivée pas à pas à une force et à une hauteur spirituelles, grâce auxquelles, hardie comme un héros, simple et naïve comme un enfant, elle poursuit sa tâche de souffrir pour l’Église pour laquelle elle expie et qu’elle représente. Et quelle vie l’attendait maintenant dans le couvent ! La touchante impression de la fête de ses noces spirituelles s’était bien vite effacée dans l’âme des sœurs, et Anne Catherine redevint bientôt pour toutes l’intrus accueilli à contrecœur qu’elle était en réalité. Dieu en effet l’avait fait entrer comme de force dans cette communauté, contrairement à toute prévision humaine et en dehors de toute adhésion libre : dès le premier jour, par sa pauvreté et son état de maladie, elle avait contracté aux yeux des religieuses une dette qui ne lui fut jamais remise. Elle avait pris l’habit malgré la répugnance de la communauté et maintenant elle arrive à la profession quoique les nonnes elles-mêmes ne puissent s’expliquer comment elles ont pu le permettre. Ce vaisseau de la grâce, cet instrument de Dieu est constamment une pierre d’achoppement et un objet d’aversion pour une famille religieuse à laquelle elle porte une ardente affection. Elle le sait et le sent continuellement, car elle ne cesse jamais d’avoir l’intuition la plus claire des pensées et des sentiments de toutes. Ainsi, elle était traitée, à la lettre, comme les vœux solennels et l’état religieux lui-même l’étaient dans son temps par d’innombrables cénobites. Et, pour compenser tant de peines et de chagrins, elle n’a pas le moindre espoir de pouvoir persuader à quelqu’une de ses compagnes la nécessité de restaurer la stricte discipline d’autrefois ou d’y préparer de jeunes âmes plus fortes : car, après elle, le noviciat se ferme pour toujours et elle est la dernière qui, dans le couvent d’Agnetenberg, soit devenue l’épouse de Jésus-Christ par la profession des vœux. Elle sait, par les évènements du jour comme par ce qui lui est annoncé en vision, que la famille spirituelle à laquelle elle est maintenant incorporée sera dissoute sous peu de temps pour ne plus jamais renaître. Et pourtant dans Anne Catherine sont réunies, d’après les calculs humains, toutes les conditions qui peuvent la rendre capable de servir l’Église de la manière la plus éclatante. Mais elle est dans la main de Dieu un instrument qui ne doit pas produire des résultats extérieurs et frappant les yeux ; elle doit, au moyen de souffrances incalculables, procurer la guérison du corps de l’Église tout couvert de blessures, de telle manière que les temps postérieurs puissent seuls recevoir la bénédiction de sa vie cachée en Dieu, humble et méprisée du monde, mais dans la réalité infiniment riche et féconde. Combien sont admirables les voies de Dieu et combien différentes des voies du monde et des moyens qu’il emploie ! Pendant que celui-ci mettait au service du prince des ténèbres tout son pouvoir, toutes ses grandeurs, tous ses artifices afin de renverser l’Église, le Dieu tout-puissant appelait une timide bergère, accablée de douleurs, à marcher contre les puissances ennemies dans l’humilité de la croix. Plus Anne Catherine s’avance sur le chemin que Dieu lui a tracé, plus ses souffrances deviennent grandes. Nous ne pourrions même pas supporter le spectacle de cette effrayante rigueur, si la bénédiction qui émane de la plus innocente et de la plus enfantine simplicité ne venait comme un souffle du paradis dorer l’océan de douleurs à travers lequel cette pauvre vie doit se frayer passage pour conquérir la palme de la victoire.
XIV
SES MALADIES ET SES SOUFFRANCES CORPORELLES.
1. « Je m’étais donnée tout entière à mon fiancé céleste et il faisait de moi ce qu’il voulait. Pouvoir souffrir en repos m’a toujours paru l’état le plus digne d’envie sur la terre, mais je n’y suis jamais arrivée. » Dans ces mots, Anne Catherine avait résumé le mystère de toute sa vie, soit dans le couvent, soit après sa suppression. Les souffrances ne lui firent jamais défaut : elle les acceptait avec reconnaissance de la main de Dieu comme un don toujours bienvenu : mais jamais le repos dans la souffrance, jamais une vie cachée, tranquille, dérobée aux regards des hommes ne put être son partage, parce qu’elle devait arriver à une pleine conformité avec son fiancé, lequel a voulu accomplir sa Passion parmi des contradictions incessantes et au milieu de tribulations extérieures et de persécutions continuelles. Toutes les douleurs et les maladies dont elle fut assaillie dès son enfance avaient une profonde signification spirituelle : car ou elle avait demandé qu’elles fussent transférées d’autrui sur elle, afin de les souffrir en tout ou en partie à la place du prochain, ou bien elle les avait reçues de Dieu pour l’expiation de fautes qui lui étaient étrangères. Mais depuis qu’elle avait reçu le sacrement de confirmation et surtout depuis sa profession religieuse, cette souffrance pour autrui prit un caractère toujours plus élevé et une plus grande extension, en ce sens que les maladies du corps de l’Église, c’est-à-dire les prévarications spirituelles et les fautes commises par des paroisses et par des diocèses tout entiers, les contraventions et les négligences des supérieurs ecclésiastiques, l’état déplorable où se trouvaient des classes entières, lui étaient imputés pour qu’elle en portât le poids et les expiât par les maladies et les souffrances les plus diverses et les plus multipliées. Ses douleurs et ses infirmités étaient donc les résultats spirituels, traduits sous forme de maladies corporelles, qu’entraînait après soi pour le troupeau de Jésus-Christ la culpabilité des divers membres de l’Église. En cela elle marchait sur les traces de la bienheureuse Lidwine de Schiedam, laquelle, avec la merveilleuse Christine (Christina mirabilis) de Saint-Trond, est peut-être le plus admirable instrument d’expiation dont Dieu se soit jamais servi en faveur de son Église. Un coup d’œil sur sa vie, écrite par un contemporain, le frère Jean Brugmann, provincial des frères mineurs en Hollande, mort en odeur de sainteté, d’après les communications du confesseur de la sainte, Walter de Leyden, de son commensal Jean Gerlach, et même, d’après les témoignages officiels du bourgmestre et du conseil de la ville de Schiedam, puis rédigée de nouveau après lui par le bienheureux Thomas a Kempis 6, nous rendra plus facile de mieux comprendre la tâche d’Anne Catherine.
2. Lidwine, fille d’un pauvre veilleur de nuit de la ville hollandaise de Schiedam, sur la Meuse, naquit quelques semaines avant la mort de sainte Catherine de Sienne. Elle fut, dès sa plus tendre enfance, mise, par une faveur spéciale, sous la conduite de la Mère de Dieu, afin de pouvoir prendre et continuer la tâche de souffrir pour l’Église qui lui était laissée par Catherine de Sienne. Catherine avait été suscitée de Dieu au milieu du XIVe siècle, comme sainte Hildegarde au commencement du XIIe, pour venir en aide à la chrétienté, à la façon des saints Prophètes. La vie de cette vierge privilégiée n’eut qu’une durée de trente-trois ans : car son cœur fendu en deux par la force de l’amour divin ne put pas supporter longtemps la malheureuse division que causa dans l’Église la création d’un antipape opposé à Urbain VI. Deux ans avant sa mort, le schisme avait éclaté, et Catherine n’avait épargné aucun sacrifice afin de lutter et de souffrir pour la restauration de l’unité : elle avait même demandé à Dieu que, pendant les trois derniers mois de sa vie (depuis le 19 janvier 1380, dimanche de la Sexagésime, jusqu’au 30 avril, cinquième dimanche après Pâques), la rage de l’enfer tout entier déchaînée contre le chef légitime de l’Église fût détournée sur sa personne, et qu’elle eût à livrer combat aux cohortes infernales, comme autrefois sainte Hildegarde qui, pendant trois années consécutives, avait ainsi combattu pour l’Église. Alors le Seigneur rappela à lui sa servante : car le dimanche des Rameaux de cette année 1380 était née dans la lointaine Hollande l’héritière de ses souffrances et de ses combats. Lidwine souffrit de la pierre dès le berceau, toutefois elle fut de bonne heure si forte et si bien faite qu’à l’âge de douze ans elle fut demandée en mariage. Mais elle s’était depuis longtemps consacrée à Dieu par le vœu de virginité et, pour se délivrer des prétendants, elle demanda à Dieu de lui enlever sa beauté. Sa prière fut exaucée : car dans sa quinzième année, elle fut attaquée d’une maladie dont elle guérit, mais qui la laissa tellement défigurée qu’elle ne fut plus recherchée par les hommes. Or, Dieu avait préparé son corps pour être un vase de souffrances sur lequel il commença à mettre toutes les misères dont l’Église d’alors était affligée. Le choc d’une de ses compagnes qui, en patinant, vint la heurter avec une grande impétuosité, la jeta sur un tas de glaçons et elle se brisa une des petites côtes du côté droit. À la suite de cette fracture, il se forma à l’intérieur un abcès qui résista à tous les remèdes et lui causa des douleurs indicibles. Un an après cette chute, le père de la jeune malade se trouvant près de son lit pour la consoler, celle-ci, dans un paroxysme de douleur, se jeta dans ses bras. La commotion causée par ce mouvement précipité fit crever l’abcès à l’intérieur, et elle faillit mourir, étouffée par l’abondance du sang qui sortait avec violence de sa bouche et de son nez. Son état empira bientôt de plus en plus. La suppuration de l’abcès à l’intérieur la rendit incapable de prendre aucune nourriture : si elle essayait de vaincre sa répugnance pour les aliments, son estomac ne pouvait pas les garder. Elle était souvent tourmentée d’une soif intolérable ; elle se traînait alors hors de sa couche pour boire de l’eau ; mais elle la vomissait aussitôt. Il n’y avait aucun moyen de lui procurer le moindre soulagement. En outre, plusieurs années s’écoulèrent, pendant lesquelles l’infortunée fut privée de tout secours et de toute direction spirituelle. Une fois l’an seulement, au temps de Pâques, on la portait à l’église, pour recevoir la sainte communion : mais, tout le reste du temps, elle était abandonnée à elle-même. Dieu, lui aussi, semblait la livrer à sa propre faiblesse et à toute la violence de ses souffrances inouïes sans lui donner de consolation ni d’assistance extraordinaire : car bien souvent elle jugeait impossible de rester dans un état aussi désespéré. La maladie ne pouvait détruire si subitement en elle toute l’énergie et la vie de la jeunesse qu’elle ne fût souvent prise d’un vif désir de guérir et accablée d’un chagrin qui se renouvelait toujours quand elle entendait ses jeunes compagnes passer joyeuses, en chantant et en riant, devant l’ouverture de son petit logement au rez-de-chaussée qui ressemblait à une cave. Elle avait bonne volonté de servir Dieu et de renoncer au monde, mais elle n’avait jamais pensé à une telle misère et à une souffrance accompagnée d’un si grand dégoût. Ainsi s’écoulèrent trois ou quatre années, jusqu’à ce qu’enfin il lui fut donné, dans la personne de Jean Pot, un confesseur et un guide qui lui apprit à pratiquer l’oraison intérieure et à acquérir dans la méditation de la douloureuse Passion de Notre-Seigneur la force d’âme nécessaire pour supporter ses peines avec résignation. Elle suivit autant qu’elle le put ses instructions, mais elle ne reçut d’assistance pour le délaissement de son âme privée de toute consolation que le jour où, recevant la sainte communion, le don des larmes lui fut accordé. Elle resta quatorze jours entiers sans pouvoir arrêter le torrent de pleurs qu’elle versait sur son impatience et sa lâcheté, et alors aussi la consolation et l’onction entrèrent dans son cœur. Elle fit bientôt tant de progrès dans l’oraison qu’elle divisa la méditation de la douloureuse Passion suivant les sept heures canoniques de la journée, et, comme elle était privée de sommeil, elle pratiqua, jour et nuit, cet exercice avec une telle fidélité, qu’on pouvait l’y croire appelée par un avertissement intérieur comme par le son d’une horloge marquant les heures. Dans la huitième année de sa maladie, elle en vint à dire : « Ce n’est pas moi qui souffre, c’est mon Seigneur Jésus qui souffre en moi » ; et, ne trouvant pas suffisantes ses immenses souffrances, elle en demandait toujours de nouvelles, s’offrant à Dieu sans relâche comme victime expiatoire des péchés d’autrui. Ainsi elle demanda une fois, le dimanche de la Quinquagésime, une souffrance particulière pour expiation des péchés commis pendant le temps du carnaval, sur quoi elle ressentit, jusqu’au jour de Pâques, de telles douleurs dans les os qu’elle n’osa plus importuner Dieu de semblables prières. Elle s’offrit de même à Dieu comme victime pour détourner de Schiedam le fléau de la peste, et il lui vint deux bubons pestilentiels à la gorge et sous la poitrine. Elle pria alors pour être gratifiée d’un troisième en l’honneur de la très sainte Trinité et aussitôt il s’en montra un nouveau au genou.
3. Bientôt toute la dislocation et la dévastation du corps de l’Église furent transportées sur elle. Le triple ravage que la licence de l’esprit, la débauche et l’hérésie faisaient dans l’Église au temps du grand schisme fut produit en elle par des vers innombrables de couleur verdâtre qui, prenant naissance dans la colonne dorsale, attaquaient les reins et dévoraient, du dedans au dehors, la partie inférieure du corps, où ils avaient pratiqué trois grandes ouvertures rondes ; en sorte que chaque jour on pouvait voir par là cent ou même deux cents de ces rongeurs, longs d’environ un pouce. Pour se préserver de leurs morsures, Lidwine était obligée de les nourrir avec une mixture de miel et de farine de froment ou avec de la graisse de chapon dont on frottait un linge placé sur les ouvertures. S’ils manquaient de cet appât, que la pauvre malade était obligée de demander, à titre d’aumône, à des étrangers, ou si la mixture n’était pas parfaitement fraîche, ils s’attaquaient à son corps martyrisé. Comme l’incrédulité et l’hérésie ont leurs racines dans les péchés contre le sixième commandement et dans l’orgueil de l’esprit qui ne dégrade pas moins l’homme, ce triple mal devait être expié par Lidwine d’une manière analogue à sa nature par la pourriture et par des vers à la morsure venimeuse.
Les autres parties intérieures du corps furent ou détruites par la malignité de l’abcès purulent, ou enlevées par le médecin de la duchesse Marguerite de Hollande et enfouies dans la terre suivant le désir de Lidwine. Dans la cavité de l’abdomen on plaça un petit paquet de laine. Les douleurs de la pierre restaient les mêmes malgré la décomposition et arrivaient souvent à une telle intensité que Lidwine perdait la connaissance et la parole. Cette souffrance avait pour cause les abominations du concubinage des gens d’Église. Les reins et le foie s’en allèrent par petits morceaux ; il se forma aux mamelles des tumeurs purulentes : car, à cette époque désordonnée, des multitudes d’enfants étaient privées du lait de la pure doctrine et ne recevaient à sa place que des scandales. Quant aux contestations des théologiens et des canonistes qui, au lieu de procurer à la chrétienté une saine nourriture, ne faisaient qu’augmenter le mal et la discorde, Lidwine en faisait pénitence par des maux de dents qui, assez souvent, se prolongeaient, pendant des semaines et même des mois entiers, avec une telle violence qu’elle craignait d’en perdre la raison. Les frissons fébriles qui ébranlaient le corps de l’Église dans les conciles se faisaient sentir à elle dans une fièvre tierce incessante qui tantôt desséchait ses os par une ardeur dévorante, tantôt les ébranlait par les frissons d’un froid inexprimable.
De même enfin que la chrétienté fut divisée pendant quarante ans entre des papes et des antipapes, de même aussi le corps de Lidwine fut séparé en deux moitiés, en sorte qu’il fallut assujettir les deux épaules avec des bandages, pour qu’elles ne tombassent pas chacune de son côté. Le front aussi était fendu verticalement jusqu’au milieu du nez, et il en était de même des lèvres et du menton : le sang jaillissait par ces fentes et souvent la mettait dans l’impossibilité de parler.
Comme l’œil du pasteur suprême ne pouvait plus veiller sur tout le troupeau du Christ, Lidwine avait perdu l’usage de l’œil droit, et son œil gauche ne pouvait supporter ni la clarté du jour ni la lumière de la lampe. Et, parce que le feu de la révolte paralysait les droits du pasteur suprême à commander à tous et à porter la houlette pastorale devant tout le troupeau du Christ, le bras droit de Lidwine était tellement brûlé par le feu Saint-Antoine que les nerfs posaient sur l’os dépouillé comme les cordes d’une guitare et que le bras ne tenait plus au reste du corps que par un tendon.
Elle ne pouvait remuer que la main gauche et la tête ; à cela près, elle était couchée sur le dos dans un état d’immobilité complète et pendant sept ans de suite on n’osa pas la changer de place, parce qu’il était à craindre que son pauvre corps ne tombât en morceaux. Privé de sommeil et de nourriture qui pussent y entretenir la vie végétative, ce corps était semblable à un arbre vermoulu, ne tirant plus sa verdure que de l’écorce, et pourtant il en sortait journellement par la bouche, les yeux, le nez, les oreilles et toutes les autres ouvertures une telle quantité de sang et d’autres liquides que deux hommes n’auraient pas suffi pour emporter ce qui en découlait pendant un mois. Lidwine savait d’où lui était fourni cet abondant supplément à la sève vitale qui avait disparu en elle comme dans le cep de vigne quand ses pousses sont taillées au printemps. Un jour que quelques personnes lui demandaient dans leur étonnement d’où venait en elle cette abondance de liquide, elle répondit : « Dites-moi d’où la vigne tire sa riche sève qui en hiver aussi paraît desséchée et tarie ? » Elle se sentait comme une branche vivante du véritable cep de vigne qui communique si abondamment à tous la plénitude de la bénédiction qu’elle coule à flots jusqu’à terre quand les branches obstruées refusent de lui livrer passage. Cette déperdition du sang de la vigne de l’Église, Lidwine avait à l’expier par le sang qui coulait de toutes les ouvertures de son corps, lequel, pour ne pas se dessécher, avait besoin d’une réparation surnaturelle qu’il recevait journellement. C’est pourquoi aussi, en dépit de la pourriture et des vers, le vase merveilleux de ce corps ne répandait qu’une odeur suave : c’était une victime si agréable aux yeux de Dieu qu’il lui imprima le sceau de ses sacrés stigmates.
4. Pendant plus de trente-trois ans, les contemporains de Lidwine eurent sous les yeux le spectacle de ces souffrances qui étaient en contradiction complète avec l’ordre accoutumé de la nature et avec l’expérience commune et qui ne laissaient à la clairvoyance humaine aucune possibilité d’explication naturelle ; aussi, dès lors, les témoins oculaires accablaient la patiente de questions comme celles-ci : « Comment peux-tu vivre, après avoir rendu le poumon et le foie avec tous les intestins, et étant presque entièrement rongée par les vers. » Et elle répondait humblement : « Dieu et ma conscience me sont témoins que j’ai perdu pièce à pièce ce que Dieu m’avait donné selon la nature. On doit comprendre qu’il m’a été difficile de supporter cette perte : mais Dieu seul sait ce qu’il a fait en moi dans la plénitude de sa toute-puissance pour remplacer ce qui est perdu. »
La fidèle fiancée ne voulait pas trahir le secret du Roi des rois que celui-ci s’était réservé pour confondre la science humaine, afin de ne le révéler qu’en ce jour où ses élus triompheront avec lui et verront en lui comment c’est lui qui accomplit tout en toutes choses. Le pieux biographe de Lidwine, François Brugman, facilite l’intelligence de ces faits inexplicables lorsqu’il dit que le Seigneur de l’Église, en conservant par un miracle de sa toute-puissance et de sa sagesse le corps en ruines de sa fiancée, voulait manifester à tous les temps ce qu’il lui faut opérer et accomplir chaque jour pour conserver jusqu’à la fin du monde la grâce de la rédemption à ces hommes qui ne cessent de maltraiter et de persécuter son Église, sa foi et ses mystères, de même que les vers, la décomposition, les accès de fièvre et tant d’autres supplices travaillaient à détruire le corps de Lidwine.
Mais, afin qu’il fût indubitable pour tous que c’étaient bien les plaies et les douleurs de l’Église dont souffrait Lidwine, avant qu’elle mourût, Dieu la lit refleurir, pour ainsi dire, et rétablit son corps dans sa parfaite intégrité. La chrétienté ayant retrouvé un chef, la tâche de Lidwine était accomplie et Dieu lui rendit ce qu’elle lui avait sacrifié dans l’intérêt de son Église.
5. Pendant que son horrible état de souffrance durait encore, on put savoir d’où provenaient les secours et les dons extraordinaires au moyen desquels la vie se prolongeait dans un corps auquel faisait défaut tout ce qui est indispensable pour subsister selon les lois ordinaires de la nature. Lidwine, en plusieurs occasions, fit allusion à une nourriture et à une onction reçues par des voies surnaturelles. Voici ce que rapporte son biographe : « La curiosité poussa beaucoup de personnes à visiter la pieuse vierge. Les uns venaient avec bonne intention, d’autres pour condamner et blasphémer. Certainement les uns et les autres ne voyaient qu’une image de la mort, mais ceux-là voyaient dans le vase brisé le baume de la sanctification, dans le portrait défiguré le Seigneur avec son admirable beauté, et dans l’image de la mort, ils honoraient le Créateur de la vie, le plus aimable des enfants des hommes. Si quelqu’un dans son étonnement demandait à Lidwine comment la fièvre pouvait trouver encore à se nourrir dans son corps, puisqu’elle-même vivait sans prendre aucune espèce d’aliment, elle répondait : « Vous vous étonnez que la fièvre trouve en moi tant de nourriture, et moi je m’étonne bien plus de ne pas devenir en un mois plus grosse qu’un tonneau. Vous jugez seulement d’après la croix que vous voyez extérieurement en moi : mais vous ne comprenez pas l’onction qui s’y joint, parce que vous ne pouvez pas voir ce qui est caché au dedans. » Et quand des prêtres ou des religieux lui exprimaient leur surprise de ce qu’elle vivait encore dans cet état de destruction inouï et lui disaient : « Tu ne pourrais pas rester en vie si Dieu dans sa miséricorde ne te conservait pas ses dons », elle répondait : « Oui, je dois l’avouer en toute simplicité, je reçois, sans l’avoir méritée, une onction que le Dieu de miséricorde répand sur moi de temps en temps. Pauvre chienne que je suis, je ne pourrais pas continuer à vivre dans un corps si délabré si les miettes du pain de mon Seigneur ne tombaient pas pour moi de sa table ; mais il ne sied pas à une vile et misérable chienne de dire quelle espèce de bouchées elle reçoit. » De même, quand des femmes indiscrètes la tourmentaient de questions pour savoir si vraiment elle ne prenait plus aucune nourriture, chose qui leur paraissait impossible et par conséquent incroyable, elle répondait avec douceur : « Si vous trouvez cela incroyable, cela ne fait pas certainement que vous soyez des incrédules, mais pourtant ne méprisez pas les opérations de Dieu qui a aussi soutenu dans les déserts Marie Madeleine et Marie Égyptienne. Il ne s’agit pas ici de ce que vous pensez de moi, seulement ne dérobez pas à Dieu sa gloire. »
6. Il ressort de beaucoup de faits que Lidwine n’entendait pas seulement parler de l’onction spirituelle communiquée par les dons et les consolations de l’Esprit-Saint, mais aussi des dons et des remèdes qui lui venaient du Paradis terrestre et qui fortifiaient et vivifiaient son corps martyrisé de manière à ce qu’il pût résister aux vers et à la décomposition. Suivant la doctrine des Pères, le Paradis s’est conservé jusqu’à présent dans la beauté inaltérée du premier jour de sa création et il n’a pas été atteint par le déluge. C’est là qu’ont été transportés Hénoch et Élie qui vivent encore dans la chair pour reparaître sur la terre au temps de l’Antéchrist et prêcher aux Juifs la parole du salut : « Hénoch et Élie, dit aussi sainte Hildegarde dans un de ses écrits, sont dans le Paradis parce que là ils n’ont pas besoin de nourriture ni de boisson terrestre. De même une personne ravie jusqu’à la contemplation des merveilles de Dieu, aussi longtemps qu’elle demeure dans cet état, n’a aucun besoin des choses dont les mortels font usage ici-bas 7. » Le Paradis n’a pas été créé pour les anges qui sont de purs esprits sans corps, mais pour la nature humaine, composée d’esprit et de corps, en sorte qu’on y trouve tout ce qui est nécessaire à la vie corporelle de l’homme pour rester inaccessible à la douleur, au mal physique et à la dissolution, ou pour conserver le privilège de l’impassibilité et de l’immortalité que Dieu lui avait octroyé à cause de sa sainteté originelle. Toutes les créatures de ce séjour magnifique, y compris les plantes et les arbres, appartiennent, il est vrai, à un ordre transcendant et sont aussi supérieures aux produits de la terre, frappée de malédiction à cause du péché du premier homme, que le corps du premier homme pur, sans péché, spiritualisé, entouré de lumière, l’était au corps de l’homme déchu : mais, de même que ce beau corps d’Adam avant la chute, ce corps impassible et immortel était vraiment et réellement un corps et non un pur esprit, de même aussi le Paradis avec les créatures qui s’y trouvent n’est pas un lieu céleste ou purement spirituel, mais un lieu matériel, apparenté, pour ainsi dire, à la nature humaine et qui n’est pas sans liens et sans relations avec elle, non plus qu’avec la terre elle-même. Le rapport dans lequel le Paradis se trouve avec la terre est indiqué clairement par les saintes Écritures, et la manne tombant comme une pluie dans le désert a révélé à l’ancienne Église quelle nourriture y est préparée pour l’homme pèlerin sur la terre. Sainte Hildegarde s’exprime ainsi à ce sujet dans l’écrit intitulé Scivias, (L. I. visio 11) : « Lorsqu’Adam et Ève eurent été chassés du Paradis, une lumière éblouissante entoura cette région. Comme leur transgression les avait forcés de quitter le séjour de la béatitude, la puissance divine y effaça toute trace de leur souillure et fortifia si bien ce lieu par sa lumière que désormais aucune attaque de l’ennemi ne peut l’atteindre. Mais Dieu voulut aussi montrer par là que la transgression qui avait eu lieu dans le Paradis devait en son temps être effacée par sa miséricordieuse bonté. Et maintenant encore le Paradis subsiste comme un lieu de béatitude qui s’épanouit pour la récréation des esprits bienheureux avec ses fleurs et ses plantes dans leur fraîcheur première, ses aromates, ses parfums suaves et ses beautés sans nombre. Le Paradis donne à la terre stérile une abondante fécondité ; de même que l’âme communique au corps les forces vitales, de même c’est du Paradis que la terre reçoit sa force vitale suprême, car il n’a pas cessé d’exercer son action malgré l’obscurcissement et la corruption qui ont été la suite du péché. »
Or, en ce qui touche les hommes, la liaison spirituelle avec le Paradis a pour intermédiaire la grâce de la Rédemption qui non seulement a rendu à la race humaine déchue le don le plus élevé que possédât Adam dans le Paradis, mais encore lui a conféré une dignité supérieure, une plus grande beauté, une plus haute valeur qui émanent pour elle de la valeur infinie du sang de Jésus-Christ. Ce don, qui est la sainte innocence baptismale, a pour effet qu’à toutes les époques Dieu confère à quelques âmes choisies plusieurs des privilèges et des distinctions qu’Adam avait reçus en vertu de sa sainteté originelle, mais que sa chute lui avait fait perdre : tous les baptisés reçoivent même avec le caractère du baptême un certain droit à ces dons extraordinaires, tant qu’ils ne ternissent pas leur innocence qui est au-dessus de l’innocence du Paradis. Aussi sainte Hildegarde écrit-elle au chapitre de Mayence : « Il a plu à Dieu qui, par la lumière de la vérité, conserve les âmes de ses élus pour l’ancienne béatitude, de renouveler à diverses époques les cœurs de beaucoup d’entre eux par l’infusion de l’esprit de prophétie, en sorte qu’ils puissent par sa lumière intérieure recouvrer en grande partie ce qui avait été perdu de cette béatitude qu’Adam avait possédée avant le châtiment de sa désobéissance. »
7. Il y a donc moins lieu de s’étonner qu’outre les faveurs spirituelles, les remèdes physiques du Paradis deviennent aussi le partage des favoris de Dieu comme récompense terrestre de leur fidélité, parce que ces dons doivent être mérités par des souffrances et des privations que Dieu regarde comme dignes d’une récompense éternelle, par conséquent incomparablement supérieure à ce que peuvent donner de jouissance ou de soulagement les objets créés du Paradis. Les voies qui conduisent dans le Paradis l’homme vivant encore dans la chair, ou par lesquelles les dons du Paradis arrivent à lui, sont la douleur et le renoncement, la victoire sur soi-même, les œuvres de mortification et de pénitence qu’opèrent par l’impulsion du Saint-Esprit des âmes pures et innocentes, revêtues de la splendeur de la grâce baptismale que rien n’a encore ternie. Mais les chemins qui mènent à ces hauteurs ne s’ouvrent pour elles que quand elles ont fermé pour leur corps toutes les voies terrestres par lesquelles lui arrivait ce qui, d’après sa nature, est la condition nécessaire de son existence sur la terre, et quand ce corps, dans le feu des souffrances supportées pour Dieu, s’est spiritualisé au point d’être un instrument parfaitement docile pour l’âme embrasée des flammes de l’amour. Ce n’est donc pas par l’effet d’une faculté naturelle extraordinaire, encore moins par celui d’une forme de maladie inusitée ou d’un dérangement dans l’équilibre entre les fonctions du corps et celles de l’âme, mais seulement par le mérite d’une pureté plus qu’ordinaire et d’une force d’âme héroïque, qu’il est donné à l’homme résidant sur la terre d’avoir accès dans le Paradis.
De même que, devant Dieu, la récompense et le châtiment se règlent selon la nature ou selon la valeur et l’importance essentielle des actes méritoires ou coupables, de même pour chaque mal, chaque douleur, chaque renoncement, chaque privation supportée sur la terre, fleurit dans l’enceinte du Paradis le produit naturel correspondant qui, sous forme de fleur, de fruit, d’aliment, de boisson, de parfum, de consolation, de soulagement, est communiqué aux favoris de Dieu selon leur besoin, non d’une manière purement spirituelle mais réellement et matériellement ; c’est par là que se répare chez eux la vie corporelle qui sans cela s’épuiserait promptement. Ainsi Lidwine rapportait 8 qu’une fois une femme, vertueuse d’ailleurs, mais atteinte d’une mélancolie qui la réduisait presqu’au désespoir, vint implorer son secours. Lidwine l’accueillit avec une grande compassion, l’encouragea par des paroles affectueuses et lui promit sa guérison. Quelques jours plus tard, elle obtint pour cette pauvre femme la grâce d’être admise avec elle dans le Paradis. Cependant, malgré les merveilles qui s’offrirent là à leur vue, elle ne cessait pas de se lamenter et de désespérer. Alors Lidwine la conduisit à un endroit du Paradis qui semblait être pour le monde entier comme la source et le trésor des parfums, des aromates salutaires et des vertus curatives. Ce fut là que la malade trouva sa guérison. Elle fut tellement réconfortée, qu’étant revenue à elle, elle fut plusieurs jours sans pouvoir supporter même l’odeur d’un aliment, et resta depuis lors si docile aux paroles et aux exhortations de Lidwine que sa mélancolie disparut entièrement.
8. Dans la vie de sainte Colette 9, contemporaine de la bienheureuse Lidwine, il est raconté que pendant toute la durée du carême, elle avait coutume de ne prendre aucune nourriture, si ce n’est tout au plus quelques petites bouchées de pain. Il arriva une fois qu’à Pâques, Dieu lui envoya du Paradis un oiseau semblable à un poulet dont un œuf, mangé par elle, la rassasia si complètement, que pendant longtemps elle ne put plus rien prendre. En outre, comme il lui fallait une récréation dans les grandes souffrances que lui occasionnait l’entreprise formée par elle de renouveler l’ordre de Sainte-Claire, il lui vint du Paradis, comme récompense de son incomparable pureté, un charmant petit animal, d’une blancheur éblouissante, qui était très familier avec elle, et qui, à certains moments, se montrait devant la porte ou la fenêtre de sa cellule et demandait à entrer, puis disparaissait au bout de quelque temps. Il excita au plus haut degré la curiosité et l’intérêt des autres religieuses ; mais, malgré tous leurs efforts, elles ne parvinrent jamais à le saisir ; car, si elles le rencontraient auprès de Colette dans sa cellule ou dans d’autres endroits du monastère, il disparaissait avant qu’elles pussent mettre la main dessus 10. Comme Colette, pénétrée de la plus profonde vénération pour les reliques des saints et avant tout pour la sainte Croix sur laquelle est mort le Fils de Dieu, désirait ardemment d’avoir une parcelle de cette croix, elle reçut du Paradis une petite croix d’or qui n’était pas l’œuvre de la main des hommes, mais un produit naturel et où était incluse une parcelle de la vraie croix. Colette depuis lors la porta toujours sur elle. Elle avait reçu de la même manière, au commencement de sa mission, une ceinture d’une blancheur éclatante qui tomba d’en haut sur ses bras pendant qu’elle conférait avec son confesseur sur les premiers pas à faire dans la grande entreprise qui était l’objet de toutes ses sollicitudes.
9. Lidwine reconnaissait souvent, suivant le témoignage de ses biographes, que, sans le secours des consolations divines qui la soutenaient sur le chemin comme un bâton de voyage, elle aurait succombé à ses immenses souffrances. Elle avouait que la force nécessaire pour y résister lui était communiquée dans les ravissements qui, chaque jour, la transportaient durant une heure et même davantage, soit dans le ciel, c’est-à-dire dans le séjour des bienheureux, soit dans le Paradis terrestre, où elle ressentait des impressions dont la suavité lui rendait supportable et même pleine de douceur l’amertume la plus amère. C’était ordinairement son ange gardien, dont la présence visible la récréait constamment, qui la transportait dans le Paradis. Le plus souvent, il la conduisait d’abord dans l’église de Schiedam devant une image de la Mère de Dieu, et, après une courte prière, il la guidait du côté de l’orient dans le vol rapide qui l’élevait au-dessus de la terre vers la région du Paradis. La première fois que Lidwine fut conduite par lui à la porte du Paradis, elle n’osait pas entrer par suite de la frayeur respectueuse qu’elle éprouvait, et l’ange eut à rassurer la timide enfant sur la crainte où elle était que son pied n’endommageât l’épais tapis de fleurs qui s’étendait devant elle, aussi loin que sa vue pouvait atteindre. Il fallut que son conducteur marchât en avant, la tirant après lui par la main. Si quelquefois elle s’arrêtait, surprise et hésitante, parce qu’il lui semblait que la hauteur et l’épaisseur des massifs de fleurs lui fermaient le passage, elle se trouvait aussitôt transportée au-delà par l’ange.
Ces campagnes revêtues d’une merveilleuse lumière et où l’on n’a à souffrir ni du froid, ni de la chaleur, étaient d’une telle beauté qu’elle était impuissante à la décrire. Elle mangeait des fruits que l’ange lui présentait et respirait leur parfum. Reconduite ensuite par l’ange dans sa demeure, elle était parfois tellement entourée de la splendeur et de l’odeur du Paradis que ses commensales, pleines d’une crainte respectueuse, n’osaient pas s’approcher d’elle : car ce corps infirme était rayonnant, et des senteurs d’une suavité inexprimable, auxquelles aucune odeur de fleurs terrestres ne pouvait être comparée, en sortaient avec une telle force qu’il en résultait pour les visiteurs une sensation semblable à celle que produisent sur la langue des épices très piquantes. La lumière qui l’entourait était quelquefois si vive qu’un jour le neveu de Lidwine s’enfuit, la croyant au milieu des flammes. La bonne odeur s’exhalait surtout de sa main par laquelle l’ange avait coutume de la prendre.
10. Lidwine avait près d’elle une tige de chanvre desséchée, qui était à la fois assez légère et assez forte pour qu’elle pût s’en servir de la main gauche, ce qui lui permettait d’ouvrir le rideau suspendu devant sa couche et de soulager ainsi l’ardeur de sa fièvre par l’introduction d’un air plus frais. Ce bâton s’étant perdu par la faute d’autrui, à l’occasion d’un incendie qui avait éclaté à Schiedam, elle se trouva, pendant la nuit du 22 au 23 juillet 1428, dans l’impossibilité de se procurer un peu d’air frais, et il n’y avait là personne qui pût l’aider à se donner ce soulagement nécessaire. Mais l’ange lui promit son assistance et, bientôt après, elle le sentit poser doucement, en travers de la couverture du lit, un bâton de bois de la longueur d’une aune. Elle essaya de le prendre, mais sa main se trouva trop faible pour le soulever, et elle dit en plaisantant : « Maintenant me voilà bien pourvue en fait de bâton. » Le lendemain matin, elle pria son confesseur de faire amincir ce morceau de bois ; mais il fut à peine possible, avec un fer tranchant, d’enlever quelques rognures, lesquelles répandaient une odeur si délicieuse que le confesseur n’osa pas entamer de nouveau un bois si précieux. Il rapporta le bâton à Lidwine qui ne sut rien lui dire, sinon qu’elle croyait le tenir d’un ange. Le 8 août, fête de saint Cyriaque, Lidwine ayant été de nouveau ravie par l’ange dans le Paradis, il la conduisit près d’un cèdre qui s’élevait à l’entrée du jardin et lui montra la branche dont il avait détaché le rameau pour elle : il lui reprocha aussi de n’avoir pas assez honoré ce précieux cadeau qui avait la vertu de chasser les mauvais esprits du corps des possédés. Lidwine demeura longtemps en possession de ce rameau qui ne perdit sa bonne odeur qu’au contact d’une main souillée par le péché. Dans une visite postérieure faite au Paradis le 6 décembre de la même année, l’aliment qui devait la réconforter lui fut fourni par un dattier chargé d’une multitude de fruits magnifiques dont les noyaux lui semblaient briller à l’intérieur comme des cristaux. Quant aux autres présents que Lidwine rapporta du Paradis sur son pauvre lit de douleur, nous ne mentionnerons plus que le suivant :
11. Lidwine ayant été un jour ravie jusqu’aux chœurs des bienheureux, la très sainte Vierge lui adressa ces paroles pleines de bonté : « Pourquoi, mon enfant, n’es-tu pas entrée dans les rangs de cette troupe resplendissante avec une parure sur la tête ? » À quoi elle répondit dans sa simplicité : « Je suis venue ici telle que mon conducteur auquel je dois obéir m’a amenée. » Alors elle reçut de Marie une couronne qu’elle devait garder pendant sept heures et donner ensuite à son confesseur pour qu’il la suspendît à l’autel de la Mère de Dieu, dans l’église de Schiedam, où elle devait plus tard être reprise. Lidwine, revenue à l’état de veille naturel, se souvint bien de ce qui lui avait été dit, mais elle n’osa pas le prendre au pied de la lettre, jusqu’à ce qu’elle sentît qu’elle portait réellement sur la tête une couronne de fleurs d’une odeur délicieuse. Avant la fin du délai indiqué, elle fit prier son confesseur de venir la trouver au point du jour et lui donna la couronne qui fut suspendue, suivant sa demande, à l’autel de la Vierge d’où elle disparut avant le jour. »
12. Après cette digression plus apparente que réelle, revenons à Anne Catherine. Nous savons que son état de souffrance avait la même nature et la même signification que celui de Lidwine. Outre des douleurs continuelles et singulièrement poignantes qui ne finirent qu’avec sa vie et qui avaient leur siège dans le cœur, il y avait en elle une succession perpétuelle de maladies très variées dans leurs formes et présentant souvent les symptômes les plus contradictoires ; car elle avait à supporter non seulement l’ensemble des souffrances de l’Église, mais encore les souffrances variables de ses membres pris individuellement. Il n’y avait pas dans tout son corps un seul point qui fût sain ou exempt de douleur, car elle avait tout donné à Dieu ; elle lui avait donné chacun de ses nerfs, chaque goutte de son sang, chaque souffle sortant de sa bouche, et Dieu avait accepté son offrande. Il l’avait placée dans un ordre de choses entièrement renversé, à le considérer humainement, où la force et la santé sont transformées en maladie et en souffrance et où la vie naturelle se consume dans la douleur comme une flamme. Son corps ressemblait à un vase posé sur un brasier et dans lequel le médecin céleste préparait des remèdes pour son troupeau, non pas selon l’art et la méthode terrestres, mais selon la loi de l’amour et de la justice éternelles. En outre les puissances de son âme et ses facultés spirituelles sont incessamment ouvertes à toutes les impressions douloureuses dont l’âme est capable pendant son union avec le corps : la terreur, la tristesse, l’angoisse, le délaissement, la sécheresse, la désolation poussée jusqu’à la défaillance, toutes les souffrances et les blessures spirituelles dont les passions d’un homme peuvent être la cause pour un autre ou que peut préparer aux âmes la malice et la perversité du démon, viennent l’assaillir. Le sentiment accablant du compte à rendre à Dieu et les terreurs des mourants, les angoisses de l’agonie des pauvres pécheurs dont l’âme est au moment de se séparer du corps et de paraître devant son juge, passent en elle : bien plus, elle doit prendre aussi sur elle la perversion du sens moral, les suites des passions telles que la colère, le désir de la vengeance, l’impatience, la gourmandise, la curiosité ; elle doit les combattre et les surmonter pour obtenir aux pécheurs la grâce de la conversion ou celle d’une bonne mort. Mais tout cela n’est rien auprès du martyre causé par l’amour qu’Anne Catherine porte à son fiancé céleste, à son Église et aux trésors de la grâce et de la miséricorde divines dont celle-ci est dépositaire : car elle voit et ressent, avec la douleur la plus poignante, l’abaissement et la dégradation incroyables que l’ennemi de tout bien prépare au sacerdoce contemporain. N’a-t-il pas réussi, en effet, à faire entrer dans les saints ordres bien des gens que l’incrédulité et l’affiliation aux sociétés secrètes ont mis à son service, et qui, plus tard, devenus les oints du Seigneur, ne reculeront pas devant le plus horrible des attentats, la guerre ouverte contre le chef invisible de l’Église et contre le représentant visible de Dieu sur la terre ? Elle voit qu’aucune attaque n’est dirigée par les pouvoirs ennemis contre l’Église, son droit divin, sa hiérarchie sacrée, son culte, sa doctrine et ses sacrements qui n’ait été inspirée par un Judas et à laquelle un Judas n’ait pris part comme agent pour quelques misérables pièces d’argent. Or, de même que le Sauveur ressentit plus douloureusement la trahison de son apôtre que tout le reste de ce qu’il eut à souffrir sur son chemin de la croix, de même les blessures les plus profondes et les plus cuisantes du corps de l’Église sont celles qui lui sont faites par un homme revêtu du caractère sacerdotal. Ce qui se faisait en dehors de l’Église, les attaques des hérétiques contre la vérité révélée et le mystère de la Rédemption, la négation impie de la très sainte Incarnation n’atteignaient pas Anne Catherine aussi directement ni aussi douloureusement que les attentats des prêtres déchus contre Dieu et contre son Église : car elle en voyait sortir de bien plus terribles conséquences que des tentatives des ennemis étrangers.
Si ses souffrances corporelles ne paraissent pas extérieurement aussi violentes et aussi affreuses que celles de Lidwine, elles ne sont pourtant pas moins profondes, moins déchirantes et moins continuelles. Il arrivait souvent qu’Anne Catherine était elle-même l’objet de sa contemplation et voyait son état de souffrance comme appartenant à une autre personne : alors, saisie d’une sympathie involontaire, elle s’écriait : « Je vois encore cette petite nonne dont le cœur est coupé en morceaux. Elle doit être de notre temps, mais elle a bien autrement à souffrir que moi : je ne dois donc plus me plaindre. »
13. Le siège et la source de ses souffrances pour l’Église étaient dans le cœur. De même que le sang part du cœur et y revient par une circulation non interrompue, ainsi les peines partant de son cœur se répandaient à travers tous les membres du corps et revenaient à leur point de départ comme pour y prendre de nouvelles forces afin de continuer leur circulation sans fin. Le cœur est le siège de l’amour divin ; c’est dans le cœur que le Saint-Esprit se répand et c’est là aussi qu’a sa racine le lien qui unit tous les membres de l’Église en un seul corps. Jamais époque n’avait autant parlé d’amour que celle-là, quoiqu’elle ne possédât plus ni amour ni foi et que toute vie réglée d’après les préceptes évangéliques et toute piété chrétienne semblassent au moment de s’y éteindre, parce que la pratique et la profession publique en étaient empêchées, parce que les veines où circule la vie étaient comprimées, et que toutes les voies par où pouvaient lui arriver l’impulsion et l’accroissement étaient obstruées. C’était le temps où la secte la plus malicieuse et la plus hypocrite qui ait jamais mordu l’Église au cœur, poussée et favorisée par les sociétés secrètes dont les chefs et les adeptes les plus zélés siégeaient jusque dans les conseils des princes ecclésiastiques, s’était répandue comme un torrent dévastateur sur la vigne de l’Église ; je veux parler du jansénisme avec ses prétendues lumières. C’était l’esprit impur de cette secte, si caractérisée par sa haine aveugle pour la très sainte Vierge et pour le souverain Pontife, qui cherchait à séparer successivement du centre, du cœur de l’Église, ses diverses parties et ses divers membres, cherchant à rendre la séparation incurable par l’introduction d’éléments hétérogènes ; qui, sous prétexte de « charité et de réformation », s’attaquait précisément à ces principes de foi, à ces pratiques de dévotion, à ces usages et à ces habitudes pieuses dont l’altération était pour lui le plus sûr moyen de porter des blessures mortelles à la vie chrétienne. Tout semblait réuni pour assurer une victoire complète à cette dangereuse persécution de la foi : car la hiérarchie extérieure de l’Église était brisée par les pouvoirs laïques, les biens ecclésiastiques étaient au pillage, les sièges des pasteurs restaient vides, les ordres religieux étaient détruits, le chef de l’Église entravé dans son action par les attaques de cet homme puissant qui devait plus tard le faire traîner en prison par ses satellites et qui fut souvent montré à Anne Catherine dans ses visions comme un oppresseur de l’Église.
« Un jour, disait-elle, que je priais devant le Saint-Sacrement pour le salut de l’Église, je fus transportée dans une grande église magnifiquement ornée. Je vis là le vicaire de Jésus-Christ, le Pape, sacrer comme roi un petit homme au teint jaune, à l’air sinistre. C’était une grande solennité, mais je fus prise d’inquiétude et de frayeur à cette vue et j’eus le sentiment que le Pape aurait dû s’y refuser avec plus de fermeté. Je vis alors quel mal cet homme devait faire au saint Père et quelle effrayante quantité de sang il devait faire verser. Quand je parlai à l’abbé Lambert de ce spectacle et de la terreur qu’il m’avait causée, il ne voulut voir là que des imaginations. Mais lorsqu’on apprit la nouvelle du sacre de Napoléon par Pie VII, l’abbé Lambert me dit : « Ma sœur 11, il faut prier et se taire. »
14. Tel était le temps où Anne Catherine portait le poids des souffrances de l’Église : on peut donc penser que son cœur avait été préparé à l’issue et au but de ces souffrances. Elles circulaient en elle, non comme un mal général ou comme une maladie vague répandue dans toutes les parties du corps, mais elles lui étaient imposées par Dieu suivant un certain ordre et à certains intervalles, comme des tâches bien délimitées qu’elle avait à accomplir complètement, de manière à ce que, l’une étant finie, elle en commençât aussitôt une autre. Chacune de ces tâches lui était montrée à part en vision sous des formes symboliques, afin que leur acceptation fût un acte méritoire de sa charité, et il lui arrivait journellement d’être appelée par le Seigneur à travailler à sa vigne, tandis que le père de famille de la parabole n’y envoie ses ouvriers qu’après d’assez longs intervalles de temps. Elle recevait l’assignation en vision, mais le travail lui-même devait être accompli sans déranger l’ordre et les relations de la vie extérieure. Dans la vision, Anne Catherine voyait et comprenait parfaitement la signification intime de ses souffrances et leur connexité avec la situation de l’Église : mais la vie de tous les jours se mettait souvent à la traverse et avec des contrastes si choquants que les incidents extérieurs lui paraissaient parfois plus difficiles à supporter que les souffrances spirituelles dont le poids pesait sur elle. Et pourtant les premiers étaient l’indispensable complément des autres ; ils étaient compris dans l’ensemble de sa tâche où Dieu lui tenait compte des plus petits détails et des choses les plus fortuites en apparence et les plus insignifiantes, en sorte que cette tâche ne pouvait compter comme menée à sa fin que lorsqu’elle s’était accomplie parmi les dérangements, les contradictions, les chagrins, les refus d’assistance, etc. C’était précisément par le support patient et par la lutte constante contre toutes les circonstances extérieures, par l’accomplissement consciencieux de toutes les obligations et de tous les devoirs que comportait sa situation ou que son entourage lui imposait, au milieu d’immenses souffrances intérieures, incompréhensibles et cachées pour les autres, que sa vertu devait se conserver ; c’était là proprement qu’était la source de ses mérites, le parfum qui s’exhalait de sa vie devant Dieu comme un encens d’agréable odeur. Toute son existence dans le cloître et jusqu’à sa mort resterait pour nous une énigme inexplicable ou un fait sans signification, si nous perdions de vue cette économie divine dans la conduite des âmes privilégiées comme elle. Déjà pendant la vie d’Anne Catherine, bien des personnes étaient touchées à sa vue et rendaient témoignage aux lumières supérieures et à la pureté d’âme qu’elles apercevaient en elle : mais elles étaient choquées de ce qu’il y avait de vulgaire et de désordonné en apparence dans la vie qu’était obligée de mener la religieuse chassée de son couvent : elles se scandalisaient de son entourage, de l’affluence des pauvres dont elle ne savait pas se défendre, de son isolement qui la laissait sans secours et sans appui, mais elles ne savaient pas voir que la pauvre victime expiatoire ne devait pas être mieux partagée que l’Église elle-même qui, dans ces jours de tribulation, se trouvait jetée comme au milieu de la subversion de tout ordre divin et humain sur la terre.
15. Anne Catherine n’aurait pu supporter la détresse de l’Église si elle n’avait aussi participé à la vie céleste et surhumaine de celle-ci. De même que l’Église est à la fois pèlerine sur la terre et en commerce avec les habitants du ciel, de même qu’elle soupire sous le poids des tribulations du présent et porte cependant en elle le salut de tous les siècles, de même qu’elle gémit sur l’éloignement de son divin fiancé élevé à la droite du Père, et pourtant s’unit à lui chaque jour par l’union la plus intime, de même Anne Catherine n’avait pas seulement à s’affliger avec la fiancée pleurant dans la vallée des larmes, mais elle s’élevait aussi avec elle par le don de contemplation au-dessus des vicissitudes du temps et des dimensions de l’espace. Le cycle entier des fêtes de l’Église était pour elle un présent toujours vivant et sans voiles : elle prenait part, comme une contemporaine, aux solennités dans lesquelles l’Église fête tous les jours les mystères de la foi et les faits de la religion, lesquels étaient plus rapprochés et plus lumineux pour son œil spirituel que le monde extérieur pour son œil de chair. Or, la vivacité de sa foi et la force de son amour la rendaient capable, non seulement de contempler comme actuellement présent ce grand fait de la rédemption accomplie que l’éloignement dans le temps ne pouvait cacher à sa vue, mais encore d’entrer avec ce mystère dans des relations intimes d’une nature merveilleuse et où les sens n’avaient aucune part. Dans cette participation à la célébration des fêtes, elle recevait de son divin fiancé, non seulement les tâches qu’elle avait à remplir pour son Église selon l’ordre du calendrier ecclésiastique, mais aussi la force, la consolation intérieure et la paix inaltérable du cœur qui lui étaient nécessaires pour ne pas perdre courage au milieu de ses tortures incessantes. Quoique le rapport entre telle et telle souffrance corporelle et la tâche d’expiation qui était imposée à Anne Catherine se montrât clairement et simplement dans la vision, elle n’aurait pourtant pas pu, dans l’état de veille, au milieu de tribulations extérieures de toute espèce, l’expliquer à d’autres d’une manière bien intelligible, si l’occasion s’en était présentée ou qu’elle en eût été requise. Devant les religieuses ou le médecin, elle n’eût pas osé s’ouvrir sur ce sujet, parce qu’on l’eût crue folle ou en délire. Elle se soumettait donc de bon gré à toutes les prescriptions de l’homme de l’art et supportait avec docilité les tentatives que la science médicale, si étrangère sur ce terrain, faisait pour guérir en elle des souffrances qui étaient le but de sa vie.
« Au couvent et plus tard, raconta-t-elle une fois, j’ai infiniment souffert des moyens qu’on employait pour me guérir. Souvent j’ai été mise en danger de mort : car on me donnait toujours des remèdes beaucoup trop forts et qui agissaient violemment. Quoique sachant d’avance combien ils me feraient de mal, il me fallait pourtant les prendre, parce que l’obéissance l’exigeait. Si j’y manquais quelquefois parce que mon esprit était ailleurs, on supposait que je le faisais exprès et que mes maladies étaient simulées. Les médicaments qu’on me donnait étaient très coûteux, et souvent une fiole payée bien cher n’était pas à moitié vidée qu’on m’en ordonnait une autre. Tous les frais étaient à ma charge, et pourtant tout fut payé. Je ne puis pas comprendre d’où tant d’argent m’était venu. Je faisais, il est vrai, beaucoup de travaux de couture, mais j’abandonnais tout au couvent. Vers la fin, le couvent paya pour moi la moitié des dépenses.
« J’étais souvent dans un si misérable état que je ne pouvais plus m’aider moi-même : dans ce cas, si mes compagnes m’oubliaient, Dieu venait à mon secours d’une autre manière. Un jour que j’étais réduite à la dernière faiblesse et couverte d’une sueur froide, deux religieuses vinrent à moi, firent mon lit qu’elles arrangèrent très commodément et m’y replacèrent si doucement que je me sentis toute soulagée. Au bout de quelque temps, la révérende mère vint avec une sœur et elles me demandèrent avec étonnement qui m’avait si bien couchée. Je crus là-dessus que c’étaient elles qui l’avaient fait et je les remerciai de leur charité, mais elles m’assurèrent formellement que ni elles, ni aucune autre sœur n’étaient venues dans ma cellule et prirent pour un rêve ce que je leur dis de deux religieuses de notre ordre qui avaient pris soin de moi : pourtant mon lit était fait et j’avais reçu du soulagement. J’appris plus tard quelles étaient ces deux religieuses qui, d’autres fois encore, me témoignèrent leur charité et me consolèrent. C’étaient des bienheureuses qui avaient vécu autrefois dans notre couvent. »
16. À propos de ce fait, Clara Soentgen fit la déposition suivante devant l’autorité ecclésiastique :
« La sœur Emmerich étant très malade, j’allai un matin dans sa cellule pour voir comment elle se trouvait. Je lui demandai qui avait fait son lit de si bonne heure et si elle-même en avait eu la force. Elle me répondit alors que la révérende mère et moi étions venues la voir, que nous avions arrangé le lit en perfection et que cela s’était fait très vite. Or ni la révérende mère, ni moi n’étions encore allées la voir. »
17. « Dans une défaillance du même genre, raconta Anne Catherine, je fus encore enlevée de mon lit par deux religieuses qui me déposèrent doucement au milieu de la cellule. Alors une des sœurs entra tout à coup et, me voyant élevée au-dessus du sol et étendue sans rien sous mon dos, elle poussa un tel cri que la frayeur me fit rudement tomber à terre. Il se tint beaucoup de propos dans le couvent à ce sujet et la vieille sœur me tourmenta longtemps de questions pour savoir comment j’avais été ainsi posée en l’air. Mais je ne pus lui donner aucune explication, car c’étaient là des choses auxquelles je ne faisais pas grande attention et tout cela me semblait parfaitement naturel. »
18. Du reste, tout ce qui était nécessaire au vase infirme de son corps pour ne pas se consumer dans le feu des souffrances lui était envoyé par son fiancé céleste de ce jardin d’Éden inaccessible au péché et à la douleur dont les produits possèdent une vertu si merveilleuse qu’ils font disparaître toute langueur et toute souffrance terrestres. Nous devons la connaissance de ces opérations cachées aux communications que, dans le cours des dernières années de sa vie, Anne Catherine eut à faire en beaucoup d’occasions qui semblaient fortuites, soit par l’ordre de son guide invisible, soit à la demande de son confesseur. Elles sont sans doute courtes et incomplètes, cependant ce qu’elles contiennent est suffisant pour qu’on puisse y trouver l’assurance qu’il en a été d’elle comme de sainte Lidwine.
19. « Les seuls remèdes qui me fissent du bien, disait-elle, étaient surnaturels. Ceux du médecin me réduisaient à l’extrémité : cependant il fallait les accepter et les payer très cher, mais Dieu me donnait l’argent et le multipliait pour moi. Dieu m’a donné tout ce dont j’ai eu besoin dans le couvent : j’ai aussi beaucoup reçu au profit du couvent. Plus tard encore, lorsque je l’eus quitté, il m’est arrivé des choses du même genre. Ayant une fois reçu une assez forte somme et l’ayant employée, je racontai la chose au doyen Rensing. Il me dit que j’avais bien fait de lui en parler, mais que si cela arrivait de nouveau, il faudrait lui montrer l’argent. À dater de ce jour cela n’arriva plus.
20. « Pendant la seconde enquête à laquelle on me soumit, je donnai à la gardienne deux thalers afin qu’elle allât pour moi en pèlerinage à Telgt et y fit dire deux messes à mon intention. La servante de la maison me prêta les deux thalers et je les remis à cette femme. Aussitôt après je trouvai deux thalers dans mon lit. J’en fus très troublée et je me fis montrer par la gardienne les deux thalers que je lui avais remis. Quand je les eus vus et reconnus, je sentis distinctement qu’une faveur que Dieu m’avait faite souvent dans des temps antérieurs s’était renouvelée pour moi et j’employai les deux thalers ainsi trouvés à payer ma dette envers la servante.
21. « Les remèdes dont j’avais besoin m’étaient donnés par mon conducteur, quelquefois aussi par mon fiancé céleste, par Marie ou par les bons saints. Je les recevais tantôt dans des flacons très brillants, tantôt sous la forme de fleurs, de boutons, d’herbes, et même de petites bouchées. Au chevet de ma couche était un petit escabeau de bois sur lequel je trouvais ces remèdes merveilleux, soit pendant mes visions, soit même à l’état naturel de veille. Souvent aussi de petits bouquets de plantes d’une beauté indicible et d’une odeur délicieuse se trouvaient placés près de moi dans mon lit, ou bien je les avais à la main quand je revenais à moi. Je palpais les feuilles avec leur verdure fraîche et tendre, et je savais quel usage j’en devais faire. Quelquefois leur bonne odeur suffisait pour me fortifier : d’autres fois je devais en manger ou verser de l’eau dessus et boire cette eau. Cela me soulageait toujours beaucoup, et je me trouvais ensuite capable de toute espèce de travail pour un temps plus ou moins long.
22. « Je recevais aussi des images, des figures ou des pierres par l’intermédiaire de personnages qui m’apparaissaient et m’enseignaient quel usage je devais faire de ces dons. Plusieurs fois des présents de ce genre me furent remis dans la main ou posés sur la poitrine, et j’en fus soulagée et fortifiée. Il y en eut que je pus conserver assez longtemps, je pus même m’en servir pour guérir d’autres personnes : je les employais ainsi ou je les donnais, mais je n’ai jamais dit d’où ils m’étaient venus. Tous ces dons sont pour moi des incidents essentiels et très certains de ma vie ; mais je ne puis expliquer comment cela se faisait. Cela se faisait en réalité et j’usais de tout cela comme d’une réalité, en l’honneur de Celui qui me l’envoyait dans sa miséricorde.
23. « Étant novice, un jour que j’étais à genoux devant le Saint-Sacrement et que j’y priais, les bras étendus, je reçus dans la main un joli petit portrait de sainte Catherine qui était comme peint sur parchemin. Je l’ai gardé longtemps, puis je le donnai à une bonne fille qui me demandait un souvenir et qui désirait bien se faire religieuse, mais qui ne put pas y parvenir. Lorsque la pauvre enfant mourut, elle fit mettre la petite image sur sa poitrine dans le cercueil.
24. « Dans une maladie postérieure, je reçus de mon fiancé céleste une pierre transparente, en forme de cœur et plus grosse qu’un écu, dans laquelle se trouvait, comme une formation naturelle, l’image de Marie avec l’enfant Jésus, de couleur rouge, bleue et or. La pierre était polie et dure ; mais la petite image était très jolie, et sa vue me fit un tel bien que j’en guéris. Je l’enveloppai dans un petit sachet en peau, et je la portai longtemps sur moi, mais elle me fut retirée. Plus tard, je reçus de mon fiancé un anneau qu’il me mit au doigt. Il y avait une pierre précieuse où était gravé le portrait de sa très sainte Mère. Je pus le conserver longtemps, jusqu’à ce qu’il me fût retiré du doigt par lui-même.
25. « J’ai aussi reçu un don semblable du saint patron de mon ordre. C’était le jour de sa fête, et j’étais au lit, souffrant beaucoup. L’heure approchait où la communauté devait aller recevoir la communion. Personne ne croyait que je pusse y prendre part, mais il me sembla alors qu’on m’appelait ; j’allai à l’église et je reçus avec les autres le très saint Sacrement. Revenue dans ma cellule, je tombai en défaillance et je fus, je ne sais comment, soulevée et posée sur mon lit tout babillée. Alors, saint Augustin m’apparut et me donna une petite pierre brillante ayant la forme d’une fève, de laquelle sortait, comme un germe, un cœur rouge surmonté d’une petite croix. Il me fut en outre annoncé que le cœur devait devenir aussi transparent que la pierre brillante. Lorsque je m’éveillai, je trouvai la petite pierre dans ma main. Je la mis dans mon verre et je bus longtemps de l’eau versée dessus, ce qui me guérit. Ensuite la petite pierre me fut retirée.
26. « Il y eut un autre présent que je pus garder sept mois, tant que dura une grande maladie qui ne me permettait pas de me lever. Pendant tout ce temps, je ne pus prendre aucune espèce de nourriture, en sorte que les sœurs ne pouvaient pas comprendre de quoi je vivais. La sœur infirmière me portait tous les jours à manger, mais je ne pouvais toucher à rien. Or, j’avais reçu, par une apparition de la Mère de Dieu, un autre aliment que je trouvai dans ma main en m’éveillant de ma vision. C’était comme une grande hostie, d’une blancheur éblouissante, toutefois plus épaisse et plus tendre qu’une hostie ordinaire et sur laquelle était l’image de la sainte Vierge avec des lettres. Je fus saisie d’un grand respect comme devant des reliques ou devant une chose très sainte. Elle avait une odeur extrêmement agréable, et pendant la nuit je la voyais lumineuse. Je la gardai près de moi, cachée dans mon lit et, pendant sept mois, j’en mangeai tous les jours de petites parcelles qui me réconfortaient beaucoup. À la fin, elle disparut et je fus très inquiète, comme si j’eusse laissé perdre cette manne céleste. Elle avait une saveur très douce, cependant ce n’était pas la saveur du très saint Sacrement.
27. « Une nuit que je priais la sainte Vierge, agenouillée devant la table de ma cellule, je vis une femme resplendissante de lumière passer à travers la porte fermée, s’avancer jusqu’au petit côté de la table, et s’agenouiller comme pour prier. J’eus un moment d’effroi, cependant je restai à prier tranquillement. Alors la figure agenouillée posa devant moi une petite image sculptée de la Mère de Dieu, haute comme la main et d’une blancheur éclatante ; puis elle laissa sa main ouverte reposer quelques moments sur la table derrière l’image. Je me retirai un peu en arrière par timidité, alors la main rapprocha de moi la petite image à laquelle je rendis hommage intérieurement. L’apparition s’évanouit, mais la petite image resta. C’était la figure d’une mère debout, tenant son enfant dans ses bras : elle était d’une beauté admirable et semblait être en ivoire. Je l’ai longtemps portée sur moi avec un grand respect : plus tard, sur un avertissement intérieur, je l’ai donnée à un prêtre étranger auquel elle fut retirée au moment de sa mort.
28. « Je reçus une fois de Marie une fleur merveilleuse qui s’épanouissait lorsqu’elle était dans l’eau. Fermée, elle ressemblait à un bouton de rose ; mais en s’ouvrant, elle déployait de petites feuilles de couleurs variées et très délicates, lesquelles se rapportaient aux divers effets spirituels que cette fleur devait produire en moi. Elle avait un parfum d’une suavité inexprimable. Je la mis dans mon verre et pendant plus d’un mois je bus l’eau qui l’avait arrosée. À la fin je fus inquiète de savoir où je devais porter ce don salutaire pour qu’il ne fût pas profané ; alors je fus avertie en vision qu’il fallait faire tresser une nouvelle couronne pour l’image de la Mère de Dieu qui était dans l’église du couvent et y faire entrer la petite fleur. Quand j’en parlai à la supérieure et au confesseur, ils exigèrent que j’épargnasse mon argent et que j’attendisse encore avant de donner suite à mon projet. Mais il me fut ordonné encore une fois de ne pas tarder plus longtemps ; sur quoi le confesseur donna la permission demandée. Je fis préparer la couronne au couvent des Clarisses de Munster, et j’y attachai ensuite la fleur. Comme les sœurs n’étaient pas assez attentives à maintenir en bon état l’habillement de la statue de Marie, je ne cessai pas d’avoir l’œil sur la couronne. J’y aperçus la petite fleur jusqu’à la suppression du couvent : alors elle disparut et il me fut montré en vision qu’elle avait été transportée dans un autre endroit.
29. « Je me souviens qu’une fois je reçus de mon guide un flacon plein de baume. C’était une liqueur blanchâtre et ressemblant à de l’huile épaisse. Je m’en servis lors d’une grave blessure que me fit une corbeille pleine de linge mouillé en tombant sur moi, et je pus aussi guérir avec ce baume d’autres pauvres malades. Le flacon était en forme de poire avec un col mince et allongé ; sa grosseur était à peu près celle d’une fiole à potions. Il était d’une matière très transparente, et je l’eus longtemps dans mon armoire. À une autre époque, je reçus aussi de petits morceaux d’un aliment très doux au goût, dont je mangeai pendant assez longtemps et dont je donnai à des pauvres pour les guérir. La supérieure en ayant trouvé chez moi me fit une réprimande parce que je ne sus pas lui dire d’où ils me venaient. »
30. Au mois d’octobre de l’an 1805, Anne Catherine fut chargée d’aider une des sœurs 12 à faire monter au grenier, pour y sécher, le linge mouillé du couvent. Elle était debout au trou du plafond pour recevoir les paniers pleins de linge à mesure qu’ils arrivaient. La sœur placée au-dessous, qui avait à les hisser, lâcha la corde par inadvertance au moment où Anne Catherine voulait prendre un de ces pesants paniers et le déposer sur le plancher. Celle-ci courut par là le danger de tomber sur la sœur avec ce fardeau beaucoup trop lourd pour elle : heureusement elle en fut préservée par son ange qui saisit aussitôt la corde abandonnée à elle-même. Mais le violent effort qu’elle fit la jeta à la renverse sur le plancher et le panier tomba sur sa hanche gauche. Il en résulta diverses meurtrissures à l’os de la hanche ainsi qu’à d’autres parties du corps, et ces lésions auraient eu certainement des suites fatales, si Dieu ne lui avait conservé la vie par une assistance toute particulière. Il fut bientôt évident que cet accident, fortuit en apparence, avait été ordonné de Dieu comme quelque chose d’aussi important dans sa vie que la chute sur la glace dans celle de Lidwine : car non seulement cette addition à ses infirmités corporelles amena un accroissement extraordinaire de ses souffrances expiatoires, mais les suites incurables de ces meurtrissures lui procurèrent des occasions continuelles de supporter pour l’amour de Dieu les humiliations les plus pénibles. Ainsi, à dater de ce moment, elle ne put plus sonner la cloche du couvent, comme sous-sacristine, qu’avec une extrême difficulté. Plusieurs fois même il lui fut impossible de s’acquitter de cette charge, ce qui la fit accuser d’orgueil et de paresse. Mais, en réalité, c’était pour elle une grande privation que de ne pouvoir plus sonner la cloche : car cet office était à ses yeux une forme de prière si grave et si auguste qu’elle semblait, en le remplissant, oublier ses cruelles souffrances.
« Quand je sonnais la cloche bénite, disait-elle un jour, je me sentais tout heureuse, comme si j’eusse par là répandu la bénédiction et appelé à haute voix toutes les personnes d’alentour à louer Dieu. J’unissais à chaque son de la cloche mes soupirs et ma prière, afin que ce son pût chasser le mal du cœur de tous ceux qui l’entendaient et les exciter à glorifier Dieu. J’aurais aimé à sonner beaucoup plus longtemps que je ne le devais et qu’il ne m’était prescrit. »
Qui ne voit que la tendre dévotion de cette pauvre religieuse sonnant la cloche, au milieu de tant de souffrances, devait, aux yeux de Dieu, servir d’expiation pour les ignobles violences de cette époque incrédule, qui proscrivait avec une fureur presque inexplicable l’usage des cloches bénites.
31. Il était aussi devenu très pénible et parfois tout à fait impossible pour elle de travailler au jardin, de laver et de repasser le linge de l’autel et de la sacristie. Dieu seul peut savoir quels efforts elle s’imposait pour faire la lessive de l’église, malgré ses cruelles souffrances. Mais le fait suivant montre comment son zèle était récompensé. Un jour qu’elle repassait les aubes avec quelques autres sœurs, le fer brûlant tomba de ses mains sur une aube. Tremblant qu’elle ne fût brûlée, elle saisit courageusement le fer, après avoir invoqué intérieurement le secours de Dieu, le retira de dessus l’aube et le posa sur le plancher où il fit un trou, mais ni l’aube, ni la main ne furent endommagées. Et pourtant ses mains étaient si délicates et tellement amaigries par des douleurs locales continuelles, qu’elle put dire un jour : « Pendant que j’étais encore au couvent, mes mains me faisaient toujours beaucoup souffrir. Je les mettais au soleil et elles étaient si maigres que les rayons passaient au travers comme des flèches. »
32. La préparation des hosties était aussi pour elle excessivement pénible à cause de la pesanteur du moule en fer dont elle se servait. C’était, à ses yeux, une importante, ou, pour mieux dire, une sainte fonction dont elle s’acquittait toujours avec respect et en priant continuellement. Un jour, elle était au lit, très malade ; il fallait mettre au four de nouvelles hosties, et comme elle était dans l’impossibilité de se livrer à ce travail, cela l’attristait beaucoup. Elle implora alors le secours de Dieu, sortit de son lit à grand-peine, se traîna dans l’église et pria de nouveau devant le Saint-Sacrement, afin d’obtenir la force nécessaire pour apprêter les hosties. Elle se sentit bientôt toute baignée de sueur, mais suffisamment forte pour faire son office de boulangère. Toutefois, elle ne fut pas seule à travailler : car son ange lui vint en aide. À peine eut-elle fini qu’elle se retrouva aussi malade qu’auparavant, et ce ne fut qu’à grand-peine qu’elle put regagner sa cellule.
33. Après l’accident occasionné par le panier de linge, Anne Catherine fut forcée de garder le lit jusqu’en janvier 1806. Vers ce temps, les douleurs autour du creux de l’estomac augmentèrent tellement qu’elles amenèrent de fréquents vomissements de sang. Quoiqu’il y eût quelques interruptions, ils se renouvelaient de temps en temps avec tant de violence que, pendant son travail, le sang lui sortait de la bouche, quelquefois avec une abondance qui faisait craindre aux sœurs une hémorragie mortelle.
34. Celles-ci ayant pu se convaincre à plusieurs reprises qu’Anne Catherine se remettait promptement de certaines défaillances qui pourtant avaient semblé annoncer une mort prochaine, ou du moins qu’elle recouvrait assez de force pour retourner à ses travaux contre toute attente, se persuadèrent de plus en plus qu’en général toutes ses maladies étaient sans gravité et qu’aucun mal, si terrible qu’il fût en apparence, ne pouvait lui causer un grand préjudice. On peut s’imaginer à quoi se réduisait, avec cette manière de voir, le soin qu’on prenait d’elle quand elle souffrait. Les religieuses s’étaient habituées à ne plus guère penser à Anne Catherine, lorsqu’elle était hors d’état de quitter sa cellule ou son lit ; aussi pouvait-il arriver facilement que, pendant le froid de l’hiver, la paille de son lit gelât contre le mur humide de sa cellule ou que la pauvre malade, en proie aux ardeurs de la fièvre, soupirât inutilement après un verre d’eau fraîche. Une personne compatissante de Dulmen entendit parler de cet état de détresse et en informa le duc de Croy, qui fit établir dans le couvent une infirmerie chauffée par un poêle, afin qu’Anne Catherine pût y être transportée.
35. En 1813, le médecin du couvent déposa ce qui suit devant l’autorité ecclésiastique :
« La sœur Emmerich, pendant ses maladies, n’était pas soignée au couvent comme elle aurait dû l’être. Je la trouvai une fois, après une très forte transpiration, tremblant de froid dans son lit. Elle n’avait pas de linge blanc pour changer ; sa chemise et les draps de son lit, tout trempés de sa sueur, étaient gelés et raides. La plupart des religieuses se plaignaient souvent de la charge que les fréquentes maladies de la sœur Emmerich faisaient peser sur la communauté, et indisposaient quelquefois par là l’infirmière, la révérende mère et celle des sœurs qui étaient mieux disposées pour la malade.
« Au commencement du mois de mars de l’année 1810, elle fut prise d’une violente fièvre nerveuse. Pendant cette grave maladie qui dura plus de deux mois et pendant laquelle elle resta couchée dans sa froide cellule, elle eut à souffrir cruellement. Des transpirations excessives, de forts évanouissements, des convulsions et de violentes douleurs se succédèrent plus ou moins pendant ce temps. »
36. Lorsqu’Anne Catherine elle-même fut obligée, pour obéir aux supérieurs ecclésiastiques, de rendre compte de la manière dont elle avait été soignée au couvent pendant ses maladies, elle s’exprima ainsi :
« Au commencement, lorsque j’entrai au couvent, il me sembla qu’en général on prenait peu de soin des malades. Il n’y avait pas de pièce particulière pour elles, jusqu’au moment où le duc de Croy, ayant appris que les malades étaient obligées de rester couchées dans leur cellule ordinaire, qu’elles y étaient sans feu pendant l’hiver et assez mal soignées, non seulement s’occupa de faire établir une infirmerie, mais encore donna un poêle pour la chauffer. Deux fois j’ai été malade et soignée par ma sœur Soentgen autant que le lui permettaient les leçons qu’elle avait à donner. Ma sœur Neuhaus aussi m’a donné les mêmes soins charitables pendant ma maladie, lorsque Soentgen en était empêchée. Tant que j’ai été soignée par ces deux personnes, je n’ai pas eu à me plaindre d’être molestée ou de n’être pas convenablement assistée, quoique toutes les deux, à cause de la charité qu’elles me témoignaient, eussent à supporter plus d’un désagrément de la part de quelques autres de nos sœurs peu favorablement disposées pour moi. Ensuite, la sœur E... fut nominée infirmière, et celle-là m’a trop souvent donné lieu de me plaindre à cause de ses singuliers caprices et de sa négligence à s’acquitter de ses fonctions au lit des malades. Souvent, quand elle aurait dû venir me visiter, elle allait dans sa cellule pour y travailler à sa fantaisie : souvent, le matin, elle me laissait si longtemps dans mon lit, sans s’occuper de moi, que je tremblais de froid dans ma chemise toute trempée de sueur, et qu’en outre, ne pouvant m’aider moi-même, j’avais à endurer une soif insupportable et d’autres incommodités douloureuses. J’ai souvent porté plainte à la révérende mère, non seulement de la conduite d’E... à mon égard, mais de ce qu’on me laissait manquer des choses les plus nécessaires. Je l’ai fait d’après l’avis de mon confesseur : mais cela ne m’a guère servi, parce que la révérende mère ne m’était pas très favorable. Quelquefois elle faisait droit à mes réclamations : d’autres fois, elle me répondait que le couvent était trop pauvre pour procurer aux malades tout ce qu’il leur fallait, et que je n’étais jamais contente. Je dois dire aussi à sa décharge qu’elle avait peu de compassion pour moi dans mes maladies, parce qu’elle ne me croyait pas aussi malade que je l’étais réellement ; j’ajouterai qu’elle prenait plus de soin des malades qu’on ne le faisait autrefois, à ce que disaient les plus anciennes des religieuses, et même qu’à cause de cela elle a pu avoir à éprouver des désagréments de la part de l’une ou de l’autre. »
Cette infirmière était précisément la personne à laquelle Anne Catherine s’attacha à rendre les services les plus affectueux quand, atteinte elle-même de maux qui excitaient le dégoût, elle était évitée de tout le monde dans le couvent à cause de son caractère acariâtre. Ce fut pour Anne Catherine l’occasion toujours bienvenue, non seulement de payer par les marques de la bonté la plus touchante les mauvais traitements qu’elle avait reçus, mais encore de s’en attirer par là de nouveaux, supportés avec une charité encore plus grande.
37. La seule nourriture terrestre dont Anne Catherine ressentît le besoin, lorsqu’elle pouvait sortir de son lit, aller au chœur et au travail, était le thé ou un café léger. « Souvent, déposa-t-elle devant le doyen Rensing, j’ai passé plusieurs nuits de suite sans sommeil. Rarement, très rarement, j’ai un peu dormi : mon sommeil n’était le plus souvent qu’un assoupissement léger et fréquemment interrompu. Il résultait de là, surtout quand j’avais en outre de fortes sueurs, que je me trouvais très mal le matin et que je ne pouvais pas me lever pour aller à matines. Mais aussitôt que j’avais pris un peu de café et qu’ensuite j’avais entendu la messe, je me trouvais en état de vaquer à mes travaux. C’est pourquoi les sœurs se moquaient si souvent de moi à cause de mes maladies qu’elles disaient simulées, ou imaginaires, ou très exagérées. »
D’après un usage établi dans le couvent, les religieuses devaient pourvoir elles-mêmes à leur déjeuner. Mais, comme Anne Catherine n’avait ni argent, ni provision de café, elle allait le matin avec sa petite cafetière dans la cuisine, où elle recueillait les restes de café que les sœurs avaient laissé tomber, et se faisait avec cela une boisson qu’elle prenait sans sucre. Clara Soentgen, à laquelle nous devons la connaissance de ces détails, avait quelquefois pitié d’elle et partageait avec elle son déjeuner : mais cela ne dura pas longtemps, parce que, d’après ses propres aveux, Clara s’en laissa dissuader par les propos des autres sœurs. Alors l’assistance vint d’ailleurs : car, un jour, Anne Catherine revenant du chœur dans sa cellule qu’elle avait laissée fermée, trouva sur la dalle du chambranle de la fenêtre deux thalers qu’elle porta aussitôt à la supérieure, et celle-ci l’autorisa à se procurer avec cet argent une petite provision de café qui lui suffit pour longtemps.
38. Clara Soentgen en 1813 déposa devant les supérieurs ecclésiastiques touchant un autre cas du même genre :
« Depuis que j’avais fait connaissance avec Anne Catherine Ernmerich, dit-elle, je remarquais que c’était pour elle une grande joie de pouvoir donner quelque chose aux pauvres. Avant d’entrer au couvent, elle avait donné tout ce qu’elle avait : elle fit de même au couvent. Je lui demandai un jour pourquoi elle faisait cela, étant elle-même dans le besoin. « Ah ! me dit-elle, je reçois toujours plus que je ne donne ! » J’ai souvent vu, à mon grand étonnement, que c’était la vérité.
« Un matin elle se leva, n’ayant ni café, ni argent pour s’en procurer. Elle va au chœur après avoir fermé sa cellule et, quand elle revient, elle voit de l’argent sur la fenêtre. Il était étalé avec beaucoup d’ordre et il y avait de grandes pièces de deux gros. Cela lui arriva encore une autre fois.
« Elle n’avait pas de plus grande joie que de pouvoir rendre à ses sœurs un service charitable. On pouvait lui demander ce qu’on voulait ; elle donnait avec joie, même ce qui lui eût été le plus nécessaire. Elle se montrait surtout bonne pour celles qu’elle savait lui être contraires. »
39. Plus tard elle reçut d’une bienfaitrice deux livres de café pour le jour de sa fête. Elle fit son déjeuner avec cela pendant toute une année sans que la provision diminuât, en sorte qu’elle s’en réjouissait souvent de tout son cœur. Mais, ayant été attaquée d’une maladie qui dura longtemps et pendant laquelle elle reçut des remèdes d’un ordre supérieur, le don de cet aliment terrestre cessa.
40. « Un jour, raconta Anne Catherine, le vieux comte de Galen me força de prendre deux pièces d’or que je devais donner aux pauvres pour lui. Je les fis changer en petite monnaie avec laquelle je fis faire des vêtements et des chaussures que je distribuai. Il y eut sur cet argent une merveilleuse bénédiction de Dieu, car, toutes les fois que je l’avais distribué en détail, je retrouvais les deux pièces d’or dans ma poche et je les faisais de nouveau changer. Cela dura bien un an, et avec cet argent j’assistai beaucoup de pauvres. Cette grâce prit fin pendant une maladie par suite de laquelle je restai deux mois sans pouvoir faire un mouvement et le plus souvent sans avoir ma connaissance : comme toutes les autres s’emparaient de mes effets, Dieu retira ce qui aurait pu scandaliser. »
41. Par une disposition toute particulière de Dieu, malgré les souffrances incessantes auxquelles Anne Catherine était en proie dans le couvent, les personnes les plus diverses venaient la trouver et lui demander son assistance pour leur détresse ou leurs infirmités. Plus un malade était délaissé et plus son état était triste, plus il pouvait être certain de recevoir d’elle les marques de charité les plus touchantes. C’étaient le plus souvent de pauvres gens de la classe inférieure qui imploraient le secours de la religieuse malade : mais les sœurs du couvent savaient aussi avec quelle charité elles seraient accueillies si elles lui demandaient un service ou faisaient seulement mine de ne pas le repousser, en sorte qu’Anne Catherine ne manquait jamais d’occasions de servir son fiancé céleste dans la personne des malades, des infirmes, des nécessiteux. L’excès de ses propres souffrances semblait agrandir à l’infini sa tendre compassion pour les souffrances bien moindres des autres : car le désir de servir et d’aider autrui et le plaisir qu’elle y trouvait faisaient d’elle comme une personne forte et vigoureuse, lors même qu’elle était encore malade et dans un misérable état. Ainsi, cette pieuse fille à laquelle, d’habitude, on n’accordait pas les moindres soins, ni la moindre attention, ne pouvait mettre de bornes à son zèle charitable quand il s’agissait de soulager les maux d’autrui. Elle avait le sentiment de ce qui pouvait faire du bien aux autres ; elle voyait la nature et le siège du mal, quels étaient les remèdes les mieux appropriés, et répandait un souffle de bénédiction sur tout ce qu’elle soignait en priant, et touchait de ses mains bienfaisantes. Elle montrait une patience si affectueuse, une mansuétude si sereine, une sollicitude si inventive, même auprès des malades irritables, grondeurs et impatients, que tous oubliaient trop facilement qu’elle-même n’était pas dans sa vie un instant sans souffrir. Elle savait, par l’impression irrésistible de sa bonté toujours aimable, vaincre la résistance de malades opiniâtres près desquels le médecin du couvent lui-même l’appelait, lorsque personne ne pouvait en venir à bout.
42. Parmi les pensionnaires du couvent se trouvait une jeune personne faible d’esprit, nommée K... et native de M..., qui, ayant à la nuque un abcès d’une mauvaise nature, s’échappait des mains du médecin quand il voulait lui mettre un bandage et repoussait tout ce qu’il voulait faire pour sa guérison. Alors la supérieure fit venir Anne Catherine, à laquelle la malade obéit de bonne grâce. Elle prit de sa main des remèdes et un bandage, et, lorsque l’abcès creva, Anne Catherine suça les plaies qui guérirent sans laisser de traces.
43. Une servante du couvent qui avait un abcès sous l’aisselle se glissa la nuit près du lit d’Anne Catherine, la pria de la traiter et reçut d’elle, pour l’amour de Jésus, le même service charitable.
Une autre jeune fille native d’Amsterdam avait un caractère insupportable et se querellait avec tout le monde dans le couvent : Anne Catherine seule savait l’adoucir et lui avait inspiré une affection que les autres ne pouvaient s’expliquer.
44. Voici ce qu’elle-même raconta à propos d’un cas du même genre :
« Le médecin du couvent, qui était un peu bourru, avait rudement grondé et menacé une pauvre femme qui avait un doigt très malade et dont le bras était très enflé et déjà tout noir, parce qu’elle avait négligé son mal ; il lui dit même qu’il serait forcé de lui couper le doigt. Là-dessus la pauvre femme, pâle de terreur, vint me trouver et me pria de lui venir en aide. Je priai pour elle, et ce qu’il y avait à faire me vint tout de suite à l’esprit. J’en parlai à la révérende mère, qui me permit de bander la plaie de cette femme dans la chambre de l’abbé Lambert. Je pris de la sauge, de la myrrhe et de l’herbe de Notre-Dame que je fis bouillir dans de l’eau avec un peu de vin : j’y ajoutai un peu d’eau bénite et j’en fis un cataplasme pour le bras de la femme. C’était sans doute Dieu lui-même qui me l’avait inspiré, car le lendemain matin le bras était déjà tout désenflé : quant au doigt, qui était encore très malade, je le fis tremper dans de la lessive de cendres chaudes avec de l’huile ; alors il s’ouvrit et j’en tirai une grosse épine. La femme fut bientôt tout à fait guérie. »
45. Voici comment elle s’exprimait sur la nature de la compassion qu’elle portait aux malades et aux mourants :
« Je ne puis avoir pitié d’une personne qui meurt avec calme, pas même d’un enfant qui souffre patiemment : car la souffrance supportée avec patience est l’état le plus digne d’envie pour l’homme dans son corps de péché. Il est très rare que notre compassion soit tout à fait pure ; il s’y mêle souvent de la mollesse et un sentiment égoïste produit par l’horreur que nous avons nous-même pour la souffrance et pour tout ce qui blesse la sensibilité. La compassion de Notre-Seigneur pour les hommes fut seule parfaitement pure, et aucune compassion humaine n’est pure si elle ne s’unit pas à celle de Jésus. J’ai seulement pitié des pécheurs, des hommes aveuglés, de ceux qui sont livrés au désespoir. Hélas ! j’ai souvent trop de pitié pour moi-même. »
46. La bénédiction extraordinaire qui s’attachait à ses soins et à ses prières pour les malades se manifesta par les faits suivants :
« Une paysanne que je connaissais, raconta-t-elle, avait toujours des couches très douloureuses et qui la mettaient en danger de mort. Elle m’aimait beaucoup, se plaignait à moi de ses peines et je priai pour elle du fond du cœur. Je reçus alors, pendant ma prière, une bande de parchemin sur laquelle il y avait quelque chose d’écrit : il me fut aussi indiqué que cette femme devait la porter sur elle. Elle le fit comme je le lui dis, et accoucha très facilement. Quand elle mourut, elle fit mettre cette bande de parchemin avec elle dans la bière, suivant la coutume de nos paysans.
47. « Il y eut une fois une grande mortalité sur le bétail dans la petite ville : les habitants étaient obligés de mener leurs bêtes dans une maison pour y être traitées, mais la plus grande partie y périt. Une mère de famille vint me trouver en pleurant et me demanda de prier pour elle et pour les autres pauvres gens. Pendant ma prière, je vis les étables de ces gens : je vis les bêtes saines et celles qui étaient malades, ainsi que la cause du mal et l’effet de la prière pour leur guérison. J’en vis beaucoup qui étaient malades par suite d’un châtiment de Dieu, à cause de l’orgueil et de la fausse sécurité de leurs possesseurs qui ne savaient pas que Dieu peut donner et retirer, et ne reconnaissaient pas que le dommage qu’ils éprouvaient était une punition et un avertissement. Je suppliai Dieu de vouloir bien les mettre dans la bonne voie d’une autre manière. Je vis aussi beaucoup de bêtes malades par suite de la malédiction et de l’envie des jaloux : et ceci particulièrement chez des gens qui manquaient à remercier Dieu filialement de tout ce qu’il leur donnait et à implorer sa bénédiction sur ses dons. Je vis comme un obscurcissement dans ce bétail autour duquel erraient des ombres ténébreuses et sinistres. La bénédiction a pour effet, non seulement de faire descendre la grâce de Dieu, mais encore de chasser les mauvaises influences de la malédiction. Les vaches que je vis épargnées par suite de la prière me parurent comme séparées des autres par quelque chose de lumineux. De celles qui furent guéries, je vis sortir une vapeur noire. Je vis de même sur ce qui fut béni de loin par la prière planer une légère lueur. Je vis le fléau s’arrêter soudainement : le bétail de la mère de famille fut épargné tout entier. »
48. Les fréquentes maladies dont il a été parlé eurent pour Anne Catherine cette conséquence qu’on ne lui confia jamais au couvent une charge particulière, mais qu’on la subordonna tantôt à une sœur, tantôt à une autre comme assistante. Ainsi le souhait qu’elle avait exprimé à son entrée au couvent d’y être traitée comme la dernière de la communauté trouva son accomplissement incessant et s’appliquant à tout. Jamais il n’arriva qu’elle fût placée au-dessus d’une autre sœur, mais, comme le rapporta Clara Soentgen : « Elle fut toujours envers chacune des autres comme une servante, sans que jamais cela la contrariât le moins du monde ou la fît murmurer. En outre, elle était très occupée des intérêts du couvent, très serviable, très diligente dans ses travaux : envers les servantes et les gens de peine, elle était non seulement très discrète, mais aussi vraiment charitable, et elle leur donnait beaucoup de bons enseignements. »
La révérende mère aussi fit, en 1813, la déposition suivante devant les supérieurs ecclésiastiques :
« Dans les travaux de la communauté et dans tout ce que je lui ai donné à faire, Anne Catherine s’est toujours comportée de manière à ce que je fusse parfaitement contente d’elle ; lorsqu’on lui confia le soin des bâtiments et des jardins, elle a fait de son mieux pour le bien du couvent, si bien que tout le monde faisait son éloge. Envers les servantes et les gens de peine, elle était très bonne (selon le rapport de la maîtresse des novices), mais pourtant elle tendit à ce qu’ils fissent leur devoir : elle a toujours été très compatissante envers les indigents. Je sais aussi qu’elle a fait des bonnets pour de pauvres enfants avec du vieux linge d’église. »
XV
SES EXTASES ET SON ORAISON.
1. Parmi toutes les privations qu’Anne Catherine eut à supporter dans le cloître, il n’y en eut pas de plus pénible pour elle que le manque d’une direction sacerdotale parfaitement sûre. Elle n’avait pas de confesseur avec qui elle pût s’ouvrir entièrement sur son état intérieur et sur tout ce qui lui arrivait. Il lui fallait donc porter seule tout le fardeau qui pesait sur elle, et il n’y avait personne qui pût lui en alléger le poids par une direction éclairée.
« Je criais sans cesse vers Dieu, a-t-elle raconté, pour qu’il voulût bien m’envoyer un prêtre auquel je pusse m’ouvrir entièrement : car j’étais assez souvent dans une extrême inquiétude, craignant que tout ne vînt de l’esprit malin. Je tombai dans le doute et, par crainte d’être dans l’illusion, je rejetais tout ce qui pourtant était devant mes yeux, ce que je souffrais, ce dont je vivais, ce qui était d’ailleurs pour moi une source de force et de consolation. L’abbé Lambert cherchait bien à me tranquilliser ; mais, comme il savait trop peu l’allemand, je me sentais hors d’état de lui faire comprendre clairement tous les incidents de ma vie et mes tribulations revenaient sans cesse. Ce qui m’arrivait et ce qui se passait en moi était incompréhensible pour moi-même, pauvre paysanne que j’étais, quoique depuis mon enfance je l’eusse éprouvé constamment et que je ne m’en fusse jamais étonnée. Mais, dans les quatre dernières années de mon séjour au couvent, j’étais presque continuellement en contemplation, et les incidents qui étaient la suite de cet état se multipliaient : or, dans une pareille situation, je ne pouvais en rendre compte à d’autres personnes qui n’avaient jamais pensé à rien de semblable et qui regardaient par conséquent de pareilles choses comme tout à fait impossibles. Dans mon délaissement, comme je priais un jour toute seule à l’église, j’entendis clairement et distinctement ces paroles qui produisirent en moi une émotion profonde : « Est-ce que je ne te suffis pas ? »
2. On ne doit pas s’étonner qu’Anne Catherine, voyant se multiplier de plus en plus pour elle les contemplations les plus variées, se trouvât souvent sans conseil et sans aide et fût tourmentée de doutes pénibles : car le don de contemplation comme tous les autres lui était départi pour l’accomplissement de sa tâche expiatoire en faveur de l’Église, et par conséquent il lui apportait des souffrances qui, aussi bien que ses souffrances corporelles, correspondaient à l’état de l’Église d’alors pris dans son ensemble. Cela en faisait pour elle un si pesant fardeau que, sans l’assistance continuelle, immédiate et personnelle de son fiancé céleste, elle aurait succombé à la peine. En nous reportant à la direction de sa première enfance, pendant laquelle elle était déjà favorisée des visions les plus riches touchant l’histoire de notre Rédemption, nous reconnaîtrons facilement que, dès ce temps, elle était préparée d’avance à la grandeur de sa tâche future. Car, parmi ces contemplations d’une richesse infinie, où sa vie intérieure se mêlait à ce qu’elle contemplait, son âme mûrissait et arrivait par degrés à la force incroyable qu’il lui fallait pour contempler aussi le côté ténébreux des visions, c’est-à-dire le développement du mystère d’iniquité ou le combat de l’ennemi de notre salut contre l’Église, et pour entrer en lutte avec les puissances du mal d’une manière correspondante aux relations qu’elle entretenait habituellement avec les saints du calendrier ecclésiastique. Si donc Anne Catherine souffre pour la foi, ce ne sont pas seulement les blessures et les coups portés au corps de l’Église par l’incrédulité, par la destruction des choses saintes et la profanation du culte divin, qu’elle a à endurer, comme représentant l’Église, et à expier par les souffrances de son propre corps : mais elle doit, en outre, lutter contre la ruse et la malice de l’ennemi lui-même qui, pendant que les gardiens sont endormis, se glisse dans la vigne et y sème la mauvaise semence ; elle doit détruire les mauvaises herbes avant qu’aucune d’elles puisse germer et croître. Elle lutte et combat contre l’ennemi des âmes en s’opposant à ses attaques, dirigées surtout contre le sacerdoce, et pour cela la pureté sans tache de son âme, la profonde humilité de son cœur, son inébranlable confiance en Dieu, la liberté spirituelle qu’elle a conquise par les voies si pénibles de l’abnégation et du renoncement à soi-même lui forment une armure qui la rend invulnérable à la rage de l’enfer. Or, dans ce combat, ce n’est pas la lumière de la contemplation, mais la force et la vivacité de la foi qui lui assurent la victoire. Dieu permet à la vérité qu’elle souffre de cruelles tribulations spirituelles, quand elle combat face à face le père du mensonge et ses stratagèmes, quand il lui faut réduire à l’impuissance ses efforts pour égarer les esprits : il la serre de près et la jette dans de terribles angoisses, mais il ne peut parvenir à ébranler sa foi, et les traits qu’il lui lance rebondissent et perdent leur force contre ce bouclier. Jamais Anne Catherine n’avait désiré les visions et les dons extraordinaires : elle les avait reçus de Dieu et en avait eu l’habitude avant de pouvoir même soupçonner que c’était une faveur accordée à elle seule, et non aux autres. Lorsqu’elle en fut avertie, son premier soin fut d’en rendre compte aux ministres de l’Église et de se soumettre à leur jugement pour savoir si ce don était réel et provenait d’une source pure, ou si ce n’était qu’illusion et tromperie. Comme aucun d’eux n’y vit rien de mauvais, elle continua à en user sans inquiétude : cependant ce ne furent pas ses visions, mais la foi seule qui fut la règle de sa conduite, et elle aurait souffert mille fois la mort plutôt que de s’écarter de cette règle. Quand, plus tard, elle entra en lutte avec l’ennemi des âmes, il put arriver que celui-ci, par la permission de Dieu, la fît douter de ses visions, l’inquiétât par des images effrayantes ou cherchât à lui persuader que ses contemplations venaient de lui, mais il ne lui fut pas donné d’aller plus loin. Elle répondit au tentateur par des actes de foi divine et de soumission complète à l’enseignement infaillible de l’Église, et par des protestations chaleureuses contre tout ce qui n’était pas conforme à la règle de la foi, refusant toute sa croyance aux visions dans le cas où elles seraient en contradiction avec cette règle.
Dans ces rudes combats, souvent répétés, Anne Catherine restait délaissée, sans assistance et sans direction sacerdotales ; délaissée comme l’Église elle-même où les chaires épiscopales restaient vides et les troupeaux sans pasteur qui pût combattre les ravages toujours croissants de l’incrédulité, où nul docteur n’élevait plus la voix contre elle, pendant que des lieux communs vides et retentissants étaient l’effort suprême par lequel le précieux trésor de la foi était moins défendu que ravalé.
3. On ne peut se défendre d’une impression toute particulière, quand on voit, dans la désolation de cette époque encore si voisine de nous, la religieuse de Dulmen, semblable à une fleur miraculeuse, déployer entre les murs du cloître prêts à s’écrouler une beauté comparable à ce qui s’est vu de plus merveilleux dans les meilleurs jours des siècles antérieurs. Lorsque sainte Thérèse et sainte Madeleine de Pazzi faisaient l’ornement de l’Église, l’ordre de saint Ignace était dans sa première floraison ; il s’était rapidement propagé par toute l’Église à laquelle il avait donné plus de saints et de docteurs qu’aucun institut religieux ne l’avait fait depuis le temps de saint François et de saint Dominique. De même, lorsque sainte Catherine de Sienne, sainte Lidwine, sainte Colette remplissaient la vigne de leur bonne odeur, l’Église languissait, il est vrai, dans une grande détresse ; toutefois, outre ces saintes, on voyait briller, dans tous les pays, des saints et des docteurs. Mais aucune époque ne fut plus désolée et plus abandonnée que celle où le Maître de la vigne répandit sur la petite bergère de Flamske la plénitude de ses grâces, lesquelles, partagées entre plusieurs, auraient suffi, ce semble, pour donner à l’Église toute une troupe de grands serviteurs de Dieu. Mais comme le Seigneur n’enrichit l’individu de ses dons qu’à la condition d’une coopération fidèle, en sorte que, si celui-ci les enfouit, ils sont accordés à un autre qui en fait un meilleur usage, ainsi les mêmes rapports entre la dispensation et la coopération se reproduisent en grand dans la communauté des fidèles. Dans aucun temps, la puissance et la miséricorde de Dieu ne sont raccourcies, mais quand, par la faute de ceux qui devraient recevoir, les vases manquent pour recueillir la richesse surabondante de ses dons, il reporte les merveilles de son amour sur le petit nombre des serviteurs fidèles qui reçoivent de plus pour leur part les grâces dont les autres n’ont pas fait usage. C’est pourquoi les dons comme les souffrances ont chez Anne Catherine un caractère si grandiose et si inusité. Les extases et les autres états extraordinaires de sainte Madeleine de Pazzi se produisaient au milieu d’une communauté cloîtrée qui regardait tout cela avec un respect mêlé de crainte ; cette même sainte, étant maîtresse des novices, avait autour d’elle ses jeunes élèves qui, poussées par une innocente curiosité, se plaisaient à parler de Dieu et de ses saints pour voir leur maîtresse tomber en extase ; mais Anne Catherine avait des ravissements auxquels il lui était impossible de résister, parmi des compagnes pour qui sa personne était, à cause de cela, aussi importune et aussi odieuse que l’était pour la grossière incrédulité de l’époque l’Église elle-même, insolemment outragée et blasphémée parce qu’elle osait encore, dans son bréviaire et ses légendes, confesser à haute voix la magnificence et la grandeur de Dieu dans ses saints.
4. « J’étais souvent impuissante à cacher ce qui se passait en moi, racontait Anne Catherine, et je tombais en défaillance devant mes compagnes. Étant un jour au chœur, sans chanter avec les autres, je fus prise comme de paralysie, en sorte que je tombai par terre quand mes voisines me poussèrent. Elles m’emportèrent et, pendant ce temps, je vis une religieuse marcher sur le toit de l’église et aller ainsi jusqu’au faite où il n’était possible à personne de monter : il me fut révélé plus tard que c’était Madeleine de Pazzi, qui a porté les marques des plaies du Seigneur. Une autre fois, je la vis courir sur la balustrade du chœur, une autre fois monter sur l’autel ou détourner la main du prêtre. Ces chemins périlleux me firent faire attention à mon état et je pris bien garde de ne pas me laisser aller à mes défaillances. Au commencement mes sœurs qui ne comprenaient rien à tout cela me faisaient de grands reproches de ce que souvent je restais prosternée dans l’église, le visage contre terre et les bras étendus. Cela arrivait sans que je pusse l’empêcher, aussi cherchais-je des places cachées où l’on ne pût pas me voir aisément. Mais j’étais ravie hors de moi, tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre, et je restais immobile et les membres raidis, soit prosternée sur le visage, soit agenouillée et les bras étendus, et le chapelain du couvent me trouvait dans cet état. J’avais toujours vivement désiré de voir aussi sainte Thérèse parce que j’avais entendu dire qu’elle avait eu beaucoup à souffrir avec ses confesseurs. Je la vis en effet plusieurs fois, faible et malade, écrivant sur une table ou dans son lit. Il me semble que je voyais un rapport intime entre elle et Madeleine de Pazzi. J’eus aussi la révélation intérieure que Madeleine de Pazzi, dès son enfance, était déjà placée très haut devant Dieu par sa simplicité et l’ardeur de son amour.
« Pendant que je faisais mes fonctions de sacristine, j’étais souvent enlevée tout à coup, et je grimpais, je montais, je me tenais debout dans les parties hautes de l’église sur des fenêtres, des ornements sculptés, des pierres en saillie ; je nettoyais et arrangeais tout dans des endroits où la chose eût été humainement impossible. Je me sentais élevée et soutenue en l’air, et cela ne m’inquiétait en rien, car j’étais accoutumée dès l’enfance à être assistée par mon bon ange. Quelquefois en revenant à moi, je me trouvais assise dans une armoire où je conservais les effets de la sacristie ; d’autres fois, je m’éveillais dans une encoignure voisine de l’autel où l’on ne pouvait pas me voir, même quand on était tout contre. Je ne puis imaginer comment j’arrivais là, sans déchirer mes habits, car il était très difficile d’y pénétrer. Souvent on m’éveillant, je me trouvais assise sur la plus haute poutre de la toiture. Cela arrivait communément quand je me cachais pour pleurer. J’ai vu aussi Madeleine de Pazzi monter ainsi et faire d’étranges courses sur les planches, les poutres, les échafaudages et les autels. »
5. Overberg de son côté dépose ainsi :
« Anne Catherine a souvent eu des évanouissements, (c’est-à-dire des extases), dans le couvent, spécialement quatre années avant sa suppression. Ils lui venaient partout, au travail, dans le cloître, dans le jardin, dans l’église et dans sa cellule. Alors elle s’affaissait sur elle-même et restait étendue par terre. Le plus souvent, cela lui arrivait quand elle était tout à fait seule ; quelquefois aussi, elle a eu de petites attaques au réfectoire, mais elle demandait à Dieu de ne pas en avoir là. Souvent elle croyait n’avoir perdu l’usage de ses sens qu’une minute : mais quand elle regardait l’heure, elle reconnaissait que cela avait duré longtemps.
« Comme je lui demandais si elle distinguait entre les évanouissements causés par la faiblesse et les autres (les extases), elle répondit : « Dans les évanouissements de faiblesse, je me sens tout à fait mal, je souffre quelquefois tellement dans mon corps qu’il me semble que je vais mourir ; dans les autres je ne sens pas mon corps, je suis souvent toute joyeuse, quelquefois aussi je suis triste. Je me réjouis de la grande miséricorde de Dieu envers les pécheurs, qu’il va chercher pour les ramener et qu’il accueille ensuite avec tant d’amour. Puis je m’attriste sur les péchés des hommes, et je gémis de ce que Dieu est si horriblement offensé. »
« Souvent dans la méditation, il me semblait contempler le ciel et y voir Dieu. Quand j’étais dans l’amertume ; il me semblait souvent que je marchais sur un sentier très étroit, large à peine comme le doigt. Des deux côtés je voyais de noirs abîmes sans fond : ou bien tout me paraissait beau et verdoyant, et un jeune homme resplendissant me tendait la main et me conduisait sur l’étroit sentier. Souvent aussi Dieu me disait quand j’étais dans la désolation et la sécheresse : « Ma grâce te suffit », et cela m’était bien doux à entendre. »
6. Il arrivait aussi assez fréquemment qu’Anne Catherine, dans l’état d’extase, recevait de son ange l’ordre de rappeler à ses sœurs l’observation de la règle. Elle paraissait ensuite devant elles sans sortir de cet état, et citait, en versant des torrents de larmes, les prescriptions de la règle qui se rapportaient au silence, à l’obéissance, à la pauvreté, à l’office divin, à la discipline claustrale et qui étaient le plus fréquemment violées. Souvent elle se jetait aux pieds d’une sœur chez laquelle elle voyait s’élever des mouvements d’aversion ou même de haine prononcée, la suppliait de pardonner et d’être charitable, et l’aidait par là à surmonter la tentation et à reconnaître combien de pareils sentiments étaient coupables. Ces humbles supplications avaient assez souvent pour résultat que les religieuses, au lieu de prendre mal la chose et de se fâcher, se sentaient poussées ou forcées en quelque sorte à aller trouver Anne Catherine pour s’ouvrir à elle et même à lui dévoiler leur intérieur. Elles lui demandaient alors ses conseils et ses prières pour remédier à leurs manquements : mais elles retombaient facilement dans des accès de mauvaise humeur et devenaient méfiantes, s’il leur semblait trop pénible de suivre le conseil reçu, de pratiquer telle ou telle mortification, de remporter sur elles-mêmes telle ou telle victoire qui leur eût été pourtant si nécessaire. Il s’éveillait dans ces faibles cœurs de nouveaux soupçons ; elles s’imaginaient qu’Anne Catherine maintenant ne cessait de penser aux manquements et aux fautes dont elles s’étaient accusées devant elle, tandis qu’en réalité elle n’y pensait pas le moins du monde : car elle avait coutume de recevoir ces sortes de confidences intimes comme quelque chose qui lui aurait été communiqué en vision, et elle n’en conservait le dépôt que pour Dieu et en vue de l’âme qui avait besoin de son assistance. En outre, quand elles lui étaient faites, elle écoutait bien moins la voix de la personne qui lui parlait que la voix de son guide céleste, parce qu’elle demandait à Dieu la lumière nécessaire pour donner de bons conseils et une utile assistance à celle qui en avait besoin, et c’est pourquoi dans ces moments-là, toute personnalité disparaissait pour ainsi dire à ses yeux.
7. « Souvent aussi, disait-elle, pendant que j’étais occupée d’un travail, ou malade et couchée dans mon lit, je me trouvais en même temps présente en esprit parmi mes sœurs ; je voyais et j’entendais ce qu’elles faisaient et disaient, ou bien je me trouvais dans l’église devant le Saint-Sacrement quoique je n’eusse point quitté ma cellule. Comment cela se faisait-il, c’est ce que je ne puis dire. La première fois de ma vie que je m’aperçus de quelque chose de semblable, je crus que c’était un rêve. C’était dans ma quinzième année, lorsque je demeurais hors de la maison paternelle. J’avais été poussée à prier pour une fille légère afin de l’empêcher d’être séduite : une fois pendant la nuit, il me sembla voir qu’on tendait un piège à cette fille. Dans mon angoisse, je courus bien vite à sa chambre, je chassai le valet de la maison qui se trouvait devant la porte et j’entrai dans la chambre où je trouvai la fille dans un grand effroi. En réalité je n’avais pas quitté mon lit et je regardai cela comme un simple rêve. Le lendemain matin la fille était très intimidée devant moi et n’osait me regarder en face. Plus tard elle me raconta toute l’histoire avec de grands remerciements, disant que j’avais chassé le tentateur, que j’étais venue dans sa chambre et l’avais défendue de la séduction. Alors il me fallut bien penser que ç’avait été quelque chose de plus qu’un simple rêve. À une époque postérieure de ma vie, il m’arriva très souvent des choses du même genre. Ainsi une femme que je n’avais jamais vue des yeux du corps vint à moi tout émue, et quand elle put me parler seule, fondit en larmes, me remercia et me raconta avec un grand repentir sa faute et sa conversion. Alors je la reconnus, elle et son histoire : c’était un travail par la prière qui m’avait été précédemment imposé par Dieu.
8. « Ce n’est pas toujours en esprit seulement que j’ai été envoyée au secours de pauvres personnes comme celle-là, mais j’y suis allée aussi corporellement. Il y avait dans les bâtiments du couvent des domestiques laïques ; or, une fois que j’étais retenue au lit par une grave maladie, je vis là pendant la nuit deux personnes qui tenaient ensemble des discours pieux en apparence, mais dont le cœur était plein de mauvaises pensées. Je me levai voyant clair, et je me rendis par le cloître aux bâtiments en question afin de séparer ces gens. Quant ils me virent venir, ils s’enfuirent effrayés et me témoignèrent par la suite de la mauvaise humeur. Comme je m’en retournais, je revins à moi : je me trouvai au milieu de l’escalier du couvent et je ne pus regagner ma cellule qu’à grand-peine, tant j’étais faible.
9. « Une autre fois une des sœurs crut m’avoir vue près du foyer de la cuisine, prenant quelque chose dans un pot pour le manger en cachette, ou cueillant des fruits dans le jardin. Elle courut aussitôt trouver la supérieure pour lui révéler la fourberie : mais on me trouva couchée dans ma cellule et malade à la mort. De tels incidents faisaient de mon état quelque chose de pénible pour les autres religieuses qui ne savaient pas ce qu’elles devaient penser sur mon compte. »
10. Depuis qu’Anne Catherine était entrée dans le convent, aucune souffrance ne lui parut pouvoir être mise en balance avec le suprême bonheur d’habiter dans le voisinage du très saint Sacrement et de pouvoir passer en sa présence une grande partie de la journée. Était-elle dans sa cellule, ou se trouvait-elle occupée à travailler dans quelque autre endroit du couvent, elle se tournait comme involontairement vers le tabernacle de l’Église, car le sentiment de la présence réelle et vivante du Seigneur n’était jamais absent de son cœur. Ni l’éloignement, ni l’épaisseur des murailles ne pouvaient être pour son œil une barrière qui l’empêchât de se porter vers le saint Sacrement, en quelque partie du couvent qu’elle se trouvât : car chaque fois qu’elle y pensait avec amour, cette pensée la mettait en état de contemplation, et si l’obéissance n’enchaînait pas l’aspiration de son âme, elle se trouvait prosternée sur les degrés de l’autel, en même temps qu’elle était corporellement dans sa cellule ou au travail devant ses compagnes. Dans tout ce que la règle du couvent lui imposait, elle savait trouver quelque chose qui se rapportait au saint Sacrement, et c’est pourquoi elle était aussi fidèle et aussi scrupuleuse dans les plus petites choses que dans les grandes. Les arrangements qu’elle avait à faire en qualité de sacristine étaient spécialement pour elle une fonction si sainte qu’elle était souverainement heureuse de ne pouvoir s’en acquitter qu’avec de grandes douleurs physiques : car elle savait qu’elle semait le roi des rois et que les anges lui portaient envie pour cela. Ainsi elle était à la lettre incessamment tournée vers son Seigneur dans le saint Sacrement comme la fleur vers le soleil ; tout était dirigé vers lui, son corps et son âme, ses pensées et ses sentiments, avec tous les trésors dont son cœur était rempli ; tout faisait monter vers lui le doux parfum de l’amour et de la souffrance. Et ses souffrances pour le saint Sacrement étaient grandes connue son amour : car aucun péché ne criait plus haut vers le ciel et n’avait un plus grand besoin d’expiation que celui dont les hommes de cette époque se rendaient coupables en s’attaquant à l’adoration et à la confession de la présence réelle. Au temps même où brûlait dans le cœur d’Anne Catherine une flamme d’amour assez puissante pour réchauffer une multitude d’âmes, non seulement les maisons de Dieu étaient profanées et détruites en très grand nombre, mais la lumière de la foi à la présence vivante de Dieu dans le Sacrement menaçait de s’éteindre presque partout, parce que la haine de la secte janséniste avec ses prétendues lumières cherchait à bannir des églises le sacrifice non sanglant et les saintes solennités qui en entourent l’offrande depuis son institution, de même qu’à chasser des cœurs la vénération envers la très sainte Vierge. Toute la suite de ces abominations passait devant son âme, et la remplissait d’une tristesse indicible, chaque fois qu’elle s’agenouillait devant l’autel ; c’était comme si elle avait eu à supporter corporellement à la place de son fiancé les douleurs causées au cœur de Jésus par les outrages envers le saint Sacrement. Où aurait-il pu chercher une compensation pour ces injures puisque ses plus cruels ennemis étaient dans les rangs de ceux auxquels il avait confié le pouvoir le plus élevé sur le gage de son amour ? Souvent Anne Catherine, dans les ténèbres de la nuit, se réfugiait devant l’Église fermée et restait devant la porte à gémir et à se consumer dans la douleur et le désir jusqu’à ce que, toute transie de froid, elle pût y être introduite au point du jour. Car aux peines expiatoires qu’elle supportait pour l’amour du Sauveur, elle ne pouvait trouver d’adoucissement et de consolation que dans son voisinage. Or ses souffrances étaient aussi diverses que les péchés des hommes de son siècle contre le saint Sacrement. Depuis la tiédeur et l’indifférence du commun des chrétiens dans la préparation et l’action de grâces avant et après la sainte communion jusqu’aux sacrilèges des ennemis de l’Église, il n’y avait rien pour quoi elle n’eût à faire pénitence, et elle aurait bien vite succombé à cette terrible tâche, si Dieu ne se fût hâté d’effacer de son âme les violentes et terribles impressions des tableaux où elle voyait ces crimes et s’il ne l’avait pas remplie de ses consolations. Plus sa merveilleuse intuition de la magnificence et de la grandeur du sacrement devenait vive et profonde, plus ses aspirations vers lui devenaient ardentes, plus aussi augmentaient sa dévotion, sa sainte vénération et son humilité intérieure : il arrivait ainsi que toutes les fois qu’elle devait recevoir la sainte communion, il s’élevait en elle une lutte entre l’amour enflammé de désir et la sainte frayeur d’une créature accablée par le sentiment de son indignité et de ses fautes, lutte à laquelle l’obéissance seule pouvait mettre un terme. Jamais elle ne cessa de craindre que ce ne fût elle qui, par suite de ses imperfections, fût la première responsable de tant d’infractions faites à la règle de l’ordre et de tant d’atteintes portés à la charité par ses sœurs : et c’est pourquoi dans son humilité sincère, elle n’osait pas s’approcher de la sainte table aussi souvent qu’elle en avait besoin et que le voulait son confesseur.
11. Voici ce qu’Overberg rapporte à ce sujet :
« Son confesseur voulait qu’elle communiât plus souvent que ses compagnes n’avaient coutume de le faire. Elle le fit pendant quelque temps, mais elle y renonça, contrairement à la volonté du confesseur, depuis la Purification jusqu’un peu après la Pentecôte, et cela, par respect humain, parce que sa communion fréquente était regardée comme une affectation de sainteté et qu’on tenait à ce sujet toute sorte de propos. Eu outre, elle se regardait comme trop mauvaise pour pouvoir communier si souvent. Mais elle tomba par là dans un si triste état qu’elle ne savait plus que faire pour en sortir, et que souvent elle ne pouvait s’empêcher de murmurer et de se plaindre. À la fin, elle reconnut la faute qu’elle avait commise en ne suivant pas les avis de son confesseur et se remit à communier plus fréquemment. Toutefois, il lui fallut expier cette désobéissance durant deux ans, car, pendant ce temps, toute consolation lui fut retirée et elle fut laissée dans une sécheresse complète.
« Au bout de ces deux ans, les consolations revinrent et elle ressentit un si ardent désir de la sainte communion qu’elle ne pouvait attendre l’heure ordinaire pour la recevoir. Son confesseur régla donc les choses de manière à ce qu’elle pût faire ses communions extraordinaires avant le lever des autres sœurs, afin que la chose fût moins connue et ne fît pas d’effet. Elle allait alors frapper à la porte de l’abbé Lambert qui avait la bonté de lui donner la sainte communion de très grand matin.
« Elle venait souvent avant le temps marqué, parce qu’elle ne pouvait résister plus longtemps à la violence du désir qui la portait vers le saint Sacrement. Une fois elle vint très peu de temps après minuit, parce que son désir était si ardent qu’elle se croyait au moment d’en mourir. C’était comme si tout son intérieur eût été en feu et elle se sentait attirée vers l’église avec une telle violence que ses membres semblaient près d’être arrachés de son corps. L’abbé Lambert fut très mécontent de l’entendre frapper si tôt à sa porte : mais quand il vit dans quel état elle se trouvait, il vint lui donner la sainte Eucharistie.
12. « Elle assistait à la sainte messe avec une dévotion extrême. Quand le prêtre commençait les prières, elle se transportait en esprit sur la montagne des oliviers et y contemplait Jésus. Elle priait alors Dieu pour tous les hommes afin qu’il leur fît la grâce d’assister pieusement à la sainte messe ; pour le prêtre afin qu’il offrît le saint sacrifice de la manière la plus agréable à Dieu ; enfin pour que Jésus voulût bien jeter sur tous les assistants un regard miséricordieux comme il l’avait fait pour saint Pierre.
« Au Gloria, elle louait Dieu avec tous les anges, tous les saints, tous les pieux chrétiens existant sur la terre et rendait grâce au Sauveur de ce qu’il renouvelle tous les jours son sacrifice : elle le priait d’éclairer tous les hommes et de consoler les pauvres âmes du purgatoire.
« À l’Évangile, elle demandait à Dieu pour elle-même et pour tous les autres hommes la grâce de bien pratiquer les enseignements évangéliques.
« À l’Offertoire, elle offrait à Dieu le pain et le vin avec le prêtre et priait pour qu’ils fussent changés au corps et au sang de Jésus-Christ : elle se disait aussi que le moment où le Sauveur allait venir était proche.
« Au Sanctus, elle priait afin que le monde entier s’unît à elle pour louer Dieu.
« À la Consécration, elle députait le Sauveur vers le père céleste, l’offrait pour le monde entier, spécialement pour la conversion des pécheurs, pour le soulagement des âmes du purgatoire, pour ceux qui se trouvaient à l’article de la mort, et pour ses sœurs les religieuses. Elle se représentait alors l’autel comme entouré d’anges qui n’osaient pas lever les yeux sur le Sauveur et se disait qu’il serait bien audacieux à elle de regarder l’autel et qu’elle ne devait pas se le permettre.
13. « Souvent elle voyait autour du Saint-Sacrement une lumière éblouissante, souvent aussi dans la sainte hostie une croix de couleur brune, ou d’une autre couleur, quoique jamais blanche. Si elle eût été blanche comme l’hostie, elle n’aurait pas pu la voir. La croix ne lui apparaissait pas plus grande que l’hostie, mais l’hostie elle-même était souvent alors plus grande que les hosties ordinaires.
« Depuis l’élévation du calice jusqu’à l’Agnus Dei, elle priait pour les âmes du purgatoire, présentait à Dieu le Christ sur la croix et demandait que celui-ci accomplît ce qu’elle-même ne pouvait pas faire. Souvent alors elle était tout à fait absente (hors d’elle-même), ce qui arrivait aussi quelquefois avant la consécration.
« À la communion, elle pensait à la mise au tombeau de Jésus-Christ et le priait d’ensevelir le vieil homme et de nous revêtir de l’homme nouveau. »
Si pendant la sainte messe ou en tout autre moment, elle entendait le chant ou l’orgue, elle se disait : « Ah ! qu’il est beau de voir ainsi tout en parfait accord ! Les choses inanimées forment entre elles une aimable harmonie : pourquoi les cœurs des hommes ne font-ils pas de même ! combien ce serait charmant ! » Et alors elle ne pouvait s’empêcher de pleurer.
14. « À Noël, pendant la messe de minuit, elle vit une fois le saint enfant Jésus au-dessus du calice. Ce qui lui parut très singulier, c’est que le prêtre lui semblait tenir l’enfant par les pieds et que, malgré cela, elle voyait aussi le calice. Du reste il lui est arrivé souvent de voir l’enfant dans la sainte hostie, mais très petit.
« Lorsqu’elle était sacristine, elle occupait au chœur une place d’où elle ne pouvait pas voir l’autel : elle avait cédé celle qui lui appartenait à une sœur qui était tourmentée de scrupules quand elle entendait la messe sans pouvoir voir l’autel. Un jour qu’elle se tenait prête à sonner la cloche pour l’élévation, elle vit l’enfant Jésus au-dessus du calice. Oh ! comme il était beau ! Elle se croyait déjà dans le ciel et voulut sauter par-dessus la grille pour aller à l’enfant. Alors elle se dit tout à coup : « Mon Dieu ! qu’est-ce que je vais faire ? » et elle ne franchit pas la grille, mais elle oublia de tinter. Elle l’oubliait souvent au milieu de la messe, et cela lui attirait des réprimandes. »
15. Clara Soentgen a déposé en ces termes : « Quand la sœur Emmerich avait reçu la sainte communion, cela la fortifiait toujours et elle m’a dit souvent que Dieu lui donnait alors beaucoup plus de force. Elle aimait beaucoup à communier le jeudi en l’honneur du Saint-Sacrement. Mais comme cela faisait de l’effet et donnait lieu à beaucoup de bavardages dans le couvent, elle reçut de son confesseur la permission de recevoir la sainte communion en secret. Elle allait la recevoir, tantôt un peu après minuit, tantôt à trois ou quatre heures du matin, parce que le désir ardent qu’elle en avait lui rendait impossible d’attendre plus longtemps.
« Je lui demandai une fois pourquoi, le jeudi, elle s’habillait mieux que les autres jours. Elle me répondit que c’était en l’honneur du très saint Sacrement. Avant et après la communion, elle se servait rarement d’un livre de prières, mais elle méditait toujours. »
16. Anne Catherine eut plus tard l’occasion de dire ce qui suit :
« J’ai très souvent vu le sang couler de la croix empreinte sur la sainte hostie. Je le voyais clairement et distinctement. Bien des fois j’ai vu le Seigneur sous la forme d’un enfant environné d’une lumière rougeâtre, paraître comme un éclair dans la sainte hostie. Souvent au moment de la communion, je vois le Sauveur paraître comme fiancé tout près de moi, puis disparaître lorsque je reçois le Saint-Sacrement, et je ressens sa présence avec une douceur inexprimable. Quand il entre dans la personne qui communie, il monte et se répand dans l’âme tout entière comme lorsqu’un morceau de sucre se dissout dans l’eau. Il pénètre d’autant plus profondément que le désir de celui qui le reçoit est plus ardent. »
17. Overberg dépose en ces termes sur sa manière de faire l’oraison dans d’autres circonstances :
« Au couvent, comme avant d’y entrer, elle a toujours prié pour les âmes du purgatoire et pour les pécheurs ; au couvent elle priait aussi pour ses compagnes, plus rarement pour elle-même. Sauf les prières qu’elle était obligée de faire conformément à la règle, elle faisait peu de prières vocales ; mais très fréquemment des oraisons jaculatoires. Sa prière habituelle consistait à parler à Dieu comme un enfant à son père : le plus ordinairement, elle obtenait de lui ce qu’elle lui demandait avec une insistance particulière.
18. « Elle ne cessait de s’entretenir avec Dieu nuit et jour, même à table, ou bien elle méditait. C’est pourquoi souvent elle ne remarquait rien de ce qui se disait pendant le repas. Si l’on portait alors des plaintes contre elle, elle ne s’en apercevait que quand cela devenait trop fort. L’abbé Lambert lui demanda un jour après le repas : « Comment pouvez-vous prêter l’oreille à des discours comme ceux qu’on a tenus tout le temps à table ? » mais elle n’avait pas fait la moindre attention à ce qui s’était dit.
19. « Pendant un temps aussi, elle avait coutume de disputer contre Dieu sur ce qu’il ne convertissait pas tous les grands pécheurs et punissait les impénitents de peines éternelles dans l’autre monde. Elle disait à Dieu qu’elle ne comprenait pas comment il pouvait agir ainsi, contrairement à sa nature qui était la bonté même : il lui était pourtant bien facile de convertir les pécheurs, puisque tout était dans sa main. Pouvait-il oublier tout ce que lui et son Fils bien-aimé avaient fait pour les pécheurs et comment celui-ci avait versé son sang sur la croix et avait souffert une mort si douloureuse ? Il devait pourtant se souvenir de ses propres paroles dans les saintes Écritures, de ce qu’il y dit de sa bonté et de sa miséricorde et des promesses qu’il y a faites. Si lui-même ne tenait pas sa parole, comment pouvait-il demander aux hommes de tenir la leur ?
20. « L’abbé Lambert auquel elle racontait cette dispute lui disait : « Doucement : tu vas trop loin ! » Elle finit pourtant par voir clairement que les choses étaient comme elles devaient être, car si Dieu convertissait tous les pécheurs, ou si les peines de l’autre vie avaient un terme, les hommes ne tiendraient plus aucun compte de Dieu et ne s’enquerraient de lui en aucune façon.
21. « Elle a toujours eu une confiance particulière dans la Mère de Dieu et elle se tournait avec plus d’ardeur vers elle quand elle avait péché. Elle la priait ainsi ordinairement : « Ô Mère de mon Sauveur, vous êtes doublement ma mère. Votre Fils vous a donnée à moi pour mère quand il s’est fait homme et quand il a dit à Jean : « Voilà ta mère. » Puis je suis devenue l’épouse de votre Fils. J’ai été désobéissante envers votre Fils, mon fiancé, et j’ai honte de me laisser voir à lui. Ayez donc pitié de moi ! Le cœur d’une mère est toujours si tendre ! priez pour que j’obtienne mon pardon ! il ne vous sera pas refusé.
22. « Peu de temps avant la suppression du couvent, un jour qu’elle avait cherché inutilement de la consolation près d’une personne, elle courut en pleurant à travers le cloître, de la porte de l’école à l’église, se prosterna devant le Saint-Sacrement et cria merci. Elle était presque tombée dans le désespoir parce qu’il lui semblait qu’elle seule était cause de tout ce qui se faisait de mal dans la maison. Dans son affliction elle pria ainsi :
« Ô mon Dieu, je suis l’enfant prodigue. J’ai dissipé l’héritage que vous m’aviez donné. Je ne suis pas digne d’être appelée votre enfant, ayez pitié de moi ! Accueillez-moi, je vous en supplie au nom de votre douce mère qui est aussi ma mère. »
« Alors elle reçut de Dieu la réponse qu’elle devait rester en paix, que sa grâce lui suffisait, qu’elle ne devait plus à l’avenir chercher sa consolation près des hommes.
23. « Bien des fois aussi, quand elle implorait instamment quelque chose et faisait de grandes promesses, elle reçut de Dieu cette réponse : « Comment peux-tu promettre de grandes choses quand les petites te sont si difficiles ! »
24. Le doyen Rensing, de son côté, a déposé ce qui suit :
« Elle faisait les prières communes avec les sœurs selon qu’elles étaient prescrites, et de même les autres prières vocales qu’elle avait à faire. Mais quand elle priait pour autrui en son particulier (c’est-à-dire mentalement), elle présentait à Dieu sa requête et lui demandait du fond du cœur de vouloir bien l’exaucer : elle ajoutait un Pater noster ou quelque autre courte prière et souvent elle allait jusqu’à entrer en contestation avec Dieu.
25. « Du reste, elle faisait plus volontiers l’oraison mentale que la prière vocale. Elle se faisait d’abord cette question : « Que devrais-tu être, et qu’es-tu ? » Elle allait ensuite de plus en plus avant, en sorte que sa méditation durait souvent très longtemps et qu’elle-même ne savait plus comment elle avait passé d’un point à l’autre. »
26. Clara Soentgen a déposé ainsi :
« La sœur Emmerich m’a raconté que, depuis l’Ascension jusqu’à la Pentecôte, elle était toujours livrée à une contemplation intérieure, où elle voyait les disciples rassemblés dans une salle pour demander le Saint-Esprit, et qu’elle-même s’enfermait avec eux dans cette salle. Elle restait dans cet état de contemplation même quand elle était en compagnie. Cela avait déjà lieu avant son entrée au couvent et, pendant ces dix jours, elle avait coutume de faire plusieurs fois la sainte communion. Au couvent, elle était tellement plongée dans cette contemplation, qu’à table, où j’étais assise auprès d’elle, j’étais souvent obligée de la secouer pour qu’elle mangeât. »
27. Anne Catherine elle-même a dit une fois :
« Je ne puis faire usage des prières de l’Église traduites en allemand. Elles sont pour moi trop insipides et trop rebutantes. Dans la prière je ne suis liée à aucune langue et, dans tout le cours de ma vie, les prières latines de l’Église m’ont toujours paru beaucoup plus profondes et plus intelligibles. Au couvent, je me réjouissais toujours d’avance quand nous devions chanter des hymnes et des répons en latin. La fête était alors plus vivante pour moi et je voyais tout ce que je chantais. Notamment quand nous chantions en latin les litanies de la sainte Vierge, j’y voyais successivement dans une merveilleuse vision toutes les figures symboliques de Marie. C’était comme si mes paroles eussent fait apparaître ces images, et au commencement j’étais tout effrayée de cela ; mais bientôt ce fut pour moi une grâce et une faveur qui excitaient beaucoup ma dévotion. J’ai vu là les tableaux les plus admirables. »
XVI
SUPPRESSION DU COUVENT. – ANNE CATHERINE REÇOIT LES STIGMATES.
1. Le 3 décembre 1811, le couvent d’Agnetenberg fut supprimé et l’église fermée. Quoiqu’Anne Catherine eût depuis longtemps vu d’avance cet évènement infiniment douloureux pour elle et quoiqu’elle eût offert à Dieu de souffrir toutes les peines imaginables pour détourner ce malheur, elle ne se crut pourtant pas de force à quitter ainsi pour toujours des lieux qui lui étaient si chers. La séparation de l’âme d’avec le corps lui paraissait quelque chose de plus facile que sa séparation d’avec le lieu où elle s’était donnée au fiancé céleste par les saints vœux de religion, afin d’y vivre cachée au monde et d’y servir Dieu dans la souffrance. « Je devins si malade, raconta-t-elle plus tard, que les autres religieuses crurent que j’en mourrais infailliblement. Alors la mère de Dieu m’apparut et me dit : « Tu ne mourras pas encore. On fera encore beaucoup de bruit à ton sujet : mais ne crains rien ! quoi qu’il t’arrive, tu seras toujours secourue. » Plus tard, j’entendis dans toutes mes maladies la voix intérieure qui me disait que je n’étais pas encore prête. » Pendant que les autres religieuses quittaient le couvent les unes après les autres, Anne Catherine y resta encore jusqu’au printemps de l’année suivante. Elle fut pendant tout ce temps si faible et si malade qu’elle ne put pas sortir de sa cellule. Les scènes pénibles occasionnées si souvent par l’antipathie des autres sœurs n’avaient jamais pénétré dans cette sombre, humide et froide cellule. Elle y était toujours seule, abandonnée à elle-même et à ses souffrances. Mais les colombes et les moineaux venaient la visiter familièrement sur la fenêtre, les souris sautaient sur sa couverture pour jouer près d’elle et recevoir ses reproches quand elles avaient détruit les œufs d’un nid de colombes. Et maintenant, si l’abbé Lambert et une vieille servante du couvent n’avaient pas eu pitié d’elle et ne lui avaient pas rendu par charité les services les plus nécessaires, elle serait restée oubliée de tous les humains. Les autres sœurs étaient trop occupées de leurs propres affaires pour penser à Anne Catherine ou tourner les yeux vers elle. Cependant, à peiné l’eurent-elles perdue de vue quelque temps qu’aucune d’elles ne sut plus dire pourquoi elles avaient été si malveillantes à son égard. Car, lorsqu’il leur fallut rendre réponse aux supérieurs ecclésiastiques qui leur demandaient « d’où venait qu’Anne Catherine n’était pas aimée dans le couvent et y avait été tellement tourmentée », toutes donnèrent leur assentiment à ces paroles de la maîtresse des novices : « Anne Catherine, il est vrai, n’était pas très aimée, mais je ne sais pas au juste d’où cela venait. » Seule, la révérende mère essaya de donner une raison et dit : « Cela venait, à ce qu’il me semble, de ce que plusieurs ne pouvaient supporter que l’abbé Lambert s’occupât particulièrement d’elle, et en outre quelques-unes croyaient qu’avec ses maladies elle était une trop lourde charge pour le couvent. »
2. L’abbé Lambert, lui-même malade, exilé et sans une âme sur la terre près de laquelle il pût espérer de trouver quelque sympathie pour sa vieillesse et sa cruelle position, resta fidèlement près d’Anne Catherine dans cette détresse extrême. Ce qu’il avait observé en elle depuis dix ans, lorsque personne n’avait le moindre soupçon de la direction merveilleuse à laquelle elle était soumise et qu’elle lui avait fait connaître, il l’avait jusqu’alors gardé fidèlement pour lui. Il se crut appelé par Dieu à protéger contre les hommes, autant qu’il le pouvait, le mystère de la vie d’Anne Catherine et sa personne elle-même en tant qu’instrument choisi de Dieu ; il vit en elle comme un trésor précieux dont il n’aurait à rendre compte qu’à Dieu, puisque lui seul avait reçu la grâce d’en bien connaître la valeur. C’est pourquoi, lorsqu’il devint impossible qu’Anne Catherine restât plus longtemps dans le couvent, il alla avec elle dans la maison de la veuve Roters, à Dulmen. Elle était encore si malade qu’elle ne put qu’à grand-peine, traînée dans la ville par la vieille servante, gagner la petite chambre située sur la rue, au rez-de-chaussée, qui devait remplacer pour elle la paisible cellule dont la sainte pauvreté s’était si souvent montrée à elle comme le ciel sur la terre.
« J’étais si inquiète et si effrayée », raconta-t-elle, « que, lorsqu’il me fallut sortir du couvent, je croyais que chaque pierre de la rue allait me dévorer. »
3. À peine eut-elle été conduite dans sa misérable petite chambre où retentissaient tous les pas des passants et où rien ne pouvait se dérober aux regards de la rue, parce que l’appui de la fenêtre était à peine élevé de quelques pieds au-dessus du sol, qu’elle tomba dans un état de langueur très grave. Il semblait qu’elle allait se flétrir, comme une plante qui, du haut d’une montagne éclairée du soleil et que le pas d’aucun homme n’a touchée, serait jetée sur une route poudreuse dans un sombre bas-fond. Bien que le couvent ne connût plus la stricte observation de la règle religieuse, cependant c’était pour elle un lieu consacré à Dieu et sanctifié par les prières et les œuvres de pénitence de celles qui l’avaient habité autrefois, dans des temps meilleurs, et où elle-même s’était appliquée sans relâche à accomplir aussi parfaitement que possible tous les devoirs de l’état religieux. Elle s’était comme identifiée avec la discipline conventuelle ; la prière au chœur et tous les restes des saints exercices de piété qui s’étaient encore conservés malgré les envahissements de la décadence, étaient, pour son âme brûlante du zèle de la gloire de Dieu, comme un aliment nécessaire à sa vie et que rien ne pouvait remplacer. Mais avant tout, le voisinage du très saint Sacrement et la maison de Dieu accessible pour elle à tous les instants, étaient, pour une créature si merveilleusement conduite par Dieu, la chose principale, celle qui lui était le plus nécessaire pour pouvoir rester sur la terre et y accomplir sa tâche. Tout cela maintenant lui est enlevé ; du fond de l’asile consacré à Dieu où sa vie était cachée, elle est jetée sans appui et sans assistance dans un coin placé sur la voie publique pour y commencer la dernière et la plus pénible partie de sa mission pour l’Église.
4. Qu’un peu avant le commencement du Carême de l’an 1812, une pauvre nonne malade se fît conduire à travers les rues de la petite ville jusqu’alors très ignorée de Dulmen, c’était sans doute un évènement bien obscur et bien vulgaire aux yeux des hommes. Pourtant, devant Dieu et dans l’intérêt de son Église, il y avait là une disposition providentielle d’une importance incalculable : car, sur cette pauvre vierge du cloître usée par les peines et les macérations, privée de tout appui, méprisée du monde, persécutée à cause de sa profession, Dieu a placé toutes les tribulations de son Église maltraitée et méprisée, comme cela ne lui était peut-être jamais arrivé depuis sa fondation, à l’égal d’un cadavre d’où la vie s’est retirée. Mais de même que l’Homme-Dieu en personne a voulu opérer notre rédemption, comme « le rejeton sorti d’une terre altérée 13 », comme le plus méprisé et le dernier des hommes, comme l’homme de douleurs, couvert de blessures et brisé à cause de nos crimes ; de même qu’il n’a pas voulu empêcher que la parole de la croix devînt un scandale pour les Juifs et une folie pour les Gentils, de même, dans tous les temps, il a conduit son Église et l’a sauvée dans le danger en choisissant ce qui est folie aux yeux du monde pour confondre les sages, ce qui est faible pour vaincre les forts, ce qui est petit, méprisé, ce qui est comme un néant pour renverser ce qui est quelque chose 14. Voulant accomplir cette opération si incompréhensible au monde, si sublime pour les habitants du ciel et si consolante pour les fidèles, il tire maintenant sa fiancée de la retraite profonde où, sous sa direction, elle a conquis la force spirituelle qui surpasse toute sagesse et toute grandeur humaines, afin qu’elle procure le salut de l’Église à laquelle elle est substituée comme victime expiatoire.
Un grand nombre de religieux des deux sexes avaient quitté sans regret les saintes demeures et s’étaient hâtés de rentrer dans le monde dont, en dépit de leurs vœux solennels, ils ne s’étaient jamais détachés intérieurement. Partout on rencontrait des moines et des prêtres impies qui se mettaient au service de la puissance laïque, pour infecter du poison de l’erreur et de la révolte contre la hiérarchie sacrée et les traditions de l’Église les cœurs de ceux qui étaient appelés à remplir, d’une manière bien insuffisante, les vides chaque jour plus nombreux faits par la mort dans les rangs du sacerdoce. C’est pourquoi la sainteté et la dignité du caractère sacerdotal ainsi que les grâces et les pouvoirs qui y sont attachés étaient alors méprisés et niés par ceux-mêmes qui en étaient revêtus ; et les ennemis du nom chrétien n’étaient pas les seuls auxquels l’anéantissement de l’Église semblât un fait à peu près accompli, car même la petite troupe de ceux qui étaient restés fidèles était découragée au point d’avoir perdu toute espérance. C’est cet état de tribulation de l’Église dans toute son étendue et avec toutes ses conséquences qu’Anne Catherine doit maintenant prendre sur elle ; et voilà pourquoi elle est couchée le long de la voie publique, sans protection et comme mise hors la loi, livrée sans assistance, ainsi que l’Église elle-même, à la méchanceté de quiconque veut l’outrager et lui nuire. C’est l’Église avec son fiancé céleste qui souffre et gémit dans la personne d’Anne Catherine, et nous verrons avec surprise dans tout le cours de cette vie pleine de mystères, comment tout ce que pouvaient faire souffrir à l’Église la déraison, l’aveuglement et la méchanceté du monde venait prendre place dans la sphère de ses souffrances expiatoires.
5. L’état d’Anne Catherine empira si promptement que son entourage la crut à toute extrémité : alors son ancienne maîtresse des novices fit appeler le P. Limberg, dominicain, qui habitait Dulmen depuis la suppression de son couvent à Munster, et le pria de la confesser. Voici ce qu’il a raconté à ce sujet :
« Dans le Carême de 1812, ma tante, ancienne maîtresse des novices de la sœur Emmerich, me fit appeler pour entendre celle-ci en confession. Je m’y refusai en alléguant qu’il fallait une permission spéciale pour confesser une religieuse ; mais comme on m’assura que cette restriction n’existait plus, je me rendis auprès d’elle sur la demande de ma tante. Je la trouvai dans un si triste état qu’elle ne pouvait plus parler et je fus obligé de l’interroger sur ce qui touchait à sa conscience. Je la croyais à l’extrémité et je lui portai aussitôt tous les sacrements des mourants. Mais elle se rétablit et je devins dès lors son confesseur ordinaire. Auparavant, ç’avait été le P. Chrysanthe, augustin, mort depuis peu. Elle portait une ceinture de pénitence en fil de laiton et un cilice de crin en forme de scapulaire que je lui fis ôter.
« Antérieurement, je n’avais pas connu particulièrement la sœur Emmerich : je l’avais seulement vue quelquefois. Je disais souvent la sainte messe dans l’église du couvent et je le faisais volontiers parce que tout y était d’une grande propreté. Cela m’avait aussi fait faire connaissance avec le chapelain du couvent, l’abbé Lambert. La sœur Emmerich était sacristine et je l’avais vue plus d’une fois aller et venir ; elle paraissait dans un si triste état que je la regardais comme perdue et que je me disais souvent : « Quoi donc ! cette pauvre personne vit encore ! »
6. Pendant tout le temps du Carême, Anne Catherine fut hors d’état de se lever de son lit ; du reste la plupart du temps son esprit était absent, ce que l’entourage prenait pour des évanouissements causés par son extrême faiblesse. À partir de Pâques, elle put, quoiqu’avec beaucoup de difficulté, gagner l’église paroissiale pour y faire la sainte communion : mais elle y alla pour la dernière fois le 2 novembre 1812, car depuis lors il lui fut à jamais impossible de quitter son lit de douleur. Au mois de septembre, elle était encore allée en pèlerinage à un lieu appelé l’Hermitage, qui est tout proche de Dulmen. Un ermite de l’ordre de saint Augustin y avait vécu et près de sa demeure était une petite chapelle. Anne Catherine voulait y demander l’adoucissement de souffrances qui lui étaient devenues intolérables ; mais elle tomba en extase, ce qui la rendit raide et immobile comme une statue. Une jeune fille qui l’accompagnait, saisie d’effroi, appela au secours une paysanne qui donna à Anne Catherine les soins qu’elle eût donnés à une personne évanouie, et ce fut ainsi qu’elles découvrirent sur sa poitrine une croix saignante qui y avait été imprimée à la dernière fête du saint patron de son ordre, mais qu’elle-même n’avait jamais vue.
Quand elle revint à elle, elle était si faible que la paysanne et la jeune fille furent forcées de la rapporter à son logis.
7. Trois jours avant le commencement de la nouvelle année 1813, la fille de la veuve Roters trouva Anne Catherine en extase ; elle priait, les bras étendus. Cette fille s’aperçut que le sang jaillissait de la paume de ses mains, mais elle crut que c’était par suite de quelque blessure accidentelle. Lorsqu’Anne Catherine revint à elle, elle lui fit remarquer que son sang coulait, sur quoi celle-ci la pria de ne parler de cela à personne. Mais le 31 décembre, le père Limberg lui porta la sainte communion et vit alors pour la première fois des plaies saignantes sur le dos des mains.
« Je fis savoir cela, dit-il dans son rapport, à l’abbé Lambert qui demeurait dans la même maison. Il vint aussitôt dans la petite chambre d’Anne Catherine, et, voyant le sang couler, il lui dit : « Ma sœur, n’allez pas vous croire une sainte Catherine de Sienne. » Mais, comme les plaies persistèrent jusqu’au soir, il me dit le lendemain : « Mon père, personne ne doit le savoir. Cela doit rester entre nous, autrement la chose fera du bruit et nous attirera beaucoup d’ennuis. »
Le père Limberg était si parfaitement du même avis que dès lors il songea bien plus à expliquer comme une chose sans importance ou à tenir secrets ces phénomènes inexplicables pour lui qu’à y chercher une liaison avec ses autres expériences touchant Anne Catherine et à l’interroger à ce sujet. Elle-même ressentit une grande joie de ce que les deux prêtres ne la pressaient pas davantage et elle chercha, autant qu’elle le put, à tenir cachées à tous les yeux les nouvelles et bien cruelles souffrances qu’elle avait à supporter. Le père Limberg omit de rédiger ses observations par écrit : seulement il consigna sur son calendrier ecclésiastique les courtes remarques qui suivent :
« Le jour des Rois, j’ai vu pour la première fois les stigmates à la partie intérieure des mains.
« 11 janvier. Elle est restée assise environ six heures dans un fauteuil et elle a été en extase une heure et demie.
« 15 janvier. Elle a communié aujourd’hui. De sept à neuf heures, elle est restée en extase, raide et immobile.
« 28 janvier. Elle a été, depuis lors, tous les jours en extase pendant un temps plus ou moins long. J’ai vu aujourd’hui les marques des plaies à la plante des pieds.
« Ses mains et ses pieds ont saigné tous les vendredis : la double croix sur la poitrine, les mercredis. Depuis que j’ai eu connaissance de ses plaies, elle n’a pris aucune nourriture.
« Son état est resté inconnu jusqu’au 28 février 4813 ; mais Clara Soentgen s’en est aperçue et m’en a parlé. »
8. Comme Anne Catherine ne parlait jamais de ses stigmates, mais les dérobait à tous les regards avec une sollicitude inquiète, nous ne pouvons avoir d’autres détails à ce sujet que par l’enquête ecclésiastique à laquelle elle fut soumise dès que son état fut connu du public.
XVII
COMMENCEMENT DE L’ENQUÊTE ECCLÉSIASTIQUE.
1. Une fois que Clara Soentgen eut pénétré le secret, la connaissance s’en répandit bientôt au loin. Au milieu de mars 1813, les stigmates étaient un sujet de conversation dans la ville de Dulmen et, comme on avait parlé très vivement pour et contre dans un cabaret 15, cela fut cause qu’on prit à ce sujet des informations dont les résultats furent communiqués aux supérieurs ecclésiastiques à Munster. Au nombre de ceux qui avaient pris part à la discussion mentionnée ci-dessus, s’était trouvé le docteur Guillaume Wesener, médecin du district de Dulmen, qui entendait pour la première fois parler de choses de ce genre, mais qui ne voulait voir là que de la superstition ; toutefois, il se proposa de visiter la malade, afin de se mieux rendre compte de la réalité des faits. Wesener avait perdu la foi pendant les années qu’il avait passées à l’Université : mais c’était un homme d’un caractère si bienveillant et si loyal que l’aspect de la patiente produisit sur lui une profonde impression. Il ne savait, à la vérité, s’expliquer aucun des phénomènes qu’il voyait, mais il espérait, grâce à la droiture et à la candeur d’Anne Catherine, arriver promptement à connaître la cause véritable de ce qui paraissait si extraordinaire. Après quelques visites, il offrit à Anne Catherine ses services comme médecin 16, ce qu’elle accepta de bon cœur. Or, après des observations faites avec le plus grand soin, il arriva à se convaincre que toute idée de fraude ou de tromperie préméditée devait être écartée et qu’il y avait là des faits dépassant, à la vérité, le cercle de ses expériences, mais qui ne pouvaient être niés, ni tenus secrets. C’est pourquoi il délibéra avec le doyen Rensing, curé de la ville, avec le père Limberg et avec un autre médecin, nommé Krauthausen, sur les mesures à prendre pour dresser préalablement un procès-verbal sur les phénomènes qui se produisaient chez Anne Catherine. Pendant que ces messieurs discutaient au presbytère sur les moyens de mettre ce projet à exécution, Dieu dirigeait vers eux le regard d’Anne Catherine afin de la préparer à ce qui allait survenir. L’abbé Lambert se trouvait près d’elle, lorsqu’interrompant tout à coup l’entretien, elle s’écria :
« Que va-t-il m’arriver ? On tient conseil chez le doyen sur un examen auquel on doit me soumettre. Si je ne me trompe, mon confesseur est là. »
Peu après ces paroles, le doyen Rensing entra chez elle et lui annonça l’enquête qui avait été décidée.
2. Elle eut lieu le 22 mars 1813. On dressa un protocole dont un passage seulement trouvera place ici :
« Sur le dos de ses deux mains, y est-il dit, nous avons remarqué des croûtes de sang desséché, sous lesquelles était une plaie. Dans la paume des deux mains, il y avait de semblables croûtes de sang figé, seulement elles étaient plus petites. Nous avons trouvé ces mêmes croûtes sur la partie extérieure des pieds et au milieu de la plante des pieds. Elles étaient douloureuses quand on les touchait et celles du pied droit avaient saigné, il y avait peu de temps. Au côté droit, nous avons vu, à peu près au-dessus de la quatrième côte, en comptant à partir d’en bas, une plaie longue d’environ trois pouces qui doit saigner quelquefois. Sur le creux de l’estomac nous avons vu certaines marques de forme ronde qui figuraient une croix fourchue. Un peu plus bas, nous avons vu une croix ordinaire formée de raies larges d’un demi-pouce et semblables à des meurtrissures. À la partie supérieure du front, nous avons vu, en grand nombre, comme des piqûres d’aiguille qui allaient des deux côtés jusque dans les cheveux. Sur le linge qu’elle portait autour du front nous avons vu beaucoup de petites taches de sang. »
Quand cela fut fini, Anne Catherine dit au doyen Rensing : « La chose n’en restera pas là. Voici des messieurs de Munster qui viennent pour faire un examen : il y a un grand personnage, il ressemble à monseigneur l’évêque suffragant qui m’a confirmée à Coesfeld : il y en a un autre qui est assez vieux et qui n’a que quelques cheveux gris. »
Ces paroles portaient juste : car, dès le 28 mars, (c’était le quatrième dimanche de Carême), le vicaire général de Munster, Clément-Auguste de Droste de Vischering, devenu plus tard si célèbre comme archevêque de Cologne, vint à Dulmen accompagné du respectable doyen Overberg et du conseiller de médecine Druffel pour soumettre Anne Catherine à un rigoureux examen. Le 25 mars, le doyen Rensing avait adressé à ses supérieurs un rapport officiel sur l’état de la malade et il avait envoyé aussi le procès-verbal du médecin dont il a été question plus haut.
3. Le rapport que nous donnons ici tout entier était ainsi conçu :
« Très noble baron, très révérend vicaire général, le cœur profondément touché et plein d’émotions religieuses, j’annonce à Votre Révérence, comme à mon supérieur ecclésiastique, un fait bien propre à prouver de la manière la plus frappante que le Seigneur, en tout temps si admirable dans ses saints, opère encore en eux, même dans nos jours d’incrédulité et de frivolité, des signes qui montrent dans son plus vif éclat la force de notre sainte religion et qui portent l’homme léger à réfléchir et l’incrédule à revenir de ses erreurs. Vraiment, le Seigneur choisit encore, comme toujours, les faibles pour confondre les forts et révèle aux simples et aux petits des secrets qu’il cache aux grands et aux savants de ce monde. Jusqu’à présent j’avais été forcé de tenir le cas secret autant que possible, par suite du silence qui m’était imposé, de la condescendance que je croyais devoir à une modestie si favorisée de Dieu et par la crainte des suites fâcheuses qui pouvaient résulter de la divulgation : mais maintenant Dieu a permis que la chose, malgré toutes les précautions prises par moi, ait été pour ainsi dire prêchée sur les toits, qu’elle ait acquis une grande notoriété et qu’elle ait déjà produit beaucoup de bien. C’est ce qui m’a poussé à faire à ce sujet un rapport officiel : car dans de telles conjonctures, il ne me paraît plus convenable de continuer à celer les secrets du roi des rois ; je crois au contraire qu’il vaut beaucoup mieux qu’on fasse connaître les œuvres de Dieu et qu’on le glorifie à cette occasion.
« Anne Catherine Emmerich, sœur de chœur du couvent d’Augustines appelé Agnetenberg et aujourd’hui supprimé, est l’élue du Seigneur dont il s’agit. D’après le témoignage de la maîtresse d’école d’ici, Clara Soentgen, qui a pris l’habit le même jour et chez les parents de laquelle elle a résidé avant d’entrer au couvent, elle a été, dès sa jeunesse, extrêmement pieuse, et elle regardait comme le plus précieux don du ciel la conformité à la volonté de Dieu, spécialement dans les moments de tribulation, afin de ressembler toujours davantage à notre Sauveur crucifié. Cette grâce était le principal objet de ses prières de tous les jours, et l’auteur de tout bien la lui accorda de bonne heure. Pendant les dix ans qu’elle a passés au couvent, elle y a été presque constamment malade et souvent obligée de garder le lit pendant des semaines : mais ce qui augmentait encore sa souffrance, c’est qu’elle était méconnue par les autres sœurs qui ne voyaient en elle qu’une pieuse visionnaire. Elles la traitaient même d’une manière peu charitable, parce que quelquefois, ou, pour mieux dire, habituellement, elle faisait plusieurs communions dans la semaine, parlait souvent avec un saint enthousiasme du bonheur qu’il y a à souffrir, faisait beaucoup d’exercices de piété de surérogation, et, par là, se distinguait trop des autres ; en outre, elle avait laissé quelquefois tomber un petit mot de visions et de révélations. Son état de maladie a continué après la suppression du couvent : maintenant, elle est forcée de rester au lit depuis quelques mois et n’a pris, depuis plus de deux mois, ni remède, ni autre nourriture que de l’eau froide à laquelle, pendant un certain temps, on a mêlé quelques gouttes de vin. Depuis trois ou quatre semaines, elle la boit sans aucun mélange. Ce qu’elle prend en sus, pour cacher au monde qu’elle ne vit que d’eau pure, est aussitôt rejeté per vomitum. En outre, elle a de si fortes sueurs que le soir tout ce qu’elle a sur elle et autour d’elle est trempé comme si on venait de le tirer de l’eau. Elle rend par là chaque jour un nouveau témoignage à la vérité du vieil enseignement biblique que l’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Communément, elle a le soir une défaillance qui dure parfois deux heures entières et même davantage. Pendant cette défaillance que j’appellerais plutôt une sainte extase, elle devient raide comme une pièce de bois, en sorte que tout le corps se pose, comme ferait une perche, sur le côté où l’on tourne sa tête avec la main ; mais le teint de son visage reste dans cet état aussi vermeil que celui d’un petit enfant : et si, pendant ce temps, lors même qu’elle a un oreiller ou la couverture du lit devant le visage, on lui donne, à la dérobée, si je puis m’exprimer ainsi, la bénédiction sacerdotale, elle lève sa main, qui, hors de là, reste immobile comme une pierre, et fait le signe de la croix. Après de semblables extases, elle a révélé à son confesseur, le père Limberg, ainsi qu’à moi, des secrets qu’elle ne peut connaître que par une inspiration supérieure. Mais ce qui marque le plus en elle une amie particulièrement chérie de notre Sauveur est qu’elle a une couronne saignante autour de la tête, les stigmates au côté, aux pieds et aux mains, et de plus, sur la poitrine deux ou trois croix. Toutes ces plaies saignent souvent, les unes le mercredi, les autres le vendredi, et si abondamment qu’on voit quelquefois de nombreuses gouttes tomber par terre. Comme ce privilège singulier fait le plus grand bruit et qu’il est l’objet de la critique la plus vive, j’ai voulu me mettre à même de faire un rapport sommaire à ce sujet, et j’ai prié les médecins d’ici de faire, un examen préalable. Tous deux ont été touchés jusqu’aux larmes en s’y livrant, et le résultat de leur enquête est contenu dans l’appendice A-A, signé par tous les deux, comme aussi par moi, par M. Limberg et par le prêtre français Lambert qui demeure dans la même maison que la malade.
« En m’acquittant du devoir de fournir à mon supérieur, par ce rapport, les informations convenables sur un cas d’une nature si extraordinaire, je le prie aussi de m’indiquer comment je dois me comporter ultérieurement, spécialement dans le cas du décès de cette personne, si remarquable dans un temps comme le nôtre. Elle craint par-dessus tout que la blessure faite à son cœur par la publicité donnée à son histoire ne soit rendue encore plus douloureuse par l’intervention de l’autorité civile : mais j’espère que vous pourrez l’empêcher. Si Votre Excellence voulait se convaincre personnellement par le témoignage de ses yeux de la vérité de mes allégations et du caractère surhumain de certaines circonstances accessoires que pour le moment je ne puis confier au papier, je la prierais d’amener avec elle le respectable M. Overberg, si expérimenté dans les voies spirituelles, et de me faire l’honneur de descendre chez moi.
« J’aurais voulu vous porter moi-même ce rapport, d’autant plus que j’aurais pu le compléter de vive voix, mais l’état de maladie de quelques-uns de mes pénitents, le catéchisme que j’ai à faire pour préparer les enfants à la première communion, et les autres affaires paroissiales, qui s’accumulent dans cette saison, ne me permettent pas de m’éloigner quant à présent. Votre Excellence trouvera certainement cette excuse trop bien fondée pour ne pas l’agréer complètement. C’est dans cette confiance que je suis, avec le plus profond respect, etc. »
Dulmen, le 25 mai 1813.
RENSING.
XVIII
PREMIÈRE VISITE DU VICAIRE GÉNÉRAL DE DROSTE À DULMEN.
1. Le rapport qu’on vient de lire fut accueilli très froidement par le vicaire général de Droste, auquel il parvint le 27 mars.
« Lorsque j’eus reçu, dit-il lui-même, l’écrit de Rensing, avec le procès-verbal des médecins, je fus bien loin d’envisager l’affaire comme elle paraissait être représentée dans ces rapports. Je supposai de l’illusion ou même de la fraude comme je le supposerai toujours dans des cas semblables. Jusque-là je n’avais pas encore entendu dire un seul mot de cette affaire. Comme je vis qu’à Dulmen, elle était déjà devenue le sujet des conversations de la ville, comme en outre, puisqu’il s’agissait de choses qui tombaient si fort sous les sens, je pensais qu’on découvrirait la vérité sans beaucoup de peine, je me rendis le jour suivant à Dulmen, où certainement l’on ne m’attendait pas sitôt. Je priai M. Overberg et le conseiller de médecine Druffel de m’accompagner. Je m’adressai spécialement à ce dernier, parce que je le considère comme un observateur très perspicace et comme n’étant pas disposé à croire légèrement, ce qui aurait beaucoup d’inconvénients dans un cas comme celui-ci. »
2. Toutefois, cette arrivée subite n’était pas aussi inattendue pour Anne Catherine que le vicaire général se l’était figuré : car, peu de jours après, le vicaire Hilgenberg déposa sous la foi du serment qu’il lui avait rendu visite le samedi soir, 27 mars, après le chant des litanies, et que lui ayant demandé comment elle se trouvait, il en avait reçu cette réponse : « J’ai eu une très mauvaise semaine à cause de l’enquête sur les stigmates faite par les médecins d’ici, mais demain et la semaine prochaine j’aurai à souffrir encore davantage par suite de nouvelles enquêtes. »
3. « Nous arrivâmes vers quatre heures à Dulmen, dit dans ses notes le vicaire général de Droste : le dimanche, nous vîmes deux fois Anne Catherine Emmerich et nous nous entretînmes avec elle, avec son confesseur et avec le doyen. Le lundi matin 29, nous vîmes encore la sœur Emmerich, et nous eûmes un nouvel entretien avec elle. Je parlai aussi à sa compagne d’enfance, Clara Soentgen, de Coesfeld. Vers dix heures, nous repartîmes de Dulmen. Dans cette première visite, la chose nous parut plus sérieuse que nous ne nous y étions attendus. »
4. Le 28 mars était le quatrième dimanche de carême et en même temps le jour de la fête de saint Joseph pour le diocèse de Munster. Le vicaire général fit dresser un procès-verbal spécial des observations faites ce jour-là et le jour suivant touchant Anne Catherine ; en outre, Overberg nota soigneusement tout ce qui lui avait paru digne de remarque. Le procès-verbal s’exprime ainsi :
« Vers cinq heures de l’après-midi, nous avons visité la sœur Emmerich pour nous assurer des phénomènes particuliers qu’on nous avait dit se produire sur son corps. On ne remarqua rien de frappant dans sa physionomie, rien qui indiquât qu’elle nous attendît, aucun signe de joie, ou d’étonnement. Quand on signifia à la sœur Emmerich que l’autorité ecclésiastique voulait s’assurer de son état, elle donna son acquiescement à tout. Elle laissa voir sans hésitation ses mains, ses pieds, son côté droit. Elle se borna à dire qu’il lui était pénible d’avoir à subir des examens de ce genre, mais que du reste elle ne désirait rien autre chose que de se conformer à la volonté de Dieu.
« Le plus léger attouchement est, à ce qu’elle assure, très douloureux pour ses plaies. Son bras tressaillait chaque fois qu’on touchait la plaie de la main, ou même quand on faisait seulement remuer le doigt du milieu.
« Vers neuf heures du soir, il y eut une nouvelle visite et bientôt après Anne Catherine tomba en extase. Tous les membres semblaient raidis comme par une paralysie, cependant les doigts pouvaient se remuer et même l’attouchement des plaies et du doigt du milieu excitaient des tressaillements. La tête ne pouvait être relevée qu’avec peine, et alors la poitrine, comme suivant le mouvement de la tête, s’élevait aussi. Diverses questions faites par les médecins restèrent sans réponse. Elle ne donnait aucun signe de vie 17. Alors M. le vicaire général lui dit : « Je vous ordonne de répondre en vertu de l’obéissance. » À peine ces paroles furent-elles prononcées, qu’elle rejeta sa tête du côté où nous étions avec une rapidité surprenante, nous regarda d’un air singulièrement affectueux et répondit à toutes les interrogations qui lui furent adressées. Plus tard, on lui demanda comment il s’était fait qu’étant sans connaissance, elle eût si promptement tourné la tête sur le commandement du vicaire général, comme si elle eût entendu ses paroles ; elle répondit : « Non ! je ne les ai pas entendues, mais quand, étant dans cet état, quelque chose m’est commandé en vertu de l’obéissance, c’est comme si une voix puissante m’appelait. »
« En ce qui touche les plaies, elle avoua qu’elle avait prié Dieu de lui enlever les signes extérieurs, mais il lui avait été répondu : « Ma grâce te suffit » ; sur quoi le vicaire général lui prescrit de recommencer sans cesse cette prière. »
5. Le lendemain matin, les visiteurs vinrent une troisième fois. Le vicaire général décida alors que le chirurgien Krauthausen de Dulmen laverait avec de l’eau tiède les plaies des mains et des pieds pour faire tomber les croûtes de sang desséché, qu’il les banderait avec des compresses bien sèches et qu’il veillerait à ce que ces bandages apposés aux mains et aux pieds y restassent ainsi huit jours pleins sans interruption, de manière à ce que ni les doigts ni les pouces ne pussent se mouvoir librement. Anne Catherine déclara qu’elle se soumettrait sans difficulté à cet arrangement : elle répéta même plus d’une fois, suivant le procès-verbal, qu’elle donnait son assentiment à toutes les expériences qu’on voudrait faire sur les plaies, et en général sur sa personne. Elle pria seulement qu’on voulût bien éviter tout ce qui pourrait faire de l’éclat.
Les assistants non seulement furent pleinement satisfaits de la manière dont se comportait en tout Anne Catherine, mais encore l’empressement sincère avec lequel elle prêta une obéissance aveugle à l’ordre de l’autorité ecclésiastique, malgré le surcroît de souffrances qu’il lui préparait, produisit sur eux une forte impression et ils consignèrent ce qui suit dans le procès-verbal :
« Pendant les divers entretiens, la physionomie de la malade se rasséréna notablement, et on fut frappé de ce que son regard avait de candide et de bienveillant.
« À la fin, le vicaire général s’entretint seul avec elle et lui dit qu’on pouvait bien désirer d’avoir part aux souffrances du divin Rédempteur et aux douleurs de ses plaies, mais non aux marques extérieures elles-mêmes. À quoi elle répondit : « Les marques extérieures sont précisément ma croix. »
XIX
MESURES FRISES PAR LE VICAIRE GÉNÉRAL DE DROSTE.
1. Après son retour à Munster, le vicaire général prit pour la continuation de l’enquête des mesures prouvant clairement que l’impression personnelle faite sur lui par toute la manière d’être d’Anne Catherine cédait à des considérations d’un ordre supérieur.
« Je ne pouvais pas, dit-il dans le procès-verbal, espérer comme résultat d’une seule enquête l’assurance que l’imposture ou l’illusion étaient impossibles. La question de savoir si, dans le cas où l’on ne rencontrerait ni l’une ni l’autre, ces phénomènes frappants peuvent s’expliquer naturellement n’est pas mon affaire. Les stigmates sont tellement visibles pour quiconque les regarde qu’on ne peut se tromper quant au fait lui-même. La question est donc celle-ci : La sœur Emmerich a-t-elle fait ces marques elle-même, oui ou non ? quelque autre personne les lui a-t-elle faites ? Comme elle a déclaré formellement que ni elle, ni personne autre ne les avait faites, il me reste à rechercher si elle trompe ou si elle est trompée. Si l’enquête me conduit à cette conclusion qu’on ne peut raisonnablement supposer aucune tromperie, je n’ai point à pousser plus loin mes perquisitions. Pour arriver là, je dois me servir uniquement de moyens qui ne blessent ni la justice, ni la charité. »
2. Quand un homme est résolu à régler sa manière d’agir d’après de semblables principes, et que cet homme, comme Droste-Vischering, unit à une inébranlable force de caractère une sensibilité d’âme poussée à ce point qu’il lui arrivait souvent d’acheter des oiseaux pris au piège pour leur rendre la liberté, on doit s’attendre d’avance que les souffrances qui résulteront inévitablement de l’enquête pour Anne Catherine seront allégées autant que possible. Toutefois, cet adoucissement n’était pas dans les desseins de Dieu qui, à cette époque d’épreuves si douloureuses pour l’Église, avait appelé Anne Catherine à être l’instrument de ses miséricordes. En cette qualité, elle avait à prendre sur elle toutes les souffrances par lesquelles l’endurcissement du siècle pouvait être vaincu et préparé à recevoir les bénédictions qui devaient découler des tortures de l’innocente pénitente. De là vint que, dans tous les procédés du vicaire général, la sensibilité de son âme prévalut moins que la nécessité de tenir compte de l’esprit de son époque et aussi sa situation très difficile, comme administrateur d’un diocèse depuis si longtemps orphelin et exposé à de continuelles vicissitudes politiques : tout cela lui imposait des obligations devant lesquelles toute autre considération devait être mise de côté.
3. Le pays de Munster avait perdu en 1802 son dernier souverain ecclésiastique, le prince évêque Maximilien-Xavier, frère de l’empereur Joseph II, et la Prusse l’avait occupé pendant la vacance du siège. La décision rendue par la députation d’Empire, en l’an 1803, mit la Prusse en possession définitive de la ville épiscopale de Munster et de la partie méridionale du pays dont le reste fut partagé entre sept autres petits souverains. Dulmen échut à un catholique, le duc de Cröy, qui plus tard fit entièrement démolir avec son église l’ancien couvent d’Agnetenberg qu’Anne Catherine a rendu célèbre. Coesfeld et Flamske échurent au comte de Salm. Après la bataille d’Iéna, ces territoires furent de nouveau retirés à leurs possesseurs et unis au grand-duché de Berg que Napoléon avait érigé en faveur d’un enfant au berceau, le fils aîné de sa belle-sœur Hortense, reine de Hollande. L’année 1810 mit fin à cette union parce que Munster, avec Coesfeld et Dulmen, fut appelé à faire partie du grand Empire français, jusqu’au moment où la Prusse, au congrès de Vienne, se fit donner tout le pays de Munster.
4. On voit assez combien devait être difficile la position d’un supérieur ecclésiastique envers ces pouvoirs qui changeaient sans cesse, dans un pays dont la population regrettait chaque jour davantage la paix et le bonheur dont elle avait joui sous le sceptre paternel de ses princes évêques. En outre, Clément Auguste appartenait à une des familles les plus anciennes et les plus considérées de la noblesse du pays de Munster, et c’était une raison pour qu’il fût regardé d’un œil méfiant par les dominateurs étrangers. En 1807, le chapitre cathédral l’avait mis à la tête de l’administration du diocèse qui était sans pasteur depuis 1802 ; mais, le 14 avril 1813, le doyen du chapitre, comte de Spiegel, fut nommé évêque par un décret de Napoléon et le chapitre forcé de lui remettre l’administration du diocèse. Clément Auguste se trouvait par là dans la nécessité de se substituer le comte Spiegel comme vicaire général, mais c’est ce que Rome naturellement ne pouvait pas tolérer. Il reprit donc ses fonctions jusqu’à l’année 1821, où le diocèse de Munster reçut enfin un véritable chef suprême dans la personne du baron de Luning, ancien prince évêque de Corvey. Mais celui-ci tomba bientôt dans un état d’affaiblissement intellectuel complet qui le conduisit au tombeau en 1825.
5. Clément Auguste ressentait une douleur amère en voyant l’Église dont il se glorifiait d’être le serviteur, traitée par les prétendues lumières du temps avec un mépris injurieux, comme une institution qui n’avait plus droit à l’existence et destinée à tomber bientôt dans l’oubli. Il savait avec quel débordement d’outrages était poursuivie toute manifestation de la vie de l’Église tendant à démentir l’opinion que l’extinction du catholicisme était déjà un fait accompli : il avait même la douleur de voir un certain nombre de prêtres dans les rangs de ces ennemis de Dieu qui combattaient par leurs paroles et leurs écrits les pratiques de la foi et de la piété. On ne doit donc pas s’étonner que, sous la pression d’une situation précaire et compliquée comme l’était la sienne, un homme d’autant de prévoyance fût très contrarié de se trouver en présence d’un phénomène aussi étrange et aussi choquant pour toutes les idées du siècle que l’était Anne Catherine, et fût effrayé de la foule de nouveaux embarras qui pouvaient en résulter pour lui. Il avait d’abord espéré pouvoir dévoiler tout de suite par sa brusque intervention l’imposture dont il supposait l’existence, et empêcher toute propagation ultérieure du bruit qu’on faisait de cette affaire, avant qu’elle pût être exploitée au détriment de l’Église ; maintenant qu’il ne pouvait plus croire à une fourberie, il se considérait comme obligé de poursuivre l’enquête aussi sérieusement que possible. Il ne devait pas laisser exposée à l’ombre d’une suspicion l’autorité ecclésiastique considérée avec tant de méfiance et de mauvais vouloir, ni donner à croire qu’elle montrait une indulgence et une incurie blâmables dans une affaire où il pouvait y avoir de la fraude, et qui, dans tous les cas, si elle n’était pas tenue dans le secret le plus profond ou ensevelie dans l’oubli, devait provoquer toute l’irritation des ennemis de l’Église et de la foi.
6. Le choix des deux hommes par lesquels Clément Auguste s’était fait accompagner à Dulmen et qui devaient continuer à l’assister dans l’enquête introduite, était le plus heureux qu’on pût imaginer. Overberg, dont le nom était prononcé avec respect bien au-delà des limites de son pays natal, était l’un des plus nobles caractères de son époque, et il était regardé dans tout le diocèse de Munster comme un prêtre d’une expérience sans égale en ce qui concernait la conduite des âmes et les voies de la vie spirituelle. Clément Auguste l’appréciait à toute sa valeur ; aussi, le chargea-t-il de prendre pour objet de ses investigations les plus scrupuleuses toute la vie intérieure et extérieure d’Anne Catherine depuis sa première jeunesse. Il prescrivit en outre à celle-ci, en vertu de l’obéissance, de rendre, en présence d’Overberg, le compte le plus exact de tout ce qu’elle avait jamais éprouvé intérieurement et extérieurement. Il ne fut pas difficile à ce saint prêtre d’obtenir d’Anne Catherine une confiance sans réserve, en sorte que, dès son premier entretien avec elle, il put rapporter ce qui suit :
« Elle m’a vu venir en esprit : elle m’a dit à moi-même et a affirmé à d’autres qu’elle ne m’avait jamais vu des yeux du corps. « Je vous ai vu intérieurement », m’a-t-elle dit. Cela la rendait aussi confiante que si nous nous étions connus depuis longtemps. »
La candeur naïve avec laquelle Anne Catherine s’ouvrait constamment à ce respectable vieillard permit à celui-ci de jeter de profonds regards dans l’âme de la pieuse fille, dont toute la vie intérieure fut bientôt clairement exposée à ses yeux. Plus il eut de rapports avec Anne Catherine, plus s’offrirent à lui les preuves multipliées de la réalité de sa vocation extraordinaire et de tous les dons qu’elle avait reçus, et cet homme accablé d’affaires, dont une infinité de personnes de toutes les classes réclamaient les conseils et l’assistance, crut devoir s’imposer le travail de noter toutes ses observations et même les propres paroles qu’il avait recueillies de la bouche d’Anne Catherine.
Avec la rare bonté d’Overberg, on devait s’attendre que son intervention apporterait quelque adoucissement aux souffrances dont l’enquête était l’occasion pour Anne Catherine : mais Dieu ne voulait pas que d’aucun côté il vînt un empêchement aux mesures jugées nécessaires par Clément Auguste pour lever tous les doutes, quant à la réalité des grâces accordées à Anne Catherine.
7. Le professeur et conseiller de médecine de Druffel, médecin savant et considéré, était un homme d’un esprit indépendant : il examina les phénomènes qui se produisaient chez Anne Catherine avec le regard exercé d’un naturaliste profondément instruit. Lui aussi, lorsqu’on lui en parla pour la première fois, se sentit porté à n’y voir que de l’imposture et de l’artifice : mais son sentiment se modifia dès la première visite. Non seulement l’état des plaies et la façon dont elles saignaient le convainquirent qu’on ne pouvait pas voir là quelque chose d’artificiel ou l’œuvre d’une main étrangère : mais toute la personne et la manière d’être d’Anne Catherine contribuèrent encore davantage à lui faire rejeter absolument toute croyance à un mensonge et à une fraude. Il est à propos de remarquer que Druffel, comme les autres médecins Krauthausen et Wesener, avait un vif sentiment des cruelles souffrances qui allaient résulter de l’enquête pour Anne Catherine et que sa conviction, quant à la véracité de la personne et à la réalité des faits, n’avait pas besoin de l’application des mesures rigoureuses que le supérieur ecclésiastique, directeur de l’enquête, se croyait obligé de faire subir, à Anne Catherine.
Par suite du grand éclat que fit l’enquête, M. de Druffel se trouva amené à faire insérer dans le journal de médecine et de chirurgie de Salzbourg un long article signé de lui, où il rendit un compte exact et détaillé de ses observations médicales auprès d’Anne Catherine. Quoiqu’il « déclarât dès l’abord son intention de ne pas chercher à expliquer les phénomènes », (ce que les éditeurs d’un journal de médecine, surtout à cette époque, auraient difficilement permis), il eut pourtant la hardiesse de conclure en ces ternies :
« Quant à ceux qui regardent les phénomènes observés comme une imposture, on doit leur faire remarquer que, dans l’enquête, l’autorité ecclésiastique y a regardé de très près. Cette fraude, si elle existait, serait d’une nature toute particulière et bien difficile à constater. »
8. Il arriva pour M. de Druffel, comme pour tous ceux qui furent en relation avec Anne Catherine, que Dieu lui fit une grâce par l’intermédiaire de sa servante. Celle-ci en effet vit l’état de l’âme du professeur et le danger dans lequel il se trouvait de perdre la foi. Dès le premier entretien, elle en fit la confidence à Overberg, laissant celui-ci, en qualité d’ami pour lequel Druffel avait un grand respect, libre d’en faire tel usage qu’il voudrait. Overberg fut très surpris et ne voulut pas croire légèrement ce qui lui était dit : mais Druffel lui-même, auquel il fit part de cette communication intime, confirma ce qu’avait dit Anne Catherine et donna à celle-ci les preuves les moins équivoques de l’utilité qu’avait pour lui cet avertissement.
9. Le vicaire général de Droste transmit à Dulmen, dès le 31 mars, une série d’ordres écrits et de règlements qui furent observés avec la plus grande exactitude et qui sont une preuve remarquable de la rare fermeté, de la prudence et de la pénétration de cet homme éminent dont Dieu voulait se servir pour la glorification de sa servante. La première disposition consistait en ce qu’il nommait le doyen Rensing 18 directeur extraordinaire d’Anne Catherine pendant la durée de l’enquête et lui imposait l’obligation d’observer avec le plus grand soin toute la conduite de la malade et d’en rendre un compte fidèle. Il lui envoya une instruction détaillée conçue en ces termes :
« C’est le devoir de l’autorité ecclésiastique d’examiner à fond, autant que possible, si les phénomènes extraordinaires qui se présentent sont l’effet d’une maladie, s’ils sont survenus et s’ils se maintiennent d’une manière qui sorte de la sphère de l’ordre naturel, ou enfin s’ils ont été produits et entretenus d’une manière artificielle. Il ne s’agit pas ici de ce que l’on croit, mais de vérifier ce qui est le plus exactement possible. D’après cela il est absolument nécessaire que, non seulement tout ce qui s’est passé par rapport à l’âme et dans l’âme (en tant que cela se peut sans porter la moindre atteinte au secret de la confession) et tout ce qui s’est produit sur le corps et dans le corps de la sœur Emmerich soit décrit et rapporté de la manière la plus conforme qu’il se pourra à la simple vérité, mais encore qu’à partir du jour où cette charge est confiée à M. le doyen Rensing, toute modification dans l’état du corps aussi bien que tout phénomène physique ou moral soit noté sur un journal qui me sera envoyé tous les huit jours. Ce qui concerne l’âme est ici confié à M. le doyen Rensing. En ce qui touche le corps, M. le doyen est chargé de dire à la sœur Emmerich que, pour obéir à l’autorité ecclésiastique, elle doit laisser M. Krauthausen faire tout ce qu’il jugera convenable pour sa guérison corporelle. En général, elle doit s’apercevoir aussi peu que possible qu’elle est l’objet d’une enquête. Plus la chose sera conduite de façon à ce qu’elle doive naturellement croire qu’on n’a autre chose en vue que sa guérison, mieux cela vaudra : on ne doit pas attacher la moindre importance aux plaies et aux signes, ni s’en préoccuper, comme si c’était une grâce extraordinaire. Plus toute cette histoire tombera dans l’oubli et moins on en parlera, mieux cela vaudra. »
10. Le chirurgien Krauthausen fut chargé d’observer et de noter tous les phénomènes physiques.
« Car, dit le vicaire général, le docteur Wesener a rédigé l’acte du 25 mars, et cela l’engage trop pour qu’on puisse l’employer dans l’enquête. D’après ce que m’a dit M. le conseiller de médecine Druffel, on peut se fier entièrement à M. Krauthausen en ce qui concerne le traitement des plaies de la sœur Emmerich. Dans aucun cas les bandages ne doivent être enlevés, ni même seulement changés par un autre que lui. Si M. Krauthausen voit quelque indice qui l’y détermine, il peut retirer les bandages au bout de quatre jours, mais il faut qu’ensuite il les remette aussitôt. »
Les points sur lesquels il devait faire son rapport chaque semaine étaient notés d’avance dans le plus grand détail par le vicaire général.
11. Rensing devait prescrire, de la part du supérieur ecclésiastique, au père Limberg, confesseur ordinaire d’Anne Catherine : 1o d’éviter autant que possible, dans ses entretiens sur des sujets de piété, de faire allusion aux souffrances de la malade ; 2o de ne jamais lui adresser, pendant ou après ses extases, de question sur son état intérieur et les diverses pensées qui avaient pu se présenter à elle, car tout cela était désormais l’affaire exclusive du doyen Rensing ; 3o de faire part à celui-ci de tout ce qu’Anne Catherine, sans y être provoquée, lui communiquerait pendant ou après les extases.
12. Enfin, Clara Soentgen fut chargée de faire des rapports secrets : « Car, dit le vicaire général, elle m’est bien connue comme une personne sensée et absolument incapable de tromper. Je lui ai demandé de me faire un rapport à l’insu du doyen, afin d’arriver plus sûrement à la vérité à l’aide de rapports tout à fait indépendants les uns des autres. »
L’ordre écrit adressé à Clara Soentgen était accompagné de l’avertissement suivant :
« Je voudrais ici tout savoir, non pas imaginer, conjecturer, mais savoir. Ce que je sais avec certitude a seul de la valeur pour moi. »
13. En ce qui touchait la sœur d’Anne Catherine, l’instruction suivante fut donnée :
« On la laisse volontiers auprès de la malade. Mais si elle se permettait d’agir à l’encontre des prescriptions données, il faudrait sans faute la séparer entièrement de sa sœur. Je dois de plus faire remarquer que des mesures venant d’autre part et qui seraient infiniment plus désagréables pour la sœur Emmerich ne pourront être évitées que si l’on se conforme scrupuleusement à celles que j’ai prescrites. »
14. Enfin le doyen Rensing fut chargé d’entendre, au nom de l’autorité ecclésiastique, sur des points déterminés d’avance, toutes les personnes, prêtres, religieuses ou laïques qui, à Dulmen, à Coesfeld et à Flamske, s’étaient trouvées en relation plus particulière avec Anne Catherine et qui par conséquent étaient en mesure de faire des communications instructives sur son caractère et toute sa manière de vivre.
XX
LE BANDAGE DES PLAIES.
1. Le 1er avril, Krauthauscn appliqua les bandages aux mains et aux pieds. Voici ce qui est dit à ce sujet dans son rapport au vicaire général :
« Conformément à la mission qui m’a été donnée, j’ai, le jeudi (d’avant le dimanche de la Passion), à huit heures du matin, lavé complètement avec de l’eau chaude les endroits marqués par des croûtes de sang desséché aux pieds, aux mains et aussi à la tête de l’ancienne religieuse augustine Catherine Emmerich : je les ai aussitôt après enveloppés ave des bandages, de manière à ce que les doigts et les pouces ne puissent se mouvoir librement et à ce que ce bandage ne puisse être dérangé et encore bien moins retiré sans que je m’en aperçoive. La lotion, quoique faite très lentement et très doucement avec une éponge fine, et l’application des bandages ont déterminé chez la malade des souffrances très vives et une agitation qui ont duré environ vingt-quatre heures. Lorsque j’eus fini de laver, je vis sur le dos des deux mains et des deux pieds une plaie ovale, longue d’environ un demi-pouce ; les plaies à la paume des mains et à la plante des pieds étaient plus petites : elles étaient saines et il n’y avait aucune suppuration. »
2. Quelques heures après l’application des bandages, le doyen Rensing vint visiter Anne Catherine, qu’il trouva « pleurant à cause des douleurs tout à fait intolérables que lui occasionnait la chaleur brûlante qui se faisait sentir dans les plaies bandées. » Consolée par lui, elle répondit :
« Je veux tout supporter de bon cœur, pourvu seulement que le bon Dieu me donne assez de force pour ne pas tomber dans l’impatience. »
Mais, lorsqu’à l’heure des vêpres, elle commença à s’unir aux douleurs de la Passion du Sauveur, les souffrances devinrent beaucoup plus violentes et elle fut prise de la peur « de ne pouvoir jamais les supporter et d’être poussée par leur excès à manquer à l’obéissance due à l’autorité ecclésiastique ».
Elle ne put être calmée que par la promesse du doyen que lui et un autre prêtre offriraient le lendemain pour elle le saint sacrifice de la messe afin de lui obtenir de Dieu la force nécessaire, et elle répondit :
« Je ne désire rien que cette grâce, et Dieu ne me la refusera pas si les prêtres la demandent avec moi. »
3. La nuit du 1er au 2 avril fut excessivement douloureuse, au point qu’elle s’évanouit trois fois. Ce ne fut que le matin, lorsqu’on dit la sainte messe pour elle, qu’elle éprouva quelque soulagement. Mais les élancements et la cuisson des plaies continuèrent sans interruption et, le soir du 2 avril, ce ne fut que d’une voix à peine intelligible à cause de sa faiblesse qu’elle put dire au doyen :
« Voilà encore des personnes qui veulent voir mes signes : cela me tourmente ; ne pourriez-vous pas l’empêcher ? »
Ces paroles reçurent leur accomplissement le 4 avril, car le commissaire général de police français, M. Garnier, vint de Munster à Dulmen pour prendre des informations auprès des médecins et de l’entourage d’Anne Catherine et pour faire une visite officielle. Il adressa différentes questions à Anne Catherine dont les réponses lui furent traduites en français par l’abbé Lambert. Il voulait surtout savoir si Anne Catherine ne parlait pas de choses touchant à la politique et ne faisait pas de prédictions. Il fit ensuite lever par Krauthausen les bandages de la main droite pour voir lui-même la plaie. Toute la manière d’être d’Anne Catherine fit sur Garnier une si profonde impression que, quatorze ans après, à Paris, il parla encore de cette visite à Clément Brentano en termes très respectueux et très sympathiques.
4. Voici ce que rapporte le journal de Krauthausen sur l’enlèvement du bandage :
« Aujourd’hui, 4 avril, sur l’ordre de M. le commissaire de police du département de la Lippe, j’ai été obligé d’enlever le bandage de la main droite et, dans l’après-midi, vers quatre heures et demie, j’ai retiré ceux de la main gauche et des deux pieds. Par l’effet du sang dont ils étaient trempés, ils étaient tellement collés ensemble et sur chaque plaie qu’il m’a fallu un certain temps pour les amollir avec de l’eau chaude et les retirer ; en outre, ce qui est le pire, cela a causé de grandes douleurs à la patiente. Les plaies se trouvaient encore dans le même état que le 1er avril. Afin que les bandages que j’ai remis immédiatement ne se collassent plus si fortement aux plaies, et aussi pour alléger les souffrances de la malade, j’ai mis un cataplasme sur les plaies. »
Toutefois, ce cataplasme ne fit qu’augmenter les souffrances déjà si cruelles et ne put pas empêcher le sang de jaillir. Le jour suivant (5 avril), les bandages étaient de nouveau traversés par le sang, en sorte que Krauthausen, sur la demande de la malade, retira le cataplasme et appliqua de nouveaux bandages de toile bien sèche. En retirant le cataplasme, il ne vit aucune trace de suppuration.
5. Le matin suivant, le sang avait de nouveau traversé les bandages, et les douleurs allaient toujours croissant. Jusqu’au 7 avril, elles augmentèrent tellement qu’Anne Catherine supplia le médecin de retirer les bandages des mains et des pieds, parce qu’elle ne se sentait pas de force à endurer plus longtemps ce qu’ils lui faisaient souffrir. Le médecin n’osait pas condescendre à cette prière sans une permission expresse de Munster : il voulait la demander par lettre, mais, le soir même, le vicaire général et ses compagnons revinrent à Dulmen.
6. Sur le refus de Krauthausen, Anne Catherine, dans son délaissement, s’était proposé de patienter encore un jour : là-dessus, il lui fut enjoint en vision de représenter à ceux qui faisaient l’enquête qu’elle ne désirait rien au monde, ni argent, ni renommée, mais qu’elle aspirait uniquement à vivre cachée et tranquille ; qu’on ne devait donc pas mettre sa patience à une si forte épreuve, car, avec l’excès intolérable de ses souffrances, ce n’était rien moins que tenter Dieu. Lorsqu’ensuite elle fit ces représentations devant Overberg, celui-ci qui, d’après ce qui s’était passé lors de sa première visite, croyait pouvoir compter sur une obéissance aveugle, en fut d’abord assez surpris : toutefois, Anne Catherine leva ses scrupules en lui disant qu’elle avait reçu l’ordre de s’expliquer ainsi, mais qu’en même temps il lui avait été prescrit de souffrir, quoi qu’il pût advenir, tout ce que l’obéissance demanderait d’elle. La suite de l’enquête montrera de plus en plus clairement, combien, en dépit de toutes les souffrances, elle fut docile à cette injonction.
XXI
LE VICAIRE GÉNÉRAL DROSTE ET SES COMPAGNONS VIENNENT POUR LA SECONDE FOIS À DOLMEN. 7 AVRIL 1813.
1. Le procès-verbal relatif à cette visite s’exprime ainsi :
« Le mercredi 7 avril, vers six heures du soir, les soussignés se sont rendus dans la maison où habite la sœur Emmerich. La physionomie de la malade ne paraissait pas avoir changé. Les bandages des pieds et des mains ont été enlevés par M. Krauthausen. Il a fallu mouiller à chaque tour la partie du linge qui posait sur les plaies, afin de pouvoir le retirer avec moins de douleur, tant le bandage était trempé de sang noirâtre. Après l’enlèvement des bandages, la patiente se trouva soulagée, quant à ses douleurs continuelles.
« Les plaies en général paraissaient très saines. Il ne s’y montrait ni suppuration, ni inflammation. À part ses plaintes sur les douleurs excessives et insupportables causées par l’application des bandages, sa figure, comme lors de la première visite, prit une expression de contentement et de bienveillance pendant la conversation. »
2. Lors du dernier entretien que Clément Auguste eut avec Anne Catherine en présence d’Overberg, celle-ci le pria « de penser à la peine qu’elle éprouvait quand il lui fallait se laisser voir ainsi, elle qui avait toujours été si timide. »
Elle dit encore « que ses souffrances la troublaient dans sa prière ; que, tout ce temps-ci, elle avait eu bien peu de consolation ; qu’elle avait eu à lutter, non seulement contre l’impatience, mais aussi contre le ressentiment à l’égard de ceux qui avaient fait connaître ce qu’il pouvait y avoir à remarquer chez elle ; qu’elle savait ce qu’ils avaient dit, mais qu’elle se résignait de bon cœur à la volonté de Dieu. »
Devant Overberg, elle exprima aussi la crainte « que sa vieille mère n’apprît qu’elle avait été soumise à un examen et ne pût supporter, à cause de son grand âge, le chagrin qu’elle en ressentirait ». Et, comme il lui demandait si elle oubliait souvent de penser à Dieu, elle resta un moment silencieuse, puis répondit : « Pendant ces huit jours 19, plus qu’ordinairement pendant une année entière. » Un peu avant qu’on se séparât, elle lui dit : « Ah ! combien je voudrais mourir. » Et à la question : « Ne pouvez-vous donc pas supporter plus longtemps vos souffrances ? » elle répondit : « Vraiment non ! » « Son regard me disait assez, écrit Overberg, pourquoi elle désirait si fort la mort. »
3. Dans cette seconde visite aussi, l’impression que la manière d’être d’Anne Catherine fit sur les supérieurs ecclésiastiques fut très satisfaisante. Ce qui plut surtout au vicaire général, ce fut la prière qu’elle lui fit avec beaucoup d’insistance de ne pas laisser approcher d’elle les curieux qui voudraient la visiter.
« La sœur Emmerich, écrivit-il le 9 avril à Rensing, m’a tellement remercié d’avoir prescrit la diminution des visites et m’a prié si instamment d’y tenir fortement la main, que cela m’aurait décidé à le faire quand même il n’y aurait pas bien d’autres raisons tirées de la manière de sentir de la sœur Emmerich, et motivées par le désir d’alléger ses souffrances et d’éloigner ce qui trouble son repos. Vous pouvez montrer cet ordre aux personnes ecclésiastiques ou laïques qui seraient assez indiscrètes pour insister malgré vos remontrances. On peut leur faire savoir aussi que la sœur Emmerich consent docilement à recevoir les visites autorisées par vous, mais qu’il ne serait pas juste de lui imposer des visites de ce genre contrairement à sa volonté. »
Clément Auguste témoigna aussi par écrit combien il était satisfait du doyen lui-même. « Votre manière d’agir, dit-il, prouve que je n’aurais pu trouver personne qui s’acquittât mieux des soins dont je vous ai chargé. »
Clément Auguste et ses compagnons quittèrent Dulmen le 8 avril, à midi. À peine étaient-ils partis qu’Anne Catherine, qui était d’ailleurs épuisée de fatigue à la suite des entretiens prolongés et multipliés des deux derniers jours, entra dans cet état qui la faisait participer à la Passion de Jésus-Christ et aux douleurs de la sainte Vierge dont la fête tombait ce jour-là. À l’heure des vêpres, les blessures de la couronne d’épines saignèrent avec tant d’abondance que le sang coula sur son visage et pénétra à travers le bandage qui entourait sa tête. Dans cet état de souffrance, elle avait fait prier le doyen de venir auprès d’elle, parce qu’on lui avait annoncé la visite du préfet du département qui, dans ces circonstances, ne pouvait lui être que très pénible. Le doyen lui ayant demandé si elle craignait que ce magistrat ne lui adressât des questions auxquelles elle ne saurait pas répondre, elle lui dit : « Quant aux questions qu’on peut me faire, je n’ai jamais eu d’inquiétude, car pour cela je me repose sur la promesse faite par le Sauveur à ses disciples qu’ils n’avaient pas à s’inquiéter de ce qu’ils auraient à dire, parce qu’il le leur suggérerait. »
Le doyen remarqua aussi que son visage se contractait douloureusement toutes les fois que le derrière de la tête touchait l’oreiller, auquel d’ordinaire elle ne s’appuyait que par les épaules, de sorte qu’entre la tête et l’oreiller, il y avait un vide de la largeur de la main. Le médecin Krauthausen rapporte aussi, en date de ce même jour :
« À deux heures moins un quart, Anne Catherine s’étant plainte, environ trois heures auparavant, de cuissons et de douleurs violentes à la tête, je trouvai le linge qui lui entourait la tête et le cou, ainsi que son visage, couverts en plusieurs endroits d’une quantité de sang qui avait coulé du front. Après l’avoir lavé avec soin, je remarquai sur le front une infinité de petites ouvertures par lesquelles le sang revint de nouveau sur plusieurs points.
« Dans la nuit du 8 au 9, les plaies des mains et des pieds avaient abondamment saigné : il en fut de même pendant la journée du 9. Le soir, à huit heures, je trouvai le pouls si petit et si faible, et la malade dans un tel état de prostration que je craignis pour sa vie. »
4. Le journal du doyen Rensing fait un rapport analogue le 9 avril.
« Lorsque je la visitai à une heure et demie, le vendredi 9, je fus terrifié : car elle était étendue sur sa couche, sans force, pâle et défigurée, comme un mourant qui est arrivé à son dernier moment : mais, dès que je lui adressai la parole, elle me tendit la main et se plaignit avec une voix qu’on pouvait à peine entendre des affreuses douleurs qu’elle ressentait dans ses plaies. Celles des pieds saignaient si abondamment que le drap de lit en était tout rougi. Elle dit aussi que sa sœur, qui était malade, s’était trouvée si faible pendant la nuit qu’elle avait craint d’être obligée de faire appeler son confesseur : « Cela m’affligea tellement, ajouta Anne Catherine, que je me plaignis du fond du cœur au bon Dieu de la détresse où j’étais et que je le suppliai de secourir ma sœur. Aussitôt après, elle se sentit mieux et reposa un peu, ce qui me causa tant de joie que j’en oubliai mes propres souffrances. » Sa sœur, en effet, fut de nouveau en état de vaquer à ses occupations ordinaires. »
XXII
VISITES MULTIPLIÉES. – TÉMOIGNAGE D’UN MÉDECIN PROTESTANT.
1. La défense faite par Clément Auguste, sur les instantes prières d’Anne Catherine, d’admettre des visites de curieux, quoique renouvelée à plusieurs reprises, n’eut pas le résultat qui eût été si nécessaire à la pauvre malade : car l’affluence des visiteurs alla toujours croissant par suite de la nouvelle promptement répandue de l’enquête. Il vint beaucoup de personnes qui ne se laissèrent pas congédier et qui mirent en avant des raisons auxquelles la trop grande condescendance du doyen n’opposa pas la résistance qu’il eût fallu : ce furent spécialement des médecins et des personnes de la haute classe qui prétendaient avoir, en quelque sorte, le droit de voir les stigmates. Rensing eut à noter dans son journal les plaintes et les prières souvent répétées avec lesquelles Anne Catherine le conjurait de ne laisser entrer personne.
« Ne vous inquiétez donc pas, lui dit-elle une fois, si l’on vous fait mauvais visage à cause de cela : Dieu vous récompensera de la charité que vous me témoignerez par là. »
L’inspection de ses stigmates lui était beaucoup plus sensible que les douleurs causées par les plaies, et Rensing était constamment obligé de la tranquilliser, en lui représentant que cette sorte de mortification pourrait être pour elle une source de nouveaux mérites devant Dieu. Cependant elle ne cessa jamais d’être tourmentée à la pensée des visites et, même dans les visions où Dieu la fortifiait et la consolait, elle était troublée par cette pensée. Elle avoua à Rensing que, trois fois déjà, comme elle priait Dieu de lui donner la patience nécessaire pour les supporter, elle avait reçu cette réponse : « Ma grâce te suffit ! » « Je deviens de plus en plus un objet de dégoût pour moi-même, ajouta-t-elle, à cause du grand bruit que mon histoire fait maintenant de tous côtés : cependant je me console par la pensée que je n’en suis pas cause. »
2. On lit dans le journal de Rensing, à la date du 3 avril :
« Aujourd’hui s’est présenté un visiteur qu’aucune représentation n’a pu arrêter ; c’est le docteur Ruhfus, de Gildhaus, dans le comté de Bentheim. Il désirait vivement être admis auprès d’elle et n’a pas voulu se retirer que je ne lui eusse promis de demander à la malade si elle pouvait se résoudre à recevoir sa visite. Elle fit d’abord des difficultés ; mais, lorsque je lui eus exposé les motifs qui me faisaient désirer qu’elle ne refusât pas cette visite d’un médecin protestant, elle dit qu’elle trouverait bon ce que je déciderais, et alors je fis entrer le docteur. Il se comporta avec beaucoup de discrétion, se fit montrer les plaies, s’enquit de tout ce qui lui parut bon à savoir en pareil cas, et, en se retirant, non seulement il remercia la malade de sa complaisance, mais encore il s’exprima touchant ce phénomène d’une manière qui fait honneur à sa droiture. Sitôt que je fus avec lui hors de la chambre, il me dit : « Ce que je viens de voir est bien étonnant. Il ne peut pas ici être question d’imposture ; les sentiments religieux de la personne le disent assez, ainsi que sa physionomie où se manifestent si clairement une pieuse simplicité, une crainte de Dieu partant du fond du cœur et un abandon paisible à la volonté divine ; c’est ce que dit enfin le caractère des plaies elles-mêmes, au moins pour un homme de l’art. Expliquer naturellement l’origine des plaies par l’imagination, l’induction, l’analogie et toutes les autres causes au moyen desquelles on voudrait en rendre raison, est chose absolument impossible. À mon avis, cela est surnaturel. » J’ai cru devoir noter dans mon journal ce jugement d’un homme compétent, dont l’impartialité n’est pas douteuse : je le fais, autant que possible, avec les propres expressions du docteur, d’autant plus qu’avant d’avoir vu par lui-même cet étrange phénomène, il en avait fait des plaisanteries à l’auberge. »
3. Comme l’entourage habituel d’Anne Catherine ne comprenait rien à son état extraordinaire, et comme il n’y avait près d’elle personne qui pût la protéger et la garantir quand elle était obsédée de visiteurs curieux, il arrivait fréquemment qu’on lui adressait des questions sottes et, indiscrètes auxquelles elle ne pouvait ni ne voulait répondre. Cela n’empêchait pourtant pas que chaque parole échappée par hasard de sa bouche, lorsqu’elle était à l’état contemplatif, ne fût avidement recueillie comme une réponse et répétée légèrement, ce qui donnait lieu à toute espèce de propos absurdes dans la petite ville. Un jour que Rensing le faisait remarquer à Anne Catherine, elle profita de cette occasion pour obtenir de lui un moyen infaillible de se défendre contre ces interrogations curieuses :
« Je vous en prie, lui dit-elle, ordonnez-moi, en vertu de l’obéissance, de ne répondre à aucune question dictée par la curiosité, quand même elle me serait adressée par mon confesseur ou par une de mes anciennes sœurs en religion ; moyennant cela, même pendant mes défaillances, je garderai le silence quand en m’interrogera de la sorte. Alors on ne pourra plus prétendre que j’ai dit, étant en défaillance : « Tel ou tel est dans le purgatoire, tel autre dans le ciel » ; car Dieu sait tout ce qu’on m’attribue dans ce genre. »
Envers son confesseur ordinaire, elle n’avait pas besoin de cette sauvegarde, car lui-même était lié par la défense rigoureuse que lui avaient faite ses supérieurs ecclésiastiques d’adresser aucune question à Anne Catherine lorsqu’elle était en extase. Et Rensing témoigne en ces termes de la fidélité avec laquelle obéissait cet homme consciencieux :
« Anne Catherine, dit-il, m’a raconté que, la nuit précédente, elle est tombée en défaillance (en extase) et qu’elle l’a dit à son confesseur, le père Limberg. Mais il lui a répondu qu’elle ne devait pas lui en parler davantage, parce que c’était contraire à la volonté des supérieurs ecclésiastiques ; que si elle avait quelque chose à faire connaître à ce sujet, c’était à moi qu’elle en devait parler. « Cela, ajouta-t-elle, m’a fait beaucoup de plaisir : car s’il m’avait fait des questions, je n’aurais plus eu pleine confiance en lui comme confesseur, parce qu’il eût été désobéissant envers l’autorité ecclésiastique. »
XXIII
LES DERNIERS JOURS DE LA SEMAINE SAINTE ET LES FÊTES DE PÂQUES.
1. Anne Catherine se prépara à la communion pascale pour le jeudi saint. Un ardent désir du très saint Sacrement s’alluma dans son cœur, comme c’était l’ordinaire, quelques jours auparavant. La pieuse fille qui, depuis l’impression des stigmates était devenue incapable de prendre aucune nourriture terrestre, éprouvait, dans sa préparation à la sainte communion, le sentiment de la faim naturelle à l’égard du pain de vie. Ce fut ainsi, qu’étant entièrement plongée dans la contemplation de ce pain céleste, elle cria plusieurs fois : « J’ai faim, j’ai faim ! » Son entourage prit ces paroles à la lettre, et sa sœur, pendant cet état d’extase où elle n’avait pas le sentiment de ce qui se faisait autour d’elle, lui versa dans la bouche deux cuillerées de bouillon d’oseille qu’elle fut forcée de rejeter à l’instant avec de violentes nausées. Elle se trouva tellement mal après cela que le médecin fit venir l’abbé Lambert pour qu’il lui rendît de la force au moyen de la bénédiction sacerdotale. Tout l’entourage savait bien que le même résultat se produisait chaque fois qu’on lui faisait goûter à quelque mets ; mais ni les médecins, ni le confesseur, ni la sœur ne cessaient de renouveler leurs tentatives pour lui faire prendre de la nourriture. Ainsi Krauthausen rapporte, à la date du 11 avril :
« Elle a, sur ma demande, pris, à deux reprises différentes, une cuillerée de bouillon gras ; mais chaque fois elle l’a vomi immédiatement. »
Le jour précédent on lui avait également fait prendre, par l’ordre du médecin, quelques gouttes de vin qu’elle avait de même rejetées immédiatement. Le 14 avril, veille du jeudi saint, on fit un nouvel essai avec de la soupe d’eau et de poisson. « Mais, dit Krauthausen, elle ne put la garder, et il s’ensuivit aussitôt un vomissement. » Toutefois, lorsqu’elle eut reçu la sainte communion, elle fut tellement fortifiée que tout son entourage fut frappé du changement qui en résulta. Et lorsque le doyen la visita à midi, il la trouva à la vérité très faible, parce que la croix imprimée sur la poitrine ne cessait pas de saigner depuis la veille ; mais pourtant elle put lui faire connaître que la consolation qu’elle avait reçue rendait maintenant ses souffrances plus supportables. Elle avait aussi, pendant la nuit précédente, imploré auprès de Dieu la guérison de Clara Soentgen, atteinte d’une maladie dangereuse.
2. Si ses souffrances étaient devenues plus supportables par la vertu de la sainte communion, elles n’avaient pourtant pas diminué : elles augmentaient plutôt constamment, et, vers le soir du jeudi saint, elles devinrent assez violentes pour lui faire dire qu’il lui semblait que, si elle pouvait mourir, elle mourrait maintenant de l’excès de ses douleurs.
« Dans la nuit d’avant le vendredi saint, vers onze heures, rapporte Rensing, toutes ses plaies commencèrent à saigner, et elles saignaient encore abondamment lorsque je la visitai à huit heures du matin. Il était notamment sorti tant de sang de la plaie du côté que le frisson me saisit lorsque je vis les draps comme teints de sang. Je lui demandai comment elle avait passé la nuit dernière, à quoi elle répondit : « La nuit ne m’a pas semblé longue, car j’ai médité, heure par heure, ce que Notre-Seigneur a souffert pendant cette nuit. Cela m’a donné de la consolation, oh ! quelle douce consolation ! J’ai eu aussi une courte défaillance et il m’est venu à l’esprit que je devrais prier pour que les signes me fussent enlevés, mais que les douleurs me restassent. »
Cette méditation des heures de la Passion était pour Anne Catherine une contemplation des souffrances du Sauveur auxquelles elle participait : c’est pourquoi, pendant ces jours-là, elle fut livrée sans relâche à des tortures indicibles. Chaque nerf de son corps, disait-elle, était torturé par des douleurs cruelles qui se faisaient sentir jusqu’à la pointe des doigts, et elle fut en proie à une fièvre ardente qui la fit souffrir sans relâche jusqu’à minuit, heure où commençait le saint jour de Pâques, lequel tombait le 18 avril. Ce ne fut qu’à trois heures du matin qu’elle se sentit soulagée.
Le samedi saint, les plaies ne saignèrent pas. Ce jour-là, le doyen la trouva très faible et très épuisée : il lui rendit un peu de force par ses exhortations spirituelles, en sorte qu’elle put répondre à quelques-unes de ses questions. Il lui demanda, entre autres choses, pour qui elle avait spécialement prié Dieu dans les derniers jours, et elle lui fit cette réponse :
« Pour ceux qui se recommandent à mes prières et surtout pour les pécheurs qui ne connaissent pas encore le malheur de leur état. Pour moi-même, je prie ainsi : « Seigneur, que votre volonté se fasse ; faites de moi ce qui vous plaira ; mais faites-moi aussi la grâce de tout endurer et de ne pas vous offenser. » Autrefois, j’étais si heureuse d’être à l’église pendant la semaine sainte et les fêtes de Pâques ! Ah ! que je m’y trouvais bien alors quand j’avais devant les yeux tout ce qui nous rappelle la mort et la résurrection du Sauveur ! Maintenant, il faut rester couchée ici : mais c’est aussi la volonté de Dieu, et par conséquent cela est bon et je me réjouis qu’il en soit ainsi. »
3. Le lundi de Pâques, Rensing note qu’il la trouva d’une bonne humeur inaccoutumée. Krauthausen le remarque aussi, à la date de ce jour :
« Le 19, dit-il, elle s’est trouvée, pendant toute la journée, si bien et de si bonne humeur qu’on n’avait pas vu pareille chose durant tout le mois. Cependant elle a continué à ne prendre aucun aliment, si ce n’est la moitié d’une pomme cuite dont elle a seulement sucé le jus et deux gorgées d’eau. »
Interrogée par le doyen sur ce qui causait sa bonne humeur, elle répondit :
« J’en suis redevable à la consolation que j’ai éprouvée en méditant sur la Résurrection. Je ne ressens maintenant ni faim, ni soif ; mais je ne sais pas ce que Dieu me prépare. Depuis plusieurs jours, il m’a semblé que plusieurs messieurs étaient chez M. le vicaire général et qu’on avait parlé de moi. Il y eut spécialement un monsieur qui parla de moi, et j’ai une idée vague que celui-là doit venir aussi pour voir mes signes. »
Le jeudi saint elle avait dit encore après la sainte communion : « Après Pâques, mon repos doit être troublé. On viendra certainement faire de nouvelles expériences sur moi. »
La suite fera voir qu’Anne Catherine, cette fois encore, voyait aussi juste que le 27 mars et le 15 avril, où elle avait dit à Rensing : « J’ai le cœur très serré parce que j’aurai de nouveau beaucoup à souffrir de la part de ces messieurs à cause de mes plaies. »
4. Le 13 avril, le vicaire général écrivit à Rensing pour l’engager à chercher une femme de bonne réputation qui pût, pendant deux semaines, rester continuellement le jour et la nuit auprès d’Anne Catherine, observer tout et le rapporter consciencieusement au doyen.
« Dans le cas où vous croiriez pouvoir trouver une telle personne, ajoutait le vicaire général, vous devez préalablement demander à la sœur Emmerich si cela lui convient, et lui dire qu’elle doit être persuadée que, lorsque j’ordonne ainsi quelque chose de fâcheux et de désagréable pour elle, je le fais uniquement parce que je le crois absolument nécessaire, et parce que je le regarde comme mon devoir et comme un moyen de lui épargner de plus grands désagréments ; dites-lui aussi que, pour agir ainsi, il me faut faire violence à mon cœur. »
Le 20 avril, mardi de Pâques, le vicaire général vint de nouveau à Dulmen avec Overberg. Nous donnons textuellement la relation de cette troisième visite d’après les notes écrites de la main du vicaire général.
TROISIÈME VISITE DU VICAIRE GÉNÉRAL ET D’OVERBERG
(D’après le rapport officiel du vicaire général Droste.)
« Le 20 avril 1813, M. Overberg et moi, nous partîmes de nouveau pour Dolmen où nous arrivâmes vers deux heures de l’après-midi.
« Nous n’avions pas encore fini de dîner qu’un médecin de Stadtlohn, dont le nom m’est inconnu, vint nous trouver et me pria de lui permettre d’examiner l’état de la sœur Emmerich. Je crois que jusque-là le doyen n’avait pas voulu l’y autoriser. Comme je juge utile que des médecins examinent les phénomènes singuliers qui se produisent sur le corps de la sœur Emmerich et que, d’ailleurs, j’avais le dessein de me faire encore montrer toutes les plaies, je promis à ce médecin de le prendre avec moi. Comme nous allions sortir, on m’annonça qu’il y avait là un chirurgien très habile de Gescher, (j’ai également oublié son nom), qui, lui aussi, désirait vivement examiner ces mêmes phénomènes. Je me dis qu’il importait peu qu’il y en eût un de plus ou un de moins, puisque tout devait être vu. Le doyen et M. Krauthausen étaient venus aussi : mais je priai ceux-ci de prévenir la malade de cette visite, parce que je savais bien que la visite de ces étrangers lui serait très désagréable. M. Krauthausen alla d’avance la trouver ; les deux médecins, M. Overberg et moi, nous le suivîmes bientôt et nous arrivâmes vers quatre heures chez la sœur Emmerich. Elle était couchée dans son lit, comme de coutume.
« Alors eut lieu l’examen. Sur la tête, on ne voyait pas de sang, mais seulement quelques piqûres. Les plaies des mains et des pieds, aussi bien à la partie supérieure que dans l’intérieur des mains et sous la plante des pieds, étaient dans leur état ordinaire ; je crois pourtant que la croûte de la main droite avait été traversée par le sang qui avait jailli. Comme, pendant ce séjour que je fis à Dulmen, je visitai souvent la sœur Emmerich, je ne puis me rappeler bien exactement si je trouvai les choses ainsi lors de ma première visite, ou lors d’une visite ultérieure. J’examinai la croûte du sang de la main gauche avec un verre grossissant et je la trouvai très mince et semblable à un épiderme rugueux ou un peu plissé vu ainsi à la loupe. Pendant ce séjour à Dulmen, j’ai aussi examiné une fois avec la loupe la plaie qui se trouve, si je ne me trompe, au-dedans de la main gauche et, dans le sang desséché, j’ai pu apercevoir une cavité ronde, un trou ayant à peu près cette forme. (Voir planche ci-dessous, fig. 1.)
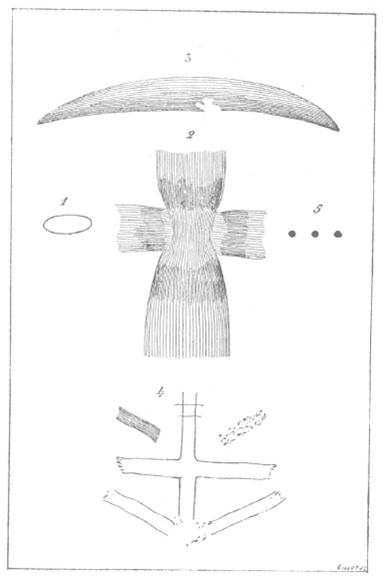
« Cette fois, les croix de la poitrine ne saignaient pas, mais semblaient colorées d’un rouge pâle par le sang qui était apparent à travers l’épiderme. J’examinai de même avec la loupe l’endroit où sont les lignes qui forment les croix, ainsi que la peau environnante, et je pus voir distinctement qu’il n’y avait aucune lésion à la peau : l’épiderme sur les lignes des croix, aussi bien que la peau environnante, à une assez grande distance, était identique à lui-même et paraissait s’écailler un peu quand on le voyait à travers le verre grossissant.
« J’examinai avec la loupe la place grisâtre au-dessous de la croix : mais je n’y distinguai pas une forme assez arrêtée pour que je pusse la décrire. Plus en haut, la couleur pâlissait et à peu de distance du centre elle semblait disparaître tout à fait : la partie inférieure était la plus allongée et la plus large ; c’était à peu près comme ceci, si ma mémoire ne me trompe pas. (Voir la planche, fig. 2.)
« La marque du côté droit ne saignait pas, mais, dans la partie supérieure, elle était couverte en partie de sang desséché ; on voyait, dans cette direction, une nuance plus foncée, comme pourrait la donner du sang extravasé qui ne serait pas immédiatement sous l’épiderme : l’ensemble peut être à peu près figuré ainsi. (Voir la planche, fig. 3.)
« J’examinai avec la loupe la place où il n’y avait pas de sang, mais je ne trouvai nulle part la peau entamée ; toutefois, il se peut que la peau, à cet endroit, eût une coloration un peu rougeâtre ; je ne m’en souviens pas distinctement.
« La sœur Emmerich y ayant donné son consentement 20, M. Krauthausen posa sur la plaie de la main gauche un emplâtre composé d’althaea et d’autres ingrédients, qu’il avait étendu sur de la charpie et par là-dessus un emplâtre collant ; il pouvait être environ six heures du soir. Si je ne me trompe, elle se plaignait déjà le soir, quand je la visitai de nouveau, que cette plaie la faisait souffrir plus que les autres.
« Le 21 avril, M. Krauthausen vint me trouver vers huit heures du matin, et nous allâmes ensemble chez la sœur Emmerich. M. Krauthausen enleva l’emplâtre posé sur la plaie de la main, afin d’examiner l’état de cette plaie, car la malade se plaignait d’y ressentir des douleurs plus vives et d’avoir passé la nuit sans dormir. La croûte qui s’était formée vint naturellement avec l’emplâtre. Je crois cependant qu’il resta encore tout autour un peu de sang desséché. Mais la plaie était nette et il n’y avait pas trace de suppuration ; on ne voyait que du sang et, à ce qu’il semblait, un liquide aqueux. Nous engageâmes la malade à supporter encore un peu de temps l’emplâtre sur cette même plaie, en lui promettant que, le soir, on l’enlèverait tout à fait, dans le cas où elle en souffrirait comme précédemment.
« Je priai Krauthausen de tourner un peu la malade sur le côté gauche, pour que je pusse voir le stigmate du côté droit à un meilleur jour qu’hier. Je l’examinai encore à la loupe et je ne vis pas de différence notable avec ce que j’avais déjà observé : seulement cet endroit où une nuance plus foncée semblait annoncer la présence du sang extravasé, était moins rouge. Je remarquai aussi avec la loupe, à droite de la partie supérieure du stigmate, quelques égratignures séparées les unes des autres et ressemblant, je ne dirai pas à des déchirures faites avec une aiguille, mais plutôt à des gerçures spontanées de la peau.
« Les croix de la poitrine étaient toutes rouges de sang. Je fis laver le sang à la partie supérieure et je regardai de nouveau avec la loupe : s’il y avait eu une lésion de la peau, je l’aurais certainement remarqué et je m’en souviendrais bien à présent ; mais près de la croix, je trouvai, je crois, une raie à peu près de cette longueur (voir la planche, fig. 4.) qui avait l’air d’une dépression remplie de sang. À droite, au-dessus du bras gauche de la croix supérieure, je trouvai des égratignures semblables à celles que j’avais observées au-dessus du stigmate du côté 21. Je demandai si par hasard l’épingle qui attachait le mouchoir du cou n’aurait pas pu faire ces égratignures : mais la malade répondit qu’elle mettait toujours cette épingle de manière à ce que la pointe fût tournée en dehors (ce qu’elle fit encore en ma présence).
« Maintenant, l’emplâtre dont il a été question plus haut fut remis sur la même plaie. Ce jour-là, je fis plusieurs visites à la malade, mais je trouvai toujours le même état. Pendant le séjour que je fis cette fois à Dulmen, toutes les fois que j’examinai une ou plusieurs des plaies des mains et des pieds, je les trouvai toujours, notamment celles de la partie extérieure, entourées d’une faible rougeur d’inflammation, à ce qu’il me sembla. M. Krauthausen me dit qu’il en était toujours ainsi.
« Vers midi, je conduisis chez elle M. Schwelling de Munster, lequel m’en avait instamment prié : elle y avait consenti, sur ce que je lui avais dit que c’était un très brave homme qui ne demandait pas à voir la marque du côté, ni les croix de la poitrine, ni même, je crois, les plaies des pieds.
« Vers six heures du soir, nous retournâmes chez elle, M. Krauthausen et moi : elle avait, si je ne me trompe, un peu dormi dans l’après-midi. Le sang paraissait à travers l’emplâtre de la main gauche qu’il avait traversé : on retira cet emplâtre qui était tout imbibé de sang. La plaie avait donc saigné, car, en supposant que, le matin, la croûte assez mince et le sang desséché qui était autour n’eussent pas été enlevés entièrement avec l’emplâtre, lorsqu’on l’avait retiré, une si petite quantité de sang desséché n’aurait pas suffi pour altérer l’emplâtre à ce degré. Je crois que la plaie supérieure de la main droite a aussi saigné. Il n’y avait dans la plaie de la main gauche aucune trace de suppuration. Comme la malade se plaignait de souffrir beaucoup, nous ne remîmes pas l’emplâtre, comme nous le lui avions promis. Nous eûmes ces ménagements pour elle parce que nous ne croyions pas avoir le droit de torturer une personne à laquelle il n’y a rien à reprocher sous aucun rapport.
« Si je le lui avais ordonné, elle aurait sans aucun doute tout supporté ; mais elle craignait de tomber dans l’impatience, et je ne crois pas avoir, en pareil cas, le droit de donner un tel ordre. La malade se plaignit le soir de douleurs de tête ; elle pensait que la tête rendrait du sang.
« Le 22, vers huit heures du matin, M. Krauthausen vint chez moi, comme je l’en avais prié ; il avait déjà visité la sœur Emmerich et elle lui avait dit qu’elle croyait que sa tête avait déjà saigné ou saignerait bientôt. M. Krauthausen n’avait pourtant pas vérifié le fait en retirant le linge que la patiente porte autour de la tête. Nous allâmes ensemble chez elle. Elle avait un peu dormi pendant la nuit, si je ne me trompe. Nous trouvâmes que le sang avait coulé du front par-dessous le linge jusqu’au-dessus du nez, mais il s’était desséché. On ôta sa coiffe et le linge qui entourait sa tête ; on vit dans le bonnet, sur la partie postérieure, d’assez larges taches de sang : il y avait spécialement au côté droit de la tête, dans le voisinage de la tempe, une forte tache de sang dans le bonnet et dans les cheveux.
« Il avait été impossible jusqu’à présent, à cause de l’épaisseur plus qu’ordinaire de la chevelure, d’examiner les points par lesquels le sang coule sous les cheveux. Maintenant, elle a consenti à ce qu’on lui coupe les cheveux aussi courts que possible ; cependant on laissera tout autour assez de cheveux pour que le sang qui coulera ne puisse traverser immédiatement ses coiffes et les draps du lit. Elle l’a demandé expressément par des raisons de propreté.
« Le sang qui était sur le nez et sur le front a été lavé par M. Krauthausen, après quoi on a pu voir à l’œil nu une quantité de petits points saignants, descendant jusqu’à la moitié du front et remontant jusqu’au milieu des cheveux de devant. Les points sont à peu près de cette dimension (voir la planche, fig. 3), les uns plus petits, quelques-uns peut-être plus grands : ils semblent semés irrégulièrement. Je les ai examinés à la loupe et j’ai pu voir spécialement dans un de ces points (qui, si je ne me trompe, sont de petits trous et ne paraissent pas avoir la forme qu’ils auraient s’ils étaient faits avec un corps très pointu) du sang encore liquide : j’ai cru voir aussi très distinctement que c’était bien un petit trou.
« Avant mon départ, la malade me dit qu’une personne de Munster était venue la visiter, disant avoir la permission du doyen, mais qu’elle ne savait pas si cela était vrai. Comme je lui répondis, d’après la connaissance que j’en avais, que le doyen avait permis cette visite, elle se montra satisfaite, me remercia cordialement de la diminution du nombre des visites et me pria de les interdire rigoureusement. Je lui parlai à ce propos de la défense que j’avais faite de faire voir les plaies du côté, de la poitrine et des pieds, et je voulus ensuite la préparer à laisser voir ses plaies aux médecins de Stadtlohn et de Gescher mentionnés plus haut, lesquels voulaient revenir dans quinze jours : mais elle dit très nettement : « Non ! ils ne les reverront pas. »
« J’ai été obligé cette fois d’examiner très minutieusement les plaies et le reste, parce que M. Krauthausen ne pouvait rien voir à travers la loupe.
« En prenant congé d’elle, je lui dis en plaisantant : « Quand vous voudrez mourir, vous me le ferez dire d’avance », à quoi elle répondit qu’elle n’y manquerait pas. »
Tel est le rapport du vicaire général.
La patiente n’avait guère le cœur à la plaisanterie. Les épreuves des jours précédents l’avaient mortellement épuisée. Mais sa patience et sa constance se soutinrent jusqu’au bout, en sorte que Clément Auguste, sous l’impression de la paix et du calme de cette âme si forte, sembla oublier un moment les cruelles souffrances qu’elle avait à endurer.
Il prit occasion de cette troisième visite pour adresser au commissaire général de police français les explications officielles qui suivent :
« La fille Emmerich désire uniquement être oubliée du monde pour s’occuper sans distraction des seules choses qui l’intéressent. Elle ne demande rien et n’accepte rien. Elle désire aussi qu’on ne parle pas d’elle. Je suis porté à croire que le monde cessera bientôt de s’occuper d’elle. Quoique je ne puisse pas apercevoir l’ombre d’une imposture, je ne cesserai pourtant pas d’y avoir l’œil très attentivement. »
XXIV
LE MÉDECIN KRAUTHAUSEN ET LE DOYEN RENSING COMMENCENT À PERDRE PATIENCE.
1. Comme le résultat des observations si exactes et si minutieuses du vicaire général concordait avec la conviction déjà existante chez les médecins que les stigmates n’avaient pas pu être produits artificiellement et qu’ils ne pouvaient pas non plus être entretenus par des moyens artificiels, le doyen Rensing se livra avec confiance à l’espoir que l’enquête allait être déclarée suffisante. Krauthausen y comptait encore plus fermement et il était décidé à ne pas continuer ses visites plus longtemps. Ayant été autrefois médecin du couvent, il avait si bien appris à connaître Anne Catherine et son entourage que la pensée d’une imposture ou d’une illusion ne pouvait pas lui venir à l’esprit. Il s’était chargé, par déférence pour le vicaire général, de l’enquête médicale et de la rédaction de rapports journaliers. Les stigmates étaient pour lui un fait certain, incontestable, qu’il ne pouvait cependant s’expliquer d’après son expérience et ses connaissances comme médecin ; car, non seulement ils échappaient à toute action curative, mais ils présentaient chaque jour à l’observateur des symptômes qui ne lui permettaient pas de les considérer comme une forme particulière de maladie naturelle. Il avait vu, jour par jour, les douleurs insolites que les plaies occasionnaient chez Anne Catherine ; c’est pourquoi il répugnait à sa ferme conviction de l’innocence de la pieuse fille, comme à la sympathie naturelle qu’elle lui inspirait, de la voir soumise plus longtemps aux tortures de l’enquête. En outre, il lui fallait, comme au docteur Wesener, subir les mépris de ses confrères incrédules qui le prenaient en pitié parce qu’il ne pouvait pas découvrir la fraude, et il en voulait presque à Anne Catherine de n’avoir pas su mieux cacher les phénomènes extraordinaires qui s’étaient produits en elle et échapper à une enquête qui pour lui n’avait d’autre conséquence que de la fatigue et des ennuis.
2. Comme le vicaire général avait quitté Dulmen sans s’expliquer d’une manière précise, Krauthausen n’attendit pas une décision ultérieure, et déclara, en envoyant son dernier rapport daté du 26 avril, qu’il se considérait comme déchargé de la mission qui lui avait été confiée. Mais la prompte décision qu’il désirait et que Rensing ne désirait pas moins que lui ne pouvait pas encore être prise par le vicaire général, malgré les observations qu’il avait faites lui-même avec tant de soin et malgré le jugement favorable des trois médecins, parce qu’Overberg n’avait pas encore fini de prendre ses informations sur la vie intérieure d’Anne Catherine. Bien que le vicaire général, à chacune de ses visites et dans chaque entretien qu’il avait eu avec elle, n’eût reçu que des impressions qui fortifiaient de plus en plus sa conviction que des faveurs extraordinaires lui avaient été accordées, c’était un homme trop judicieux et trop prudent pour se hasarder à rendre un jugement final avant d’avoir pesé mûrement les conclusions et les rapports de tous ceux qui avaient pris part à l’enquête. Il laissa donc Overberg à Dulmen quelques jours encore, afin qu’il pût compléter ses informations autant que le permettraient les forces d’Anne Catherine. Mais, en attendant que tous les renseignements eussent passé sous ses yeux et l’eussent mis en mesure de rendre sa dernière décision, il voulait que le projet formé, dès le 13 avril, de placer Anne Catherine sous la surveillance d’une femme digne de confiance, frit mis à exécution. Il regardait cette mesure comme nécessaire pour prévenir le reproche qui pourrait lui être fait de n’avoir pas employé tous les moyens que la prévoyance et la prudence paraissaient prescrire.
3. Mais Rensing, qui ne pouvait trouver la personne capable de remplir cet office aussi promptement que son impatience l’eût désiré, fit le 27 avril, au vicaire général, une nouvelle proposition pour laquelle il s’était assuré d’avance du contentement d’Anne Catherine. Voici ce qu’il lui écrivit :
« M. Krauthausen commence à être fatigué des fréquentes visites qu’il lui faut faire, et il m’a dit hier qu’il ne continuerait ses observations et ses rapports que jusqu’à la fin de ce mois. La malade aussi s’aperçoit bien qu’il est excédé de cette affaire et il en résulte qu’elle ne le voit venir qu’avec un sentiment d’effroi. Pour rendre le repos à la pauvre fille, qui du reste n’en trouvera guère tant qu’elle vivra, et en même temps pour donner satisfaction aux critiques dont il est permis de tenir compte, le mieux serait, suivant l’opinion de tous les gens sages, que deux ou trois médecins, à tour de rôle, restassent jour et nuit près d’elle et l’observassent pendant une semaine. Cette opinion était aussi celle du médecin protestant, le docteur Ruhfus, qui est revenu ici ce matin et m’a encore déclaré que les phénomènes lui paraissaient surnaturels. La sœur Emmerich acceptera volontiers cet arrangement. »
Deux jours après, Rensing reproduisit cette proposition et y ajouta, en ce qui le concernait, la demande de pleins-pouvoirs de l’autorité épiscopale pour essayer ce qui lui paraîtrait utile. Le sévère vicaire général répondit, en peu de mots :
« D’abord, je crois toujours que le mieux serait la surveillance de quinze jours par une personne du sexe. Notre mission n’est pas de mettre la chose tellement hors de doute que ceux qui ont peur de la vérité ne puissent plus trouver des objections : ce serait une tâche ingrate, et la peine qu’on y emploierait resterait infructueuse. Qu’y a-t-il réellement là dans le corps et dans l’âme ? comment ce qui y est a-t-il pris naissance ? comment Anne Catherine est-elle devenue ce qu’elle est ? Telles sont les questions auxquelles nous avons à répondre et cela de manière à ce que la chose soit éclaircie pour nous et pour tous les hommes sensés, non par des faits isolés, mais par l’ensemble qui résulte du rapprochement de toutes les circonstances. Toutefois, dans l’application des moyens, nous ne devons pas contrevenir aux règles de la justice et de la charité, et un soupçon en l’air, fondé uniquement sur une possibilité, ne mérite pas qu’on en tienne un compte particulier. »
4. On ne doit pas trouver étrange que Rensing désirât si vivement la clôture de l’enquête : il devenait tous les jours plus pénible pour lui d’être le spectateur du cruel martyre d’Anne Catherine sans pouvoir lui offrir d’autre assistance ni d’autre consolation que la simple mention des ordres et des prescriptions de l’autorité ecclésiastique. En outre, l’importunité et la curiosité sans retenue des étrangers, plus nombreux qu’à l’ordinaire à l’époque des confessions pascales, qui désiraient voir Anne Catherine, lui occasionnaient non seulement des dérangements très désagréables, mais assez fréquemment des conflits irritants qui, pour un homme aussi poli et aussi régulier dans ses habitudes, devenaient de plus en plus incompatibles avec ses devoirs de pasteur des âmes. Dans ses visites journalières, il s’était scrupuleusement fait rendre compte par Anne Catherine de tout ce qui lui arrivait à l’intérieur comme à l’extérieur : il avait envoyé les rapports les plus exacts sur tout cela et porté en outre à la connaissance du vicaire général une multitude de faits qui, selon sa conviction bien arrêtée, devaient lever toute espèce de doute quant à la réalité des phénomènes observés. C’est pourquoi il ne voyait aucune raison qui pût justifier à ses yeux la prolongation d’une enquête si fatigante pour lui et si douloureuse pour Anne Catherine. Avant de poursuivre le récit de la continuation de l’enquête, nous devons prendre une connaissance plus détaillée des notes de Rensing, parce qu’il s’y trouve beaucoup de traits qui font de mieux en mieux connaître Anne Catherine et les voies par lesquelles Dieu la conduisait.
XXV
LE TÉMOIGNAGE DE RENSING SUR ANNE CATHERINE.
1. Le doyen Rensing, qui connaissait depuis longtemps la piété sincère d’Anne Catherine et spécialement son désir de mener une vie entièrement cachée au monde, avait, dès le commencement, regardé comme indubitable la vérité des phénomènes extraordinaires qui se produisaient en elle. Mais malgré cette conviction, les objections des étrangers ou des adversaires ne laissaient pas de faire leur effet sur cet homme circonspect et craintif. Un argument spécieux, un soupçon, si léger qu’il fût, portant sur l’indépendance de son jugement ou la fermeté de son caractère, suffisait pour le tourmenter vivement et lui inspirer une grande méfiance à l’égard d’Anne Catherine. Avec une telle disposition d’esprit, la sagesse et le bon sens qui le caractérisaient d’ailleurs ne résistèrent pas à l’impression des suspicions absurdes qui se produisirent de toutes parts, dès que l’existence des stigmates fut portée à la connaissance du public. Ainsi, de son côté, rien ne manqua pour aggraver encore la tâche douloureuse d’Anne Catherine, déjà si pénible par elle-même ; et la patience de celle-ci, son humble obéissance, sa confiance en Dieu furent soumises à des épreuves comme Dieu n’en impose qu’à ceux qui sont appelés à choses des extraordinaires.
2. L’opinion favorable de Rensing avait été ébranlée d’abord par les bavardages d’une ancienne compagne de couvent d’Anne Catherine qui, environ un mois avant le commencement de l’enquête, prétendit avoir vu par le trou de la serrure la malade sortir de son lit et chercher des aliments dans une armoire. Deux autres personnes disaient avoir observé la même chose de la même manière et avoir trouvé Anne Catherine couchée sur le plancher avec une tartine de beurre à la main. Rensing qui, jusque-là, n’avait jamais douté de l’impossibilité où était Anne Catherine de manger quoi que ce fût, prit la chose très au sérieux. Il fit venir les personnes en question et dressa un procès-verbal de leurs dires. Mais quand lui-même voulut faire ses observations par le trou de la serrure, il put se convaincre qu’il n’était pas possible de voir par là le lit de la malade non plus que l’armoire qu’elle était censée avoir ouverte. Puis enfin la religieuse avoua qu’elle avait la certitude de l’impossibilité absolue où était Anne Catherine de sortir de son lit sans l’aide d’autrui. Malgré cela Rensing interrogea Anne Catherine elle-même, car le pain beurré l’inquiétait beaucoup :
« Je lui demandai, rapporte-t-il dans son journal, si elle ne se souvenait pas d’avoir été trouvée une fois hors de son lit. « Oui, sans doute, répondit-elle. » J’étais étendue par terre devant le lit, d’on j’étais tombée parce que je n’avais là personne pour m’assister. Il peut se faire que j’eusse à la main un morceau de pain beurré, mais je crois plutôt qu’il était à terre près de moi. J’en avais fait mettre un sur mon lit parce que j’attendais la fille d’une pauvre femme à laquelle je voulais l’envoyer. En tombant du lit j’aurai bien pu entraîner le pain avec le drap du lit. »
Cela le tranquillisa ; cependant il ne se tint pour entièrement satisfait que lorsqu’il en eut parlé à Overberg et que celui-ci eut pris en main la défense d’Anne Catherine.
3. Il avait été encore plus ému d’un propos qui circulait à Dulmen et à Munster ; on y disait « que quand même la sincère piété d’Anne Catherine serait hors de doute, ses stigmates devraient toujours éveiller le soupçon, tant qu’on n’aurait pas la certitude que l’abbé Lambert ne travaillait pas à les entretenir artificiellement. N’était-il pas permis de croire en effet que ce prêtre émigré était assez fanatique pour regarder comme une bonne œuvre d’aider une religieuse à porter constamment sur son corps des signes si douloureux en mémoire de la Passion de Jésus-Christ ? »
Le doyen Br. de Munster, dans une visite à Dulmen, avait émis cette conjecture devant Rensing qui en fut d’autant plus ému qu’il avait entendu dire quelque chose de semblable à Dulmen. « Cette remarque, écrit-il, a été aussi faite ici, non seulement par des chrétiens judicieux, mais même par un Juif bien disposé qui a été très frappé de ce phénomène. » Quoiqu’il fût moralement sûr, d’après les déclarations formelles « tant de l’abbé Lambert que de la sœur Emmerich, qu’ils étaient incapables d’une fraude pieuse de cette espèce », cela fit pourtant naître en lui beaucoup d’inquiétudes et de doutes qui le poursuivirent jusqu’au moment où Anne Catherine elle-même vint à son aide et le délivra de ses angoisses. Son regard clairvoyant avait reconnu ce qu’il tenait caché dans son intérieur et, comme il n’y avait pas à espérer qu’il s’expliquât franchement à ce sujet, elle lui demanda la permission de lui dire ce qui se passait en lui, et lui signala ses inquiétudes et ce qui les causait :
« Je fus profondément étonné, rapporte-t-il. La chose était bien comme elle la disait. Je lui déclarai alors qu’il vaudrait mieux qu’elle donnât ses stigmates comme l’œuvre d’une pieuse exaltation, parce qu’alors je serais délivré de beaucoup d’ennuis et elle de beaucoup de souffrances. « Comment pourrais-je dire pareille chose ? » répondit tranquillement la malade. Je ferais un mensonge. Or un mensonge est tout au moins un péché véniel. Et le plus petit mensonge est si abominable devant Dieu que j’aimerais mieux souffrir encore bien davantage que de m’en rendre coupable. »
C’en était fait dès lors de la réserve silencieuse de Rensing. Il se mit à parler longuement des dangers du zèle religieux, quand il est peu éclairé : il conjura Anne Catherine au nom de la gloire de Dieu et du salut des âmes d’avouer si ses plaies étaient réellement l’œuvre d’une dévotion exaltée.
« Mais, rapporte son journal, elle protesta au nom de tout ce qu’il y a de plus sacré qu’elle ne pouvait dire autre chose sur ses plaies que ce qu’elle en avait dit jusqu’à présent, à moins de parler contrairement à la vérité ; que du reste, il lui serait très agréable que Dieu voulût l’exaucer et donner au médecin les moyens de faire disparaître les signes extérieurs. « J’accepterais alors bien volontiers, ajouta-t-elle, d’être punie par l’autorité comme coupable d’imposture et d’être méprisée et injuriée du monde entier. »
4. La conscience pure d’Anne Catherine vint une autre fois au secours du doyen dans ses anxiétés d’une façon encore plus remarquable. Rensing avait été chargé par le vicaire général d’interroger l’ancienne supérieure et toutes les compagnes de couvent d’Anne Catherine sur sa vie dans le cloître. Anne Catherine pouvait prévoir aisément que ces femmes diraient bien des choses propres à tout embrouiller et jetteraient de nouveau le doyen dans l’incertitude et l’agitation. Mais, craignant qu’une fausse honte ne le portât à garder encore pour lui les soupçons qui pourraient lui venir, et désirant qu’il se décidât plutôt à s’acquitter rigoureusement et sans ménagement de la mission qu’il avait reçue à son égard, Anne Catherine elle-même l’y prépara d’avance.
« L’enquête que vous allez faire près de mes compagnes, lui dit-elle, vous donnera l’occasion de faire appel à ma conscience en termes très sévères, cela vous coûtera et vous causera du trouble : mais je vous supplie de ne pas vous laisser effrayer par ces difficultés et de me soumettre, aussi bien que mes anciennes compagnes, à l’examen le plus rigoureux. Je prierai pour vous afin que Dieu vous donne pour cela grâce et courage. »
Anne Catherine aida par là le doyen à s’armer de la fermeté et de la rigueur que la circonstance exigeait, et lui rendit plus facile l’accomplissement des graves devoirs que lui imposait la qualité de directeur de sa conscience. Mais plus il eut d’occasions de l’examiner, plus il trouva nombreuses et convaincantes les preuves de la réalité des dons extraordinaires accordés à Anne Catherine et de la haute perfection de ses vertus.
5. Son obéissance et son respect envers l’autorité ecclésiastique étaient véritablement sans limites. Comme on l’a déjà dit, les tentatives de guérison des stigmates faites par les médecins sur l’ordre du vicaire général lui causèrent des douleurs intolérables : mais ce qui la tourmentait encore davantage était la crainte de tomber par faiblesse dans la désobéissance. Souvent Rensing la trouva baignée de pleurs causés par l’excès de ses souffrances : mais il n’avait qu’un mot à dire et, au lieu de plaintes, il entendait ces touchantes paroles : « Est-ce que j’ai péché en m’affligeant ainsi ? » Au désespoir qui avait commencé à s’emparer d’elle succédait aussitôt la douce résignation d’un enfant innocent qui pouvait dire, les yeux mouillés de larmes : « Je souffrirai volontiers encore davantage, si seulement Dieu me donne assez de force pour tout supporter et pour n’être point désobéissante. »
Jamais Rensing ne l’entendait se plaindre d’autre chose que de la multitude des curieux qui venaient pour la voir : s’il les tenait à distance, elle l’en remerciait comme du plus grand bienfait qu’elle pût recevoir, et ses prières pleines d’anxiété donnaient à cet homme si facile à blesser la force de la défendre avec constance contre la presse des curieux. Jamais il ne vit en elle un signe d’impatience ou de mécontentement : au contraire, la paix profonde et la sérénité imperturbable qui, de son âme, passaient sur son visage, témoignaient assez de la grandeur de sa résignation et de la ferveur de son union continuelle à Dieu. Voici ce que dit le journal de Rensing :
« Je la trouvai extrêmement faible, mais aussitôt qu’elle me vit, elle reprit l’air de sérénité qui lui est habituel. » Et ailleurs : « Pendant que je causais avec elle, sa figure était pleine de sérénité, mais je remarquai que, quand par hasard le derrière de la tête touchait l’oreiller, son visage se contractait par l’effet de la douleur. »
6. S’il arrivait que Rensing, au lieu de la consoler, lui fît de ses stigmates un sujet de reproches, elle prenait cela avec simplicité comme une chose sur laquelle elle-même ne pensait pas autrement que lui.
« Si vous n’aviez pas sur vous ces étranges signes, lui dit-il un jour, vous seriez soustraite aux douleurs qu’ils vous font souffrir maintenant 22. » Elle lui répondit : « J’ai prié du fond du cœur le bon Dieu de me les retirer et je me résignerais volontiers à être traitée de fourbe et d’hypocrite, mais ma prière n’est pas exaucée. »
7. Rensing lui-même était souvent découragé à la vue des souffrances d’Anne Catherine : parfois il en était tout bouleversé et voulait alors se retirer parce qu’il se sentait incapable de lui donner des consolations. Mais, se remettant aussitôt, elle le retenait, et le suppliait afin qu’il ne la privât pas de sa présence et de sa bénédiction sacerdotale. Rensing dit à ce sujet dans son journal :
« Je restai près d’elle et ne la quittai que plus tard, profondément touché de voir combien la grâce de Notre-Seigneur est forte dans les faibles. »
De telles expériences étaient pour lui la preuve que, chez Anne Catherine, la grâce de la patience et de la longanimité était attachée à la fidélité avec laquelle elle obéissait aux supérieurs ecclésiastiques comme représentants de Dieu, et il trouvait là un signe infaillible de la réalité des dons de la grâce en elle. Par suite de ses expériences de chaque jour, cet homme, d’ailleurs si peu enthousiaste, arrivait, comme malgré lui, à la certitude quant au pouvoir et à la plénitude de bénédiction que Dieu a attachés au caractère sacerdotal : car chaque fois qu’Anne Catherine lui faisait des déclarations comme celle-ci : « Je me sens fortifiée quand vous êtes là, dans quelque état de faiblesse que je sois tombée : ce dont je parle avec vous vient de Dieu, est pour Dieu : cela ne m’est jamais pénible, etc. » il voyait toujours ces paroles confirmées par des effets réels.
8. Comme le vicaire général avait enjoint à Anne Catherine de rendre au doyen Rensing un compte aussi exact de ses contemplations intérieures que de tout ce qui lui arrivait extérieurement, elle s’appliquait à répondre à ses questions avec le soin le plus scrupuleux. Ces réponses nous font connaître que les mérites de sa patience dans les souffrances étaient offerts pour les pauvres âmes du purgatoire et pour la conversion des pécheurs. Même pendant l’enquête, elle passait la nuit en prière et en contemplation et elle sortait souvent d’elle-même, suivant son expression habituelle. Lors de la première visite de Rensing, interrogée par lui, elle raconta ce qui suit :
« J’étais cette nuit dans le purgatoire. Il me sembla que j’étais conduite dans un profond abîme. Je vis un lieu très spacieux. Les pauvres âmes qui l’habitent sont silencieuses et tristes : on ne peut les voir sans être ému. Quelque chose sur leur visage indique pourtant qu’elles ont encore de la joie dans le cœur, à la pensée des miséricordes de Dieu. – Je vis aussi sur un trône magnifique la Mère de Dieu, plus belle que je ne l’avais jamais vue. » Après avoir raconté cela, elle adressa au doyen cette prière : « Exhortez donc au confessionnal, lui dit-elle, à prier avec ferveur pour les pauvres âmes du purgatoire : car certainement elles prieront aussi beaucoup pour nous par reconnaissance. Et la prière pour ces pauvres âmes est très agréable à Dieu parce qu’elle les fait arriver plus tôt à jouir de sa vue. »
Quelques jours plus tard elle lui rapportait ceci :
« Cette nuit, de cruelles douleurs dans les plaies ne m’ont pas laissé un moment de repos : mais j’ai été grandement consolée par une apparition. J’ai vu comment le divin Sauveur accueille les pécheurs repentants et comment il en use avec eux. Il était bon et affectueux au delà de tout ce que je puis dire. »
Elle eut cette vision plusieurs fois à l’approche des fêtes de Pâques et elle y trouva toujours beaucoup de force et de consolation.
« Mes souffrances sont redevenues beaucoup plus supportables pour moi, dit-elle un jour : car j’ai été consolée et j’ai éprouvé une joie particulière en apprenant que beaucoup de grands pécheurs reviendraient prochainement à Dieu et même que c’était déjà fait pour plusieurs. »
9. Dans la semaine d’après Pâques elle dit à Rensing. « J’ai eu un ravissement assez court, mais qui m’a rempli de consolation. J’ai vu que, dans ce temps pascal, beaucoup de grands pécheurs sont revenus à Dieu et que beaucoup d’âmes sortent du Purgatoire. J’ai vu aussi le lieu de purification et j’ai remarqué sur les visages un air de joie indicible qui m’a paru le signe de la délivrance prochaine de ces âmes. C’était pour moi une grande joie de les voir délivrées de leurs tourments. Ainsi j’ai reconnu les âmes de deux prêtres qui ont été déjà admises dans le ciel. Ils avaient eu à souffrir pendant des années, l’un à cause de sa négligence à remplir les obligations de son état dans de petites choses, l’autre à cause de son penchant à la raillerie. »
Elle vit aussi la conversion de certains pécheurs retombés dans le mal et raconta ce qui suit :
« Jésus était devant mes yeux et il avait à souffrir successivement divers mauvais traitements. Mais pendant tout ce temps, il avait l’air si plein de bonté et d’amour que la tristesse que me causait sa souffrance était mêlée de douceur. Ah ! me disais-je, tous les pécheurs ont leur part dans cette souffrance et ils se sauvent pour peu qu’ils aient de bonne volonté. – Je vis aussi des personnes de ma connaissance qui sont arrivées à reconnaître leurs fautes et à se corriger. Tout cela se montrait à moi aussi clairement que si je l’avais vu de mes yeux, étant éveillée. Parmi ces personnes, il y en avait une qui est très pieuse et qui parle humblement de ce qui la concerne, mais qui ne voulait pas reconnaître qu’elle est trop éprise d’elle-même. Il a fallu de la peine pour qu’elle en vînt à reconnaître ses fautes. Ce n’est pas par une véritable humilité qu’on se déprécie soi-même, si en même temps on ne peut supporter qu’un autre nous blâme ou nous soit préféré. »
10. Elle dit un autre jour : « J’ai vu Dieu rendre son jugement sur de grands pécheurs. Sa justice est grande, mais sa miséricorde est encore plus incompréhensible. Il ne condamne que ceux qui ne veulent pas absolument se convertir : mais ceux qui ont encore une étincelle de bonne volonté se sauvent. Il y en a qui ont un très vif repentir de leurs péchés, qui les confessent sincèrement et ont le cœur plein de confiance dans les mérites infinis de notre Sauveur ; ceux-là arrivent au bonheur éternel et leurs péchés sont oubliés. Ils passent bien par le Purgatoire, mais ils n’y restent pas longtemps. Au contraire, beaucoup vont pour longtemps en Purgatoire, qui ne sont pas de grands pécheurs, mais qui vivent dans la tiédeur et qui, par amour-propre, trouvent mauvais que leurs confesseurs les avertissent et les redressent.
« Autrefois la pensée de la damnation, n’y eut-il de damné qu’un seul pauvre pécheur, me causait une si grande peine que je ne pouvais m’y résigner, mais cette fois je suis restée en paix quoique beaucoup fussent réprouvés, car je vis bien que la justice de Dieu voulait qu’il en fût ainsi. Tout était pour moi aussi clair et aussi frappant que si Dieu lui-même m’eût parlé.
« Je vis Jésus sur un trône brillant comme le soleil : près de lui Marie, Joseph et Jean. Devant lui étaient agenouillés les pauvres pêcheurs repentants. Ils priaient Marie d’intercéder pour eux : je vis alors qu’elle est le vrai refuge des pécheurs et que tous ceux qui ont recours à elle trouvent grâce, pourvu qu’il leur reste un peu de foi. »
Elle eut la vision qui suit sur la valeur de la prière :
« J’étais dans un grand espace lumineux qui s’étendait à mesure que je regardais tout autour de moi. Je vis là ce qui advient de nos prières devant Dieu. Elles étaient comme inscrites sur de grands tableaux de couleur blanche et elles semblaient divisées en quatre classes. Quelques prières étaient écrites en magnifiques lettres d’or, d’autres en caractères brillants comme de l’argent, d’autres présentaient une nuance sombre ; d’autres enfin étaient en lettres noires et celles-ci étaient rayées d’une barre. Cette vue me donna de la joie : cependant j’étais inquiète, craignant de n’être pas digne de voir cela et j’osai à peine demander à mon conducteur ce que tout cela signifiait. Il me répondit : « Ce qui est tracé en lettres d’or est la prière de ceux qui, une fois pour toutes, ont uni leurs bonnes œuvres aux mérites de Jésus-Christ et qui renouvellent souvent cette union, qui, en outre, travaillent avec un grand soin à observer ses préceptes et à imiter ses exemples. Ce qui a le brillant de l’argent est la prière de ceux qui n’ont point présente à la mémoire cette union avec les mérites de Jésus-Christ, mais qui pourtant sont pieux et prient dans la simplicité de leur cœur. Ce qui est de couleur sombre est la prière de ceux qui ne vivent pas en repos s’ils ne s’approchent pas souvent des sacrements et s’ils ne font pas chaque jour certaines prières, mais qui pourtant sont tièdes et ne font le bien que par habitude. Enfin ce qui est écrit en noir et barré est la prière de ceux qui mettent toute leur confiance dans les prières vocales et dans leurs prétendues bonnes œuvres, mais qui n’observent pas les commandements de Dieu et ne font pas violence à leurs mauvais désirs. Cette prière n’a aucun mérite devant Dieu : c’est pourquoi elle est rayée. De même aussi sont rayées les bonnes œuvres de ceux qui se donnent beaucoup de peine pour faire quelque fondation pieuse, mais qui en cela considèrent l’honneur et les avantages temporels qu’ils doivent en retirer. »
11. Rensing l’ayant trouvée un jour qui récitait les litanies des saints d’après un livre, voulait attendre qu’elle eût fini, mais elle lui dit :
« Je ne suis pas scrupuleuse pour ces sortes de choses : je puis reprendre à l’endroit où j’ai fini. Je pense que Dieu n’est pas si exigeant en pareil cas et ne regarde pas où je commence. »
Elle voulait dire que cette interruption n’était pas l’effet de la distraction ou de l’indifférence, mais une marque de respect pour son supérieur ecclésiastique. Elle rapporta ainsi une autre vision symbolique touchant la prière.
« J’étais dans l’église, à la place où j’avais coutume de m’agenouiller autrefois. Il faisait très clair et je vis deux femmes bien vêtues se mettre à genoux au pied du maître autel, le visage tourné vers le tabernacle, et, à ce qu’il me parut, avec beaucoup de dévotion. Je les regardais prier, le cœur touché de leur piété, lorsqu’apparurent deux couronnes d’or éclatantes suspendues au-dessus de leurs têtes. Je m’approchai et je vis qu’une des couronnes se posa sur la tête de l’une d’elles, tandis que l’autre resta en l’air à quelque distance, au-dessus de la seconde. Enfin elles se levèrent toutes deux et je leur dis qu’elles m’avaient semblé prier avec bien de la ferveur. « Oui, répondit la seconde, il y a longtemps que je n’avais prié aussi dévotement et avec un sentiment aussi vif qu’aujourd’hui. » Au contraire, la première, sur la tête de laquelle la couronne s’était posée, se plaignait d’avoir voulu prier avec ferveur, mais d’avoir été troublée par des distractions de toute espèce qu’il lui avait fallu combattre sans cesse pendant sa prière. Je vis alors comment le bon Dieu, dans la prière, ne considère que le cœur. »
De ce récit il ressort clairement que cette vision avait été envoyée à Anne Catherine pour la garantir de la pusillanimité qui aurait pu lui faire regarder sa prière, si souvent troublée et interrompue par les dérangements extérieurs et l’affluence des étrangers, comme moins agréable à Dieu que le profond recueillement et la dévotion tranquille à laquelle autrefois elle pouvait se livrer dans le cloître.
12. On peut reconnaître une intention semblable dans une vision postérieure qui paraît bien simple et peu significative, mais qui est pourtant un témoignage frappant de la bonté avec laquelle Dieu daignait consoler et fortifier Anne Catherine, comme un enfant, pour l’aider à accomplir sa grande tâche.
« Il me fallait passer sur un pont étroit, raconta-t-elle. Je regardais en tremblant l’eau qui coulait au-dessous à une grande profondeur : mais mon ange gardien me fit passer heureusement. Sur le bord était une souricière autour de laquelle une souris courut longtemps. Enfin attirée par l’appât elle s’y glissa pour le prendre. « Folle petite bête, m’écriai-je, tu sacrifies à une friandise ta liberté et ta vie. » Les hommes sont-ils plus raisonnables, dit mon ange gardien, quand pour un plaisir d’un moment ils mettent en danger leur âme et leur salut ? »
La compassion qu’Anne Catherine ressentait pour la pauvre petite bête était tournée par l’ange gardien vers l’aveuglement des pêcheurs, afin qu’elle les avertît de se tenir en garde et cela non seulement par ses prières et par ses souffrances secrètes et inconnues du monde, mais aussi par des exhortations et des supplications, ou même par la vue des tortures auxquelles elle était livrée. Il lui semblait impossible que le temps où elle menait une vie tranquille et cachée au monde ne revînt pas pour elle : mais Dieu en avait décidé autrement. Ce bien si désiré ne lui fut jamais rendu : au contraire, le moment était venu où Anne Catherine, au milieu des plus grandes tribulations, devait être préparée à entrer dans la dernière et la plus pénible phase de sa mission de souffrances. De même qu’à l’Église elle-même il n’était plus laissé d’asile où la piété pût être pratiquée sans trouble et la contemplation s’abriter en paix, de même qu’on lui enlevait toutes les saintes demeures dans lesquelles ses enfants pouvaient, loin des regards du monde, endurer le martyre de la pénitence pour les péchés d’autrui ou pour leurs propres fautes, de même aussi Anne Catherine à qui Dieu faisait porter le poids des tribulations de son Église devait avoir en partage un sort pareil. Elle le subit jusqu’au dernier instant de sa vie : mais nous verrons bientôt combien il lui en coûta d’avoir à remplir cette tâche.
XXVI
DU TEMPS ENTRE PÂQUES ET LA PENTECÔTE (1813).
1. Après la troisième visite du vicaire général, Rensing avait ordonné à Anne Catherine de prier à une certaine intention qu’il ne voulait pas lui désigner plus clairement. Le 2 mai, il la trouva très consolée par une apparition de la Mère de Dieu avec l’enfant, laquelle avait eu lieu pendant la nuit. Voici ce qu’elle dit à ce sujet :
« J’ai beaucoup invoqué l’intercession de Marie à l’intention qui m’avait été prescrite : mais je n’ai pas été exaucée. J’ai déjà prié trois fois pour cela et j’ai dit à Marie : « Je suis obligée de prier à cette intention parce que la chose m’a été prescrite en vertu de l’obéissance » : mais je n’ai pas reçu de réponse et j’ai oublié d’insister davantage par suite de la joie que me causait le saint enfant. J’espère pourtant que je serai exaucée. Je ne prie pas pour moi et j’ai été si souvent exaucée quand je priais pour autrui ! Pour moi, je ne l’ai jamais été, si ce n’est quand je demandais des souffrances. »
Sans le savoir, Anne Catherine avait cette fois encore prié pour elle-même, car l’intention inconnue de Rensing avait pour objet la prompte conclusion de l’enquête. De même que Rensing, tout l’entourage d’Anne Catherine en avait un plus grand désir qu’elle-même, et il arrivait ainsi qu’il lui fallait non seulement obtenir pour elle-même la patience et la constance, mais encore tranquilliser et consoler ceux qui auraient dû lui servir d’appui. En outre elle ressentait plus vivement que ses propres peines les soupçons qui atteignaient le vieil abbé Lambert, comme si le fanatisme aveugle de ce digne prêtre eût été la cause de ses stigmates 23. Le P. Limberg avait été trop peu de temps son confesseur pour être exposé aux mêmes soupçons : cependant il possédait déjà une connaissance exacte de l’état de son âme et de toute sa vie, et, malgré la défiance qui lui était naturelle, il ne pouvait pas douter de la réalité des stigmates. C’était un homme très timide et très facile à troubler, qui n’osait paraître qu’en tremblant devant un personnage aussi imposant que Clément Auguste : il n’est donc pas étonnant qu’il s’attirât fréquemment le reproche « d’imprudence ». S’il eut été en son pouvoir ou au pouvoir de l’abbé Lambert de faire disparaître les stigmates, cela serait arrivé dès le commencement, d’autant plus qu’Anne Catherine elle-même l’aurait ardemment désiré. L’abbé Lambert et lui voyaient dans les stigmates un malheur, une fatalité inévitable qu’on ne pouvait pas empêcher et à laquelle il fallait s’accommoder le mieux possible. La pensée que ce pouvait être une œuvre de Dieu, une distinction qu’il n’avait accordée qu’à peu d’élus dans l’Église, était chez eux tellement rejetée au dernier rang que l’enquête ecclésiastique, à cause de la publicité à laquelle Anne Catherine et eux avec elle se trouvèrent livrés, fut pour eux un incident extrêmement pénible. Cette disposition de son entourage ecclésiastique augmenta chez Anne Catherine la crainte de perdre elle-même la patience et le sang-froid, si elle ne retrouvait pas bientôt la vie cachée, le repos, et avec eux le recueillement accoutumé en Dieu. C’était pour cela qu’elle avait accédé de si bon cœur à la proposition faite par Rensing de la faire surveiller pendant huit jours par des médecins, et qu’elle en attendait la mise à exécution avec un désir toujours croissant.
2. Le 9 mai, Overberg, envoyé par le vicaire général, vint pour la quatrième fois à Dulmen afin de compléter, s’il y avait lieu, les observations recueillies par lui jusqu’alors.
« Je suis revenu, dit-il, sur différentes choses qu’elle m’avait racontées précédemment, afin de m’assurer si je les avais bien saisies et notées exactement ; à cette occasion elle me donna à entendre que l’examen détaillé de sa vie passée ne contribuait pas peu à ses souffrances parce qu’on pouvait penser qu’elle était quelque chose, tandis qu’elle-même savait mieux que personne ce qui en était. – Je lui trouvai l’air serein quoiqu’elle eût beaucoup souffert et saigné abondamment la nuit précédente. »
Le second jour de son séjour, Overberg rapporte ce qui suit.
« Ce matin, j’ai trouvé de nouveau Anne Catherine très faible. Elle avait, m’a dit sa sœur, passé la nuit dans l’angoisse et l’agitation. Quand elle commençait à sommeiller, elle était bientôt éveillée par la crainte qu’on n’entreprit de nouvelles enquêtes. Elle pleurait parce qu’elle avait peur de perdre la patience, si elle ne retrouvait pas du repos pour se recueillir de nouveau en Dieu. Elle disait que l’enquête lui avait fait presque entièrement perdre le recueillement. Je ne pus et ne voulus m’entretenir que très peu de temps avec elle, à cause de sa faiblesse : cependant elle confirma encore ce qu’elle avait déjà raconté. – Dans l’après-midi, elle se trouva un peu mieux que le matin. Elle insiste elle-même pour qu’on la fasse surveiller pendant huit jours par des hommes dignes de foi et des médecins afin que ces dérangements qui lui sont si pénibles et si préjudiciables puissent enfin arriver à leur terme. »
3. Lors du départ d’Overberg, Rensing et Wesener appuyèrent les prières d’Anne Catherine pour l’établissement d’une surveillance de huit jours.
« Elle m’a dit en pleurant, dit Wesener, avec quelle ardeur elle aspire à trouver enfin du repos. « Ah ! me disait-elle, je ferais tout au monde pour rendre service à mon prochain. Je laisserais couper mon corps en morceaux et remettre tous ces morceaux ensemble pour sauver une seule âme : mais il m’est vraiment impossible de me donner en spectacle à tous les curieux. Je crois pourtant que si on me donne des surveillants pendant huit jours, je ferai connaître mon état d’une manière aussi satisfaisante que cela est possible. Ce n’est pas pour moi que je désire voir la vérité de la chose garantie, mais en cela j’ai surtout en vue mes amis, désirant qu’ils ne soient pas mal jugés et injuriés à cause de moi. »
4. Un jour après le départ d’Overberg, M. de Druffel arriva à Dulmen et il écrivit à propos de cette visite :
« Rien de nouveau ne s’est présenté à moi. L’impression produite par l’attitude extérieure et la physionomie de la malade est toujours la même : l’état des plaies, de la marque du côté et de la croix de la poitrine n’offraient aucun changement. »
5. Overberg était parti en promettant de faire consentir le vicaire général à la mesure proposée et de s’occuper ensuite de la faire exécuter promptement. Il réussit quant au premier point, mais non quant au second. Le 18 mai il écrivait à Rensing :
« L’homme propose et Dieu dispose. En voici une nouvelle preuve. Nous ne pouvons trouver aussitôt que nous le voudrions les personnes qui doivent surveiller notre bonne sœur Emmerich. Les médecins que l’on voudrait avoir pour cela ne seront pas libres avant les vacances de la Pentecôte, à cause des cours. On désire fort que la malade puisse être transportée aussitôt que possible dans une maison où elle soit commodément installée : veuillez la consoler de ce retard qui nous est aussi désagréable qu’à elle. Je vous prie de la saluer de ma part. »
Peu de jours après cette lettre arriva une couverture de peau que le bon Overberg avait fait faire pour Anne Catherine.
« Krauthausen, écrivait-il en l’envoyant, m’a dit dernièrement qu’il serait fort à désirer que notre malade eût une couverture de peau pour se coucher dessus parce que la peau rafraîchit et empêche ou diminue les écorchures qui se produisent quand on reste trop longtemps dans la même position. Aussi je me suis mis en quête d’une couverture de ce genre et j’ai été assez heureux pour en trouver une bonne en peau de chamois. Je l’avais chez moi depuis plusieurs jours, attendant une occasion. Pour ne pas retarder plus longtemps le soulagement que cette couverture pourra peut-être procurer à la malade, je l’envoie par un exprès payé d’avance. Vous aurez la bonté de veiller à ce qu’on la place sous la malade. »
6. Le nouveau retard de la mise en surveillance si désirée de tous fut plus pénible pour Anne Catherine que tout ce qu’elle avait eu à souffrir jusque-là, car elle voyait là l’assurance très douloureuse que ses espérances et ses prières restaient vaines et que, pendant le reste de sa vie si pleine de souffrances, elle ne pourrait plus se dérober à la publicité, non plus qu’aux dérangements et aux peines qui en étaient la conséquence inévitable. On ne saurait lui en faire un reproche quand on songe que, comme une pauvre et faible créature, elle avait jusque-là cherché sa consolation dans l’espoir de voir bientôt finir l’enquête et les visites dont elle était l’occasion, et d’être rendue au repos et à la vie cachée, objets de ses plus ardents désirs. Avec ses amis spirituels, elle s’était hasardée à compter sur la fête de l’Ascension, comme sur le jour où elle recouvrerait les seuls biens dont elle eût besoin sur la terre, la solitude et la retraite ; mais maintenant cette attente était déçue !
Ainsi elle avait souvent gémi, les derniers temps, en présence de l’abbé Lambert : « Je suis un instrument du Seigneur, disait-elle. Je sais peu de chose de ce qui se prépare pour moi. Je ne demande rien que du repos. »
Maintenant toutefois elle ne pouvait pas se dissimuler que ce repos ne lui serait plus jamais accordé sur la terre. Pour cela encore, Dieu exigeait de sa servante la plus complète, la plus sincère soumission : mais elle tomba dans un tel abattement que l’on craignit de lui voir perdre entièrement la force de résister plus longtemps à ses souffrances corporelles toujours croissantes.
« Elle s’est plainte à moi, dit le rapport de Rensing à la date du 17 mai, d’avoir ressenti la nuit passée des douleurs si vives qu’elle ne put pas s’empêcher de prier Dieu de les adoucir. Sa prière a été exaucée et elle s’est sentie assez forte pour souffrir patiemment. Elle a ajouté : « Alors j’ai dit le Te Deum laudamus que j’ai enfin pu achever, après l’avoir commencé plusieurs fois sans pouvoir aller jusqu’au bout, interrompue comme je l’étais par la violence de mes souffrances. »
La nuit suivante fut encore tellement douloureuse qu’Anne Catherine se plaignit à Rensing en ces termes :
« J’ai souvent demandé à Dieu la souffrance et la douleur, mais maintenant j’ai la tentation de lui dire : Seigneur arrêtez-vous ! pas davantage ! pas davantage ! Mes maux de tête étaient si forts que je craignais de perdre la patience. Cependant, à l’aube du jour, j’ai posé sur ma tête la particule de la vraie croix que m’a laissée M. Overberg, j’ai prié Dieu de m’assister et aussitôt j’ai senti du soulagement. Les douleurs de l’âme, les sécheresses, l’amertume, l’angoisse intérieure me tourmentaient encore plus que les souffrances corporelles : mais pourtant j’ai deux fois repris du calme et ressenti une douce consolation en recevant la sainte communion. »
7. Comme l’entourage d’Anne Catherine ne tenait aucun compte de ces vicissitudes intérieures et ne se répandait que trop souvent devant elle en plaintes sur ses espérances déçues, elle n’en ressentait que plus cruellement sa position et son dénuement de secours spirituels, et elle tomba dans une telle angoisse qu’elle paraissait pour ainsi dire avoir perdu toute sa sérénité et toute sa force d’âme. Ainsi, le 19 mai, Rensing la trouva dans un si grand état de faiblesse et d’affliction qu’il ne voulut avoir aucun entretien avec elle. Quand il revint le soir, il vit la croix de la poitrine rendre une telle quantité de sang que son vêtement en était traversé. Elle avait repris contenance et put lui raconter que le malin esprit, pendant la nuit précédente, avait profité de son abattement pour la troubler par des visions effrayantes :
« J’ai éprouvé, dit-elle, une terrible angoisse. Ma sœur était profondément endormie : la lampe brillait et j’étais éveillée dans mon lit. Alors j’entendis un mouvement dans la chambre. Je regardai et j’aperçus une figure hideuse couverte de sales haillons qui s’approchait de moi lentement. Lorsqu’elle fut auprès de mon lit et ouvrit le rideau, je vis une affreuse femme qui me regardait en face, immobile et l’air menaçant. Plus elle fixait longuement ses regards sur moi, plus elle me paraissait effrayante et horrible. Elle avait une tête d’une grosseur énorme et se penchait sur moi, en ouvrant une bouche immense, comme si elle eût voulu me dévorer. Au commencement je n’étais pas très effrayée : mais cela ne dura pas. Je me mis à prier, je prononçai avec confiance les saints noms de Jésus et de Marie et tout disparut. »
8. Le P. Limberg vint enfin en aide à Anne Catherine dans cet état de détresse spirituelle. Il lui fit une courte exhortation où il lui reprocha ses plaintes répétées avec un peu d’impatience sur ce qu’elle ne pouvait trouver aucun repos : il lui dit encore qu’elle devait attendre en paix ce qui serait décidé à son égard et méditer plus attentivement la prière de chaque jour : « Seigneur, que votre volonté soit faite ! » Le docteur Wesener était présent pendant cette exhortation et voici ce qu’il rapporte à ce sujet :
« Anne Catherine se soumit à l’instant de la meilleure grâce du monde et ne fit plus entendre de plaintes. M. Limberg m’expliqua ensuite qu’il croyait devoir la traiter avec cette sévérité parce qu’il savait par expérience que la moindre imperfection lui était très préjudiciable. »
Le journal de Rensing s’exprime ainsi, à la date du jour suivant : « Je lui demandai si, pendant la nuit précédente, elle n’avait pas eu de vision ou d’apparition : « Non, répondit-elle, j’étais trop affligée d’avoir montré tant d’impatience et de mécontentement sur ce qu’on troublait mon repos à cause de mes signes. Je devrais être comme l’argile dans la main du potier et ne pas avoir de volonté propre, garder le silence et supporter patiemment ce que le bon Dieu m’envoie. Mais cela m’est très difficile parce que je pense plus à ma tranquillité d’âme qu’à la volonté de Dieu qui m’éprouve et sait parfaitement ce qui m’est utile. » De même, devant Wesener, elle s’est accusée avec tristesse d’être tombée dans le péché par son impatience. Wesener dit qu’il s’est efforcé de lui ôter cette idée, mais inutilement. »
9. Dieu récompensa cette humble obéissance par différentes consolations qui l’animèrent d’une nouvelle ferveur. Le vendredi 21 mai, Rensing la trouva très affaiblie, parce qu’elle avait beaucoup souffert et que ses plaies avaient rendu une grande abondance de sang, au point que son serre-tête et sa camisole en étaient devenus tout raides : mais elle avait repris sa sérénité accoutumée, car, au milieu de ses souffrances et notamment après la sainte communion, elle avait reçu de grandes consolations.
« Une chose m’a beaucoup réjouie, disait-elle. J’ai vu, après la sainte communion, deux anges qui portaient une belle couronne de fleurs. C’étaient des roses blanches avec de longues épines pointues qui me blessèrent quand je voulus détacher une rose. « Ah ! pourquoi y a-t-il des épines ! » me disais-je, et il me fut répondu : « Si tu veux avoir les roses, il faut aussi trouver bon que les épines te piquent. « J’aurai donc encore beaucoup à souffrir avant d’arriver à des joies qui soient sans mélange. »
10. Elle eut plus tard une vision analogue qu’elle raconta ainsi :
« Je fus conduite dans un beau jardin où je vis des roses d’une grandeur et d’une beauté extraordinaires, mais elles étaient entourées d’épines si longues et si pointues qu’on ne pouvait pas les cueillir sans être cruellement piqué : « Cela ne m’est pas agréable », disais-je, mais mon ange gardien répondit : « Qui ne veut pas souffrir n’aura pas à se réjouir. »
Les joies sans souffrances lui furent aussi montrées, mais comme ne devant lui être accordées qu’au moment de la mort :
« Je me vis couchée dans le tombeau, mais j’avais le cœur plein d’un contentement que je ne puis exprimer. Il me semblait en même temps entendre dire que j’aurais encore beaucoup à souffrir avant la fin de ma vie, mais que je devais m’abandonner à la grâce de Dieu et rester constante. Enfin je vis Marie avec l’enfant et je ressentis une joie inexprimable quand la bonne mère me mit l’enfant dans les bras. Lorsque je le lui rendis, je demandai à Marie trois dons qui devaient me rendre agréable à elle et à son fils : la charité, l’humilité et la patience. »
11. Maintenant son énergie morale allait croissant de jour en jour, au point que le 26 mai, veille de la fête de l’Ascension, elle put dire au doyen :
« Ah ! comme je voudrais aller au ciel avec le cher Sauveur, mais mon temps n’est pas encore venu : mes souffrances et mes douleurs s’accroissent et je dois être éprouvée davantage et plus complètement purifiée. Que la volonté de Dieu soit faite ! Pourvu seulement qu’il m’accorde la grâce de persévérer jusqu’à la fin dans la patience et l’abandon à sa volonté. »
Le jour de la fête, lorsqu’elle reçut la sainte communion, elle entendit ces paroles, ainsi qu’elle le dit à Rensing : « Aimes-tu mieux mourir que de souffrir davantage ? » à quoi elle répondit : « J’aime mieux souffrir davantage, si tel est votre bon plaisir. Mon désir, ajouta-t-elle, est accompli, mais en ce sens que maintenant je souffre plus qu’auparavant. »
12. Les notes de Wesener font connaître combien ses souffrances étaient nombreuses et diverses, et combien son plus proche entourage contribuait à les augmenter. Voici ce qu’il rapporte, à la date du 25 mai :
« Je la trouvai ce soir très agitée et comme hors d’elle-même par l’excès de la douleur. Sa sœur avait lavé avec de l’eau-de-vie son dos tout couvert de plaies, ce qui lui fit perdre connaissance. Elle se tordait dans son lit, gémissant et disant à sa sœur : « Pourquoi m’as-tu fait cela ? Je souffrirai tout de bon cœur, seulement tu ne devrais pas faire les choses avec si peu de ménagement ! » Pendant qu’elle parlait ainsi, son visage était enflammé et ses yeux étaient pleins de larmes. Son pouls n’avait pas varié. M. Limberg lui ordonna de se calmer et aussitôt elle se tint tranquille et ne dit plus rien. »
Bientôt, par la faute de la même personne, elle eut à subir un supplice analogue, mais bien plus grand encore :
« Je trouvai, dit Wesener, sa sœur auprès de son lit avec une assiette pleine de salade qui nageait dans une sauce de vinaigre et de farine. Lorsque je demandai si la malade en avait goûté, je reçus pour réponse qu’elle avait pris de cette sauce et en outre un petit morceau de fromage. La malade elle-même était dans un singulier état d’étourdissement et n’avait plus sa connaissance. Bientôt je découvris la vraie cause de tout cela. Sa sœur avait voulu de nouveau lui laver le dos avec de l’eau-de-vie, et comme la malade s’y refusait, elle avait laissé devant le lit le vase où était la liqueur. L’odeur de l’eau-de-vie causa presque aussitôt un tel étourdissement à la pauvre malade qu’elle n’eut pas la force de repousser les aliments que lui présentait cette sœur stupide et entêtée. Elle tomba alors dans un état des plus tristes ; c’était une succession de maux de cœur affreux et de vomissements convulsifs, avec un étranglement continuel qui faisait craindre une suffocation complète. Ce ne fut que le soir à neuf heures qu’elle put rejeter ce qu’elle avait pris, et que son état s’améliora. Alors elle se désola d’avoir goûté à de semblables crudités dans un moment d’étourdissement où elle n’avait pas la conscience de ce qu’elle faisait. »
13. Des expériences de ce genre ne désabusaient pourtant pas les personnes qui l’entouraient de leur confiance dans l’emploi de l’eau-de-vie comme remède et, plusieurs années après, le pèlerin eut encore l’occasion de le constater. « J’ai vu une quantité de fois, dit-il, Anne Catherine livrée à d’affreuses souffrances par l’absurde manie de laver avec de l’eau-de-vie les plaies que cause la nécessité de rester toujours couchée. Elle s’y refusait en gémissant, mais sans pouvoir l’empêcher. L’emploi de l’eau-de-vie comme moyen curatif est une idée fixe chez les gens de la classe inférieure dans le pays de Munster. Personne ne voulait voir que la seule odeur de cette abominable liqueur faisait perdre connaissance à Anne Catherine. Il fallait qu’elle eût aussi cela à souffrir. Hélas ! le plus souvent on traitait la pauvre patiente comme si elle eût été une chose et non une personne. »
14. Une des principales causes qui faisaient désirer si ardemment à Anne Catherine une vie complètement retirée et cachée au monde était la foule de visiteurs qui commençait à se presser près de son lit de douleur. C’était pour elle une chose très pénible, non seulement à cause du trouble et des dérangements intérieurs, mais bien plus encore à cause des souffrances morales qui en résultaient pour elle. « Elle s’est plainte à moi, dit Wesener, de ce que les nombreux visiteurs la troublent extraordinairement et de ce qu’elle a en outre d’autres souffrances qu’elle ne peut pas dire. »
Mais ces souffrances, nous les connaissons par ce qui a été raconté d’une époque antérieure : elles provenaient du don qu’avait Anne Catherine de lire dans les cœurs et de ressentir avec une extrême vivacité l’état moral d’autrui. Elle voyait avec une profonde et douloureuse impression la perversité, la corruption et les péchés de ceux qui la visitaient : les passions, les sentiments, les intentions avec lesquelles venaient à elle les personnes les plus diverses la frappaient comme des traits acérés. Déjà dans le cloître ce don vraiment effrayant avait été l’un de ses plus grands supplices : mais maintenant elle était comme sur la voie publique, abordable à tous ceux qui voulaient la voir et sans défense contre eux, car les prohibitions protectrices de l’autorité ecclésiastique étaient de moins en moins respectées, et le plus souvent elle était accablée de visiteurs qui n’abaissaient leurs regards sur Anne Catherine et son entourage sacerdotal qu’avec des soupçons blessants et un mépris orgueilleux. De quelle force n’avait-elle donc pas besoin pour ne pas tomber dans le désespoir, lorsque devant son âme se dressait cette certitude : « Jusqu’à ma mort, il en sera toujours ainsi ! »
XXVII
LE VICAIRE GÉNÉRAL DROSTE VIENT À DULMEN POUR LA QUATRIÈME FOIS.
1. Rensing avait fait connaître à Overberg l’impression accablante que sa lettre du 18 mai avait faite sur Anne Catherine et aussi les plaintes avec lesquelles elle avait accueilli la communication du nom et de la condition des messieurs de Munster choisis pour la garder à vue.
« J’espérais, avait-elle dit, que la chose serait finie pour la fête de l’Ascension et que j’aurais ensuite le repos nécessaire pour me préparer comme il faut à la venue du Saint-Esprit, pendant l’intervalle qui sépare les deux fêtes et qui a toujours été pour moi un temps si saint : maintenant cette espérance, qui me donnait une grande joie, m’est aussi enlevée. Si l’on ne peut pas avoir des médecins de Munster, on pourrait prendre des hommes d’ici qui, eux aussi, sont en état de voir ce qui se passe et qui méritent bien autant de confiance que des jeunes gens faisant encore leurs études. M. de Druffel m’a dit qu’on enverrait des personnes dont je serais contente. Mais que des jeunes gens, comme N. qui n’a pas encore vingt ans, restent jour et nuit assis près de mon lit, c’est que ce je ne puis pas admettre. »
2. Overberg porta cet écrit à la connaissance du vicaire général qui s’en occupa sérieusement. La manière dont s’était exprimée Anne Catherine lui semblait peu d’accord avec l’idée qu’il s’était faite d’elle d’après l’enquête, comme d’une âme favorisée de grâces extraordinaires et qui ne vivait que pour l’obéissance ; aussi crut-il de son devoir de se rendre à Dulmen aussitôt que possible et d’avoir une explication avec Anne Catherine. Il écrivit à Rensing pour le blâmer d’avoir nommé devant elle les personnes désignées pour la surveiller et fit les remarques suivantes :
« Il aurait dû suffire à la sœur Emmerich et à son entourage de savoir que les personnes en question avaient l’agrément de l’autorité ecclésiastique. Je n’en exigerais pas autant de tout le monde : mais quand, vis-à-vis de ceux auxquels Dieu paraît avoir accordé des grâces extraordinaires, j’ai aussi des exigences extraordinaires, et quand je conclus au plus ou moins de grâces, selon qu’on se soumet ou qu’on ne se soumet pas à ces exigences, je suis en cela la marche qu’ont tracée les hommes les plus renommés par leur sagesse. »
Le 3 juin, il vint lui-même à Dulmen.
« Mon intention, dit-il dans un rapport écrit par lui sur cette visite, était surtout de connaître les dispositions intérieures de la sœur Emmerich : l’inspection des plaies n’était qu’un but secondaire. Celles-ci, lorsque j’arrivai, avaient saigné récemment. Je trouvai tout comme à l’ordinaire. Je voulus examiner son intérieur, à raison de la manière dont elle s’était exprimée sur la surveillance et sur les personnes à envoyer de Munster. »
3. À peine eut-il vu Anne Catherine et lui eut-il demandé des explications sur ses prétendues plaintes qu’il nota ce qui suit dans le procès-verbal de l’enquête :
« Quant aux personnes qui devaient venir de Munster pour veiller auprès d’elle, la sœur Emmerich n’avait trouvé qu’une chose à objecter contre la jeunesse de ces messieurs, c’est qu’ils verraient peut-être en elle ou entendraient sortir de sa bouche des choses qu’ils pourraient mal comprendre. Et cette crainte est très naturelle, parce que la sœur Emmerich rêve quelquefois tout haut et on a déjà raconté, à sa connaissance, qu’elle avait dit que celui-ci ou celui-là était au ciel ou dans le purgatoire. Elle était du reste si bien disposée pour tous ceux que je voudrais envoyer qu’il n’y a eu aucun besoin de la raisonner sur ce point. »
Quant à ce qui concernait son impatience des délais apportés à la mise en surveillance, il fut également satisfait de ce qu’elle lui dit à ce sujet. Voici ce qu’on lit dans son procès-verbal. « La sœur Emmerich s’est exprimée en ces termes : « Jusqu’à présent, pendant le temps qui s’écoule de l’Ascension de Notre Seigneur à la Pentecôte, je me suis toujours trouvée présente en esprit dans le Cénacle avec les disciples attendant la venue du Saint-Esprit. » (Clara Soentgen a déposé de son côté que la sœur Emmerich pendant ce temps est ordinairement plus recueillie que de coutume, dit une note ajoutée au procès-verbal.) « Cette fois encore je désirais qu’il en fût de même et je m’étais trop fortement mis dans la tête que je ne devais pas en être empêchée. Mais en cela j’ai bien failli. J’ai été aussi trop hardie. « Souffrir ou mourir », ai-je dit. Dieu m’a punie pour cela. Il m’a dit : « Si tu veux souffrir, tu dois vouloir souffrir ce que je veux que tu souffres. »
Le vicaire général prit de là occasion pour rappeler à Anne Catherine la devise de sainte Thérèse : « Souffrir ou mourir » et celle de saint François de Sales : « Aimer ou mourir. » Il lui fit observer que la première était bonne pour les saints, mais que la seconde convenait à tout le monde. Le procès-verbal ajoute « qu’elle saisit tout cela facilement et même qu’elle en fut réjouie, ainsi qu’on pouvait le voir ».
4. Peu de jours avant l’arrivée du vicaire général, Anne Catherine avait aussi reçu la visite de sa mère qui était inquiète d’elle. On peut facilement se figurer combien avait été douloureuse pour cette bonne vieille pleine de simplicité la nouvelle que sa fille était soumise à une enquête ecclésiastique. Pour la consoler, le curé de Saint-Jacques de Coesfeld avait pris la peine d’aller à Dulmen pour lui rendre compte de ce qu’il aurait vu ; alors elle se mit elle-même en route.
Clara Soentgen écrivit au vicaire général à propos de cette visite :
« Avant-hier est venue ici la vieille mère d’Anne Catherine ; celle-ci désirait que je fusse présente lors de sa visite, parce qu’elle était intimidée en présence de sa mère. Elle avait prié Dieu de faire en sorte que sa mère ne demandât pas à voir ses stigmates et ne lui fît pas de questions sur son état. Cette prière a été exaucée. La conduite de la vieille femme a été vraiment admirable. Elle n’a pas dit un mot des plaies, mais elle a seulement fait à sa fille des exhortations édifiantes. Comme des personnes étrangères lui disaient qu’elle avait grand sujet de se réjouir d’une telle fille et qu’on n’avait jamais entendu parler de rien de semblable, sa réponse fut qu’on ne devait pas lui dire de telles choses, que tant qu’une personne est en vie, il n’y a pas grand état à en faire. La sœur Emmerich m’a avoué qu’ayant déjà entendu dire des choses de ce genre, elle avait demandé à Dieu que sa mère répondît ainsi et qu’elle avait été exaucée. »
Quand sa mère fut partie, Anne Catherine éprouva un certain scrupule de ce qu’étant obligée de se montrer à tant d’étrangers et de curieux, elle s’était tenue dans une telle réserve vis-à-vis de sa propre mère : elle craignait d’avoir peut-être manqué par là au respect lilial. Elle fit part au vicaire général de ses inquiétudes à ce sujet et lui demanda si elle n’aurait pas dû montrer ses plaies à sa mère bien que celle-ci n’eût pas demandé à les voir. « Je lui répondis, écrit Droste dans le procès-verbal ; que si sa mère l’eût demandé, elle aurait dû lui obéir, mais qu’elle avait très bien fait, en cette occasion, de ne pas les montrer. »
5. Le vicaire général fut très satisfait de cette visite, comme le prouve ce qu’il écrivit le jour suivant à Rensing. Celui-ci avait été très sensible au reproche, bien peu grave pourtant, d’avoir nommé devant Anne Catherine les personnes qui devaient veiller auprès d’elle et cela l’avait mal disposé à l’égard de celle-ci. Dans cette situation d’esprit, il avait fait un commentaire très défavorable à Anne Catherine de quelques paroles assez simples du vicaire général, si bien que celui-ci prit en ces termes la défense de la malade :
« Quant à ce qui a été dit des visions, je n’ai pas cru le moins du monde à une imposture, mais seulement à la possibilité d’une illusion dont je ne rendais personne responsable. Maintenant que je me suis entretenu avec la sœur Emmerich, je ne puis conclure qu’une chose de la manière dont elle s’est exprimée par rapport à la surveillance à laquelle on veut la soumettre ; c’est que peut-être elle n’est pas encore arrivée au degré de perfection où Dieu la veut. »
Il donna en outre par écrit les injonctions suivantes :
« La mise à exécution du projet relatif à la sœur Emmerich ne doit pas être différée plus longtemps ; je désire qu’on commence le plus tôt possible. Quant au choix des personnes à employer, j’attends d’abord vos propositions. En règle générale, il faut préférer des gens âgés, comme méritant plus de confiance que de moins avancés en âge. J’agrée d’avance monsieur N...N... mais son fils est trop jeune. On ne peut confier cette tâche ni à lui, ni à d’autres aussi jeunes.
« Les surveillants, quand ils s’entretiendront entre eux, doivent s’abstenir de rien dire qui puisse aggraver pour la malade une mesure déjà si pénible par elle-même. J’espère que pendant ce temps, vous la visiterez souvent et que vous pourrez savoir d’elle si elle désire qu’on modifie telle ou telle disposition. »
6. Rensing prit alors les mesures nécessaires et put bientôt proposer vingt hommes de confiance, tous de Dulmen, qui se déclaraient prêts à veiller auprès de la malade, sous la direction d’un médecin qu’on ferait venir d’ailleurs.
Le vicaire général approuva tout, et l’on put, à la grande satisfaction d’Anne Catherine, commencer le 10 juin. Avant de raconter comment les choses se passèrent, il faut nécessairement prendre connaissance des rapports qu’Overberg et Rensing avaient faits au vicaire général sur les stigmates d’Anne Catherine, parce qu’ils contribuèrent essentiellement à établir un résultat certain pour toute l’enquête ecclésiastique.
XXVIII
TÉMOIGNAGES D’OVERBERG, DE RENSING ET DE WESENER TOUCHANT LES STIGMATES.
Dès sa première visite à Dulmen, Clément Auguste avait acquis la conviction qu’il n’y avait pas possibilité d’imposture quant aux stigmates ; il chargea alors Overberg de soumettre Anne Catherine à des interrogatoires détaillés sur leur origine et leur nature. Celui-ci commença le 13 avril 1813 et continua jusqu’à sa quatrième visite qui eut lieu le 12 mai ; sa manière de procéder consistait à demander à Anne Catherine de nouvelles explications plus détaillées sur des questions auxquelles elle avait déjà répondu, tandis que, d’un autre côté, les investigations faites plus tard et les rapports journaliers rédigés par Rensing et Krauthausen lui indiquaient de nouvelles questions auxquelles il demandait à la malade de répondre. Quand Overberg avait mis au net le procès-verbal d’un de ces interrogatoires, il le transmettait à Clément Auguste, lequel avait coutume de demander encore des explications là-dessus à Anne Catherine et ne se tenait pour satisfait que quand, par d’autres voies, il était arrivé aux mêmes résultats qu’Overberg. C’est pourquoi on trouve sur les procès-verbaux des additions et des remarques de sa main, lesquelles toutefois ne se montrent jamais en contradiction avec les conclusions d’Overberg, mais plutôt les confirment en les présentant d’une manière plus claire et plus précise.
Ce qui suit est extrait fidèlement des interrogatoires d’Overberg, des rapports de Rensing et des notes non officielles de Wesener :
« J’étais chargé, dit Overberg, à la date du 8 avril, de m’enquérir auprès d’Anne Catherine si elle s’était fait elle-même les plaies, ou si elle les avait laissé faire par d’autres. Je lui représentai aussi fortement qu’il me fut possible qu’elle devait obéissance à l’autorité ecclésiastique et que par conséquent elle était obligée de dire la vérité, quand même elle aurait promis le secret avec serment à celui qui lui aurait fait la marque des stigmates ; qu’un serment contraire à son devoir d’obéissance envers l’Église n’avait aucune valeur, et qu’elle ne pourrait se présenter avec confiance devant le tribunal de Dieu si elle cachait la vérité, contrairement à l’obéissance. Elle m’assura que tout cela était indubitable pour elle ; et alors je lui fis les questions suivantes :
1. « Auriez-vous (ce qui aurait pu se faire avec une bonne intention) donné quelquefois des coups de canif dans vos mains, ou bien y auriez-vous enfoncé un clou ou quelque chose de semblable, afin de ressentir plus vivement les douleurs de Notre Seigneur Jésus-Christ ? »
Réponse. – « Non ! jamais ! »
2. « N’auriez-vous pas appliqué à ces endroits de l’eau forte ou la pierre infernale ? »
R. – « Je ne sais pas ce que sont ces choses dont vous parlez. »
3. « Quelque personne portant intérêt au progrès de votre âme dans la vertu et connaissant votre culte pour la Passion de Jésus-Christ, vous aurait-elle fait ces blessures au moyen d’une forte pression ou de piqûres, ou de toute autre manière ? »
R. – « Non certainement ! »
« Lorsque j’entrai ainsi en matière et que je lui posai ces questions, son visage resta d’une sérénité inaltérable. Puis elle me raconta ce qui suit :
« Quand les plaies sont survenues, je n’en ai rien su : c’est une autre personne qui les a d’abord remarquées (je crois qu’elle nomma l’abbé Lambert) et qui m’y fit faire attention, tout en me disant : « N’allez pas vous croire maintenant une sainte Catherine de Sienne ; vous êtes encore bien loin de là. »
« Comme je lui objectais qu’il ne me paraissait pas possible qu’une autre personne eût remarqué les plaies avant elle, car, quand on reçoit une blessure, ordinairement on s’en aperçoit, elle répondit : « Cela est vrai ; mais la douleur existait trois ou quatre ans avant les plaies, et c’est pourquoi je ne soupçonnais pas qu’il se fût opéré quelque changement. »
« Lorsque je reçus les signes extérieurs, je n’avais pour me servir qu’une petite fille qui ne pensait pas à laver le sang desséché. Moi-même je ne l’ai pas remarqué et je ne l’ai pas lavé non plus. Voilà comment il est arrivé que l’abbé Lambert a remarqué avant moi-même les plaies des mains. La douleur ne pouvait pas m’y faire regarder, car elle existait déjà longtemps auparavant et les signes extérieurs n’y apportèrent aucun changement. (C’est pourquoi Anne Catherine avait coutume d’appeler marques la douleur ressentie depuis plusieurs années déjà aux endroits où se formèrent plus tard les plaies ; quant aux plaies visibles, elle les appelait les signes extérieurs.) En ce qui touche les douleurs à la tête, je les avais déjà environ quatre ans avant d’entrer au couvent. C’est comme si ma tête était tout entourée d’épines, ou plutôt comme si tous mes cheveux étaient des épines, en sorte que je ne pose jamais sans une vive souffrance la tête sur l’oreiller. Les souffrances causées par les autres plaies ne sont pas comme d’autres souffrances ; elles pénètrent jusqu’au cœur. Un attouchement ou une légère pression sur les croix de la poitrine ne me fait pas très grand mal à l’extérieur, mais bien à l’intérieur. C’est comme si toute la poitrine était enflammée. Quant au signe qui est au-dessus de l’estomac, j’y ai éprouvé la même douleur que si du feu était tombé dessus. »
4. « Quand les signes se sont-ils montrés sur votre corps ? »
R. – « Celui qui est sur l’estomac s’est montré le jour de saint Augustin ; la croix inférieure de la poitrine, environ six semaines après ; la croix supérieure de la poitrine, le jour de la fête de sainte Catherine ; les plaies des mains et des pieds à la dernière fête de Noël ; la plaie du côté, entre Noël et la nouvelle année. »
5. « Lorsque vous avez d’abord ressenti les douleurs, et plus tard quand sont survenues les plaies à la tête, aux mains et aux pieds, avez-vous vu quelque chose qui vous ait semblé être une apparition, ou avez-vous reçu des lumières spéciales sur quelque chose. »
R. – « Non ; j’étais alors en proie à des souffrances d’un genre particulier. »
6. « Ne savez-vous pas ce que signifient les croix sur la poitrine ? »
R. – « Non ; mais lorsque le premier signe sur l’estomac s’est montré, j’ai eu, en méditant, l’impression que je devais y faire attention comme à une marque que j’aurais encore beaucoup à souffrir pour l’amour de Jésus-Christ. Lorsque le second signe survint à la fête de sainte Catherine, je reconnus que ma croix serait doublée, et il en fut de même à Noël, lorsque le troisième signe se montra. »
« Elle me répéta encore, dit Overberg, qu’elle avait bien prié pour souffrir les douleurs de Jésus, mais jamais pour avoir les stigmates. »
Déjà, lors de la première visite d’Overberg, le 28 et le 29 mars, comme il lui demandait si elle avait prié Dieu pour avoir les marques des plaies du Sauveur, elle avait répondu : « J’ai prié Dieu à la vérité de me faire participer à ses souffrances, mais jamais je ne lui en ai demandé les marques extérieures. Je me suis bien souvent plainte à Dieu de ce qu’il me les avait données, mais je n’ai reçu aucune consolation. » Overberg ayant répondu : « Dieu a voulu que sa grâce vous suffît », elle répliqua aussitôt : « C’est ce qu’il m’a dit aussi. »
7. « Comment faut-il entendre votre première déclaration (insérée dans le premier procès verbal du 25 mars) ? « Mes plaies n’ont pas été faites par les hommes, mais je crois et j’espère qu’elles viennent de Dieu. »
R. – « J’ai dit : « Je crois » et non pas : « Je suis sûre », parce que les paroles du doyen et des médecins, ainsi que la sévérité de l’examen, ont fait naître en moi la crainte que ces plaies ne vinssent peut-être de l’esprit malin. Mais les marques de croix sur ma poitrine m’ont tranquillisée, parce que je me suis dit que celles-là certainement ne peuvent pas avoir été faites par le diable. C’est par la même raison que j’ai dit aussi : « J’espère », parce que je souhaiterais que ces signes fussent l’œuvre de Dieu et non pas un prestige du démon. »
8. « Et si vos plaies guérissaient, comme M. de Druffel le croit possible ? »
R. – « Il m’a été permis de prier pour que les plaies me fussent retirées ; il ne m’a été rien dit quant à la guérison. Aucune pensée ne m’est venue à ce sujet. J’ai compris la chose dans ce sens que Dieu ne prendrait pas en mauvaise part ma prière pour la disparition des signes, mais que les souffrances ne diminueraient point pour cela, qu’elles augmenteraient plutôt. Elles ont déjà beaucoup augmenté. »
Overberg lui ayant dit là-dessus : « Je ne puis pas croire que vous ayez de telles révélations, si vous ne me donnez pas la preuve que vous pouvez distinguer une révélation d’un simple souvenir », elle répondit : « Mais comment puis-je donner cette preuve ? » À quoi Overberg répliqua : « Je n’en sais rien. » Anne Catherine reprit alors :
« Il se peut que j’aie entendu, ou vu, ou éprouvé quelque chose, et que, quand j’en ai parlé, cela ait été pris à tort par d’autres personnes pour une révélation. (Elle cita, remarque Overberg, un exemple de ce genre.) Ce qu’on a entendu, d’ordinaire, doit être dans la pensée avant qu’on l’énonce. Mais si l’on reçoit tout à coup la connaissance de quelque chose dont on n’a rien entendu dire, ni rien vu antérieurement, ce ne peut pas être une réminiscence. »
9. « Savez-vous au juste en quel temps vous avez ressenti ces douleurs aux mains et aux pieds ? »
R. « – Quatre ans avant la suppression du couvent, je fis un voyage à Coesfeld, pour rendre visite à mes parents. Il m’est arrivé alors de prier une fois pendant environ deux heures derrière l’autel, au pied de la croix qui est dans l’église de Saint-Lambert. J’étais très attristée de l’état de notre couvent, et j’avais prié pour que mes sœurs et moi, nous pussions reconnaître nos fautes afin que la paix s’établit. J’avais aussi prié pour que Jésus daignât me faire ressentir avec lui toutes ses souffrances. Depuis ce temps j’ai toujours eu les douleurs et l’inflammation. J’avais cru avoir une fièvre continue et que la douleur venait de là. La pensée me vint souvent aussi d’y voir un signe que ma prière avait été exaucée, mais je repoussais toujours cette pensée, parce que je me regardais comme étant indigne d’une semblable grâce. Souvent je ne pouvais pas marcher à cause des douleurs aux pieds. Les mains me faisaient aussi tellement mal que je ne pouvais plus faire certains travaux, par exemple bêcher la terre. Je ne pouvais pas plier le doigt du milieu et quelquefois il était comme mort.
« Ayant déjà ces douleurs, un jour, au couvent, je priai instamment pour que mes sœurs et moi nous reconnussions nos fautes, pour que la paix s’établit et pour que mes souffrances cessassent. Alors je reçus pour réponse : « Tes souffrances ne diminueront pas. Que la grâce de Dieu te suffise. Aucune de tes sœurs ne mourra sans avoir reconnu ses fautes. » D’après cette réponse, lorsque les signes vinrent, je m’étais figuré qu’ils étaient seulement pour mes sœurs, et je pouvais m’y résigner : mais je fus saisie d’effroi quand je m’aperçus que ces signes devaient aussi être pour le monde.
10. « Quand je l’interrogeai touchant les croix de la poitrine, elle me dit : « Dès ma jeunesse j’ai prié Dieu de vouloir bien imprimer la croix dans mon cœur, afin que je n’oublie jamais ses souffrances : mais je n’ai jamais pensé à un signe extérieur. »
« Elle me fit connaître en outre que l’enquête minutieuse qu’on faisait sur sa vie antérieure n’était pas la moindre cause de ses souffrances, parce qu’on pouvait s’imaginer après cela qu’elle était quelque chose, tandis qu’elle-même savait bien mieux que personne qu’il n’y avait rien en elle.
11. « Le jeudi 13 mai, vers quatre heures de l’après-midi, le sang jaillit de sa tête. Je vis le sang couler du front, non goutte à goutte, mais comme un jet. En moins d’une minute, le mouchoir qu’elle avait autour du cou fut tout ensanglanté. Pendant ce temps, elle était très pâle et très faible. Les mains aussi commencèrent à saigner. Avant l’hémorragie, elle eut de violentes douleurs au front et aux tempes par suite des piqûres d’épines qui se faisaient sentir jusque dans les yeux. Quand elle parla de ces piqûres, je lui dis que, si je le pouvais, je retirerais les épines de sa tête et pourtant que j’en laisserais une. Elle me répondit : « Je ne demande pas que vous m’ôtiez les épines ; je souffre volontiers ces douleurs. »
« Je lui demandai quelle avait été sa pensée lorsqu’elle avait dit devant le doyen Rensing que ceux qui ne croyaient pas sentiraient ? Croyait-elle que ceux qui ne voulaient pas croire à la réalité de ses stigmates seraient punis pour cela ? Elle répondit en souriant : « Non certainement ; mes plaies ne sont pas un article de foi. Je voulais dire seulement que ceux qui ne veulent pas croire ce qu’enseigne la doctrine catholique ne trouveront pas, même sur la terre, un véritable repos, mais se sentiront misérables. »
12. Overberg rend ainsi compte d’une visite postérieure faite le 15 septembre 1864 : « Le matin, entre neuf et dix heures, je vis les signes des mains rougir et s’enfler, ce qui indiquait qu’ils allaient saigner. J’observai alors l’intérieur des mains pour voir si l’enflure s’y montrait aussi, mais je ne pus rien remarquer. Comme cela m’étonnait, Anne Catherine m’expliqua que les marques empreintes dans la paume des mains n’enflaient jamais avant de saigner, mais qu’au contraire elles s’enfonçaient en quelque sorte plus profondément pour devenir plus saillantes à la surface supérieure.
« La croix de la poitrine n’avait pas saigné aujourd’hui, mais elle était d’un rouge très vif. Cette rougeur se produit constamment aux jours marqués quand il n’y a pas effusion de sang. »
13. Depuis le temps où Anne Catherine avait reçu les signes extérieurs des plaies, elle s’était appliquée soigneusement à dérober ses mains aux regards de tous les visiteurs. C’est pourquoi elle les tenait cachées sous la couverture du lit ou bien, quand l’inflammation des plaies ne le permettait pas, elle posait dessus un linge blanc : elle en était si préoccupée que, même dans l’extase, elle s’apercevait quand quelqu’un voulait ôter ce linge. Voici ce que raconte le docteur Wesener : « J’ai conduit un jour ma sœur aînée près d’Anne Catherine. Elle était couchée sans connaissance, comme cela lui arrivait fréquemment. Le père Limberg voulut soulever le linge placé sur ses mains ; elle en marqua du mécontentement, et il lui demanda : « Qu’avez-vous ? » Elle répondit à voix basse et sans ouvrir les yeux : « On veut de moi quelque chose que je ne dois pas faire. » Or, je désirais vivement dans mon cœur, ajoute Wesener, que ma sœur pût être fortifiée dans sa foi par la vue de ces merveilleux phénomènes. Anne Catherine répéta : « On veut de moi des signes que je ne dois pas donner. » Alors le père Limberg lui donna sa bénédiction. Aussitôt, sans sortir du sommeil extatique, elle se signa d’une main tremblante, mais en faisant des efforts pour que le linge ne tombât pas de dessus sa main. »
14. Quelque chose de semblable arriva à Overberg, le 10 septembre 1813, quand il accompagna à Dulmen la princesse Galitzin. « Je trouvai Anne Catherine très faible, rapporte-t-il. Comme j’étais près d’elle à six heures du soir, elle tomba dans une de ces profondes défaillances (extases) qui lui étaient ordinaires. J’approchai de son visage les deux premiers doigts de ma main droite ; aussitôt elle pencha la tête et les baisa avec respect. Alors je me penchai à mon tour vers sa main gauche qui était étendue devant moi, raide et immobile, afin de la baiser : mais Anne Catherine, effrayée, la retira. Je me penchai ensuite vers la main droite : mais je ne pus pas non plus y atteindre, tant elle fut retirée vite, quoique dans cette défaillance tout le corps de la malade fût aussi raide qu’un morceau de bois. » Overberg avait fait ces tentatives par suite d’un mouvement involontaire de respect pour les stigmates ; mais l’humilité de la patiente, devenue pour elle une seconde nature, se dérobait à un semblable hommage, même quand elle n’avait pas l’usage de ses sens ; bien plus, elle ne pouvait supporter même un regard dirigé par un sentiment de ce genre, ainsi que le Pèlerin en fit l’épreuve plus tard. « J’étais assis près de son lit, raconte celui-ci, et je priais, pendant qu’elle était en extase et en proie à de grandes souffrances. Dans ma prière, j’offrais à Dieu les souffrances de tous les martyrs et les douleurs de tous les saints stigmatisés en union avec les très saintes plaies de notre Sauveur : comme en même temps je regardai avec émotion les mains d’Anne Catherine, elle les retira avec une rapidité incroyable. Cela me surprit à tel point que je lui demandai ce qu’elle avait. « Une grande peine », me répondit-elle sans sortir de sa profonde défaillance. »
15. Le doyen Rensing se trouvant auprès d’elle, un peu avant le moment où son sang allait couler, elle se plaignit des douleurs cuisantes qui précédaient toujours l’effusion du sang. Il lui demanda alors pourquoi elle n’avait pas découvert ses nains devant lui, ajoutant qu’elle ne devait se faire aucun scrupule de le faire en sa présence. « Ah ! répondit-elle, je ne puis pas moi-même souffrir de voir mes signes à découvert parce qu’en faisant croire à des grâces particulières, ils m’ont fait un renom dont je ne suis pas digne. » « Là-dessus elle me remercia, raconte Rensing, de ce que je n’avais pas laissé pénétrer auprès d’elle toute une société de curieux en voyage : puis elle se mit à pleurer de ce que ces bonnes gens se donnaient tant de peine pour elle et l’estimaient tant quoiqu’ils valussent bien mieux qu’elle devant Dieu. « Je dois aussi rendre grâce à Dieu, ajouta-t-elle, de ce qu’il ne me cache pas mes fautes et me confirme ainsi dans l’humilité. »
16. Dans une autre occasion, elle parla de nouveau de ces visites qui lui causaient tant de peines et de soucis et pria instamment Rensing de ne plus la laisser voir, surtout aux médecins étrangers qui, la plupart du temps, blessaient sans ménagement ses sentiments les plus délicats. « Il m’est bien dur, dit-elle, d’être obligée si souvent de montrer mes signes : mais cela m’est encore plus pénible quand je suis forcée de voir que ces gens ne s’occupent pas de ce qui peut intéresser la gloire de Dieu et n’ont d’autre but que d’avoir quelque chose à raconter à ce sujet.
« Je ne désire pas être délivrée des souffrances corporelles. Dieu me les laissera. Mais à quoi bon cette inspection et ces enquêtes ? Notre Sauveur lui-même n’a pas pu contenter tout le monde de façon à ce qu’on crût et à ce qu’on se convertît. D’autres ont trop de compassion pour moi. Que ne prient-ils pour moi afin que je me soumette humblement à tout ce que Dieu ordonne de moi par les supérieurs ecclésiastiques et que je ne perde pas sa grâce ? Dieu conduit chaque homme par un chemin particulier. Mais qu’importe par quel chemin nous allions au ciel ? Puissions-nous seulement faire tout ce que Dieu demande de nous suivant notre état ! »
17. Rensing lui ayant raconté dans une autre occasion comment sainte Véronique Giuliani avait eu longtemps autour de la tête les marques de la couronne d’épines et comment, lorsque la chose fut connue, on voulut les faire effacer par des médecins, ce qui lui fit souffrir de terribles douleurs, elle répondit en soupirant : « Je n’ai pas encore eu tant à supporter ; cependant lorsque l’autorité ecclésiastique a décidé que mes plaies devaient être guéries, cela m’a fait une bien pénible impression à cause des cruelles souffrances que j’éprouvais. J’ai ressenti les douleurs de la couronne d’épines autour de ma tête avant mon entrée au couvent ; cela m’est arrivé pour la première fois dans l’église des Jésuites, à Coesfeld. »
18. À l’heure des premières vêpres de la fête de sainte Catherine de Sienne, Rensing la trouva rendant du sang par ses plaies ; mais elles saignèrent beaucoup plus fortement le jour même de la fête, 30 avril. Voici ce que Rensing rapporte à ce sujet : « Lorsque je la visitai à trois heures, je fus tellement surpris, en entrant dans sa chambre, à la vue du sang qui coulait incessamment de la tête et des mains, que j’en fus tout bouleversé. Il m’échappa une expression d’admiration pour les grâces extraordinaires que le Seigneur lui fait. Elle le remarqua et dit : « Oui, Dieu me fait plus de grâces que je ne le mérite et je l’en remercie ; mais j’aurais voulu qu’il cachât ces grâces aux yeux des hommes, car je crains qu’à cause de cela, on ne me prenne pour meilleure que je ne suis. » Nous eûmes alors un entretien qui me fit voir au fond de son âme si pleine de pureté et d’humilité, et me fit connaître quelques particularités de l’histoire de sa jeunesse où je vois la preuve la plus convaincante que, dès son enfance, la main de Dieu l’a conduite, protégée et préservée des périls les plus imminents. Je fus touché et étonné de voir une personne qui a reçu si peu d’éducation avoir des idées si claires, si justes et si élevées sur Dieu et sur les choses de Dieu. Elle m’a raconté aussi que Dieu lui avait demandé la nuit précédente : « Qu’aimes-tu mieux ? être bientôt près de moi ou souffrir longtemps encore pour moi ? » À quoi elle répondit : « Si c’est votre volonté, je souffrirai de bon cœur encore davantage, pourvu que vous m’accordiez la grâce de souffrir comme vous le voulez. » Dieu m’a promis cette grâce et cela m’a rendue très joyeuse. Dieu m’a aussi rappelé que, pendant ma vie au couvent, j’avais commis beaucoup de fautes contre la perfection à laquelle je suis appelée par mes vœux. Je me suis repentie de nouveau de ces fautes et j’ai reçu de Dieu l’assurance qu’elles ne m’avaient pas fait perdre sa grâce, parce que je m’étais humiliée devant lui et devant les hommes. Il m’a aussi fait souvenir qu’au couvent, quand j’étais méconnue de mes compagnes, j’ai souvent prié Dieu avec instance de vouloir bien leur faire reconnaître les fautes dont j’avais été l’occasion pour elles. Souvent, quand j’ai prié ainsi, et en particulier l’été de l’avant-dernière année, j’ai reçu la promesse consolante que toutes reconnaîtraient leurs fautes avant ma mort. Et maintenant toutes sont rentrées en elles-mêmes depuis que Dieu a mis sur moi des signes si extraordinaires. C’est là une grande joie et j’en rends de vives actions de grâces au milieu des grandes douleurs que me causent mes signes. »
19. « Je lui demandai une fois, écrit encore Rensing, si elle n’avait pas aussi une plaie sur l’épaule : car je crois que le Sauveur aura certainement eu sa sainte épaule blessée par sa pesante croix. « Oui, sans doute, répondit-elle. Notre divin Sauveur a eu à l’épaule une blessure très douloureuse que la croix lui a faite : mais je n’ai pas cette blessure, quoique j’en aie depuis longtemps ressenti la douleur à mon épaule. Déjà, dans ma jeunesse, je vénérais la sainte plaie de l’épaule, parce que cette vénération plaît particulièrement au Sauveur. Lorsque j’étais encore au couvent, il m’a révélé un jour que cette blessure, à laquelle on pense si peu, lui a causé des douleurs excessives, et que la vénération qu’on a pour elle lui plaît autant que lui aurait plu l’acte de celui qui, touché de compassion, lui aurait pris sa croix pendant qu’il en était chargé et l’aurait portée à sa place jusqu’au Calvaire. À l’âge de six ou sept ans, il m’est arrivé, lorsque j’étais seule et que je pensais à la Passion du Seigneur, de charger sur mes épaules une lourde pièce de bois ou quelque autre fardeau que je pouvais à peine traîner. »
Pendant tout le mois de mai 1813, Rensing eut à noter presque journellement l’effusion du sang par les plaies et la violence croissante des douleurs qu’elles causaient. En outre, jusqu’au 8 mai, elle était restée toujours couchée sur le dos, de telle façon qu’elle y avait de profondes blessures en plusieurs endroits. Quoiqu’il en résultât pour elle des douleurs très cuisantes, elle disait pourtant : « Je n’en tiens pas compte en comparaison de celles que me font souffrir continuellement les autres plaies. Cependant je supporterais volontiers toute espèce de souffrances corporelles, pourvu que le bon Dieu ne me retirât pas les consolations intérieures. Au lieu de consolations, maintenant, je ressens souvent une grande amertume intérieure. Cela est dur ; mais que la volonté de Dieu soit faite ! »
20. Pendant l’octave de l’Invention de la sainte Croix, toutes ses plaies rendirent journellement du sang avec des douleurs toujours croissantes. Rensing, la visitant le 3 mai au matin, trouva toutes les plaies saignantes ; ne devinant pas le rapport de cette manifestation avec la fête du jour, il exprima son étonnement, et Anne Catherine lui répondit : « Cela doit venir de ce qu’on célèbre aujourd’hui la fête de l’Invention de la sainte Croix. » Elle avait reçu ce jour-là la sainte communion, mais elle se plaignait d’avoir ressenti ensuite une sécheresse spirituelle inaccoutumée, ce qui lui avait été beaucoup plus pénible que les souffrances physiques les plus vives. Les douleurs de la couronne d’épines étaient extrêmement violentes autour du front, des yeux et des tempes, et elles descendaient jusqu’à l’intérieur de la bouche et au gosier. Elles persistèrent sans interruption pendant plusieurs jours et sans que la patiente eût été fortifiée par des visions consolantes. Rensing n’avait pas la force de supporter cette vue ; ordinairement il restait près de la malade le moins de temps qu’il pouvait.
21. Elle lui dit le 6 mai : « Je sens les douleurs des plaies des pieds monter dans la poitrine ; c’est comme si toutes mes plaies se trouvaient en communication, de manière à ce que les douleurs passent de l’une à l’autre. » En outre son dos sur lequel elle était couchée s’était écorché par endroits, en sorte que la chemise et le drap du lit restaient collés à la peau ; toutefois, elle déclarait que la souffrance qu’elle en ressentait n’était pas comparable aux douleurs que lui causait chacune des autres plaies prise à part. Rensing lui ayant dit qu’étant dans un pareil état, elle devait avoir eu une bien mauvaise nuit, elle répondit : « Non ! ma souffrance elle-même m’a causé de la joie. Car, quand j’ai quelque chose à souffrir, je me réjouis et je remercie Dieu de ce que, par là, je ne suis pas oisive dans mon lit. » Elle s’exprima un jour de la même manière en présence d’Overberg, disant que ce qu’il y avait de plus fâcheux pour elle était de n’avoir rien de particulier à souffrir, parce qu’elle ne se trouvait contente que quand Dieu daignait lui faire endurer quelque chose pour lui.
22. Le 9 mai, Rensing la trouva dans un état qui montrait bien que ses souffrances n’avaient pas encore diminué le moins du monde ; mais Dieu lui avait rendu ses consolations, ce qui avait beaucoup relevé son courage. Elle raconta à Rensing que les douleurs étaient toujours aussi intenses autour de la tête : c’était comme si une corde de crin serrée tout autour y eût pénétré profondément ; elle craignait souvent d’en perdre la raison. Cependant elle se montra consolée et ajouta : « Ma souffrance ne m’est plus difficile à porter, parce que Dieu me l’a adoucie par des consolations que je ne mérite pas. Je me suis rendue indigne de semblables consolations, surtout au couvent, où je me suis souvent chagrinée des procédés de mes compagnes et où je me préoccupais beaucoup de la manière dont elles auraient dû se comporter et trop peu de ce que j’aurais dû être moi-même. C’était de l’ingratitude et de l’imperfection : c’est pourquoi je suis contente maintenant que Dieu me fasse souffrir ainsi. Et si je savais que par mes souffrances je pusse contribuer tant soit peu à sa glorification et à la conversion des pécheurs, je voudrais de grand cœur souffrir plus longtemps et davantage. Seulement, que Dieu me donne la patience ! » Le soir de ce jour, les douleurs diminuèrent enfin quelque peu, et Rensing trouva la malade d’une sérénité inaccoutumée.
23. Outre les effusions de sang, elle avait journellement par tout le corps des sueurs tellement abondantes que tous les draps de son lit en étaient mouillés et traversés comme si on les eût trempés dans l’eau. Il en résultait des blessures dans le dos, et elle ne pouvait que rarement le mettre en contact avec le lit. Il lui était impossible de se coucher, soit sur le côté droit, à cause des douleurs intolérables de la plaie qui s’y trouvait, soit sur le côté gauche, parce que l’os de la hanche était complètement dégarni de chair. Il fallait donc qu’elle restât péniblement sur son séant, soutenue par des appuis, sans pouvoir poser sur un oreiller sa tête cruellement endolorie. Après sa mort, Clément Brentano rendit ce témoignage : « J’ai été pendant quatre ans en relations journalières avec Anne Catherine ; j’ai vu très souvent sa tête saigner avec de grandes douleurs, quoique jamais elle ne se soit montrée à moi la tête découverte et que je n’aie jamais vu les gouttes de sang jaillir immédiatement du front. Mais je voyais le sang couler de dessous sa coiffe sur son visage en telle quantité qu’on aurait pu le recueillir dans les plis de son fichu avant qu’il fût absorbé par la toile. Elle sentait sa tête entourée d’une large et pesante couronne d’épines et ne pouvait pas la poser sur un oreiller. Assise sur son séant, elle balançait pendant des heures entières au-dessus de son cou, comme un fardeau de douleurs intolérables, sa tête courbée sous la pression d’un supplice inouï ; souvent je l’ai soutenue plus ou moins longtemps en tenant l’os du nez entre mes deux doigts, parce que je ne pouvais supporter la vue de ces horribles souffrances pendant lesquelles la sueur de l’agonie coulait sur son pâle visage. Elle passait souvent toute la nuit dans cet état, délaissée, sans secours, sans marques de sympathie. »
24. Quant à l’impossibilité absolue de prendre aucune espèce de nourriture qui avait coïncidé avec l’apparition des stigmates, Overberg s’exprime en ces termes à la date du 12 mai 1813 :
« Depuis environ cinq mois, Anne Catherine n’a pris aucun aliment solide, pas même une quantité équivalente à un petit pois. Il ne lui a plus été possible de rien retenir, ni chocolat, ni café, ni vin, ni soupe ; tout au plus a-t-elle pu prendre quelquefois sans la rejeter une petite cuillerée de bouillon. Elle a cherché à cacher cela, en faisant mettre devant elle, pour qu’on les voie, une pomme cuite ou des prunes bouillies dont elle peut seulement sucer le jus.
« Pendant son séjour au couvent, un peu de café très léger était ce qu’elle pouvait le mieux supporter ; mais, au commencement de l’hiver dernier, elle en vint à ne plus pouvoir garder le café lui-même. Elle essaya ensuite de prendre du chocolat très délayé, mais cela ne lui réussit que peu de jours. Elle ne pouvait supporter le vin, ni pur, ni mélangé d’eau. Ainsi l’eau resta l’unique chose qu’elle pût garder. »
25. On a déjà raconté comment Anne Catherine, qui aurait tant désiré cacher à tous les hommes son abstinence de toute nourriture, fut soupçonnée, dès le commencement, de manger en secret : or cette suspicion se reproduisit plus tard à diverses reprises. Ainsi Overberg rapporte, à la date du 17 septembre 1814 : « Selon ce que m’a raconté Rensing, la maîtresse de la maison où loge la sœur Emmerich resta jour et nuit, pendant tout le mois qui précéda sa mort, dans la chambre d’Anne Catherine, persuadée qu’étant là elle pourrait supporter plus facilement ses souffrances et se mieux préparer à la mort. Deux jours avant sa mort, cette femme a avoué à Rensing qu’auparavant la pensée lui était quelquefois venue qu’il ne fallait pas trop prendre à la lettre ce qu’on disait de l’abstinence absolue de nourriture chez la sœur Emmerich, mais que maintenant elle s’était convaincue qu’en réalité Anne Catherine ne prenait absolument rien. »
26. Wesener, de son côté, rapporte ainsi, à la date du 29 octobre 4814, comment il fut forcé de prendre la défense d’Anne Catherine contre des soupçons de ce genre : « J’ai reçu la visite du doyen de Notteln qui voulait, me dit-il, savoir par lui-même ce qu’il fallait croire du bruit répandu à Munster qu’on avait vu Anne Catherine hors de son lit et mangeant de la viande. Je le conduisis près de la malade, en le priant de bien observer sa physionomie pendant que je lui communiquerais ce bavardage sans aucun ménagement. Mon récit la fit sourire, et elle fit entendre que ces propos ne lui inspiraient que de la compassion pour ceux qui les auraient inventés et propagés. Je dois moi-même reconnaître, pour rendre hommage à la vérité, que j’ai pris bien de la peine pour trouver quelque chose dont elle pût manger sans le vomir aussitôt, mais toujours inutilement. Si j’ai été trompé, je dois refuser croyance au témoignage de mes sens et à toutes mes facultés. En outre, la malade a un entourage qui se ferait un plaisir de rendre publique la moindre chose tant soit peu équivoque ou capable de provoquer la suspicion. Sa propre sœur qui devrait la servir est une personne d’un esprit mal fait et d’un mauvais caractère, et, comme elle se met souvent dans le cas d’être reprise par moi et par la malade, elle n’a aucune affection pour celle-ci et la laisse parfois des jours entiers sans lui donner une goutte d’eau à boire. Certainement elle ne garderait pas le silence en présence d’une imposture. »
27. Le père Limberg lui-même, par suite de sa disposition au scrupule, se laissait si facilement aller au soupçon que, quinze mois après la fin de l’enquête, ayant aperçu au drap de lit de la malade une tache de couleur foncée qu’il ne pouvait s’expliquer, il fut, pendant plusieurs jours, extrêmement agité par la crainte qu’elle ne provint d’un aliment mangé en cachette. Clara Soentgen et Wesener finirent par le rassurer en lui expliquant que la tache venait d’un emplâtre que la première, sur la demande de la malade lui avait posé sur l’os de la hanche. Anne Catherine ne put s’empêcher de sourire de l’inquiétude si peu raisonnable de son confesseur, et elle dit : « Si je pouvais manger, je ne sais vraiment pas pourquoi j’en ferais un secret. » Cependant elle le pria de lui communiquer à l’avenir les soupçons qui lui viendraient et de ne pas les garder pour lui pendant des jours entiers. Nous verrons plus tard tout ce qu’elle eut à souffrir des tentatives de Wesener pour lui faire prendre des aliments.
28. Voici ce que rapporte Overberg sur sa manière de prier lorsqu’elle faisait la sainte communion.
« La préparation la plus prochaine à la réception de la sainte Eucharistie consiste pour Anne Catherine à prier Dieu, son Sauveur, de lui donner son propre cœur, pour qu’elle puisse le recevoir et l’héberger dignement. Elle lui représente qu’elle ne peut l’aimer et le louer comme il le mérite, sinon par son cœur divin et avec ce cœur. Elle lui offre pour cela son cœur à elle et le prie de le prendre et d’en faire ce qui lui plaira. Quand elle l’a ainsi livré à Dieu, elle passe en revue toutes les puissances de son corps et de son âme, afin de donner à Dieu tout ce qu’elle possède. Elle lui offre ses yeux, ses oreilles et tous ses membres, le suppliant d’en user pleinement pour son service et d’accomplir par eux ce qu’elle ne peut pas elle-même. Elle contracte alors un engagement avec Dieu, s’obligeant à le remercier et à le louer avec tout ce qui est d’elle et en elle ; chaque souffle, chaque sentiment, chaque mouvement des yeux et des mains, chaque instant de ses souffrances doit devenir un acte de gratitude et de louange.
« Ensuite elle s’adresse aux saints, les priant de lui prêter ou de lui donner quelque chose de leur beauté, des ornements dont ils sont parés ou de leurs vertus, pour qu’elle puisse mieux faire sa préparation à la sainte communion et rendre des actions de grâces plus ferventes. Par-dessus tout, elle s’adresse à la Mère de Dieu pour qu’elle lui confère un don tiré du trésor surabondant de sa gloire et de ses vertus. Elle la prie notamment de mettre entre ses bras le divin enfant comme elle l’a fait pour les rois de l’Orient. Puis elle va d’un saint à l’autre, demandant l’aumône et rappelant à chacun ses prérogatives particulières, afin d’obtenir pour elle-même un don à l’aide duquel elle puisse plaire davantage au divin Sauveur. Elle les invoque en ces termes : « Vous êtes si immensément riches et je suis si pauvre ! ayez donc pitié de moi ! je ne demande qu’un peu de votre superflu ! »
« Après la communion, elle entre en extase comme elle le faisait au couvent. »
XXIX
ANNE CATHERINE EST GARDÉE À VUE PENDANT DIX JOURS (DU 10 AU 20 JUIN 1813) PAR VINGT BOURGEOIS DE DULMEN. – CLÔTURE DE L’ENQUÊTE ECCLÉSIASTIQUE.
1. « Le 9 juin, dit Rensing dans son rapport, je fis savoir à la malade que toutes les mesures étaient prises pour la faire garder à vue et que cela commencerait le lendemain. Cette nouvelle la réjouit beaucoup, et elle déclara qu’elle se soumettait sans la moindre objection à la décision de l’autorité ecclésiastique. Je remarquai que la croix de la poitrine saignait abondamment, car le sang traversait son vêtement.
« Lorsque je la visitai de nouveau le lendemain, pour la préparer à l’arrivée des gardiens qui était fixée au soir de ce jour, elle me dit : « Ne vaudrait-il pas mieux que l’abbé Lambert s’éloignât d’ici pendant tout le temps que durera cette surveillance ? Il est décidé à partir si vous le trouvez bon. » Cela me fit grand plaisir, et j’en parlai à l’abbé Lambert qui partit dans l’après-midi pour l’ancienne Chartreuse, laquelle est à une lieue et demie de Dulmen. Le soir, à huit heures, les gardiens sont entrés en fonction. »
2. Cette ouverture d’Anne Catherine surprit agréablement non seulement le doyen Rensing, mais aussi le vicaire général Droste. Ce dernier désirait vivement l’éloignement de l’abbé Lambert, mais, par égard pour ce vieillard infirme, il n’avait jamais voulu le demander. Le 8 juin encore, il avait écrit à ce sujet à Rensing : « Je vous prie, si cela est possible, de faire en sorte que l’abbé Lambert ne reste pas dans la maison qu’habite la sœur Emmerich pendant le temps qu’elle sera gardée à vue, ou tout au moins qu’il ne lui fasse pas de visites. Au fond, ce sera difficile, et, s’il n’y a pas moyen d’y arriver, il faudra s’en remettre à Dieu. Si la chose ne peut pas se faire comme d’elle-même, il vaut mieux y renoncer. Je vous prie de recommander aux prières de la sœur Emmerich une intention que j’ai oublié de lui faire connaître verbalement. » Et Rensing avait répondu : « Il serait certainement à désirer que M. Lambert s’éloignât tout à fait pendant le temps que durera la surveillance ; mais, vu son état d’infirmité, je ne vois aucun moyen de l’y déterminer. »
3. Le vicaire général avait donné des prescriptions minutieuses quant à la manière dont la surveillance devait être organisée : « Les gardiens (ainsi s’exprimait l’ordonnance du 4 juin) ne quitteront pas un seul instant la sœur Emmerich, soit le jour, soit la nuit. Sa sœur peut toutefois être présente et doit lui rendre les services qui seraient nécessaires : mais jamais, et dans aucun cas, les gardiens ne doivent la quitter. Même quand elle se confessera, ils doivent être là. Le père Limberg doit alors parler bas avec elle, mais éviter avec le plus grand soin tout ce qui pourrait provoquer chez les gens soupçonneux la simple pensée de la possibilité que les plaies soient entretenues par lui. Comme deux personnes à la fois doivent toujours remplir l’office de surveillants, je crois convenable, si la chose est possible, qu’une d’elles soit un homme âgé. Les gardiens n’ont du reste rien autre chose à faire qu’à voir : tout le reste serait hors de leurs attributions. »
4. Le cinquième jour, Rensing fut en mesure de faire le rapport suivant au vicaire général : « Les avis donnés par l’autorité sont exactement observés par les gardiens, et la patiente est tellement satisfaite de la manière dont ils se comportent à son égard qu’elle m’a déjà remercié plus d’une fois d’avoir choisi des hommes aussi discrets pour remplir cet office dans des circonstances qui sont d’ailleurs si pénibles, pour elle. »
Il se plaint en même temps du refus fait par un médecin des environs de Dulmen de se charger de diriger la surveillance : « N. N... se retire parce qu’il trouve trop délicat de se charger seul de l’affaire sans le concours de quelques-uns de ses confrères. N’est-il pas triste de voir des hommes auxquels leur profession impose souvent le devoir d’exposer leur vie dans les cas de maladies contagieuses, craindre à ce point le fouet de papier de la critique, là où il s’agit de rendre témoignage à la vérité ? »
Cette hésitation du médecin, lequel parut enfin le 15 juin et passa plusieurs nuits auprès de la malade avec les autres gardiens, avait failli faire manquer complètement le but qu’on s’était proposé, parce que la surveillance n’était pas destinée à confirmer le jugement des supérieurs ecclésiastiques sur la réalité des phénomènes remarqués chez Anne Catherine, mais seulement à dé tourner les suspicions qui pourraient s’élever contre l’autorité ecclésiastique, comme n’ayant pas fait l’enquête avec toute la rigueur voulue. Voilà pourquoi le vicaire général, que le refus du médecin surprit très désagréablement, avait écrit à Rensing : « Pour que le but de la mise en surveillance soit atteint, il est nécessaire que le docteur N. N.... sep rende à Dulmen, dirige toute l’affaire et atteste de son côté que tout s’est passé dans les règles. Je regarde cela comme tellement nécessaire que sans cela la surveillance à laquelle serait soumise la sœur Emmerich me paraîtrait inutile. »
5. Anne Catherine, aussi fut très contrariée du refus fait d’abord par le médecin. Elle avait chargé le père Limberg d’aller de sa part à Munster exprimer au vicaire général sa crainte que la surveillance ne fût déclarée insuffisante, qu’on n’en exigeât plus tard une nouvelle, et qu’elle-même peut-être ne fût traînée à Munster, ce dont elle priait l’autorité ecclésiastique de la préserver. Le vicaire général, avec la sévérité que lui inspiraient ses bonnes intentions, ne crut pas devoir accueillir sans un blâme rigoureux cette prière, bien justifiée pourtant et appuyée sur des motifs qui, comme on le verra, étaient loin d’être sans fondement. Son œil clairvoyant, on peut même dire soupçonneux, n’avait rien pu découvrir chez Anne Catherine qui ne fût en parfait accord avec ses dons extraordinaires ; les rapports exacts et circonstanciés sur sa vie passée que lui avait faits Overberg et que confirmaient des interrogatoires subis par de nombreux témoins, lui avaient donné la certitude qu’Anne Catherine, dès sa première jeunesse, avait été favorisée par Dieu d’une direction particulière : c’est pourquoi il avait envers elle les plus grandes exigences, et il procédait contre tout ce qui ne semblait pas répondre à son attente avec la rigueur implacable qu’il aurait montrée à l’égard de tout ce qui aurait pu donner lieu à la moindre suspicion, s’il s’était présenté quelque chose de ce genre touchant les signes extérieurs. Ainsi, d’après la haute opinion qu’il avait de la vocation d’Anne Catherine, il trouva blâmable qu’elle ne fût pas assez « morte à toute volonté », pour ne plus ressentir aucune inquiétude quant à l’avenir.
« Dites à la sœur Emmerich, écrivit-il à Clara Soentgen, et cela en la saluant amicalement de ma part, que le proverbe dit : Ne t’inquiète pas des œufs qui ne sont pas pondus. J’ai coutume d’y ajouter : Ni des œufs gâtés. Le passé est passé ; le futur n’est pas encore là, il ne viendra peut-être jamais ; s’inquiéter de l’avenir est aussi inutile que s’inquiéter du passé, et non pas seulement inutile, mais nuisible ; car, avec des soucis de cette espèce, nous risquons de ne pas remplir nos devoirs actuels. En outre, l’inquiétude de l’avenir provient ordinairement de l’attachement à sa volonté propre. Dites-lui donc que toutes ces pensées : « qu’elle craint de pécher par impatience ; qu’il ne faut pas tenter Dieu, etc. », me paraissent des inspirations de l’amour-propre. »
Si Clément Auguste se montrait tellement rigoureux pour un de ces mouvements de crainte et d’inquiétude auxquels les hommes les plus saints ne peuvent échapper tant qu’ils vivent dans la chair, que n’aurait-il pas fait s’il avait jamais aperçu chez Anne Catherine un véritable manquement ? Et combien cette sévérité atteste l’attention sérieuse et le soin scrupuleux avec lesquels toute l’enquête fut conduite !
6. La mesure qui avait été prise ne pouvait avoir d’importance, quant à la conviction déjà bien arrêtée chez le vicaire général de la parfaite sincérité d’Anne Catherine, et rien ne lui faisait sentir le besoin d’autres preuves que celles qu’il avait déjà recueillies. Cela résulte clairement de ce qu’avant la fin des-dix jours pendant lesquels la malade devait être gardée à vue, par conséquent sans attendre le compte qui lui serait rendu, il écrivit comme il suit à Rensing :
« Je vous demande instamment de me faire parvenir le plus tôt que vous pourrez le résultat des interrogatoires des compagnes de la sœur Emmerich, afin que je puisse finir l’enquête aussitôt que possible. »
Et, quelques jours plus tard, il demande en ces termes le journal où étaient consignées les observations des gardiens :
« Je désire fort l’avoir pour lundi. Ce sera la clôture de l’enquête. Cependant je vous prie de me donner des informations quant aux incidents qui pourraient survenir, et d’aider la sœur Emmerich autant que vous le pourrez à acquérir ce qui peut lui manquer encore du côté de l’indifférence. Saint François de Sales a dit : « Ne rien craindre, ne rien demander, ne se plaindre de rien. »
7. Rensing ajouta les observations suivantes au procès-verbal qui lui était demandé :
« Puisque Votre Excellence va clore l’enquête, je lui demanderai si la mission qui m’a été confiée en ce qui touche les visiteurs indigènes ou étrangers doit cesser ; vous croirez sans peine que je le désire vivement, afin d’être délivré des dérangements et des ennuis journaliers qui en résultent pour moi. Mais alors cette pauvre fille n’aura pas une heure de repos du matin au soir, et elle sera assaillie par des caravanes de curieux, d’autant plus que, comme elle me l’a déjà dit deux fois, M. le docteur Krauthausen a répandu ici et à Coesfeld le bruit que, si la sœur Emmerich donne elle-même la permission de venir la voir, on n’a pas besoin de l’autorisation du doyen. La femme du docteur, qui est malade, a confirmé récemment cette allégation par son propre exemple : car, jeudi dernier, pendant le service de l’après-midi, elle s’est fait porter sur un fauteuil chez la sœur Emmerich sans m’en rien faire dire. J’ai cru devoir vous faire connaître cet incident, parce qu’il a fait grand bruit dans la ville et qu’il peut avoir des conséquences très désagréables : car déjà plusieurs personnes ont demandé la permission de rendre visite à la sœur Emmerich, désirant, pour cause de maladie ou d’infirmité, lui demander conseil et se recommander personnellement à ses prières. »
8. Le rapport des vingt gardiens joint à cette lettre est ainsi conçu :
« Nous, soussignés, ayant été invités par M. le doyen Rensing à garder à vue la sœur Emmerich malade et informés verbalement et par écrit des motifs de cette surveillance, ainsi que des points à observer, nous sommes rendus deux par deux à son domicile le 10 juin 1813, à huit heures du soir. Nous avons commencé à remplir notre office suivant l’ordre prescrit, et nous avons continué jour et nuit, sans interruption, jusqu’au samedi 19 juin, à midi. Pendant ce temps, personne n’est venu près de la malade, à l’exception de sa sœur qui la servait, de ses anciennes compagnes de couvent, et de personnes qui lui ont été amenées par M. le doyen ou qui présentaient une permission écrite de M. le vicaire général. Personne n’a pu rien dire à la malade ni rien concerter avec elle que nous n’eussions pu entendre distinctement et remarquer.
« M. Lambert, ecclésiastique qui demeurait dans la même maison que la malade, s’était déjà éloigné de son propre mouvement avant qu’on eût commencé à la garder à vue, afin de prévenir toutes les objections, et il n’est revenu à la ville qu’après la fin de l’enquête.
« Pendant ces dix jours, la malade n’a rien pris que de l’eau claire ; elle en a rarement demandé, mais n’en a bu le plus souvent que quand elle lui était offerte par nous, par sa sœur ou par MM. les médecins. Elle a mis une fois une cerise dans sa bouche et l’a un peu sucée, mais elle en a rejeté la chair ; elle a avalé aussi plusieurs gouttes de laudanum que M. le docteur Wesener lui a fait prendre un jour qu’elle ressentait des douleurs extraordinairement vives et persistantes.
« Ni la malade même, ni aucun de ceux qui l’ont visitée n’ont touché le moins du monde à ses plaies.
« La double croix de la poitrine a commencé à saigner dans la nuit du 15 au 16, après de grandes douleurs et des élancements dans la poitrine dont la malade se plaignait beaucoup ; cela peut avoir duré jusqu’à sept heures du matin. Les autres plaies ont commencé à saigner de bon matin le vendredi 18, et elles ont continué plus ou moins fort toute la journée ; les plaies à la tête ont encore un peu saigné le matin du samedi 19. Avant et pendant l’hémorragie, la malade se plaignait beaucoup de douleurs et d’élancements dans ces plaies. Du reste, nous avons observé que généralement aux heures de la matinée jusque vers dix heures, la malade se plaignait moins et quelquefois se montrait de très bonne humeur ; il y avait une exception pour le temps qui précédait et suivait l’effusion du sang. Pendant le reste de la journée, elle se plaignait plus ou moins de faiblesse, de chaleur et d’élancements aux plaies et dans la poitrine, de maux de tête et de maux d’yeux. Il était rare qu’elle eût un sommeil tranquille ; l’état qui nous paraissait ressembler au sommeil n’était, disait-elle, jamais bienfaisant pour elle, et elle se sentait ordinairement plus faible après qu’avant. La nuit venue, presque toujours entre dix heures et minuit, elle entrait en extase, et alors elle avait le délire, parlait haut, tressaillait comme saisie de terreur, etc. ; souvent aussi, elle restait longtemps tranquille comme si elle eût dormi.
« Nous sommes prêts à renouveler en toute occasion nos présentes affirmations devant toute autorité ecclésiastique ou civile, et, s’il le faut, à en attester la vérité par serment.
« Dulmen, le 23 juin 1813. »
9. Le vicaire général exprima alors sa satisfaction au doyen dans la lettre qui suit : « Je ne puis me dispenser, monsieur le doyen, de vous exprimer ma plus vive reconnaissance pour avoir conduit l’enquête d’une manière si parfaitement conforme à mes désirs et à mes instructions. Je ne puis donner de meilleur conseil à la sœur Emmerich que de s’affermir dans l’indifférence, au moyen de la grâce de Dieu qui ne fait jamais défaut à ceux qui veulent et qui prient, et d’employer les moyens qui sont à la disposition de tout citoyen pour qu’on la laisse tranquille chez elle et à l’abri des visites importunes. Je la plains de tout mon cœur, mais je ne puis plus lui venir en aide. »
Ces derniers mots se rapportaient à un incident qui eut des conséquences ultérieures et qui avait eu lieu peu de jours avant la clôture de l’enquête ; il ne doit pas être passé sous silence, parce que, quatre ans plus tard, il servit de prétexte à des attaques dirigées contre Anne Catherine par la voie de la presse.
10. Le 16 juin, Rensing avait reçu par écrit l’avis suivant du vicaire général :
« Si la femme du préfet du département de R..., avec mademoiselle sa sœur et le professeur B..., de Munster, demandent à visiter la sœur Emmerich, veuillez les introduire auprès d’elle. Dites à la sœur Emmerich de ma part qu’elle consente par obéissance à laisser voir toutes ses plaies à ces personnes. Il est d’autant plus nécessaire de les faire voir toutes à M. le professeur qu’il est très défavorablement prévenu. »
Le soir du même jour, ces personnes arrivèrent à Dulmen. Elles se rendirent d’abord chez le docteur Krauthausen et se firent rendre compte par lui de ses observations sur Anne Catherine. Le professeur, plein d’assurance et de présomption, n’y voulut voir qu’ignorance et illusion, de même qu’avant d’avoir vu la patiente, il l’avait condamnée comme coupable d’imposture et avait déclaré que l’enquête était sans valeur.
Dans la matinée du 18 juin, Rensing conduisit les voyageurs chez Anne Catherine qui, par obéissance à l’ordre du vicaire général, consentit à l’inspection si pénible pour elle de ses plaies. M. le professeur ne trouva là que fourberie pure et simple. Les croûtes de sang desséché qui recouvraient les stigmates étaient, selon lui, (ainsi qu’il le répéta quatre ans plus tard dans une brochure), collées avec de l’amidon ; la croix de la poitrine lui parut si faiblement appliquée qu’elle disparut, dit-il, sous ses mains. Les plaies elles-mêmes avaient été faites avec des aiguilles et un canif ; le sang qui en découlait était « de la peinture ». Le savant homme fut surtout choqué de ce que du sang avait jailli sous la coiffe de la malade et coulé le long de son nez : c’était, selon lui, « une tentative par trop grossière pour le tromper, lui et sa science ». Anne Catherine elle-même était à ses yeux « une personne saine et robuste qui se trouvait à merveille de sa prétendue abstinence de nourriture ». Ainsi donc, pour ce professeur aux yeux de lynx, il n’y avait de vrai dans cette affaire que des instruments pointus, du blanc d’œuf, de l’amidon, des couleurs de teinturier et de l’eau de gomme : quelques années plus tard, il fit part de cette découverte au monde surpris. – Madame la préfète aussi pensa qu’il était facile de se faire de semblables blessures avec un canif et rattacha les extases au magnétisme qui avait tant d’importance à ses yeux qu’elle tourmenta Anne Catherine de questions sans fin sur la guerre et sur la paix, sur les choses cachées et les évènements à venir. La malade toutefois ne lui fit que cette brève réponse : « Ma paix intérieure est la seule chose dont j’aie souci. »
11. Le docteur Krauthausen et Rensing furent très blessés de semblables procédés, et ce dernier prit sur lui de refuser à ces personnes une nouvelle visite. Cela lui attira un reproche du vicaire général qui exprima son mécontentement en ces termes :
« En toute autre circonstance, il eût été injuste de permettre la répétition d’une pareille visite qui eût été très pénible pour la sœur Emmerich. Mais ici, avec des gens si disposés à croire qu’on veut, par une fraude pieuse, c’est-à-dire, pour parler clairement, par une grossière ignorance ou un charlatanisme diabolique, produire je ne sais quel effet, il faut éviter tout ce qui peut fournir un prétexte aux soupçons. Or, le refus d’une seconde visite est évidemment propre à fournir ce prétexte. »
Quelques années après, en effet, le professeur, dans des écrits imprimés, reprocha au doyen de ne lui avoir refusé une seconde visite « que parce que la croix de la poitrine, qui était à peu près effacée, n’avait pas encore été remise à neuf ».
Madame la préfète protesta devant Wesener « qu’il ne s’agissait pour elle que d’arriver à la pure vérité et de se tranquilliser elle-même, ainsi que d’autres personnes. » Et elle pria Wesener d’en appeler au jugement d’Anne Catherine sur la pureté de ses intentions. Lorsqu’il interrogea la malade à ce sujet, elle lui répondit :
« Dans cette société, madame la préfète était celle qui prenait la chose le plus au sérieux : mais pourtant elle n’est pas venue avec une intention tout à fait pure. Elle a la tête trop exaltée et elle est encore bien loin du véritable christianisme. Cette visite m’a fait beaucoup souffrir, et j’ai l’intime persuasion qu’il ne sert à rien de me tourmenter ainsi. »
12. De retour à Munster, le professeur répéta avec beaucoup d’aigreur que, dans son opinion, Anne Catherine était une trompeuse, si bien que le vicaire général eut la pensée d’accorder à cet homme des pleins-pouvoirs très étendus à l’égard d’Anne Catherine, dans l’espoir que des observations plus exactes et plus prolongées pourraient le forcer à rendre témoignage à la vérité, et à retirer ses calomnies. Quelque peu de cas qu’il fît personnellement du jugement de ce professeur dont il pénétra, dès le premier mot, la légèreté superficielle, il lui sembla que ce serait un triomphe pour l’innocence et pour la vérité que de mettre leur ennemi le plus acharné, par l’offre d’un nouvel examen, dans l’impossibilité de contester ou de nier l’état réel des choses.
B... lui ayant déclaré avec l’impudence qui le caractérisait qu’il était en mesure de guérir les plaies en très peu de temps, le vicaire général le prit au mot. Dans un appendice aux procès-verbaux de l’enquête, il s’exprime ainsi à ce sujet :
« Je désirais que l’expérience ne se fît que sur une seule main, parce que je prévoyais que la sœur Emmerich aurait à en souffrir beaucoup : mais tant de repos était nécessaire pour la guérison de cette main que la tentative n’était pas exécutable. »
« B... lui-même parut trouver cela vrai, et il raisonnait ainsi : « Si l’imposture existe sur un point, elle existe sur tous. » Il se déclarait convaincu qu’il n’y en avait pas moins quant à l’abstinence de nourriture qu’en ce qui concernait les stigmates, et que la tromperie serait mise au grand jour si Anne Catherine était transportée à Munster pour y être soumise à la surveillance de six médecins. Mais je m’y suis refusé. Je ne voulais pas, par mes mesures, donner crédit aux soupçons qu’inspire à plusieurs personnes l’entourage d’Anne Catherine, car je les crois tout à fait sans fondement. Cela m’eût semblé contraire à la justice et à la charité. »
13. Le plan de B. fut alors modifié, en ce sens que deux femmes de confiance devaient être choisies par lui à Munster et envoyées à Dulmen pour observer le plus soigneusement possible la sœur Emmerich, laquelle devait être transportée dans un autre logement, rester complètement séparée de son entourage actuel et ne recevoir de visites que de Rensing. Le vicaire général voulait aller lui-même à Dulmen pour faire tous les arrangements nécessaires.
Mais le préfet français vint à l’encontre de ce projet. Il ordonna au maire de Dulmen de s’opposer, en vertu de son autorité, à ce qu’on entreprît de nouveau de garder à vue la malade ; le gouvernement, disait-il, devait prendre sous sa protection un sujet qui avait été si longtemps soumis à une enquête rigoureuse et dont l’autorité ecclésiastique avait rendu un si bon témoignage au commissaire de police impérial. À cette déclaration était jointe la menace de faire diriger par l’autorité civile elle-même l’enquête future sur Anne Catherine et son entourage, s’il était constaté que l’enquête ecclésiastique n’avait conduit à aucun résultat satisfaisant. Cette menace décida le vicaire général à renoncer à son projet et à laisser là le professeur et ses rêveries.
14. Au premier coup d’œil, il semble incompréhensible que le vicaire général Droste ait pu donner une attention qu’elles méritaient si peu à ces indignes menées du professeur B... ; mais il nous donne l’explication de sa manière d’agir quand il dit : « Je désirerais moi-même que B. pût guérir les plaies. »
Les stigmates et les effusions de sang avaient été, dès le commencement, pour le vicaire général, une chose dont il eût bien voulu se débarrasser, même au prix de cruelles souffrances pour Anne Catherine, car à ses yeux c’était là seulement ce qui avait attiré l’attention du public sur une personne dont toute la manière d’être était si étrangère aux idées de l’époque et forcé l’autorité ecclésiastique à entreprendre une enquête qui, de quelque manière qu’elle aboutît, ne pouvait avoir pour ceux qui la feraient que des conséquences désagréables. Il aurait vivement désiré qu’on évitât ou qu’on laissât de côté tout ce qui pouvait devenir pour les innombrables ennemis de l’Église une occasion de nouvelles injures et de nouvelles attaques contre la sainte foi. C’est pourquoi le fait des stigmates, désormais impossible à cacher et qui semblait réveiller toute la rage des incroyants, était toujours resté à ses yeux une manifestation fâcheuse. Cette impression n’était pas encore affaiblie chez lui, alors même que ses propres observations faites avec le plus grand soin et les témoignages irrécusables d’autrui lui rendaient impossible la supposition d’une fraude. Dans le cours de l’enquête, la conviction chaque jour plus assurée de la piété sincère et de la haute perfection spirituelle d’Anne Catherine l’avait conduit à regarder les stigmates comme l’œuvre immédiate de Dieu ou du moins à étudier plus sérieusement et plus attentivement la nature et la signification de ces phénomènes dans leur rapport avec l’ensemble de la direction donnée à Anne Catherine et de la tâche qui lui était assignée ; cependant, sa raison froide, peu sympathique à toute espèce de mysticisme, reculait toujours avec une sorte de crainte devant un examen plus approfondi de ce mystère et s’en dispensait à l’aide de l’argument suivant :
« Je n’ai à rechercher qu’une seule chose : Anne Catherine trompe-t-elle ou est-elle trompée ? L’enquête a eu pour résultat de me convaincre que raisonnablement on ne peut voir là aucune imposture ; je n’ai donc rien de plus à rechercher. Ou les stigmates sont un phénomène naturel d’une espèce très rare sur lequel je n’ai pas de jugement à porter, ou ils ont une cause surnaturelle qu’il serait difficile de rendre évidente. »
Avec une telle manière de voir, on s’explique comment le vicaire général pouvait être plein du plus grand respect pour Anne Catherine, recommander instamment aux prières de la pieuse fille ses propres affaires et celles de l’Église, lui adresser les personnages les plus considérables appartenant au cercle très étendu de ses relations, et pourtant ne jamais renoncer au désir de la soustraire autant que possible aux regards et à l’attention du monde.
Il écrivit le 16 juillet à Rensing : « Je vous prie de saluer de ma part la sœur Emmerich, de lui recommander instamment une certaine intention et de lui dire que, si le comte et la comtesse de Stolberg viennent à Dulmen, tout doit leur être montré. »
Visite du comte Frédéric-Léopold de Stolberg.
L’illustre comte de Stolberg arriva à Dulmen avec sa femme, en compagnie d’Overberg, le 22 juillet (tout juste un mois après la visite du professeur B...) ; il y resta deux jours. Voici comment il raconte sa visite :
« Overberg nous annonça à Anne Catherine. À neuf heures du matin, il nous conduisit chez elle. Sa petite chambre n’a qu’une entrée et elle est sur la rue, en sorte que les passants peuvent voir dans l’intérieur et qu’on ne peut rien y faire qui ne puisse être vu de la rue. Elle est extrêmement propre : on ne sent pas la moindre mauvaise odeur dans cette petite pièce. C’est pour Anne Catherine une grande souffrance que de se montrer. Elle nous reçut de la manière la plus amicale. Overberg la pria en notre nom de retirer ses mains du linge sous lequel elle a coutume de les tenir cachées. C’était un vendredi. Les plaies de la couronne d’épines avaient saigné abondamment. Elle ôta sa coiffe. Le front et la tête étaient comme percés de grosses épines : on voyait distinctement les plaies vives, remplies encore en partie de sang frais, et tout le tour de la tête était ensanglanté. Jamais peintre n’a ainsi rendu au naturel les plaies faites au Sauveur par la couronne d’épines. Les plaies qui se trouvent au dos des mains et des pieds sont beaucoup plus grandes que celles de la surface intérieure ; les plaies des pieds sont plus larges que celles des mains. Toutes saignaient en même temps.
« Les médecins ont signalé ce qu’il y a là de merveilleux plus tôt et plus ouvertement que les ecclésiastiques, parce qu’ils ont des données certaines pour juger, d’après les règles de la science, le phénomène qui est sous leurs yeux. Ils disent qu’il est impossible de maintenir artificiellement de telles plaies dans le même état, de façon à ce qu’il n’y ait ni suppuration, ni inflammation, ni guérison. Ils disent aussi qu’on ne peut pas expliquer naturellement comment la malade, avec ces plaies incompréhensibles de leur nature et avec la cruelle douleur qui ne lui laisse aucun moment de relâche, ne tombe pas dans un dépérissement complet, comment elle ne pâlit même pas et comment son regard reste plein de vie, d’intelligence et d’amour.
« Depuis quelque temps, il dépend d’elle d’admettre ou de refuser les visites : elles lui sont très pénibles et sont déclinées le plus souvent, même quand il s’agit de gens qui viennent de loin. Ce n’est que sur les représentations de quelques ecclésiastiques ou du médecin, auxquels les étrangers s’adressent, qu’elle consent à faire des exceptions. Elle a assez à faire, dit-elle, de prier Dieu, afin qu’il lui conserve la patience dans ses souffrances continuelles ; c’est le tenter que de mettre cette patience à l’épreuve pour des personnes qui la plupart du temps viennent uniquement par curiosité. « Ceux qui ne croient pas à Jésus-Christ, dit-elle encore, ne deviendront pas croyants à cause de mes stigmates. » Cela ne doit pas étonner quand on pense combien il doit en coûter à une pauvre religieuse timide et délicate d’avoir à supporter l’invasion de curieux souvent peu discrets.
« Anne Catherine, qui a gardé les troupeaux pendant son enfance et qui s’est livrée à des travaux de toute espèce, parle d’une voix très douce ; elle s’exprime sur les choses de la religion dans un langage élevé qu’elle n’a pas pu apprendre au couvent, et elle le fait, non seulement avec convenance et discernement, mais avec un esprit éclairé de lumières supérieures. Son regard est plein d’intelligence ; son aimable affabilité, sa sagesse lumineuse et sa charité respirent dans tout ce qu’elle dit. Elle parle bas et sa voix est claire et limpide. Il n’y a rien d’exagéré dans ses manières ni dans ses paroles parce que l’amour n’est pas où l’on sent l’effort. Elle donne le spectacle de ce qu’il y a de plus sublime, l’amour de Dieu inspirant toutes les actions, les paroles et les sentiments, le support de tous, la charité envers le prochain quel qu’il soit.
« Combien nous sommes heureux de connaître Jésus-Christ, a-t-elle dit à Sophie ! Combien il était difficile aux païens, nos ancêtres, d’arriver à Dieu ! » Bien loin de s’enorgueillir des signes extérieurs de la faveur divine, elle s’en sent tout à fait indigne et porte avec une humble sollicitude le trésor du ciel dans un vase de terre fragile. »
Cette relation écrite sous forme épistolaire par l’illustre écrivain fut imprimée dans la suite avec des additions. Kellermann, le premier, en prit copie pour Michel Sailer, plus tard évêque de Ratisbonne, qui en donna connaissance à beaucoup de personnes. Elle tomba aussi entre les mains de Clément Brentano et ce fut là ce qui lui inspira d’abord le désir de connaître Anne Catherine. Stolberg resta jusqu’à sa mort, par l’intermédiaire d’Overberg, en union spirituelle avec la pieuse fille qui était pour lui l’objet d’une profonde vénération. Elle, de son côté, ne perdit jamais le souvenir de Stolberg qui la suivit souvent dans la sphère de ses contemplations. Il fut dès lors du nombre de ces personnes pour lesquelles elle offrait à Dieu d’une manière toute spéciale ses prières et ses souffrances et en faveur desquelles elle luttait afin qu’elles pussent remplir leur mission et recevoir de Dieu la couronne qui leur était réservée. Car elle s’était prise d’une vive affection pour cette grande âme, si richement douée, dont la beauté se montrait clairement à ses yeux. Personne sans doute ne regardera comme un pur effet du hasard que, si peu de temps après la clôture de l’enquête, un des hommes les plus éminents de cette époque ait été conduit dans le pauvre petit réduit de Dulmen pour rendre hautement témoignage à l’œuvre de la grâce divine.
Peu après la visite de Stolberg, la princesse Galitzin vint aussi plusieurs fois avec Overberg.
XXX
DERNIÈRE VISITE DU VICAIRE GÉNÉRAL DROSTE À DULMEN. – IL ESSAIE D’EMMENER ANNE CATHERINE À DARFELD.
1. Le vicaire général voyait toujours avec plaisir que des personnes haut placées et des hommes distingués par leurs lumières et l’indépendance de leur esprit demandassent à visiter Anne Catherine et à se renseigner sur son état. Il avait coutume de la préparer d’avance à leur arrivée, en lui exprimant le désir qu’elle leur permit de voir ses stigmates : car il espérait augmenter par là le nombre de ceux qui rendraient témoignage à la vérité et réduire peu à peu au silence la voix de la calomnie.
2. Ce fut dans cette louable intention que, quelques mois après la fin de l’enquête, il vint lui-même à Dulmen avec une nombreuse société de personnes appartenant à la noblesse, pour leur faire faire sur Anne Catherine des observations aussi circonstanciées que celles auxquelles lui-même s’était livré le 21 avril. On lit à ce sujet dans le journal de Wesener :
« Dans la soirée du jeudi 26 août, je rencontrai chez la malade le vicaire général de Droste et le professeur de Druffel. La malade était très soucieuse et le professeur Druffel désira savoir de moi dans quel état elle avait été jusqu’alors. Il trouvait la physionomie, les plaies, les signes et la manière d’être d’Anne Catherine comme à l’ordinaire. Le vendredi soir, je trouvai la malade dans un si triste état, le pouls si bas et si petit, qu’elle-même, ainsi que nous, s’attendait à une mort prochaine. Sa sœur et le père Limberg me dirent que le vicaire général, accompagné d’une suite nombreuse, l’avait fatiguée aujourd’hui toute la journée. On lui avait découvert plusieurs fois la poitrine et on avait lavé les plaies pour pouvoir mieux examiner les signes. »
3. Anne Catherine qui s’était soumise passivement à son supérieur ecclésiastique et avait supporté sans se plaindre une inspection excessivement pénible pour elle, était après cela tombée dans une faiblesse presque mortelle dont elle ne se remit que lentement. Wesener fut saisi d’une telle compassion pour la pauvre malade sans défense que, dans une lettre assez longue, il s’en plaignit vivement au vicaire général.
« Vous voulez, écrivit-il, examiner la chose à fond : c’est même votre devoir. Soit ; mais on n’examine pas ainsi. La pauvre malade a été martyrisée jusqu’à en mourir ! Vous êtes venu avec une suite de huit ou dix personnes et vous êtes resté avec elles près de la malade de huit heures du matin à six heures du soir. Il est à regretter que j’aie été appelé auprès de malades demeurant hors de la ville, car j’aurais pu vous dire à l’avance tout ce qui en résulterait. La malade n’aurait pas enduré ce supplice et je n’aurais pas eu la douleur de la trouver dans un état de faiblesse mortelle. Elle-même croyait, et elle en remerciait Dieu, que sa dernière heure était arrivée. Je ne m’expliquerais pas comment vous avez pu imposer ce supplice à la malade, si je ne me souvenais d’avoir entendu le docteur Druffel affirmer que des traitements de ce genre ne peuvent être nuisibles pour elle. Mais moi, je vous affirme, sur mon honneur, que ce qui s’est passé hier aurait coûté la vie à la malade, sans un miracle du Dieu tout-puissant. Si vous devez continuer l’enquête, la patiente vous laissera faire tout ce que vous voudrez ; mais, au nom de Dieu, que cela ne se fasse pas avec tant de bruit, ni aux dépens de sa santé certainement très précaire. »
4. Anne Catherine ne se remit que difficilement et lentement et, quand elle put de nouveau prononcer quelques paroles, elle s’expliqua ainsi devant son entourage :
« Je suis convaincue dans ma conscience que je ne dois plus me prêter à de telles visites, ni montrer les signes extérieurs. Cet avertissement m’a été donné en esprit. J’étais agenouillée en esprit dans une belle chapelle devant une image de Marie tenant l’enfant Jésus dans ses bras et j’invoquais la Mère de Dieu. Mais celle-ci descendit, m’embrassa et me dit : « Mon enfant ! prends garde à toi et ne va pas plus loin. Éloigne de toi les visites et conserve-toi dans l’humilité. »
5. La manière d’agir du vicaire général paraît moins rigoureuse si l’on considère de près les motifs qui le dirigeaient. Depuis la clôture de l’enquête, il méditait le projet de dérober Anne Catherine aux regards du monde et de lui assurer la possibilité matérielle d’accomplir sa tâche de souffrances dans une retraite où rien ne la troublerait. Après y avoir longtemps réfléchi, il avait fini par se décider à préparer pour Anne Catherine, dans un des biens seigneuriaux de sa famille, un asile où l’on pourvoirait à tous ses besoins de la manière la plus généreuse. Avant de faire le dernier pas, quelques membres de son illustre famille et quelques amis devaient se convaincre par eux-mêmes de la sincérité d’Anne Catherine et de la réalité de son état extraordinaire. Telle était la cause pour laquelle il était venu chez la malade avec cette nombreuse compagnie et l’avait soumise à cette longue inspection qui, à ce qu’il pensait, devait être la dernière, et dont il comptait la dédommager par son offre charitable et par des bienfaits de toute espèce. Personne à Dulmen ne devait avoir connaissance de ce projet, excepté le doyen Rensing, qui devait assister Anne Catherine de ses conseils dans le cas où elle demanderait à réfléchir quelque temps avant d’accepter cette bienveillante invitation. Si elle donnait son assentiment, il était chargé de l’accompagner immédiatement au château de Darfeld dans la voiture du vicaire général.
6. Quand le vicaire général fit cette offre à Anne Catherine, il lui imposa le silence le plus absolu à ce sujet envers son confesseur ordinaire comme envers tout son entourage. Le père Limberg ne devait en être informé qu’au moment du départ par un écrit cacheté que laisserait le vicaire général et qui lui intimerait en même temps la défense absolue de se mêler de cette affaire en aucune façon. Cette proposition mit Anne Catherine dans un état qui menaçait d’épuiser ce qui lui restait de force. Les plus grands et les seuls biens terrestres auxquels elle aspirât et qui lui semblaient ravis pour toujours, la solitude et le repos, se présentaient à elle comme assurés ; de plus son acceptation lui paraissait un devoir de déférence et de gratitude envers la première autorité ecclésiastique.
En outre, le doyen Rensing lui représentait que l’asile retiré de Darfeld pourrait seul la protéger contre tout projet de faire plus tard une nouvelle enquête. Mais où Anne Catherine trouvait-elle l’assurance qu’en acceptant cette offre généreuse, elle ne se rendait pas infidèle à Dieu ; qu’en cherchant une vie plus tranquille et plus commode, elle ne poursuivait pas une chose incompatible avec sa tâche ? Qui pouvait tranquilliser sa conscience, quant aux saints vœux de religion auxquels elle contrevenait peut-être en ne donnant pas la préférence à la position et au genre de vie qui amenaient à leur suite le plus d’ennuis et de privations ? Où était la garantie pour son cœur brûlant de charité, que, dans ce noble séjour, elle trouverait les mêmes occasions pour les œuvres de miséricorde que dans sa position actuelle, où sa porte était ouverte à toute heure pour quiconque avait besoin d’assistance ? D’un autre côté, si elle ne se rendait pas à l’invitation, cela n’attirerait-il pas sur elle le juste mécontentement du supérieur ecclésiastique ? Et ne se donnerait-elle pas l’apparence de l’ingratitude et du caprice ? Toutes ces pensées remplissaient Anne Catherine d’une grande tristesse et elle la ressentait d’autant plus douloureusement qu’elle était depuis longtemps accoutumée à ne rien faire sans l’ordre de ses supérieurs ou de son confesseur. Or non seulement il lui était rigoureusement défendu de rien communiquer au père Limberg, mais encore le vicaire général et le doyen Rensing s’abstenaient avec soin de lui dire une parole qui eût l’air d’un ordre ou d’une décision. L’acceptation de l’offre qui lui était faite devait être entièrement et uniquement l’œuvre de sa propre volonté et c’est pourquoi ils se gardaient de toute manifestation qu’Anne Catherine eût pu interpréter comme l’expression de la volonté de l’autorité ecclésiastique, agissant en cette qualité. Elle demanda du temps pour réfléchir, afin de consulter Dieu dans la prière, et au bout de quelques jours, elle mit le doyen en mesure d’écrire ainsi à Darfeld au vicaire général :
« La sœur Emmerich ne peut pas se résoudre au voyage de Darfeld. Elle se sent trop faible pour pouvoir l’entreprendre sans risquer sa vie. C’est pourquoi, n’étant pas tenue à ce voyage en vertu de l’ordre des supérieurs ecclésiastiques, elle craint de tenter Dieu en le faisant et de s’exposer à pécher par une confiance imprudente. De plus, elle est persuadée que son séjour à Darfeld près de la famille de messieurs de Droste, si considérée pour sa piété dans tout le pays de Munster, loin de faire cesser les accusations calomnieuses, en susciterait de nouvelles. Elle aurait donc le chagrin d’exposer cette noble famille à des désagréments et à des ennuis, parce que M. B... et ceux qui pensent comme lui se tairaient difficilement sur cette démarche, mais au contraire demanderaient d’autant plus instamment qu’elle fût traînée à Munster pour y être soumise à une nouvelle enquête. »
La faiblesse physique de la malade était très grande, car pendant tout le temps qui s’écoula du 1er au 10 septembre, on s’attendit plusieurs fois à la voir expirer. Le 2 septembre, le père Limberg la crut déjà morte, et récita près d’elle les prières pour les morts : mais quand il l’aspergea d’eau bénite, un rayon de son amabilité accoutumée passa sur son pâle visage et peu à peu elle revint à elle.
7. Le vicaire général ne put s’empêcher de reconnaître la valeur des raisons qui motivaient le refus d’Anne Catherine. Quoiqu’il vît avec peine avorter un plan au moyen duquel il avait espéré fermer la bouche à ceux qui mettaient son enquête en suspicion, et faire tomber les calomnies des incrédules et des ennemis de l’Église, il trouva pourtant dans la réponse négative d’Anne Catherine une nouvelle preuve de la pureté de ses intentions et de la haute perfection de sa vertu : aussi sa sympathie affectueuse et sa haute estime pour elle n’en souffrirent-elles aucune diminution. Il conserva avec elle des relations constantes par l’intermédiaire de Rensing et surtout d’Overberg qui, jusqu’à la mort d’Anne Catherine, resta toujours en commerce spirituel avec elle et lui fit des visites aussi fréquentes que le lui permirent ses occupations et l’état de sa santé. Clément Auguste lui envoyait de temps en temps ses salutations et recommandait à ses prières lui-même et ses intentions.
Un an après l’enquête, le vicaire général ayant appris par Clara Soentgen qu’on regardait la mort de la sœur Emmerich comme imminente, écrivit en ces termes à Rensing :
« Je voudrais savoir si vous regardez la fin de la sœur Emmerich comme aussi prochaine que le croient d’autres personnes, et je vous prierais de m’envoyer un messager si vous regardiez comme très probable qu’elle approche de son dernier moment, ou si la mort survenait inopinément. Je serais bien aise d’avoir une notice sommaire sur ce qui s’est passé de remarquable depuis le mois d’août 1813. Veuillez saluer la sœur Emmerich de ma part. »
8. Rensing répondit :
« Je ne remarque pas encore en elle de signes inaccoutumés annonçant une mort prochaine : mais elle-même assure que son état intérieur semble indiquer que le terme n’est plus très éloigné. Si Dieu daignait lui faire une révélation touchant sa mort et si elle me disait à ce sujet quelque chose de précis, j’aurais l’honneur de vous en donner avis aussitôt. Son corps présente toujours les mêmes phénomènes qu’il y a un an. Le sang continue à couler les vendredis comme alors et, depuis le mois d’août de l’année précédente jusqu’à ce jour (15 mars 1814), il ne s’est rien passé extérieurement qui mérite d’être noté. Mais quant à l’état de son âme, elle a gagné à plusieurs égards, car elle s’est défaite de diverses imperfections auxquelles elle se laissait aller facilement autrefois et unit encore davantage sa volonté à celle de Dieu. Ce qu’elle me raconte des objets qui occupent son esprit dans l’extase est souvent si élevé que j’en suis dans l’admiration, et il y a en même temps une simplicité si naïve qu’on n’y peut soupçonner aucune arrière-pensée, aucun dessein préconçu. En supposant même qu’il n’y ait pas là d’intervention d’un ordre supérieur, c’est dans l’ensemble la plus belle manifestation d’une âme pure comme les anges, absorbée en Dieu et qui n’est occupée que de la gloire de Dieu et du salut des hommes. »
9. Deux mois plus tard Rensing envoyait un nouveau rapport. « La sœur Emmerich se trouve un peu mieux, disait-il. Peut-être va-t-elle se remettre pour quelques jours. Comme son existence est depuis longtemps déjà en désaccord complet avec les lois ordinaires de la nature, il ne faut pas augurer sa un prochaine parce qu’on voit des symptômes qui sembleraient l’annoncer. Hier, étant dans un état de faiblesse extrême, elle m’a dit qu’elle espérait qu’avant sa mort, Dieu lui donnerait encore assez de force pour me révéler, ainsi qu’à quelques autres personnes, des choses qu’elle ne veut pas garder pour elle seule. Comme sa faiblesse était excessive, elle parlait très bas et il me fallait beaucoup d’efforts pour comprendre ce qu’elle disait. »
10. Ce rapport décida le vicaire général à rendre l’ordonnance suivante pour le cas où Anne Catherine viendrait à mourir.
« Si la religieuse augustine Anne Catherine Emmerich vient à s’endormir dans le Seigneur, M. le doyen Rensing devra dès qu’il en aura été informé :
1. M’en prévenir par un exprès aussitôt que possible, en quelque lieu que je me trouve, et venir lui-même, s’il le peut : sinon, prendre les dispositions suivantes :
2. Jusqu’à mon arrivée ou jusqu’à ce qu’il ait reçu de nouvelles instructions, il devra faire en sorte :
(a) Qu’une ou plusieurs personnes du sexe, bien connues de lui, veillent nuit et jour près du corps (je pourvoirai aux dépenses qui seront nécessaires) ;
(b) Qu’aucune autre personne ne reste près du corps et que l’autorisation de le voir ne soit donnée que le plus rarement possible : si de telle visites devaient devenir trop fréquentes, M. le bourgmestre voudrait bien prêter la main pour l’empêcher ;
(c) Que, jusqu’à mon arrivée ou jusqu’à l’envoi de nouvelles instructions, le corps reste absolument intact en sorte que personne ne puisse l’examiner le moins du monde, soit dans l’ensemble, soit aux places marquées par les stigmates.
3. Monsieur le doyen prendra ses mesures pour que la mort lui soit annoncée aussitôt qu’elle aura eu lieu : il priera immédiatement M. le bourgmestre de se transporter avec lui près du corps de la sœur Emmerich, non en qualité d’autorité civile, mais officieusement. Il adressera la même invitation à MM. Limberg et Lambert et aux docteurs en médecine Wesener et Krauthausen ; puis, en présence de ces messieurs, on dressera un procès-verbal signé d’eux tous où soient consignés brièvement :
(a) Le genre et l’heure de la mort ainsi que les circonstances notables, s’il s’en est présenté ;
(b) L’état du corps et des diverses marques existant aux mains et aux pieds comme au côté, à la tête, et aussi à la poitrine.
N. B. Il ne doit y avoir aucun intervalle entre l’invitation et la réunion auprès du corps ; ces messieurs ne doivent pas y aller ensemble, afin d’éviter l’éclat autant que possible, et il ne doit y avoir là que les personnes nommées plus haut.
4. Ensuite M. le doyen devra prier MM. Limberg et Lambert et les deux médecins de ne pas s’éloigner de Dulmen, s’il est possible, jusqu’à ce que je sois arrivé et que je me sois entendu avec eux.
5. Je réglerai le reste en son temps.
CLÉMENT AUGUSTE DE DROSTE VISCHERING.
Munster, le 26 mai 1844.
XXXI
SITUATION EXTÉRIEURE ET MANIÈRE DE VIVRE D’ANNE CATHERINE APRÈS L’ENQUÊTE. – SON ENTOURAGE : L’ABBÉ LAMBERT, LE PÈRE LIMBERG ET SA SŒUR GERTRUDE.
1. Pour apprécier plus complètement les dernières années de la vie d’Anne Catherine, il faut, avant tout, se bien rendre compte de ses relations avec le dehors telles qu’elles s’établirent après la clôture de l’enquête ecclésiastique. Sans cette connaissance, nous ne pourrions pas comprendre une vie dans laquelle les incidents qui semblent le plus insignifiants sont évidemment disposés par Dieu même pour des fins d’une haute importance. De même que dans la conduite de l’Église tout entière par la divine Providence, il n’y a rien de fortuit, quoique beaucoup d’évènements paraissent petits et sans importance à l’œil débile de l’homme parce qu’il n’est pas en état de voir l’effet dans la cause et réciproquement ; de même la signification des diverses circonstances de la vie d’Anne Catherine et de toutes les personnes gratifiées de privilèges semblables se trouve dans leur rapport avec la tâche assignée par Dieu à ces personnes. Les plus petites choses y sont donc d’une importance réelle, quoique notre regard qui se laisse prendre à l’apparence extérieure n’y voie rien que d’insignifiant. C’était parmi les incidents vulgaires de la vie de tous les jours qu’Anne Catherine devait atteindre à la sainteté et s’acquitter de sa tâche. Elle était appelée à travailler pour l’Église ou pour les chrétiens de son temps plongés dans la détresse et les tribulations, c’est pourquoi sa vie extérieure devait être ordonnée de la manière qui était, devant Dieu, la plus appropriée à l’accomplissement de cette mission. Sa position ne fut donc jamais pour elle une affaire de libre choix, mais un acte de soumission fidèle à la direction divine et par là même une source intarissable de vertus et de mérites. Les personnes avec lesquelles elle se trouvait en contact direct ou qui exerçaient une influence sur sa vie n’avaient pas été choisies par elle, mais avaient été amenées près d’elle par des causes étrangères à toute prévision et à tout calcul humain.
Ce qui doit attirer d’abord notre attention, c’est l’effet produit sur toute l’économie de sa vie par ses stigmates dont l’enquête ecclésiastique avait établi le caractère surnaturel et divin. Tant qu’elle avait vécu dans le cloître, elle avait eu le bonheur de cacher les effusions de sang produites par la couronne d’épines à la curiosité soupçonneuse de ses compagnes, parce qu’il n’était pas dans les vues de Dieu de rendre dès lors le monde témoin de ses voies mystérieuses. C’est pourquoi, dans les années précédentes, il avait mis sur elle les douleurs, mais non les signes extérieurs et visibles des plaies du Sauveur, et il fallait toute son humilité pour les endurer comme d’autres souffrances corporelles, sans y soupçonner des rapports avec quelque chose de plus élevé, bien que ces douleurs fussent si terribles et si continues que personne n’eut pu les supporter un instant sans une assistance extraordinaire et directe de la toute puissance divine. Mais, grâce à cette assistance, son corps avait si bien pris la nature de la vigne que, comme le cep autour de l’échalas, il commença à s’adapter de lui-même à la forme de la croix. Était-elle assise ou couchée dans son lit, ses pieds se croisaient involontairement l’un sur l’autre aussi fortement que les pieds d’un crucifix. C’est pourquoi, à une époque postérieure, lorsqu’elle était rappelée subitement par son confesseur de l’état d’extase à l’état de veille naturel, elle s’écriait naïvement et d’une voix suppliante : « Ah ! je ne puis pas ! je ne puis pas ! Déliez-moi ! je suis clouée », parce qu’elle ne pouvait pas reprendre aussi vite qu’elle l’eût voulu pour obéir à l’appel, la position d’une personne qui se relève. Elle avait aussi senti les paumes de ses deux mains percées de part en part pendant que les deux doigts du milieu, comme paralysés et morts, se montraient au-dessus des autres dans une position qui ne leur était pas naturelle, si bien qu’il lui avait fallu avec des douleurs incroyables rapprendre à se servir de ses mains. Mais à peine est-elle sortie de l’obscurité de sa cellule et jetée dans un monde si étranger pour elle que les signes extérieurs se manifestent. La pauvre religieuse malade n’avait-elle pas dû espérer, à juste titre, que son expulsion du couvent et sa rentrée dans ce monde auquel elle avait eu tant de peine à se soustraire, seraient enfin le point culminant de sa voie de souffrance ? Qui pouvait désormais se soucier d’elle, la troubler au sein de sa misère et de son abandon, elle dont le seul désir était de souffrir pour les autres dans le silence et l’obscurité ? N’était-ce pas un assez lourd fardeau à supporter pour elle que d’être obligée de renoncer à son habitation dans la maison de Dieu, d’être privée de l’unique consolation que la terre pût encore lui donner ? Et pourtant elle n’est qu’au début d’une vie dont l’austérité et la sublimité laisseront bien loin derrière elles tout ce qu’elle a enduré jusque-là.
2. Le seul désir terrestre qui eût persisté dans son cœur depuis son expulsion du couvent était de pouvoir rendre les offices d’une fidèle servante, tant qu’il vivrait, au vénérable prêtre qui avait été son plus grand bienfaiteur et l’unique appui humain qu’elle eût jamais rencontré, et qui était resté avec elle à Agnetenberg jusqu’à ce que l’un et l’autre eussent pu trouver un misérable logement dans la maison de la veuve Roters. Elle honorait dans ce vieillard infirme non seulement l’ami et le protecteur sacerdotal, mais encore plus le pieux confesseur de la foi que sa fidélité à l’Église avait condamné à la pauvreté et à l’exil. Lorsqu’étant devenue l’objet de l’animadversion générale, elle avait à recevoir tous les jours de nouvelles blessures dans ce couvent qu’elle aimait d’ailleurs si tendrement, l’abbé Lambert avait été la seule personne près de laquelle elle pût trouver un refuge, à laquelle elle pût révéler ses souffrances. Quand il venait de grand matin à la sacristie pour sa préparation à la sainte messe, elle lui communiquait les avertissements reçus en vision pendant la nuit sur les souffrances qui l’attendaient durant la journée ; elle s’était recommandée à ses prières et avait reçu de lui des paroles d’encouragement et de consolation pour lesquelles elle conservait une reconnaissance infinie. C’était, après tout, ce qu’elle avait jamais reçu de plus précieux de la part d’une créature humaine ; bien plus, une consolation que son ange lui-même ne pouvait lui donner : car elle avait un cœur qui battait et sentait à la manière humaine, pour lequel, comme pour celui du reste des mortels, des paroles parties d’un autre cœur qui la comprenait et partageait ses sentiments étaient un soulagement et un besoin. Elle n’était pas un pur esprit ; elle portait le poids des souffrances qui faisaient de sa vie un martyre continuel dans un cœur singulièrement énergique, mais tendre et sensible comme celui d’un enfant. La pauvre nonne avait reçu jusqu’à des aumônes du pauvre prêtre ; car il n’ignorait pas qu’elle remettait ordinairement à la supérieure l’argent gagné par son travail manuel sans que pour cela il fût pourvu à ses besoins si peu nombreux. Tant qu’elle fut encore en état de prendre quelque nourriture, cet homme charitable lui portait de temps en temps un peu de pain meilleur que celui qu’elle pouvait trouver au couvent. Elle avait la permission de l’accepter et se trouvait heureuse de ce que la main de ce même prêtre, auquel elle était redevable de la réception plus fréquente de la sainte eucharistie, lui dispensait aussi le pain ordinaire pour l’entretien de sa vie terrestre.
Or l’espoir qu’elle avait eu de reconnaître ces bienfaits par des soins fidèles et assidus ne s’était pas réalisé ; car elle s’était bientôt trouvée hors d’état de se tenir sur ses jambes et elle était si souvent ravie en extase sans pouvoir s’en empêcher qu’il lui fallait avoir recours à l’assistance d’autrui pour ses arrangements domestiques. L’abbé Lambert l’avait souvent trouvée agenouillée dans sa chambre, raide et immobile comme une statue et en apparence sans vie. Cet état lui était connu dès le temps du couvent, mais il n’osait pas l’en retirer par un commandement sacerdotal, et ainsi les extases étaient devenues tous les jours plus longues et plus fréquentes. Son unique souci était qu’elles n’arrivassent pas à la connaissance du public, et pour maintenir Anne Catherine dans l’humilité et ne pas attirer son attention sur une chose extraordinaire qui ne se présente que dans la vie des saints, il n’en avait jamais parlé avec elle et se refusait à toute communication de sa part sur ce sujet, lui disant : « Ma sœur ! ce n’est rien ! ce n’est rien ! ce ne sont que des rêves. » Son plus vif désir était de la maintenir dans une heureuse ignorance sur ce que signifiait cet état et de le cacher au monde entier : car avec les infirmités corporelles dont il était atteint, il aspirait au repos et souhaitait que ses derniers jours sur la terre étrangère ne fussent pas troublés par de nouveaux ennuis. Quoiqu’il dit été atterré à la première vue des stigmates saignants, il s’était consolé par la ferme confiance qu’ils disparaîtraient peut-être du matin au soir ou qu’au moins ils resteraient cachés. Mais combien promptement, combien tristement le pauvre vieillard fut désabusé ! et quelle douleur pour Anne Catherine d’avoir à soutenir le courage de son vieil ami, tandis qu’elle-même avait tant à lutter pour rester mai tresse d’elle-même et ne pas se laisser complètement abattre !
3. Aucun des évènements de sa vie n’avait été plus mal accueilli et ne s’était imposé plus violemment à elle que l’apparition des signes merveilleux par lesquels Dieu voulait montrer, en face d’une époque sans foi, avec quelle jalousie poussée à l’extrême il se réservait ses droits sur Anne Catherine comme sur son œuvre et sa propriété. De même que le corps de Lidwine détruit par les vers et la pourriture lui avait servi, plus de trente ans, comme instrument destiné à expier vis-à-vis de lui les attentats des contemporains contre l’Église et à montrer, par là, à ceux-ci combien ils étaient coupables, de même maintenant la vierge de Dulmen doit porter sur elle avec leurs douleurs les blessures par lesquelles le Sauveur a voulu verser le sang dont il nous a rachetés. Lidwine aussi en avait reçu l’empreinte ; mais l’impression terrifiante que faisaient ses autres souffrances expiatoires sur ceux qui en étaient les témoins effaçait jusqu’à un certain point celle des stigmates. Chez Anne Catherine, ce sont eux qui font qu’elle est arrachée à l’obscurité pour être livrée aux regards du public : car son époque, si pleine de mollesse, si facile au dégoût, n’aurait pu supporter le spectacle d’un martyre semblable à celui de Lidwine.
Les plaies agirent de l’extérieur à l’intérieur et elles eurent pour effet que toute la circulation naturelle du sang parut changée. Chaque plaie devint comme le centre d’une sphère à part dans laquelle les courants, semblables à des rayons, allaient vers ce centre et en revenaient. Même les pulsations semblaient changées de place ou doublées, car elles étaient aussi sensibles au bout des doigts qu’aux poignets. Les mains étaient percées de part en part en allant des surfaces intérieures aux supérieures, pendant qu’aux pieds les blessures, partant des coude-pieds, traversaient la plante. La plaie du côté allait en montant comme si elle eût été faite par un coup porté de bas en haut. Ces directions des plaies étaient pour Anne Catherine une cause de douleurs indicibles, lorsqu’elles s’ouvraient assez largement pour que l’air passât au travers, et le cas n’était pas rare. Après avoir persisté pendant des années, elles étaient encore aussi nettes, aussi fraîches et aussi cuisantes que le premier jour, en sorte que le plus léger souffle d’air agissait sur elles comme une flamme ou comme un fer acéré et que la patiente était obligée d’envelopper ses mains de bandages moelleux pour se procurer un peu de soulagement en les garantissant du contact de l’air. Mais jamais on n’y pouvait découvrir l’ombre de suppuration, tandis que la plus petite lésion naturelle avait immédiatement ce résultat pour la malade.
Wesener rapporte ce qui suit, à la date du vendredi 8 septembre 1815 :
« J’ai trouvé la malade très affaiblie, mais pourtant de bonne humeur. Les stigmates des mains et des pieds saignaient : sur le dos des mains, les bords des plaies, lesquelles étaient de forme circulaire et avaient la largeur d’une pièce de deux gros, étaient un peu relevés, mais sans inflammation. Une chose qui me sembla bien remarquable, quoique peut-être ayant peu d’importance aux yeux de ceux qui ne sont pas du métier, ce fut une petite écorchure de la peau à l’articulation inférieure de l’index de la main droite. Cette écorchure s’était enflammée et un liquide purulent s’était déjà amassé sous l’épiderme en trois endroits. Je demandai à la malade si elle s’était égratignée avec une aiguille, sur quoi elle me raconta qu’hier, en essuyant son verre à boire, elle en avait brisé le bord et s’était fait ainsi cette écorchure au doigt. Elle m’assura aussi qu’elle avait toujours eu la peau facilement inflammable et portée à la suppuration. Que ceux qui ont des connaissances médicales rapprochent ce fait de l’état où se maintiennent les stigmates. »
Wesener trouvait là avec raison une preuve très claire du caractère surnaturel des plaies. Il y en avait une autre dans cette règle sans exception que les effusions de sang étaient liées à des jours déterminés et à des fêtes de l’année ecclésiastique, puisqu’elles se produisaient non seulement les vendredis, par conséquent à des intervalles fixes et revenant périodiquement, mais aussi les jours des fêtes de la Passion qui changent chaque année ; et cela était si indépendant de la disposition personnelle de la patiente que souvent elle n’avait connaissance de l’approche ou du commencement d’une de ces fêtes de l’Église que par un redoublement de douleur dans ses plaies. Ainsi le jour du marché annuel de Dulmen étant tombé un vendredi, cela fut cause qu’Anne Catherine fut importunée ce jour-là par des visites sans fin ; elle en fut très fatiguée et, voyant un grand nombre de paysans vêtus de leurs habits du dimanche, elle crut que c’était un jour de fête. Vers trois heures de l’après midi, elle pâlit tout à coup et le sang coula en quatre endroits de dessous son bonnet sur son visage, ce qui lui parut à elle-même tout à fait inexplicable jusqu’à ce qu’on lui eût fait remarquer que ce n’était pas un dimanche, mais un vendredi.
4. Le sang coulait toujours de la tête et des mains dans la direction de celui qui avait coulé des saintes plaies du Fils de Dieu attaché à la croix pour nous. Ainsi, de la paume des mains, il revenait vers l’intérieur de l’avant-bras, du dos des pieds vers les orteils, du front et des tempes en avant et en arrière, et ensuite sur le visage et l’os du nez, même quand il lui était impossible de relever la tête. Nous avons vu combien le professeur de chimie de Munster s’était récrié sur ce sang qui coulait contrairement aux lois de l’équilibre et en avait conclu qu’il n’y avait là que de la peinture. Clément Brentano qui, des années après, put observer à diverses reprises l’effusion de sang produite par la couronne d’épines a rendu à ce sujet le témoignage suivant :
« L’écoulement du sang, comme on peut le penser, n’était visible qu’à la partie supérieure de son front très élevé, là où il était dégarni de cheveux. On voyait là le sang sortir de plusieurs points comme des gouttes de sueur, sans qu’on pût apercevoir de plaies ou d’autres lésions, mais, quand le sang s’était desséché aux endroits où avait eu lieu cette espèce de transpiration et les avait colorés, l’observateur distinguait de petits points rouges comme des piqûres d’aiguille auxquels Wesener et Druffel donnaient un nom particulier. La quantité de sang qui coulait de sa tête était tantôt plus forte, tantôt plus faible, et il en était de même pour les autres effusions de sang ; il semblait aussi quelquefois que certaines plaies saignassent plus abondamment alors que cela arrivait pour d’autres dans une plus faible proportion. »
Ce dernier détail est confirmé par Wesener dans son rapport à la date du vendredi 3 juin 1814.
« L’effusion de sang avait commencé aujourd’hui à midi et elle a duré jusque vers quatre heures. Il avait coulé du front et des tempes en telle quantité que cela avait produit chez la malade une pâleur effrayante et une grande prostration. Les personnes de son entourage en furent si inquiètes qu’elles cherchèrent à arrêter le sang avec des compresses de vinaigre. »
Et le vendredi, 29 septembre 1815 :
« La malade a reçu cette après-midi la visite de la princesse Galitzin, venue de Munster, laquelle s’est entretenue assez longtemps avec elle. L’abbé Lambert et Clara Soentgen se trouvaient aussi dans la chambre. Quand la princesse se fut retirée, la malade poussa un soupir arraché par la souffrance, et aussitôt Clara Soentgen, s’étant approchée pour l’assister, vit un sang clair et limpide jaillir de trois petites ouvertures sur l’os du front en sorte qu’elle fut obligée de le recueillir dans un linge plié. Les autres plaies commencèrent aussi à saigner, mais non aussi abondamment que la tête et le front. Il y a une circonstance que je ne dois pas omettre : c’est l’exclamation de M. Lambert. Quand il vit la malade saigner si fort, il se mit à pleurer et dit à Clara Soentgen : Ma sœur ! vous voyez bien que ce n’est pas moi qui fais cela ! »
Le vendredi, 9 février 1821, à neuf heures du matin, pendant l’enterrement de l’abbé Lambert, Clément Brentano remarqua également une abondante effusion de sang et l’ayant notée dans son journal, il ajouta la description suivante :
« Anne Catherine a le front très élevé et une chevelure abondante d’un brun foncé. Ses tempes sont très découvertes. Ses cheveux, quoiqu’en réalité fins et délicats, paraissent épais parce qu’on les coupe souvent très court et qu’ils sont constamment pressés par une coiffe très juste. Des maux de tête continuels les ont rendus d’une sensibilité incroyable au point qu’on ne peut les peigner sans qu’il en résulte une très vive douleur. Aussi ce n’est qu’en cas de nécessité absolue qu’elle les laisse couper court : mais, sur ce point aussi, la pauvre patiente avait perdu sa liberté à certains égards pendant les premières années, lorsque ses stigmates furent devenus de notoriété publique. Toujours épiée et soupçonnée, elle ne pouvait que difficilement tenir sa porte fermée pendant le temps nécessaire pour couper ses cheveux ou simplement pour les mettre en ordre, car autrement une personne qu’on aurait fait attendre en aurait facilement propagé le soupçon qu’il s’agissait de faciliter ou de cacher une fraude. Ces circonstances impérieuses rendaient difficile de lui donner même les soins les plus nécessaires ; quiconque lui rendait un petit service charitable s’en acquittait avec une inquiétude et une précipitation qui en faisaient parfois quelque chose de plus nuisible qu’utile. Elle-même éprouvait une certaine crainte révérencielle en présence de son corps marqué de signes si merveilleux. Mais Dieu qui, dans ses premières années, lui avait rendu faciles des travaux manuels de toute espèce, lui a de même donné maintenant une aptitude surprenante à faire avec une promptitude extrême, même dans l’état de contemplation, sur sa personne comme autour d’elle, tout ce qu’exigent la propreté et la décence, en sorte que, sur son pauvre et misérable lit de douleur, on l’a toujours vue aussi propre et aussi bien arrangée que peut l’être dans son couvent la religieuse la plus soigneuse et la plus entendue. Mais tout cela présentait de grandes difficultés pour une personne qui, pendant plusieurs années, avait eu une telle faiblesse dans la colonne vertébrale qu’elle ne pouvait rester dans son lit sur son séant, au point que sa tête tombait sur ses genoux ; qui souvent pouvait à peine remuer ses mains blessées et ses doigts du milieu paralysés, et qui cependant, à cause de ses sueurs continuelles, incroyablement abondantes et souvent froides comme la glace, était obligée de changer de linge plusieurs fois le jour. Pourtant jamais personne, à quelque heure que ce fût, n’est entré chez elle sans la trouver habillée avec un soin et une propreté qui faisaient plaisir à voir. Je l’ai vue pendant quatre ans à toutes les heures du jour, et j’ai toujours observé dans tout ce qui se rapportait à son intérieur et à son extérieur une propreté qui faisait penser involontairement à ce dont elle était l’image, l’innocence, la chasteté et la pureté de cœur. »
Un seul fait suffira pour montrer avec quelle parcimonie lui était mesurée l’assistance de son entourage. Pendant les jours chauds de l’été, quand elle était en prière et à l’état d’extase, des essaims de mouches venaient quelquefois se poser sur ses plaies et les piquer jusqu’à les faire saigner. Nous ne saurions rien de cet abandon si Wesener ne l’avait trouvée une fois dans cet état sans que personne vînt à son secours. Nous sommes redevables au même Wesener de la connaissance de ce phénomène remarquable que, lorsqu’elle avait à endurer des souffrances expiatoires, notamment pendant les jours de l’octave de la Fête-Dieu, on voyait sur elle les plaies de la flagellation. Elles étaient toujours accompagnées de violents frissons de fièvre et avaient exactement la forme des marques que peuvent laisser sur la peau de forts coups de fouet.
5. Mais ce qui réclame notre attention à un degré incomparablement plus grand que tous ces phénomènes merveilleux et les souffrances physiques qui y étaient liées, c’est la manière dont Anne Catherine les supportait. Tout cela était pour elle un fardeau d’une pesanteur inconcevable, la cause de tortures continuelles de toute espèce, un objet de craintes et d’inquiétudes constantes et, jusqu’à la fin de sa vie, une occasion sans cesse renaissante des plus profondes et des plus pénibles humiliations. Mais la grâce de Dieu lui donnait la faculté de les porter, non comme une chose qui lui appartînt en propre ou comme une distinction particulière, mais comme l’œuvre pure du Fils de Dieu, son fiancé céleste qui, personnellement et immédiatement, avait ainsi marqué son corps de cette empreinte afin qu’elle continuât à accomplir sa tâche, si grandement aggravée par là, au milieu de circonstances qui devaient la faire arriver à la plus parfaite conformité avec la vie de pauvreté de ce même Sauveur. Le mystère de la rédemption, le prix de notre salut, le sang infiniment précieux de l’agneau de Dieu dont l’effusion a expié nos péchés et nous a conquis la qualité d’enfants de Dieu avaient disparu, pour ainsi dire, de la mémoire et de l’esprit des hommes de cette époque et on en tenait peut-être moins de compte qu’on ne l’avait jamais fait à aucune époque antérieure. Ce n’était pas seulement pour les incrédules et les ennemis de Dieu qui combattaient la sainte Église avec toutes les armes de la violence et de la ruse que la croix était une folie et un scandale, mais, même à ne considérer que les hommes qui ne voulaient pas renier la foi en Jésus-Christ, on était effrayé du petit nombre de ceux qui comprenaient encore le témoignage du prince des apôtres : « Scientes quod non corruptibilibus auro vel argento redempti estis, sed pretioso, sanguine quasi agni immaculati Christi 24. » C’était le temps où dans les chaires des professeurs comme dans celles des prédicateurs, on gardait le silence sur la croix, sur le sacrifice et la satisfaction, sur le mérite et le péché, où les faits, les miracles et les mystères de l’histoire de notre rédemption devaient céder la place à de creuses « théories de la révélation », où l’homme-Dieu, pour être supporté, ne devait plus être présenté que comme « l’ami des hommes, des enfants des pécheurs », où sa vie n’avait de valeur que comme « enseignement », sa Passion comme « exemple de vertu », sa mort comme « charité » sans objet ; où l’on enlevait au peuple croyant l’ancien catéchisme qu’on remplaçait par des « histoires bibliques » où le manque total de doctrine devait être voilé sous « un langage naïf et à la portée de toutes les intelligences » ; où les fidèles étaient forcés d’échanger leurs livres de piété, leurs vieilles formules de prière et leurs anciens cantiques contre des productions de fabrique moderne aussi mauvaises et aussi impies que celles par lesquelles on cherchait à remplacer le missel, le bréviaire et le rituel.
6. Nous sommes trop facilement portés à ne voir dans cet aplatissement intellectuel qu’une aberration passagère ou une fausse direction de l’esprit de l’époque ; mais, devant Dieu, il y avait plus que cela. C’était une atteinte portée à la foi, mettant en péril le salut éternel d’un nombre infini d’âmes, un mépris tellement coupable de son amour et de sa justice qu’il voulait le faire expier par les tortures de l’innocente pénitente, et c’est pourquoi il disposait les choses pour qu’elle ne fût pas autrement traitée par les hommes de cette époque que lui-même et l’œuvre sainte de la rédemption. L’effrayante majesté du sacrifice sanglant de Jésus-Christ et la rigueur avec laquelle il a satisfait pour nos péchés sont pour tous une pierre d’achoppement ; il en est ainsi pour elle à cause des signes dont elle est marquée ; elle est même, pour ses plus fidèles amis, un fardeau dont le poids retombe doublement sur elle. L’abbé Lambert et son confesseur désirent ardemment voir disparaître ces signes dont la présence malencontreuse leur ôte le repos et la paix ; le pasteur de la paroisse dans laquelle elle vit se retire d’elle avec un sentiment d’irritation dès qu’il croit sa réputation compromise à cause d’elle : la première autorité ecclésiastique du diocèse la soumet comme une trompeuse à l’enquête la plus sévère et lui fait subir toutes les tortures imaginables, afin d’épargner au monde le spectacle insupportable pour lui de ces plaies. Puis, comme on n’y peut pas réussir, elle est abandonnée sans secours et sans défense, livrée en proie à la curiosité importune, aux soupçons et même aux plus cruelles persécutions 25. Et les supplications qu’elle-même adresse au ciel ne sont pas exaucées : ses ardentes prières, qui attirent d’en haut sur une foule d’autres des torrents de bénédictions, n’obtiennent rien quand elle crie vers Dieu pour que les stigmates lui soient retirés. « Ma grâce te suffit » lui répond le Seigneur et les stigmates restent ; car, suivant les belles paroles de Clément Brentano :
« Elle est envoyée dans le désert de l’incrédulité contemporaine, avec les empreintes du sceau de l’amour crucifié, pour rendre témoignage à la vérité de cet amour. Quelle lourde tâche que de porter sur son corps, aux yeux du monde et des courtisans du prince du monde, les insignes de la victoire du fils du Dieu vivant, Jésus de Nazareth, roi des juifs ! Il y faut un grand courage et une assistance toute particulière de la grâce divine ; car il s’agit d’être un objet de scandale, de suspicion et de doute pour la plupart, et malheureusement une énigme pour tous ; de rester exposée sur la croix, au centre du carrefour où se croisent les voies suivies par l’incroyance et par la superstition, par la malice et par la niaiserie, par l’orgueil de la science humaine et par la platitude servile du vulgaire soi-disant éclairé ; d’être livrée ainsi à l’examen curieux de tous les passants, en butte aux propos et aux explications les plus absurdes. Vivre pauvre et délaissée, en proie à.une maladie mystérieuse qui est un martyre continuel ; être méconnue de son entourage le plus proche et par suite souvent maltraitée involontairement ; se sentir profondément isolée au milieu de la foule des curieux qui s’empressent de tous côtés et où l’on est d’autant plus seule qu’on n’y rencontre pas son semblable, subir sans relâche les exigences de toutes les absurdités possibles et de toutes les suspicions imaginables ; avec tout cela ne pas perdre patience un instant, rester toujours affable, humble, douce, sage, intelligente, édifiante selon la mesure de tant de personnes si diverses qui n’exigent d’elles-mêmes rien de semblable, c’est vraiment une tâche colossale pour une pauvre religieuse fille d’humbles paysans, sans autre instruction que son catéchisme, née à une époque où l’esprit primitif s’était presque partout retiré des cloîtres, et où même peu de prêtres se rencontraient qui eussent eu l’occasion d’apprendre à diriger les âmes placées dans de telles circonstances. »
7. Jamais un mot de plainte ne venait sur ses lèvres quand elle se voyait soupçonnée d’imposture ou calomniée : par contre, elle était inconsolable quand elle avait à subir des marques de respect et d’admiration. De même que, pendant des années, elle avait supporté la douleur des plaies avant qu’elles devinssent apparentes, sans voir là autre chose qu’une grâce accordée à ses prières et à son désir de souffrir pour autrui ; de même qu’elle avait vu dans l’empreinte faite par son divin fiancé lui-même une vision symbolique et non pas un fait réel, au point d’en effacer le souvenir de son esprit et de ne pas même tenir compte des effusions de sang qui étaient survenues ; de même elle était toujours prête à ne voir dans ces signes que ce qu’y verraient son confesseur et l’autorité ecclésiastique. Le sentiment de sa propre indignité, la crainte de la louange et des hommages étaient tellement dominants dans son âme qu’elle avait honte d’elle-même jusque dans ses visions et qu’elle aurait préféré être punie et méprisée comme une trompeuse.
Ainsi, en septembre 1815, le dimanche d’après la fête de l’Exaltation de la croix, elle avait assisté en esprit à la grande procession qui se faisait à Coesfeld avec le crucifix miraculeux : marchant pieds nus et en adoration derrière la sainte croix, elle eut le sentiment que beaucoup de pieux assistants pensaient à elle, lorsque la procession passa par l’église de Saint-Jacques, et parlaient de ses signes comme d’une chose miraculeuse. Cela la jeta dans une telle confusion qu’elle chercha à cacher ses plaies et comme elle ne put y réussir, la très vive douleur qu’elle en ressentit la réveilla de sa vision. Souvent aussi, il arrivait que l’esprit malin venait lui faire des reproches artificieux ; il lui disait qu’elle pourrait bien manger si elle le voulait, mais qu’elle était une hypocrite qui ne voulait pas se lever de son lit et qui, à cause de cela, refusait de manger : elle pourrait commencer, lui disait-il encore, par boire de l’eau et du vin et elle verrait aussitôt combien il lui serait facile de prendre de la nourriture. Alors, dans son humilité, oubliant la malice du tentateur, elle répondait très sérieusement avec un saint mépris d’elle-même : « Oui, je suis une indigne, et je mérite d’être méprisée comme une hypocrite. » Et cela excitait en elle un tel zèle contre elle-même qu’elle essayait de sortir de son lit pour aller à la fenêtre et crier de là dans la rue : « Vous tous, bonnes gens, évitez-moi ! ne vous inquiétez pas de moi ! je suis une indigne créature. » Mais, bientôt épuisée par cet effort, elle retombait sur son lit et reconnaissait quel était celui qui l’avait ainsi circonvenue par de fausses accusations.
Wesener, à la date du vendredi 9 août 1816, rapporte un autre fait en ces termes : « Elle se plaint toujours des nombreuses visites qu’elle reçoit. « Je suis triste à mourir à cause de l’affluence des visiteurs, me disait-elle aujourd’hui en sanglotant, et surtout quand il me faut voir que beaucoup ont presque une vénération plus grande devant ce que Dieu a fait en moi, son misérable instrument, que devant le très saint Sacrement. Oui, je voudrais pouvoir mourir de honte quand de vieux et respectables prêtres, qui sont dix fois meilleurs que moi, demandent à me voir. » Je cherchai à la calmer en lui disant que Dieu permettait ces visites pour éprouver sa patience, qu’on ne venait pas pour sa personne, mais pour les œuvres de Dieu manifestées en elle, que les gens raisonnables ne l’admirent pas, mais admirent seulement les décrets incompréhensibles du Dieu tout-puissant. Ces paroles lui plurent, elle reprit sa sérénité et se consola. »
8. Nous n’aurions pas la connaissance précise de l’origine des signes extérieurs si Anne Catherine, dans les dernières années de sa vie, n’avait pas eu, à diverses reprises, des visions sur sa stigmatisation et ne les avait pas racontées par ordre de son confesseur. Ainsi elle eut la vision suivante le 4 octobre 1820, fête de saint François d’Assise.
« Je vis le saint sur une montagne, dans un lieu désert, parmi des buissons. Il y avait là des grottes ressemblant à de petites cellules. François avait ouvert l’Évangile à plusieurs reprises, et il était toujours tombé sur le récit de la Passion. Alors il demanda à Dieu la grâce de ressentir ses souffrances. Ordinairement, il faisait là un jeûne très rigoureux et ne mangeait que ce qu’il fallait de pain ou de racines pour ne pas mourir de faim. Il s’agenouilla, les genoux nus, sur deux pierres très raboteuses et se mit deux autres pierres fort lourdes sur les épaules. Je le vis après minuit, accroupi sur ses genoux, le dos appuyé à la montagne ; il priait, les bras étendus. Je vis près de lui son ange gardien qui lui tenait les mains. Son visage était enflammé du feu de l’amour divin. C’était un homme maigre : il avait un manteau brun, ouvert par devant, avec un capuchon comme le portaient alors les pauvres bergers du pays. Il avait une corde autour des reins. Je le vis comme paralysé. Une splendeur indescriptible partit du ciel, venant à lui perpendiculairement, et je vis dans cette gloire un ange avec six ailes, deux au-dessus de la tête, deux avec lesquelles il semblait voler et deux qui lui couvraient les pieds. Cet ange tenait dans la main droite une croix de demi-grandeur naturelle, sur laquelle était un corps vivant, tout pénétré de lumière. Les deux pieds étaient croisés, les cinq plaies étaient resplendissantes et rayonnantes comme des soleils. Il partit de chaque plaie trois rayons d’une lumière rouge qui se terminaient en pointe ; ils partirent d’abord des mains, se dirigeant vers la paume des mains du saint ; puis de la blessure du côté droit, vers son côté droit, (ceux-ci plus larges avec une pointe plus large) ; puis enfin des pieds vers la face inférieure de ses pieds. L’ange tenait de la main gauche une tulipe d’un rouge de sang au milieu de laquelle était un cœur d’or. Je me souviens confusément qu’il la lui donna. Le saint ne pouvait pas se tenir sur ses pieds lorsqu’il revint à lui. Je le vis retourner au couvent, souffrant cruellement, mais aidé par son ange gardien. Je le vis cacher ses plaies du mieux qu’il put. Il ne voulut les laisser voir à personne. Il avait de grosses croûtes de sang de couleur brune sur le dos des mains. Ses mains ne saignaient pas régulièrement tous les vendredis. Son côté saignait souvent si fort que le sang coulait jusqu’à terre. Je le vis en prières, le sang ruisselant le long de ses bras. J’ai vu beaucoup d’autres choses de lui, notamment comment le Pape, avant qu’il vînt le trouver, le vit dans une vision soutenant sur ses épaules le Latran qui allait tomber.
« J’eus ensuite une vision touchant moi-même et la manière dont j’avais reçu les plaies. Je ne savais pas auparavant comment cela s’était fait. Je me vis seule dans la chambre de la maison Roters. C’était trois jours avant la nouvelle année, vers trois heures de l’après-midi. J’eus une contemplation de la Passion de Jésus-Christ, je le priai de me faire ressentir les souffrances qu’il avait éprouvées et je dis cinq Pater, en l’honneur des cinq plaies. J’étais couchée dans mon lit, les bras étendus. J’eus des impressions d’une grande douceur avec une soif infinie des douleurs de Jésus. Alors je vis descendre sur moi une lumière qui venait obliquement d’en haut. C’était un corps crucifié, vivant et transparent, avec les bras étendus, mais sans croix. Les plaies resplendissaient plus que le corps : c’étaient cinq gloires distinctes de la gloire céleste où elles étaient comprises. J’en fus toute transportée et mon cœur ressentit avec une grande douleur, mêlée pourtant de douceur, le désir de partager les souffrances de mon Sauveur. Et comme mon désir croissait de plus en plus à la vue de ses plaies et, s’élançant, pour ainsi dire, de ma poitrine, à travers mes mains, mes pieds et mon côté, allait comme suppliant, vers ses saintes blessures, de triples rayons d’une lumière rouge finissant en pointe se précipitèrent, d’abord des mains, puis du côté, puis des pieds du crucifié vers mes mains, mon côté et mes pieds. Je restai longtemps ainsi sans rien percevoir de ce qui m’entourait, jusqu’au moment où un enfant, fils de la maîtresse de la maison ; me fit baisser les mains. Cet enfant passa par la salle et dit à ceux qui étaient là que je m’étais heurté les mains quelque part jusqu’à les faire saigner. Je priai ces gens de n’en pas parler.
« J’avais depuis plus longtemps déjà la croix sur la poitrine : je l’avais reçue vers la Saint-Augustin. J’étais agenouillée, les bras étendus, et mon fiancé m’en avait marquée. Après la réception des plaies il survint dans mon corps un grand changement. Je sentis que mon sang prenait un autre cours et se précipitait vers ces points avec un tiraillement douloureux. »
« Saint François s’est entretenu avec moi cette nuit et il m’a consolée. Il a parlé de la violence des douleurs intérieures. »
9. Afin que le lecteur ne se méprenne pas sur cette vision relative à la propre stigmatisation d’Anne Catherine, il est nécessaire de dire ici quelque chose de plus précis sur la signification des visions qui se rapportaient à elle-même. Comme instrument d’expiation, elle avait à accomplir toutes ses actions et à endurer toutes ses souffrances de la manière la plus agréable à Dieu. La pureté de l’intention ne devait pas être altérée ; la patience, la douceur, la charité, la force de sa confiance en Dieu ne devaient pas être ébranlées, quand même des obstacles insurmontables en apparence ou quand les plus fortes oppositions se présenteraient de la part des personnes qui devaient recevoir assistance et bénédiction par suite de ses luttes et de ses souffrances. Si la fragilité humaine la faisait rester en arrière, si elle se laissait décourager et abattre, si une tache, visible à l’œil de Dieu seul, ternissait l’éclat de sa vertu, il lui fallait réparer cette faute par la pénitence. Pour se purifier des fautes qu’elle pouvait commettre dans la vie de chaque jour et dans le commerce avec les hommes, elle avait la direction de son confesseur et le sacrement de pénitence : mais quand il s’agissait d’effacer les imperfections de son action en vision, l’ange qui se tenait à ses côtés l’obligeait à réparer chaque négligence ou chaque infidélité par un surcroît d’efforts et de souffrances. C’était lui, comme nous l’avons vu, qui, depuis sa jeunesse, l’éclairait habituellement sur toutes les parties de sa tâche et qui, par là, la rendait capable de l’accomplir parfaitement. Mais à mesure que cette tâche prenait des proportions plus grandioses avec les années et réclamait plus impérieusement jusqu’à son moindre souffle, les voies par lesquelles elle marchait lui étaient montrées dans des visions de plus en plus riches et compréhensives. Le temps qui lui restait à vivre était court et il fallait qu’il fût consacré à l’accomplissement de sa mission pour l’Église ; c’est pourquoi l’ange avait à veiller pour que chaque instant fût scrupuleusement employé. Tantôt sa lumière éclairait pour elle tout le chemin parcouru jusqu’alors, avec tous les évènements, toutes les souffrances et tous les dangers qui s’y étaient rencontrés, avec toutes les circonstances et avec toutes les personnes dont l’influence avait entravé ou aidé ses efforts : tantôt c’étaient seulement certains évènements plus importants dont l’effet se faisait encore sentir. Cela se faisait pour qu’elle pût reconnaître ce qu’il y avait à corriger ou à reprendre en sous-œuvre et pour qu’elle pût correspondre avec toute la fidélité possible à la direction de son fiancé divin. Enfin bientôt l’avenir lui fut dévoilé, et les travaux et les souffrances qui allaient venir plus ou moins prochainement lui furent montrés. Elle acquérait par là la vue la plus claire du caractère et de l’état moral des personnes pour lesquelles elle avait à prier, à lutter ou à souffrir, on bien contre lesquelles elle avait à combattre, pour rendre vaines leurs attaques et leurs menées perverses contre l’Église, la foi et le salut des âmes. Le lecteur doit comprendre qu’il est incomparablement plus grand et plus méritoire de souffrir et d’expier par pure charité pour une personne dont les intentions et les pensées les plus intimes, dont la perversité, la culpabilité et la rébellion sont clairement mises devant vos yeux, alors qu’il faut pour agir sur son cœur se frayer d’abord un passage à travers les barrières et les obstacles de sa mauvaise volonté, que de prier seulement en général et d’accomplir des œuvres de pénitence pour la conversion des pécheurs. Il peut dès lors se rendre compte de ce que comprenaient ces visions préparatoires envoyées à Anne Catherine dont l’action par la prière, par la lutte, par l’expiation, s’étendait à toute l’Église. Enfin en qualité d’instrument que le chef invisible de l’Église voulait faire servir à ses desseins en faveur de la chrétienté, elle n’avait pas seulement à bien l’emplir son office en ce qui la concernait personnellement et à réparer constamment les fautes provenant de sa propre fragilité, mais elle devait aussi répondre pour ceux que Dieu avait mis en relation avec elle afin qu’ils l’aidassent à accomplir sa mission. Ainsi son œil était depuis longtemps tourné vers Overberg et vers Clément de Droste, avant que ceux-ci eussent même entendu parler d’elle ; sa prière et son influence salutaire étaient autour du Pèlerin, lorsqu’il errait encore loin de l’église, lorsque Dieu et le salut de son âme étaient ce dont il s’occupait le moins.
Celui-ci lui était souvent montré en vision afin qu’elle le gagnât à Dieu et le préparât à être l’instrument par le moyen duquel elle pourrait exécuter l’ordre donné par Dieu de faire connaître ce que lui avaient révélé ses contemplations.
Comme exemple des tableaux symboliques dans lesquels lui était montrée sa situation après l’enquête, nous pouvons reproduire ici une vision qui nous a été conservée par Son confesseur lui-même et qu’elle raconta aussi à l’abbé Lambert :
« Je me trouvais au milieu de beaucoup de gens, sur le chemin de la Jérusalem céleste et j’avais à porter un fardeau très lourd en sorte que je pouvais à peine me traîner. Je me reposai un peu près d’une image du Sauveur crucifié et je vis couchées autour de cette croix une multitude de petites croix de paille et de petites branches sèches liées ensemble. Comme je me demandais tout étonnée ce que pouvaient signifier ces petites croix, mon conducteur me dit : « Ce sont les petites croix que tu avais à porter au couvent : elles étaient légères, mais maintenant une autre croix t’est imposée, porte-la. » Alors la foule de mes compagnons dans laquelle se trouvait mon confesseur se dispersa. Celui-ci se plaça derrière un buisson pour guetter un lièvre. Je le priai de laisser cela et de m’accompagner plus loin sur mon pénible chemin : mais il ne voulut pas et il me fallut continuer à marcher seule et haletante sous mon pesant fardeau. Alors j’eus la crainte qu’il ne fût pas généreux ni charitable à moi de laisser mon confesseur dans l’embarras ; je pensai que je devais le décider par mes prières et au besoin le forcer à marcher avec moi vers le but magnifique qui était devant nous. Je revins sur mes pas : je le trouvai endormi, et je vis avec effroi que des bêtes féroces rôdaient dans le voisinage et qu’un grand danger le menaçait. Je l’éveillai, je le suppliai ; il me fallut presque employer la force pour le tirer après moi et je sentis que mon fardeau n’en était pas peu aggravé. Mais ce fut un bonheur pour moi, car bientôt nous arrivâmes devant un cours d’eau large et profond qu’on ne pouvait franchir que par un passage très étroit. Je n’aurais pu en venir à bout et je serais tombée dans l’abîme avec mon fardeau si le père ne m’avait pas aidé. Enfin nous arrivâmes heureusement au but. »
On verra par la suite combien cette vision est profonde et significative dans sa simplicité.
10. Son confesseur, le père Limberg, dominicain, était un religieux pour lequel la suppression violente des couvents avait été la plus grande des afflictions et qui était rentré dans le monde avec la ferme résolution d’y régler sa vie aussi fidèlement que possible suivant ses vœux de religion. Aussi Anne Catherine vit-elle une disposition particulièrement miséricordieuse de Dieu dans les circonstances qui lui avaient donné pour directeur spirituel ce digne religieux envers lequel elle s’était efforcée dès le premier moment de pratiquer la plus parfaite obéissance. Le P. Limberg n’était pas seulement pour elle un confesseur et un directeur, mais encore le remplaçant de ses anciens supérieurs monastiques : c’est pourquoi elle avait reporté sur sa personne et sur ses paroles le respect sans bornes et la soumission avec lesquels, étant au couvent, elle avait réglé sa vie selon la volonté de ses supérieurs et les prescriptions de la règle. Elle s’était engagée pour jamais envers Dieu par ses vœux de religion, et il voulait que, dans le monde, elle continuât à mener fidèlement et complètement la vie qui convenait à une âme dont il avait fait sa fiancée. Quoiqu’elle fût très supérieure par l’intelligence et les lumières spirituelles à cet homme simple, assez inexpérimenté et médiocrement instruit, elle conservait toujours vis-à-vis de lui l’attitude d’un enfant plein de simplicité, obéissant aveuglément et qui ne demande qu’à être conduit et dirigé. Chaque parole du père Limberg était pour elle un ordre, bien plus, un oracle de Dieu qui n’admettait pas la contradiction. Était-elle assurée d’avance par des expériences journalières ou même par les avertissements de son ange que l’obéissance à telle ou telle prescription de son confesseur amènerait pour elle les plus grandes souffrances, elle n’avait pas l’idée d’y faire la plus petite objection : car aucune douleur, aucun sacrifice ne lui semblait devoir être mis en balance avec le mérite de l’obéissance. Quand son œil perspicace ne pouvait s’empêcher de voir que la direction de son confesseur ne faisait qu’aggraver le poids déjà si lourd de sa mission, et, loin de lui faire suivre le chemin direct, ne la conduisait souvent au but que par les détours les plus fatigants, elle ne voyait jamais là l’effet de l’insuffisance et de l’imprévoyance humaines, mais l’ordre établi par Dieu même qui voulait lui faire accomplir sa tâche d’expiation, non par le ministère de l’ange, mais par celui de l’homme faible et fragile, par celui du prêtre. Il y a un trait commun qui se rencontre chez toutes les âmes choisies de Dieu pour être des victimes expiatoires et qui se reproduit de la manière la plus constante, quelque diverses que paraissent leurs voies considérées du dehors, c’est que leur vie est un sacrifice incessant, un abandon absolu de l’être tout entier, corps et âme, aux desseins de Dieu sur elles : cela se manifestait avec un caractère singulièrement élevé chez Anne Catherine et nulle part plus que dans ses rapports avec son confesseur. De même qu’une plante ne peut pas croître ni une fleur s’épanouir sans air et sans lumière, de même Anne Catherine ne pouvait vivre sans l’obéissance à l’autorité spirituelle : la parole et la bénédiction du prêtre était pour elle plus que la bénédiction de l’ange lui-même. L’obéissance était le moyen à l’aide duquel le fruit de ses travaux profitait à l’Église : elle était le lien qui lui rendait possible de représenter dans son corps le corps de l’Église à laquelle elle se trouvait par là si étroitement unie qu’elle en pouvait pénétrer sans obstacle toutes les parties. Mais cette obéissance reposaitst.ir la foi dont la lumière lui faisait voir dans le prêtre et le confesseur le représentant de Dieu : et sa foi était d’autant plus puissante et plus méritoire qu’elle voyait plus clairement dans le prêtre les défauts et les faiblesses de l’homme. Cependant le don de contemplation ne paraissait octroyé à Anne Catherine dans une telle plénitude que pour qu’elle menât aussi parfaitement que possible une vie de foi, afin de prouver par là à tous les temps que les vrais privilégiés de Dieu, quelque extraordinaires que soient leurs dons, quelque insolite que soit la tâche dont ils sont chargés, ne connaissent pas d’autre loi ni de direction plus élevée que la règle de la foi, telle que la pose l’Église infaillible, colonne et fondement de la vérité. La mystique vraie et pure n’a sa racine et sa vie dans aucun autre terrain que celui de la discipline ecclésiastique, du culte divin, des sacrements, des pratiques et des usages de l’Église, des principes posés par les saints et les docteurs autorisés. Jamais elle n’admet une transgression ou une dispense à l’égard des commandements de Dieu et de l’Église qui obligent tous les chrétiens sans exception ; elle n’admet pas davantage l’omission d’un devoir sous le prétexte mensonger qu’une vie spirituelle d’un ordre transcendant n’est pas rigoureusement liée par toutes les lois et tous les règlements de l’Église. Dieu maintient strictement ces barrières pour ceux qu’il a choisis entre tous, tandis que la fausse mystique ou la prétention mensongère à des grâces extraordinaires ne tarde pas à les renverser : aussi peut-on, en toute assurance, voir un signe infaillible d’imposture ou d’illusion chez toute personne soi-disant favorisée de dons ou de lumières particulières qui se met au-dessus de la moindre règle de la discipline de l’Église, ne fût-ce qu’une rubrique de la liturgie.
11. Quand le P. Limberg prit en main la direction spirituelle d’Anne Catherine, il s’était approprié, comme principale règle de conduite, l’opinion de l’abbé Lambert, suivant laquelle il fallait tenir secret autant que possible tout ce qui se passait d’extraordinaire chez la malade et qualifier ses visions de pures rêveries afin de la maintenir par là dans l’humilité. Il était naturellement d’un esprit si scrupuleux et si facile à troubler que ce ne fut qu’après des années, après avoir vu fréquemment les choses les plus frappantes et les plus émouvantes, qu’il put arriver à apprécier équitablement, sans soupçon et sans méfiance, les dons départis à sa fille spirituelle. Après l’avoir dirigée pendant sept ans et avoir reçu des preuves innombrables de son obéissance, de sa véracité et de sa candeur, il lui arrivait encore de tomber dans le doute quant à la réalité et à l’origine de tout ce qu’il voyait en elle. Voici un incident raconté par lui-même en ces termes :
« Je disais mon bréviaire pendant que la malade était en prière extatique, les yeux fermés. Il y avait bien une heure que cela durait lorsque je finis mon bréviaire. Alors les doutes du professeur B. se présentèrent à mon esprit et une idée me vint, je ne sais comment. Je me souvins que l’abbé Lambert dans sa messe d’aujourd’hui avait consacré deux hosties, afin d’en réserver une pour donner la communion à la malade le jour suivant. Ne serait-il pas permis, me dis-je en moi-même, de la mettre encore une fois à l’épreuve, ne faisant cela ni par vaine curiosité, ni à mauvaise intention ? J’allai donc prendre l’hostie consacrée, je la mis dans un corporal autour duquel j’enveloppai une étole et je la portai chez la malade. Lorsque j’entrai dans la chambre, elle était encore en prière et dans la même position qu’avant : mais je n’eus pas plus tôt mis le pied sur le seuil qu’elle se releva à la hâte et avec un grand effort, tendit les bras et tomba sur ses genoux en adoration. « Qu’avez-vous ? » lui demandai-je, mais elle s’écria : « Ah ! mon seigneur Jésus vient à moi avec le tabernacle. » Je la laissai adorer le saint Sacrement pendant quelque temps, puis je le remportai. »
La première fois qu’il avait trouvé Anne Catherine en extase et qu’à son réveil il lui avait demandé des explications à ce sujet, cela l’avait jetée dans une grande confusion ; elle l’avait supplié en rougissant de ne la trahir vis-à-vis de personne. Il lui était arrivé comme à la bienheureuse Marie Bagnesi 26 avec laquelle elle a en général une ressemblance tout à fait surprenante : car Marie aussi, ayant été trouvée une fois ravie hors d’elle-même et élevée au dessus de terre, fut saisie d’un tel effroi, quand elle revint à elle, qu’elle cacha son visage dans ses mains comme eût fait un enfant pris en faute et n’osa plus lever les yeux sur ceux qui avaient été témoins de son extase.
Le P. Limberg avait si peu l’intelligence de cet état, que, s’il trouvait Anne Catherine absorbée dans un de ses travaux en esprit où elle secourait le prochain et souffrait pour lui, il cherchait à la faire revenir à elle en la secouant bien fort : car il croyait alors « qu’elle avait le délire ». Ainsi, en août 1814, elle avait à secourir une personne phtisique, non seulement en prenant sa maladie pour elle-même, mais encore par d’autres souffrances expiatoires, afin de lui obtenir la patience et la grâce d’une bonne mort. Limberg la trouva un jour poussant des gémissements plaintifs comme si elle eût été agonisante et il la secoua de côté et d’autre par les épaules jusqu’à ce qu’elle fût revenue à elle : alors elle lui répondit tranquillement : « J’étais près de la malade et à mon retour, je me suis trouvée si faible qu’il m’a fallu monter l’escalier en pierre 27 en me traînant sur les genoux. Cela m’a donné une peine incroyable, et je sens de grandes douleurs aux genoux. »
Quoique les genoux fussent couverts d’ampoules et que les douleurs eussent duré plusieurs jours, Limberg traita tout cela de rêverie jusqu’au moment où la phtisique, qui était sa propre sœur, s’adressa directement à Anne Catherine, désirant que la mort qu’elle savait inévitable, la trouvât près de la servante de Dieu et sous la protection de ses prières. Alors le P. Limberg la fit transporter dans la chambre d’Anne Catherine, chez laquelle se manifestèrent aussitôt tous les symptômes et toutes les souffrances de la phtisie la plus intense. Elle fut prise d’une soif ardente accompagnée d’élancements si violents dans le côté droit que la douleur la fit tomber sans connaissance lorsque sa sœur voulut la retirer du lit. Quant à la phtisique elle-même, elle se trouva soulagée et consolée, car l’assistance s’étendit aussi à son âme. Voici ce que rapporte Wesener à ce sujet :
« La sœur Emmerich me raconta qu’elle avait eu une nuit très pénible et très agitée. Elle avait été injuriée, raillée et même poussée et frappée par diverses personnes. Il y avait spécialement quelques enfants qui tombaient sur elle, la battaient et la maltraitaient, en sorte qu’il lui fallait se défendre contre eux des deux mains et que pourtant elle ne pouvait s’en délivrer. M. Limberg, qui veillait dans la chambre auprès de sa sœur phtisique, vit les gestes qu’Anne Catherine faisait comme pour se défendre et la prit par le bras pour la retenir. Alors elle revint à elle et vit M. Limberg près d’elle, mais malgré cela, elle avait toujours devant les yeux ces enfants qui la tourmentaient et elle se plaignit à moi de souffrir encore partout où ces enfants l’avaient heurtée et frappée. Une fois ces mêmes enfants voulurent aussi la forcer à manger et lui mirent des mets devant la bouche, si bien que toute la matinée elle en conserva le goût sans pouvoir s’en débarrasser. »
Ces tourments se rapportaient aux soupçons répréhensibles que la mourante avait longtemps nourris antérieurement et qu’elle avait communiqués à d’autres personnes, touchant le jeûne continuel d’Anne Catherine qu’elle traitait de fourberie et d’illusion. Anne Catherine expiait cette faute à sa place en souffrant patiemment les mauvais traitements indiqués plus haut et elle lui obtint par là la grâce d’un sincère repentir et d’une bonne mort.
Le Père Limberg fut bien obligé de reconnaître que tout cela n’était pas une pure rêverie ; pourtant, après comme avant, son esprit resta fermé à, l’intelligence de l’état contemplatif, ainsi qu’on peut en juger par le fait suivant. La veille et le jour de l’Assomption, Anne Catherine eut à contempler presque sans interruption la mort de la sainte Vierge avec toutes les circonstances qui l’accompagnaient. Étant en extase, elle parla de ces visions d’une façon si claire et si animée que le Père Limberg lui-même fut forcé de reconnaître qu’il n’y avait pas là l’ombre de délire. Il prit alors un petit tableau à l’huile représentant la mort de Marie et le tint à quelque distance devant les yeux fermés d’Anne Catherine. Tout à coup le corps raidi de la malade se pencha vers le tableau ; elle courba la tête et finit par le prendre dans ses mains, puis elle fit cette allusion à saint Pierre qui y était représenté : « Ah ! cet homme à la barbe blanche est un bien excellent homme ! » Elle retomba ensuite en arrière et Limberg plaça le tableau contre ses mains qui étaient croisées sur sa poitrine. Étant revenue à elle, elle répondit ainsi à ses questions :
« Je voyais la Mère de Dieu mourante, entourée des apôtres et des personnes de sa famille, et je me suis pendant longtemps réjouie à cette vue ; alors la chambre avec tout ce qui était dedans m’a été posée sur les mains. Cela m’a causé un plaisir inexprimable, mais en même temps je m’étonnais beaucoup de pouvoir porter toute cette chambre sur mes mains, sur quoi il me fut dit intérieurement : « Il n’y a là que pure vertu et c’est léger comme de la plume. » Dans la nuit précédente, j’ai eu aussi, presque sans interruption, des visions relatives à la mort de Marie. J’étais en voyage pour aller à Jérusalem et cela dans un état tout à fait singulier, car j’étais couchée, sans dormir ni rêver ; j’avais les yeux ouverts, je voyais les objets qui sont dans ma chambre et pourtant cela ne me dérangeait pas dans mon voyage, ni dans ma contemplation, et ne m’empêchait pas d’avoir la perception de tout ce qui était sur la route. »
12. Le Père Limberg avait coutume de traiter Anne Catherine comme une religieuse ordinaire ; il lui parlait brièvement et sévèrement et c’était précisément ce qu’elle-même appréciait le plus en lui. Il était déjà son confesseur depuis deux ans, lorsqu’un jour Wesener la trouva toute en pleurs et, lui ayant demandé la cause de cette tristesse, en reçut cette réponse : « Je crains que ma pleine et entière confiance en Dieu, mon seul protecteur, ne se soit amoindrie ; car, maintenant qu’il me faut rester couchée sans pouvoir m’aider en rien, tout m’afflige. Auparavant j’avais une si ferme confiance en Dieu qu’aucune souffrance ne me troublait, quelque violente qu’elle pût être ; à présent je suis tout attristée par le projet qu’a mon confesseur de chercher une autre position, car je l’apprécie extrêmement et je le préfère à tout autre à cause de sa sévérité salutaire. »
Quelques années plus tard, elle dit encore devant Wesener qu’elle sentait bien combien la sévérité de son confesseur lui était profitable et que rien ne lui ferait plus de peine que de le voir se relâcher de cette sévérité.
Quant à la manière dont elle était traitée par lui, nous pouvons mentionner ici le fait suivant qui est très caractéristique : « Un soir, dit Wesener, je trouvai la sœur Emmerich semblable à une mourante. Son pouls était si petit et si faible et elle-même dans un tel état de prostration qu’elle pouvait à peine articuler une parole à voix basse. Je ne pus découvrir la cause de cette extrême faiblesse, cependant je lui fis prendre dix gouttes d’opium, et je la laissai dans le même état. Le lendemain, dans la matinée, je la trouvai toute changée ; elle avait repris de la gaieté et des forces, et, tout surpris d’un changement si subit et si frappant, je m’adressai à son confesseur qui était présent, pour savoir ce qui s’était passé ; sur quoi il me répondit : « Je l’ai trouvée ce matin dans un état encore plus misérable qu’hier au soir et, craignant qu’elle ne mourût, je lui ai donné le plus promptement possible la sainte communion. À peine avait-elle la sainte hostie dans la bouche que son visage, pâle comme celui d’une morte, s’est coloré et que son pouls s’est relevé. Elle est restée plus d’une heure plongée dans une profonde adoration. Cela m’a fait clairement reconnaître la cause de cette faiblesse extraordinaire : elle venait de ce que je lui avais interdit la sainte communion pendant deux jours, pour la punir de ne s’être pas laissé laver le dos avec de l’eau-de-vie chaude. »
Cet incident présente le tableau le plus vrai et le plus frappant de la pénible position où se trouvait Anne Catherine. Les lotions avec de l’eau-de-vie étaient pour elle un supplice, d’autant plus que la seule odeur de cet affreux liquide était intolérable pour elle. Cependant il fallait s’y prêter par obéissance, car le confesseur et le médecin l’exigeaient. Si elle était trop faible ou si l’étourdissement causé par les exhalaisons de l’eau-de-vie la rendaient incapable de se laver le dos elle-même, il lui fallait recourir à l’assistance de sa sœur, laquelle tenait si peu de compte du sentiment de pudeur incroyablement délicat de la malade que celle-ci souvent, pour éviter la confusion où cela la jetait, n’osait pas se mettre entre ses mains. Il en avait été ainsi dans le cas présent. Le mercredi d’avant, le confesseur avait découvert qu’Anne Catherine s’était lavée elle-même avec de l’eau-de-vie et avait décliné les services de sa sœur. Pour la punir de ce refus, il l’avait privée de la communion le jeudi et le vendredi, et il l’eût fait plus longtemps si l’état où il l’avait trouvée le samedi ne lui eût fait craindre qu’elle ne mourût. Le lecteur appréciera facilement de quelle utilité pouvaient être dans un cas semblable les dix gouttes d’opium données à Amie Catherine. Mais quand ces choses et d’autres semblables lui arrivaient, elle avait coutume de les prendre comme une punition bien méritée, avec un profond sentiment de sa culpabilité et sans jamais se permettre une excuse.
13. Son obéissance acquit par là une telle énergie que même ses facultés corporelles et ses sens obéissaient aussi ponctuellement à l’ordre du prêtre que la volonté elle-même, et en cela aussi il en était d’elle comme de Marie Bagnesi. Un jour que celle-ci, livrée à des tortures intolérables, ne pouvait plus se tenir en repos, mais se tordait en gémissant sur son lit de douleur, ses commensaux appelèrent son confesseur afin que la bénédiction sacerdotale lui rendît le calme. Il vint, la consola, et avant de se retirer, il lui donna sa bénédiction en disant : « Maintenant, sœur Marie, obéis et tiens-toi tranquille. » À l’instant elle devint immobile, resta ainsi, jusqu’au lendemain, dans la position où elle était couchée, et ne fit plus un mouvement jusqu’à ce que le confesseur fût revenu et eût retiré son ordre. Quant à Anne Catherine qui, comme Marie Bagnesi, était habituellement visitée par des souffrances plus grandes encore qu’à l’ordinaire à la fin de chaque année ecclésiastique, parce que, comme une fidèle servante, elle avait à corriger et à refaire avec un redoublement de fatigue les travaux omis ou mal faits dans la vigne du Seigneur par des serviteurs négligents, voici ce que rapporte Wesener, à la date du 27 octobre 1815 :
« Elle fut très malade toute la journée et tout son corps tremblait dans l’excès de la souffrance. Ce qui me parut le plus remarquable fut une surdité complète survenue depuis quelques jours et qui faisait que, même sans être en extase, elle n’entendait plus rien de ce qu’on lui disait. Elle ne pouvait entendre que ce que son confesseur lui ordonnait en vertu de l’obéissance.
« En novembre, il survint une forte toux, laquelle augmenta bientôt à tel point qu’il me fallut penser au moyen de la modérer. Je voulus réserver l’essence de musc jusqu’à la dernière extrémité : d’un autre côté l’opium me parut attaquer l’estomac : c’est pourquoi j’essayai d’une friction de camphre, mais cela ne fit qu’augmenter la toux. Je priai alors son confesseur de veiller près d’elle avec sa sœur. Le lendemain je trouvai la malade sans toux, ce que M. Limberg m’expliqua. « J’ai veillé, m’a-t-il dit, jusqu’à minuit près de la malade avec sa sœur. Elle toussait sans relâche et si violemment que je ne pouvais plus le supporter. Dans mon embarras, saisi de compassion, j’ai eu recours à un moyen de l’ordre spirituel et je lui ai ordonné, en vertu de l’obéissance, de ne plus tousser et de rester tranquille. À l’instant elle s’est affaissée sur elle-même comme sans connaissance ; elle n’a pas toussé une seule fois depuis ce moment et elle st restée tranquille jusqu’au matin. » La toux ne revint plus de toute la journée et ne reprit que le soir, mais assez faiblement.
« Le vendredi 10 novembre, ses stigmates lui occasionnèrent toute la journée de si affreuses douleurs que nous en étions tout bouleversés. Ses mains et ses doigts étaient d’une pâleur livide et recourbés vers l’intérieur. Elle-même tremblait de tout son corps et était étendue sans connaissance, semblable à une morte. Tout à coup elle soupira et dit : « Ah ! si je pouvais sortir d’ici ! Si je pouvais être devant le Saint Sacrement pour y prier ! » sur quoi M. Limberg répondit : « Faites seulement cela, vous serez délivrée ! » Ces paroles de son confesseur dites presque au hasard et d’ailleurs fort peu claires ne donnèrent pas de force à la patiente, qui dit alors : « Puis-je le faire ? Dois-je le faire ? » Je priai le confesseur de lui en donner la force au moyen de l’obéissance. Il le fit et à l’instant elle se releva sur ses genoux et commença à prier les bras étendus. La vue de cette femme agenouillée, faible jusqu’à en mourir, avait réellement quelque chose d’effrayant et, comme nous craignions que cet effort n’empirât encore son état, le confesseur, au bout de quelque temps, lui commanda de se recoucher. Aussitôt elle retomba sur elle-même comme un drap mouillé et quand un peu plus tard, elle revint à elle, elle dit qu’elle sentait l’intérieur de son corps comme mort. On lui mit sur la poitrine un cataplasme trempé d’eau-de-vie très chaude, et le soir, à dix heures, je lui fis donner huit gouttes d’essence de musc. »
Son désir de recevoir le Saint-Sacrement aussi bien que son profond respect devant lui s’exprima dan d’autres occasions de la manière la plus touchante. Ainsi un jour elle fut enflammée d’un si grand désir de cet adorable sacrement qu’involontairement elle fut transportée en esprit à l’Église. Elle se trouva agenouillée devant le tabernacle et comme étant sur le point de l’ouvrir pour se donner à elle-même la communion. Alors elle fut saisie d’une terreur indicible à la pensée de cet acte illicite, si bien qu’elle revint à elle, et, dans son angoisse, pria son confesseur, qui était là, de lui permettre de se confesser, afin de recevoir l’absolution. Il voulut l’en dissuader comme s’il ne s’était agi que d’un simple rêve, mais il ne put la calmer qu’à grand-peine, car elle se sentait sûre de n’avoir pas rêvé, mais de s’être trouvée réellement et en personne devant le tabernacle, quoiqu’en esprit.
Pendant l’octave de la Toussaint, son confesseur ayant fait une absence de quelques jours, elle n’osa pas recevoir la sainte communion sans y être autorisée par lui, parce qu’elle craignait d’avoir commis un péché en se mettant en colère contre sa sœur. Par suite de la douleur qu’elle en ressentit et de la privation du sacrement, elle devint, suivant les paroles de Wesener, « si faible et si misérable, son pouls si petit et d’une telle ténuité qu’on ne doutait pas de sa mort prochaine ». Mais, après le retour de Limberg, s’étant confessée et ayant reçu le corps du Seigneur, cela lui rendit si bien ses forces que, le lendemain, Wesener la trouva bien portante et de bonne humeur.
14. Ce n’était pourtant pas seulement dans les choses de la vie spirituelle qu’Anne Catherine se soumettait passivement à ce que disait son confesseur, mais elle cherchait en tout, sans aucune exception, à régler sa conduite suivant ce qu’il permettait ou défendait. Son désir de vivre dans l’obéissance, avait pris d’autant plus de force, depuis son expulsion du couvent, que les circonstances extérieures lui rendaient plus difficile une vie réglée conformément aux vœux de religion. Elle voulait se soumettre pour l’amour de Dieu à toute créature : c’est pourquoi elle s’appliquait avec une sagacité et une persévérance étonnantes à sacrifier sa volonté propre dans toutes les occurrences de la vie de chaque jour. L’abandon complet à Dieu de toutes les puissances du corps et de l’âme que, sous l’impulsion du Saint-Esprit, elle renouvelait sans cesse avec la plus vive ferveur, n’était pas seulement pour elle une prière enflammée ou un ardent acte d’amour, mais c’était un fait, une réalité dans sa vie, car à chaque instant il se présentait des occasions de mettre cet abandon en action d’une manière héroïque par la souffrance et par le renoncement, par la patience et par la douceur. Son extrême humilité et son constant oubli d’elle-même avaient habitué son entourage à ne pas la considérer comme une malade qui eût besoin de soins particuliers : car, de même que, dans son enfance, elle n’avait jamais pris ses visions et son état de souffrance comme prétexte pour se dispenser d’un travail pénible ou pour s’élever au-dessus des exigences gênantes de sa modeste condition, de même sa position actuelle n’apportait aucun changement dans sa manière de vivre accoutumée. Elle était restée aussi simple, aussi serviable, aussi laborieuse qu’auparavant et il ne lui vint jamais dans l’esprit qu’elle pût prétendre à des égards particuliers. Comme elle ne pouvait plus sans assistance étrangère gouverner le ménage de l’abbé Lambert, elle avait pris avec elle, comme aide, sa sœur cadette Gertrude ; mais celle-ci était si inexpérimentée qu’Anne Catherine, sans pouvoir quitter son lit, était obligée de lui enseigner tous les travaux propres aux femmes, y compris la cuisine, et de préparer elle-même chaque mets de manière à ce que le vieillard infirme pût en manger. Elle faisait cela, malgré toutes ses souffrances et malgré sa répugnance presque insurmontable pour l’odeur des aliments, comme une chose qui s’entendait de soi-même, et elle s’y prêtait de si bon cœur que tout l’entourage prit l’habitude de se faire rendre toute espèce de services par cette pauvre malade, dont la bouche ne manifestait jamais le désir du moindre soin ou de la moindre assistance pour elle-même. La victoire sur elle-même et le renoncement étaient tellement devenus sa nature que la joie de servir les autres semblait tout remplacer pour elle. En outre, dès le premier jour, sa sœur la considéra et la traita comme une personne qui ne restait toujours couchée que pour suivre sa fantaisie et par amour de ses aises, qui, d’ailleurs, aurait bien pu manger si elle avait voulu prendre un peu plus sur elle. On peut se figurer ce qu’elle eut à endurer par suite d’une telle manière de juger son état. Il est plus facile de supporter avec résignation de grandes souffrances et de grandes tribulations dont la cause reste cachée aux yeux des autres, ou de conserver la patience et la sérénité de l’âme au milieu de douleurs corporelles incessantes que d’accueillir en silence avec une douceur, une bonté et une aménité inaltérables, avec une bienveillance toujours la même, les témoignages répétés tous les jours, pour ne pas dire à toute heure, d’une dureté sans ménagement et les explosions d’une irritabilité provocante, sans être jamais l’objet de ces petites attentions et de ces soins coûtant si peu qui, pour la pauvre religieuse couchée sur son lit de douleurs, eussent été un bienfait inappréciable. Elle-même ne demandait jamais rien : mais à chaque moment elle acquérait le mérite d’un renoncement plein de mansuétude, mérite d’autant plus grand devant Dieu que l’effort par lequel il était conquis échappait aux yeux des hommes.
Wesener donne les détails suivants sur ce qu’il vit pendant la première année de ses rapports avec Anne Catherine :
« La sœur d’Anne Catherine a un caractère qui est à la fois plein de faiblesse et de dureté et elle donne souvent les plus grands ennuis à la malade aussi bien qu’à moi. Elle a très peu d’affection pour la malade et de plus aucune déférence : pendant des journées entières, elle ne lui donne pas une goutte d’eau et encore moins quelque autre chose. S’il y avait de la fourberie en jeu, cette sœur serait certainement la première à la dénoncer : j’ai eu un jour l’occasion de parler à la malade de la manière dont sa sœur se comportait et elle n’a pu s’empêcher d’avouer que celle-ci serait la première à témoigner contre elle, si elle faisait le moindre acte d’hypocrisie ; car elle ne la traite pas en sœur, mais en ennemie, parce qu’elle ne peut endurer ni un avis sur ses défauts, ni une prière de s’en corriger. Je dois avouer que je ne serais pas de force à supporter l’esprit de contradiction et l’humeur fantasque de cette sœur si inférieure à son aînée. La malade est obligée de se donner la peine de l’aider dans tous ses travaux, et je l’ai vue souvent moi-même préparer sur son lit certains mets où il entrait du lait, de la farine et des œufs. C’est là ce qui l’a fait soupçonner d’imposture par beaucoup de gens méfiants. L’abbé Lambert était souvent si attristé de tout cela qu’il voulait empêcher la malade de s’occuper ainsi de travaux de cuisine : mais il fallait qu’elle s’en mêlât pour que ce vieillard infirme pût avoir ce qui lui était nécessaire. Or ce travail était pour elle un vrai supplice, car elle pouvait à peine supporter l’odeur des mets. Ainsi je la trouvai une fois prise d’une toux convulsive parce que sa sœur qui avait retiré du four du pain blanc fraîchement cuit était venue près du lit de la malade, ayant ses vêtements encore imprégnés de l’odeur du pain chaud. Elle était du reste presque toujours prise d’une toux de ce genre quand sa sœur laissait la porte de la chambre ouverte et que l’odeur des mets y arrivait de la cuisine. Dans une visite du matin je la trouvai une fois très affaiblie. Elle avait eu toute la nuit des accès de toux convulsive parce que sa sœur avait soufflé une bougie devant son lit sans éteindre la mèche fumante. La fumée qui s’en était dégagée avait été cause de cette toux qui n’avait pu se calmer de toute la nuit. »
Six ans plus tard, Clément Brentano racontait ainsi ce que lui-même avait vu :
« La sœur de la malade était une des plus grandes croix qu’elle eut à endurer. Elle la subissait avec une douleur indicible et avait pour elle la plus grande compassion. Cette sœur avait un caractère très malheureux ; mais Anne Catherine travaillait jour et nuit par la souffrance, la prière et la patience, à obtenir de Dieu son changement moral. Elle était très bornée, sans discernement, sans aucune douceur, colère, entêtée ; en sorte qu’elle ne pouvait supporter ni le moindre avis, ni la moindre observation. La malade, dans son état d’abandon et sans cesse privée de l’usage de ses sens, était livrée jour et nuit à la dureté inintelligente et impitoyable de cette sœur ; en outre, grâce au don terrible de lire dans les cœurs, elle avait le sentiment de l’état intérieur de sa sœur, ce qui était extrêmement douloureux pour elle. Elle a beaucoup souffert et prié pour cette sœur, si bien que celle-ci, après la mort d’Anne Catherine, est devenue une tout autre personne. »
15. Anne Catherine avait à endurer un supplice d’un genre tout particulier de la part de sa sœur qui avait la manie de vouloir la faire manger. Toutes les fois qu’elle avait à souffrir pour des mourants qui s’étaient rendus gravement coupables d’intempérance et n’en avaient pas fait pénitence, ses peines expiatoires avaient ce caractère qu’elle prenait sur elle les diverses suites physiques et morales de ce vice et qu’elle avait à les combattre en elle-même par la mortification et la patience, prenant la place de ces malheureux pécheurs d’habitude pour leur conquérir la possibilité de bien mourir. Tantôt elle était poursuivie par une odeur si forte d’aliments et de plats recherchés que l’excès du dégoût lui ôtait toute espèce de force, tantôt elle était assaillie d’une envie de manger irrésistible qu’elle avait la plus grande peine à dompter, tantôt elle éprouvait le déplaisir et la vive irritation d’une personne sensuelle qui ne peut satisfaire un désir insurmontable de friandises ; tantôt elle mourait de soif et, si elle essayait de boire, il s’ensuivait un étranglement et des efforts pour vomir qui semblaient devoir aboutir à la mort ; tantôt enfin, elle goûtait en réalité de quelque aliment et il en résultait des tortures auxquelles l’assistance spéciale de Dieu l’empêchait seule de succomber. C’était sa sœur qui, par indifférence et par sottise, la forçait à manger, quand, absorbée dans un travail fait en esprit, elle ne savait pas ce qui se passait autour d’elle ; cependant c’était moins encore par suite de cette ignorance et de la privation de l’usage de ses sens qu’elle acceptait de la nourriture que par un excès d’obéissance. Le Père Limberg voulait qu’elle ne rejetât aucun des services que pouvait lui rendre sa sœur ; de là venait qu’elle se soumettait passivement chaque fois que ladite sœur s’approchait d’elle en lui parlant du ton du commandement et lui présentait à manger. Wesener a noté plusieurs cas de ce genre parmi lesquels nous avons choisi ceux qui suivent :
« 30 mai 1814. J’ai trouvé la malade dans un triste état et sans sentiment. Je soupçonnai que sa sœur, très entêtée et en même temps très grossière, lui avait donné quelque ennui. Il en était ainsi. Le Père Limberg me raconta que cette sœur lui avait fait prendre une tasse de choucroute ; ce ne fut que la nuit suivante qu’elle put la vomir avec des douleurs excessives.
« 2 septembre. Je trouvai la malade dans un état misérable. Elle finit par vomir, mais après cela elle fut si mal que nous l’aurions crue morte si le pouls, quoique bien faible, n’eût pas encore trahi une étincelle de vie. En vomissant, elle avait rendu quelques petits brins de viande, ce dont sa sœur nous donna l’explication en disant : « J’ai fait cuire un ragoût pour l’abbé Lambert et je l’ai donné à goûter à la malade. Mais il faut qu’elle n’ait pas bien eu sa connaissance puisqu’en goûtant, elle a avalé quelque chose.
« 29 octobre. Je la trouvai le soir malade à la mort. Elle avait un mal de cœur effrayant avec des étranglements et des vomissements convulsifs. Cela avait déjà commencé vers midi. Je m’informai de la cause de ce triste état et j’appris que le matin, pendant la grand-messe, dans un moment où elle n’avait pas bien l’usage de ses sens, sa sœur lui avait présenté de la salade arrosée d’une sauce acide pour qu’elle y goûtât. Elle vomit quelques brins de salade et des mucosités : mais je ne pus parvenir à calmer ses terribles nausées ni à arrêter les vomissements. Je fis veiller la nuit auprès d’elle. Le lendemain matin, je la trouvai en vie, mais c’était tout. Toute la nuit elle avait lutté contre la mort et ce fut le matin seulement que la sainte communion arrêta les vomissements et lui procura un peu de repos. À midi tout était de nouveau comme avant. La malade éprouvait une soif ardente, elle avait des douleurs terribles dans le corps et dans le cou, et une gorgée d’eau renouvela les nausées et les vomissements. Je lui donnai six gouttes d’essence de musc sans beaucoup de succès : c’est pourquoi je réitérai la dose le soir. Elle se sentait comme rouée et se faisait de grands reproches pour avoir goûté la salade. Je pus pourtant la tranquilliser à cet égard : car ce n’était pas à elle, dans l’état d’absorption où elle se trouvait, mais à l’incroyable manque de ménagements de sa sœur qu’il fallait imputer tout cela.
« 9 mai 1815. J’ai trouvé la malade faible à en mourir. M. Limberg et sa sœur qui avaient veillé près d’elle pendant la nuit, avaient craint plusieurs fois de la voir expirer entre leurs mains, parce qu’avec l’étranglement le plus violent, elle ne pouvait pas arriver à vomir. Le matin, après avoir reçu la communion, elle devint un peu plus calme, cependant je remarquai en elle un effort violent et convulsif comme pour avaler quelque chose. À la fin elle vomit un liquide de couleur brunâtre dans lequel nous reconnûmes la cause de ses souffrances. Son frère aîné l’avait visitée le jour précédent et il lui avait présenté de la bière dont elle avait avalé quelques gouttes, ayant l’esprit absent. »
Dans de semblables occasions, Anne Catherine ne laissait jamais échapper une plainte contre sa sœur : bien plus, elle n’avait pas même un premier mouvement de colère contre l’incurie si peu charitable qui lui préparait de telles souffrances : elle ne s’en prenait qu’à elle-même comme si son imprudence eût été la cause de tout le mal. Mais quand elle voyait combien sa sœur était sourde aux exhortations les plus affectueuses, combien peu de peine elle se donnait pour remplir consciencieusement les devoirs de son état, avec quelle obstination elle refusait toujours d’avouer une faute et de se corriger d’un défaut, Anne Catherine tombait dans une tristesse indicible, surtout lorsque cette sœur, qui se tenait pour une personne pieuse et craignant Dieu, s’approchait des sacrements. À ce propos, Wesener rapporte ce qui suit, le 26 septembre 1815 :
« J’ai trouvé la malade toute triste, et comme je lui en demandai la cause, elle m’a dit : « Je suis prête à souffrir patiemment toute espèce de peine, car je suis dans ce monde pour souffrir et je sais même pourquoi j’ai à souffrir, mais la pensée et je pourrais dire la conviction que ma pauvre sœur devient près de moi plutôt pire que meilleure me fait trembler. » Je cherchai à la consoler en lui disant que certainement Dieu ne permettrait pas que sa sœur se perdît, qu’assurément elle changerait, mais que présentement il fallait peut-être qu’elle fût l’instrument destiné à la rendre plus parfaite. Je parvins par là à la calmer. »
16. Ce qui aggravait encore la situation d’Anne Catherine, c’est que, dans ses rapports avec cette sœur, l’assistance de ses amis ecclésiastiques lui faisait défaut. L’abbé Lambert était trop débonnaire et possédait trop peu la langue allemande ; le Père Limberg était d’un naturel trop timide pour pouvoir maîtriser ce caractère intraitable ; Overberg voyait là une pierre de touche et un instrument à l’aide duquel Dieu voulait purger de toute imperfection l’âme d’Anne Catherine. Elle n’avait de ce côté ni consolation, ni garantie : elle aurait eu besoin d’un arbitre entre elle et Gertrude, qui ne lui épargnât pas à elle-même les réprimandes, si, comme le lui reprochait sans cesse sa sœur, elle se laissait aller à l’irritation et à l’emportement. Mais son humilité ne lui permettait pas d’être juge dans sa propre cause : c’est pourquoi elle pria Overberg de confier cette fonction d’arbitre au docteur Wesener qui connaissait aussi exactement que possible tous ses rapports domestiques et qui était en mesure de dire la vérité à toutes les deux. Elle ne cessa pas non plus de supplier Wesener jusqu’à ce qu’il consentît à se charger de cet office charitable, mais il ne tarda pas à reconnaître quel labeur ingrat il s’était laissé imposer.
« Un jour, dit-il dans son journal, qu’avec beaucoup de douceur et de ménagement, je faisais des représentations à cette sœur sur sa méchante humeur, sa désobéissance et son caractère acariâtre, elle se montra surprise et choquée, déclarant qu’elle était ainsi faite et qu’elle n’y voyait pas grand mal. Alors je lui citai des faits, mais inutilement ; bien plus elle triomphait quand elle voyait la malade s’indigner à trop juste titre. »
Anne Catherine de son côté prit tellement au sérieux l’office dont le médecin s’était chargé quelle s’accusait devant lui en pleurant chaque fois qu’elle craignait de s’être emportée. Au bout de quelques mois Wesener écrivit à Overberg :
« Si cela dépendait de moi, j’aurais depuis longtemps chassé le mauvais esprit, c’est-à-dire la sœur de la malade : mais quand je veux en venir là, celle-ci me conjure au nom de Dieu de n’en rien faire ; elle seule, dit-elle, est responsable de tout cela parce que c’est une épreuve à laquelle elle est soumise : ainsi j’ai toujours les mains liées, autrement j’aurais depuis longtemps renvoyé cette sœur. Il faut pourtant que cela se fasse, à quelque prix que ce soit, car je crois qu’un ange même ne pourrait s’accommoder avec elle. Je ne mentionne ici qu’un exemple tout récent. Gertrude, pendant toute une matinée, avait été de très mauvaise humeur vis-à-vis de la malade qui pourtant supportait sa méchanceté avec beaucoup de calme et de patience. Dans l’après-midi, Anne Catherine voulut raccommoder une chemise pour un pauvre et pria sa sœur de l’aider, lui montrant ce qu’il y avait à faire ; mais celle-ci prit le contre-pied et enleva un morceau en bon état au lieu de celui qui était endommagé. La malade le lui fit observer et prit elle-même les ciseaux pour lui préparer le travail. Là-dessus la sœur se montra si mécontente et si insolente qu’Anne Catherine retira vivement l’ouvrage, ce qui fit tomber les ciseaux par terre. Quel triomphe pour Gertrude ! Elle releva les ciseaux d’un air railleur et les rendit en donnant à entendre qu’Anne Catherine les lui avait jetés à la tête. Celle-ci en fut comme anéantie et malade à la mort jusqu’à ce qu’une confession faite avec un vif repentir et la sainte communion lui eussent rendu des forces. Les cas de ce genre ne sont pas rares. Il faut ici des conseils et de l’assistance, car l’abbé Lambert et le Père Limberg ne prennent aucune résolution et laissent toutes choses aller leur train. »
Cette lettre et tous les efforts du médecin pour l’éloignement de Gertrude n’eurent aucun résultat, sans qu’il y eût de sa faute, ni de celle d’Overberg : car Anne Catherine n’osait pas se séparer de sa sœur sans l’ordre de son conducteur invisible, et elle la supporta ainsi durant six ans, jusqu’à ce qu’enfin, un an avant sa mort, l’ange l’autorisa à la congédier. Il y a un fait qui se reproduit presque sans exception dans la vie des personnes favorisées de grâces extraordinaires, c’est qu’elles sont placées par Dieu dans des circonstances qui deviennent pour elles une école de renoncement et de mortification spirituelle, et où il leur faut conquérir les vertus qui leur coûtent le plus dans une lutte incessante avec leur propre faiblesse. Ainsi, pour ne citer qu’un seul exemple, nous trouvons Marie Bagnesi dans une situation semblable à celle d’Anne Catherine. Elle avait pour garde une personne qui exigeait d’elle avec une dureté insolente les plus humbles offices d’une servante. Cette femme avait été au service des parents de Marie et elle se croyait autorisée par là à se faire servir à son tour par leur fille. Si peu que Marie se trouvât en état de se mouvoir, elle lui ordonnait du ton le plus impérieux de s’occuper du ménage, de porter du bois et de l’eau et de préparer le repas. Elle-même allait faire des visites hors de la maison, et malheur à Marie si, à son retour, elle ne trouvait pas toutes choses arrangées à son gré ! C’étaient alors de sauvages explosions de colère contre lesquelles ne pouvaient rien les douces prières de la patiente qui, les mains jointes devant la poitrine, la suppliait de lui pardonner pour l’amour de Jésus. Mais, quand Marie était clouée sur son lit de malade par de violents accès de fièvre, par les douleurs de la pierre ou par d’autres cruelles souffrances, elle ne pouvait pas obtenir un verre d’eau de cette servante. Elle languissait alors dans l’excès de sa soif, si bien que des chats, qui avaient trouvé le moyen d’entrer dans sa chambre par la fenêtre, y apportaient dans leur compassion de la viande et du fromage, comme s’ils eussent voulu préparer une réfection pour la pauvre délaissée. Il n’en aurait coûté qu’un mot à Marie pour se délivrer de ce fardeau insupportable ; mais elle n’osait pas le dire, persuadée qu’elle ne pouvait trouver une meilleure occasion de pratiquer la douceur et la patience. Ces épreuves, qui se renouvelaient chaque jour sous les formes les plus diverses, étaient pour Marie Bagnesi et pour Anne Catherine ce que sont pour le peuple laborieux des abeilles les bourgeons des arbres ou les fleurs des prairies ; car elles y trouvaient le miel de l’ineffable onction spirituelle au moyen de laquelle elles répandaient la consolation, la lumière, l’édification et une sainte émotion dans les cœurs de tous ceux qui s’approchaient de leur lit de douleur. Elles expiaient ainsi les fautes des cœurs durs, des violents, des vindicatifs, des implacables, de ceux que l’impatience pousse au désespoir, et finissaient par obtenir pour les pécheurs d’habitude les plus endurcis la grâce trop souvent repoussée de la conversion. Elles amassaient ainsi l’inépuisable trésor de bienveillance cordiale, de bonté et de douceur infinies qui, comme un parfum plein de suavité, découlait de ces vases de la miséricorde de Dieu. C’était là qu’elles prenaient l’attrait irrésistible du langage avec lequel elles faisaient revivre la foi et l’amour de Dieu dans tant de cœurs où ils s’étaient éteints. Mais, chargées d’expier comme elles l’étaient, elles avaient à tirer le miel des chardons et des épines et la cire des pierres arides ; car, pour accomplir leur tâche, il leur fallait arroser les épines de leurs larmes comme d’une rosée et amollir la pierre par le feu de leurs souffrances. Sans doute tout ce qui se rattachait à leur vie extérieure était humble et vulgaire, sans toutefois l’être plus que les besoins des pauvres humains de haute ou de basse condition, savants ou illettrés, au secours desquels elles couraient, dont elles expiaient les offenses, pour le salut desquels elles luttaient ; puis devant Dieu, tout cela était grand, éclatant et magnifique comme la poussière de la terre, la sueur, la chaleur et la fatigue qu’a supportées le Fils de l’homme, comme la classe méprisée, profondément abaissée, des publicains et des pécheresses publiques avec lesquels il a frayé, comme l’humble condition des pécheurs galiléens parmi lesquels il a choisi ses apôtres. Car c’est lui-même qui, dans ces instruments qu’il s’est faits, opère et souffre, guérit et sauve ; c’est lui qui veille avec un soin jaloux à ce qu’ils embrassent l’état d’abaissement comme le sceau de leur élection.
XXXII
LE DOCTEUR GUILLAUME WESENER ; SA POSITION VIS-À-VIS D’ANNE CATHERINE. – RAPPORTS D’ANNE CATHERINE AVEC LE MAGNÉTISME.
1. Il est temps d’étudier de plus près un homme qui, sous bien des rapports, tient une place considérable dans la vie de la servante de Dieu et aux fidèles relations duquel nous sommes redevables de la connaissance de tant de faits importants. Comme nous le savons déjà, le médecin du district, Guillaume Wesener, avait été conduit au lit de douleurs d’Anne Catherine par la première publicité donnée à l’existence des stigmates, et un plus long commerce avec elle lui avait fait retrouver la foi qu’il avait perdue et la réconciliation complète avec Dieu. Sa profonde reconnaissance pour cette grâce, dont il se considérait comme redevable à Anne Catherine, le porta à tenir note de ses expériences et de ses observations sur elle ; il voulait conserver le souvenir des faits et des traits nombreux qui lui paraissaient prouver sa vocation extraordinaire et la rare perfection de ses vertus : il mit un soin particulier à noter les incidents et les entretiens qui avaient eu une influence considérable sur lui ou une importance décisive pour le progrès de sa vie intérieure. Ces notes simples et sans art montrent clairement, comme celles que, cinq ans plus tard, Clément Brentano commençait à écrire sur la direction imprimée à son âme par son commerce salutaire avec Anne Catherine, par quelles voies et par quels moyens la vierge favorisée du ciel gagnait les âmes à Dieu et à sa sainte loi. Il serait difficile d’imaginer deux personnes qui, par la direction donnée à leur vie, le tour de leur esprit et leurs facultés naturelles, fussent plus complètement dissemblables que le médecin tout uni de Dulmen et le poète Brentano, si richement et si merveilleusement doué ; et pourtant tous deux s’accordent pour avouer que leur liaison avec Anne Catherine, amenée, non par leur propre volonté et par des projets conçus à l’avance, mais par des circonstances fortuites en apparence, est devenue la disposition la plus féconde en conséquences et la plus miséricordieuse que Dieu ait prise à leur égard. On se plaît aujourd’hui à excuser des hommes fort vantés à cette époque et leurs discours vides et sonores où se faisaient entendre à peine quelques échos lointains de la doctrine chrétienne, en alléguant que la foi de leurs contemporains était devenue trop faible pour pouvoir supporter la vérité tout entière. Mais quoi ! le divin Sauveur aurait-il donné à ses envoyés la mission de celer son saint Évangile en présence de tel ou tel siècle ? ou de soustraire le bienfait de sa parole de salut à ceux-là mêmes qui en auraient le plus grand besoin ? Combien la prétendue sagesse de cet enseignement dirigé selon les principes du monde est confondue par la servante de Dieu qui, fidèle à son fiancé céleste, ne voyait de salut pour ses contemporains délaissés que dans la proclamation de la pleine et pure vérité de la foi catholique, et qui, pour cela, toutes les fois que l’occasion s’en présentait, rendait témoignage à cette vérité dans un langage où se manifestait un esprit dont la lumière de la foi était devenue la loi et la vie.
2. Nous reproduirons, en laissant de côté quelques détails secondaires sans grand intérêt, les paroles mêmes où Wesener rend compte de l’impression produite sur lui par Anne Catherine, non seulement aussitôt après qu’il eût fait connaissance avec elle, mais encore après des rapports de plusieurs années ; nous y ajouterons quelques-uns des entretiens qu’elle avait avec lui sur des choses concernant la foi. Ces récits, avec ceux de Clément Brentano qui seront reproduits plus tard, nous serviront il donner un portrait plus complet et plus vivant de toute la personne d’Anne Catherine, et une idée de son influence extraordinaire sur les âmes.
« Ce fut en l’année 1806, dit Wesener, que j’entendis parler pour la première fois d’Anne Catherine ; j’étais encore médecin à Reklinghausen, d’où Krauthausen, médecin du couvent d’Agnetenberg, m’appela en consultation sur les phénomènes pathologiques inexplicables qui se produisaient chez Anne Catherine. À cette époque, j’avais lu quelque chose sur le magnétisme dans les Archives de Reil et je parlai à mon confrère d’accidents cataleptiques, ce qui toutefois ne lui parut rien éclaircir et ne l’empêcha pas de continuer à traiter sa malade par les moyens médicaux. Krauthausen était un homme âgé, d’un caractère morose, qui traitait gratuitement les malades du couvent, et c’était une des raisons pour lesquelles Anne Catherine n’osait refuser aucun de ses remèdes, quoiqu’elle fût obligée de les payer. Il me raconta que la liste des maladies de cette personne était très longue et qu’elles avaient toutes un caractère particulier, car, à peine était-elle guérie de l’une qu’elle était prise de l’autre ; que chacune suivait son cours et, au montent où la mort paraissait prochaine et inévitable, prenait tout à coup une tournure favorable, sans que l’art médical exerçât là-dessus une influence appréciable. Ce fut le 21 mars 1813 que j’entrai pour la première fois en rapport avec elle. Ayant entendu parler de ses stigmates dans une société peu nombreuse, j’en pris occasion, en ma qualité de médecin, de visiter la nonne malade. Je la trouvai dans son lit, n’ayant pas sa connaissance ; mais, lorsqu’elle revint à elle, elle me regarda d’un air ouvert et amical, et, quand l’abbé Lambert m’eut nommé à elle, elle dit en souriant qu’elle me connaissait bien. Comme tout cela me paraissait très étrange et que je croyais voir là une sotte plaisanterie, je voulus y mettre promptement fin par une attitude grave et imposante ; toutefois mon attente ne fut pas remplie. Plus je frayai avec la malade, plus j’appris à voir en elle mieux que la personne pleine de calme, de candeur et de simplicité qui s’était montrée à moi à la première vue et qu’elle était aux yeux de tout le monde. Je reconnus de plus en plus en elle une âme simple, vraiment chrétienne, vivant en paix avec elle-même et avec le monde entier, parce qu’elle voyait partout la sainte volonté de Dieu. Elle se considérait comme la pire des créatures et préférait les autres à elle-même. Je n’oublierai jamais non plus avec quelle simplicité et quelle bonté, lorsque nous eûmes fait plus ample connaissance, elle chassa le trouble qui m’agitait et calma mes vives inquiétudes sur les dangers menaçants de la guerre. Elle me dit souvent et positivement que Napoléon tomberait bientôt et que Dulmen serait épargné par les armées françaises, ce qui se vérifia d’une façon remarquable. La garnison française de Minden avait dans ses rangs une masse de bandits effrénés qui firent beaucoup de mal à Dorsten, mais qui passèrent près de Dulmen sans y entrer.
« Dans nos rapports, je trouvai la malade toujours simple et naturelle. Elle éprouvait beaucoup de chagrin et de confusion de ce qu’on faisait tant d’état d’elle. Elle était affable et affectueuse pour tous, elle secourait les pauvres en secret et aidait les malades et les malheureux à porter leur fardeau. Ce n’est qu’assez tard que j’ai eu plus de lumières sur cette faculté qu’elle avait de se charger des souffrances d’autrui ; mais on ne pouvait jamais méconnaître en elle cette forme que prenait sa compassion. Elle possédait à un haut degré le don de consoler et j’ai souvent fait l’épreuve de sa charité sympathique. Elle a ressuscité en moi la confiance en Dieu et la pratique de la prière, et n’a pas médiocrement allégé par là les lourds fardeaux que j’avais à porter et qu’aggravait encore un penchant naturel à la mélancolie. Son âme vivait entièrement en Dieu, quoiqu’elle fût sans cesse rappelée dans la sphère des choses terrestres, à cause de la quantité de personnes qui venaient auprès d’elle se soulager du poids de leurs chagrins et lui demander des consolations et des conseils. Elle leur donnait l’un et l’autre et rendait le calme à tous les affligés. On devine aisément où était pour elle la source de ces consolations qu’elle donnait aux autres quand on considère combien son cœur était libre à l’endroit de toutes les créatures.
« Lors de notre premier entretien, elle m’engagea avec un visage souriant et de douces paroles à me calmer et à avoir bon courage. « Dieu est infiniment miséricordieux, disait-elle ; quiconque est repentant, quiconque a bonne volonté trouve grâce devant lui. » Elle m’exhortait en outre fortement à assister et à secourir les pauvres, parce que c’est une œuvre particulièrement agréable à Dieu. Elle disait en gémissant : « Jamais il n’y a eu dans le monde si peu d’amour du prochain qu’aujourd’hui ; pourtant c’est une si belle vertu, et l’indifférence ou le mépris pour le prochain est un si grand vice ! » Elle protestait aussi que la foi catholique est la seule véritable, la seule où l’on puisse trouver le salut. Enfin, toutes les fois que l’occasion s’en présentait, elle parlait chaleureusement de l’incomparable bonheur d’appartenir à l’Église catholique. « Fions-nous à Dieu ! aimait-elle à dire, et tenons à notre sainte foi. Y a-t-il quelque chose de plus consolant sur la terre ? Quelle religion, ou quelle philosophie pourrait la remplacer ? Je plains par-dessus tout les juifs. Ils sont pires à cet égard et plus aveugles que les païens eux-mêmes. Leur religion n’est plus qu’un conte de rabbins et la malédiction du Seigneur repose sur eux. Mais combien le Seigneur est bon à notre égard, lui qui vient comme à moitié chemin au-devant de la bonne volonté et fait dépendre la communication de plus en plus abondante de sa grâce du désir que nous en avons. Même un païen ou un homme qui n’a aucune connaissance de notre sainte foi peut être sauvé, si, ayant une ferme conviction et la volonté sincère de servir Dieu comme le souverain maître et l’auteur de toutes choses, il suit la lumière divine déposée dans notre nature et s’il pratique la justice et l’amour du prochain. »
3. « Une fois, je dirigeai la conversation sur la prière, et je dis que, selon moi, la vraie prière consistait dans l’accomplissement du devoir et la charité envers le prochain, mais que pourtant je désirerais savoir comment elle pouvait persévérer dans l’oraison pendant des heures entières, oublier tout ce qui l’entourait et se perdre, pour ainsi dire, en Dieu. Elle me répondit : « Réfléchissez un peu ; n’est-il pas possible à un homme de s’absorber tellement dans la lecture d’un livre qu’elle lui fasse oublier tout ce qui est autour de lui ? Or, si l’on s’entretient avec Dieu lui-même, qui est la source première de toute beauté, comment ne se perdrait-on pas tout entier dans cet entretien ? Commencez par adorer Dieu en toute humilité, et le reste viendra. » Je répliquai en parlant des tentations que l’homme a à souffrir de l’esprit mauvais, et elle reprit : « Il est vrai que l’ennemi cherche à empêcher l’homme de prier et que, plus celui-ci est fervent, plus l’autre multiplie ses attaques. Une similitude de ce qui se passe alors m’a été montrée un jour. Je me trouvais dans une belle église ; j’y vis trois femmes en prière et derrière elles une horrible figure. Elle caressa la première de ces femmes qui s’endormit. Elle passa ensuite à la seconde qu’elle chercha à endormir aussi, mais n’y réussit pas complètement. Elle frappa et maltraita la troisième au point que j’en eus une grande pitié. Dans ma surprise, je demandai à mon guide ce que tout cela signifiait ; il me fut répondu que c’était un tableau symbolique de la prière. La première femme manquait de sérieux et de ferveur, c’est pourquoi le malin esprit l’avait bientôt endormie. La seconde était meilleure, mais pourtant tiède. La troisième était bonne et sa prière fervente, c’est pourquoi la tentation avait été plus violente, mais heureusement surmontée. Une prière particulièrement agréable à Dieu est celle qu’on fait pour autrui et, par-dessus tout, pour les pauvres âmes en peine. Priez pour elles, si vous voulez placer vos prières à gros intérêt. Quant à ce qui me concerne personnellement, je m’offre à Dieu, mon souverain maître, en lui disant : « Seigneur, faites de moi ce que vous voudrez. » Alors je suis en assurance, car le meilleur, le plus aimant des pères ne peut me faire que du bien. Les pauvres âmes du purgatoire y souffrent des peines inexprimables. La différence entre les souffrances du purgatoire et les supplices de l’enfer consiste en ceci que dans l’enfer le désespoir règne seul, au lieu que, dans le purgatoire, c’est l’espoir de la délivrance qui domine. Le plus grand tourment des damnés est la colère de Dieu. On peut se faire une faible idée de cette colère en pensant à la terreur d’une personne qui voit fondre sur elle un homme en fureur sans avoir aucun moyen d’échapper à ses menaces et à ses violences. »
« Comme je tournais la conversation vers la destination de l’homme, elle me dit : « Savez-vous pourquoi Dieu a créé l’homme ? Pour sa propre glorification et pour notre béatitude. Lors de la chute des anges, Dieu résolut de créer l’homme pour l’élever à la place des légions tombées du ciel. Dès que le chiffre des anges déchus sera égalé par celui des hommes justes qui doivent les remplacer, la fin du monde viendra. » Je lui demandai dans mon étonnement d’où elle avait appris cela ; mais elle répondit qu’à proprement parler, elle ne le savait pas.
4. « Dans un entretien sur les indulgences, où je lui dis que je les regardais seulement comme la rémission des anciennes pénitences ecclésiastiques, elle me répondit : « Non, les indulgences sont quelque chose de plus, car par elles nous obtenons la rémission des châtiments que nous sommes destinés à souffrir après la mort dans le purgatoire. Mais, pour gagner une indulgence, il ne suffit pas de faire tant bien que mal la prière ou la bonne œuvre prescrite, il faut encore s’approcher des sacrements avec un véritable repentir et un amendement réel. J’ai toujours vécu dans la croyance qu’une indulgence ne se gagne pas sans repentir sincère et sans amendement sérieux, et qu’au fond une indulgence est attachée à toute œuvre méritoire. Les bonnes œuvres d’une personne sont aussi diverses que les chiffres : s’il découle sur la moindre d’entre elles quelque chose des mérites de Jésus-Christ, elle acquiert une grande valeur. Ce que nous offrons à Dieu en union avec ces mérites infinis, quand ce ne serait qu’un bon acte des plus insignifiants en apparence, nous est compté par lui et déduit sur les châtiments que nous avons mérités. Je ne puis assez déplorer le triste aveuglement de tant de gens pour lesquels la sainte foi est devenue quelque chose de chimérique. Ils vivent tranquillement dans leurs péchés d’habitude, et avec cela ils s’imaginent pouvoir gagner des indulgences au moyen de certaines formules de prières. Mais beaucoup de chrétiens verront un jour des païens et des Turcs qui se sont efforcés de vivre vertueusement selon la loi naturelle, mieux traités qu’eux au tribunal de Dieu. Nous avons la grâce et nous n’en tenons pas compte ; elle nous est comme imposée, et nous la repoussons loin de nous. Celui qui voit une petite pièce de monnaie dans la poussière court bien vite et se baisse pour la ramasser ; mais, si la grâce du salut éternel est à ses pieds, il fait un effort pour passer par-dessus et s’éloigne pour poursuivre les chimères de ce monde. À ces sortes de gens, les indulgences ne servent de rien ; bien plus, les pratiques religieuses que leur fait faire une aveugle routine seront leur condamnation. »
5. « C’est à cette aveugle poursuite des biens de ce monde que paraissait se rapporter une vision qu’elle raconta ainsi : « Je me trouvai dans une vaste plaine que je pouvais voir tout entière. Elle était couverte d’une multitude innombrable, et tous travaillaient de diverses manières et faisaient les plus grands efforts pour atteindre un but qu’ils se proposaient. Mais, au milieu de la plaine se tenait le Seigneur, plein d’une bonté infinie, et il me dit : « Vois comme ces gens se tourmentent et se fatiguent, comme ils cherchent partout aide et consolation, comme ils courent après le gain ; mais ils ne font pas attention à moi, leur maître et leur bienfaiteur, qui me tiens pourtant ici visible à tous les regards. Il n’y en a qu’un petit nombre qui conserve un sentiment de reconnaissance envers moi ; mais ceux-là aussi se bornent à me jeter un remerciement en passant, comme une chétive aumône. » Il vint alors une troupe de prêtres pour lesquels le Seigneur montrait une inclination particulière ; mais ils passèrent rapidement, lui jetèrent quelque chose à la hâte et se perdirent dans le grand tourbillon. Je n’en vis qu’un seul parmi eux s’approcher davantage, mais d’un air assez indifférent. Quand il fut près du Seigneur, celui-ci le prit par l’épaule et lui dit : « Pourquoi t’éloignes-tu de moi ? Pourquoi ne me payes-tu pas ta dette, à moi qui t’aime si tendrement ? » Là-dessus, cette vision s’évanouit à mes yeux. Mais j’ai eu plusieurs contemplations touchant la manière de vivre de notre clergé actuel, et elles m’ont causé une grande tristesse. Grâce à l’influence de l’esprit du siècle, à la tiédeur générale et à la décadence qui est partout, si le Sauveur aujourd’hui revenait en personne parmi nous pour y annoncer sa doctrine, il trouverait autant de contradicteurs pleins de haine qu’il en a trouvés parmi les Juifs. »
6. « Je lui ai entendu raconter la vision symbolique qui suit sur les doctrines de notre époque et leur enseignement : « Mon conducteur me mena devant un grand édifice et me dit : « Entre là ! je te montrerai les enseignements des hommes. » Nous entrâmes dans une salle spacieuse qui était remplie de professeurs et d’auditeurs. On se disputait avec chaleur ; c’étaient des cris et un tapage sans fin. Ce qui me parut merveilleux, c’est que je voyais jusque dans le cœur des maîtres et que je remarquais dans tous un petit coffret noir. Au milieu de la salle se tenait une grande femme d’apparence imposante qui se mêlait à la dispute et qui proprement donnait le ton. Je restai quelques moments avec mon guide à l’écouter, mais je vis avec surprise que les auditeurs disparaissaient les uns après les autres et que la salle elle-même devint très promptement, et sans qu’on s’en aperçût, comme une vieille ruine au moment de s’écrouler, si bien que le plancher ne présentait plus de solidité à qui y marchait. Les docteurs jugèrent prudent d’aller chercher une autre salle. Ils montèrent un étage plus haut, et se remirent à disputer avec la même ardeur. Mais là aussi l’état de décrépitude et de ruine de l’édifice entier se manifesta si vite, qu’à la fin je me vis avec effroi sur une planche à moitié pourrie et que je priai mon conducteur de me tirer du danger d’être précipitée dans un gouffre profond. Il me rassura et me conduisit en lieu sûr. Comme je l’interrogeais sur la signification du petit coffret noir, il me dit : « C’est la présomption et l’esprit de dispute ; la femme est la philosophie ou, comme ils l’appellent, la raison pure, qui veut tout régler selon ses formules. C’est à elle que s’attachent ces docteurs, et non à la vérité, trésor précieux transmis par la tradition. »
« De là, mon guide me conduisit dans une autre salle, où plusieurs docteurs étaient assis sur des chaises. Là, c’était tout autre chose ; les paroles coulaient avec tant de clarté et de limpidité que j’en étais grandement réjouie. L’ordre et la charité régnaient dans ce lieu, et beaucoup d’auditeurs s’y étaient réfugiés en quittant ces salles qui tombaient en ruines. Mon conducteur me dit : « Ici est la vérité simple et sans artifice. Elle vient de l’humilité et engendre l’amour avec la plénitude de la bénédiction. »
7. « Un jour que j’exprimais à Anne Catherine mon regret de ce que nous ne possédons pas une connaissance plus précise de la vie de Jésus avant sa prédication, elle répondit : « J’en connais jusqu’aux moindres détails, comme si je l’avais vue moi-même. Je connais tout aussi bien l’histoire de la mère de Jésus, et je m’étonne souvent de ce que tout cela est si vivement présent à mon esprit, n’ayant jamais pu le lire nulle part. » Elle me promit de me raconter l’une et l’autre histoire, et, lorsqu’en temps opportun, je lui rappelai cette promesse, elle commença par m’expliquer comme quoi il avait été annoncé à sainte Anne que le Messie naîtrait de sa postérité. « Anne, dit-elle, avait mis au monde plusieurs enfants, mais elle savait que le vrai rejeton n’était pas encore venu ; c’est pourquoi elle s’efforçait par la prière, le jeûne et les sacrifices, d’obtenir la grâce promise. Elle resta environ dix-huit ans sans avoir d’autre postérité, sur quoi elle s’attrista tellement que, dans son humilité, elle attribua à ses péchés l’inexécution de la promesse. Joachim alla en pèlerinage au temple de Jérusalem pour y faire faire un sacrifice expiatoire ; mais il fut repoussé. Il pria avec une grande tristesse et reçut en songe l’assurance que sa femme concevrait. Anne de son côté reçut une semblable promesse et enfanta au temps déterminé la petite Marie. Alors Joachim et Anne, reconnaissant en elle le pur don de Dieu, résolurent de la conduire au temple et de la consacrer au service du Seigneur. Ils conduisirent Marie au temple dans sa troisième année. Quand ils furent arrivés, ils voulurent prendre par ses petites mains leur enfant qui était habillée d’une robe bleu de ciel, et l’aider ainsi à monter les hauts degrés du temple. Mais l’enfant les franchit seule avec beaucoup d’agilité et arriva ainsi dans le temple avec ses parents. En prenant congé d’eux, la petite Marie ne fut ni inquiète, ni triste ; mais elle se confia paisiblement à la garde des prêtres. On l’instruisit de toute espèce de choses et on lui donna du travail à faire pour le temple. Lorsqu’elle eut atteint sa quatorzième année, on écrivit à ses parents de reprendre leur fille, parce que, d’après les statuts, on ne devait garder aucune jeune fille au-delà de cet âge. Elle serait volontiers restée au temple dans l’état de virginité ; mais cela ne lui fut pas accordé. Ses parents étaient embarrassés de trouver un époux digne d’un enfant si admirable ; alors, ils eurent recours au temple pour y faire interroger le Très-Haut. L’ordre fut donné aux jeunes gens qui prétendaient à la main de Marie de porter leurs bâtons dans le Saint des Saints ; mais on les y retrouva tels qu’ils y avaient été déposés. De nouvelles prières et de nouveaux sacrifices ayant été faits, une voix annonça qu’il manquait encore le bâton d’un jeune homme. On fit des recherches et on trouva enfin Joseph, issu d’une noble famille, mais qui était méprisé des siens à cause de sa simplicité et parce qu’il était resté célibataire. Il apporta aussi son bâton qui, placé dans le Saint des Saints, y fleurit le lendemain et se trouva surmonté d’un lis blanc. Là-dessus, Marie fut fiancée à Joseph et, quand Marie lui fit part de son vœu de virginité perpétuelle, il en fut tout joyeux. Marie pensait toujours au Rédempteur promis ; mais, dans son humilité, elle ne demandait à Dieu que de vouloir bien faire d’elle la servante de la mère élue par lui. C’est pourquoi elle fut surprise jusqu’à en être effrayée quand l’ange lui annonça sa sublime maternité ; mais elle ne dit rien à son mari de toutes ses visions ni du message de l’ange. »
« Il arrivait aussi à Anne Catherine, en parlant de l’aumône et de la pratique des devoirs d’état, de faire mention de ses contemplations. Ainsi, elle me dit un jour : « Employez vos forces et ce que vous possédez à faire du bien à vos malades, mais sans faire tort à votre propre famille. D’ailleurs, ce n’est pas un seul nécessiteux, mais plusieurs qui réclament votre assistance. Les pauvres doivent trouver leurs mérites dans la pauvreté, car la foi nous apprend que la pauvreté est un état digne d’envie, puisque le Fils de Dieu lui-même l’a choisi pour lui et qu’il a donné aux pauvres les premiers titres au royaume des cieux. » À cette occasion, elle raconta des traits singulièrement gracieux de l’enfance de Jésus-Christ, et elle dit que Marie, quelques jours après la nativité, s’était tenue cachée dans une demeure souterraine pour éviter l’affluence des curieux. »
8. Quand Wesener fut entré dans des rapports de plus en plus intimes avec Anne Catherine, il devint clair que Dieu l’avait appelé près d’elle, comme plus tard Clément Brentano, en qualité d’instrument qui devait l’aider à accomplir sa mission. Elle prit l’habitude de se servir de lui comme d’une main par laquelle elle faisait arriver sans cesse des dons charitables à des pauvres et à des malades qui ne pouvaient pas venir la trouver. Il avait toujours à traiter comme médecin une quantité de pauvres auxquels il distribuait, d’après les conseils d’Anne Catherine, non seulement ses propres aumônes, mais encore l’argent, les chemises et les pièces d’habillement qu’elle lui remettait pour cela. Par une bénédiction particulière de Dieu, la pieuse fille était en mesure de distribuer, chaque année, des aumônes de toute espèce tellement abondantes qu’elles dépassaient de beaucoup le montant de sa pension de 180 thalers. Tout instant du jour ou de la nuit qu’elle pouvait employer à des travaux manuels appartenait aux pauvres et aux malades, et, quand ses minces ressources ne suffisaient pas à lui procurer ce qu’il fallait de laine et de toile, elle savait se le faire donner par des âmes charitables ; sous ses adroites mains, des chiffons de soie qu’il semblait impossible d’utiliser se transformaient rapidement en jolis petits bonnets pour les nourrissons de pauvres accouchées. Elle avait même coutume de s’adresser, avec une familiarité touchante, à sainte Lidwine, à Madeleine d’Hadamar et à d’autres bienheureuses vierges stigmatisées d’une époque plus rapprochée, pour obtenir, par leur intermédiaire, les étoffes qui lui manquaient. Elle leur disait avec chaleur, comme si elle eût eu affaire à des vivants : « Chère Madeleine, est-ce toi ? Vois, nous touchons à Noël, et il y a encore tant d’enfants qui ont besoin de bas et de bonnets ! Il faut que tu tiennes ta promesse et que tu m’apportes de la laine et de la soie. » Mais jamais elle n’avait à se plaindre que ses prières restassent sans résultat.
Wesener avait coutume de lui décrire les souffrances de ses malades, et il put ainsi, d’après des expériences presque journalières, acquérir la ferme conviction qu’elle voyait et assistait en esprit chacun de ceux qu’il avait à traiter. Il usait avec le plus grand succès de ses indications et de ses conseils, et souvent il reconnaissait avec surprise que ses malades étaient redevables d’un mieux inattendu, non pas aux remèdes qu’il leur donnait, mais à l’assistance d’Anne Catherine, qui avait pris sur elle les maladies pour faciliter la guérison de ceux qui en souffraient ou pour leur préparer une bonne mort.
Il fut jusqu’au dernier instant, à la grande consolation d’Anne Catherine, le fidèle ami et soutien de l’abbé Lambert. Ce vieillard infirme ne pouvait plus se passer des secours de la médecine, et Wesener les lui donnait avec une charité attentive que sa vénération pour Anne Catherine pouvait seule lui imposer. Or celle-ci était très occupée de l’abbé Lambert, comme le montre un incident où l’on peut voir aussi un exemple des avertissements surprenants qu’elle recevait d’avance sur des dangers prochains.
Voici ce que rapporte le journal de Wesener, à la date du 15 février 1815 : « Je voulais, dit-il, tranquilliser la malade à propos de très grandes craintes qu’elle ressentait pour l’abbé Lambert. Celui-ci souffre d’une toux chronique avec oppression de poitrine, et il a eu aujourd’hui un accès si violent qu’il était tombé dans une espèce de paralysie et qu’il avait perdu connaissance. Cela arriva dans la chambre de la malade et heureusement en présence de son confesseur, lequel me confia que, le jour précédent, elle l’avait prié très instamment de rester aujourd’hui près d’elle dans l’après-midi, parce qu’elle avait de graves inquiétudes. Et cette prière avait été cause que le père Limberg s’était trouvé présent en ce moment. »
9. Les rapports de Wesener avec le père Limberg lui-même eurent encore plus d’importance pour Anne Catherine. Cet homme craintif, malgré tout ce qu’il avait vu, aurait abandonné sa fille spirituelle dès qu’il avait eu connaissance des sottes calomnies répandues contre elle, s’il n’eut été soutenu par le médecin qui avait l’expérience du monde et que rien ne pouvait ébranler. Le père Limberg ne possédait pas l’énergie nécessaire pour répondre tranquillement et sans hésitation aux contradictions, aux arguments spécieux ou aux suspicions malignes qui se produisaient avec une confiance présomptueuse. Il s’effrayait, tergiversait et se disait qu’il valait mieux tout laisser là que de s’exposer à de telles tracasseries. Cependant il reprenait toujours courage près de Wesener, car il voyait avec quel sérieux et quelle persévérance celui-ci remplissait les devoirs d’un bon chrétien, depuis qu’Anne Catherine l’avait ramené à la foi, et avec quelle indifférence pour le jugement de la foule il rendait témoignage à la vérité clairement reconnue. Cela l’encourageait et le fortifiait, mais lui donnait aussi une confiance sans bornes dans Wesener, en sorte qu’il faisait un devoir à sa pénitente d’user avec docilité de tous les remèdes qu’ordonnait le docteur. Anne Catherine se trouvait donc par là, envers Wesener, exactement dans la position où elle avait été autrefois à Agnetenberg envers Krauthausen, le médecin du couvent. Cependant, encore ici, elle se soumettait avec une simplicité et une abnégation parfaites à toutes les ordonnances, et le médecin comme le confesseur restaient intimement persuadés que les plus fortes doses de musc, d’opium et de camphre, sans parler de l’eau-de-vie bouillante, étaient les moyens les plus appropriés à la guérison de ce corps miraculeux qui ne portait jamais en lui-même les causes de ses maladies, mais qui endurait en elles les souffrances de l’Église. Jamais une plainte ne venait sur ses lèvres quand un surcroît de douleur ou l’étourdissement stupéfiant causé par ces remèdes lui montraient clairement combien ils lui étaient contraires ; elle se montrait même d’autant plus docile, plus affectueuse et plus reconnaissante, au point que des années se passèrent avant que Wesener et Limberg missent quelque modération dans l’application de leurs moyens curatifs. Un seul fait suffira pour apprendre dans quelle proportion ils étaient administrés. Voici ce que dit le journal de Wesener à la date du 16 niai 1814 :
« La malade souffre le martyre ; elle a des douleurs terribles dans le diaphragme et semble avoir perdu l’ouïe. Son entourage l’a déjà plusieurs fois crue à la mort. Les spasmes dans l’estomac et le gosier sont si fréquents que nous devons nous attendre à une fin prochaine. La malade, en outre, est si défaite et souffre si horriblement, que le père Limberg veut lui donner l’extrême-onction. Je ne pense pas que ce soit encore absolument nécessaire ; en attendant, il m’est impossible de rester plus longtemps simple spectateur de pareilles souffrances, et je suis obligé de faire violence à la conviction où je suis qu’aucun remède n’y peut rien faire, la malade ne pouvant rien garder... Je lui ai donné quatre gouttes de musc qui ne sont pas arrivées jusqu’à l’estomac, mais qui ont été rejetées aussitôt. J’ai fait encore donner la même dose par intervalles, mais sans plus de succès. Dans la nuit, la malade a terriblement souffert. On lui a fait prendre du musc à plusieurs reprises ; mais elle a toujours été forcée de le vomir à l’instant, et ce n’est qu’après minuit qu’elle en a enfin avalé cinq gouttes sans difficulté. Les spasmes ayant augmenté le matin, on a encore donné à deux reprises cinq à six gouttes. Je l’ai trouvée dans un état de prostration indescriptible ; son aspect était vraiment effrayant. En la quittant, je ne croyais pas la retrouver en vie. Le 18 mai, elle fut sans connaissance presque toute la journée. Plusieurs fois elle avait vomi de l’eau avec des efforts terribles. Je me suis décidé à veiller la nuit auprès d’elle. Son état ne varia pas jusqu’à minuit ; mais alors il vint un peu de calme et de sérénité. Je lui fis une lecture dans un livre de piété, et je l’entretins ensuite de sujets religieux. Cela la soulagea tellement qu’elle fut en état de parler comme à l’ordinaire. Comme je lui exprimais mon étonnement, elle répondit : « Cela m’arrive toujours ainsi. Quelque faible que je sois, je me sens toujours soulagée et fortifiée quand on parle de Dieu et de notre sainte religion ; mais, si l’on parle des choses du monde, cela empire encore mon état. »
Lorsque, six ans plus tard, Clément Brentano fut témoin d’un essai du même genre qu’on faisait avec du musc, il exprima involontairement son vif déplaisir, et elle lui dit à ce propos : « Il est vrai que ce remède m’est particulièrement antipathique ; j’en ai beaucoup souffert et il m’a fait beaucoup de mal. Mais je dois le prendre par obéissance pour mon confesseur, qui pourtant a déjà vu, par plus d’une expérience, dans quel état de faiblesse me fait tomber l’emploi de ce médicament. »
10. Peu de temps après, ayant eu une vision où Dieu lui avait fait voir beaucoup de choses touchant le cours de sa vie passée, elle racontait les particularités suivantes, qui se rapportent aux remèdes donnés à contretemps et aux conséquences qu’ils avaient eues :
« J’ai eu une vision qui m’a paru présenter le côté douloureux de mon existence. Tout ce que des personnes de ma connaissance ont fait durant ma vie pour contrarier ma tâche m’a été montré dans des tableaux où figuraient ces personnes : c’étaient des choses auxquelles je n’osais jamais penser, de peur qu’elles ne devinssent pour moi des tentations d’aversion et de mécontentement. J’ai encore essayé d’y résister cette nuit ; je me suis défendue et j’ai lutté avec beaucoup d’efforts ; mais j’ai eu la consolation de m’entendre dire que j’avais bien combattu.
« Les choses m’ont été représentées de différentes manières : tantôt c’était comme si une épreuve passée fût redevenue actuelle, tantôt je voyais des gens qui s’empressaient, tantôt cela m’arrivait comme un récit. En outre, on m’a montré tout ce que j’ai perdu par là dans ma vie corporelle et dans mon action spirituelle, et j’ai vu clairement de combien de mal telles ou telles personnes ont été cause pour moi à mon insu ; car tout ce qu’auparavant je soupçonnais seulement sans en avoir la certitude, je l’ai vu distinctement dans son ensemble. Ç’a été une rude épreuve que de ressentir de nouveau les douleurs et les angoisses de ma vie passée, avec toute la méchanceté et la fausseté des hommes, et non seulement de ne me laisser aller à aucun ressentiment, mais d’avoir la plus sincère affection pour les plus cruels ennemis.
« Les visions ont commencé par ce qui touchait ma profession religieuse et par tout ce que mes parents ont fait pour l’empêcher. Ils ont exercé ma patience et ont tout fait en secret. Les nonnes m’ont fait beaucoup souffrir. J’ai vu leur grande déraison ; comment d’abord elles m’ont maltraitée, puis quand mon état fut connu, comment elles m’honoraient d’une manière exagérée et pourtant revenaient sans cesse à leurs commérages. Elles m’ont fait bien du mal, car je les aime beaucoup. J’ai vu le médecin du couvent, ses remèdes, et combien ils m’étaient nuisibles. J’ai vu le second médecin, comment ses remèdes m’ont ruiné la poitrine et m’ont mise dans l’état le plus misérable. J’ai vu ma poitrine comme entièrement vide et creuse, et je sentais que, sans de grandes précautions, je pouvais m’en aller bien vite. J’aurais pu guérir de toutes mes maladies, sans aucun traitement médical, si l’on avait appliqué à propos les remèdes de l’Église.
« J’ai vu le tort qu’on a eu de me trop mettre en lumière, de ne regarder qu’à mes plaies et de ne pas tenir compte des autres circonstances. J’ai vu comment j’ai été forcée de m’exposer aux regards de tous, ce qui m’a dissipée et n’a fait de bien à personne ; j’aurais pu être bien plus utile si l’on m’avait laissée en repos. J’ai vu mes prières et mes supplications pour obtenir qu’on m’y laissât, prières que je ne faisais pas de moi-même, mais par suite d’un avertissement intérieur ; j’ai vu comment tout a été inutile, et comment, contrairement à mon intime conviction, je suis devenue un spectacle pour le monde. Il m’a fallu subir les plus grandes humiliations ; mais ce que je faisais dans l’affliction de mon cœur et par pure obéissance m’était d’autre part reproché comme de l’effronterie, sans que ceux qui me contraignaient à livrer mes signes en proie au public prissent ma défense. »
Quelque fréquemment qu’Anne Catherine fût favorisée de contemplations de ce genre, sa position extérieure ne changeait pas. Le traitement absurde qu’elle avait à supporter de la part de ses amis et de ses ennemis persistait après comme avant, et les ordonnances des médecins allaient leur train ; mais, grâce à ces visions, son âme recevait la lumière qui lui faisait reconnaître dans les personnes et dans les choses les instruments et les moyens préparés par Dieu pour la faire avancer de plus en plus vers son but, si elle persévérait fidèlement ; elle y trouvait aussi l’impulsion et la force qui l’aidaient à réparer, par un redoublement de charité et de patience, les fautes que lui faisait commettre la fragilité humaine. L’ange, dont elle recevait d’ailleurs tant d’avis, ne lui ordonnait jamais de repousser les remèdes. Cela entrait dans le plan de Dieu, d’après lequel Anne Catherine, tenant la place du corps de l’Église, avait à expier le péché de ceux qui, par des doctrines, des principes, des desseins et des mesures nuisibles, cherchaient à exercer sur l’Église une action analogue à celle que produisaient sur Anne Catherine elle-même le musc, l’opium, le camphre et les lotions d’eau-de-vie. Elle avait la conscience que son expiation était d’autant plus efficace qu’elle se soumettait avec plus de simplicité et de docilité aux prescriptions qui lui imposaient l’usage de ces médicaments ; c’est pourquoi on ne rencontrait chez elle ni résistance, ni contradiction. Mais quand on sait de quels fléaux destructeurs l’Église était menacée à cette époque, quand on se souvient, par exemple, des ravages que faisaient l’esprit malsain du philosophisme et l’exaltation factice du faux mysticisme qui, chez un si grand nombre de ses adhérents, aboutissait ordinairement à des débordements monstrueux, on est conduit involontairement à reconnaître dans l’opium et l’eau-de-vie frelatée un symbole frappant de ces fausses doctrines.
11. Il y avait, en outre, les dangers provenant du magnétisme contre lesquels Anne Catherine devait agir, au moyen de diverses souffrances expiatoires, et ici aussi le médecin et le confesseur furent les premiers qui essayèrent de la guérir par des moyens magnétiques, de même qu’auparavant ils l’avaient essayé à l’aide de l’opium et du musc. Wesener dit à ce sujet :
« M. Limberg me raconta qu’Anne Catherine étant dans un état de catalepsie, il avait fait sur elle diverses expériences magnétiques, mais qui n’avaient eu aucun succès. Je me proposai alors de faire les expériences moi-même à la première occasion. Je commençai peu de jours après, pendant que la malade était en extase. Tout son corps était raide et immobile. Je prononçai quelques paroles sur le creux de l’estomac, sur l’extrémité des orteils ; je mis le bout des doigts de ma main droite sur le creux de l’estomac et je parlai sur le bout des doigts de la main gauche ; je lui criai dans l’oreille : mais rien de tout cela ne fit sur elle la moindre impression. Sur mon désir, le confesseur répéta les mêmes tentatives, qui restèrent également sans effet. Mais, lorsqu’il prononça le mot d’obéissance, elle tressaillit tout d’un coup en poussant un profond soupir, reprit l’usage de ses sens, et, comme le confesseur lui demandait ce qu’elle avait, elle répondit : « On m’a appelée. »
Le médecin et le confesseur s’abstinrent alors de nouvelles tentatives jusqu’au mois de janvier de l’année suivante ; mais, pendant ce mois, Anne Catherine tomba dans un tel état de souffrance que l’un et l’autre pouvaient à peine en supporter la vue. Durant plusieurs semaines, elle eut, chaque jour, pendant une heure, des douleurs spasmodiques au cœur, avec des accès de suffocation d’une telle violence que la mort semblait inévitable ; cependant la communion quotidienne lui donna la force de résister à ces effroyables douleurs. Ce ne fut pas la malade, mais le médecin et le confesseur qui furent déconcertés et perdirent enfin patience. Voici ce que rapporte Wesener à la date du 26 janvier :
« J’étais le soir chez elle. Elle était horriblement mal, et le pouls était tombé très bas. Vers cinq heures, survint une sorte de spasme tonique. Les yeux de la malade étaient ouverts, mais insensibles au point que je pouvais toucher la cornée avec le doigt sans que les paupières se fermassent. Le jour précédent, comme elle pouvait un peu parler, elle m’avait révélé que sa vue était si étonnamment perçante que, même à l’état naturel de veille, elle pouvait voir beaucoup d’objets les yeux fermés. Le spasme tonique dura une heure ; mais, peu de temps après, elle tomba en extase, se releva sur les genoux et pria les bras étendus. J’engageai son confesseur à essayer du magnétisme, c’est-à-dire à lui demander quelle était sa maladie et où en était le siège principal. Il le fit à plusieurs reprises et en insistant ; mais la malade ne répondit pas. Je le priai alors de lui ordonner de le dire en vertu de l’obéissance. À peine le mot d’obéissance était-il parti de sa bouche qu’elle tressaillit et s’éveilla avec un profond soupir. Interrogée sur son mouvement d’effroi, elle répondit : « Quelqu’un m’a appelée. » Elle tomba de nouveau dans une défaillance causée par la faiblesse, et je lui donnai douze gouttes d’essence de musc. Le lendemain matin, elle me dit qu’elle avait passé toute la nuit dans un état de vertige continuel, par suite de sa faiblesse. » Et certainement encore plus à cause du musc qu’elle ne pouvait supporter.
Il n’y avait pas de guérison possible pour cet état de souffrance, parce qu’il avait sa cause non dans une maladie corporelle, mais dans les péchés d’autrui qu’Anne Catherine s’était chargée d’expier ; c’est pourquoi elle ne put répondre à la demande que lui faisait son confesseur. S’il avait désiré qu’elle rendît compte de ses contemplations intérieures, il aurait sans doute reçu des explications complètes. Quand, enfin, les convulsions cessèrent, la malade fut prise de vomissements continuels d’un liquide aqueux, quoiqu’elle ne pût pas avaler une goutte d’eau et qu’elle mourût presque de soif. Cependant elle fut chaque jour plusieurs heures dans un état de prière extatique qui, le 9 février, dura environ neuf heures sans interruption. Elle donna l’explication suivante au confesseur, ainsi qu’au médecin qui voyait son art et ses efforts déconcertés par ces souffrances et dont la sympathie cordiale la touchait :
« Jeudi (8 février), comme je disais mes heures, ma méditation se porta sur notre indignité et sur la miséricorde et la longanimité infinies de Dieu ; je fus toute bouleversée par la pensée qu’en dépit de ces miséricordes, tant d’âmes se perdent pour toujours. Je ne pouvais m’empêcher de supplier le Seigneur de faire grâce à ces malheureux. Je vis alors tout à coup ma croix, qui est là-dessous attachée au montant du bois de lit 28, entourée d’une lueur brillante. J’étais parfaitement éveillée, avec le plein usage de mes sens ; je me dis : « N’est-ce pas une vaine imagination », et je continuai à dire mes heures ; mais l’éclat de la croix m’éblouissait. Alors je fus forcée de reconnaître que ce n’était pas une illusion ; je me recueillis et priai avec toute la ferveur possible, demandant à Dieu, mon Sauveur, grâce et miséricorde pour tous et surtout pour les faibles et les égarés. L’éclat de la croix devint plus vif et je vis alors un corps qui y était attaché. Des plaies de ce corps crucifié, le sang coulait à flots jusqu’au bas de la croix ; mais je ne le vis pas se répandre en dehors de la croix. Je redoublai ma prière et mes actes d’adoration ; alors le corps étendit son bras droit en l’arrondissant, comme s’il voulait nous embrasser tous ensemble. Pendant que tout cela se passait, j’avais tellement ma connaissance que j’observai très bien plusieurs objets autour de moi et qu’entre autres choses je pus, chaque fois que l’horloge sonna, en compter tous les coups. J’entendis en dernier lieu sonner six coups ; mais je ne sais rien de ce qui se passa ensuite autour de moi. J’entrai alors tout entière dans la contemplation intérieure, et je méditai sans interruption la Passion de Jésus-Christ. J’ai vu toute l’histoire de la Passion de mes propres yeux, exactement comme dans la réalité. J’ai vu le Sauveur sortir, portant sa croix ; j’ai vu Véronique et Simon contraint de porter la croix. J’ai vu le Seigneur étendant ses membres, puis cloué à la croix. Cela me bouleversait jusqu’au fond de l’âme ; j’avais de la tristesse, mais avec un mélange de joie. Je vis la mère du Seigneur et plusieurs de ceux qui lui appartenaient. Je continuai à adorer mon Seigneur Jésus et à lui demander merci pour moi et pour tous les hommes. Là-dessus, il me dit : « Vois mon amour ; il est sans bornes ! Venez, venez tous dans mes bras ; je veux tous vous rendre heureux ! » Mais alors je vis que la plupart se détournaient de lui et s’arrachaient violemment à ses embrassements. Dès le commencement de cette apparition, je priai le Seigneur, en vue de la guerre présente, de nous donner enfin la paix et de mettre fin aux horreurs des combats ; je lui ai demandé de nouveau grâce et merci. Alors une voix me dit : « Ce n’est pas encore la fin de la guerre ; plus d’un pays s’en ressentira encore cruellement ; toutefois, prie et aie confiance ! » Maintenant, j’espère très fermement que le pays de Munster et Dulmen ne seront pas trop maltraités. »
« M. Lambert et la sœur de la malade ont encore rapporté que, pendant tout le temps de cette apparition, c’est-à-dire depuis dix heures du matin jusqu’à cinq heures du soir environ, elle était restée très calme ; notamment, qu’elle eut, de dix heures à midi, les yeux ouverts et le visage coloré, mais depuis midi jusque vers cinq heures, les yeux fermés et tout à fait immobiles. Ils n’avaient rien remarqué de plus chez elle, si ce n’est que des larmes à peu près continuelles coulaient sur ses joues. »
Le 8 février était le jeudi d’avant la Septuagésime. Anne Catherine avait reçu ce jour-là la tâche qu’elle avait à remplir pendant le saint temps de Carême et elle l’avait acceptée avec un ardent désir du salut des âmes. Son humilité l’empêchait de communiquer au médecin, sans l’ordre exprès du confesseur, des détails plus précis tirés de sa contemplation qui embrassait beaucoup de choses ; mais le peu qu’elle dit suffit pour que Wesener ne pensât plus de quelque temps à une application ultérieure des moyens magnétiques. Ni lui ni le confesseur n’osèrent faire mention devant Anne Catherine de leurs tentatives avortées, car il leur fallait bien reconnaître qu’elles avaient trop peu agi sur elle pour qu’elle en eût le moindre sentiment ou le plus faible souvenir. Ils laissèrent donc la chose tomber dans l’oubli ; mais, un an plus tard, un ami de Neeff et de Passavant vint à Dulmen pour faire des observations sur Anne Catherine qu’il croyait un sujet magnétique. Ce médecin était plein d’un enthousiasme touchant au fanatisme pour la somnambule de Neeff et en général pour le magnétisme où il prétendait avoir trouvé une telle confirmation de la foi chrétienne qu’il déclarait hautement avoir été guéri par là d’une incrédulité absolue. Comme il avait à un rare degré le don de la persuasion, il ne lui fut pas difficile de faire avouer à Wesener et à Limberg que des vues aussi élevées sur le magnétisme ne leur avaient jamais été présentées ; et tous deux, malgré les expériences antérieures faites sur Anne Catherine, étaient sur le point de se déclarer partisans et défenseurs de la médecine magnétique, lorsqu’intervint une sagesse plus haute qui fit connaître la vérité avec une clarté irrésistible. C’est par le journal de Wesener que nous savons comment les choses se passèrent.
12. Le Samedi saint, 5 avril 1817, le doyen Rensing fit annoncer à la malade la visite d’un médecin étranger arrivé de Francfort, lequel avait apporté un ordre écrit de le recevoir adressé à Anne Catherine par le vicaire général de Droste. Elle en fut si affligée qu’elle pria Wesener de représenter au doyen combien lui étaient pénibles les visites en général, et spécialement celle d’un homme qui était venu de si loin à cause d’elle. Le doyen n’accueillit point cette prière ; mais il réitéra l’ordre, qui fut communiqué à Anne Catherine par Wesener. Voici ce que celui-ci rapporte à ce sujet :
« Lorsque je lui annonçai cela, elle en fut d’abord attristée, mais reprit bientôt contenance et dit : « Puisqu’il en est ainsi, je me soumets par obéissance. » Elle me pria alors de venir avec l’étranger, à cause de la difficulté qu’elle avait à parler. Quelques heures après, je l’amenai. Elle le reçut poliment ; mais il fut tellement frappé à son aspect qu’il se jeta à genoux et demanda à lui baiser la main. Elle retira sa main avec une sorte d’effroi et reprocha à cet homme son exagération. Elle ne comprenait pas, disait-elle, comment un homme raisonnable pouvait se laisser aller à donner de telles marques de respect à une misérable créature comme elle ; dans la soirée du même jour, elle m’exprima encore la douleur la plus vive de cet incident si affligeant pour elle, s’humilia et dit : « Que de tentations j’ai à combattre ! que d’épreuves pour la patience et l’humilité ! Voici maintenant qu’arrivent des tentations d’une espèce qui m’était inconnue jusqu’à présent ! »
Peu de jours après, Wesener rapporte ce qui suit :
« Grâce aux entretiens instructifs de M. le docteur N... avec M. Limberg et avec moi, nous nous sommes familiarisés davantage avec le magnétisme et nous avons reconnu qu’il n’est autre chose « que l’écoulement d’un esprit vital déterminant sur le malade ». Cet esprit, qui est répandu dans toute la nature, est reçu par le malade au moyen d’une communication spirituelle ou même corporelle ; il agit alors, dans celui qui le reçoit, d’après la nature de son principe ; y allumant une flamme qui appartient soit à la terre, soit aux régions supérieures, soit même aux régions inférieures, et opérant, suivant son origine, des effets salutaires ou pernicieux. Cet esprit vital, le chrétien peut et doit l’enflammer par la religion et par l’amour de Dieu et du prochain, de manière à le rendre salutaire pour le corps et pour l’âme. »
Wesener savait pourtant par de fréquentes expériences ce qui avait le pouvoir d’enflammer Anne Catherine, et, peu de temps avant, il avait écrit sur son journal : « Je l’ai trouvée aujourd’hui toute vermeille et comme enflammée ; je lui en demandai la cause, et elle me répondit : « M. Overberg est venu ici, et je n’ai parlé que de Dieu avec lui ; cela m’a fort animée ; mais, en outre, je ne me sens pas mal. » Or, ce même Wesener, soutenu par le confesseur, vint la trouver, tout plein de sa découverte de l’esprit vital magnétique, et il lui exposa avec tant de chaleur cette science nouvelle pour lui qu’elle put facilement reconnaître sur quelles dangereuses voies le père Limberg et lui étaient au moment de s’égarer. Elle se contint pourtant avec sa prudence ordinaire, écouta patiemment les zélés adeptes sans les contredire, et ne prit la parole que quand son ange lui en eût donné l’ordre. Voici ce que dit Wesener à ce sujet :
« Dans une visite postérieure, la malade me pria de rester un peu, parce qu’elle désirait me faire une ouverture. « Vous avez remarqué, dit-elle, comment j’ai accueilli ce que le père Limberg, le docteur étranger et vous, m’avez dit sur le magnétisme. Je me suis montrée à peu près indifférente ; cependant, j’étais bien aise de ce qu’au moins vous vous efforciez de présenter la chose par un côté moral. Mais voilà que j’ai été avertie en vision pour la troisième fois. La première vision n’était pas favorable au magnétisme ; la seconde me le présenta sous un jour qui me remplit d’effroi ; mais, la nuit dernière, mon conducteur m’a montré que, dans ce qui s’y passe, presque tout est un prestige du démon. J’espère que je trouverai la force nécessaire pour vous raconter cela en détail. Quant à présent, je ne puis vous dire qu’une chose : si nous voulons faire ce qu’ont fait les prophètes et les apôtres, nous devons aussi être ce que ces hommes étaient, mais alors nous n’avons aucun besoin de ces manipulations dont un magnétiseur fait usage, car, dans ce cas, le saint nom de Jésus suffit pour opérer ce qui est bon et salutaire. Qu’on s’efforce d’opérer une guérison au moyen de quelque chose qui se transmet d’une personne bien portante à un malade, ce n’est pas mauvais en soi ; mais les tours de passe-passe qu’on y ajoute sont quelque chose de sot et d’illicite. Le sommeil magnétique et l’intuition de choses éloignées et futures pendant ce sommeil, voilà où est le prestige du démon. Il se donne dans tout cela une apparence de piété pour gagner par là des adhérents et surtout pour attirer les gens de bien dans ses filets. » Elle dit cela d’un ton si grave que je lui répondis qu’en présence d’un semblable jugement, je ne me croyais pas autorisé à continuer une cure magnétique commencée sur une fille de la campagne qui avait un bras paralysé. Elle me demanda comment je m’y prenais, et, quand je lui dis que je faisais des passes avec les mains, que je traçais des cercles et que je soufflais sur la partie malade, que la malade buvait de l’eau magnétisée et portait autour du membre perclus une bande de flanelle également magnétisée, elle me dit : « Je puis, à la rigueur, considérer l’insufflation et le réchauffement du membre malade par l’imposition des mains comme des moyens naturels ; mais je repousse les passes et les cercles tracés comme des choses déraisonnables et conduisant à une superstition dangereuse. »
« Je lui demandai alors ce qu’elle pensait des vues du docteur étranger, et elle me dit : « Il faut bien se tenir sur ses gardes pour ne pas tomber dans la maison avec la porte. Cet homme reviendra sur le bon chemin, et j’ai la confiance que je pourrai lui être utile. »
13. Cet entretien fit une profonde impression sur Wesener, déjà convaincu par tant d’expériences de tout ce qu’il y avait de clairvoyance et de perspicacité chez Anne Catherine ; mais, dans son zèle, il oublia l’avis qu’elle lui avait donné de ne pas blesser l’étranger en lui faisant connaître trop brusquement cette sévère appréciation. Il lui communiqua sans l’y avoir préparé tout ce qu’avait dit Anne Catherine, et cela causa à celui-ci une surprise d’autant plus pénible qu’il avait une très haute opinion des lumières et de la piété de la somnambule de Francfort et de ses admirateurs. C’est pourquoi, loin d’être ébranlé par le jugement d’Anne Catherine, il répondit avec beaucoup de vivacité qu’on ne pouvait pas admettre que des hommes aussi graves et animés de sentiments aussi pieux pussent avoir quelque chose de commun avec le mauvais esprit ; enfin, pour se rassurer, il prétendit qu’Anne Catherine n’avait vu le magnétisme que par son côté ténébreux, mais non par son côté lumineux. Or, selon lui, ce côté lumineux pouvait encore arriver à se faire reconnaître avec l’aide du confesseur. Il pria donc celui-ci de guérir le violent mal de dents dont Anne Catherine souffrait alors par l’imposition des mains et la bénédiction sacerdotale ; il appelait cela le « procédé curatif magnétique ». Le confesseur qui pourtant, depuis des années, avait mille fois expérimenté la merveilleuse sensibilité d’Anne Catherine à l’égard de la bénédiction du prêtre et de l’efficacité curative des moyens employés par l’Église, voyant cette fois le prompt soulagement qu’avait apporté l’imposition de ses mains, se sentit porté à en chercher la cause, non dans la vertu du caractère sacerdotal, mais dans l’esprit vital magnétique. Ce même homme qui, d’ordinaire, ne faisait usage pour Anne Catherine du pouvoir de bénir conféré à sa main par le sacrement de l’ordre que quand il la croyait à toute extrémité, se laissait maintenant entraîner par l’attrait de la nouveauté à soumettre « au procédé curatif magnétique » toute manifestation d’une souffrance physique chez sa fille spirituelle. Anne Catherine ne fut pas peu contristée de ce travers d’esprit jusqu’à ce que son conducteur invisible lui eût donné l’avis formel d’engager le confesseur à s’abstenir de cette façon d’agir. « C’est la volonté de Dieu, lui avait-il été dit, que tu portes tes douleurs avec patience ; ton confesseur ne doit rien te faire de plus que ce qu’il faisait auparavant. » Elle eut, en outre, pour l’instruction des autres, la vision suivante :
« Je me trouvais dans une grande salle ; c’était comme une église qui était pleine de monde. Des hommes à l’air grave et imposant allaient à travers la foule et faisaient sortir de l’église un grand nombre des assistants. Je m’en étonnai beaucoup et je demandai à ces personnages pourquoi l’on renvoyait des gens qui paraissaient avoir de si bons sentiments et qui savaient parler à merveille. Là-dessus, un de ces hommes à l’air sévère me répondit : « Ils n’appartiennent pas à ce lieu ; ils sont dans de fausses voies. Et, bien qu’ils parlent avec des voix d’anges, leurs opinions et leurs doctrines sont fausses. » Je vis alors que le docteur étranger était du nombre de ceux qui devaient être mis dehors. Cela me fit beaucoup de peine pour lui, et je voulais courir à lui pour le retenir ; mais autour de moi se trouvaient d’autres personnes qui essayèrent de m’en empêcher, en disant que cela ne convenait pas. Je ne me laissai pourtant pas arrêter, et je répondis : « Il s’agit du salut de son âme ! » J’eus le bonheur de le retenir, en sorte qu’il ne fut pas mis dehors. »
Cette simple vision trouva un accomplissement bien remarquable, car, malgré leur penchant apparent pour le catholicisme et en dépit de tous leurs beaux discours, la plupart des membres de ce cercle ensorcelé par la somnambule sont morts hors de l’Église. Seul « le docteur étranger », secouru par les prières d’Anne Catherine, arriva plus tard à trouver pour sa foi un autre et plus solide fondement que celui qu’il prétendait avoir rencontré dans la ressemblance des phénomènes du magnétisme avec les merveilles opérées par Dieu dans la personne de ses saints et de ses élus.
Le père Limberg accepta les avertissements qui lui avaient été donnés et ne se hasarda plus à tenter la moindre expérience de « cure magnétique » sur sa fille spirituelle, en dehors de la bénédiction sacerdotale selon l’Église. Wesener aussi semble avoir été bientôt guéri de son enthousiasme pour le magnétisme, car son journal se borne à mentionner ce qui suit :
« Je lui demandai ce qu’elle me conseillait de faire pour mon compte, quant à l’application du magnétisme près des malades, à quoi elle répondit : « Vous pouvez faire usage de l’imposition des mains et de l’insufflation, quand vous avez la parfaite assurance que vous n’induisez en tentation et en danger ni vous-même, ni l’autre personne. »
Quant à ces visions où Anne Catherine avait appris à connaître l’essence du magnétisme, la dégradation où il peut entraîner une âme et les dangers qu’il lui fait courir, elle en communiqua quelque chose peu de temps après.
« Lorsque j’entendis pour la première fois parler du magnétisme par le docteur étranger, dit-elle, mon attention n’avait jamais été appelée sur ce sujet. Mais chaque fois qu’il parlait de la personne clairvoyante et des amis qui étaient en rapport avec elle, cela excitait en moi, sans que je susse pourquoi, un sentiment de vive répulsion. Cette personne me fut ensuite montrée, et je fus instruite sur son état dans des visions qui me prouvèrent que cet état n’était rien moins que pur et venant de Dieu. Je vis que l’attrait sensible et le désir de plaire y avaient part, quoiqu’elle ne voulût pas se l’avouer, et que, sans s’en rendre compte, elle avait trop d’attachement pour son magnétiseur. Je vis encore çà et là, dans l’éloignement, quelques autres personnes de cette espèce ; on voit cela comme à travers un verre grossissant. Je les vis assises ou même couchées ; j’en vis quelques-unes ayant devant elles un verre d’où partait un tube qu’elles tenaient à la main. L’impression que je ressentais était toujours une impression d’horreur, ce qui venait moins de la nature même de la chose que de l’immense danger auquel je les voyais presque toujours succomber.
« Les gestes des magnétiseurs devant les yeux, leurs passes et leur manière de prendre la main avaient pour moi quelque chose de si repoussant que je ne puis l’exprimer, parce que je voyais à la fois l’intérieur du magnétiseur et celui de la somnambule, l’influence de l’un sur l’autre, la communication de la nature et des mauvais penchants du premier à la seconde. Je voyais toujours là Satan en personne dirigeant tous les mouvements du magnétiseur et les faisant avec lui.
« Ces personnes sont dans leurs visions tout autrement que moi dans les miennes ; quand, avant d’entrer dans l’état d’intuition, elles ont en elles si peu que ce soit d’impur, elles ne voient que fausseté et mensonge, car le démon leur présente des tableaux et donne à tout une belle apparence. Quand une telle personne se dit seulement à l’avance qu’elle désirerait ce jour-là dire quelque chose d’intéressant ou quand elle a en elle la moindre convoitise sensuelle, elle se trouve aussitôt exposée au plus grand danger de pécher. Plusieurs, à la vérité, reçoivent un soulagement corporel ; mais la plupart en ressentent des effets pernicieux pour l’âme, sans le savoir et sans reconnaître d’où cela leur est venu. Je ne puis comparer l’horreur que ces choses me font éprouver qu’à celle que m’inspirent une certaine association secrète et ses pratiques. Il y a aussi là une corruption que je vois sans pouvoir bien la décrire.
« La pratique du magnétisme confine à la magie ; seulement on n’y invoque pas le diable, mais il vient de lui-même. Quiconque s’y livre prend à la nature quelque chose qui ne peut être conquis légitimement que dans l’Église de Jésus-Christ et qui ne peut se conserver avec le pouvoir de guérir et de sanctifier que dans son sein ; or la nature, pour tous ceux qui ne sont pas en union vivante avec Jésus-Christ par la vraie foi et la grâce sanctifiante, est pleine des influences de Satan. Les personnes magnétiques ne voient aucune chose dans son essence et dans sa dépendance de Dieu ; elles voient tout isolé et séparé, comme à travers un trou ou une fente. Elles perçoivent un rayon des choses par le magnétisme, et Dieu veuille que cette lumière soit pure, c’est-à-dire sainte. C’est un bienfait de Dieu de nous avoir séparés et voilés les uns devant les autres et d’avoir élevé des murs entre nous, depuis que nous sommes remplis de péchés et dépendant les uns des autres ; il est bon que nous soyons forcés d’agir préalablement avant de nous séduire réciproquement et de nous communiquer l’influence contagieuse du mauvais esprit. Mais en Jésus-Christ, Dieu lui-même fait homme nous est donné comme notre chef dans lequel, purifiés et sanctifiés, nous pouvons devenir une seule chose, un seul corps, sans apporter dans cette union nos péchés et nos mauvais penchants. Quiconque veut faire cesser d’une autre manière cette séparation établie par Dieu s’unit d’une façon très dangereuse à la nature déchue, dans laquelle règne avec ses séductions celui qui l’a entraînée à sa chute.
« Je vois l’essence propre du magnétisme comme vraie ; mais il y a un larron qui est déchaîné dans cette lumière voilée. Toute union entre des pécheurs est dangereuse ; la pénétration mutuelle l’est encore davantage. Mais quand cela arrive pour une âme tout à fait ouverte ; quand un état qui ne devient clairvoyant que parce qu’il implique la simplicité et l’absence de calcul devient la proie de l’artifice et de l’intrigue, alors une des facultés de l’homme avant la chute, faculté qui n’est pas entièrement morte, est ressuscitée d’une certaine manière, pour le laisser plus désarmé et dans un état plus mystérieux, exposé intérieurement aux attaques du démon. Cet état est réel, il existe ; mais il est couvert d’un voile, parce que c’est une source empoisonnée pour tous, excepté pour les saints.
« Je sens que l’état de ces personnes suit, à certains égards, une marche parallèle au mien, mais allant d’un autre côté, venant d’ailleurs et ayant d’autres conséquences. Le péché de l’homme doué de la faculté commune de voir est un acte accompli avec ses sens, devant ses sens ; la lumière du dedans n’est pas obscurcie pour cela, mais elle exhorte dans la conscience, elle pousse comme un juge intérieur à d’autres actes sensibles de repentir et de pénitence ; elle conduit aux remèdes surnaturels que l’Église administre sous une forme sensible, aux sacrements. C’est alors le sens qui est pécheur et la lumière intérieure qui est l’accusatrice.
« Mais dans l’état magnétique, quand les sens sont morts, quand la lumière intérieure reçoit et rend des impressions, alors ce qu’il y a de plus saint dans l’homme, le surveillant intime, est exposé à des influences pernicieuses, à des infections contagieuses de l’esprit mauvais, dont l’âme, à l’état de veille ordinaire, ne peut pas avoir la conscience au moyen des sens, assujettis comme ils le sont aux lois du temps et de l’espace ; de même aussi elle ne peut pas se défaire de ces péchés à l’aide des remèdes purificateurs de l’Église. Je vois à la vérité qu’une âme tout à fait pure et réconciliée avec Dieu, même dans cet état où la vie intérieure est ouverte, peut n’être pas blessée par le diable. Mais je vois aussi que si auparavant, ce qui arrive bien facilement, surtout pour le sexe féminin, elle a consenti à la moindre tentation, Satan joue librement son jeu dans l’intérieur de cette âme, ce qu’il fait toujours de manière à éblouir et avec les apparences de la sainteté. Les visions deviennent des mensonges, et, si elle y voit par hasard quelque moyen de guérir le corps mortel, elle l’achète bien cher au prix d’une infection secrète de l’âme immortelle. Elle est fréquemment souillée par un rapport magique avec les penchants mauvais du magnétiseur. »
14. Il arrivait souvent aussi que des femmes magnétisées étaient montrées en vision à Anne Catherine, afin qu’elle priât pour leur salut ou qu’elle travaillât à prévenir les conséquences ultérieures de ces pratiques par des souffrances expiatoires. Elle disait ordinairement en pareil cas qu’elle était prête à porter secours à ces infortunées ; toutefois, elle priait ardemment pour être dispensée de se trouver en contact avec elles, même dans l’état naturel de veille. Une fois seulement, comme le docteur de Francfort vantait beaucoup les visions soi-disant pures et la piété de sa somnambule clairvoyante, elle lui dit très nettement :
« Je voudrais qu’elle fût ici en face de moi, car ses belles et agréables visions cesseraient bientôt, et elle-même en viendrait à voir par qui elle est trompée. Elle m’a été souvent montrée en vision et j’ai toujours vu que, pendant qu’elle était sous l’influence magnétique, le démon aussi usait de tous ses prestiges avec elle, et qu’elle le prenait pour un ange de lumière. »
Wesener, pendant un voyage, s’étant trouvé par hasard en rapport avec le docteur Neeff qui magnétisait cette personne, lui signala le danger. Celui-ci en prit occasion de venir lui-même à Dulmen, afin d’étudier la prétendue ressemblance avec Anne Catherine. Il raconta alors que cette femme avait le don de voir des remèdes pour tous les maux et toutes les maladies possibles, qu’elle frayait avec des esprits bienheureux, qu’elle était conduite par son ange et par celui du magnétiseur à travers des mondes de lumière et recevait une espèce de sacrement provenant « du saint Graal ». Tout cela fit frissonner Anne Catherine ; cependant elle s’efforça, avec toute la douceur que sa charité pouvait lui inspirer, d’appeler l’attention de cet homme infatué sur les grands dangers qu’il courait et sur les illusions dans lesquelles ils vivaient, lui et sa somnambule (tous deux étaient protestants) ; mais cela ne lui réussit pas. L’homme était comme ensorcelé : il invoquait la pureté d’intention avec laquelle la somnambule et lui, avant de commencer leurs opérations, priaient Dieu de les préserver de toutes les embûches et de tous les prestiges du diable. Il assurait que sa somnambule suivait une voie qui devenait chaque jour plus lumineuse et plus sublime, et, avec toutes ces protestations, il éluda tout examen plus approfondi de la nature intime de ses pratiques. Ce fut en vain qu’Anne Catherine déclara que la prétendue nourriture céleste et les mondes de lumière de la somnambule étaient des tromperies et des prestiges au moyen desquels l’esprit malin la tenait enchaînée dans ses filets ; le docteur n’en crut rien et ne voulut pas prendre la main qui lui était tendue pour le sauver.
« Lorsque ces deux personnes me sont montrées, dit un jour Anne Catherine, je le vois tirer de sa somnambule un fil qu’il dévide et où il fait comme un nœud qu’il avale, en sorte qu’elle le tire partout et le tient lié par là. Je vois ce peloton de fil dans son intérieur comme un nuage ténébreux qui pèse sur tout et étouffe tout. Bien des fois il lui vient à l’esprit qu’il devrait rejeter quelque chose hors de lui, mais il n’y parvient jamais. »
15. Il arriva plusieurs fois que des gens poussés par la curiosité et par une intention malveillante eurent recours à une somnambule pour obtenir des révélations sur Anne Catherine. Ainsi, pendant l’enquête dont il sera parlé plus au long dans le second volume, on lui enleva sa coiffe pour la faire servir à mettre en rapport avec elle une somnambule de M..., à qui l’on voulait faire dire toutes sortes de choses touchant Anne Catherine.
« Cette personne, raconta-t-elle plus tard, me fut montrée par mon conducteur céleste, et je vis qu’elle se tourmentait beaucoup sans pouvoir arriver à rien savoir de moi. Je vis toujours le diable là-dedans. Quand je fus délivrée de mon emprisonnement, il me fut montré en vision que mon confesseur se trouvait auprès de cette personne. À l’un de ses côtés se tenait le diable ; un autre esprit était d’un autre côté. L’intention de l’ennemi était qu’elle dît de moi des choses infâmes en présence de tout le monde et devant mon confesseur ; mais, malgré toutes les peines qu’elle se donna pour cela, elle ne put rien voir. Enfin, quand elle prit la main du père Limberg, elle dit : « La sœur Emmerich est en prière. Elle est très malade. Ce n’est pas une trompeuse, si personne ne l’est dans son entourage. » Lorsque mon confesseur revint de M... et me raconta la chose, j’eus encore une vision à ce sujet et je fus saisie de crainte à la pensée de recevoir de lui la sainte communion le lendemain, parce que je croyais qu’il avait participé par curiosité à une chose dans laquelle il devait savoir que le diable avait la main. Mais je fus consolée en apprenant que c’était sans l’avoir voulu qu’il s’était trouvé auprès de cette femme. Je la vis dire des mensonges à propos d’autres personnes, et je vis comment le diable lui suscitait des visions. »
Dans l’enquête dont il vient d’être parlé, on fit, en outre, une tentative en sens inverse, en voulant forcer Anne Catherine à porter sur elle un conducteur magnétique qui devait la mettre en rapport avec un magnétiseur. On lui pendit au cou un petit flacon enveloppé dans de la soie qui excita aussitôt en elle un tel dégoût et de si violentes palpitations de cœur qu’elle le lança loin d’elle et rejeta avec énergie comme un impudent mensonge l’allégation que cette affreuse chose lui était envoyée par Overberg, le directeur de sa conscience.
16. Une femme de Dulmen se laissa un jour persuader d’aller chez une tireuse de cartes à Warendorf. Elle savait que cette personne avait coutume de prédire, d’après ses cartes, des mariages et des choses de ce genre, et elle se proposa de la mettre à l’épreuve par des questions touchant la sœur Emmerich. « Que se passe-t-il chez la sœur Emmerich ? » lui demanda-t-elle. La femme étala ses cartes en trahissant une irritation intérieure, et dit : « Chose curieuse, tout est là confit dans la dévotion ! Voilà un homme âgé qui est assez gros, en voilà un plus jeune ! voilà une vieille femme qui se meurt (c’était la vieille mère d’Anne Catherine qui mourait alors auprès d’elle) ! La personne elle-même est malade ! Étrange maladie ! » La questionneuse en eut assez et s’en alla tout effrayée. Quand Anne Catherine entendit parler de cette affaire, elle fit à ce sujet des observations dignes de remarque.
« Ce ne sont pas les cartes, dit-elle, qui montrent ou font voir quelque chose à ces sortes de personnes, mais c’est leur foi aux cartes qui les rend voyantes. Elles disent ce qu’elles voient et non ce que montre la carte. La carte est le simulacre du faux dieu, mais c’est le diable qui est ce faux dieu. Souvent il est forcé de dire la vérité, et alors la voyante l’annonce avec colère. »
17. En janvier 1821, lorsqu’Anne Catherine, dans ses visions quotidiennes sur la prédication de Jésus, contempla la guérison d’un possédé, elle eut de nouveau une vision d’ensemble sur le caractère et les effets moraux du magnétisme, où les relations générales et les liaisons diverses du royaume des ténèbres avec les hommes lui furent représentées dans trois sphères ou trois mondes. La sphère inférieure, qui était la plus ténébreuse, renfermait tout ce qui tient à la magie et au culte formel du diable ; la seconde, ce qui se rapporte à la superstition et aux convoitises sensuelles ; la troisième était celle de la libre pensée, de la franc-maçonnerie, du libéralisme. Elle vit toutes ces sphères reliées entre elles par des fils innombrables entrelacés les uns avec les autres, qui, comme des degrés, conduisaient des plus élevées aux plus basses. Dans l’enceinte de la sphère inférieure et dans celle du milieu, elle vit les remèdes et les états magnétiques au nombre des moyens les plus puissants par lesquels le royaume des ténèbres attire les hommes à lui.
« Je vis, raconta-t-elle, dans la sphère la plus ténébreuse certains états et certaines relations qui, dans la vie ordinaire, ne sont pas considérés comme absolument illicites ; il y avait spécialement beaucoup de personnes magnétisées. Je vis quelque chose d’abominable entre elles et le magnétiseur : c’étaient comme des nuages noirs de toutes les formes qui allaient des uns aux autres. Je n’ai presque jamais vu personne sous l’influence du magnétisme sans qu’il s’y mêlât au moins une impureté charnelle très subtile. Toujours aussi je vois leur clairvoyance ayant pour agents de mauvais esprits. Je vis des gens tomber de la région lumineuse située plus haut dans la région ténébreuse par suite de leur participation à ces procédés magiques qu’ils appliquaient au traitement des malades, prenant pour prétexte l’intérêt de la science. Je les vis alors magnétiser et, égarés par des succès trompeurs, attirer beaucoup de personnes hors de la région lumineuse. Je vis qu’ils voulaient confondre ces guérisons d’origine infernale et ces reflets du miroir des ténèbres avec les guérisons opérées par la lumière et avec la clairvoyance des personnes favorisées du ciel. Je vis, à cet étage inférieur, des hommes très distingués travailler à leur insu dans la sphère de l’Église infernale. »
XXXIII
NOUVELLES TENTATIVES POUR AMENER ANNE CATHERINE À MUNSTER ET LA SOUMETTRE À DE NOUVELLES EXPÉRIENCES. – MORT DE SA VIEILLE MÈRE.
1. En juin 1815, Overberg vint passer quelques jours à Dulmen.
« N’ayant pas vu la malade depuis quatre mois, dit-il, je l’ai visitée aujourd’hui 8 juin. Son visage exprima une grande joie lorsqu’elle me vit, et elle me parla pendant près d’une heure et demie de ce qui la concernait. Je m’étais proposé de rester près d’elle aussi longtemps que possible. Le lendemain, à sept heures et demie du matin, je lui portai la sainte communion. Depuis le moment où elle acheva son action de grâces, je ne la quittai plus jusqu’à midi. Je la revis à quatre heures de l’après-midi. Elle était excessivement faible et agitée d’un fort tremblement. Comme je lui en demandais la cause, elle répondit : « C’est la douleur de mes plaies qui fait cela ; mais j’en suis contente. » Elle me raconta que le temps ne lui paraissait jamais long, même quand elle passait des nuits entières sans sommeil. Depuis ma dernière visite au mois de janvier, on lui avait donné deux fois les derniers sacrements, parce qu’on la croyait à toute extrémité. Ce qui l’avait fait croire, c’est qu’il n’y avait plus ni pouls, ni respiration perceptibles, que ses lèvres étaient livides, son visage tiré, enfin qu’elle ressemblait plus à une morte qu’à une vivante. Mais on lui avait donné la sainte communion, et la vie et les forces étaient revenues aussitôt. Elle me confessa que, les deux fois, c’était l’ardent désir de la sainte Eucharistie qui l’avait réduite à cet état de faiblesse voisin de la mort. Quand elle s’abstient de communier par obéissance, bien que son désir du sacrement devienne aussi très ardent, elle est plus en état de le supporter ; mais si c’est par sa propre faute qu’elle ne communie pas, toute force s’éteint en elle et elle est comme une mourante.
« Le vendredi, dans l’après-midi, je la vis en défaillance (en extase) et, comme je lui tendais la main, elle prit seulement le pouce et l’index qui sont les doigts consacrés dans l’ordination du prêtre et les tint fortement serrés. Je les retirai au bout d’un peu de temps et je lui présentai le doigt du milieu, duquel elle éloigna sa main avec un mouvement d’effroi. Elle reprit de nouveau le pouce et l’index en disant : « Ce sont eux qui me nourrissent. »
2. Overberg profita du temps de Son séjour pour engager Anne Catherine à se séparer quelque temps de son entourage et à se laisser conduire à Munster où elle pourrait être examinée de nouveau par des personnes dignes de foi ; il ne s’agissait pas en cela, affirma-t-il à plusieurs reprises, de certifier à l’autorité ecclésiastique la réalité des grâces reçues par elle, mais de convaincre les douteurs et les incroyants. Overberg s’était laissé persuader par ses pénitents de Munster et par les raisonnements de plusieurs prêtres qu’il dépendait uniquement d’Anne Catherine de réduire pour toujours au silence les imputations calomnieuses, selon lesquelles l’autorité ecclésiastique n’aurait pas fait son enquête avec toute la rigueur nécessaire pour découvrir la fraude. Mais, disait-il, si elle venait à Munster pour y être encore une fois soigneusement examinée par des médecins, ceux-ci pourraient confirmer la réalité de son état et constateraient la sévérité et l’impartialité de l’enquête ecclésiastique ; puis ce serait une grande consolation pour les bons catholiques de trouver une merveilleuse garantie de leur foi dans les stigmates de l’amie de Dieu. Overberg était pleinement convaincu qu’un observateur sans prévention reconnaîtrait la vérité au premier coup d’œil, si bien que le vendredi, 9 juin, lorsque les plaies commencèrent à saigner, il s’écria involontairement : « Non ! personne ne peut produire artificiellement pareille chose, et elle moins que personne. » Il espérait qu’une nouvelle enquête aurait un résultat complètement décisif ; et il ne pouvait pas comprendre qu’Anne Catherine ne fît pas pour ainsi dire la moitié du chemin à sa rencontre, lorsqu’il cherchait à lui persuader de se laisser conduire à Munster dans l’intérêt de la bonne cause. Loin de là, elle lui déclara qu’elle obéirait sans résistance aucune à un ordre de l’autorité ecclésiastique, mais qu’elle ne pouvait pas de son propre mouvement se résoudre à un voyage qui lui était physiquement impossible. Toutefois Overberg n’osa pas donner un ordre ; le voyage à Munster ne devait avoir lieu que sur la décision libre et spontanée d’Anne Catherine, ce qui fit qu’Overberg n’autorisa pas non plus son confesseur ordinaire, le père Limberg, à agir sur elle par la voie de l’autorité. Mais il s’efforça d’amener Wesener à son opinion, afin que celui-ci persuadât à l’abbé Lambert de ne pas se montrer contraire à son projet non plus qu’à la libre détermination qu’il espérait obtenir d’Anne Catherine. On lit dans le journal de Wesener :
« M. Overberg m’a fait l’honneur de me rendre visite pour m’expliquer combien il était nécessaire que la malade se laissât conduire à Munster pour y être soumise à un examen rigoureux. Cet homme respectable m’a si bien parlé qu’il m’a fait partager entièrement sa manière de voir. Dès le soir de ce même jour, j’en parlai à l’abbé Lambert afin de l’amener à la même persuasion. Il ne trouva rien à objecter à mes raisons ; mais il me dit : « Eh bien ! soit ! si la malade, d’elle-même et sans y être contrainte, consent à l’arrangement projeté, que la chose se fasse dans l’intérêt du bien ! Toutefois je crains bien que mes inquiétudes pour elle, jointes au manque de soins, ne me fassent peut-être mourir. Mais si elle ne consent pas, je m’efforcerai jusqu’à mon dernier soupir de la défendre contre toute violence qu’on voudrait lui faire. Je suis prêt à faire toute espèce de sacrifices à la bonne cause ; mais à quoi bon martyriser si cruellement cette pauvre fille dans son corps et dans son âme ? Qu’on choisisse une voie plus courte et plus douce ! Je ne demande pas mieux que de m’éloigner de Dulmen pour un temps plus ou moins long, et pendant ce temps-là on pourra l’examiner aussi rigoureusement qu’on voudra. » À ces paroles, le bon vieillard fut vaincu par la douleur et ce ne fut qu’en pleurant qu’il put dire encore : « Je ne sais pas ce qui peut résulter de là. Mais c’est une chose affreuse que de martyriser ainsi cette pauvre malade. »
« Le jour suivant, la malade elle-même dirigea devant moi la conversation sur les projets d’Overberg. Je cherchai à exposer mes raisons. Elle m’écouta tranquillement ; mais combien je fus surpris lorsqu’elle m’annonça sa ferme résolution de ne jamais se laisser emmener de Dulmen de son libre consentement. « M. Overberg, me dit-elle, a une bonté excessive dont on abuse. Il veut me sacrifier, afin, m’a-t-il dit lui-même, de prouver à quelques bonnes personnes que les phénomènes qui se montrent chez moi ne sont pas une œuvre artificielle. Mais comment ces braves gens qui sont ses enfants spirituels peuvent-ils avoir si peu de confiance dans les saintes affirmations de ce vénérable prêtre qui s’est convaincu par lui-même de la vérité de la chose et peut à chaque instant se procurer de nouvelles preuves à ce sujet ? Pourraient-ils trouver un témoin plus sûr et plus irrécusable ? » – Comme je lui répliquai qu’on attendait de la constatation de son état quelque chose de beaucoup plus considérable et de beaucoup plus important encore, elle reprit : « Si cinq mille personnes ne croient pas dix personnes d’une loyauté avérée qui rendent témoignage à la vérité en ce qui me touche, vingt millions ne croiront pas non plus au témoignage de quelques centaines. » Je lui demandai alors si elle ne consentirait pas à donner sa vie pour ramener dans le bon chemin, ne fût-ce qu’une seule personne, et elle répondit : « Certainement, mais commuent puis-je savoir si cela peut ou doit résulter de mon changement de résidence, quand ce changement ne m’est pas ordonné par une voix intérieure qui jusqu’à présent m’a toujours bien guidée, et quand, d’un autre côté, mon sentiment intime se révolte contre ! Je voudrais en dire davantage à ce sujet, mais le moment n’est pas encore venu. Si, en dépit de cette voix, j’entreprends le voyage et que je vienne à mourir en route, ne sera-ce pas agir au préjudice de mon âme et aller contre les vues de Dieu sur moi ? Et qui peut me garantir qu’il n’en sera pas ainsi, si la voix qui me parle à l’intérieur ne me l’assure ? En vérité, si mon juge intérieur me dit : « Tu dois partir », je suis prête à le faire à l’instant. M. Overberg me dit que je devrais m’y résoudre pour contenter le bon professeur Druffel dont on a publiquement attaqué l’honneur à mon sujet. Je ferais volontiers tout au monde pour sauvegarder son honneur et celui de toute autre personne qui sera jugée injustement à cause de moi, pourvu que ce soit par des moyens permis ; du reste, j’aurais désiré de tout mon cœur qu’il ne fît rien imprimer sur moi et sur ma maladie. Combien je vous ai prié souvent vous-même de ne rien publier sur moi de mon vivant ! Mais pourquoi devrais-je risquer ma vie et plus que ma vie pour sauver à un homme un peu de son honneur selon le monde ? Où est ici l’humilité, la patience, la charité chrétienne ? Et après tout, on ne persuadera jamais le grand nombre, car la paresse, l’avarice, la méfiance, l’amour-propre, l’incrédulité, et chez beaucoup la crainte d’avoir à échanger leurs convictions contre de meilleures rendent la plupart des hommes aveugles en face de vérités claires comme le jour. Si l’on attache tant de prix à la constatation de ce qui se passe en moi, les gens bien portants peuvent venir me voir sans danger ; je ne puis sans danger aller à eux. Je consens à toutes les épreuves et à toutes les enquêtes qui ne sont pas contre ma conscience. Si un plus grand nombre de personnes veut se convaincre, elles peuvent faire comme ceux qui se sont convaincus ; elles peuvent se placer devant mon lit et faire sur moi leurs observations. Je ne puis aux dépens de ma conscience épargner aux curieux leur peine et leur argent. Que ceux qui peuvent voyager viennent me voir ; si je voulais aller à eux, il y aurait de ma part présomption, vanité ou quelque chose de pire encore, puisque, selon toute vraisemblance, il est impossible que je fasse le plus petit voyage sans risquer beaucoup. Je ne puis certainement me livrer en proie à tous les curieux ; mais qu’on envoie des hommes clairvoyants, jouissant de l’estime publique ; je me prêterai à tout ce qu’ils voudront ordonner, en tant qu’il n’en résultera pas de dommage pour mon âme. Du reste, je ne désire rien ! Je ne me donne que pour un néant ! Je suis une pauvre pécheresse et je ne demande rien que le repos et d’être oubliée du monde entier, afin de pouvoir souffrir et prier en paix pour mes péchés et, s’il est possible, pour le bien de tous les hommes. M. le vicaire général est revenu de Rome, il y a peu de temps ; n’a-t-il rien dit de moi au saint Père ? Grâce à Dieu, il me laisse en repos maintenant. Oh ! soyez tranquilles, vous tous qui êtes bons et croyants, le Seigneur vous manifestera ses œuvres : si c’est de Dieu, cela subsistera ; si c’est chose humaine, cela disparaîtra. » Elle disait tout cela d’un ton résolu et animé. Son confesseur vint se joindre à moi, mais il conserva une attitude passive ; seulement, lorsqu’elle fit allusion à des paroles du Nouveau Testament, comme en dernier lieu, par exemple, il fit cette remarque : « Ce que Gamaliel a dit, elle le pense. »
3. Wesener ayant fait là-dessus un rapport détaillé à Overberg, celui-ci ne put s’empêcher de donner son plein assentiment aux raisons d’Anne Catherine et il s’abstint pour le moment de lui rien demander. Pourtant, un an et demi plus tard, quand le professeur B..., répétant ses calomnies dans des feuilles publiques, accusa Anne Catherine d’imposture et traita l’enquête ecclésiastique d’affaire manquée, Overberg se laissa pousser à exprimer de nouveau son désir ; mais il put se convaincre dans ses visites à Dulmen que la faiblesse physique de la malade rendait impossible un voyage à Munster. Sur ces entrefaites, le doyen Rensing, malgré les supplications d’Anne Catherine pour l’en empêcher, essaya de réfuter publiquement les attaques du professeur, ce qui eut tout juste le résultat qu’avait prédit Anne Catherine et qui se reproduira toujours en pareil cas. B... en prit seulement occasion de répéter ses injures et même de les amplifier pendant qu’aux yeux de tous ceux qui ne fermaient pas volontairement les yeux à la lumière, ses grossières calomnies tombaient d’elles-mêmes. Rensing ne put pas voir sans chagrin qu’Anne Catherine n’accordait pas à ses efforts pour sauver son honneur la sympathie qu’il s’était attendu à trouver chez elle, et depuis ce temps il y eut un refroidissement marqué dans ses relations avec elle. On entendit aussi beaucoup de personnes assurer que c’était un devoir pour Anne Catherine de se soumettre à une nouvelle enquête à Munster, afin de laver définitivement l’autorité ecclésiastique du reproche de ne s’être pas acquittée de sa tâche avec assez de prudence et de sévérité. Cependant aucun des supérieurs ne prit sur lui d’adresser à la malade un appel ou un ordre formel, parce qu’on ne pouvait se défendre de la crainte qu’une nouvelle enquête n’eût sa mort pour conséquence. Telle était la disposition des esprits quand, dans l’automne de 1818, Michel Sailer vint à Munster et exprima en présence d’Overberg le désir d’aller à Dulmen. Ce désir causa une grande satisfaction à Overberg, parce qu’il voyait dans Sailer un arbitre aux décisions duquel tout le monde se soumettrait. Il lui procura les pouvoirs nécessaires pour entendre Anne Catherine et avisa le père Limberg de faire à celle-ci un devoir d’exposer en détail à Sailer l’état de sa conscience. Anne Catherine obéit avec plaisir. Sailer put prendre une connaissance assez complète de son intérieur et de toute sa situation extérieure pour déclarer avec une pleine conviction, soit à elle-même, soit au père Limberg et à Overberg, qu’elle était en droit, devant Dieu et devant sa conscience, de se refuser au voyage à Munster, évidemment dangereux pour sa vie, ainsi qu’à la répétition d’une enquête que rien ne justifiait en soi, puisque l’autorité ecclésiastique s’était convaincue depuis longtemps de la réalité de son état à la suite du traitement rigoureux auquel on l’avait soumise dans l’année 1813. Anne Catherine garda de cette décision une reconnaissance qui dura tout le reste de sa vie ; elle déclara souvent que la visite de Sailer avait eu pour elle les résultats les plus heureux, d’autant plus que le père Limberg, si prompt à tomber dans l’hésitation, en avait retiré la fermeté nécessaire pour approuver pleinement le refus de sa fille spirituelle. Depuis lors, Anne Catherine fut parfaitement en repos de ce côté.
4. Sa mère octogénaire était morte près d’elle à Dulmen le 12 mars 1811. Depuis la suppression du couvent, elle n’avait visité sa fille à Dulmen qu’une seule fois, lorsqu’était arrivée à Flamske la première nouvelle de l’enquête ecclésiastique dont Anne Catherine était menacée. Mais quand elle sentit approcher la mort, elle voulut mourir dans le voisinage de son enfant. Elle se fit conduire le 3 janvier 1817 à Dulmen, où Anne Catherine lui avait préparé un lit de mort près de son propre lit de douleurs. La pieuse malade, dont les prières et les souffrances expiatoires avaient déjà apporté à tant de mourants la consolation et le salut, n’avait jamais cessé de se préoccuper de la position de sa vieille mère, et elle avait demandé à Dieu l’assurance qu’elle pourrait lui rendre à sa dernière heure tous les services auxquels, la portaient si vivement l’amour filial et la reconnaissance. Une seule chose avait inquiété et tourmenté son humble simplicité, c’était la crainte qu’à cause de son état de souffrances extraordinaires, elle ne put pas prendre envers sa mère la position d’une simple et innocente enfant et lui rendre les soins physiques nécessités par son état. Mais encore en cela elle eut la consolation que, tant que sa mère resta près d’elle, l’impression de ses souffrances fut adoucie et qu’elle-même se trouva capable de remplir tous les devoirs d’une fille reconnaissante.
Le 28 décembre 1817, Wesener, à son grand étonnement, trouva Anne Catherine assise sur son séant dans son lit, et, comme il demandait la cause de ce retour de forces tout à fait inexplicable pour lui, le père Limberg lui raconta ce qui suit :
« La veille de la fête des saints Innocents, elle a été deux heures en extase et elle est revenue à elle sans que je lui en aie donné l’ordre. Elle m’a demandé alors d’un ton très animé si elle pouvait se lever, et, quand je le lui eus permis, elle se mit sur son séant si résolument et si lestement que j’en fus effrayé. Elle put même se tenir droite sans aide, jusqu’au moment où je lui ordonnai de se recoucher. Elle me dit alors : « Mon guide m’a menée à un endroit où j’ai pu voir le meurtre des saints Innocents et la grande magnificence avec laquelle Dieu récompensa ces victimes d’un âge si tendre, quoiqu’elles n’eussent pu coopérer activement à la confession du saint nom de Jésus. J’admirais l’immensité de leur récompense, et je me demandais ce que je pouvais donc espérer, moi qui, depuis si longtemps déjà, avais eu à souffrir bien des affronts et bien des peines et à pratiquer la patience pour l’amour de mon Sauveur ? Là-dessus, mon conducteur me dit : « Dans ce qui t’appartient, bien des choses ont été dissipées, et toi-même en as laissé perdre beaucoup ; toutefois, persévère et sois vigilante, car ta récompense aussi sera grande. » Cela m’enhardit à lui demander si je ne pourrais pas recouvrer l’usage de mes membres et même prendre de la nourriture ? – « Ce que tu désires te sera donné pour ton soulagement, me fut-il répondu, et tu en viendras même à pouvoir manger quelque chose. Seulement sois patiente ! » – « Comment ! répliquai-je ; ne puis-je pas dès à présent quitter mon lit ? » – « Assieds-toi dans ton lit, en présence de ton confesseur, me fut-il dit, et attends pour le reste ! Ce que tu as et ce que tu souffres n’est pas pour toi, mais pour beaucoup d’autres. » Là-dessus, je m’éveillai, et je pus me redresser dans mon lit. »
5. Le mieux se soutint, et une semaine après Wesener put écrire dans son journal :
« La malade est toujours en état de se redresser seule ; elle même déjà pu une fois s’habiller sans l’aide d’autrui et quitter son lit. Je me suis décidé alors à essayer de lui faire prendre quelque nourriture ; en le lui annonçant, je fis cette observation : « Que dira le professeur B... quand il apprendra que vous pouvez vous lever et manger ? » À quoi elle répondit : « Je ne sais pas ce qui adviendra encore de moi ; mais je ne me suis jamais inquiétée de l’approbation des hommes. Leurs opinions me sont indifférentes, sauf le cas où je ne puis m’empêcher d’avoir pitié de leur aveuglement. Dois-je souffrir des affronts ? Je le veux bien, pourvu que cela tourne à la gloire de Dieu ; si j’ai quelque chose à manifester comme son indigne instrument, le Seigneur le confirmera. » Elle se refusa encore à essayer de prendre de la nourriture, jusqu’à ce que son confesseur en eût décidé. »
Wesener rapporte à la date du 16 janvier : « Elle peut maintenant, sans malaise et sans vomissements, prendre chaque jour quelques cuillerées d’eau et de lait mêlés en parties égales. Je crois qu’elle aurait déjà recouvré encore plus de force, si elle ne se consacrait pas à soigner sa vieille mère malade. Cependant elle est toute joyeuse de ce que l’extrême bonté de Dieu la met maintenant en état de s’acquitter dans une certaine mesure envers sa bonne mère pour la tendresse que celle-ci lui a prodiguée dans son enfance. Le vendredi 17 janvier, les plaies n’ayant pas saigné, elle s’est livrée entièrement à l’espérance que les stigmates disparaîtraient. Mais cette espérance ne s’est pas réalisée. – Vers la fin de janvier, elle a pu plusieurs fois prendre et garder un peu de bouillon de viande très léger.
« 14 février. Elle continue à être pleine de sérénité et de contentement, quoique jour et nuit elle souffre cruellement de la douleur que lui cause le spectacle de sa mère bien-aimée attendant la mort à tout moment.
« 21 février. Le mieux qui s’était manifesté ne se soutient pas. La compassion que lui inspire sa mère malade me semble en être cause..... Sa mère est morte dans la soirée du 12 mars. La malade en est très affectée et tout inquiète, parce qu’elle craint de n’avoir pas soigné sa mère comme elle l’aurait dû.
« 20 mars. Elle est aussi faible et dans un état aussi précaire qu’auparavant ; cependant elle exprime une reconnaissance touchante envers Dieu dont la main secourable lui a rendu de la force pendant tout le temps qu’a duré la maladie de sa mère. »
XXXIV
CLÉMENT BRENTANO À DULMEN. – L’INFLUENCE D’ANNE CATHERINE SUR SA VIE INTÉRIEURE.
1. Wesener a noté un entretien très significatif qu’il eut avec Anne Catherine le 26 septembre 1815. Il la trouva très attristée à cause d’une lotion d’eau-de-vie que sa sœur, sur l’ordre du confesseur, lui avait administrée sans aucun ménagement, et il chercha à la consoler en lui insinuant que Dieu se servait de cette sœur comme d’un instrument pour l’amener à la perfection et que, par conséquent, il ne permettrait pas que ladite sœur se perdît, malgré ses nombreux défauts. Il s’ensuivit un long entretien dans lequel Anne Catherine s’exprima ainsi :
« J’ai toujours regardé l’assistance du prochain comme une vertu particulièrement agréable à Dieu ; dès ma plus tendre jeunesse, j’ai prié Dieu de me donner la force de servir mes semblables et de leur être utile. Je sais maintenant qu’il a exaucé cette prière. Mais j’ai encore une autre tâche à remplir avant ma mort. Je dois encore révéler beaucoup de choses avant de mourir ; je sais et je sens bien que j’ai cela à faire, mais je ne le puis pas, et la raison principale est la crainte que ce que j’ai à dire ne m’attire des louanges. Je sens aussi très bien que cette crainte est répréhensible ; je devrais communiquer ce que j’ai à dire en toute simplicité, pour l’amour de Dieu et de la vérité ; mais je ne suis pas encore arrivée au véritable point de vue ; je dois encore rester couchée jusqu’à ce que j’aie appris à me surmonter entièrement. » Wesener lui répondit qu’il ne pouvait croire que la prolongation, incompréhensible pour lui, de la vie d’Anne Catherine eût pour but unique sa personne même, c’est-à-dire l’accroissement de sa perfection personnelle, car autrement elle serait déjà en purgatoire ; alors elle reprit : « Plût à Dieu que j’y fusse ! Néanmoins il est certain que ce n’est pas pour moi seule que je suis ici couchée sur un lit de douleurs ; et je sais pourquoi je souffre. Vous ne devez rien faire connaître sur moi avant ma mort. Ce que j’ai ne me vient pas de moi. Je ne suis qu’un outil dans la main du Seigneur. De même que je puis à ma volonté poser ici où là mon petit crucifix, il faut aussi que je trouve bon tout ce que Dieu veut et fait de moi, et que je le fasse avec joie. En réalité, je sais bien pourquoi je suis ici couchée, et la dernière nuit j’ai reçu de nouveau des informations à ce sujet. J’ai toujours demandé à Dieu, comme une grâce particulière, de souffrir, et, si c’est possible, de satisfaire pour ceux qui s’égarent par erreur et par faiblesse. Mais, comme cette ville et le couvent qui y existait m’ont accueillie, moi, pauvre fille de la campagne, que plusieurs couvents avaient déjà repoussée, je me suis tout particulièrement offerte pour Dulmen. J’ai eu la consolation de voir que Dieu a agréé ma prière ; j’ai déjà détourné de cette ville quelque chose dont elle était menacée et j’espère que je pourrai encore lui être utile par la suite. »
2. Trois années s’écoulèrent encore avant que se présentât pour Anne Catherine la possibilité matérielle de communiquer ses contemplations à quelqu’un qui pût employer ses forces et son temps à les rédiger. Ce devait être Clément Brentano, lequel, ne se doutant guère que sa personne, présente en esprit depuis des années à la pieuse voyante, était l’objet de ses prières et de ses souffrances expiatoires, fut conduit à Dulmen par une occasion toute fortuite. Sailer, alors professeur à Landshut, avec lequel Brentano entretenait une correspondance touchant les affaires de sa conscience, lui avait fait connaître son projet d’aller, pendant les vacances d’automne, à Munster et à Sondermuhlen, chez le comte Frédéric de Stolberg, et il l’avait engagé à se rendre de Berlin en Westphalie pour s’y rencontrer avec lui. Comme Sailer avait pour compagnon de voyage Christian Brentano, qui avait fait connaissance avec Anne Catherine l’année précédente et qui avait aussi intéressé à elle son frère Clément, celui-ci eut l’idée de profiter de sa rencontre avec Sailer pour faire une courte visite à Dulmen. À cela se bornaient les vues de Clément, et, en entreprenant ce voyage, rien n’était plus éloigné de sa pensée que de faire un séjour tant soit peu prolongé dans la petite ville de Dulmen, fort dénuée d’attrait pour lui. Sondermuhlen avait été désigné comme le lieu du rendez-vous ; mais, lorsque Clément y arriva, Sailer n’avait pas encore fait savoir quel jour il viendrait. Là-dessus, Brentano se décida à se rendre à Munster pour y voir Overberg, puis de là à Dulmen.
« Le jeudi 24 septembre 1818, dit son journal, j’arrivai à Dulmen vers dix heures. Wesener annonça ma visite à la sœur Emmerich, afin qu’elle ne s’en émût pas trop. Elle m’accueillit amicalement. Nous arrivâmes, en passant par une grange et par de vieux celliers, à l’escalier en pierre qui conduit chez elle. Nous frappâmes à la porte. Sa sœur ouvrit, et nous entrâmes par la petite cuisine dans la pièce du fond où elle est couchée. Elle me salua et me dit d’un air aimable qu’on me reconnaissait à ma ressemblance avec mon frère. Son visage empreint de pureté et d’innocence excita en moi une joie intérieure, ainsi que la vivacité et l’aimable enjouement de sa conversation. Je ne trouvai ni dans sa physionomie, ni dans toute sa personne, aucune trace d’effort ou d’exaltation. Quand elle parle, ce n’est pas pour faire une leçon de morale ou un lourd sermon sur le renoncement ; son langage n’a point cette fadeur doucereuse qui rebute. Tout ce qu’elle dit est bref, simple, uni, mais plein de profondeur, plein de charité, plein de vie. Je fus tout de suite à mon aise ; je comprenais tout ; j’avais le sentiment de tout. »
Nous savons pourquoi il fut accueilli si promptement et si amicalement. Anne Catherine voyait enfin arriver près d’elle l’instrument depuis longtemps désiré au moyen duquel devaient être recueillies les communications que Dieu lui avait ordonné de faire ; mais il était encore, par rapport aux services qu’il devait rendre, ce que la souche de la forêt est à l’œuvre de sculpture que l’art du maître doit en faire sortir. Par quels moyens Anne Catherine fixera-t-elle près d’elle cet étranger qui par ses tendances et ses instincts vit dans un monde tout différent ? Comment occupera-t-elle cet esprit encore plein d’agitation, n’obéissant qu’à ses impulsions et à ses caprices, lequel, après de longs et dangereux égarements, a commencé depuis quelques mois à peine à chercher la voie qui conduit au salut ? Au bout de quelques semaines, elle put déjà lui faire cet aveu :
« Bien souvent je suis toute surprise de ce que j’en suis venue à vous parler avec tant de confiance et à vous communiquer bien des choses sur lesquelles je n’ai pas coutume de m’ouvrir avec d’autres personnes. Dès le premier moment, vous n’étiez pas un étranger pour moi ; je vous connaissais avant que vous vinssiez me voir. Souvent, dans les visions où des évènements futurs de ma vie me sont indiqués, j’ai vu un homme d’un teint très brun écrivant près de moi : c’est pourquoi, quand vous êtes entré pour la première fois dans ma chambre, je n’ai pu m’empêcher de me dire : « Ah ! le voilà ! »
Clément, toutefois, n’avait alors d’autre pensée que de faire de la vie d’Anne Catherine le sujet d’une narration plutôt romanesque qu’historique.
« Je m’efforcerai, écrivait-il dans son journal, de noter pour moi ce que j’apprends de la malade ; j’ai l’espoir de devenir son biographe. »
Ses idées à ce sujet ne s’élevaient pas encore au-dessus d’un travail purement poétique, comme le prouvent son journal et les lettres qu’il écrivait à des amis éloignés pendant les premières semaines de son séjour à Dulmen.
« Elle parle (c’est ainsi qu’il célèbre les louanges d’Anne Catherine) comme une fleur des champs et comme un oiseau des bois dont le chant a un son merveilleusement profond et souvent même prophétique. » Tantôt elle est pour lui « l’amie merveilleuse, bienheureuse, aimable, digne d’être aimée, rustique, naïve, enjouée, malade à la mort, existant sans nourriture, vivant d’une vie surnaturelle ». Tantôt c’est « une âme pleine de sagesse, délicate, fraîche, chaste, éprouvée, complètement saine, et avec cela toute campagnarde », qui, à chaque minute, le surprend par la ressemblance de caractère, de langage et de manières qu’il croit lui trouver avec une personne qui le touche de près ; tantôt enfin il espère changer d’un seul coup toute sa position extérieure. « Tout ici, dit-il, pourrait être remis en bon état au moyen d’une créature fidèle, intelligente et pieuse qui la déchargerait des soins domestiques et, assise près de son lit, ce qui est le plus beau siège du monde, dirigerait le petit ménage et éloignerait tout ce qui peut troubler. »
3. Anne Catherine supporta avec une patience infinie cet homme dont toute la manière d’être formait un tel contraste avec la sienne ; elle le traita avec cette bonté attrayante qu’elle témoignait d’ailleurs aux plus pauvres et aux plus humbles de ceux qui s’approchaient de son lit ; mais elle lui montra, en outre, une confiance pleine d’abandon dont il fut touché jusqu’au fond du cœur. Il se décida donc plus facilement à attendre, dans la localité fort peu attrayante pour lui de Dulmen, l’arrivée impatiemment désirée, mais retardée d’une semaine à l’autre, de Sailer et de son frère. La première impression que lui fit la petite ville est plaisamment décrite dans son journal.
« Cet endroit, dit-il, offre beaucoup de ces choses que peuvent goûter les âmes simples. C’est une petite ville agricole où il n’y a ni art, ni science, où l’on n’a nulle idée de la littérature, où l’on ne sait rien d’aucun poète, et où, le soir, on trait les vaches devant la porte de la plupart des maisons. Presque tous les habitants portent des sabots, y compris malheureusement les servants de messe. Les enfants courent dans la rue au-devant de tout passant qui a un peu d’apparence et lui font des baisemains. Maint pauvre promet à celui qui lui fait une aumône de faire pour lui le chemin de la croix dans la soirée avec ses enfants, et, en réalité, la veille des fêtes, ce chemin avec ses représentations de Jésus portant sa croix est toujours fréquenté par des familles en prière. Les travaux délicats du beau sexe consistent à cultiver les champs et les jardins, à préparer le lin, à le briser, à l’affiner, à le filer, à blanchir la toile, etc. ; même les filles de bourgeois aisés sont habillées comme les servantes le sont ailleurs. Dans tout l’endroit, on ne trouve pas un roman, et jusqu’à un certain point aussi la mode n’y existe pas ; chacun porte le vêtement qu’il a, jusqu’à ce qu’il tombe en lambeaux ; et, pourtant, il y a ici une grande route de poste, un hôtel de la poste et la résidence d’été d’un duc médiatisé de Croy-Dulmen, lequel a une maison de trente personnes au moins. Avec tout cela, chacun parle des progrès inouïs qu’ont faits depuis dix ans le luxe et la corruption des mœurs. »
Mais la bienveillance amicale avec laquelle Anne Catherine, d’après le désir de son confesseur, le laissait chaque jour venir plusieurs fois près de sa couche de malade et écoutait tout ce qu’il lui disait des incidents de sa vie et des choses qui l’intéressaient, le réconcilia de plus en plus avec les privations que lui imposait le séjour de Dulmen. Il vit, dans l’intérêt que prenait Anne Catherine à sa vie passée, la preuve irréfragable que maintenant elle était uniquement préoccupée de ce qui le touchait de plus près et de ce qu’il y avait de plus important pour lui. Cet homme, habitué à agir d’après ses premiers mouvements les plus irréfléchis, se trouva chaque jour plus fortement attiré par là ; mais, pendant que sa seule pensée était de prêter l’oreille « au chant prophétique d’un petit oiseau des bois », Anne Catherine travaillait très sérieusement au progrès de son âme et cachait ses propres souffrances et ses sacrifices sous une profusion de douceur et de bonté afin de ne pas faire reculer ce novice dans la vie spirituelle. Toute sa manière d’agir, jusqu’à la plus simple parole, était dirigée avec le tact merveilleux qui la caractérisait vers un but unique, qui était de le réconcilier pleinement avec Dieu, et de renouveler à fond son intérieur par une soumission filiale à l’Église et par une pleine et sincère adhésion à la sainte foi catholique. Ses visions prophétiques ne lui semblaient devoir être réalisées que quand elle aurait amené l’étranger à courber son esprit sous le joug de l’obéissance aux préceptes divins et à adopter les prescriptions de la religion comme l’unique et suprême règle de toutes ses actions et de toutes ses pensées. Elle savait dire au moment opportun ce qui pouvait le mieux porter coup, et ainsi ses paroles tombaient comme des semences dans le cœur de Brentano où elles germaient et prenaient racine avant qu’il eût pu s’apercevoir qu’il s’agissait de quelque chose de bien autrement élevé qu’un butin poétique à recueillir ou que l’attrait de la nouveauté et de l’extraordinaire pour cette nature richement douée, mais blasée sur toutes les jouissances de l’art.
4. Cette direction donnée au pèlerin 29 pour le préparer graduellement à une intelligence plus profonde de la mission d’Anne Catherine et à la rédaction de ses visions est un fait décisif dans la vie de la servante de Dieu, et elle mérite d’autant plus d’être étudiée attentivement que la correspondance de Clément Brentano, incomplètement publiée, ne suffit pas pour donner une idée juste et claire de la manière dont les choses se passèrent. Il semblait n’avoir été conduit à Dulmen que par un enchaînement de circonstances fortuites ; mais Anne Catherine y reconnaissait la direction de la divine providence, et, au bout de quelque temps, elle éveilla dans le pèlerin lui-même le pressentiment que la prolongation involontaire de son séjour pouvait devenir d’une grande importance pour sa vie tout entière. Il est généralement difficile à l’homme de comprendre l’appel que Dieu lui adresse et de s’affranchir de ses penchants et de ses habitudes invétérés pour répondre à cet appel et pour accomplir la tâche qu’il lui assigne ; mais, d’un autre côté, il y avait dans la riche nature du pèlerin, avec sa vie passée si pleine de vicissitudes, bien des choses qui, à en juger humainement, devaient le faire paraître, malgré ses rares facultés, moins propre qu’un autre à remplir les vues de Dieu. Lors de son arrivée à Dulmen, il venait d’accomplir sa quarantième année, et il n’y avait que peu de temps qu’il avait donné suite à sa résolution de se réconcilier avec Dieu et avec l’Église, à laquelle il était devenu complètement étranger et qu’il connaissait encore assez mal.
« Les formes du culte catholique, écrivait-il peu de temps auparavant à un ami, sont devenues pour moi aussi inintelligibles et aussi déplaisantes que celles de la synagogue. Je sens que je ne suis pas heureux ; mais je sens aussi que si je cherche le repos de mon âme dans le christianisme catholique, je me trouverai dans une telle perplexité et dans un tel embarras que mon état sera encore pire qu’auparavant. Il y a à chaque pas mille choses qui me déconcertent quand je m’approche de l’Église catholique. » Au contraire, il se sentait tellement attiré par le cercle piétiste d’un pasteur protestant de Berlin qu’il disait : « L’Église de l’excellent H... m’a pour la première fois de ma vie fait ressentir l’impression d’une communauté. Il n’y a rien là qui me trouble ; tout, au contraire, m’attire. Quoique dans l’Église catholique il n’y ait plus rien pour moi qui me rattache intérieurement à elle, je ne vais pourtant pas chez H... par suite d’une certaine répugnance à me séparer d’elle entièrement. » Cette répugnance qu’il ne pouvait pas s’expliquer lui-même, l’empêchait encore de faire le dernier pas ; mais il avait bien montré combien large et profond était devenu l’abîme qui le séparait intérieurement de l’Église, en écrivant ces tristes paroles : « La transmission magique de l’esprit de Dieu par l’imposition des mains ne peut pas avoir plus de réalité à mes yeux que la dispensation du génie poétique par le couronnement du poeta laureatus », et ailleurs : « Quel abîme entre la Cène du Seigneur et l’hostie dans notre ostensoir 30 ! »
Dans une semblable disposition, il n’y avait pas de voix à laquelle l’oreille du pèlerin ne s’ouvrît plus facilement qu’à celle de la vérité. Il se plongeait dans les écrits de Jacob Boehme et de Saint-Martin ; il s’enthousiasmait pour la secte pseudo-mystique de Boos et de Gossner, où il voyait « la fidèle image des temps apostoliques et une manifestation très redoutable pour le siège de Rome » ; il se laissait volontiers entraîner sur ces sortes de voies, et il en arrivait à proférer contre l’Église ces paroles pleines d’injustice et d’amertume :
« Chez quels peuples la doctrine de Jésus s’est-elle le mieux manifestée ? Chez les chrétiens purement papistes, chez les protestants, les réformés, les grecs, les mennonites, les herrnhutes ? Où donc ? où donc ? Que chacun en juge comme il peut. Si l’on me dit que ce sont les catholiques qui sont dans le vrai, je demande pourquoi il faut leur retirer la Bible afin qu’ils restent catholiques ? Celui qui est dans le vrai, c’est Jésus ; lui seul est le médiateur ; entre lui et l’homme il n’y en a pas. L’unique connaissance qu’on puisse avoir de lui vient de sa doctrine, de la nature et du cœur humain en rapport avec celle-ci, et dans le rapport le plus immédiat. Je dois éviter tout ce qui me trouble et m’éloigne de lui en voulant m’amener maladroitement à lui. Quand on me crie d’une voix impérieuse : « C’est ici, c’est ici qu’est la vraie voie ; tu dois faire telle et telle chose ; ainsi le veut la véritable Église ! » cela me déconcerte, me jette dans la confusion et me met à la torture. »
Le pèlerin, il est vrai, poussé par l’inquiétude de son âme qui aspirait à la paix, s’était approché des sacrements ; mais, lors de son arrivée à Dulmen, les vues contraires à la foi n’étaient pas surmontées en lui. Il se trouvait dans un état de fermentation dont il ne put sortir en véritable converti que dans le voisinage d’Anne Catherine et sous l’influence de la bénédiction qui émanait d’elle.
5. Dans le temps où il était le plus profondément divisé d’avec l’Église, il s’était écrié une fois dans une aspiration involontaire vers le jour où il serait délivré de son trouble et de sa désolation intérieure : « J’ai besoin d’un supérieur qui m’attire à lui en me faisant respirer l’atmosphère divine de l’innocence et de la piété et qui me conduise comme un aveugle, car je ne puis pas me fier à moi-même. » Maintenant il sentait réellement le pouvoir irrésistible de cette atmosphère. Il voyait l’effrayante austérité de la vie de souffrances imposée à l’innocente pénitente jointe à l’humble simplicité d’un enfant vivant en Dieu, et, dans cet enfant, la magnificence de l’Église, la puissance et la vérité de la foi catholique se manifestaient chaque jour plus clairement aux yeux étonnés du pèlerin. Ce ne furent ni les visions, ni la communication des contemplations intérieures, ni l’attrait du surnaturel qui firent sur lui l’impression décisive dans ses rapports avec Anne Catherine, mais la vue de la sainteté, l’aspect d’une vie si parfaitement réglée d’après les principes de la foi et où se montrait à lui une copie, ou plutôt un si fidèle miroir de l’Église qu’il exprima bien des fois sa profonde émotion dans des paroles comme celles-ci :
« Un nouveau monde s’ouvre devant moi ! Combien la patiente est entièrement et parfaitement chrétienne ! Maintenant, j’ai le pressentiment de ce qu’est l’Église ! »
Dès le huitième jour après son arrivée, il en était venu à écrire dans son journal :
« J’ai quitté l’hôtel de la poste où j’étais descendu, et j’ai pris deux petites chambres dans la maison sur le derrière de laquelle elle loge. C’est une boulangerie et une auberge appartenant au frère de son confesseur. J’ai fait cela pour pouvoir l’observer plus souvent. Je resterai ici quinze jours au moins.
« Je serai bientôt au courant des arrangements extérieurs de sa vie ; avec une personne si complètement séparée du monde, il n’y a pas beaucoup de peine à se donner pour voir clair dans tout cela. Je noterai par écrit mes diverses impressions sur ce qui m’entoure ici, sans suivre un ordre déterminé, jusqu’à ce que je trouve un point de vue fixe d’où l’on puisse tout embrasser.
« La pauvre malade vit dans une grande détresse, privée des soins affectueux qu’elle devrait recevoir d’une personne de son sexe. Je le vois à chaque instant et je m’en attriste. Sa sœur a des façons très blessantes, et comme, en outre, elle est très inexpérimentée, la malade est obligée de l’aider dans tous les arrangements domestiques ; mais elle ne se plaint jamais et supporte tout avec patience. Un jour, je la trouvai si accablée sous le poids d’une masse de linge humide qui avait été posé sur son lit qu’elle ne put pas se remuer jusqu’à ce qu’on l’eût allégée un peu. Il fallait qu’avec ses mains blessées elle examinât et raccommodât tout ce linge grossier et mouillé, avant de le mettre sous la calandre, et ses doigts étaient raidis et bleuis par le froid. C’est ainsi qu’elle travaille souvent pendant des demi-journées, et si elle parle au milieu de ses contemplations si animées, si, étant en extase, elle fait un mouvement, sa rude et stupide compagne la traite comme une servante grossière traiterait un enfant malade ou une personne qui parle dans le délire de la fièvre, et lui enjoint brutalement de se tenir tranquille.
« Toute sa vie, dont ses horribles souffrances physiques et morales font un martyre perpétuel, est, en outre, troublée et tiraillée par des visiteurs déraisonnables et indiscrets. Mais elle est toujours bienveillante, et, dans tout ce qui arrive, elle honore les desseins de Dieu qui veut l’éprouver et l’humilier.
« Elle accueille avec une rare bonté mes efforts pour lui procurer quelque allégement dans une position si incommode et si pleine de vexations de toute espèce, et elle m’en remercie cordialement. Son entourage fait la plupart des choses avec négligence, sans soin, sans égards, et, lors même qu’il y a bonne volonté, le plus souvent avec maladresse. Ainsi, il y avait dans le mur qui est près de son lit une fente par où venait un fort courant d’air, et personne n’avait songé à une réparation si facile. J’y ai assujetti un morceau de toile cirée, et elle en a été très reconnaissante.
« Sa situation est aussi à plaindre que possible ; mais je la vois toujours sereine et affectueuse. De sa misérable couche de malade, elle ne peut plus même jeter un regard vers la lumière du ciel ou sur la cime des arbres du jardin qui est devant sa fenêtre, elle qui, ayant grandi dans la solitude champêtre dont la chaumière paternelle était entourée, avait avec la nature des rapports plus intimes que bien d’autres.
« Le vendredi 9 octobre, je vis avec effroi et avec horreur tous les stigmates. Son confesseur avait désiré que je les visse pour pouvoir rendre à ce sujet un témoignage véridique. La marque de la lance dans le côté droit fait une impression qui bouleverse. Elle me parut longue d’environ deux pouces et demi et me fit l’effet d’une bouche pure et silencieuse dont les lèvres sont à peine séparées. Outre la double croix fourchue sur l’os de la poitrine, elle a sur la région de l’estomac une croix latine de la largeur du pouce qui ne rend pas du sang, mais de l’eau. J’ai vu aussi aujourd’hui saigner les plaies des pieds. On est pénétré jusqu’à la moelle des os en voyant ce pauvre corps marqué d’un sceau si merveilleux, ce corps qui ne peut remuer que les pieds et les mains, qui ne peut ni se redresser, ni se tenir assis, mais que surmonte une tête couronnée des douleurs de la couronne d’épines et un visage plein d’amour et de bienveillance dont les lèvres pures laissent échapper tant de paroles consolantes et secourables, tant d’humbles et ferventes prières. Près de la couche de cette sainte âme, instruite dès sa première jeunesse non par les hommes, mais par le Seigneur, par son ange et par ses saints, mille choses me font comprendre pour la première fois ce que c’est que l’Église et ce que signifie la communion des saints dans l’Église.
6. « Quelles prodigieuses, quelles émouvantes expériences son confesseur a tous les jours à faire sur elle ! Celle qui bouleverse le plus est l’effet produit par le caractère sacerdotal. Si la malade est en extase et que son confesseur s’approche d’elle en lui présentant les doigts qui ont reçu l’onction sainte, elle lève la tête et suit ces doigts dans tous leurs mouvements ; s’il les retire, elle tombe affaissée sur elle-même. Et il en est de même avec tout prêtre, quel qu’il soit. Celui qui, comme moi, a eu la chance de voir cela doit bien reconnaître que l’Église seule a des prêtres, et il a le profond sentiment que la consécration sacerdotale est certainement plus qu’une pure cérémonie. Un jour, je l’ai entendue dire en pleurant : « Les doigts consacrés des prêtres seront reconnaissables en purgatoire ; bien plus, ils le seront même dans l’enfer et ils brûleront d’un feu particulier. Chacun les connaîtra et leur fera des reproches. »
« Combien grande et touchante est son obéissance à l’ordre du prêtre ! Quand le moment approche où sa sœur doit refaire son lit, et que le confesseur s’écrie : « Sœur Emmerich, levez-vous, au nom de l’obéissance ! » elle se réveille avec un tressaillement soudain, et, se remuant à grand-peine, cherche à se redresser un peu. Aujourd’hui, j’ai prié le confesseur de donner cet ordre en latin et à voix basse, sur quoi il s’est levé du siège, placé assez loin, sur lequel il disait son bréviaire ; il s’est rapproché du lit et a murmuré, sans qu’on pût les entendre, les paroles suivantes : Tu debes obedire et surgere ; veni 31 ! À l’instant elle s’est redressée péniblement, avec un mouvement indiquant qu’elle voulait se jeter à bas du lit, en sorte que le confesseur effrayé lui dit : « Qu’avez-vous ? » À quoi elle répondit : « On m’appelle. » Il lui ordonna de rester couchée, et elle rentra à l’instant dans son repos.
« Ce réveil subit sur l’ordre du prêtre est toujours pour moi quelque chose de très émouvant et excite ma compassion pour la pauvre personne qui, tout à coup, sans ménagement, est arrachée à ses visions et à un autre monde plein de lumière où elle vit véritablement, et jetée dans le monde d’ici-bas, monde sombre et triste où tout la choque et la blesse. Cela me fait souvent l’impression d’horreur que j’éprouverais en voyant saisir soudainement avec une fourche un enfant malade jouant au milieu des fleurs pour le jeter dans une glacière ténébreuse. Mais souffrir est sa tâche, et, quoiqu’elle se débatte encore après être revenue au sentiment du monde extérieur, elle remercie de cette souffrance avec un sourire affectueux. Cette obéissance n’est pas pour elle une chose involontaire et, y eût-il même une force irrésistible, son âme docile est toujours prête, comme un enfant soumis, à répondre à l’appel. Je l’ai entendue, au moment du réveil, dire avec un accent touchant : « Il faut que j’aille ; oui ! je viens ! » ou bien : « Je ne puis pas ! j’ai les pieds cloués ! déliez-moi les pieds ! » Cette prière se rapporte à la position toujours la même de ses pieds étendus, dont les talons se croisent involontairement l’un sur l’autre comme ceux d’un crucifix, en sorte qu’en revenant à elle, elle a de la peine à les détacher. Ensuite elle se frotte un peu les yeux, et reprend tout à fait connaissance quand on l’a aspergée d’eau bénite, faisant en même temps le signe de la croix et cherchant à reprendre son chapelet s’il est tombé de ses mains pendant l’extase.
« Elle m’a dit qu’elle éprouvait une souffrance inouïe quand elle était subitement réveillée et tirée d’un état si étranger à la vie commune pour rentrer dans cette vie rude et agitée. C’est pour elle souvent comme si elle tombait tout d’un coup au milieu de gens complètement étrangers, desquels elle ne pourrait être comprise et qui seraient pour elle une espèce d’énigme. Souvent on veut lui venir en aide, et l’assistance lui est plus douloureuse que la négligence.
« Peu de temps après, je priai le confesseur de donner son ordre à la malade par écrit ; il écrivit en ma présence les mots : « Soyez obéissante, levez-vous ! » La malade était plongée dans l’extase ; sa tête était cachée dans une double coiffe et entourée d’un linge plié. À l’instant même où le billet du confesseur fut mis sur sa tête, elle poussa un profond soupir et se redressa. « Que voulez-vous ? » demanda le confesseur, et elle répondit : « Me lever ; on m’appelle » ; mais lorsqu’il lui dit : « Restez couchée » et retira le billet, elle retomba aussitôt dans son immobilité. Je garde ce billet et je veux savoir si, en l’absence du confesseur, je pourrai, moi aussi, m’en servir pour l’éveiller. »
Le confesseur ayant donné son consentement, l’ordre écrit fit de nouveau son effet sur Anne Catherine quelques jours après, ainsi que le rapporte le pèlerin. « Ce soir, dit-il, comme elle était en extase pendant l’absence de son confesseur et que personne ne pouvait la réveiller, j’ai pris l’ordre écrit par lui et, à peine l’avais-je mis sur sa poitrine qu’elle revint à elle comme de coutume. »
7. Or, il la vit pratiquer ainsi l’obéissance non seulement pendant l’extase, mais encore dans l’état de veille naturel et même au milieu des souffrances les plus cruelles. Voici ce qu’il rapporte :
« Aujourd’hui, la douleur la fit plusieurs fois tomber en faiblesse, et on lui fit prendre du musc à diverses reprises. Comme elle le vomissait toujours, on lui frictionna l’estomac avec de l’opium. Elle se laissa faire patiemment et resta comme morte. Comme j’étais à peu de distance de son lit, vivement ému de son état, elle me fit un léger signe de tête. À tout ce que disait le confesseur, elle répondait à voix basse, sans sortir de sa défaillance : « Oui, oui. » Dans cette défaillance presque mortelle, on pouvait voir en elle une image singulièrement touchante de l’obéissance et de la résignation. L’autre jour elle a dit : « J’ai eu beaucoup à souffrir pendant la nuit ; mais, quand je puis souffrir en paix, cela m’est très doux. Il est doux alors de penser à Dieu. Une pensée tournée vers Dieu est pour moi plus que le monde entier. Les remèdes ne m’ont pas fait de bien. Je ne puis pas les supporter. Tantôt on me laisse languir et défaillir, tantôt tous les remèdes à la fois tombent sur moi ; mais cela aussi, je dois le supporter. »
Sa profonde humilité ne fut pas tout de suite comprise du pèlerin. Elle pratiquait cette vertu à un si haut degré qu’elle semblait être devenue comme sa nature ; c’est pourquoi, assez souvent, il n’en remarquait pas les marques les plus touchantes, ou bien il les prenait pour des malentendus, jusqu’à ce qu’un plus long séjour eût rendu son regard plus clairvoyant à ce sujet. Voici ce que rapporte son journal :
« Je lui exprimais mon désir qu’une personne bien élevée, ayant à la fois de la distinction et de la simplicité, pût être placée auprès d’elle pour y remplir l’office de garde-malade. Elle se mit alors à pleurer comme un enfant et s’accusa elle-même de n’avoir reçu aucune éducation. Je répondis qu’elle ne paraissait pas m’avoir bien compris, vu que les qualités dont je parlais ne lui manquaient pas ; c’était pour sa consolation, ajoutai-je, que je lui souhaitais une compagne qui les possédât. Mais elle revenait sans cesse à ces paroles pour se les appliquer et s’accuser d’être entièrement dépourvue de ces qualités. Comme à la fin je m’impatientais de ce qu’elle ne voulait pas me comprendre, elle dit en pleurant avec une voix suppliante : « Je ne veux pas vous blesser ; je n’ai pas ces qualités, mais Dieu a pitié de moi. »
8. De même qu’il avait constaté le pouvoir du commandement donné par le prêtre, le pèlerin apprit aussi à connaître la vertu de la bénédiction sacerdotale. Voici ce qu’il rapporte :
« Elle me dit un jour : « Les souffrances que j’éprouve dans le corps et dans l’âme et les effrayantes visions qui me sont montrées me mettent souvent à l’extrémité. Alors je suis cruellement altérée et je n’ai pas une goutte d’eau pour me rafraîchir, parce que je ne puis pas me remuer. » À ces paroles, je lui présentai à boire et, comme j’arrosai le bord du verre avec de l’eau bénite, elle dit : « C’est du vin, du vin du jardin de l’Église. »
« Un autre jour, j’étais assis dans sa chambre pendant qu’elle était en contemplation. Comme, sans sortir de la vision, elle se mit à pousser des gémissements plaintifs, je m’approchai d’elle avec le verre à boire qui est placé près d’elle et où il doit toujours y avoir de l’eau bénite. Frappé de sa pâleur livide et de son aspect effrayant, je lui demandai si elle voulait boire, mais elle secoua la tête et dit d’une voix éteinte comme celle d’un agonisant : « Il faut que j’aie un peu d’eau fraîche bénie par la main d’un prêtre. Il y a deux prêtres tout près de moi. Ils possèdent ce pouvoir divin ; mais ils m’oublient et je reste languissante. Dieu veut que je vive de cela ; au moins, qu’ils ne me laissent pas mourir ! » J’allai aussitôt dans la chambre de l’abbé Lambert, qui était tout à côté, et je trouvai, en effet, le confesseur près de lui, ce que ni elle ni moi ne pouvions savoir, parce que nous le croyions absent. Celui-ci bénit de l’eau fraîche et la lui porta. Elle but avec plaisir et dit : « Je suis soulagée. » Il lui dit alors par manière de plaisanterie : « Venez avec moi au nom de l’obéissance. » Alors cette personne, qui ressemblait à une morte, fit un effort pour se lever ; mais, comme l’ordre n’était pas donné sérieusement, elle retomba sans connaissance. Je fus singulièrement bouleversé de cette scène ; je n’osai pourtant pas prier le confesseur de s’abstenir de semblables expériences, de peur de troubler les bons rapports. Mais la compassion m’arracha des larmes lorsque je la vis supporter cette épreuve si tranquillement et sans proférer une plainte.
« Dans une autre occasion, je l’entendis s’exprimer ainsi à propos de la bénédiction sacerdotale : « Il est bien triste que les prêtres, dans notre temps, soient si indifférents en ce qui touche le pouvoir de bénir. On dirait souvent qu’ils ne savent plus ce que c’est que la bénédiction sacerdotale ; beaucoup y croient à peine et rougissent de la bénédiction comme d’une cérémonie surannée et superstitieuse. Beaucoup enfin ne réfléchissent nullement à cette vertu et à cette grâce qui leur a été donnée par Jésus-Christ, et traitent la chose très légèrement. Si on néglige de me bénir, c’est quelquefois de Dieu lui-même que je reçois la bénédiction ; mais, comme le Seigneur a institué le sacerdoce et lui a transmis le pouvoir de bénir, il me faut souvent languir et me consumer dans le désir que j’ai de recevoir la bénédiction. Tout dans l’Église ne fait qu’un seul corps ; le refus de l’un est cause que l’autre reste affamé. »
Le pèlerin pouvait se convaincre presque journellement de la vérité de ces paroles, en sorte qu’il éprouvait un sentiment de douleur toutes les fois qu’en l’absence du confesseur elle désirait de l’eau bénite et que celui-ci avait oublié d’en bénir. L’ayant trouvée un jour en proie à une fièvre brûlante, avec le gosier et le palais tout desséchés, il alla prendre pour elle un verre d’eau fraîche qu’il bénit avec la meilleure intention du monde devant la porte de sa chambre qui était fermée. La malade le reçut en souriant avec ces paroles : « Ah ! pourquoi n’êtes-vous pas prêtre ? » Et, comme il s’en étonnait, elle lui avoua qu’elle l’avait vu bénir l’eau à travers la porte fermée. Cela lui fit une grande et singulière impression ; mais il fut encore bien plus surpris lorsqu’un jour il acquit tout à coup la certitude qu’Anne Catherine lisait en lui ses pensées les plus secrètes et les plus fugitives. Un jour, pendant qu’il s’entretenait avec elle, son esprit fut traversé avec la rapidité d’un éclair par l’idée qu’elle mourrait peut-être bientôt et par le souvenir d’avoir lu quelque part, qu’après la mort d’une personne favorisée de grâces extraordinaires, un pape avait fait détacher sa main ; alors, interrompant la conversation, elle sourit et lui dit : « Vous pensez à ma mort et vous voulez me couper la main. » Le pèlerin fait à ce propos la remarque suivante dans son journal : « En vérité, cela vaut la peine de penser à quelque chose ! Il est bien facile de s’entendre avec une personne qui, non seulement lit dans votre âme, mais qui va au-devant de la pensée avant qu’elle s’y soit clairement développée. »
9. D’autres incidents se présentèrent qui non seulement le conduisirent à se faire une idée juste de l’Église, mais qui, en outre, excitèrent en lui un vif désir de mettre consciencieusement à profit pour le progrès de sa vie intérieure la grâce que Dieu lui faisait en le mettant en rapport avec une créature si privilégiée. Voici comment il s’exprime à ce sujet :
« Je l’ai vue en prière. Ses mains blessées, toujours douloureuses aux doigts du milieu, reposaient sur sa poitrine, jointes ensemble et légèrement recourbées en dedans. Elle semblait sourire et son visage était celui d’une personne qui voit et qui parle, quoique les lèvres et les yeux fussent parfaitement clos. Sa vue me toucha profondément. La paix joyeuse et la piété profondément contemplative qui brillaient sur ce visage plein d’innocence et de candeur enfantine réveillèrent en moi avec une extrême vivacité la conscience de mon indignité et de ma vie criminelle. Dans la paisible solennité de cet instant, je me tenais comme un mendiant devant elle ; je soupirais intérieurement et je disais avec l’émotion d’une douleur suppliante : « Âme pure, prie pour moi, pauvre malheureux gisant à terre, plein de ténèbres et de péchés et ne pouvant pas m’aider moi-même. »
« Je sens que je trouve ici une demeure et quelque chose me dit que je ne puis pas quitter cette admirable créature avant sa mort ; je sens que la tâche à laquelle je dois consacrer ma vie est ici et que ma prière a été exaucée quand j’ai demandé à Dieu de me charger sur la terre de quelque chose qui ne soit pas au-dessus de mes forces et qui puisse contribuer à sa gloire. Je m’efforcerai, suivant mon pouvoir, de recueillir consciencieusement et de conserver le trésor de grâces que j’ai ici sous les yeux. »
Cette sérieuse impression devint chez lui de plus en plus profonde et, peu de temps après, il résumait ce qu’il avait éprouvé jusqu’alors dans cet aveu significatif :
« Les merveilleux incidents au milieu desquels je vis, l’innocence enfantine, la paix, la patience et la profonde sagesse dans les choses spirituelles de la pauvre paysanne illettrée près de laquelle s’ouvre pour moi comme un nouveau monde, me font sentir si vivement l’état misérable de ma propre vie pleine de trouble et de péchés, ainsi que la conduite absurde de la plupart des hommes ; elles me montrent sous un jour si brillant le prix de tous ces biens perdus trop tôt, la simplicité, la foi et l’innocence, qu’en songeant à ces trésors je verse du fond de mon cœur des larmes de repentir...
« Elle s’est confessée aujourd’hui ; elle tomba aussitôt après en extase et récita sa pénitence les bras étendus. Je considérais avec étonnement la sainte expression de son visage, et je dois avouer que tout ce que j’ai jamais vu, soit dans la réalité, soit en peinture, comme représentation de la piété, de la paix et de l’innocence, me paraissait en comparaison pauvre et inanimé. Comme je me préparais moi-même à la confession, je fus saisi d’une grande tristesse et d’un grand repentir ; je me recommandai à ses prières et, pour me consoler, elle m’adressa à la bonne mère de Dieu. « Ah ! dit-elle, la bonne mère de Dieu ! Elle nous connaît bien, pauvres créatures que nous sommes, et nous conduit à Jésus, son enfant. Oh ! quel immense trésor de grâces il y a dans l’Église ! Consolez-vous ! nous avons dans ce trésor de quoi nous réconforter !... » Je sentis alors de nouveau que l’Église est pour elle quelque chose que, dans mon aveuglement, je ne puis encore comprendre, et je repassai dans mon âme tout ce que j’ai éprouvé et tout ce que j’ai appris ici pour la première fois de ma vie. J’en fis la comparaison avec ma vie passée et ma conduite désordonnée, et il s’éveilla en moi un nouveau et sérieux désir de conversion. Dans cette disposition d’esprit, je lui écrivis une lettre où je m’humiliais devant Dieu et où je lui faisais part de la tristesse que me causait mon état, la suppliant de continuer à prier pour ma conversion. Elle prit cette lettre avec beaucoup de bienveillance. Je ne vis pas qu’elle la lût ; mais elle savait bien ce qu’elle contenait et peut-être encore plus qu’elle ne contenait...
« La bonté et la confiance naïves que me témoigne cette créature privilégiée sont quelque chose qui me relève et me fait un bien extraordinaire, car elle est si parfaitement, si véritablement chrétienne ! Personne n’a jamais connu comme elle la misère de mon âme et l’énormité de mes fautes ; je ne les connais pas moi-même à ce degré, car elle mesure et pèse les choses avec une justesse et une clairvoyance que je n’ai pas ; mais elle me console et m’assiste...
« Maintenant je reconnais ce qu’est l’Église et comment elle est quelque chose d’infiniment supérieur à une réunion de personnes animées des mêmes sentiments. Oui, elle est le corps de Jésus-Christ qui, comme son chef, est essentiellement uni à elle et qui a avec elle des rapports intimes où il n’y a jamais d’interruption. Maintenant je reconnais quel trésor immense de grâces et de biens de toute espèce l’Église a reçu de Dieu, lequel ne peut se communiquer aux hommes que par elle et en elle. »
10. Ces dernières phrases se rapportaient aux divers entretiens dans lesquels Anne Catherine avait combattu les vues erronées du pèlerin et avait fait ressortir avec force la pureté et la complète vérité de la foi catholique. Encore dominé par le faux mysticisme d’après lequel il ne voyait dans l’Église « qu’une communauté formée de tous les enfants de Dieu, sans distinction de confession extérieure », il n’avait pas été médiocrement surpris lorsqu’Anne Catherine, dès les premiers jours de son séjour à Dulmen, l’entendant parler dans les termes les plus élogieux « des frères séparés extérieurement, mais unis par l’esprit, parce que tous appartiennent à l’Église universelle », lui fit cette réponse grave et concluante :
« Il n’y a qu’une Église, l’Église catholique romaine ! Et, quand il ne resterait sur la terre qu’un seul catholique, celui-ci constituerait l’Église une, universelle, c’est-à-dire catholique, l’Église de Jésus-Christ, contre laquelle les portes de l’enfer ne prévaudront pas. » Et comme il objectait que pourtant tous ceux qui croient au Christ sont certainement enfants de Dieu, elle répondit : « Si Jésus-Christ dit que les enfants de Dieu doivent honorer et aimer Dieu comme leur père, il faut bien aussi qu’ils appellent leur mère la mère bien-aimée de Dieu et qu’ils aient le sentiment qu’elle est leur mère. Quant à celui qui ne voit pas cela, qui ne le fait pas et ne le pratique pas de lui-même sans autre explication, le Notre Père est pour lui une vaine formule et lui-même est loin d’être un enfant de Dieu. » Puis, revenant à l’Église, elle continua : « La connaissance de la grandeur et de la magnificence de cette Église, dans laquelle les sacrements sont conservés avec toute leur vertu et leur sainteté inviolable, est malheureusement une chose rare de nos jours, même chez les prêtres. Et c’est parce que tant de prêtres ne savent plus ce qu’ils sont que tant de fidèles aussi ne savent plus ce qu’ils sont et ne comprennent plus le sens de cette parole, « appartenir à l’Église ». Afin que nul pouvoir humain ne pût détruire l’Église, Dieu a fait de la consécration sacerdotale un signe ineffaçable. Quand il n’y aurait sur la terre qu’un seul prêtre régulièrement ordonné, Jésus-Christ serait vivant dans son Église comme Dieu et homme au moyen du très saint sacrement de l’autel ; quiconque, étant absous de ses péchés par le prêtre, reçoit ce sacrement, celui-là seul est véritablement uni à Dieu. »
11. C’est quelque chose de très grand, mais aussi quelque chose d’impossible sans la vraie lumière, sans la simplicité et la pureté, que de vivre selon la foi de cette sainte Église, de célébrer avec elle le culte divin, et de participer par là au trésor infini de grâces et de satisfactions qu’elle possède dans les mérites de son chef divin, et, à cause de ces mérites, dans le sang de ses innombrables martyrs, dans les souffrances et les pénitences de ses saints, dans les prières et les bonnes œuvres de tous les pieux fidèles, trésor qu’elle communique sans l’épuiser jamais à tous ceux qui sont en union avec elle, qui sont ses enfants véritables. C’est de là qu’elle tire de quoi satisfaire la justice de Dieu, de quoi payer pour les indigents et les faibles dans ce monde, comme pour les âmes souffrantes dans l’autre, la dette qu’eux-mêmes ne peuvent pas acquitter. Chaque heure a sa grâce ; celui qui la repousse languit et dépérit. Comme il y a une année terrestre avec ses saisons, une nature terrestre avec ses créatures, ses fruits et ses propriétés, de même il existe aussi une économie d’un ordre supérieur pour la restauration de notre race déchue, avec des grâces et des moyens de salut innombrables, tout cela lié à une année spirituelle et qui a ses saisons. Chaque année, chaque jour, chaque heure y font mûrir les fruits qui nous sont offerts pour notre salut éternel. Les enfants de l’Église catholique qui célèbrent pieusement cette année spirituelle avec ses fêtes et ses cérémonies, qui règlent leur vie d’après ses prescriptions, qui récitent les saintes heures canoniques, ceux-là seuls sont des travailleurs et des cultivateurs fidèles dans la vigne et y recueillent les bénédictions en abondance. Il est triste de voir aujourd’hui si peu de personnes reconnaître cette économie de la grâce et y conformer leur vie ; mais, un jour, on verra avec terreur ce que c’est que l’année ecclésiastique, ses fêtes, les temps et les jours consacrés à Dieu, les prières et les dévotions de l’Église, les heures canoniques et la récitation du bréviaire par les prêtres et les religieux. C’est le divin Sauveur lui-même qui vit avec nous dans cet ordre de choses, qui en tout temps se donne à nous comme victime et comme nourriture, afin que nous devenions un en lui. Combien éclatent sa miséricorde et sa sollicitude sans relâche pour nous dans ces milliers de messes où le sacrifice propitiatoire, sa mort sanglante sur la croix, est renouvelé tous les jours d’une manière non sanglante et offert pour nous au Père céleste ! Ce sacrifice de la croix est un sacrifice éternel, un sacrifice d’une efficacité infinie, inaltérable, toujours nouvelle ; mais il doit profiter aux hommes dans le temps qui est fini et où tout est compté. C’est pourquoi, suivant l’institution du Fils de Dieu fait homme, ce très saint sacrifice est renouvelé et répété tous les jours jusqu’à ce que le compte soit achevé et que le monde avec son existence dans le temps arrive à sa fin, car c’est Jésus-Christ lui-même qui, par les mains des prêtres légitimement ordonnés, fussent-ils même indignes, s’offre à son Père céleste sous les espèces du pain et du vin pour le réconcilier avec nous.
12. Lorsqu’Anne Catherine avait avec le pèlerin des entretiens de ce genre, elle en profitait pour l’exhorter en même temps à la prière, aux pratiques de pénitence, à la charité chrétienne, à la lutte contre lui-même et au renoncement, et cela d’une manière si simple et si naturelle que ses paroles se présentaient à lui moins comme une exhortation que comme une consolation, ou comme la conséquence nécessaire et venant de soi-même de ce qu’elle avait dit et de ce qu’il avait reconnu vrai. Et quand elle ne pouvait pas avoir avec lui un entretien prolongé, elle lui demandait au moins ses prières, qu’elle réclamait comme une aumône spirituelle, pour elle-même ou pour quelque intention à elle recommandée par d’autres personnes. Elle lui indiquait tel ou tel exercice de piété, telle ou telle formule de prière, l’encourageant à mettre en Dieu toute sa confiance et le faisant ainsi entrer chaque jour plus avant dans une vie en union avec l’Église. Elle lui demandait par exemple en ces termes des prières et des œuvres de charité pour les pauvres âmes du purgatoire : « Nous vivons des biens que nous ont laissés nos parents et nos aïeux ; mais nous oublions facilement ce que nous leur devons, combien ils désirent que nous nous montrions reconnaissants envers eux et combien ils ont besoin de notre secours. Supporte, souffre, prie, jeûne, fais l’aumône pour nous ! nous crient-ils ; offre pour nous le saint sacrifice de la messe ! » Et quand il lui demandait ce qu’il pouvait faire pour ses parents décédés, elle lui conseillait, outre la prière et les aumônes, de s’imposer pendant un certain temps des pratiques déterminées de renoncement à lui-même et de mortification spirituelle, de patience et de douceur.
13. Quoique le pèlerin ne pût pas résister à la force et à la vérité des paroles d’Anne Catherine, il lui était pourtant difficile de se défaire d’une opinion longtemps nourrie dans son esprit et que son attachement pour des personnes respectées lui avait rendue chère, opinion suivant laquelle il était possible, même sans adhérer extérieurement à l’Église et sans être en communion réelle et complète avec elle, d’avoir une piété véritable et agréable à Dieu. Il s’appuyait pour le prouver sur ce que beaucoup de personnes vivant hors de l’Église valent mieux que d’autres personnes nées dans le catholicisme, et il se plaisait à retracer si éloquemment le triste état de l’Église catholique dans bien des pays que souvent Anne Catherine n’osait rien répliquer, parce qu’elle voyait bien que ses arguments ne feraient pas d’effet sur lui. Mais un jour elle amena elle-même la conversation sur ce sujet, et lui dit :
« Mon conducteur spirituel m’a reproché sévèrement d’avoir écouté avec trop de complaisance l’éloge des hérétiques pieux. Il m’a demandé si je ne savais plus qui je suis et à qui j’appartiens. Je suis, m’a-t-il dit, une vierge de l’Église catholique, consacrée à Dieu et liée par de saints vœux. Je dois louer Dieu dans l’Église et prier pour les hérétiques avec une sincère compassion. Je suis à même de savoir mieux que d’autres ce qu’est l’Église et je dois pour cela louer les membres de Jésus-Christ dans l’Église, qui est son corps ; quant à ceux qui se sont arrachés de ce corps et lui ont fait de si cruelles blessures, je dois les plaindre et prier pour leur conversion. En louant les désobéissants, on participe à leur faute. Puis ces louanges ne sont pas de la charité parce que le véritable zèle pour le salut des âmes en est affaibli. Il a été bon pour moi que je fusse blâmée, car il ne faut pas se laisser aller ainsi quand il s’agit de choses aussi saintes. Je vois bien parmi les hérétiques beaucoup de bonnes personnes, et elles m’inspirent une grande compassion ; mais je vois aussi qu’ils sont des enfants dont l’origine ne remonte pas plus haut qu’eux-mêmes, qui vont à la dérive et qui se divisent sans cesse entre eux. Un mouvement vers la piété qui leur vient de la souche catholique se fait sentir par moments chez eux ; mais il se trouve à côté un mouvement ténébreux, indocile, qui les soulève contre la mère commune et les détourne d’elle. Ils ne demandent pas mieux que d’être pieux, pourvu qu’ils ne soient pas catholiques. Quoiqu’ils disent sans cesse que les cérémonies et les formes mortes n’ont pas d’importance, qu’on doit servir Dieu en esprit, ils tiennent pourtant avec obstination à la forme et en réalité à une forme morte, qui s’est faite elle-même et qui, à cause de cela, est toujours variable ; qui n’est pas le résultat d’un développement interne, un corps animé par l’esprit, mais une enveloppe morte. C’est pourquoi ils ne peuvent courber la tête et tous ont la maladie de l’orgueil. En effet, comment arriveraient-ils à avoir l’humilité du cœur, eux qui n’apprennent pas dès l’enfance à s’humilier, qui ne confessent pas leurs péchés et leurs misères, qui ne se sont pas accoutumés comme les enfants de l’Église à s’accuser dans le sacrement de pénitence devant le représentant de Dieu, pleins de repentir et de confusion ? Voilà pourquoi je vois, même dans les meilleurs, quelque chose de défectueux, de présomptueux, d’opiniâtre, d’orgueilleux. Les seuls hérétiques qui ne soient pas sur une mauvaise voie sont ceux qui, ne sachant rien de l’Église, hors de laquelle il n’y a point de salut, pratiquent la piété comme ils le peuvent. Mais aussitôt que Dieu leur donne le moindre signe ou leur envoie le moindre doute, c’est un appel qui leur est fait et ils doivent chercher à connaître la vérité. Les hérétiques aussi sont devenus membres de l’Église par le saint baptême, s’ils l’ont reçu suivant les règles ; ils vivent uniquement de l’Église et n’ont, en fait de nourriture spirituelle, que ce qui peut leur venir de l’Église ; mais ils ne sont point à table avec les enfants de la maison ; ils sont dehors, insultant, se vantant ou mourant d’inanition. Quand je vois en vision des hérétiques baptisés qui rentrent dans l’Église, c’est comme s’ils sortaient des murs de l’Église pour venir devant l’autel et le très saint Sacrement ; tandis que les non-baptisés, les Juifs, les Turcs et les païens, quand ils se convertissent, me sont montrés comme entrant par la porte. »
Un jour, elle exprima sa pensée au moyen du tableau symbolique suivant :
« Je vis deux villes, l’une à droite, l’autre à gauche. À la ville de gauche conduisait une belle allée droite d’arbres au tronc lisse et couverts de fleurs ; mais ces fleurs tombaient sans cesse les unes après les autres et on ne voyait pas de fruits. Mon conducteur me dit : « Vois combien cette nouvelle ville est plus pauvre que l’ancienne qui est à droite. » La ville elle-même paraissait extérieurement très bien perchée ; mais tout y était comme mort. Alors mon conducteur me montra aussi la vieille ville qui était à droite. Elle paraissait par endroits beaucoup plus irrégulière et plus dégradée ; mais on voyait tout autour des arbres magnifiques, couverts de fruits. Il n’y avait de pénurie et de dommage à souffrir que pour ceux qui ne recueillaient pas les fruits et ne soignaient pas les arbres. Ces arbres étaient très vieux et s’élevaient majestueusement jusqu’au ciel. D’un côté, ils étaient laissés à l’abandon par ceux qui en étaient chargés : on y voyait des branches brisées et des fruits tombés à terre ; de l’autre côté, ils étaient sains, vigoureux et couverts de fruits excellents. »
14. Mais le pèlerin se sentait encore plus déconcerté quand il voyait, à ne pouvoir s’y méprendre, avec quelle décision Anne Catherine condamnait le faux mysticisme de Boos et de Gossner, leurs menées et leurs adhérents, et quelle peine elle se donnait pour chasser de son âme le poison mortel qu’il y avait laissé pénétrer par suite d’un engouement aveugle pour cette secte et pour ses opinions radicalement destructives de l’économie de la rédemption chrétienne. De même que, précédemment, quelques-uns des visiteurs d’Anne Catherine avaient voulu voir en elle une somnambule magnétique, de même le pèlerin, au commencement, avait été tenté de la ranger dans la même catégorie que les faux mystiques ; mais l’impression que toute sa manière d’être fit sur lui, sa simplicité modeste, son respect sans bornes pour l’autorité ecclésiastique, la fermeté inébranlable et la pureté de sa foi qui ne tolérait pas qu’on s’écartât le moins du monde des prescriptions et des traditions de l’Église, le ramenèrent bientôt à une appréciation plus juste. Un jour qu’il parlait en termes élogieux des chefs de cette secte, elle lui dit avec chagrin : « Oui, je connais Gossner. Cet homme me fait horreur ; il est extrêmement dangereux. Boos aussi est un homme inflexible et opiniâtre qui me fait peur. Il faudrait bien des choses pour que celui-là pût être sauvé. »
Il fut aussi question par hasard d’une certaine Marie Oberdorfer qui était en rapports intimes avec les cercles de faux mystiques et dont le pèlerin, appuyé sur l’opinion d’un ami ecclésiastique qu’il estimait beaucoup, parlait comme d’une personne éclairée de lumières particulières. Anne Catherine, qui assistait à la conversation sans y prendre part, s’écria tout à coup : « Éclairée ! qu’est-ce que cela ? » Et sur l’explication de Brentano, que cette femme lui semblait posséder une lumière intérieure pour l’intelligence des saintes Écritures, elle reprit :
« Ces lumières ne sont rien ; mais la grâce accordée aux fidèles enfants de l’Église est grande. Ceux-là seuls, par leur confession sincère et obéissante de la foi catholique, la seule vraie, par leur communion vivante avec l’Église visible, sont dans les eaux qui découlent de la Jérusalem céleste. Quant à ceux qui ont la présomption de s’élever au-dessus de l’Église et de l’autorité spirituelle, qui prétendent être les seuls à posséder la lumière et s’appellent eux-mêmes « la communion des saints », ils n’ont aucune lumière réelle, car ils ne se tiennent pas dans la foi, mais ils s’égarent et se séparent de Dieu et de son Église. Je vois chez tous, même chez les meilleurs d’entre eux, un orgueil effrayant, mais chez aucun l’humilité, la simplicité et l’obéissance. Ils sont terriblement vains de la séparation dans laquelle ils vivent. Ils parlent de foi, de lumière, de christianisme vivant ; mais ils méprisent et outragent la sainte Église dans laquelle seule il faut chercher la lumière et la vie. Ils se placent au-dessus de tout pouvoir et de toute hiérarchie ecclésiastique et ne connaissent ni la soumission ni le respect envers l’autorité spirituelle. Dans leur présomption, ils prétendent mieux comprendre toute chose que les chefs de l’Église et même que les saints docteurs. Ils rejettent les bonnes œuvres, et veulent pourtant posséder toute perfection, eux qui, avec leur prétendue lumière, ne jugent nécessaires ni obéissance, ni règles de discipline, ni mortification, ni pénitence. Je les vois toujours s’éloigner de plus en plus de l’Église, et je vois beaucoup de mal provenir d’eux. »
Comme ce jugement sévère choquait beaucoup le pèlerin par sa contradiction si tranchante avec l’opinion favorable à ces sectaires dont il s’était imbu antérieurement, Anne Catherine revint encore plusieurs fois sur ce sujet. Et, un jour, elle porta ce jugement sévère : « Ces “éclairés”, je les vois toujours dans un certain rapport avec la venue de l’Antéchrist, car eux aussi, par leurs menées, coopèrent à l’accomplissement du mystère d’iniquité. »
Le pèlerin n’osa pas la contredire ; mais il se passa encore longtemps avant qu’il arrivât à bien comprendre et à voir clairement qu’Anne Catherine avait par là atteint le faux mysticisme dans son essence la plus intime. Aucun égarement n’amène des conséquences aussi désastreuses et n’est aussi difficile à guérir que cet orgueil de l’esprit par suite duquel l’homme pécheur prétend arriver à la suprême union avec Dieu sans passer par le chemin laborieux de la pénitence, sans pratiquer même les premières et les plus nécessaires des vertus chrétiennes et sans autre guide que le sentiment intime et la lumière qui est censée donner à l’âme la certitude infaillible que le Christ opère en elle. « Le Christ pour nous ! le Christ en nous ! » telle avait été la devise des sectaires ; faisant appel à l’infaillibilité de la voix intérieure, ils avaient rejeté tout jugement de l’autorité légitime, de l’Église, qui seule a reçu son pouvoir de Dieu, qui seule a mission pour décider de la vérité ou de la fausseté de ces sortes de manifestations intérieures ; ils s’étaient mis au-dessus des règles de la foi et des commandements divins et avaient par là renversé toute barrière qui eût pu préserver ces infortunés de ce mal dont l’influence désastreuse faisait lever comme une semence de malédiction partout où ils portaient leurs pas.
À la vérité, le poète n’avait pas encore bu à leur coupe enivrante ; toutefois son ancienne disposition hostile à l’Église l’avait conduit à prendre d’autant plus volontiers pour la vérité leurs mots sacramentels « d’esprit, d’amour, de lumière, d’entrée, d’habitation, d’opération et de parole de Dieu en nous », que tous ces biens lui étaient montrés comme pouvant être acquis de la manière la plus facile et la moins pénible. Mais, dans le voisinage de la servante de Dieu et sous son action, ces prestiges se dissipèrent forcément pour lui ; il commença avec toute l’énergie de son esprit à s’efforcer d’acquérir cette foi pure et vive qu’il reconnaissait être le principe fondamental et l’élément essentiel d’où venait à Anne Catherine la force incompréhensible avec laquelle elle accomplissait sa mission de souffrance pour la glorification de Dieu et de son Église.
15. Sailer et Christian Brentano étaient arrivés le 22 octobre à Dulmen, et le pèlerin pensait à se joindre à eux lors de leur départ pour aller de nouveau séjourner à Berlin ; mais Anne Catherine, avec une bonté touchante, l’engagea à rester encore à Dulmen, pour y poursuivre à l’aide des moyens déjà indiqués l’œuvre commencée de sa rénovation spirituelle. « Dieu me fait de grandes grâces, s’écria-t-il plein de reconnaissance ; la sœur Emmerich fait prodigieusement pour moi ; je suis devenu son enfant ! » Il voulait très sérieusement être envers elle comme un enfant docile ; mais cette bonne résolution ne passait pas encore à l’état de fait accompli. Bientôt l’entourage d’Anne Catherine se sentit de plus en plus gêné par l’entrée d’un esprit si supérieur dans sa modeste sphère, à mesure que le pèlerin arrivait à mieux comprendre la personne d’Anne Catherine et ses dons extraordinaires et s’attachait avec une ardeur toujours croissante à tirer le plus grand profit possible pour lui-même et pour les autres de son commerce avec elle et de tout ce qu’elle lui communiquait. Il regardait comme perdu tout le temps qu’elle ne lui donnait pas, mais qu’elle employait à consoler les pauvres, les affligés et ceux qui avaient besoin d’assistance ; il lui arrivait souvent de s’abandonner au plus amer mécontentement et même à l’affliction la plus profonde, lorsqu’elle se fatiguait péniblement à diriger sa sœur dans les soins du ménage, au lieu d’initier le pèlerin aux mystères de ses contemplations. Le médecin ne pouvait plus parler de ses malades à Anne Catherine, le confesseur lui raconter ses peines spirituelles, l’abbé Lambert l’entretenir des infirmités de sa vieillesse. Il fallait que sa sœur Gertrude fût éloignée, que sa porte fût fermée aux rares visites de Flamske et surtout à ses anciennes compagnes du couvent d’Agnetenberg, afin que sa bouche ne s’ouvrît pour personne, sinon pour le pèlerin, tourmenté d’un désir ardent de ses communications, et qui assurait de si bon cœur, en versant des larmes, qu’il voulait employer toutes les forces de son esprit et sa vie elle-même pour faire connaître aux contemporains les grâces de Dieu dans cet instrument qu’il s’était choisi.
Il fallait la rare force morale d’Anne Catherine pour rétablir la bonne intelligence entre les personnes de son entourage et l’ami si souvent chagrin, pour obtenir de cet homme si prompt à s’irriter qu’il prît patience et se surmontât lui-même. À la fin, elle ne vit pas d’autre moyen à employer que son éloignement temporaire de Dulmen. Sur la prière de la servante de Dieu et avec l’assurance d’un accueil amical quand il reviendrait, il quitta la petite ville en janvier 1819, et il n’y revint qu’au mois de mai ; mais, même alors, il se passa un temps assez long avant qu’il arrivât au calme et à la liberté d’esprit dont il avait besoin pour recevoir les communications et noter les faits qui seront rapportés dans le volume suivant.
FIN DU TOME PREMIER
TABLE DES MATIÈRES
_______
I. – Mœurs et coutumes populaires en Westphalie au commencement de ce siècle.
II. – Baptême et première jeunesse d’Anne Catherine.
III. – Anne Catherine est conduite par Dieu à l’aide de visions.
IV. – Son éducation dans la maison paternelle.
V. – Anne Catherine reçoit les saints sacrements de pénitence et d’Eucharistie.
VI. – Embûches du mauvais esprit.
VII. – Ses rapports avec son ange gardien.
VIII. – Anne Catherine est appelée par Dieu à l’état religieux, et elle y est préparée par une direction particulière.
IX. – Anne Catherine séjourne trois ans à Coesfeld, depuis sa dix-septième jusqu’à sa vingtième année.
X. – Anne Catherine essaye, en apprenant à jouer de l’orgue, de se faire admettre dans un couvent. – Son séjour de trois ans chez le chantre Soentgen, à Coesfeld.
XI. – Anne Catherine reçoit de Dieu les douleurs de la couronne d’épines. – Son entrée au couvent des Augustines de Dulmen.
XII. – Noviciat d’Anne Catherine.
XIII. – Anne Catherine fait sa profession religieuse le 13 novembre 1803.
XIV. – Ses maladies et ses souffrances corporelles.
XV. – Ses extases et son oraison.
XVI. – Suppression du couvent. – Anne Catherine reçoit les stigmates.
XVII. – Commencement de l’enquête ecclésiastique.
XVIII. – Première visite du vicaire général Droste à Dulmen.
XIX. – Mesures prises par le vicaire général Droste.
XX. – Le bandage des plaies.
XXI. – Le vicaire général Droste et ses compagnons viennent pour la seconde fois à Dulmen, 7 avril 1813.
XXII. – Visites multipliées. – Témoignage d’un médecin protestant.
XXIII. – Les derniers jours de la semaine sainte et les fêtes de Pâques. – Troisième visite du vicaire général et d’Overberg (d’après le rapport officiel du vicaire général Droste).
XXIV. – Le médecin Krauthausen et le doyen Rensing commencent à perdre patience.
XXV. – Les témoignages de Rensing sur Anne Catherine.
XXVI. – Du temps entre Pâques et la Pentecôte.
XXVII. – Le vicaire général Droste vient à Dolmen pour la quatrième fois.
XXVIII. – Témoignages d’Overberg, de Rensing et de Wesener touchant les stigmates.
XXIX. – Anne Catherine est gardée à vue pendant dix jours (du 10 au 20 juin 1813) par vingt bourgeois de Dulmen. – Visite du comte Frédéric-Léopold de Stolberg.
XXX. – Dernière visite du vicaire général Droste à Dulmen. –Il essaye d’emmener Anne Catherine à Darfeld.
XXXI. – Situation extérieure et manière de vivre d’Anne Catherine après l’enquête. – Son entourage : l’abbé Lambert, le père Limberg et sa sœur Gertrude.
XXXII. – Le docteur Guillaume Wesener ; sa position vis-à-vis d’Anne Catherine. – Rapports d’Anne Catherine avec le magnétisme.
XXXIII. – Nouvelles tentatives pour amener Anne Catherine à Munster et la soumettre à de nouvelles observations.
XXXIV. – Clément Brentano à Dulmen. – L’influence d’Anne Catherine sur sa vie intérieure.
FIN DE LA TABLE.