La Maria-Roseta
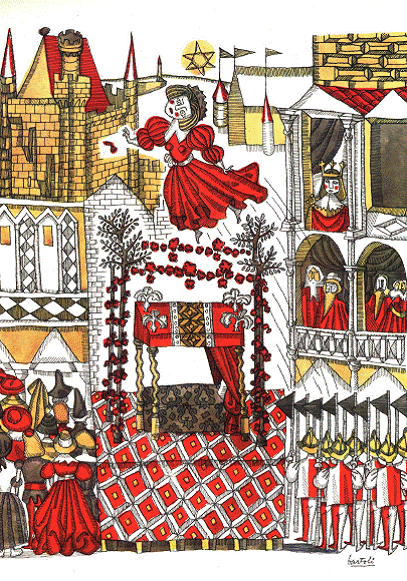
VOICIqu’il était une fois un jeune roi qui voulait se marier et qui, après maintes réflexions sur la vertu majeure que devait avoir sa femme, pensa que mieux vaudrait peut-être qu’elle fût très agile, afin que si, un jour, on voulait l’attraper et qu’elle dût se sauver par la fenêtre, elle fût bien leste pour la sauter.
Il fit alors proclamer publiquement son désir de se marier. Il annonçait que devant son palais, au milieu de la place, il ferait dresser un lit, tout couvert de fleurs, de rameaux et de feuilles et que la jeune fille qui le sauterait d’un seul bond sans faire tomber ni fleur ni feuille se marierait avec lui.
Les demoiselles de tous les pays du monde se présentèrent par milliers et par milliers de mille. Il en vint des jeunes, des riches et des pauvres, et toutes s’efforçaient à qui mieux-mieux de faire le plus grand saut. Mais il n’y en eut aucune d’assez légère pour sauter le lit sans faire tomber quelque fleur ou quelque brindille, ou qui ne fit tout aller sens dessus dessous. Cette sorte d’exercice dura plusieurs mois, et pour rire à se tordre, tous les gens de la ville allaient voir sauter celles qui voulaient être les promises du roi.
Voici qu’un jour se présenta une petite veuve, si jeune que personne n’eût pu déjà la croire en veuvage. Elle était fort vive, légère et jolie. Elle prit sa course de très loin, s’élança et d’un bond passa par-dessus le lit sans faire tomber aucune fleur. Toutefois elle fit voltiger un pétale de rose très petit, mais elle fut si leste qu’elle le saisit au vol, le porta à sa bouche et l’avala sans que personne s’en aperçût. Sitôt qu’elle eut sauté, elle courut se mêler à la foule qui regardait et sans que personne s’en rendît compte, elle s’en alla chez elle, s’y enferma à sept serrures et à sept clés et n’en sortit plus, sauf pour aller à la messe. Le roi fut très content de voir qu’enfin il avait trouvé celle qui pouvait sauter par dessus le lit et il ordonna aux domestiques de la lui amener. Mais les domestiques, cherche par ci, cherche par là, ne purent la trouver, ni personne qui sût leur en rien dire. Puisqu’elle était la seule capable de sauter le lit, le roi dit qu’elle avait gagné sa main, qu’il ne se marierait qu’avec elle et qu’un jour ou l’autre il la trouverait et saurait qui elle était.
Et voici que cette petite veuve eut au bout d’un certain temps une petite fille qu’elle appela Maria-Roseta. Celle-ci était très jolie, plus encore que sa mère. Quand elle fut grande, sa mère la fit aller à la couture 1 et c’était la plus vive de toutes les petites filles qu’instruisait la maîtresse.
Voici qu’un jour, le roi passa près de la couture et lorsqu’il entendit le grand babillage de toute cette troupe de petites filles, il s’en amusa beaucoup et il entra. Toutes les fillettes lui contèrent des histoires, lui chantèrent des chansons et lui dirent des devinettes ; et le roi fut si content d’elles toutes qu’il leur promit qu’il reviendrait et qu’il leur apporterait une petite chaise d’or à chacune. La Maria-Roseta arriva chez elle toute joyeuse et raconta tout ce qui s’était passé à sa petite mère qui lui répondit :
– Dis au Seigneur roi quand il reviendra que tu n’as pas besoin de sa petite chaise d’or ; moi je t’en donnerai une qui sera plus jolie que la sienne, et s’il te demande ton nom, tu lui répondras :
– Je suis Maria-Rose,
Mon père est un rosier,
Ma mère est une rose,
Je vis rue des rosiers
À la maison des roses.
Et elle lui donna une petite chaise d’or pour qu’elle s’y assît à la couture. Au bout de quelques jours, se présenta le roi avec maints serviteurs tout chargés de petites chaises d’or et il en donna une à chaque petite fille. Quand ce fut le tour de la Roseta, celle-ci lui dit qu’elle ne la voulait pas car elle en avait une plus jolie que lui avait donnée sa petite mère. Le roi fut fort étonné de ce refus et lui demanda qui elle était et comment elle s’appelait.
– Je suis Maria-Rose,
Mon père est un rosier,
Ma mère est une rose,
Je vis rue des rosiers
À la maison des roses.
Le roi, très surpris de cette réponse, s’en retourna tête baissée avec la petite chaise dont la Marieta n’avait pas voulu.
Au bout de plusieurs jours, le roi revint à la couture et toutes les petites filles, très contentes, lui contèrent des histoires, lui chantèrent des chansons et lui dirent des devinettes. Le roi, tout heureux, leur promit à chacune un coussinet d’or pour y planter leurs aiguilles.
Quand la Maria-Roseta raconta cela à sa petite mère, celle-ci répondit qu’elle lui donnerait un coussinet plus joli que celui que le roi pouvait lui offrir, qu’elle ne devait pas accepter un coussinet qui lui vînt du roi et que s’il lui demandait qui elle était, elle répondît comme la première fois. Au bout de quelques jours, le roi vint à la couture tout chargé de coussinets d’or ; il en donna un à chaque fillette et la Maria-Roseta lui dit qu’elle n’en voulait pas parce qu’elle en avait un, plus joli, que lui avait donné sa petite mère. Le roi, très fâché, lui demanda qui elle était et comment elle s’appelait.
– Je suis Maria-Rose,
Mon père est un rosier,
Ma mère est une rose,
Je vis rue des rosiers
À la maison des roses.
Le roi, courroucé, dut s’en retourner chez lui avec le coussinet d’or qu’il avait apporté pour la Maria-Roseta.
Et voici qu’au bout de quelques jours, le roi revint encore une fois à la couture, et toutes les fillettes, très contentes, lui racontèrent des histoires, lui chantèrent des chansons et lui dirent des devinettes. Le roi en fut si heureux qu’il leur promit à chacune un aiguillier en or. La Maria-Roseta, toute joyeuse, raconta la chose à sa petite mère qui, fort en colère, lui répondit qu’elle n’avait pas besoin de cet aiguillier, qu’elle lui en donnerait un plus joli que celui du roi, et que lorsqu’il viendrait, elle lui répondît comme les autres fois.
Le roi, tout satisfait, revint au bout de quelques jours, à la couture, tout chargé d’aiguilliers d’or ; et il en donna un à chaque petite fille. Mais la Maria-Roseta ne voulut point accepter le sien et lui répondit comme les autres fois :
– Je suis Maria-Rose,
Mon père est un rosier,
Ma mère est une rose,
Je vis rue des rosiers
À la maison des roses.
Le roi furieux s’abandonna à sa colère, jeta l’aiguillier à la tête de la Marieta et toutes les aiguilles se prirent dans sa chevelure blonde qui descendait jusqu’à ses talons. La pauvre Maria-Roseta dut passer le matin entier à se peigner pour parvenir à enlever tout cet essaim d’aiguilles, mais il lui en resta une, juste auprès de la nuque. Quand elle eut fini de se démêler, elle s’en alla chez elle.
Sur son chemin elle rencontra une vieille sorcière qui l’arrêta, lui demanda où elle allait avec cette aiguille dans les cheveux et qui ajouta qu’elle la lui enlèverait, si elle voulait. La Maria-Roseta, sans penser à mal, lui répondit oui, la méchante sorcière – que fait-elle ! – lui enfonce l’aiguille dans la nuque et la petite fille devient une petite colombe.
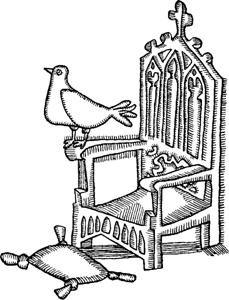
Quand elle se vit devenue colombelle, la Maria-Roseta ne sut plus que faire. Mais enfin, tout en volant, volant, elle s’en alla chez le roi et ne cessa de voltiger, si bien que les domestiques s’en aperçurent et la firent entrer. Elle se posait partout, et elle gagna si vite la sympathie de tous qu’elle venait même se poser sur l’épaule du roi et manger dans son assiette.
Plus de sept ans passèrent. Le roi ne voulait point se marier car il attendait qu’un jour ou l’autre se présentât cette galante mignonne qui avait sauté le lit. Comme celle-ci ne se présentait pas, les gens de la Cour lui firent comprendre qu’il devait se décider à se marier, sans quoi, quand il mourrait, les plus grands embarras surviendraient pour savoir qui serait héritier de la couronne. Le roi se laissa convaincre. Mais comme aucune des femmes du pays qui avaient essayé de sauter par-dessus le lit ne lui avait plu, il crut qu’il ne lui restait pas d’autre solution que d’aller chercher épouse sur une autre terre.
Il appela le patron de la barque la plus grande et la plus rapide et lui dit de l’armer pour le mener dès le lendemain au Pays des Plus-jolies-jeunes-filles. Le patron arma son bateau, et, le jour suivant, de bonne heure, le roi s’embarqua, accompagné des sept hommes les plus vieux et les plus sages du royaume. Quand l’ancre fut levée, la barque ne voulut point bouger, le patron comprit alors qu’il se passait quelque chose et il demanda au roi et aux sept hommes s’ils n’avaient rien oublié. Tous les huit pensaient que non, jusqu’à ce que le roi se frappât le front et dît :
– Voici que j’ai oublié de demander à ma petite colombe si elle ne voulait pas que je lui rapporte quelque chose de la Terre des Plus-jolies-jeunes-filles.
– Allez donc, Seigneur roi, tout de suite le lui demander, car autrement la barque ne bougera pas d’ici.
Le roi, vite, s’en alla chez lui trouver la petite colombe et lui demander si elle voulait qu’il lui apportât quelque chose de la Terre des Plus-jolies-jeunes-filles ; et la petite colombe lui dit :
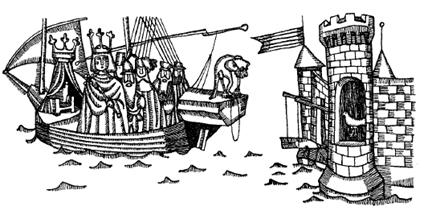
– Je veux un peu de pierre brise-cœur
Qui porte le rire et les pleurs,
Et un peu d’adiante fleurie
Qui donne la mort et la vie.
Et le roi revint à la barque qui aussitôt mit à la voile et en trois souffles de vent on arriva à la Terre des Plus-jolies-jeunes-filles.
Le roi et les sept plus vieux hommes allèrent dans la rue où les jeunes filles qui veulent se marier vont chercher époux. Il en passa par douzaines, par centaines, par milliers et milliers de mille, et aucune ne plut au roi. Ils se promenèrent par cette rue, ce jour-là, le lendemain et le surlendemain et ainsi trois semaines durant sans qu’aucune femme, petite ou grande, plût au roi. Les sept vieux qui étaient avec lui, crurent qu’il ne leur restait plus d’autre solution que d’aller au Pays des Femmes-encore-plus-jolies.
La barque les porta au Pays des Femmes-encore-plus-jolies ; et là ils restèrent trois autres semaines, voyant passer des femmes grandes et petites. Et le roi n’en trouva aucune qui lui plût.
Alors les conseillers pensèrent qu’il leur fallait aller au Pays des Femmes-encore-deux-fois-plus-jolies. Là aussi ils virent passer femmes et filles, dames et demoiselles, sans que le roi se décidât pour aucune.
C’est ainsi qu’ils firent le tour des sept pays des Femmes-jolies, Trop-jolies et Beaucoup-plus-que-jolies. Et pas une ne plut au roi ; les sept vieux se réunirent et décidèrent que ce qu’ils pouvaient faire de mieux serait de revenir chez eux.
Mais voici que la barque ne voulait point bouger et le patron demanda :
– N’y a-t-il personne parmi vous qui n’ait fait quelque oubli ?
Et le roi se rappela alors qu’il n’avait plus pensé à ce que la petite colombe lui avait demandé. Il sauta à terre encore une fois et se mit à faire le tour des boutiques, demandant partout
– Je veux un peu de pierre brise-cœur
Qui porte le rire et les pleurs,
Et un peu d’adiante fleurie
Qui donne la mort et la vie.
Personne ne sut lui répondre et tout le monde se moquait de lui car nul ne croyait à une pierre qui puisse faire rire et faire pleurer ; partout on lui disait que l’adiante était une herbe qui ne fleurissait pas, et le roi passa la journée entière à chercher de boutique en boutique jusqu’à ce que tombât la nuit.
Il pensait qu’il ne pourrait revenir chez lui parce que la barque ne voudrait toujours pas bouger ; mais voici que s’approcha une petite vieille, – si petite, si vieille ! – qui lui demanda la grâce de la charité pour l’amour de Dieu. Et le roi lui dit :
– Écoutez, bonne femme, ne sauriez-vous pas me dire où je pourrais trouver
La pierre brise-cœur,
Qui porte le rire et les pleurs,
Et un peu d’adiante fleurie
Qui donne la mort et la vie.
– Oui, je vous le dirai. Sortez de la ville, marchez sept heures durant vers le midi, et là, vous trouverez deux grandes montagnes. Au sommet de l’une d’elles, vous trouverez un grand tas de pierres blanches : ce sont, changées en pierres, les larmes d’une demoiselle qui y pleura la mort de son promis.
C’est là la pierre-brise-cœur
Qui porte le rire et les pleurs.
À la cime de l’autre montagne, vous trouverez la seule adiante qui fleurisse au monde.
C’est l’adiante fleurie
Qui donne la mort et la vie.
Le roi, à grandes enjambées, s’en alla vers ces montagnes. Il y trouva la pierre et l’adiante, il prit l’une et il prit l’autre, puis, toujours à grandes enjambées, reprit le chemin de la barque où il trouva le patron et les sept conseillers, las d’attendre.
En quatre bourrasques de mistral qui, s’il ne souffle d’en bas, souffle d’en haut, ils arrivèrent en leur pays où tout le monde les attendait pour connaître la princesse. Et tous les gens firent un nez d’un empan, marris de voir que le roi revenait célibataire comme il était parti.
Et voici que le roi, qui avait grande dévotion pour la Mère de Dieu, allait chaque matin, au point du jour, à la messe, suivi de tous ses domestiques. L’un d’eux était un grand dormeur qui se réveillait plus souvent tard que de bonne heure. Un jour il se réveilla si tard qu’il n’était pas encore levé alors que toute la bande des domestiques était déjà sur le chemin de l’église. Quand le roi s’en aperçut, il le fit appeler et le valet sortit à demi vêtu. Comme l’heure de la messe approchait, le roi et sa suite de valets entrèrent dans l’église pendant que le valet dormeur finissait de s’habiller dans la rue. Tout en marchant, celui-ci entendit une petite voix qui disait :
Ah ! pierre brise-cœur,
Toi qui donnes le rire,
Toi qui donnes les pleurs,
Pourquoi n’en pas finir
Avec mes pleurs ?
Ah ! adiante fleurie,
Toi qui donnes la mort,
Toi qui donnes la vie,
Viendras-tu pas encore
M’ôter la vie ?
Et le domestique fut tout interdit d’entendre cette voix. Vite, vite il s’en alla à la messe et il y arriva quand déjà on était sur le point de tourner le missel. Le roi s’aperçut de son retard et tout furieux allait le gronder quand le valet lui demanda pardon, raconta ce qu’il avait entendu et dit que c’était en écoutant cette petite voix qu’il s’était attardé. Le roi ne le crut qu’à demi, pensant que c’était là une excuse.
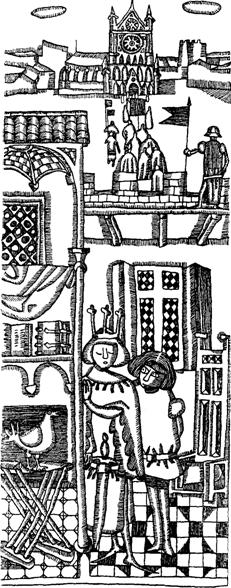
Le lendemain, le valet dormeur dormait encore ; et le roi s’aperçut à nouveau qu’il n’était pas avec les autres quand il se trouva dans la rue avec sa suite. Il le fit appeler et le valet dormeur comme l’autre fois sortit à demi vêtu. Le roi et sa suite de valets se mirent en route et, pendant que le dormeur mettait ses chaussures, il entendit à nouveau la petite voix qui disait :
Ah ! pierre brise-cœur,
Toi qui donnes le rire,
Toi qui donnes les pleurs,
Pourquoi n’en pas finir
Avec mes pleurs ?
Ah ! adiante fleurie,
Toi qui donnes la mort,
Toi qui donnes la vie,
Viendras-tu pas encore
M’ôter la vie ?
Le valet fut encore en retard et le roi gronda de nouveau. Le dormeur lui dit qu’il avait entendu une nouvelle fois la petite voix.
Le roi, tout inquiet de savoir ce que cela pouvait être, prit la décision d’aller plus tard à la messe le lendemain et pendant ce temps il resta à la maison, écoute qu’écouteras. Dès que tous les domestiques furent partis, il entendit la petite voix qui disait :
Ah ! pierre brise-cœur,
Toi qui donnes le rire,
Toi qui donnes les pleurs,
Pourquoi n’en pas finir
Avec mes pleurs ?
Ah ! adiante fleurie,
Toi qui donnes la mort,
Toi qui donnes la vie,
Viendras-tu pas encore
M’ôter la vie ?
Le roi, écoute qu’écouteras, comprit que cette petite voix venait de chez lui et, en se guidant sur elle, il arriva jusqu’à la petite colombe et vit que c’était elle qui parlait. Il lui demanda :
– Or donc, que t’arrive-t-il, colombelle, que tu veuilles mourir ?
– Ah ! Seigneur roi, si vous saviez ma mésaventure ! Ma mère était une petite veuve. Un jour le Seigneur roi promit qu’il se marierait avec la dame qui sauterait un lit mis au milieu de la place sans en faire tomber aucune fleur, aucune brindille, ni voltiger aucune feuille. Ma petite mère parvint à le sauter. Au bout d’un peu de temps je naquis, puis j’allai à la couture. Un jour vint le roi et il me promit une petite chaise en or, et un autre jour un coussinet. Ma petite mère ne voulut pas qu’il me les donnât. Un autre jour, il me promit un aiguillier d’or et parce que je n’en voulus pas, le roi me le jeta à la tête. Une aiguille s’emmêla dans mes cheveux et une vilaine sorcière me l’enfonça dans la nuque et me fit devenir colombe. Je vins habiter chez le roi sans plus jamais rien savoir de ma petite mère, malgré les années passées.
Quand le roi entendit ceci, son cœur défaillit. Tout de suite il prit la petite colombe et, dans le duvet des plumes de sa nuque, chercha l’aiguille, l’enleva, et la colombe devint une jeune fille de quinze ans comme jamais l’on n’en avait vu de si charmante et de si gentille. Le roi lui demanda si elle le voulait pour mari ; elle lui dit que oui, mais que d’abord elle voulait aller voir sa mère. Tout de suite, ils y allèrent et trouvèrent la porte ouverte. Cherche que chercheras, ils ne la trouvèrent que dans la chambre la plus éloignée de la maison. Elle était morte sur son lit, mais aussi fraîche et aussi resplendissante que lorsqu’elle était en vie. Ils l’enterrèrent et, au retour de l’enterrement, se marièrent et vécurent longtemps très heureux.
Conté à Barcelone en 1922 par Antònia Rius i Margalet de Macià, paysanne née à Sarria, banlieue de Barcelone, en 1862. Elle l’avait appris d’une de ses tantes, née à Sant Cugat del Vallès.
Le mari de cette conteuse travaillait à la maistrance d’artillerie et, de ce fait, elle était connue sous le nom de Mme Antònia de la Mestrança. Elle avait toujours vécu à la campagne et était profondément superstitieuse, ignorante et méfiante, et c’est à cause de cette circonstance qu’elle se montrait sauvage pour conter ce qu’elle savait. Elle ne s’expliquait pas très bien ni n’avait un grand répertoire. Elle habitait une ferme éloignée du centre urbain et il nous fallut nous procurer une recommandation de ses maîtres pour qu’elle voulût bien nous recevoir et nous écouter.
Une seconde version de La Maria-Rosetam’a été donnée par Josepa Moix i Carcereny de Ferrer, née à Barcelone en 1868. Elle tenait une taverne ; illettrée, elle possédait une culture traditionnelle très riche, notamment dans le domaine de la médecine chimérique, au point de pouvoir être considérée comme médecin-guérisseur. Elle était profondément superstitieuse et méfiante et savait quelques contes. Pour gagner sa confiance et lui faire réciter ce qui nous intéressait, nous dûmes faire de grands efforts. Nous fûmes obligés de nous recommander d’un de nos parents, ami intime de son mari. Elle se fit payer le temps de travail qu’elle perdait en nous recevant. Nous lui donnâmes une peseta par conte. Elle nous en conta cinq, parmi lesquels La Maria-Roseta, qui, à lui seul, valait bien notre argent ! Les autres n’avaient aucune valeur.
Par méfiance et de peur qu’on ne se servît de son nom pour quelque sortilège, elle se refusa résolument à nous dire comment elle s’appelait. Son mari nous le dit, mais en cachette, afin de s’éviter une dispute.
Joan AMADES, Contes catalans,
Éditions Érasme, 1957.
Traduit par Soledad Estorach
et Michel Lequenne.
Dessins de José Bartoli.
Commentaires de Walter Anderson
et Joan Amades.