Sainte Colette
QUI, DE NAINE, DEVINT GRANDE ABBESSE
par
Marie-Thérèse LATZARUS
À COLETTE DUFLOT
CE LIVRE DANS LEQUEL
SES DEUX PETITS ENFANTS
APPRENDRONT À LIRE.
M.-T. L.
I
LA PETITE FILLE DE CORBIE
Le roi Charles V venait de mourir, après un règne de seize années, pendant lesquelles le peuple, bien qu’accablé d’impôts, avait joui d’une certaine prospérité. Même l’aspect extérieur de la France avait changé, depuis Jean le Bon. Aux demeures massives du douzième et du treizième siècle avaient succédé des maisons ornées de porches, sous lesquels les passants trouvaient un abri contre les intempéries. Les façades s’agrémentaient de tourelles ; les fenêtres carrées, séparées par des meneaux de pierre, s’ouvraient sous des arcades ogivales. Au-dessus des rez-de-chaussée de pierre, s’élevaient des poutres verticales et horizontales, dont les interstices étaient remplis de mortier. Les rues encore malpropres tendaient à s’élargir : des litières, des chariots, des chars à quatre roues y circulaient sans cesse.
L’intérieur des maisons s’enrichissait également : les bourgeois les décoraient de tapisseries, de cuir doré, de miroirs de cuivre étamé, de bahuts sculptés. Même les humbles jouissaient d’un certain bien-être. Les lits à quenouilles se couvraient de « couettes » de plumes et de couvertures de laine de toutes couleurs. Dans la grande salle, il y avait des coffres, des escabelles, de la vaisselle d’étain. Le pain remplissait la huche et le vin, le cellier. Les fêtes de famille et les célébrations religieuses étaient le signal de réunions joyeuses, au cours desquelles le robuste appétit de nos ancêtres se donnait libre cours. En ce Moyen Âge si décrié, le règne de Charles V est une halte durant laquelle le peuple de France reprend des forces pour affronter les dures épreuves des temps qui vont suivre.
Ce qui suivra – hélas ! – ce sont les luttes fratricides des Armagnacs et des Bourguignons, la folie du roi, la trahison de la reine Isabeau de Bavière et les Anglais maîtres en France. Et, pendant ce temps disent les chroniqueurs « l’herbe poussait dans les rues, les loups entraient la nuit dans les villes et les enfants mouraient de froid dans les bras de leurs mères ».
Cette anticipation est faite pour aider à bien situer les faits dont nous allons nous entretenir, mais au temps où commence ce récit, nous ne sommes encore qu’au lendemain de la mort de Charles V. Il y avait trois mois que le cercueil du roi, recouvert d’un drap fleurdelysé, avait été placé dans le caveau de Saint-Denis, quand le 13 janvier 1381, naquit la petite fille dont nous allons conter l’histoire. Toujours sage dans ses desseins, il semble que la Providence, en privant la France de ce lys royal ait voulu lui laisser, en gage de prédilection, une de nos fleurs des champs, modeste et sans éclat, mais qui répandra sur ce quatorzième siècle finissant le parfum de ses rares vertus.
Pour bien comprendre dans quelles conditions va grandir notre sainte, il faut remonter de plusieurs siècles en arrière. Ceux de nos lecteurs qui font déjà de l’Histoire de France goûteront ces précisions.
En 657, la régence du royaume de France était exercée par la reine Bathilde, jeune princesse d’origine anglo-saxonne qui avait été servante du maire du palais Erchinoald. Clovis II, l’époux de Bathilde était, dit le moine de Saint Denis, « un fornicateur, un glouton et un ivrogne ». La sévérité de l’historien s’explique du fait que le roi, en ces temps où les reliques étaient l’objet d’un culte solennel, avait commis une faute inexpiable. Il avait, en effet, enlevé au corps de Saint Denis, patron de l’Abbaye, un bras qu’il avait emporté pour s’assurer la protection du martyr. Curieuse façon d’honorer les saints !
Après la mort du roi coupable de ce sacrilège, sa veuve, exerçant la régence au nom de son fils, le futur Clotaire II, alors âgé de cinq ans, multiplia les bonnes œuvres. Elle était aidée et conseillée par Saint Éloi. Or, en 657, un fief militaire des environs de Corbie étant revenu à la couronne, la reine Bathilde appela des religieux de Saint Colomban, pour défricher les terres incultes. Ce territoire devint l’abbaye de Corbie qui ne tarda pas à embrasser la règle de Saint Benoît.

On a dit, par erreur, que la petite cité picarde appartenait au duc de Bourgogne. Ce n’est qu’en 1435 que, par le traité d’Arras, la ville passa pour quelque temps, avec les autres villes de la Somme, sous la suzeraineté du duc de Bourgogne. Le 13 janvier 1381, quand naquit la petite Colette, Corbie était donc française.
La jolie petite bourgade, bâtie sur les bords de la Somme doit-elle son nom au filet d’eau qui se jette dans le fleuve, ou au seigneur de Corbon qui commandait le château-fort dominant la ville ? Plus simplement, son nom lui vient-il des corbeaux qui, en certaines saisons, s’abattent en masse sur ses champs et ses prairies ? Aussi bien, les armes de la ville ne portent-elles point trois corbeaux ? Quoi qu’il en soit, au déclin de ce quatorzième siècle, le gouverneur de la ville était le prieur des bénédictins et, blottie tout près du monastère, s’élevait la modeste maison du maître-charpentier de l’abbaye, Robert Boëllet.
Celui-ci et sa femme, née Marguerite Moyon, menaient une vie tout occupée par le travail et la prière. Ils jouissaient de la paix des enfants de Dieu, mais le Ciel leur refusait la faveur que, depuis leur mariage, ils n’avaient jamais cessé de solliciter. Tout comme Élisabeth, la pieuse épouse de Zacharie, Marguerite se sentait vieillir : elle avait soixante ans et aucun enfant ne grandissait à son foyer. Pleine de confiance et de foi, cette ardente chrétienne ne désespérait pas de la bonté de Dieu. Elle finit par s’adresser à Saint Nicolas, le protecteur des enfants et ses prières furent entendues. Le 13 janvier 1381 elle mit au monde une blonde petite fille qu’en hommage à Saint Nicolas, on appela Colette, petite Nicole 1. Les yeux bleus de l’enfant étaient à peine ouverts que l’on dirigea son regard vers la statue de l’Enfant-Dieu qui ornait la grande salle et les premiers mots que prononcèrent ses lèvres balbutiantes furent les noms de Jésus et de Marie. Dès l’âge de quatre ans elle avait déjà, de son Créateur, une idée très haute, déposée surnaturellement dans son cœur d’enfant. C’était le Saint-Esprit qui, selon le mot de l’un de ses biographes, le Père Sylvère, « régentait en une créature si tendrelette ».
Vous la représentez-vous, cette petite fille vêtue, à la mode de son temps, du surcot qui depuis peu avait remplacé le bliaud ? Un gilet gris, fendu depuis les aisselles jusqu’au bas des hanches, repose sur une jupe ample, mi-partie bleue, mi-partie grise. Ses tresses blondes forment, de chaque côté de son visage, ce que l’on appelait alors la coiffure « à templettes ». Pour aller à l’église ou se rendre à Amiens, qui est à quatre kilomètres de Corbie, on couvre sa tête d’un bonnet de linge plissé et empesé. Elle ne porte pas ce chapel d’orfèvrerie 2 qui fait ressembler les dames de la ville à de précieuses statues, mais, lors des processions, elle pose sur sa tête un chapel de fleurs qu’elle choisit blanches, de préférence et qui accentue encore la grâce de son fin visage. Dans la cathédrale d’Amiens, elle demeure longtemps agenouillée devant le reliquaire qui contient le crâne de Saint Jean-Baptiste, que les seigneurs picards ont rapporté des croisades. Son recueillement est si profond qu’elle ne voit pas s’agiter autour d’elle les riches seigneurs et les dames parées venus faire leurs dévotions.
Sur les chemins seulement, elle les remarque, et parce qu’elle est du pays qui donnera naissance à la verve malicieuse de Gresset 3 et sur le sol duquel fleurira le fabliau, elle rit un peu des promeneurs dont les souliers à la poulaine se relèvent en une longue pointe retenue par une chaînette et des échafaudages de coiffures élevées, qu’à l’exemple d’Agnès Sorel, ont adoptées les daines. Plus tard, quand elle sera grande et songera au cloître, elle couvrira sa tête d’un fichu de fin tissu qui formera bandeau sous le menton, elle y ajoutera la touaille cette pièce de toile qui passe devant le menton et se fixe au col et, ainsi, elle portera la guimpe qu’adoptent également les religieuses et les veuves.
Pour le moment, elle n’est encore qu’une petite fille qui, chaussée de souliers découverts retenus par une patte fixée à l’aide d’un bouton, gambade sur les bords de la Somme, avec les fillettes de son âge. Elle ne compte parmi celles-ci que des amies. Elle les suit dans leurs courses sur les pentes douces que recouvre une herbe rare et jaune. Comme elles, elle se cache derrière les buissons épineux, mais aussi, la main dans celle de son père, elle va parfois voir partir les bateaux qui portent au loin des chargements de waide, cette plante tinctoriale dont la couleur bleue est si recherchée.
Mais, à tous ces plaisirs, elle préfère la prière. Depuis l’âge de sept ans, elle fait chaque jour au moins une heure d’oraison et souvent, quand ses petites amies viennent la chercher, elles ne la trouvent pas : u Où est Colette, Madame Boëllet ? » demandent-elles et la mère, en souriant, répond : « Elle était là, il n’y a qu’un instant, cherchez-la dans la maison, marmousettes. »
– « On peut monter, à l’étage, dame Marguerite ? »
– « Mais oui, Mahaut et toi aussi Aëlis, montez donc. »

Des cris d’oiseaux, des piétinements dans l’escalier : « Colette, Colette ! nous te venons chercher. Où te caches-tu, méchante ? »
Du haut en bas de la maison et jusques au grenier, dont les fenêtres donnent sur l’abbaye et d’où l’on voit remuer les loches, les appels se heurtent au silence. Devant la porte de la chambre de Colette les petites filles hésitent un instant, frappent doucement, puis plus fort et n’obtenant pas de réponse, ouvrent la porte toute grande. C’est une belle journée de printemps : par la fenêtre ouverte, l’on voit le soleil dorer au loin la rivière, entre les peupliers. Sur les toits de l’abbaye, les pigeons se poursuivent avec des cris rauques. Les cloches sonnent les vêpres... Mais dans la petite chambre au lit drapé de blanc, entre les murs ornés de pieuses images, point de Colette. « Où peut-elle être, Madame Boëllet ? » – « À l’église, sans doute », répond la mère sans s’étonner. Toutes déçues, après un dernier effort, les fillettes s’égaillent sur la route et l’on entend pendant quelque temps, leurs rires et leurs chants. Quand le silence s’est fait et que les pigeons effarouchés ont regagné leurs places sous les solives, Madame Boëllet, un peu étonnée quand même, gravit l’escalier et ouvrant la porte de la petite chambre appelle : « Colette ? » – « Sont-elles parties ? » demande une voix étouffée et, à la grande surprise de sa mère, la petite fille sort à quatre pattes de sous son lit, dont la longue courtepointe la dissimulait.
– Colette, mon enfant, tu te cachais, pourquoi ?
– Ne comprenez-vous pas, ma mère que c’est temps perdu que d’aller courir les routes au lieu de prier et méditer en sa chambre ?
– Il y a temps pour tout, ma fille et tu aurais pu sortir une heure avec tes amies et prier ensuite.
– Je n’ai plus le goût à prier, quand j’ai batifolé avec mes amies. Je les aime et point n’ai voulu leur faire de peine, mais je me dois au service de Dieu, pardonnez-moi ma mère.
Cependant Colette croissait en grâce et vertu et déjà, autour d’elle, on murmurait qu’elle était l’élue de Dieu. Un miracle que Dieu permit confirma dans cette opinion la plupart des habitants de Corbie :
Si parfaite qu’elle fût, l’enfant, avec l’étourderie de son âge, s’exposait parfois à des dangers dont l’évidence fait dire à la foule « il y a un Bon Dieu pour les enfants », et aux philosophes que le « petit d’homme » survit seulement par une succession de miracles. Un jour, en effet, Colette se saisit malencontreusement de la cognée de son père. Elle était haute et lourde, alors que la petite fille était frêle et menue. Le redoutable outil lui échappa, vint buter contre le genou fragile et le trancha si profondément que la jambe ne tenait plus à la cuisse que par un filament de chair sanguinolente. Il ne semble pas que Colette en fut effrayée. Elle vivait tellement dans l’intimité divine qu’elle ne douta pas du secours qui allait lui être accordé. Détachant donc de son cou le fichu de lingerie qui l’enserrait, et sans se soucier du sang qui coulait, elle entoura sa jambe de ce bandage improvisé et aussitôt, elle-put marcher. Au bout de quelques instants, elle enleva le pansement et trouva la plaie complètement guérie.
Ce fut le premier contact de l’enfant avec le miracle, un miracle qui ne l’étonna pas, car rien n’est impossible à Dieu.
Cependant, un grand souci occupait l’esprit des parents de Colette. Ravis de la sagesse et de la piété de la fillette, ils lui taisaient soigneusement les craintes que leur inspirait son avenir. En effet, l’intelligence déjà mûre de l’enfant, son caractère déjà formé s’abritaient dans un corps minuscule, et le contraste était grand entre les paroles sages qui s’échappaient des lèvres de Colette et les dimensions réduites de son corps fluet. Quand, zézayant encore un peu, ce grand bébé se mettait à chanter les louanges de Dieu, l’on se sentait ému et un peu inquiet comme devant tout ce qui nous dépasse.
Mais, en admirant les sages paroles de Colette, les voisins et les amis gémissaient entre eux : « Cette petite fille ne grandit pas ; elle est avancée pour son âge, mais elle a, à neuf ans, la taille d’un bébé. Quel dommage ! et Dieu n’a-t-il donné cette enfant aux Boëllet que pour la leur retirer bientôt ou la laisser vivre infirme ? »
J’imagine que les parents et amis s’amusaient à mesurer la taille de l’enfant en l’appliquant contre le mur et qu’ils se désolaient de ne jamais voir la marque tracée au-dessus de sa tête dépasser la marque précédente.
– « Point ne grandis donc, Colette ? » Mutine, la fillette répondait en se haussant sur la pointe des pieds : « Grandirais bien si l’on me mettait hauts talons. » Mais, un jour, à la réflexion d’une voisine comparant la taille de l’enfant à celle de sa propre fille, de deux ans plus jeune, Colette vit le front de son père se rembrunir, tandis que des larmes perlaient aux yeux de sa mère. Alors elle comprit : cette petite taille, dont elle ne se souciait pas, affligeait les siens et son cœur aimant s’en inquiéta. Son premier biographe, Pierre de Vaux lui prête cette prière : « Hélas : Sire Dieu, vous plaît-il que je demeure ainsi petite ? » Et, pleine de foi, elle entreprend le pèlerinage à Notre-Dame de Brebières, en la bourgade d’Ancre (aujourd’hui Albert).
Elle se prosterne au pied de la statue et supplie la Consolatrice des Affligés d’accueillir sa plainte : « De ma taille, point ne me soucie, mais ceux que j’aime s’en affligent. Mère de Miséricorde, obtenez de votre divin Fils que je devienne grande comme il convient à mon âge. »

Notre-Dame dut jeter un regard de compassion sur cette toute petite qui l’implorait. Pourquoi Celui qui fait croître les lis des champs et transforme en oiseaux les frêles oisillons, ne ferait-il pas croître une enfant si grande en vertu ? L’oraison terminée, Colette eut soudain l’impression que ses membres s’allongeaient et que tout son petit corps tendait à s’élever. Elle se sentait souple et légère comme si le nœud qui retenait ses muscles captifs se détachait. Une fierté nouvelle l’envahissait : elle n’était plus condamnée à vivre près du sol, des forces neuves la soulevaient. Comme le dit encore le Père de Vaux, « elle trouva qu’elle était accrue et qu’elle était plus grande au retourner qu’elle n’avait été à l’aller ». La croissance miraculeusement commencée se continua au cours des ans, puisqu’il semble, d’après la robe et le manteau qui nous sont restés de l’Abbesse, que la sainte atteignait la taille de un mètre soixante-cinq centimètres.
Plus les grâces célestes favorisaient l’enfant, plus elle se sentait attirée vers Dieu. L’abbaye fondée par Sainte Bathilde n’abritait plus alors ces centaines de religieux divisés en plusieurs chœurs qui, en se relayant, chantaient les psaumes jour et nuit. Pourtant l’office canonial, célébré avec la gravité bénédictine, occupait une grande partie du jour et de la nuit. Ces offices nocturnes exerçaient sur la fillette un tel attrait qu’elle obtenait souvent de ses parents l’autorisation de s’y rendre en compagnie de pieux voisins qu’édifiait sa ferveur.
Mais au quatorzième siècle comme dans tous les temps, il se trouvait des gens pleins de sollicitude pour la santé des enfants. Ils estimaient que le plaisir n’était pas fatigant, que les excès du jeu et de la gourmandise n’étaient pas dangereux, mais que les parents étaient coupables d’autoriser des excès de prière. Blâmés par tous ceux qui dormaient tandis que les moines priaient, Robert Boëllet fut contrarié de ces critiques et intima l’ordre à sa fille de ne pas quitter le soir la maison paternelle. Pour être sûr d’être obéi, il fit coucher la petite fille dans une chambre dont elle ne pouvait sortir qu’en traversant la chambre de ses parents. Colette fut désolée : ces veillées au pied de l’autel comblaient de joie sa ferveur. Elle considérait que puisque les moines restaient debout pour chanter les louanges divines, elle pouvait, elle qui aimait tant le Bon Dieu, s’associer à leurs prières.
Le travail du jour n’épuisait pas ses forces toutes neuves ; pourquoi ne sacrifierait-elle pas quelques heures de sommeil pour se consacrer à l’adoration et à la prière ? Cependant, formée toute jeune à l’obéissance, elle se coucha docilement comme l’avait ordonné son père, mais elle ne put trouver le sommeil. Sans trêve, il lui semblait entendre le doux reproche du Maître à ses apôtres : « Vous n’avez pu veiller une heure avec moi ? »
Après une nuit d’insomnie, la petite Colette se sentit plus lasse que, lorsque, ayant prié avec les moines, elle s’endormait d’un sommeil sans rêves. La perspective des nuits douloureuses qui l’éprouveraient désormais, lui fut si pénible que, n’y tenant plus, la petite fille alla confier ses peines à un voisin, Adam Mannier, vieil homme simple, très avancé dans l’intelligence des choses divines. Un jour, l’enfant lui avait demandé de lui procurer de petites cordes, pour s’en faire un cilice. Frappé d’admiration devant ce désir de mortification éprouvé par une enfant si jeune, Adam Mannier l’avait maintes fois accompagnée aux offices nocturnes. Lorsque, tout en larmes, elle vint lui faire part de la résolution de son père, le brave homme fit parler Colette et se sentit certain qu’un tel amour de Dieu était un signe de prédestination.
« Ma mie, lui dit-il, Robert Boëllet ne te défendrait point l’assistance à l’office de nones, s’il voyait comme moi que tu suis l’ordre du Saint-Esprit. Prends cette corde ; ce soir, fixe-la à ta ceinture et ouvre ta fenêtre. Dieu fera le reste. »
Folle de joie, lorsque la cloche appela les moines à l’office, Colette dit bonsoir à ses parents et, retirée dans sa chambre, attacha la corde à sa ceinture. « Enjambe la fenêtre, lance-moi la corde et saute dans mes bras » ordonna la voix étouffée d’Adam Mannier et, quelques instants après l’enfant atterrissait sur les épaules robustes du brave homme, qui ne la libéra que sur le seuil de la chapelle.
Enfin parvenue au port, vers lequel depuis deux jours tendaient tous ses espoirs, Colette se prosterna et les assistants eurent l’impression que les anges de Dieu étendaient leurs ailes autour d’elle et l’isolaient du monde extérieur. Cependant, ayant entendu du bruit dans la chambre voisine de la sienne, Robert Boëllet ouvrit la porte de communication et s’aperçut que sa fille avait disparu. Où pouvait-elle être ? Le père ne douta pas qu’elle ne fût à l’église. Il s’y rendit sur l’heure et, invisible, il aperçut l’enfant prosternée. Comme les assistants, il lui sembla que le coin obscur où elle se blottissait éclatait de lumière. Le sombre pilier qui la cachait à-demi semblait pailleté d’étoiles. De la voûte paraissait pleuvoir sur la tête blonde une gerbe de rayons.
Robert Boëllet lui aussi, pria. Sa voix mâle s’associa aux chœurs et quand la voix grêle de Colette se mêla aux lentes psalmodies, on eût dit qu’aux cantiques des Saints s’associaient les hymnes des Anges.
Quand les orgues se turent, Colette s’apprêtait à mettre sa main dans celle d’Adam Mannier, mais ce fut son père qui, sans un reproche, la ramena dans la demeure où Dame Marguerite attendait en pleurant.
L’enfant remontée dans sa chambre, Robert Boëllet se tourna vers Adam Mannier qui ne les avait pas quittés. « Voisin, dit-il, vous vîtes céans plus clair que moi dans l’âme de ma petite fille : la main de Dieu est sur elle : vous le saviez, alors que je l’ignorais encore... » – « Mais objecta Dame Marguerite, vous auriez pu, cependant, lui faire observer qu’elle avait désobéi. »
Gravement, le père secoua la tête : « Non, dit-il, car j’ai présente à l’esprit la réponse de l’Enfant-Jésus au milieu des docteurs : “Ne faut-il pas que je m’occupe des affaires de mon Père ?” Notre petite fille a des colloques avec Dieu, desquels nous sommes exclus. Désormais, ni jour ni nuit, je ne lui interdirai l’accès de l’église et dès demain, je la réinstallerai dans son ancienne chambre où je lui aménagerai un petit oratoire. »
Ainsi fut fait et Colette, désormais libre de se livrer à tous les exercices que sa piété lui dictait, ne cessa de croître, comme le Fils de Dieu Lui-même, « en grâce et en sagesse ».
En ces temps lointains, les petits enfants n’étaient pas admis à la Table Sainte. Assistant à la messe auprès de sa mère, Colette brûlait d’envie de communier avec elle et, ne pouvant réaliser ce rêve, elle demeurait du moins, toute la journée dans le sillage maternel, comme si elle eût pu jouir un peu de la Présence divine. Enfin, le temps vint où elle fut jugée digne – ou plutôt capable – de recevoir en toute connaissance Notre-Seigneur. Dès lors, ses progrès dans la vie surnaturelle furent de plus en plus rapides. Une nouvelle façon de servir Dieu lui fut révélée. Elle comprit, malgré son jeune âge, que toute vertu reste stérile, si elle n’est fécondée par l’amour. Ses parents l’avaient habituée à faire l’aumône. Dès qu’elle fut en âge d’agir par elle-même, elle fit plus encore. Elle se priva, pour les donner aux pauvres, de toutes les friandises qu’aiment les enfants et, dès qu’elle en eut la force, elle se rendit au chevet des vieillards et des malades pour leur rendre ces menus services qui font moins amère la solitude. Un jour, sa mère, rentrant à la maison après une course, trouva sa fille agenouillée auprès d’une pauvre femme dont elle lavait les plaies avec adresse et douceur.

– Je ne voulais pas, dit la pauvresse en remarquant la surprise de la mère. La gentille damoiselle m’a introduite de force dans votre demeure. Mais, maintenant, je m’en irai promptement.
Elle faisait mine de se lever : « Restez, bonne dame, restez – dit Colette, en levant sur sa mère le regard limpide de ses yeux bleus – c’est Jésus-Christ Lui-même que je soigne en vous soignant, n’est-il pas vrai, ma mère ? »
Émue jusqu’aux larmes, la mère répondit : « Continue, mon enfant » et elle-même chercha dans ses armoires du linge blanc et un manteau chaud pour couvrir les haillons de la pauvresse. Quand, réconfortée par un bouillon, celle-ci se fut éloignée, la mère dit à sa fille : « Change de vêtements et lave tes mains et ton visage ; c’est une lépreuse que tu viens de soigner. »
– Je le savais, répliqua doucement l’enfant, mais ma mère, vous vous souvenez de ce que disait le bon roi Louis IX ? « Qu’importe que je contracte la lèpre, si mon âme n’est souillée d’aucun péché mortel ? »
– C’est une enfant de prédilection qui grandit à notre foyer, disait le soir Dame Boëllet à son mari Je n’ose plus rien lui défendre, car, ce faisant, il me semblerait me révolter contre Dieu qui l’inspire.
– Ainsi, vous faites bien, ma mie, répondit le père. Notre nom ne périra pas, j’en ai la conviction, car cette petite Colette fera tant pour la gloire de Dieu que les siècles la vénéreront à l’égal des plus grands. Bénissons le Seigneur, car l’enfant du miracle deviendra l’enfant du salut.
II
LA RECLUSE
Colette Boëllet était venue, telle un présent du Ciel, réjouir la vieillesse de ses parents. Tandis qu’elle grandissait et devenait une belle jeune fille, son père et sa mère au contraire, allaient sur leur déclin. Marguerite Boëllet mourut la première : Colette n’était encore qu’une adolescente. Elle ressentit vivement le déchirement de la séparation. Dieu qui, dès son plus jeune âge, l’avait instruite des vérités de la foi, lui avait donné aussi un cœur tendre qui se brisa lorsqu’elle fut privée des soins maternels.
Malgré sa piété, la jeune fille eut peine à se résigner à ne plus entendre la voix de sa mère, à ne plus voir son sourire, à ne plus être serrée dans ses bras. Son père lui restait, mais l’affection d’un homme ne se manifeste pas avec la même tendresse et, prosternée dans son oratoire, la tête dans ses mains, Colette, bien des fois, laissa couler ses larmes, en murmurant le nom de l’absente.
Elle était loin d’être remise de ce premier chagrin, lorsqu’à Noël 1399, à l’aube de ses dix-neuf ans, la pieuse jeune fille perdit aussi son père. Le vénérable vieillard sentant la fin proche, s’inquiéta du sort de l’enfant qu’il allait laisser sans secours humain.
L’abbaye de Corbie était gouvernée depuis huit ans par Dom Raoul de Raye qui appartenait à une famille illustre et qui, loin d’être hautain, comme le prétendent certains historiens, traitait avec une paternelle bonté l’humble artisan qu’était Robert Boëllet.
Le sachant malade, il vint le visiter et le père de Colette rendit grâces de l’honneur qui lui était fait et joignit les mains comme pour une prière.
– Calmez-vous, mon ami, dit l’Abbé en traçant sur le front du mourant le signe du salut, et dites-moi ce qui vous contriste. Vous fûtes bon et loyal serviteur de Dieu et des hommes. S’il plaît à notre Sire de vous retirer de ce monde, c’est pour vous accueillir en sa sainte garde. Soyez sans crainte et dites-moi ce qui vous chagrine.
– Messire, dit le charpentier, dont la voix était à peine perceptible, point ne me soucie de quitter la terre pour aller rejoindre ma sainte femme. Mais, je laisse en ce monde de perdition ma mie Colette, une fleur de Paradis qui est encore bien tendrelette pour rester seule exposée aux pièges des démons.

Ce disant, Robert Boëllet réunit ses dernières forces pour supplier : « Messire, soyez le gardien et le tuteur de Colette. Si votre bonté m’accorde cette grâce, je mourrai sans regret. »
Profondément ému, le Père Abbé acquiesça au désir du brave homme qui, quelques instants après, s’endormit dans le Seigneur.
– Ma fille, dit Raoul de Roye, en bénissant la jeune fille, désormais, je suis votre Père, remettez-vous à moi du soin de votre avenir.
Malheureusement, bien qu’il eût renoncé pour lui-même à tout bonheur humain, le Père Abbé, quand il songeait à la belle jeune fille qui lui avait été confiée, se disait qu’il importait de lui donner, au plus tôt, une famille à aimer. Elle avait été une fille incomparable, elle serait une mère parfaite. Estimée comme elle l’était à Corbie, il lui serait facile de trouver un compagnon de vie.
Déjà, dans les meilleures familles de la ville, des jeunes gens aspiraient à sa main. Le bon Abbé écarta les uns, examina le cas des autres et son choix tomba sur un jeune homme pourvu des plus hautes qualités.
– Colette, dit le religieux, je crois avoir trouvé le parti qui vous convient. Mettez votre main dans celle de cet honnête homme Fondez une famille et ainsi vous accomplirez votre devoir de chrétienne.
– Et si mon devoir m’apparaissait à moi tout autre ? s’écria Colette, avec un peu de sa pétulance de naguère. Messire Abbé, je ne saurais vivre autrement qu’attachée uniquement au service de Dieu. J’ai, depuis plusieurs années déjà, pour confesseur et directeur de conscience, le Père Bassand qui vint à Amiens pour fonder le monastère des Célestins. Sur son conseil, je me suis enrôlée déjà dans les Vierges du Seigneur. De grâce, mon tuteur et Messire Abbé, autorisez-moi à me consacrer à Dieu.
– Ma fille, observa le religieux, avez-vous bien réfléchi ? Les chagrins, parfois, obscurcissent la raison et font croire aux âmes de bonne volonté qu’elles sont appelées au service de Dieu.
Les mains jointes, les yeux perdus comme dans une contemplation surnaturelle, Colette répondit doucement :
– Vous êtes, Messire, mon maître et mon tuteur. Autorisez-moi à donner tous mes biens aux pauvres et dépouillée de tout, comme Notre-Seigneur le conseillait au jeune homme de l’Évangile, je quitterai tout pour suivre le Seigneur.
En ce monde où la question d’argent tient si souvent dans les âmes la première place, il n’est peut-être pas de preuve plus convaincante de la sincérité d’une vocation, que celle que donnait Colette. On ne peut servir Dieu et l’argent. Elle abandonnait tout pour se consacrer à Dieu et, les mains vides, elle se tenait devant l’Abbé pour attendre sa décision.
Ému, troublé, le religieux sentait la lumière du Saint-Esprit l’envahir. Telle qu’elle était là, pauvre et dépouillée, Colette lui apparaissait comme l’une de ces âmes qui, parce que le Crucifié a laissé au monde son divin Message ont, depuis des siècles, tout quitté pour Le suivre. Cette enfant prédestinée, dont il était le guide humain, elle avait trouvé ailleurs le guide surnaturel qui l’entraînerait sur les hautes cimes.
– Que Dieu vous bénisse, mon enfant, dit-il et qu’il en soit fait comme vous le désirez. Soyez la servante du Seigneur et priez pour moi.
Ivre de joie, Colette se hâta d’informer le Père Bassand qu’elle était libre, dépouillée de ses biens et qu’il importait de lui trouver au plus tôt une communauté où elle se retirerait du monde. Ne voulant pas agir inconsidérément, Colette, d’abord, se retire au Béguinage, Là, dans de petites maisons, vivent des femmes qui ont quitté l’agitation du monde. Leurs demeures s’abritent dans un vaste enclos que l’on ne peut quitter sans l’autorisation de sa Supérieure. À Corbie la rue de la Boulangerie, près du Pont-Neuf, abritait un Béguinage. C’est là que la jeune fille se rendit, pour se préserver des dangers extérieurs et mener une vie plus parfaite.

Mais elle a beau fréquenter les églises, assister chaque jour à plusieurs messes et passer des heures en oraison. Elle a beau coucher sur la dure terre et multiplier les austérités : son âme ne trouve pas le repos. Sa ville natale, plus tard lui reprochera d’avoir l’esprit changeant, parce qu’elle adopte tour à tour des modes de vie différents. Son but demeure le même : elle veut mener la vie la plus parfaite possible, mais le moyen qu’elle a choisi ne la satisfait pas. Elle veut être plus mortifiée et plus fervente pour être plus près de Dieu.
Colette quitte donc le Béguinage pour un couvent de Bénédictines. Elle allait prononcer ses vœux, lorsqu’en passant devant un autel consacré à saint François d’Assise, elle vit nettement l’image du saint s’animer et lui faire signe de quitter le couvent. Or, depuis l’âge de huit ans, si merveilleux que cela paraisse Colette avait, de tout ce qui regardait l’ordre de saint François, une connaissance surnaturelle. Le commandement donné par l’image du saint lui parut providentiel et, aussitôt, elle se rendit au monastère de Pont Saint-Maxence, où, dans son humilité elle se proposa pour être la servante des pauvres Clarisses. Les religieux et les religieuses fondés par saint François et sainte Claire, avaient suivi, au début, des règles très sévères. Depuis La mort du fondateur, des adoucissements avaient été apportés à la règle dans la plupart des monastères et Colette, qui avait soif de mortifications, fut profondément déçue quand elle s’aperçut qu’auprès des Clarisses, elle ne mènerait pas la vie dure qu’elle avait choisie.

Le Père Bassand était parti pour l’Italie. Colette ne trouva aucun prêtre qui pût la conseiller utilement. Son besoin de perfection paraissait exagéré. Ce fut la période de sa vie où la future sainte subit le plus d’épreuves. Il lui semblait que Dieu s’éloignait et, à certaines heures, elle se sentait glisser vers le découragement. Mais c’est au moment où Colette se débattait dans les ténèbres que vint la lumière.
Le couvent franciscain d’Hesdin (Pas-de-Calais) avait, lui aussi profité des dispenses et des adoucissements à la règle de saint François. Le Révérend Père Pinet qui, au moment des épreuves de Colette, avait été nommé gardien de ce monastère fut, comme elle, affligé de voir combien la règle primitive avait dégénéré. Ne pouvant, de sa propre autorité, supprimer les dispenses dont jouissaient ses frères, le Révérend Père Pinet, du moins, pratiquait personnellement la règle dans toute sa rigueur. Mis au courant par Colette de ses difficultés, il découvrit en elle une vraie fille de Saint François, l’encouragea, la réconforta et lui indiqua des prières spéciales afin d’obtenir la manifestation de la volonté divine. Ayant demandé au Saint-Esprit de l’éclairer il se sentit persuadé qu’il n’y avait aucun couvent qui pouvait convenir à Colette, car elle trouverait toujours la règle trop douce. Mais, la règle franciscaine existait encore dans toute sa pureté. Si Colette avait le courage de se retirer du monde et de s’imposer seule les obligations des vrais franciscains, elle pourrait satisfaire son esprit de sacrifice.
Or, au Moyen Âge, l’on voyait parfois de pieuses femmes désireuses d’expier leurs fautes ou celles des leurs, se retirer dans une cellule sans porte et vivre dans le silence et la prière. Dans Notre-Dame de Paris, Victor Hugo décrit ainsi la prison dans laquelle s’enfermait une recluse (c’est ainsi qu’on les nommait) : « un cabanon muré et grillé au fond duquel priait, jour et nuit, un être humain volontairement dévoué à quelque lamentation éternelle, à quelque grande expiation ».
Colette avait vingt-et-un ans lorsqu’elle adopta cette vie. Son tuteur, l’Abbé de Corbie, lui donna par écrit l’autorisation de faire élever une maison de recluse pour y demeurer sa vie durant et n’en jamais sortir. Il n’avait pas été facile d’obtenir du Père Abbé l’autorisation d’entrer en réclusion. Il s’y refusait formellement. Mais Colette pria tant qu’elle obtint de Dieu le courage de plaider elle-même sa cause. Tremblante et le cœur battant, elle se dirigea vers l’abbaye alors que son tuteur, à l’occasion d’une grande fête, avait réuni à sa table des seigneurs, des grands vassaux et de hauts dignitaires ecclésiastiques. Au milieu de la foule parée, elle se prosterne aux pieds de l’Abbé et le supplie de lui accorder la permission qu’elle sollicite.
– Aidez-moi, vous tous qui m’entendez, vous avez, vous aussi, entendu la parole du Sauveur qui disait : « Donne tout et suis-moi. » Joignez vos prières aux miennes, suppliez Messire l’Abbé de me laisser entrer en réclusion. Dans ma cellule murée, je chanterai les louanges du Seigneur, j’obtiendrai la grâce des pécheurs et je demanderai à Dieu de bénir ma ville natale.
Un certain nombre d’assistants pleuraient : tous étaient émus. « Messire l’Abbé, dit une voix, exaucez la prière de cette gente damoiselle, c’est Dieu qui vous parle par sa bouche. » Avec un soupir, l’Abbé céda et, le lendemain, l’on se mit à édifier le reclusage, dans l’angle formé du côté de l’Épître par l’abside et le transept de l’église Notre-Dame. Guillemette Gameline, veuve du prévôt de Corbie, contribua largement aux frais de l’humble construction et l’Abbé « fit un petit lieu de retraite le plus consolatif qu’il put pour celle qui voulait se renfermer ».
Le reclusage comprenait un oratoire donnant sur l’église par une petite ouverture fermée de barreaux de fer en croix. Cette fenêtre était munie d’une trappe mobile dans des coulisses qui, levée fermait la partie supérieure et ménageait en-dessous une ouverture par laquelle la recluse pouvait recevoir la Sainte Communion. À côté de l’oratoire, une petite pièce servait à la fois de chambre à coucher et de salle à manger. L’un des murs de cette pièce était muni d’une grille de fer qu’un rideau fermait, pour dissimuler la recluse aux yeux des visiteurs. Ces visiteurs étaient introduits dans un petit vestibule toujours ouvert et parlaient à Colette à travers la grille.
Le 17 septembre 1402, jour de la fête des Stigmates de Saint François, eut lieu la cérémonie de l’introduction de la recluse dans son étroite demeure. Le Père Raoul de Roye présidait. Le Père Pinet prêcha. Toute l’abbaye était présente et une foule considérable s’était jointe aux moines. Cette jeune fille de vingt-et-un ans que, quelques années auparavant, l’on avait vu folâtrer sur les bords de la Somme, cette petite fille pieuse qui, prosternée auprès de l’autel, édifiait toute la population, elle eût pu se faire religieuse. Mais se murer vivante, s’introduire dans cette prison dont tout à l’heure, le Père Abbé emporterait la clé pour qu’il n’y eût plus aucun rapport entre Colette et le monde extérieur, cela paraissait aux assistants admirable et un peu cruel.
Cependant, Colette marchait d’un pas ferme vers son nouveau logis. Sa voix vibrante prononça les vœux éternels. Voilée de blanc, elle entra. La porte fut refermée sur elle et l’on apposa sur la serrure imprégnée de cire, le sceau de l’Abbé de Corbie. Les larmes aux yeux, les assistants se retirèrent, laissant la jeune fille à son silence et à sa solitude.
En lisant ceci, bien des petites filles penseront certainement que si elles avaient été à la place de Colette, elles auraient été, alors, bien désolées. Mais ce que voulait la jeune fille, c’était vivre seule avec Dieu. Elle se sentit donc au contraire toute joyeuse. À genoux devant la grille de l’oratoire, les yeux tournés vers l’autel qu’éclairait seule la lueur tremblante de la lampe perpétuelle, Colette se disait qu’elle aussi serait une lampe vivante brûlant devant le Saint-Sacrement.
Dans son reclusage, elle s’imposa des mortifications qui ne cessaient ni jour, ni nuit : elle couchait, en effet, sur des sarments de vigne et sa tête s’appuyait sur une pièce de bois. Elle portait autour de la taille un cercle de fer et, sur sa poitrine, s’entrecroisaient des chaînes qui la meurtrissaient. La recluse se mortifiait, mais aussi elle priait. La plus grande partie de la nuit était employée à la récitation de l’office franciscain et d’autres oraisons. Sa couche était si dure qu’elle n’y restait pas longtemps, aussi de bon matin reprenait-elle ses méditations et ses prières.
Il semble que, pour supporter ces austérités, il eût fallu à la jeune fille une nourriture substantielle. Or, deux amies dévouées : Jacqueline Legrand et Marie Sénéchal qui lui apportaient chaque jour sa ration de la journée, se lamentaient de la voir consommer seulement quelques cuillerées de potage maigre, très peu de légumes et un petit morceau de pain.
Cependant la solitude de Colette n’était pas aussi complète qu’elle l’aurait voulu. En effet, la sachant là en prières, tous les habitants de Corbie qui se trouvaient aux prises avec des difficultés quelconques, venaient lui demander de les aider et de les secourir. Elle était persuadée qu’elle n’avait rien à apprendre aux autres et demandait à son confesseur de prier pour « sa pauvre âme, la plus pauvre de toutes. » Dieu, pourtant l’avait choisie pour être son instrument sur terre et lui révéla dans des visions surnaturelles ce qu’il attendait d’elle.
Elle voyait en songe les divisions de l’Église et les facilités qui, dans les monastères, s’opposaient à la vraie vie religieuse. Et toutes les fois que ces spectacles lui apparaissaient, elle entendait une voix impérieuse lui dire : « C’est toi, Colette, qui dois opérer les réformes nécessaires » – « Quoi ! s’écriait Colette, une simple fille qui ne sait rien, pour une œuvre semblable ! »
Avant sa mort, le Père Pinet avait eu la vision d’une belle jeune fille travaillant péniblement à cultiver une vigne, arrachant les mauvaises herbes, soutenant les jeunes plantes. Et une voix lui disait que cette vigne était la vie religieuse et que cette jeune fille était Colette.
Mais le Père Pinet était mort et la jeune fille n’avait plus personne qui pût apaiser ses craintes, dissiper ses doutes et lui dicter avec autorité la conduite à tenir. Dieu connaissant son embarras, lai envoya pour la convaincre un moyen qui devait réussir, avec une âme comme la sienne, si simple et si candide. Un jour, dans son étroite demeure, la recluse vit apparaître un bel arbre dont le jeune feuillage s’éclairait de fleurs d’or au parfum vivifiant. Autour de l’arbre, de verts arbrisseaux se pressaient, comme des poussins, autour de leur mère. Stupéfaite et trop habituée aux pièges du démon, Colette se méfie de cette floraison spontanée. Elle n’ose s’attaquer à l’arbre principal, mais elle arrache les rejetons et, à grand-peine, les fait passer à travers le grillage. Mais, dans tous les coins, de la cellule, comme s’ils avaient trouvé là leur terre d’élection, les verts arbustes aux fleurs d’or rayonnent de nouveau. Alors, Colette tente un dernier effort, elle oppose à l’entêtement des végétaux, le fervent signe de croix qui, tant de fois, avait fait fuir les fantômes.
Plus verdoyants que jamais et exhalant un parfum plus suave, les arbrisseaux, tels des hôtes familiers, se transportaient d’un bout à l’autre de la cellule et, quand elle priait, se groupaient autour d’elle, en inclinant leurs branches. Et puis, s’éleva la voix qui, si souvent déjà s’était élevée dans le silence. « Cet arbre, Colette, c’est toi, et les arbrisseaux, ce sont les âmes qui viendront s’abriter auprès de toi. »
Or, à l’autre bout de la France, l’un des rares disciples de Saint François qui avait gardé intact l’esprit de l’Ordre, recevait dans le même temps une révélation semblable. Ce saint homme : le Père Henri de la Balme (ou Baume) se dirigeait vers Marseille, dans l’intention d’aller à Jérusalem, se prosterner sur le tombeau du Christ.

En Avignon, il va visiter une autre pieuse recluse, Marion Ameute, aux prières de laquelle il veut recommander son voyage. Or, à sa grande surprise, la voyante inspirée lui déclare que Dieu ne le veut point à Jérusalem, mais, au contraire, l’envoie en Picardie, à Corbie, auprès d’une jeune servante de Dieu, par laquelle de grandes choses devront être opérées pour le salut du monde. Reconnaissant la voix de Dieu, le religieux n’hésita pas et se rendit chez Blanche de Savoie, comtesse de Genève et nièce de Clément VII, à laquelle il conta ce qu’il lui advenait.
Cette princesse, désirant aider le Père Henri dans ces circonstances miraculeuses, l’adressa à l’une de ses amies, Isabeau de Rochechouart, baronne de Brisay qui, dès qu’elle eût entendu le religieux, se mit à sa disposition, elle et ses serviteurs, pour accomplir la mission qu’il avait reçue.
Après un repos de quelques heures, le religieux, la baronne et leur escorte se dirigèrent promptement sur Corbie. Dieu qui voulait la rencontre du religieux et de Colette, avait laissé subsister auprès d’elle les marques du choix qu’il avait fait. Un arbuste miraculeux, chargé de fruits et de fleurs répandait dans l’air de suaves parfums. Presque sans se parler, le Père Henri et Colette s’apercevant à travers le grillage, se reconnurent. L’un et l’autre, dans leur humilité, se demandaient pourquoi ils avaient été choisis pour une mission si haute et, dans une sorte d’extase, la sainte adressa au Ciel une prière dont la ferveur eût suffi, s’il en avait été besoin, à convaincre les nouveau-venus qu’ils étaient en présence d’une vraie servante du Bon Dieu.
Pour comprendre ce que Dieu demandait à Colette, il faut savoir que les couvents de clarisses, naguère fondés par Saint François d’Assise et Sainte Claire, avaient pour règle principale la pauvreté. Les monastères ne devaient rien posséder et les moniales étaient contraintes de vivre de la charité publique. Or, avec la meilleure volonté du monde, de jeunes princesses, en entrant chez les Clarisses, firent fléchir cette règle. Lorsqu’Isabelle de France sœur de Saint Louis fonda le couvent de Longchamp, près Paris, elle y fut suivie par plusieurs jeunes filles de la haute noblesse. Ces jeunes filles avaient vécu dans des palais ou des châteaux, entourées de tout le bien-être que donne la richesse. Elles étaient désireuses de faire des sacrifices pour Dieu, mais ne pouvaient s’habituer tout d’un coup à coucher sur des planches, à ne se nourrir que de pain et d’eau, à marcher pieds-nus hiver comme été. Les Franciscains comprirent que leur santé ne résisterait pas à de telles privations et, pour elles on adoucit la règle. Mais des monastères qui pouvaient se contenter d’aumônes, tant que l’on y vivait pauvrement, durent, pour suffire à de nouvelles dépenses, accepter des revenus importants. Or, la richesse est toujours dangereuse pour les âmes. Les Abbesses deviennent de grandes dames, qui s’habillent richement, voyagent, vont même jusqu’à Rome et, comme le dit Mme Ancelet-Hustache dans son beau livre « les Clarisses » étalent sur leurs robes luxueuses les insignes de leur dignité, devenus de véritables bijoux.
La sainte pauvreté, si agréable à Saint François et à Dieu son Maître, disparaissait du monde et c’était Colette que la Providence avait choisie pour l’y ramener. Mais pour accomplir la volonté divine, il fallait d’abord que la « petite Ancelle » fût relevée du vœu de clôture perpétuelle. Son tuteur, l’Abbé, était peu disposé à donner l’autorisation nécessaire. C’est pourquoi le Père Henri résolut de s’adresser au Souverain Pontife, Benoît XIII par l’intermédiaire de son représentant, le légat Antoine de Chaland, qui résidait à Paris à la cour de France.
Le 23 juillet 1404, ce légat donna pouvoir à l’évêque d’Amiens de dispenser la jeune fille de la clôture perpétuelle. Le vicaire général vint à Corbie s’assurer de la mission reçue de Dieu et Colette qui, quatre ans auparavant, avait dit, en entrant dans son reclusage : « C’est là le lieu de mon repos et j’y habiterai à jamais parce que je l’ai choisi », sortit de cet asile pour accomplir la volonté divine.

III
COLETTE VOYAGE
Pour se rendre compte des difficultés du voyage qu’entreprennent Colette et ses compagnes, afin de rencontrer le légat d’abord, le Souverain Pontife ensuite, il faut imaginer l’état dans lequel se trouvait la France, à l’aube du quinzième siècle. On vous a parlé, en histoire, de la guerre de Cent ans et vous avez peut-être imaginé, au cours des ans, d’interminables batailles. Il n’en est rien : il s’agit, plutôt, d’une époque particulièrement misérable, où la France, au milieu des pires douleurs, comprit qu’elle était une nation.
Le fils aîné d’Édouard Ier, roi d’Angleterre, avait épousé, Isabelle de France, fille de Philippe le Bel. Leur fils, Édouard III, qui voyait dans la France un marché où vendre les laines anglaises, prit prétexte des droits à la couronne de France, qu’il tenait de sa mère. Au début du règne de Philippe VI, en 1346, il débarqua dans la rade de Saint-Vaast la Hougue et, après avoir pillé la Normandie, il arriva aux environs de Paris, où il brûla quelques villages. Et ce fut, avec Philippe de Valois le désastre de Crécy (1346), avec Jean le Bon, le désastre de Poitiers (1356). Le dauphin Charles qui devait devenir Charles V, résista à une nouvelle invasion et fit signer à Édouard III le traité de Brétigny (1360) qui faisait abandonner aux Anglais la Normandie, le Maine, la Touraine et ne leur laissait que le Poitou, la Saintonge, le Limousin et le Périgord. Ce traité, d’ailleurs, les provinces annexées ne l’acceptèrent pas et en 1369, Charles V recommença la guerre. Avec l’aide de du Guesclin, les Anglais furent refoulés et, en 1380, à la mort de Charles V, ils ne possédaient plus en France que Bayonne, Bordeaux, Brest, Cherbourg et Calais.
Malheureusement, le nouveau roi, Charles VI, était un enfant de douze ans. La régence fut assurée par ses oncles qui accablèrent le peuple d’impôts. Tout changea lorsque le fils de Charles V atteignit sa majorité.I1 avait hérité de la sagesse de son père, il compatissait aux maux des petits et, durant les quelques années où il gouverna lui-même, ses sujets reprirent goût à la vie. Mais, lorsque commence le voyage de sainte Colette, depuis douze ans déjà, comme le disent les historiens du temps, notre pays était « frappé au chef » (à la tête). À la suite d’incidents qu’il est difficile de préciser, tant les historiens professent d’avis différents, Charles VI est atteint de folie. A-t-il vraiment rencontré l’homme étrange qui saisit la bride de son cheval, en lui annonçant qu’il a été trahi ? A-t-il reçu un coup sur la tête ? A-t-il été frappé d’insolation ? Qu’importe, puisque le résultat, c’est la démence. Le roi affirme que son blason ne porte pas de fleurs de lys, mais un lion traversé d’une épée. Il dit s’appeler Georges et, parfois, se croyant de verre, il tremble à la pensée qu’il peut « choir et se briser ».
Isabeau de Bavière, cette princesse allemande qui, lors de son mariage, a été reçue par les Parisiens avec un luxe presque excessif en ces temps de misère, Isabeau de Bavière ne se soucie pas du pauvre roi qui traîne son ennui dans le palais royal. Elle n’entend pas les sinistres éclats de rire qui succèdent parfois à des crises de larmes. Laissant à Odette de Champdivers le soin d’apaiser le malheureux insensé, elle court la forêt à cheval, entourée de jeunes seigneurs ou bien elle donne des bals costumés où elle danse jusqu’à l’aube, dans les salons dont les lourdes draperies étouffent le bruit des sanglots.
Parmi les jeunes seigneurs qui entourent la reine, se trouve un brillant cavalier, le duc d’Orléans, frère du roi. Sa grâce et son élégance en font le héros de toutes les fêtes de la cour. Le roi étant incapable de régner, le pouvoir se partage entre le duc d’Orléans et son cousin Jean sans peur, duc de Bourgogne. Les deux princes ne tarderont pas à entamer une lutte fratricide qui se terminera le 23 novembre 1407, par l’assassinat de Louis d’Orléans, victime des partisans du duc de Bourgogne. Ce dernier se vanta, d’ailleurs, d’avoir suscité le crime.
Charles d’Orléans, le fils du duc assassiné, ayant épousé la fille du comte d’Armagnac, ce fut l’origine du nom donné désormais aux adversaires de Bourguignons. Armagnacs et Bourguignons firent tant et si bien que l’Angleterre se décide à reprendre la guerre. Comme le dit fort bien « le Bourgeois de Paris », « le roi d’Angleterre n’eût été tant hardi de mettre le pied en France n’eût été la dissension qui régnait en ce malheureux pays ». Pour notre plus grande honte, le roi Henri V se présenta comme envoyé de Dieu « pour punir les désordres, péchés et mauvais vices qu’on voyait au royaume de France ». Et ne voit-on pas l’empereur d’Allemagne donner à Henri V – l’anglais ! – le titre de roi de France et lui promettre « assistance pour le recouvrement de son royaume » ?
L’armée anglaise arriva par la Normandie et livra aux Armagnacs la terrible bataille d’Azincourt où périt la plus grande partie de la noblesse française. Du Guesclin n’était plus là et c’était le moment de répéter les vers qu’Eustache Deschamps avait écrits pour le pleurer :
« Ô Bretagne, pleure ton espérance,
Normandie, fais son enterrement,
Pleurez, pleurez, fleur de chevalerie. »
Rouen et toute la Normandie étaient entre les mains des Anglais. Jean sans Peur voulut négocier avec le dauphin Charles qui s’était rangé du côté des Armagnacs. Lors de cette entrevue sur le pont de Montereau, le duc de Bourgogne fut assassiné lui aussi et son corps jeté dans la rivière. Pour le venger, son fils Philippe le Bon s’entendit avec Isabeau de Bavière et Henri V pour faire signer au roi fou le plus honteux traité qui eût jamais été signé sur la terre des lys. Reniant son fils, le dauphin, Charles VI faisait du roi d’Angleterre son héritier et lui donnait en mariage sa fille Catherine.
À l’imitation des Armagnacs et des Bourguignons, les villages combattaient entre eux, la France du Midi luttait contre la France du Nord et le voyage entrepris par les serviteurs de Dieu était bien hasardeux. Les champs étaient ravagés par les gens de guerre, les paysans se cachaient, chez eux et les pèlerins traversaient de vastes étendues désertes et silencieuses qu’éveillait parfois le bruit des armes.
Sans la protection de Dieu et de ses anges, Colette et ses compagnons n’eussent pu subsister le long de la route désolée qu’ils suivaient en priant.
La première étape devait les conduire à Paris. En temps de paix de belles routes bien entretenues faisaient une promenade de la traversée de la Picardie. Il en était tout autrement en temps de guerre : les villes cherchent à se défendre plus qu’à se répandre. Aussi ne se soucie-t-on pas d’entretenir les chemins et quand la nécessité des guerres force à détruire les ponts, l’on ne se presse pas de les relever.
Les voyageurs entraient à Paris par le grand-Pont, situé sur le fleuve, un peu plus haut que le Pont-au-Change actuel. L’animation y était d’autant plus grande que les arrivants devaient s’arrêter pour payer le droit de péage (passage). Il y avait là, précisément, un jongleur qui, requis de payer pour le singe qu’il portait sur son épaule, offrit de s’acquitter de sa dette en faisant danser l’animal. Cela fit la joie de l’escorte de Colette qui, elle-même, regardait sans voir et égrenait son rosaire. Il y eut ensuite des compagnons de Sainte-Geneviève qui furent dispensés de la taxe parce que, lors de la fête de la sainte, l’abbaye envoyait au péager du vin et des échaudés. Vint ensuite un troubadour qui, en guise de paiement, débita d’une voix claire son dernier poème :
« Ainsi suis comme l’oiseau franc,
Et comme l’oiseau sur la branche,
Je chante »
Madame de Brisay chargea l’officier de l’escorte de payer les droits et, précédés par un troupeau de moutons que le berger avait grand-peine à faire marcher droit, les voyageurs entrèrent dans Paris. Des infirmes appuyés sur des béquilles tendaient la main, un portefaix, sac au dos, évita de justesse un fauconnier à cheval, un valet de chiens conduisait des lévriers en laisse. Un grand coche transportait cinq personnes assises sur une banquette et le postillon sonnait de la trompe pour faire écarter les piétons. Dans un vacarme infernal défilaient des crocheteurs, des fripiers, des ménétriers et des marchands d’oublies. Derrière une litière un cavalier suivait sa dame.
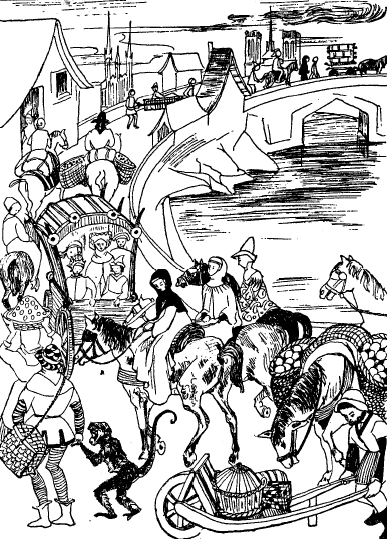
La rive droite était alors le quartier du commerce. Dans la rue Saint-Denis qu’empruntèrent les voyageurs, les boutiques débordaient sur la chaussée, donnant l’impression d’une foire permanente. Et ces marchands ambulants de pousser des clameurs : « J’ai des oies dodues », « j’ai de la chair salée », « j’ai de bonnes échalotes d’Étampes », « qui veut des fromages de Brie, des figues de Malte, des galettes, des échaudés ? » – « Mon Dieu ! s’écria Colette, ne serons-nous pas bientôt hors de ce vacarme et pourquoi prendre tant de souci de la nourriture du corps lorsqu’on en prend si peu de celle de son âme ? »
– Sur la rive gauche, siège de l’Université, hormis les jeux des escholiers, nous serions au calme, repartit le Père Henri, mais le palais du légat est dans la Cité où l’autorité religieuse voisine avec l’autorité laïque. Tenez, ma sœur, nous arrivons : voici Notre-Dame.
Colette leva les yeux et vit l’admirable église, qui, depuis plus d’un siècle élevait sur le ciel de Paris sa prière de pierre. On lui avait parlé souvent du magnifique élan qui avait porté nos ancêtres fraternellement unis, à faire surgir du sol de Lutèce cet ample vaisseau, ces chapiteaux romans supportant l’ogive gothique et ces tours surmontées de monstres de pierre. « Que c’est beau : s’écria Colette et comme la Vierge Marie doit aimer la France pour ce don royal ! »
Elle aperçut ensuite les flèches ailées de la Sainte Chapelle dont saint Louis, lui-même échangeant la pourpre et l’hermine pour un simple surcot de laine, surveilla les travaux. Les rayons du couchant frappant les onze cents vitraux multicolores, transformaient la chapelle en une châsse somptueuse ornée de diamants... L’escorte était sans cesse arrêtée par des rassemblements où l’on criait tantôt « Vive le duc d’Orléans », tantôt « Vive le duc de Bourgogne » et où malgré l’intervention des arbalétriers, des coups d’épée étaient échangés. Perdue dans son rêve pieux, Colette ne vit rien de tout cela. Elle n’aperçut même pas, en passant devant un gibet, se balancer le corps de deux étudiants récemment pendus. Elle allait, au pas de sa mule et ne s’arrêta que devant le palais du légat, but du voyage.
Ce légat, Antoine de Chaland, avait, sur le rapport du Père Henri, donné pouvoir à l’évêque d’Amiens de dispenser Colette de la clôture. Il était donc très au courant de la question. Il reçut les voyageurs avec bonté, leur remit un message pour Benoît XIII qui habitait alors à Nice et leur conseilla de se rendre au plus tôt auprès du Souverain Pontife.
Il y avait alors deux papes à la tête de la chrétienté. C’est l’époque du grand Schisme d’Occident qui dura malheureusement de 1378 à 1417. En 1303, le roi de France, Philippe le Bel avait commis le crime d’emprisonner le Souverain Pontife Boniface VIII, de le déposer et de lui enlever la dignité pontificale. À vrai dire, c’est la réunion des cardinaux que l’on nomme conclave qui, seule, a le pouvoir d’élire les papes et de les déposer, mais, au point de vue humain, Philippe le Bel ayant usé de la force, put disposer de la tiare, quand Boniface VIII fut mort en prison. Après le court pontificat de Benoît XI, il fit élire Bertrand de Got, archevêque de Bordeaux, qui prit le nom de Clément V. Le nouveau pape, de caractère faible, accepta de résider en Avignon et, pendant cette période, l’autorité pontificale fut enchaînée au pied du trône de France.
Dans le même temps, l’Italie était déchirée par la guerre civile et les papes étaient plus en sûreté qu’à Rome, dans ce Comtat Venaissin si charmant où la Durance coule, entre les sombres cyprès et les oliviers argentés. « Un instant dans nos murs, toujours dans nos cœurs », dit une devise du pays et les papes demeurèrent 70 ans dans ce séjour enchanteur. La chrétienté, dans l’impossibilité où elle se trouvait de savoir qui était le pape légitime : celui d’Avignon ou celui de Rome, adopta une solution que les circonstances imposaient : la France et ses alliés, c’est-à-dire la Castille, l’Aragon, le Portugal, la Savoie, l’Écosse, la Lorraine et le royaume de Naples, se déclarèrent pour le pape d’Avignon tandis que les autres nations catholiques se rattachaient au pape de Rome. Or, depuis 1894, on avait élu comme pape d’Avignon, sous le nom de Benoît XIII, un Catalan, Pierre de Lune, dont Paul Claudel dit qu’il « a le nom de la lune, au fond de sa Catalogne ».
Des années s’étaient écoulées, depuis que, monté sur un palefroi blanc, précédé d’un écuyer portant un pavillon de pourpre fixé au fer de sa lance, le pape Clément V avait été sacré à Lyon et avait fait son entrée dans Avignon. Il y séjourna peu, d’ailleurs et fit son logis du couvent des Frères Prêcheurs. Son successeur, Jean XXII, s’installa au palais épiscopal, situé sur le versant occidental de la route des Doms.
Le séjour des Papes en Avignon eut d’heureuses conséquences pour la ville. D’abord, soucieux de donner au Vicaire de Jésus-Christ une demeure digne de sa haute dignité, tous ceux qui se succédèrent sur le trône pontifical firent subir au palais de nombreuses transformations. Les péniches qui longent le Rhône transportent des milliers de jolis carreaux vernissés de toutes couleurs, pour paver la chapelle et les chambres. L’intérieur du palais, attristé par des murs sombres, s’égaie de tapisseries aux couleurs chatoyantes. Et la présence des Papes attire dans la ville des artistes et des artisans venus de France et d’Italie pour répandre de la beauté.
L’on construit des quartiers neufs et, dans chaque quartier, une église fait monter vers le Ciel sa prière de pierre. Dans tous les clochers, des cloches sonnent pour appeler à la prière les nombreux moines et moniales, aussi bien que les pieux habitants. Selon le joli mot de Rabelais Avignon devient « la ville sonnante ». Mistral plus tard, dira que la ville des Papes est « la sonneuse de joie », celle qui a vu dans ses murs tant de gloire, qu’elle n’a gardé pour elle que l’insouciance.

Au moment où sainte Colette et sa suite font route vers le Souverain Pontife, Benoît XIII n’est plus en Avignon. Trois ans auparavant, à la suite d’une discussion avec le roi de France, les habitants mal informés ont fait le siège du palais pontifical. Quelques éclats de pierres ayant atteint le Pape à l’épaule, il a fui sa demeure et s’est réfugié à Gênes. C’est là que Sainte Colette croyait le voir mais, la peste ayant décimé la ville, Benoît XIII était alors à Nice et c’est vers cette ville que se dirigèrent les pèlerins. L’on croyait être au terme et il faut continuer les efforts. Les pluies d’automne ont raviné les routes et grossi les rivières. Parfois les paysans indiquent un gué, c’est-à-dire un lieu où l’on doit pouvoir traverser le fleuve à pied sec, mais l’eau est si profonde que les montures y plongent jusqu’au ventre. Ailleurs, la terre argileuse colle aux pieds et les chemins glissants rendent la marche dangereuse. On a grand-peine à parcourir cinq lieues par jour et il y a loin de Paris à Nice.
En remontant le cours de la Seine, les voyageurs se dirigent vers la Bourgogne où leur réputation les a précédés, si bien que les grands prétendent à l’honneur de les loger. C’est chez le jeune duc de Savoie, Amédée VIII, qu’ils acceptent de descendre, car il habitait alors à Bourg-en-Bresse.
De Bourg, ils se rendent à Rumilly, chez Blanche de Savoie, comtesse de Genève. Cette princesse, nièce du précédent pape Clément VII, avait gardé des attaches à la cour pontificale. Dès qu’elle vit Colette, elle sentit qu’elle était en présence d’une envoyée de Dieu et résolut de lui faciliter sa mission. Elle écrivit un message personnel au Souverain Pontife, mais, pour témoigner de plus d’égards envers l’Ancelle 4, elle chargea l’une des dames de sa cour d’accompagner les pèlerins et de remettre le pli à Benoît XIII pour qu’il pût en prendre connaissance avant l’audience qu’il lui accorderait.
Comme la caravane descendait la vallée du Rhône, elle fut rejointe par un messager chargé par un ami du Père Henri de l’informer que le Souverain Pontife résidait à Nice, ce que n’ignoraient pas les voyageurs. Le terme du voyage approchait : que l’on se sentait loin de Picardie ! Ce n’était plus même le ciel tendre de l’Île-de-France ou de la Bourgogne, mais un ciel d’un bleu intense que ne voilait aucun nuage. La lumière était si vive que l’air semblait transparent et, quand la mer apparut dans son azur sans rides, les voyageurs poussèrent des cris d’admiration. Colette, elle-même, arrachée à sa contemplation intérieure, emplit ses yeux de tout ce bleu. Les orangers et les citronniers pliaient sous le poids de leurs fruits d’or. D’or aussi étaient les branches souples des mimosas qui ombrageaient la route, en répandant d’exquises senteurs. « N’est-ce point là l’antichambre du Ciel ? » pensa la sainte et un hymne de reconnaissance s’éleva de son cœur fervent. Mais, Satan veillait. Au moment où, vibrants d’espoir, les voyageurs entrevoyaient déjà la fin de leur mission, ils furent brusquement rappelés à la réalité par des cris affreux sortant du chariot couvert dans lequel avait pris place la dame d’honneur de Blanche de Savoie. L’on entrait dans Nice et, à la grande humiliation des pèlerins, l’on vit cette dame s’échapper du chariot et courir devant les montures, en éclatant d’un rire sardonique et en prononçant des paroles insensées. Parfois, elle s’arrêtait au milieu de la rue et se mettait à danser d’une danse frénétique. Le Père Henri était heureusement muni de toutes les pièces officielles nécessaires, sans quoi il n’est pas certain qu’on eût laissé pénétrer les voyageurs dans l’actuelle résidence du Souverain Pontife.

Cependant, la foule s’amassait autour de la caravane, et, comme l’on approchait de la demeure pontificale, un prélat de la maison de Sa Sainteté s’informa des causes du bruit.
– C’est, lui répondit-on, une pauvre folle qui fait mille excentricités et brandit un pli en disant « Je veux voir le Pape u.
Benoît XIII, informé, ordonna qu’on introduisît auprès de lui la malheureuse, dont l’agitation n’avait fait que croître. Elle entra, l’injure à la bouche, le visage enflammé, les yeux pleins de courroux. O miracle ! elle avait à peine aperçu le pontife, blanche silhouette aux traits sereins, qu’elle tomba à genoux en pleurant. « Relevez-vous, ma fille, lui dit le Pape avec bonté, et me dites ce que vous m’apportez céans. »
– Une lettre de très haute et très puissante Dame Blanche de Savoie, comtesse de Genève, dit nettement la dame que le démon abandonnait enfin.
Et, tout en remettant le message à Benoît XIII, elle expliqua que le Père Henri et Colette attendaient devant le palais qu’on eût pourvu à leur subsistance. Immédiatement, le Souverain Pontife donna des ordres pour que les pèlerins fussent logés dans des maisons religieuses et les convoqua auprès de lui, pour le lendemain.
Lorsque Colette fut admise auprès du Souverain Pontife, ses historiens disent qu’elle s’en alla en « bonne simplicité, confiance et grande humilité, les yeux en bas et le cœur en haut ».
Et voilà qu’il advint cette chose merveilleuse : en présence de cette jeune fille au doux visage, qu’auréolait la grâce de Dieu, le Père commun des fidèles tomba de la chaire où il était assis et, en tombant, eut la révélation qu’il était en présence d’une sainte. Cette chute avait fort effrayé Colette. Elle demeurait interdite, si bien que le Pontife s’étant relevé, s’approcha d’elle et prit la petite bourse qui pendait à la courroie de sa ceinture et qui contenait les notes qu’elle avait écrites pendant sa réclusion, au sujet des grâces qu’elle avait reçues de Dieu. Colette demandait au Pape l’autorisation d’entrer dans l’ordre de Sainte Claire et d’y travailler à la réforme de cet ordre. S’il n’eût tenu qu’à lui, Benoît XIII eût donné immédiatement ces autorisations. Mais les révélations qui lui avaient été faites au moment où Colette avait été introduite en sa présence n’avaient pas éclairé ses conseillers. Ne jugeant que sur les apparences, ceux-ci n’avaient aucune confiance en cette jeune fille inconnue, venue de si loin pour demander de faire revivre l’austère règle d’autrefois. Patiemment, Benoît XIII attend que se manifeste la volonté divine. Or, la peste qui avait obligé la cour pontificale à quitter Gênes, éclata dans Nice et emporta les conseillers les plus opposés à l’œuvre de Colette. L’opposition se tut et tous furent gagnés à la cause de notre sainte. Le Souverain Pontife déclara que le temps de la réclusion pouvait lui tenir lieu de postulat et de noviciat. Il voulut faire lui-même la cérémonie de la profession, imposa le voile à Colette et la ceignit du cordon séraphique 5. Mais, sans l’avertir, il procéda ensuite aux cérémonies de la bénédiction d’une abbesse, conférant à l’humble fille de Corbie l’autorité sur toutes celles qui embrasseraient la réforme. Ce n’est que durant le voyage de retour que Colette s’entendant appeler « ma Mère » apprend que c’est elle qui porte ce titre : « Pauvre sœur Colette ! indigne serviteresse de Dieu ! » s’écrie-t-elle et elle tente de faire revenir le Souverain Pontife sur sa décision. « Ce qui est fait, est fait » répondit Benoît XIII et, pour consoler la nouvelle Abbesse, il lui envoie un magnifique livre d’heures sur vélin, orné de miniatures, que l’on peut encore admirer au couvent de Poligny.
Cependant, sa mission accomplie, Colette n’a plus qu’un désir, regagner sa ville natale qui, lui semble-t-il, doit être la première à abriter un couvent réformé. La comtesse de Genève supplie la réformatrice d’établir à Rumilly ce monastère tant attendu et le duc Amédée VIII désire, lui, voir cette maison bénie s’élever à Bourg-en-Bresse. Colette reste sourde à toutes les demandes. C’est sur les rives de la Somme, dans les lieux où elle a grandi qu’elle veut bâtir un couvent de Colettines. Mais les compatriotes de Sœur Colette lui en ont voulu de les quitter. Ils considéraient sa présence de recluse comme une protection. Son départ les a froissés. Et puis, ils lui reprochaient aussi d’avoir changé plusieurs fois de couvent et les Bénédictins installés depuis si longtemps à Corbie ne comprenaient pas que la jeune fille qui avait grandi à l’ombre de l’abbaye ait l’ambition d’instituer un autre ordre dans sa ville natale.
Sur le passage de Colette, on se détournait donc, on avait pour elle des mots aigres et des manières inamicales. Elle, qui voulait le bien de tous, s’étonnait et s’affligeait de l’animosité qu’elle sentait autour d’elle. L’on rapporte que, lasse et découragée, elle gravit un jour, la colline qui domine Corbie, alla se réfugier dans une carrière creusée dans le terrain crayeux et, de là, contemplant la ville, ainsi que Notre-Seigneur avait, jadis, contemplé Jérusalem, elle s’écria dans un élan prophétique : « Malheureuse ville ! on dira un jour : Ici fut Corbie. »
Si attristée que fut la jeune moniale de ne pouvoir faire du bien à la ville qu’elle aimait le plus au monde, elle comprit qu’il était inutile d’insister et elle accepta l’offre du Père Henri qui l’emmena chez son frère, au château paternel de la Balme (ou la Baume) en Savoie. Deux amies d’enfance, Marie Sénéchal et Colette Chrétien quittent Corbie avec la jeune Abbesse qu’elles croient être une envoyée du Ciel.
Installée d’abord au château de la Balme, la nouvelle communauté se transporte ensuite dans le château que la comtesse de Genève possédait dans le même village. Bientôt, d’ailleurs, une autre installation plus conforme à l’esprit de l’ordre s’offre providentiellement. En effet, un couvent de Clarisses se trouvait à Besançon. Les religieuses avaient accepté tous les adoucissements à la règle dont nous avons déjà parlé. Or, le service de Dieu, devenu trop facile, avait cessé d’attirer les jeunes filles. On n’entrait plus au couvent et lorsque Sœur Colette arriva, il n’y avait plus dans le monastère que deux religieuses. À la demande de la sainte, le Souverain Pontife lui fit don du monastère, à condition de caser les dernières Clarisses. L’une d’elles entra dans un autre ordre et l’autre resta avec Sœur Colette.
C’est à Besançon que Dieu permit les premiers miracles qui devaient confirmer dans les esprits l’idée que l’Abbesse était une envoyée de Dieu. Il y avait seulement cinq jours qu’elle était dans la ville, lorsqu’on lui amena la femme d’un des principaux notables, atteinte d’une maladie nerveuse qui l’exposait à des crises tellement fortes que quatre personnes ne suffisaient pas à la tenir.
Lorsque Sœur Colette la vit, elle l’engagea à croire à sa guérison et par deux fois, elle alla prier dans son oratoire. Mais à deux reprises, elle en sortit, le visage affligé et disant que la malade ne guérissait pas, parce qu’elle n’avait pas la foi. La troisième fois, Colette revint auprès de la malade, avec un visage serein et rayonnant de joie : « Vous avez cru, dit-elle, vous êtes guérie. »
Quelque temps après, un homme accourut au monastère en portant dans ses bras, le corps sans vie de sa petite fille. L’enfant était morte en naissant et le père, désolé qu’elle n’eût par reçu le baptême, l’avait portée à l’église dans l’espoir qu’un souffle de vie permettrait de la faire enfant de Dieu. Hélas 1 la vie ne s’éveilla pas. C’est alors que sur les conseils des habitants, il apporta l’enfant à l’Abbesse. Celle-ci se mit en prière, pendant que ses Sœurs enveloppaient le petit corps dans un voile de Sœur Colette. L’enfant donna bientôt des signes de vie, elle fut baptisée, reçut le nom de Colette et devint ensuite religieuse, puis abbesse. Comme le dit Mme Ancelet-Hustache, si l’on hésite à croire que sainte Colette ressuscita les morts, pourquoi ne pas penser que l’enfant était endormie, mais d’un sommeil dont, sans l’intervention de l’Abbesse elle ne se fut probablement pas réveillée ?

Tous ces prodiges excitèrent à Besançon un tel enthousiasme que l’élite des jeunes filles ne tardèrent pas à se présenter au couvent des Clarisses pour solliciter l’entrée en religion. Déjà le monastère de Besançon ne pouvait plus loger les postulantes. C’est alors qu’intervint Marguerite de Bavière, duchesse de Bourgogne. Son mari, Jean sans Peur, possédait, à Auxonne, deux maisons qu’il voulut bien donner à l’Abbesse pour y établir un monastère. Colette partit pour cette ville avec quelques-unes de ses filles, dans les derniers jours d’octobre 1412. Ce voyage fut marqué par un prodige que relatent tous les historiens de la sainte. Assise sur son âne, elle cheminait lentement, ignorant comme d’ordinaire, les incidents de la route, quand le Père Henri et les sœurs qui l’accompagnaient s’aperçurent que les voyageurs, les chemineaux, les ouvriers des champs interrompaient leur travail et s’immobilisaient sur le passage de l’Abbesse. Ils regardent à leur tour et s’aperçoivent que le corps de la Bienheureuse est transfiguré : un reflet d’En-Haut l’enveloppe et, de sa tête, partent les rayons d’une lumière supraterrestre.
Les habitants de Dôle ayant appris ces merveilles, se portent processionnellement à la rencontre de la caravane. On chante des hymnes, on réclame un discours de l’Abbesse. Spontanément, elle parle de la noblesse de l’état religieux et des trésors de la pauvreté évangélique. Déjà elle projette de revenir à Dôle pour y établir un monastère, mais pour le moment, c’est Auxonne qui l’attire dans ces plaines humides de Bresse, ces prairies noyées de brouillard que Michelet, plus tard, comparera à une « petite Hollande fiévreuse ». Des étés chauds, un sol fertile font de cette région l’une des plus riches de France. C’est là que sainte Colette établit un monastère qu’elle voulait très pauvre pour qu’il pût servir de modèle aux autres, dont le caractère essentiel devait être l’humilité.
Le 28 octobre 1412, la réformatrice s’installa à Auxonne avec quelques religieuses, mais la duchesse de Bourgogne, désireuse d’apaiser le courroux céleste attiré par les crimes de Jean sans Peur, avait résolu d’offrir à Dieu quatre monastères réformés. Or, dans un voyage de Rumilly à Besançon, Sainte Colette avait remarqué la petite ville de Poligny, bizarrement campée au pied de deux énormes rochers séparés par une vallée étroite. Or, précisément, le duc possédait à Poligny un arsenal qui servait moins de dépôt d’armes que de dépôt de vivres. Les fermiers généraux protestèrent, quand Jean sans Peur fit don de ce bâtiment, mais il affirma « de son cœur désirer l’augmentation du divin service » et les travaux commencèrent immédiatement. Ce nouveau couvent fut encore plus pauvre et plus étroit que celui d’Auxonne. L’on pouvait toucher les plafonds avec la main et l’oratoire de l’Abbesse était obscur et si bas que c’était à peine si elle pouvait s’y tenir debout. L’eau manquait, mais à la prière de Colette une source jaillit. De ce couvent, où elle demeura sept ans, l’Abbesse voulut faire un noviciat général d’où elle pourrait tirer des sujets de valeur, pour de nouvelles fondations.
En 1416, elle se vit confier une toute petite fille qui devait devenir Sœur Perrine. Lorsque Colette avait, au retour de Rome, été accueillie au château de la Balme, la châtelaine avait, dans la nuit-même, donné naissance à une petite fille qui n’avait dû la vie qu’aux prières de la sainte. Ses sœurs aînées : Odile et Mahault de la Balme avaient été parmi les premières religieuses colettines. La petite Perrine fut élevée au monastère de Poligny et, dès que son âge le lui permit, elle prit le voile et demeura trente ans auprès de l’Abbesse. C’est à Poligny que Sainte Colette reçut la visite de Saint Vincent Ferrier, venu s’entretenir avec elle de l’état de l’Église 6. Ils adressèrent, au concile de Constance, une lettre qu’ils signèrent tous deux et dans laquelle ils suppliaient les 1800 prélats réunis là de mettre fin au schisme, en élisant un seul pape. Leur prière fut exaucée et, le 11 novembre 1417, le cardinal Otton Colonne fut élu pape, sous le nom de Martin V.
Les postulantes continuent d’affluer dans les couvents de Clarisses et les malheurs terribles qui fondirent sur la France inspirèrent à maintes grandes dames des gestes généreux.
... 25 octobre 1415... Dans la petite vallée d’Azincourt, en Artois, la fleur de la jeunesse française est fauchée par les Anglais. Parmi les victimes se trouvent les deux frères du duc de Bourgogne : le duc de Nevers et le duc de Brabant. Désolée, le cœur brisé, la comtesse de Nevers, Bonne d’Artois, dont la belle-sœur était la protectrice de Colette, chercha une consolation dans les bonnes œuvres. Elle obtint une bulle de Martin V et fit ériger, dans la petite ville de Decize, un monastère dont elle fit don à la sainte. Le duc de Bourbon n’avait pas péri lors du désastre d’Azincourt, mais il avait été fait prisonnier et sa femme, désireuse d’obtenir par ses offrandes la liberté de son mari, supplia sainte Colette de fonder un monastère dans ses États. Ce fut là l’origine du couvent de Moulins, à la tête duquel l’Abbesse plaça Sœur Marie de Corbie. La générosité de la duchesse de Bourbon n’était pas satisfaite : elle voulut un autre monastère à Aigueperse. De tous les coins de France, l’on sollicitait la fondation de nouveaux couvents. Pour obéir aux désirs du duc de Savoie, l’Abbesse en établit un à Vevey. Puis, c’est Claudine de Roussillon, comtesse de Polignac qui obtient la création du monastère du Puy.
L’un des historiens de sainte Colette, Monsieur l’Abbé Douillet croit pouvoir affirmer que, lors d’un de ses voyages à Moulins, l’abbesse rencontra Jeanne d’Arc qui faisait alors le siège d’un certain nombre de places-fortes occupées dans le Nivernais par les Bourguignons, alliés aux Anglais. L’on aime à penser que ces deux âmes dévorées du même amour de Dieu : celle qui voulait garder le sol de France et celle qui voulait y faire germer des saints, échangèrent des propos où se révélèrent les secrets de leurs âmes prédestinées.
Cependant, l’Abbesse ne pouvait se résigner à ne réformer que des couvents de femmes, car des aumôniers et des directeurs de conscience ne se trouveraient que dans des monastères d’hommes ayant eux-mêmes embrassé la réforme. C’est pourquoi Colette retourne à Dôle où elle n’avait fait que passer et, avec l’aide du Père Henri, elle désarme l’opposition de quelques religieux et finit par obtenir le retour à l’ancienne observance d’un couvent de Franciscains. Parmi les moines les plus opposés à la réforme se trouvait le Père Foucault qui disait, en regardant le rocher qui domine la ville de Besançon : « Colette, Colette, tu parviendras plutôt à arracher la roche Chandane qu’à prendre le couvent de Dôle. »
Elle le fit pourtant et le Père Foucault, lui-même devint un religieux fervent, tout dévoué à l’Abbesse. De Dôle, ces religieux colettins essaimèrent un peu partout, mais les historiens ne font que peu d’allusions aux couvents d’hommes. C’est pourquoi le Père Sylvère, l’un des premiers historiens de sainte Colette, écrit : « Je suis grandement marri que je n’ai pu tracer la liste des religieux qui ont suivi la réforme de Sainte Colette, car je ne doute aucunement qu’ils n’aient occupé un grand nombre de couvents et beaucoup plus que les filles de Sainte Claire. » L’essentiel est de savoir que, sous l’influence de l’humble fille de Corbie, les monastères revinrent aux règles qu’avaient établies leurs fondateurs.
Sainte Colette, naturellement, donnait l’exemple et l’on remplirait un livre tout entier du détail de ces renoncements. En ces temps où la main d’un Dieu courroucé semblait s’étendre, menaçante, sur notre pauvre pays, que serait-il advenu de lui si, dans les monastères, de saintes âmes n’avaient sans cesse élevé vers le Ciel leurs mains suppliantes ?
Couchée sur un sac de paille posé sur une planche, ayant pour reposer sa tête, une pièce de bois, Colette ne dormait qu’une heure par nuit. Elle ne se nourrissait guère que de pain, auquel elle ajoutait parfois quelques petits poissons, non des gros qu’elle ne trouvait « pas assez purs ». Elle ne buvait que de l’eau et, durant tout le Carême, elle réduisait si bien ces pauvres rations qu’il lui arriva de jeûner comme Notre Seigneur, pendant quarante jours et quarante nuits.
Elle se mortifiait aussi par le vêtement, car refusant toutes robes neuves, elle ne portait que celles qui avaient déjà été usées par ses sœurs et qui étaient raccommodées de toutes parts. Quel exemple pour tant d’enfants gourmands et de jeunes filles coquettes ! Sous son humble robe, sainte Colette portait une ceinture de fer qui pénétrait si profondément dans la chair que, lorsque le Père Henri lui ordonna de l’enlever, elle enleva du même coup des lambeaux sanglants. De santé très délicate, elle souffrit constamment de maux divers ; mais loin de se plaindre, elle disait que ce qui pourrait lui arriver de plus pénible, ce serait de « passer un jour sans avoir rien enduré pour Dieu ».
Ainsi éprouvée physiquement, Sainte Colette ne cessait pourtant pas d’arpenter les routes pour faire de nouvelles fondations. Ayant établi des Colettines à Seurre, à Pont-à-Mousson, à Amiens, elle franchit la frontière et fonda des couvents à Hesdin (Pas-de-Calais), à Gand (Belgique) et à Heidelberg (Allemagne).
Ces nombreux voyages exposèrent la sainte à bien des dangers, quoi qu’elle fût « peureuse et moult craintive ». Elle fut, à plusieurs reprises, arrêtée par des brigands ; avec la permission de Dieu, elle les met en fuite de diverses manières ! Un jour, le regard du chef des bandits avait à peine rencontré les yeux de lumière de la sainte que toute la bande battait en retraite. Un autre jour, ce sont les chevaux des détrousseurs de grand chemin qui s’arrêtent paralysés et qui restent cloués au sol.

Veut-elle traverser le Doubs débordé ?... devant elle et ses sœurs les flots s’aplanissent, à moins qu’un pont ne surgisse ou que le terrain ne s’élève pour laisser passer à pied sec les « serviteresses de Dieu ». Et les prodiges ne sont pas seulement extérieurs. Dieu permet que Colette lise dans les âmes. À une religieuse distraite pendant l’office, elle fait dire de chasser toutes les pensées frivoles ; à une autre qui a fait tous ses efforts pour attirer son attention par son maintien recueilli et la ferveur de sa prière, elle ordonna de se donner la discipline « afin qu’elle apprenne à dominer sa vanité et sa dissipation ». De passage à Courtrai, elle entendit un religieux chanter les louanges d’une recluse qui édifiait le voisinage par ses mortifications. Alors que les sœurs qui l’entouraient poussaient des exclamations d’admiration, la sainte se taisait et son visage demeurait impassible. – « Mais, ma Mère, lui dit une religieuse, cette sainte fille ne prend jamais aucun aliment. » – « Satan non plus » répondit calmement l’abbesse. Peu après, en effet, la simulatrice fut démasquée, car l’on s’aperçut qu’elle se nourrissait la nuit.
Maintes fois, les âmes sur le point de paraître devant Dieu apparurent à la sainte avec la souillure de leurs péchés et elle obtint pour elles le repentir et la miséricorde. Pitoyable aux maux de l’âme, sainte Colette le fut aussi aux maux physiques et son intervention guérit de nombreux malades. Un jour, dans un couvent, alors que toutes les religieuses lui étaient présentées, elle aperçut l’une d’elles qui se tenait à l’écart. C’était une lépreuse. La sainte s’approcha et la serra dans ses bras, la délivrant de son terrible mal. Dans l’église de Poligny, un vitrail rappelle la résurrection de la religieuse qui, morte en état de péché mortel, eut, par l’intermédiaire de l’Abbesse, la faveur de revivre pour obtenir le pardon.
Tant de marques de la faveur divine excitaient la fureur des démons et sainte Colette, si souvent réjouie par des visions célestes, fut aussi éprouvée d’affreuses persécutions. Parfois, en entrant dans sa cellule, elle la trouvait envahie par des crapauds, des reptiles et des monstres divers. D’autres fois, c’étaient des mouches, des fourmis, des limaces qui emplissaient la pièce et l’empêchaient de faire oraison.
Les animaux, heureusement, n’étaient pas toujours des suppôts de l’enfer. La sainte était souvent visitée par des oiseaux qui pénétraient par son étroite fenêtre et chantaient avec elle les louanges de Dieu. Une alouette, en particulier, qu’elle aimait à cause de son vol dirigé tout droit vers le Ciel, partageait sa vie, se nourrissait des miettes de son pain et se désaltérait dans sa cruche. Il y eut aussi un charmant agneau, blanc comme neige, qui pénétrait dans son oratoire et s’agenouillait, dit-on, au moment de l’Élévation. Tout aussi blanc était un oiseau inconnu qui séjournait auprès d’elle, disparaissait et revenait au gré de ses caprices.
Lorsqu’il sera question de canoniser « sœur Colette », on aura grand-peine à choisir dans tous les faits merveilleux qui ont rempli sa vie. Cette vie s’achève : nous sommes en 1447. L’abbesse vient d’avoir 66 ans. Elle a maintes fois prédit qu’elle ne dépasserait pas cet âge. Le 6 décembre, jour de la Saint Nicolas, Sainte Colette arrive à Gand et avertit le père de Vaux et le Père Claret de sa fin prochaine. « Si j’avais à recommencer, dit-elle, je ne sais comme je ferais, si ce n’est de la manière que j’ai fait. »
Le dimanche 26 février 1447, dès le matin, elle se confessa, communia, puis s’étendit sur sa pauvre couche, mit sur sa tête le voile noir qui lui avait été remis par le Souverain Pontife et attendit la mort. Quarante-huit heures après, le lundi 7 mars 1447, elle rendit à Dieu son âme angélique. Selon ses dernières volontés, elle fut inhumée à Gand « sans suaire et sans cercueil ». Au moment-même de sa mort, des anges portèrent à la plupart des couvents de son ordre, la glorieuse nouvelle : « La vénérable religieuse Sœur Colette est allée vers le Seigneur », dit une voix angélique.
L’ouvre de Sainte Colette fut immense et il est clair qu’elle ne put l’accomplir qu’avec l’aide de Dieu. En effet, l’humble fille du charpentier de Corbie n’était pas, comme Sainte Claire, appelée par sa naissance à être en relations avec les puissants. Or, ce sont précisément les puissants qui sont ses principaux auxiliaires.

Outre la duchesse de Bourgogne et la duchesse de Bourbon, la comtesse de Genève et autres grandes dames rendent hommage à ses vertus et sollicitent la fondation de monastères. À Heidelberg, elle est appelée par la princesse Palatine, fille de Blanche de Savoie et mère de Sœur Élisabeth de Bavière qui venait de faire profession.
Le monastère de Gand est fondé sur les instances de Philippe le Bon, duc de Bourgogne et de sa femme, Isabelle de Portugal. Dans le Languedoc, elle est appelée par le roi Jacques (époux de Jeanne, reine de Naples) et par son gendre, Bernard d’Armagnac. Plusieurs filles du roi sont déjà Colettines. Lui-même et son fils prennent l’habit en 1435.
En rapport avec les grands du monde, l’abbesse est aussi en rapport avec les saints de l’époque, avec Saint Vincent Ferrier, avec Saint Jean de Capistran, religieux franciscain chargé par le Souverain Pontife Eugène IV de ramener toutes les familles franciscaines à la même règle et qui vint de Rome à Besançon pour en parler avec l’abbesse. Même après sa mort, Colette et son œuvre eurent de puissants protecteurs. C’est grâce à l’intervention de la sainte Carmélite : Madame Louise de France, fille de Louis XV, que, lors de la persécution de l’empereur Joseph II, en 1782, les religieuses de Gand peuvent s’établir à Poligny avec les reliques de leur fondatrice.
La canonisation de « Sœur Colette » fut, dès 1472, sollicitée en cour de Rome, d’abord par Charles le Téméraire, puis par Charles VIII et même par le roi d’Angleterre Henri VIII, encore catholique à cette époque. La cause, retardée par les événements extérieurs, aura, en 1625, l’appui d’Henriette d’Angleterre et de Marie de Médicis. Sous Clément XI, la cause était près d’aboutir, quand le pape mourut, ce qui occasionna de nouveaux délais. Enfin, grâce à l’appui du Cardinal de Bernis, ambassadeur de France à Rome, et du cardinal de Choiseul-Beaupré, archevêque de Bordeaux, le 24 août 1771, le décret établissant que les vertus de « Sœur Colette » ont été portées à un degré héroïque, est promulgué. En effet, pour être proclamé saint ou sainte, il ne suffit pas d’avoir pratiqué un certain nombre de vertus. Il faut les avoir pratiquées en s’oubliant complètement soi-même, en manifestant une énergie, une force d’âme et un amour de Dieu qui dépassent les vertus ordinaires. L’héroïsme, c’est ce qui nous élève au-dessus de la commune nature et qui fait de nous des saints. De plus, pour être canonisé, c’est-à-dire proclamé saint, il faut qu’un certain nombre de miracles aient été reconnus par la Sacrée Congrégation. Du vivant de Sœur Colette, de très nombreux miracles avaient été constatés. Ceux qu’il importait de retenir devaient avoir été accomplis après la mort de l’abbesse. L’on retint la guérison de Sœur Rosa Croës, qui était dans l’impossibilité de marcher à la suite d’une fracture transversale de l’os du genou (la rotule) et qui recouvra en quelques instants l’usage de sa jambe. L’on retint également la guérison de la sœur Marie-Thérèse Smidts, tertiaire de Saint-François qui fut délivrée subitement d’une tumeur au côté gauche, dont elle souffrait cruellement. Le troisième miracle fut la guérison soudaine de François Romain de la Motte, des Récollets de St François, qui était atteint de phtisie pulmonaire (tuberculose).
Il était dit que la cause de la sainte Abbesse devrait encore être retardée, car lorsque le Souverain Pontife Pie VI proclama le 15 août 1790 le décret permettant de procéder à la canonisation, l’on était en pleine révolution et ce fut seulement en 1807, plus de trois siècles après sa mort que « Sœur Colette » monta enfin sur les autels.
Voici en quels termes le Souverain Pontife Pie VII annonce la grande nouvelle à toute la chrétienté : « Nous avons déclaré que la bienheureuse Colette Boëllet, réformatrice de l’ordre de Ste Claire, admirable par l’éclat de ses vertus, comblée des dons célestes, illustrée après sa mort par des miracles et par des prodiges, est véritablement sainte. »
IV
LES MIRACLES DE SAINTE COLETTE
Chemin faisant, j’ai signalé un certain nombre de faveurs divines dont Sainte Colette fut l’instrument. Je voudrais, en achevant le récit de cette belle vie, montrer à mes jeunes lecteurs que la sainte, en contact permanent avec notre Père céleste, obtint de Lui des grâces de tous genres. Certes, le bien des âmes était son souci essentiel pourtant, avec quelle tendresse se pencha-t-elle sur les corps douloureux et avec quelle simplicité elle s’aperçut que, dans ses mains suppliantes, Dieu déposait la guérison.
Un jour, la joyeuse Sœur Perrine, qui, depuis son noviciat n’avait jamais quitté l’Abbesse et lui rendait les menus services qu’exigeait la santé de la sainte, pénètre dans sa cellule, chargée d’un bassin dans lequel elle va laver les pieds de sa Mère. Celle-ci jette sur la toute jeune religieuse le coup d’œil perspicace dont elle avait coutume d’envelopper ses sœurs – « Qu’est-ce donc, dit-elle, vous ne souriez pas comme d’habitude. Vous souffrez ? » Ne voulant pas se plaindre, Sœur Perrine ne répondit pas. Alors, avisant un bandage qui entourait le bras de la moniale – « C’est au bras que vous avez mal ? – dit-elle, avec cette voix compatissante à laquelle les malades ne résistaient pas. – Allons, enlevez-moi ce linge. » Tant était grande la confiance de Sour Perrine qu’elle n’hésita pas. Le bandage enlevé, l’abbesse sourit : « N’êtes-vous pas guérie ? » dit-elle et le mal, en effet, s’était enfui comme se dissipe la pluie sous les rayons du soleil. Persuadée que les faveurs dont Dieu gratifiait les malades étaient dues uniquement à la clémence divine, sainte Colette faisait de doux reproches à ses sœurs lorsqu’elles venaient lui demander de les guérir. – « Si vous aviez la foi, leur disait-elle, vous obtiendriez du Ciel les mêmes grâces que moi. » Mais les moniales n’étaient pas dupes de l’humilité de leur Abbesse. Et bien leur en prenait, car lorsqu’importunée par les supplications de l’une d’entre elles, Sainte Colette repoussait doucement la main meurtrie qu’elle lui montrait, cette main, à peine effleurée, guérissait instantanément.
L’infinie pitié qu’éprouvait la sainte devant les malades faisait fleurir le miracle avec une évidence qui imposait l’admiration et le respect. Une religieuse demeurait retirée dans sa cellule, car atteinte d’une sorte de lèpre, non seulement, elle était un objet d’horreur, mais encore ses plaies exhalaient une odeur infecte. Ouverte seulement à la charité, l’abbesse pénètre dans la cellule où la malheureuse profondément humiliée s’écrie : « N’entrez pas, ma Mère, et me laissez avec mon mal. » – « Dieu peut tout ! » réplique la sainte et tandis qu’un suave parfum se répand dans la cellule, les plaies se ferment une à une. Le soir, la malade guérie chantait à la chapelle les louanges du Dieu trois fois saint qui commande aux puissances de l’enfer.
Certains critiques mondains qui, d’ailleurs, n’ont généralement pas mis les pieds dans un couvent, se plaisent à dire et à écrire que les religieux ou les religieuses malades sont traités avec une dureté parfois cruelle. Il suffit de lire les « Constitutions 7 » de sainte Colette pour se convaincre du contraire. À l’exemple de sainte Claire, l’Abbesse étendait aux malades toute sa sollicitude.
Les infirmes aussi avaient droit à ses bienfaits. Une novice avait, au cours de son service dans le cloître, été atteinte par un morceau de bois et l’œil blessé avait perdu la vue. Comme, au moment de la profession, les autres religieuses déclaraient que l’on ne pouvait admettre parmi elles une infirme, Sainte Colette répondit simplement : « Je quitte Hesdin à la Saint-André, j’emmène cette moniale avec moi : c’est à Gand qu’elle fera profession. » Dès le premier jour du voyage, la novice recouvra l’usage de son œil et toute joyeuse fit profession à Gand.
Dans ce même couvent, une religieuse avait perdu la voix et ne pouvait chanter à l’office. À sa grande confusion, l’abbesse s’approcha d’elle et lui dit – « Il y a bien longtemps, ma fille que vous êtes absente de l’office. À Matines, vous chanterez n’est-ce pas, car vous devez comme les autres célébrer les louanges divines. » Et, à matines, prosternée au milieu des moniales, l’infirme s’aperçut soudain que sa voix s’élevait, haute et claire, dans le chœur des voix angéliques. C’était bien une sainte que Dieu avait placée à leur tête et, non seulement, les religieuses en étaient certaines, mais au dehors déjà l’on vénérait l’abbesse.
En effet, des faits aussi étranges et merveilleux que les guérisons étaient venus aux oreilles de la masse, car je le disais au début de ce chapitre, c’est dans tous les domaines que le pouvoir surnaturel de sainte Colette devait se révéler.
Si la maladie entraîne parfois la mort, il est des accidents qui mettent la vie en grand danger. Durant ses nombreux voyages, Sainte Colette fut exposée avec toute sa suite, aux pires infortunes. En ces temps lointains, la lenteur des moyens de locomotion semble une garantie. Sainte Colette, en effet, voyageait dans un chariot bas traîné par un bœuf. C’est assez dire la lenteur de son allure. Cependant, à la suite d’un mouvement maladroit, une novice tomba dans une ornière, au moment précis où le chariot mal conduit se retournait sur lui-même. Sainte Colette avait eu le temps de sauter du véhicule, mais la novice demeurait sous le chariot que l’on osait à peine déplacer, tant on avait peur de blesser l’accidentée. – « Priez », dit l’Abbesse, et aussitôt, la novice sortit saine et sauve de sa fâcheuse posture.
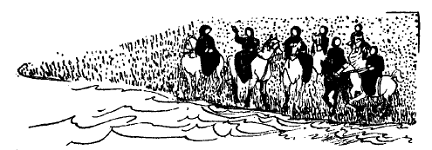
Toujours au cours d’un voyage, Colette et plusieurs religieuses avaient traversé sans encombre le Doubs débordé. Sur l’autre rive, une seule moniale épouvantée n’avait pas osé lancer sa monture dans les eaux tumultueuses. Le soir tombait et l’on ne pouvait tarder davantage à gagner le couvent où les pèlerins étaient attendus.

– « Je vais chercher la retardataire » dit un homme courageux, Jean de Bacs, qui lança son cheval dans les flots. Il parvint sans dommage sur la rive et, après bien des résistances, arriva cependant à décider la moniale à monter en croupe- sur sa robuste monture. Mais à peine le cavalier s’efforçait-il de lutter contre le courant qu’un coup de vent violent s’éleva et que les flots déchaînés roulèrent en tourbillonnant cavalier, moniale et la monture affolée. Aux cris de la religieuse croyant sa dernière heure venue, l’Abbesse répondit par les litanies des saints reprises par les religieuses dont les voix s’enflaient pour dominer le grondement des vagues en furie : « Des embûches du démon, délivrez-nous, Seigneur... » L’eau montait toujours et les cris de la jeune religieuse se faisaient plus horrifiés : « De la foudre et des tempêtes, délivrez-nous Seigneur ! » Un calme soudain emplit l’étendue, le fleuve rentra dans son lit, le cheval assagi retrouva son cavalier et la religieuse rassurée se hissa sur le dos de la monture qui regagna la rive aussi posément que si elle revenait de sa promenade quotidienne.
Une autre religieuse, Catherine Sumenck, faillit périr par son imprudence. En effet, dans la chapelle d’un monastère, un vitrail était resté ouvert et, au lieu d’aller quérir un jardinier qui était chargé d’ouvrir et de fermer ces fenêtres placées très haut, cette moniale traîna une grande échelle et grimpa au sommet, persuadée qu’elle se tirerait très bien de cet office. Posa-t-elle mal l’échelle trop lourde, ou quand elle fut au sommet, n’eut-elle pas la force de pousser le vitrail pesant. Le fait est que dans un fracas qui ameuta tout le monastère, l’échelle s’écroula, entraînant l’imprudente qui demeura sans vie sur le carreau. Et l’abbesse était absente. On porta la blessée dans sa cellule, on l’étendit sur son lit : elle ne faisait aucun mouvement et l’on crut à une paralysie totale.
Immobile, mais lucide, la pauvre religieuse demeurée seule, gravit un véritable calvaire. « S’il y avait eu le feu au monastère, dit-elle plus tard, j’aurais été bien incapable de quitter mon lit. » Les premières heures de la nuit se passèrent tristement, mais soudain, la porte de la cellule s’ouvrit doucement : l’Abbesse qui était, cependant, à plusieurs lieues de là, entra : son regard compatissant enveloppa la malade. « Ma fille, dit-elle, ce n’est rien, avec l’aide de Dieu, vous serez bientôt guérie. » Jusqu’à cinq heures du matin, elle demeura penchée sur la malade, lui prodiguant des soins et l’encourageant tendrement. Quand elle partit, la sœur Catherine ne ressentait plus qu’une vague courbature qui semblait avoir persisté pour attester que l’accident s’était bien produit. Au grand étonnement de ses Sœurs, la blessée se leva à l’heure habituelle et ne se ressentit jamais de sa chute.
Même prodige favorisa Blanche d’Hut qui, après la mort de la sainte, avait reçu sur le pied une bûche enflammée. La brûlure très profonde s’infecta et la gangrène s’y mit. La religieuse se fit envoyer un peu de terre prélevée sur le tombeau de la sainte et la plaie se ferma instantanément.
La sainte Abbesse fut l’instrument de miracles d’un autre ordre. En ces temps troublés où les villes étaient souvent menacées de l’invasion, plusieurs villes, celle de Decize, en particulier, furent par la présence de l’Abbesse préservées de l’ennemi. Lorsqu’elle arrivait, on lui faisait fête, parce qu’on avait foi en sa protection. D’ailleurs, son autorité imposait le respect.
Dans un de ses voyages, les étapes ayant été plus longues qu’on ne le croyait, Colette arriva, comme le soir tombait, à la lisière d’une forêt où s’ouvrait une gorge sombre fermée par des montagnes. Le lieu était sinistre. De plus, l’abbesse étant en marche pour fonder un monastère, emportait avec elle un certain nombre d’ustensiles de première nécessité et une importante somme d’argent. Elle sentait fort bien que des malfaiteurs pouvaient être en embuscade pour s’emparer de ses biens. L’heure et le lieu étaient propices. Une bande d’homme armés entoura le cortège, se saisit des bagages et semblait prête à massacrer les voyageurs. L’abbesse redressa sa haute taille et s’approchant du chef des bandits, le questionna calmement : « Est-ce moi que vous cherchez ? En ce cas, laissez aller ceux-ci. » Et, faisant signe à son escorte, elle demeura seule avec ses religieuses, en présence de l’homme redoutable. Celui-ci regarda longuement la religieuse : si perverti qu’il fût, il reconnut la marque du Divin. Il rappela ses hommes, fit rendre aux voyageurs les effets qui leur avaient été ravis et demanda aux religieuses l’autorisation de les escorter jusqu’à la ville voisine.
La charité de sainte Colette fut telle qu’elle obtint de Dieu des grâces presque naïves qui évoquent les prodiges de certains contes de fées. Un jour, le monastère était en grand émoi. Le Père Pierre de Vaux, le confesseur de l’Abbesse, avait grand besoin d’un habit neuf. Or, il était pauvre et sainte Colette, qui dépensait tout le produit des aumônes en constructions, était pauvre aussi. L’on se rendit chez un bienfaiteur du couvent pour lui demander de la bure et l’on obtint une pièce d’étoffe solide que l’on remit incontinent au Frère André, le tailleur de la communauté. Il s’extasia sur la qualité du tissu, puis prudemment, demanda : « Y en aura-t-il assez ? » Hélas ! le Père de Vaux était grand et fort, on eut beau mesurer et remesurer, il fallut se rendre à l’évidence : le métrage était insuffisant. Sûre que la Providence ne la laisserait pas dans la peine, Sainte Colette se mit en prière, le frère André pria aussi et, après quelques heures passées au pied de l’autel, on mesura de nouveau la pièce d’étoffe. Ô merveille : non seulement, cette fois le métrage était suffisant, mais encore il resta un morceau que Sœur Perrine mit de côté et garda longtemps, ce qu’elle affirma en racontant elle-même cette anecdote.

Ce n’est pas cette fois-là seulement que l’Abbesse fut tirée par la Providence de ses difficultés matérielles. En ces temps où les hommes d’armes parcouraient sans cesse les campagnes, saccageant les récoltes, dépeuplant les fermes et ruinant les pays, les famines étaient fréquentes. Il arriva que l’abbesse et ses filles n’eurent plus pour se nourrir que les grains de blé restés entre les planches du grenier. Et avec ces quelques débris, l’on arriva à faire assez de pain pour suffire aux besoins de la communauté. Quand il n’y en eut plus du tout, un sac plein du plus pur froment, fut découvert par l’abbesse dans le grenier vidé de fond en comble. Et, comme naguère sur les bords de la mer de Galilée, à la prière de Colette les provisions se multiplièrent. Quelques œufs donnés en aumônes nourrirent les religieuses pendant des semaines et, plusieurs fois, alors que la disette était complète, un homme tout vêtu de blanc apporta au monastère des corbeilles de pain blanc. Plusieurs fois, d’ailleurs, l’Abbesse reçut des messagers célestes. L’un d’eux lui apporta la croix qui est encore vénérée au monastère de Poligny et qui porte enchâssé un morceau de la vraie croix. C’est un crucifix d’or de la dimension des croix des évêques. D’un côté se trouve l’image en relief du divin Crucifié, de l’autre côté sont disposés un rubis, quatre saphirs et quatre perles fines. Quand l’Abbesse quitta le couvent de Besançon, elle y laissa cette croix, pour consoler les Sœurs de son départ. Ce couvent supprimé par la Révolution, le monastère de Poligny put heureusement prendre possession de ce précieux et miraculeux souvenir.
La sainte Abbesse obtenait également des faveurs pour les âmes. Il y avait près de Poligny une prison, occupée par des criminels dont on entendait les cris jour et nuit, si bien que, dans tout le pays, l’on croyait qu’ils étaient possédés du démon. Le couvent que fonda Colette était tout proche de cette prison. Or, il arriva cette chose merveilleuse, que lorsque résonna la clochette argentine, appelant les moniales à la prière, une paix angélique se répandit jusqu’à l’intérieur de la prison. L’on n’entendit plus ni blasphèmes, ni cris de haine et les prisonniers disaient : « Quelle est donc cette voix du ciel qui nous assure le repos ? »
À maintes reprises, l’Abbesse eut la révélation des fautes commises par des coupables qui, sans son intervention, seraient morts sans obtenir le pardon. Il semblait, d’ailleurs qu’elle lisait dans les âmes : un jour, elle fait appeler une novice qui n’ayant, lui semblait-il, commis aucune faute, se demandait ce dont la Mère voulait l’entretenir. – « Ma fille, lui dit l’Abbesse, vous avez la tentation de quitter ce monastère où votre piété et votre vertu sont à l’abri. Résistez à ce mouvement trop humain, restez parmi nous, c’est là que Dieu vous veut. » Stupéfaite de voir ses intentions devinées et persuadée qu’elle a devant elle une sainte, la jeune novice se rend à l’avis de l’Abbesse et devient une professe irréprochable.
Dieu permettait également que Sainte Colette eût parfois le don de seconde vue : Tandis que l’on construisait un de ses couvents elle eut soudain la révélation que des ouvriers étaient en danger sur un cours d’eau. Elle y envoie le Père Henri qui trouve en effet ces hommes dans un petit canot près de sombrer et qui les sauve, de la noyade.
L’avenir lui fut aussi révélé : elle prédit à saint Vincent Ferrier sa mort prochaine. S’étant rendue à Castres, en 1427, elle vit l’évêque de cette ville qui lui demanda le secours de ses prières en vue du voyage qu’il comptait faire à Rome, prochainement. Le regardant comme regardent ceux qui connaissent le secret des cœurs, Colette dit au prélat avec respect, mais avec fermeté, qu’au lieu de se soucier tellement de ce voyage, il ferait sagement de songer plutôt à un autre voyage plus long et dont on ne revient pas, car ce voyage était proche.
L’évêque allait, en effet, à Rome, dans l’espoir d’obtenir le chapeau de cardinal. Il l’obtint, mais à peine revêtu de cette dignité, il mourut comme l’avait prédit l’Abbesse. À peu près à la même époque sainte Colette reçut la révélation de la fin prochaine du Souverain Pontife, Martin V, qui mourut, en effet, le 20 février 1431.
Dès que l’Abbesse arrivait dans un monastère, elle se faisait rendre compte de ce qui s’était passé en son absence, mais tout ce qu’on lui disait lui avait été révélé par le Saint-Esprit, car Dieu permettait qu’elle fût présente par l’esprit dans les lieux où il était nécessaire qu’elle soit renseignée. En arrivant au couvent de Poligny elle trouva une jeune religieuse qui avait été maladroitement chargée de la dépense. Sans examiner ses comptes, sans l’interroger, Colette réunit immédiatement le chapitre, la fit déposer et l’envoya apprendre sous la conduite d’une ancienne, la pratique parfaite de la religion. Pour occuper des charges qui peuvent pousser à la dissipation de l’esprit et éloigner de la méditation, la sage Abbesse ne voulait que des personnes mûres et favorisées d’une vie intérieure intense.
Toujours avec ce don de seconde vue qu’elle possédait, la sainte refusait d’admettre au noviciat une jeune fille qui semblait douée de sérieuses qualités. Les religieuses insistèrent tellement et le confesseur du monastère les soutint avec tant d’énergie que l’Abbesse céda. Elle le fit à regret : « Vous me forcez, dit-elle, mais cette jeune personne n’arrivera pas à la profession. » Il en fut comme elle l’avait prévu.
Il fut même permis à la sainte de plonger plus avant dans les ténèbres de l’avenir. En 1435, accompagnée de la jeune duchesse de Bourbon, l’Abbesse se rendait à Vevey, pour obéir au désir du duc de Savoie qui voulait posséder sur ses États un monastère de Clarisses. Pour atteindre la petite ville située sur le lac Léman, les voyageuses durent traverser Genève. Perdue dans ses pensées et dans ses prières, Sainte Colette ne se souciait pas du paysage. La jeune fille, au contraire, jeta un regard ravi, sur la ville splendide adossée à de vertes collines et s’étendant sur le grand lac paisible que survolaient les mouettes. « Que c’est beau : s’écria-t-elle et comme un monastère serait bien placé ici ! » Tirée de sa méditation, Colette regarda longuement ce morceau de terre favorisé des cieux et dit en souriant : « Le monastère y sera. » Puis ses lèvres devinrent sérieuses et elle dit gravement : « Les sœurs en fuiront, chassées par l’hérésie. » Un siècle plus tard, la Réforme obligea, en effet, les Clarisses à s’établir à Annecy, sur les bords d’un autre lac.

Sainte Colette portait beaucoup d’attachement au couvent de Besançon, dans lequel elle s’était installée en mars 1410. L’archevêque Thibaud de Rougemont, accompagné de son clergé et suivi d’une immense foule, s’était rendu à la rencontre de l’Abbesse, jusqu’au village de Beure à plus d’une lieue de Besançon. La comtesse de Genève, accompagnée de sa nièce Mahaut de Savoie, s’y était rendue également afin de présenter la sainte à l’Archevêque. Ce fut donc une entrée triomphale que fit la sainte à Besançon et elle ne devait jamais oublier cet accueil. Aussi, lorsqu’en 1444, elle dut quitter définitivement la Franche-Comté pour regagner la Picardie, elle fit des adieux émus aux religieuses qui lui étaient si chères. En cette heure douloureuse, l’esprit prophétique l’inspira à nouveau et elle leur révéla que l’incendie devait détruire cette pieuse demeure et que, plus tard, la peste la décimerait, mais qu’elle serait repeuplée par des religieuses venues des couvents voisins. Une grande croix de pierre s’élevait dans l’enclos où les religieuses défuntes dormaient de leur dernier sommeil. L’abbesse étendant la main vers le champ du repos, s’écria : « Quand cette croix tombera, sachez que l’incendie est proche et portez tout ce que vous pourrez sauver à l’extrémité du jardin. » Soixante-six ans après, en 1510, aucune des religieuses qui avaient entendu cette prédiction n’était encore vivante, mais elles avaient pris soin de la transcrire sur les registres du monastère. Par suite, la religieuse qui, un matin, vit la croix abattue sut ce que cela signifiait et donna l’alarme. Le monastère brûla, en effet, sauf l’oratoire de Sainte Colette et la chapelle de Jacques de Bourbon. Rebâti, il fut en 1544, envahi par la peste et dépeuplé, il ne put survivre que grâce à l’apport des monastères voisins. La prédiction de la sainte s’était réalisée à la lettre.
J’ai voulu achever mon livre sur la vision des nombreux miracles de Sainte Colette. En effet, je ne voudrais pas détruire le rêve des Colettes, « petites Nicoles » pour qui j’écrivis cette histoire qui est aussi un acte de foi. Quand ces jeunes lectrices, toutes petites, demandaient à leurs mères de leur faire connaître la sainte dont elles portaient le nom, on leur répondait : « C’était une grande abbesse ». Alors, quand, les années passant, elles ont appris l’histoire, elles ont vu, penchée sur leur berceau, une femme drapée dans un manteau quasi-royal, la poitrine barrée d’une croix enrichie de diamants et portant une crosse d’or, au sommet incrusté d’émaux et de pierres précieuses. Et, parce que je n’ai pas voulu que dans leur esprit, leur glorieuse patronne se confondît avec les fées lumineuses dont on berça leurs rêves d’enfant, il m’a fallu les décevoir. Non, la réformatrice des ordres franciscains ne voulut jamais qu’on l’appelât « Abbesse ». Elle ne portait pas de long manteau traînant sur les dalles, mais un vieux manteau rapiécé plus court que sa robe. Dans ses mains, souvent occupées à de rudes besognes, elle ne tint jamais de crosse d’or, mais seulement un rosaire qu’elle égrenait tout en marchant. Et pourtant, je l’ai dit : elle fut en relations avec des rois et des princesses et Dieu permit qu’elle commandât aux puissances de l’enfer, fît reculer la mort et démasquât le mensonge. Que les petites Nicoles ne regrettent rien : D’ailleurs, elles ont aussi pour patron le grand évêque qui ressuscitait les enfants et nourrissait les pauvres. Qu’elles effacent de leur mémoire la solennelle Abbesse aux allures souveraines, qu’elles se jettent aux pieds de la douce moniale au regard de bonté. Si elles tardent à grandir, elles diront, comme les petites Jurassiennes dont parle Marguerite Bourcet : « Sainte Colette, tirez-nous les jambettes. » Puis elles lui demanderont de poser sur leurs têtes la main tendre qui caressait son agneau et lui promettront d’être humbles comme elle, mortifiées comme elle, pieuses comme elle, afin de participer un jour à son glorieux destin, car c’est elle qui a dit :
« Le labeur est bref, mais le repos est long. Pour un peu de peine, on recevra grand loyer. »
Marie-Thérèse LATZARUS, Sainte Colette,
qui, de naine, devint grande abbesse, Caritas, 1956.
Illustrations de Catherine J.-LAMY.