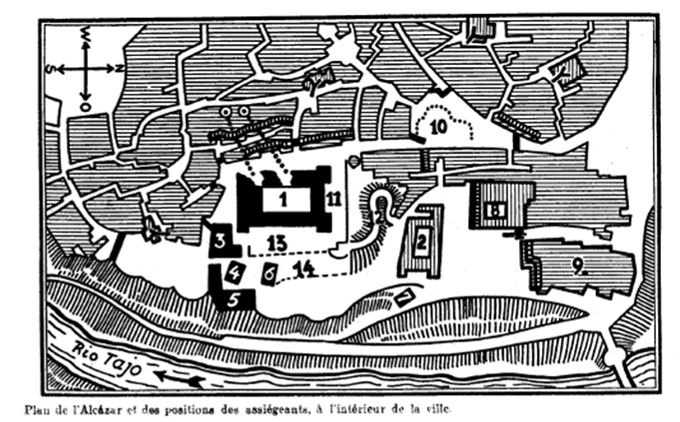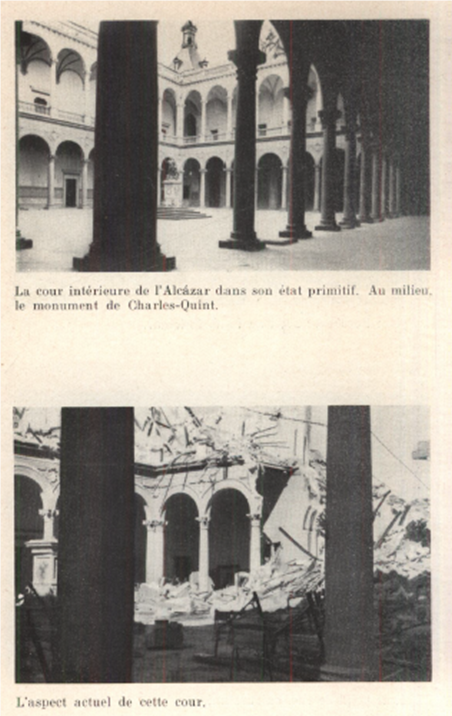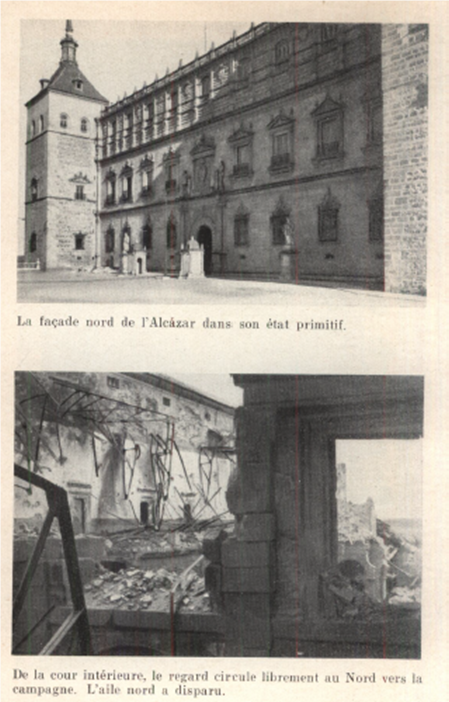Les héros de l’Alcázar
RÉCIT AUTHENTIQUE
par
Rodolphe TIMMERMANS

« L’esprit du grand monarque Charles-Quint, fondateur de l’Alcázar de Tolède, à n’en pas douter a conféré à ses modernes défenseurs la ténacité, la sérénité et la foi nécessaires à cet exploit.
José Moscardó.
Alcázar de Tolède, le 29 septembre 1936. »
________________________________________________
Le général Moscardó, le glorieux chef de la défense de l’Alcázar, accorda un long entretien à l’auteur et voulut bien écrire pour ce livre quelques lignes qui peuvent y figurer comme dédicace. Nous reproduisons ces lignes en fac-similé ci-dessus avec la traduction française.

L’épée reproduite également ci-dessus a été offerte à l’auteur à titre de souvenir, dans l’Alcázar même, par l’officier espagnol qui y fut son guide.

Légende de la carte postale
Au lendemain de la délivrance de l’Alcázar par les troupes du général Franco, fut lancée en Espagne une carte postale qui porta, d’un côté l’image de l’Alcázar dans son état primitif, et de l’autre, un texte qui commémore l’exploit héroïque des défenseurs de la forteresse.
Ci-contre, le verso de la carte avec le texte espagnol et les signatures d’un certain nombre d’officiers et de cadets qui ont pris part à la lutte glorieuse pour la défense de l’Alcázar et qui ont bien voulu signer, pour l’auteur, cette carte qui leur est dédiée. Le lecteur retrouvera, pour autant qu’il saura déchiffrer les signatures, plusieurs noms dont il est question dans ce livre.
Voici le texte espagnol de la carte, traduit en français :
« Tolède, la cité impériale et éternellement héroïque, l’Alcázar, sanctuaire de la foi et de la patrie, berceau de l’infanterie espagnole, où une poignée d’Espagnols ont forcé l’admiration du monde.
« Durant soixante-douze jours, ils ont résisté aux hordes rouges, rejetant les offres de reddition, préférant la mort à l’abandon des ruines sacrées de l’Alcázar.
« L’armée du général Franco a reconquis Tolède le 28 septembre 1936. »

Premières Flammes
Été 1936 !
Le soleil, durement, brûle et accable la terre d’Espagne ; il brûle dans les cerveaux, brûle dans le sang, et les passions une fois embrasées sévissent, aveugles, brutales et sauvages.
En apparence, la paix règne encore en Espagne ; il y a toujours un gouvernement qui dispose de la puissance de l’État, mais déjà il s’est déclaré lui-même parti belligérant. Déjà, le feu jaillit des églises et des couvents, des coups de feu éclatent dans la nuit obscure trouvant leurs victimes dont le sang rouge et chaud est absorbé par le sol assoiffé de l’Espagne, ce sol qui a déjà bu tant de sang et qui en boira encore. –
À Tolède, la ville séculaire sur le Tage, les premières flammes de l’incendie futur s’élancent.
Elles ne montent point encore jusqu’à l’Alcázar qui est à la fois forteresse et palais et dont les quatre tours angulaires dominent fièrement tout alentour. Mais en bas, dans la ville dont les maisons au Sud et à l’Ouest se blottissent presque contre l’immense forteresse tandis qu’au Nord, l’enchevêtrement des toits n’arrive même pas jusqu’à la hauteur du rocher abrupt de l’Alcázar et qu’à l’Est, la vallée profondément entaillée du Tage s’ouvre à cent mètres de distance à peine – en bas dans la ville, les étincelles jaillissent des premiers chocs.
*
Sur la plaza Zocodover vers laquelle les étroites rues tolédanes déversent la vie de la ville, quelques cadets de l’école d’officiers d’infanterie que l’Alcázar héberge en ses murs. Ils sont assis ; on les reconnaît tout de suite aux galons rouges qu’ils portent à leur uniforme : les cadets qui font partie de l’image de la ville et de la plaza Zocodover où, presque tous les jours, au café Suizo, ils prennent leur café, plaisir dont l’Espagnol se prive rarement après l’« almuerzo », c’est-à-dire, le déjeuner.
Un vendeur de journaux communiste s’approche, dans la foule.
– El socorro rojo ! – Le discours de Diaz aux Cortès, crie-t-il en s’arrêtant devant la table des cadets qui le renvoient, d’un geste de la main. Mais cela ne semble pas troubler le gamin qui agite son journal par-dessus la table jusqu’à ce qu’un cadet écarte son bras.
– Cela ne nous intéresse pas !
– Lisez toujours, c’est ce qu’il vous faut.
En glapissant, le vendeur tend le journal sous le nez d’un des cadets. Mais celui-ci en a assez ; un bon coup de poing et l’importun se retrouve sur le pavé, assis à côté de ses journaux.
– J’espère que ça lui suffira pour quelque temps ! Ces gaillards s’imaginent que tout leur est permis depuis que cet individu de Casares Quiroga a déclaré que son gouvernement faisait la guerre aux fascistes. Qu’ils attendent que nous la leur fassions, nous, la guerre !. . . Tu disais justement, Juan, que l’« ABC » annonçait hier. . .
– Dis donc, Julio, tu ferais mieux de te retourner ; ton gaillard revient.
Traversant la place presque en courant, un groupe d’hommes se dirigeait tout droit sur le café Suizo, le vendeur de journaux en tête. Agitant ses mains dans tous les sens, celui-ci leur parle ; tous ont les mains dans les poches comme s’ils s’étaient entendus pour un mauvais coup.
– Tenez, celui-là qui est assis au coin.
Menaçants, les rouges s’approchent ; les premières injures volent vers les cadets. Ceux-ci, brusquement, se sont levés ; l’affaire commence à être sérieuse.
« Attendre qu’il soit trop tard ? » Julio réfléchit rapidement. « Non, plutôt les intimider ! » Et déjà son revolver étincelle au dessus des têtes. Un coup de feu part en avertissement pour les communistes ; mais leurs poings surgissent des poches avec la même rapidité. De part et d’autre, les coups de feu crépitent ; sans viser et sans atteindre sérieusement qui que ce soit ils continuent le feu.
Les autres occupants du café s’enfuient en désordre. Des tables sont renversées, des verres cassés, des chaises traversent les fenêtres en les brisant avec fracas. Quelques minutes à peine, et déjà apparaît, à l’autre bout de la place, la guardia civil. Rien que cette apparition rétablit soudain le silence. Le vendeur de journaux disparaît, avec sa troupe, dans une ruelle. Le garçon se précipite pour relever les tables, le malin petit vendeur de cigarettes qui s’était aussitôt mis à l’abri derrière une table, lui et surtout son uniforme aux vingt-trois boutons étincelants, objet de sa fierté, s’adresse aux cadets, flairant la bonne affaire.
– Après cette émotion, messieurs, il vous faut un cigare. Rien de tel pour vous calmer. Tenez, je vous recommande ce havana.
*
Peu de temps après, avec le premier juillet, commencent les vacances de l’école, et les quatre-vingt-dix cadets de l’Alcázar retournent chez eux, tout à l’attente car avec l’Espagne entière ils pressentent que bientôt des évènements décisifs auront lieu.
Mais où seront-ils alors ? Le congé les dissémine un peu partout en Espagne et la tempête peut se lever pendant la nuit, sans leur laisser le temps de se rassembler. Neuf sur les quatre-vingt-dix cadets ont leurs parents à Madrid tout proche. Ils décident de se rencontrer tous les jours au café afin de garder le contact. Puis :
– Mon capitaine, vous savez où nous trouver, vous nous appellerez lorsqu’on aura besoin de nous ?
Le capitaine Vela, un des jeunes professeurs de l’école d’officiers, le leur promet, à la fois souriant et grave.
– Volontiers. Mais quelles sont ces idées ? On n’aura besoin de vous qu’à la fin des vacances pour recommencer les cours. Avant ?. . .
– Avant, mon capitaine, on aura peut-être besoin de nous pour autre chose. Ou bien nous faudra-t-il attendre qu’il soit trop tard, que l’Internationale soit devenue l’hymne national et le drapeau rouge, le drapeau de l’Espagne ?
– Nous verrons. Viva España !
– Vive l’Espagne !
*
Un jeune officier est debout sur le Miradero. Il est en service commandé à Tolède pour un cours d’exercices physiques à l’école d’officiers. Ses camarades sont à cent mètres, sur la plaza Zocodover, derrière un Vermouth. Il vient de les quitter pour faire une promenade.
Quelle place, ce Miradero !
Elle mérite son nom. D’un côté, elle est bordée par les maisons de la ville, de l’autre, elle domine verticalement la vallée et rien n’empêche le regard de parcourir, à l’Est, la vaste Vega de Tolède, la plaine fertile où serpentent les méandres du Tage.
Le crépuscule est traversé des lueurs de phares d’auto roulant sur ces routes qui, aux abords de Tolède, se réunissent en faisceau et, longeant le Miradero, attaquent la montée de la ville. La route d’Aranjuez, toute plate et droite, parcourt la Vega. La route de Madrid descend des collines au Nord, et au delà encore, entre les hauteurs, la route disparaît qui conduit à Talavera de la Reina et Avila.
Et là-bas, où ces routes se rencontrent, un peu avant la porte de Visagra, il y a l’hospice des afueras, autrefois hôpital, et légèrement cachée par derrière, l’escuela de gimnasia. C’est là que demain, durement, le service reprendra.
Mais en ce moment, le lieutenant n’y pense pas : il est le prisonnier de ses propres regards qui plongent dans ce paysage vaste et silencieux sur lequel descendent les premières ombres du crépuscule.
– Que c’est beau !
Ne vient-il pas de le penser tout haut ? Il se retourne pour voir si personne ne l’a entendu : un officier qui rêve, les yeux ouverts. Non, personne alentour. Sept ou huit hommes seulement arrivent du côté de la route, mais encore assez loin pour ne point l’avoir entendu.
Finie, la rêverie. Il est d’ailleurs temps de s’en aller. Donc, demi-tour, marche !
Comme le lieutenant veut passer à côté des hommes, ceux-ci lui barrent le passage.
– Dis-donc, ton revolver ferait bien notre affaire. Montre-le !
Pour se dégager sur l’arrière, l’officier recule de deux pas. Il porte la main à l’étui de son arme, mais. . . déjà trois ou quatre individus se sont rués sur lui. Les autres se tiennent revolver au poing, bien qu’ils n’aient pas le courage de tirer à cause de leurs propres camarades et du bruit qui les trahirait.
L’officier se défend rageusement, désespérément. Si seulement il avait une main de libre pour saisir son revolver. Mais que faire contre l’attaque brusque d’agresseurs en surnombre ? Ils lui arrachent le revolver du baudrier, et aux cris de « À bas l’armée ! » lui assènent un coup de poing en guise de salut, puis disparaissent, en traversant la place, dans des ruelles presque obscures.
Haletant de son effort et de son émotion intérieure, l’officier se tient à la rampe du Miradero. De colère, il se mord les lèvres jusqu’à la souffrance. Les voyous lui ont arraché son arme –l’arme !
Le colonel Moscardó, directeur de l’escuela de gimnasia, accueille le récit du jeune officier sans grand commentaire et adresse un rapport au ministère de la guerre aux fins d’enquête et sanctions contre les agresseurs. Immédiatement, Madrid donne la réponse en indiquant les « sanctions » : « Le cours d’officiers de l’escuela central de gimnasia est suspendu sans délai, les examens finals n’auront pas lieu. Les officiers participants devront réintégrer leur garnison. »
Les ordres stricts du ministère de la guerre sont exécutés. Mais personne ne comprend cette façon d’agir.
Les communistes braillent : « Muere et ejercito ! – À bas l’armée ! », attaquent des officiers et volent leurs armes. Et le ministère de la guerre, c’est-à-dire, le ministère de l’armée, au lieu de poursuivre les coupables, il punit les officiers. Il persécute l’armée au lieu de la défendre contre ceux qui veulent sa perte. En agissant ainsi, le gouvernement n’encourage-t-il pas ceux qui crient « À bas l’armée ! » ? En prenant de pareilles mesures, ne se rallie-t-il pas à ce cri même ? Où va, en chancelant, ce gouvernement ? vers quel abîme ?
Nombreux sont ceux qui se posent alors cette question. Et devant tous ceux qui se sentent responsables de leur pays, cette question se dresse, inexorable, lorsque le 13 juillet Calvo Sotelo, chef de la droite et député aux Cortès, est arrêté dans son appartement, puis assassiné par des agents en uniforme de la guardia de asalto.
Gagner du temps
– Allô, José. C’est toi, à l’appareil ? Ici, Antonio.
– Oui, moi-même. Comment vas-tu ?
– Fort bien.
– Qu’y a-t-il donc ? Est-ce que notre gouvernement t’a nommé général ? De capitaine à général, c’est un saut considérable. Cela ne m’étonnerait pas, du moment que partout ils destituent nos généraux et que. . .
– Allons, pas de sottises !. . . C’est bien autre chose : le général Franco s’est révolté au Maroc, contre le gouvernement. Là-bas, il a toutes les forces en main ; il veut passer en Espagne.
– Comment ? Est-ce vrai ? ou bien est-ce encore une de ses stupides rumeurs ?
– Non, non, des amis viennent de me téléphoner de Madrid où tout le monde est hors de ses gonds, les uns de joie, les autres de rage. Et le gouvernement dément, disant qu’il ne s’agit là que de l’insignifiante escarmouche de quelques militaires. Donc la chose est vraie.
– Dieu soit loué ! Enfin, c’est fait ! Maintenant, à l’Alcázar, pour voir ce qu’ils savent là-haut. Nous allons nous y retrouver, dans un instant. A Dios.
– A Dios.
*
Avec une rapidité prodigieuse, la nouvelle du soulèvement de Franco fait le tour de Tolède. Dans la cour de l’Alcázar des groupes d’officiers et de civils appartenant aux partis de droite : acción popular, traditionalistes, falange española. Le directeur de l’école d’officiers, le colonel Abeilhe, est absent depuis quelques jours : il est à Madrid. Les autres professeurs de l’école, commandants, capitaines, et le directeur suppléant : le lieutenant-colonel Valencia, sont tous présents.
Franco s’est révolté. Les autres, vont-ils le suivre ? qu’allons-nous faire nous-mêmes ?
Le gouvernement dément en réduisant tout à une petite action isolée ; les nouvelles adverses grossissent tout énormément.
Voici le colonel Moscardó, gouverneur militaire de Tolède. Pour un instant, les entretiens cessent ; tous le regardent afin de deviner dans un geste, dans un mot, ce qu’il pense, lui dont dépendra l’attitude de Tolède dans cette lutte. Mais Moscardó, après un bref salut, gravit en courant le large perron qui, de la cour intérieure de l’Alcázar, conduit à la galerie du premier étage, et rapidement, sa silhouette haute et mince disparaît dans l’une des entrées.
Vers le soir, un officier arrive à l’Alcázar annonçant qu’en différents points de la ville des armes sont distribuées aux ouvriers des organisations front populaire. Voilà de quoi alimenter les discussions ; et les têtes de s’échauffer.
– Il faut nous décider, avant qu’il soit trop tard !
Moscardó est assis à son bureau. Va-t-il faire hisser le drapeau pour Franco, pour la liberté de l’Espagne ? Ou bien n’est-ce pas trop tôt encore ? Il n’a pas de renseignements précis encore sur l’action de Franco. Il ne sait pas comment les autres garnisons réagiront. Tolède ne peut pas d’elle-même prendre la décision d’entrer dans la lutte. Les forces sur lesquelles Moscardó peut compter sont trop insuffisantes. Il y a là les quelques officiers, professeurs de l’école, puis une poignée de soldats de l’escuela central de gimnasia et de la fabrique de munitions, en outre quelques officiers en retraite, d’un certain âge par conséquent, et plusieurs officiers d’artillerie qui participent à un cours à la fabrique de munitions. En tout, cent trente hommes environ. Le directeur de la fabrique lui-même, le colonel Soto ? Pour le moins, sujet à caution. On pourra compter sur les soldats répartis dans les deux écoles, mais près de la moitié se trouvent en congé ; à peine s’il en reste une centaine, et beaucoup d’entre eux n’ont même pas fait deux mois de service encore. Guardia civil : sept cents à huit cents hommes dans la province tout entière. . . !
La sonnerie du téléphone retentit.
– Ici, le colonel Moscardó.
– Madrid. Le ministère de la guerre. Le général Cruz désire vous parler.
– À votre disposition.
Que vont-ils vouloir à Madrid ? Pour le moment, gagnons un peu de temps pour ne pas tout perdre.
Voilà que le général Cruz est déjà à l’appareil.
Il exige que les munitions emmagasinées dans la fabrique de Tolède soient immédiatement transférées à Madrid. Après quelques répliques de part et d’autre, Moscardó accepte, mais demande un ordre par écrit, vu l’importance de l’affaire.
Madrid ne se décide qu’après une hésitation. Le récepteur est remis en place. À présent, il va falloir agir.
Moscardó appelle son ordonnance.
– Le commandant Lecanda !
Une minute après, Lecanda se présente : commandant de cavalerie, de taille moyenne, solidement charpenté, entre quarante et cinquante ans, avec des yeux vifs, jeunes comme ceux d’un adolescent.
– Présent, mon colonel.
– Écoutez, Lecanda. Vous savez aussi bien que moi ce qui se joue aujourd’hui. Madrid veut des munitions. Je suis en train de faire attendre ces messieurs. Maintenant, il nous faut des nouvelles de Franco. On dit qu’à onze heures nous allons avoir des informations par Radio-Ceuta, donc d’ici trente-cinq minutes. Je vous prierai de vous mettre à l’appareil.
– Nous avons déjà essayé d’avoir Ceuta. Mais Madrid brouille l’émission. Il serait préférable d’aller à la caserne de la guardia civil où l’appareil est supérieur.
– Bien. Vous en profiterez pour faire savoir au lieutenant-colonel Romero que je l’attends demain matin à dix heures pour un entretien. Et vous me tiendrez au courant des informations de Ceuta.
*
Vers minuit, Lecanda revient, rayonnant. Franco est maître de la situation au Maroc ; les regulares marocains et le tertio, la légion étrangère espagnole qui se compose toutefois de 80 pour cent d’Espagnols, la meilleure troupe d’Espagne, celle qui a fourni le plus de preuves de sa valeur au combat, se sont rangés derrière Franco. Mais ce n’est pas tout. À Pampelune, le général Mola à proclamé l’état de siège. Le gouvernement madrilène a destitué les généraux Cabanellas et Queipo de Llano, donc Saragosse et Séville se sont également soulevés. Radio-Ceuta a annoncé de prochains débarquements de troupes sur la côte espagnole.
Le colonel Moscardó le remercie, après avoir écouté le récit avec calme. Sa décision est prise. Cela reste toujours une entreprise téméraire que de se révolter, mais à présent, la témérité a un sens. Il s’agit maintenant de se joindre au mouvement pan-espagnol. Et même si cette peignée d’hommes de Tolède devait finir par succomber à l’ennemi en payant leur hardiesse de leur vie, ces hommes auront du moins immobilisé autour de l’Alcázar de forts contingents de troupes rouges, entravant par là leur marche contre le soulèvement national de l’Espagne et gagnant à Franco du temps et de l’espace, lui rendant possible d’occuper, sans coup férir, les hauteurs qui se trouvent à un peu plus de cent kilomètres à l’Ouest de Madrid et qui présentent un plus grand intérêt dans la lutte autour de la capitale.
Mais si au contraire l’Alcázar voulait capituler, des batailles sanglantes s’engageraient pour l’occupation de ses hauteurs, combats qui coûteraient peut-être la vie à des milliers d’Espagnols. Oui, le prix vaut bien l’enjeu de toutes les forces !
Mais, vis-à-vis de Madrid, il s’agit de gagner encore le plus de temps possible.
*
Dimanche, le 19 juillet.
Après une fusillade éclatée la veille au soir entre des hommes de la guardia civil et des partisans du front populaire, la cité présente, en cette matinée de dimanche, un aspect normal. Dans les rues, le mouvement dominical des gens se rendant à l’église. Les femmes et les jeunes filles avec leurs mantilles noires sur la tête, les hommes, les officiers, le colonel Moscardó lui-même, plus austère, plus fermé que d’habitude. Moscardó porte une grande et lourde responsabilité devant Dieu et sa conscience ; en se rendant à l’église il prouve qu’il s’en rend compte et qu’il ne cherche pas à s’en débarrasser.
À 10 heures, Moscardó est à son bureau de l’état-major, en compagnie du lieutenant-colonel Valencia. Peu après, apparaît également Romero, chef de la guardia civil de la ville et de la province de Tolède.
– Veuillez excuser mon retard. J’allais partir lorsque Madrid m’a téléphoné.
– À vous aussi ?
– Oui. À Madrid, on désire que je fasse distribuer aux milices du Frente popular les armes qui se trouvent encore chez nous depuis le désarmement général de la population civile, ainsi que tout autre matériel de guerre.
– Et puis ?
– J’ai déclaré que je regrettais, que la guardia civil suffisait amplement pour assurer l’ordre et qu’une telle mesure anormale était superflue. Et j’ai raccroché.
Le colonel Moscardó leur fait part de sa décision et il n’a pas besoin d’un commandement pour s’assurer l’assentiment des deux autres officiers.
– Nous nous rallions à Franco.
Les trois hommes ont une seule volonté.
*
Dans un café, à Madrid, neuf cadets de l’Alcázar de Tolède autour d’une table. En civil, bien entendu ; en uniforme, ils se feraient remarquer.
Ils sont inquiets, nerveux. Que faire ? Offrir leurs services ici à Madrid ? Repartir pour Tolède ? Quelle est la situation là-bas ?
Si seulement Vela voulait tenir sa promesse !
Soudain, le capitaine en personne apparaît à leur table.
– Hola ! Que tal ?
Il réussit tout juste à empêcher le salut militaire des cadets. Voilà qui serait réussi ! Neuf civils anodins qui, le 19 juillet, saluent militairement un autre civil à Madrid. Peut-être en criant, par dessus le marché : « A sus ordenes, mi capitan ! » Les milices rouges n’auraient plus qu’à les arrêter.
Déjà, il est assis à leur table.
– Camarero, un café solo !. . . Alors, comment cela va-t-il ?
– Si vous êtes venu pour nous ramener à Tolède, alors, ça va bien.
– À la bonne heure. Je pense que nous partirons d’ici une heure et demie pour ne pas arriver en retard. Il vous reste le temps de faire vos adieux chez vous.
*
Le même soir, le capitaine Vela se fait annoncer par l’ordonnance auprès du colonel Moscardó. Il lui demande un entretien d’une minute.
Moscardó, plongé dans ses plans et réflexions d’où dépendront tant de choses, acquiesce d’un bref mouvement de tête ; il a l’air absent.
Entre le capitaine Vela :
– Mi coronel ! Neuf cadets venant de Madrid sont ici présents.
Moscardó sursaute. Une brusque joie illumine ses traits habituellement si sévères. Il appelle les cadets qui attendent sur le seuil.
Il n’aime pas faire de longs discours. Rien qu’une phrase, mais jaillissant du fond du cœur.
– Je vous remercie.
Puis il serre la main à chacun, fixe chacun dans les yeux comme pour l’assermenter à nouveau. . . sur l’Alcázar. . . sur l’Espagne !
Des munitions, des munitions !
Le lundi matin, le directeur de la fabrique de munitions reçoit de Madrid l’ordre de faire charger les munitions stockées sur des camions et de les conduire à la capitale. Le colonel Soto en informe par téléphone le colonel Moscardó.
– Entendu ! Je vais réquisitionner les camions nécessaires et vous les envoyer. Afin que tout soit scrupuleusement exécuté les officiers participant au cours chargeront eux-mêmes les munitions.
– À quel moment ces camions pourront-ils être ici ?
– Cet après-midi, vers quatre heures.
Aujourd’hui, chez Moscardó, peu de répit pour le téléphone. La sonnerie retentit encore.
– Ici, le commandant Diaz Gourez.
– Ici, Moscardó. Qu’y a-t-il ?
– Mes hommes se sont emparés de deux éclaireurs qui venaient de Madrid en moto.
– Les avez-vous déjà interrogés ?
– Oui. Ils sont partis en avant-garde pour reconnaître ce qui se passe chez nous. À Illescas, trois camions avec des milices armées de Madrid attendent le résultat de cette patrouille.
– Vos guardias, cher commandant, on fait une bonne prise. Bien entendu, tous deux sont gardés prisonniers. Merci.
Le colonel Moscardó réfléchit :
Les premières milices sont donc déjà à trente-cinq kilomètres de Tolède. Auraient-ils des soupçons à Madrid ? Cela en a tout l’air. Nous sommes tranquilles jusqu’à demain, car les milices vont tout d’abord attendre le retour de leurs éclaireurs, et étant en si petit nombre ils n’oseront pas s’approcher davantage sans renfort.
– Donne-moi la caserne de la guardia civil, le lieutenant-colonel Romero.
– . . . ..
– Ici, Moscardó. Êtes-vous déjà au courant au sujet d’Illescas ?
– . . . ..
– Bientôt Madrid y verra clair. Je crois opportun de rassembler ici et immédiatement la guardia civil de toute la province de Tolède. Cela vous demande combien de temps ?
– . . . ..
– Fort bien. Il est maintenant deux heures. À cinq heures, toutes les troupes devront être ici. Prenez sans tarder les mesures nécessaires, je vous prie.
À présent, il va falloir réquisitionner les camions pour les munitions « à destination de Madrid » et se préparer en vue d’une attaque des milices rouges. Sur le champ, un officier part avec les instructions nécessaires. Il y a là douze mitrailleuses lourdes ainsi que huit légères qu’on tâchera de répartir adroitement : sur les différents fronts de l’Alcázar même, puis sur les deux esplanades qui, à l’Est, font suite au bâtiment principal, l’une vingt mètres au dessous de l’autre, au bureau du commandement militaire surtout qui, au Nord, est situé à l’avant de l’esplanade la plus basse. Avant tout, il faudra bien garder les rues, car le poste de commandement pourrait facilement être pris à revers par une ruelle qui le longe sur un de ses côtés et, passant par le portail de fer, conduit à l’esplanade inférieure. En plusieurs points, à l’intérieur de la forteresse, il y a des parapets. . .
Le téléphone.
– Moscardó.
– Ici, Madrid. Le ministère de la guerre. Que se passe-t-il avec ces munitions que vous auriez dû nous envoyer depuis longtemps ?
– J’ai réquisitionné dix-sept camions, et on est en train de charger les munitions.
*
Dans la fabrique de munitions de Tolède, universellement réputée, dix-huit officiers sont au travail sous la direction d’un commandant. Les caisses de munitions sont entassées, il ne reste rien des stocks. Au début, les ouvriers sont méfiants ; mais dès qu’ils apprennent par les chauffeurs des camions que ces munitions sont destinées à Madrid, ils sont satisfaits.
Les officiers font du travail soigné ; ils raflent jusqu’à la dernière cartouche. Il fait sombre lorsque tout est chargé sur les camions. Environ 900,000 cartouches de fusil en 600 caisses dont chacune pèse 52 kilogrammes. Une rude tâche ! Sur l’ordre de Moscardó, le départ des camions chargés n’aura lieu que le lendemain matin.
Les officiers passent la nuit dans la fabrique de munitions ; le directeur, le colonel Soto, leur est suspect. Ce serait un coup diablement bête si Soto, accélérant par trop le transport des munitions, remettait les camions aux milices rouges. Il faut donc remiser dans la cour de la fabrique ces camions et leur lourde charge – et les tenir sous bonne garde.
Le soir même, le colonel Moscardó a encore un entretien avec les cadets et quelques jeunes officiers. Tous quittent le bureau de l’état-major avec le sourire.
Depuis quand donc le sérieux Moscardó dit-il des plaisanteries ? Et cela par les temps qui courent !
L’état de siège et les cadets « rebelles »
Le mardi, 21 juillet, à une heure très matinale – sur Tolède et les tours de l’Alcázar scintillent encore les étoiles d’une calme nuit d’été finissante – les soldats de la compagnie d’assaut qui cantonnent dans l’Alcázar sont brutalement tirés de leur sommeil.
– Dans cinq minutes, rassemblement avec fusil, baïonnette et cartouchière.
Les dormeurs sursautent. Qu’arrive-t-il ? Mais ils n’ont pas le temps de réfléchir. Déjà, les fusiliers se mettent en rang. L’ordre habituel est renversé. Quatre groupes de vingt hommes chacun se forment. Un petit déjeuner hâtif, puis en avant : les uns au gobierno militar, le commandement militaire, d’autres à l’hospital de afueras, un groupe encore au Miradero, un dernier enfin à un autre proche bâtiment qui, haut perché au dessus de l’entrée de la ville, domine la contrée au loin. Partout, les troupes d’assaut rencontrent déjà de la guardia civil. Les portes de la ville et les ponts sont occupés par elle : des parapets et des barricades sont dressés, le matériel nécessaire est tout prêt.
Et maintenant, repos, patience. La plupart des soldats pressentent de quoi il s’agit, mais il en manque encore la confirmation.
À sept heures précises, un petit détachement de soldats et de sous-officiers – le capitaine Vela en tête – quitte l’Alcázar au son du tambour. Sur la place Zocodover : Attention. . . Halte ! Les tambours longuement roulent. Puis Vela, devant les Tolédans ébahis, rapidement accourus ou assistant à ce spectacle de leurs fenêtres, lit le « bando » par lequel le colonel Moscardó déclare l’état de siège de la ville de Tolède.
La proclamation est affichée à une grande porte de bois, puis le défilé continue à travers la ville, et en plusieurs endroits encore la même cérémonie se répète. Le voile est tombé ; par sa proclamation, le colonel Moscardó a ouvertement pris parti contre Madrid et pour Franco.
Pendant la lecture du « bando » quelqu’un crie, le poing tendu en l’air : « Muere el ejercito ! – À bas l’armée ! » Un petit signe, et le manifestant est saisi par de vigoureuses mains de soldats. Il est obligé de suivre le cortège à travers la ville jusqu’à son retour à l’Alcázar où il est enfermé avec les deux éclaireurs prisonniers.
*
Presque au même moment, à la fabrique de munitions située sur le Tage au Nord-Ouest de Tolède, la longue caravane des camions gris avec leur haut chargement de caisses de munitions se met en mouvement. Quelques uns des chauffeurs, en quittant la fabrique, saluent du poing levé. En avant pour Madrid !
Déjà la première voiture est arrivée à la porte de Visagra, au tournant où le tronçon de chemin qui conduit à la fabrique rejoint à angle aigu la route de Madrid.
Soudain des cadets et des officiers barrent le passage, revolver au poing.
– Halte-là ! Que conduisez-vous là ?
– Des munitions pour Madrid.
– Elles n’iront pas à Madrid.
– Nous avons l’ordre du gouverneur militaire.
– Cela nous est bien égal. À l’Alcázar avec ces munitions.
– Mais. . .
– Pas de « mais ». Celui qui refuse ou qui donne l’alarme en ville a une balle dans la peau.
Un cadet s’assied à côté du chauffeur. Et au lieu de tourner à gauche vers Madrid ils obliquent à droite, passent la porte et montent vers l’Alcázar. Les autres camions reçoivent chacun leur surveillant et en une longue colonne suivent le premier.
*
Le colonel Moscardó est de nouveau au travail depuis l’aube. Des officiers, des ordonnances, des civils, des commandements et des ordres se suivent sans arrêt.
Voilà Madrid qui téléphone encore.
– Où sont ces munitions ?
– Les camions doivent être partis à l’instant même. . . attendez, une minute. . . oui, ils arrivent justement. . . à l’Alcázar !
– Caramba, qu’est-ce que cela veut dire ?
– Que les munitions restent ici et n’iront pas à Madrid.
– Vous refusez d’obéir au gouvernement d’Espagne ?
– Pour sauver l’Espagne, je suis prêt à tout mais non pour la perdre.
– Vous vous rendez compte de ce que cela signifie ?
– Parfaitement.
– Et vous ne rendrez pas l’Alcázar ?
– Jamais.
– Nous enverrons des troupes contre vous.
– Bien.
– Et d’ici une heure, nos avions seront là-bas pour vous bombarder.
– Allez-y toujours.
Un flot d’insultes et de jurons que Moscardó n’entend plus. Les fils entre Madrid et Tolède sont coupés. Et maintenant, chacun à son poste.
Premières bombes
Dans l’hospital de afueras, les soldats et les guardias civils anxieusement attendent. Le commandant Villalba qui y dirige la défense vient d’être mis au courant de la communication téléphonique avec Madrid par Moscardó lui-même.
Que tous descendent donc aux étages inférieurs. Alerte aérienne ! Il s’agit d’être prêt au moindre signe d’alarme. Quelques hommes resteront là-haut pour guetter. En même temps quelques patrouilles avanceront pour surveiller les grandes routes.
Il y a de la nervosité dans l’atmosphère, c’est l’ambiance qui précède le combat, l’inconnu.
Les jeunes soldats n’ont point encore participé à une affaire sérieuse. Jusqu’à présent, tout n’a été qu’exercices et jeux. La guardia civil est une formation solide sur laquelle on peut compter, mais avant tout, une troupe de police et qui a fourni ses preuves en tant que telle. Ce qui vient maintenant est plus que du service de police, c’est le combat – c’est la guerre.
Avant que les guetteurs de l’hôpital aient pu constater quoi que ce soit, on fait savoir de l’Alcázar – de par sa situation, excellent poste d’observation – que des avions approchent. Immédiatement les jumelles cherchent dans le ciel, les oreilles redoublent d’attention.
Déjà les guetteurs de l’hôpital entendent le bourdonnement encore faible et lointain de moteurs qui s’intensifie de plus en plus. Dans la lumière éclatante du soleil, il est difficile de découvrir l’oiseau hostile sur le fond miroitant de l’azur.
– Tu l’as déjà, Bernardo ?
– Non.
Si ! là-haut. Au dessus de la bosse, au centre de la colline. Assez haut. Lentement, un puissant biplan descend en spirale, puis tourne sur la ville.
Bernardo sent follement battre son cœur.
Il n’est au service que depuis le début de juin. À présent, cela commence. Tout à l’heure, les premières bombes vont éclater. Tomberont-elles sur l’hôpital ? Ouvrir la bouche et se jeter à terre – voilà ce qu’il a appris. Mais aucune des deux choses n’est nécessaire. Au lieu de bombes, des feuilles de papier descendent, légères et flottantes, comme des mouettes argentées dans les rayons du soleil. Encore une brassée et encore une. Le vent en garde beaucoup et les éparpille à sa guise.
Quelques-unes finissent par tomber près de l’hôpital.
Le colonel Villalba lit la curiosité sur le visage de ses soldats. Les proclamations madrilènes – car il ne peut guère s’agir d’autre chose – les impressionneront-elles ? Il envoie Bernardo chercher quelques-uns de ces tracts. Celui-ci en ramasse une dizaine et revient en courant. En route, il les parcourt du regard : « Folie criminelle d’une poignée de militaires. . . Les généraux vous trahissent. . . Quelques heures seulement et la rébellion sera étouffée. . . Faites prisonniers les officiers, ces traîtres, ces lâches et rendez-vous. . . Vive la République ! »
Bernardo est quelque peu troublé. Traîtres ? Lâches ? Mais déjà il est de nouveau devant Villalba. Comment le commandant va-t-il réagir, se demande-t-il. Villalba prend les feuilles, mais ne daigne pas y jeter un regard. De ses yeux francs et clairs, il fixe ses hommes, déchire les tracts d’une main calme et assurée, lentement, impassible. Et les morceaux sont encore emportés par le vent.
Des nouvelles arrivent régulièrement des postes avancés qui gardent les routes d’accès. L’ennemi reste invisible.
L’après-midi, des moteurs vrombissent encore dans le ciel. Cette fois-ci, il y a trois avions et ils ont une autre charge que le visiteur de ce matin. Déjà les premières bombes éclatent. C’est une sensation désagréable que le sifflement des bombes durant leur trajectoire. On s’imagine qu’elles vont tomber juste à côté, et bien qu’ils aient trois étages au-dessus d’eux encore, les soldats et les guardias involontairement baissent la tête.
Z-z-z-z. . . Boum ! Z-z-z-z-z. . . Boum ! Cela siffle, cela claque, mais les points de chute sont encore très loin. Les avions volent assez haut, ils veulent sans doute rester hors d’atteinte. Mais ceux d’en bas n’ont que des fusils et des mitrailleuses, ce qui ne permettrait pas de faire grand-chose contre les puissants trimoteurs quand bien même ceux-ci se risqueraient plus bas.
Soudain, de nouveau le silence. Les avions disparaissent vers le Nord. Mais pas pour longtemps. Juste le temps nécessaire pour retourner à l’aérodrome de Madrid et prendre à bord de nouvelles munitions. Puis cela recommence. Et cette fois-ci ils visent plus près. D’où savent-ils là-haut que l’hôpital est occupé ? Il paraît être spécialement leur point de mire. Quelques bombes l’atteignent. . . d’autres éclatent dans la cour. . . mais il n’y a pas de victimes. Tous les hommes se tiennent à la cave et Bernardo a déjà cessé d’avoir un frisson à chacun de ces sifflements et à chacune de ces détonations si infernalement proches.
Plusieurs fois encore, les avions font leur navette jusqu’à ce qu’une dernière fois ils disparaissent vers le Nord pour ne plus revenir – au moins pour aujourd’hui. Paisible et claire, la nuit arrive et ses ombres apportent le calme et le silence.
Ils arrivent
À quatre heures du matin, les patrouilles envoyées en reconnaissance rentrent dans la cour de l’hôpital sur leurs motos.
Ils arrivent ! Les miliciens rouges !
D’ici une heure ils peuvent être là.
– Au jugé, combien sont-ils ?
– Autant qu’on a pu le constater, environ deux mille hommes.
Immédiatement Villalba communique ce rapport à l’Alcázar, en même temps qu’il donne le signal d’alarme.
De l’hôpital, on est maître de la route qui vient de Madrid, mais sur quelques centaines de mètres seulement ; au delà elle disparaît derrière une élévation du terrain.
L’ennemi profitera sans doute de l’aube pour tenter une attaque par surprise.
Mais ils se trompent, pense Villalba.
Quelques avant-postes sur la route jusqu’à la hauteur en question !
Les mitrailleuses en position, les cartouchières en place !
Les fusils prêts à tirer !
Ne pas tirer pourtant avant que la mitrailleuse placée à la troisième fenêtre ouvre le feu.
Au dernier étage Bernardo est posté, avec quelques camarades, à une fenêtre qui donne sur la rue, abrité derrière quelques sacs de sable. Il épaule son fusil qui déjà n’est plus au cran d’arrêt. Ses doigts tremblent légèrement. Est-ce le froid dans ce brouillard du matin ? Est-ce parce que, maintenant – pour la première fois – il va tirer sur des hommes ?
Ses yeux percent, au dehors, la pénombre qui peu à peu s’éclaircit, se fixent sur le coteau d’où les milices rouges doivent dévaler.
Tout est tranquille, la rue, les arbres. Là-haut sur la crête un petit tas de terre, une grosse pierre. Était-ce déjà là tout à l’heure ? Bernardo aiguise son regard. Non, c’est un homme, car maintenant cela bouge. Il a dû longuement y rester aux aguets. Un autre encore, puis d’autres de-ci, de-là. La hauteur toute entière s’anime soudain.
C’est l’ennemi. Bernardo énervé chuchote à ses camarades : « Les voilà ! » Mais ceux-ci ont également observé le mouvement et épaulent à leur tour.
Silence angoissant. Des secondes qui semblent ne point passer. L’ennemi approche. Pourquoi ne tirons-nous pas encore, se demande Bernardo. Le commandant ne les aurait-il donc pas encore découverts ? Ils avancent de plus en plus. Il faudrait se renseigner.
– Oye, Francisco ?
Celui-ci sans détourner la tête répond en grommelant à voix basse et sans aménité :
– Que pasa ?
Au même moment un coup de feu déchire le silence lugubre.
À la troisième fenêtre, la mitrailleuse crépite.
Aussitôt Bernardo décharge son fusil presque mécaniquement ; le coup est parti avant même qu’il ait visé. Mais ensuite Bernardo se calme : Charger, viser, feu. Charger, viser, feu.
Dès les premiers coups de feu tous les ennemis là-bas ont disparus de la route. Quelques points sombres et immobiles seulement qui n’étaient pas là auparavant.
Les miliciens ont cherché un abri dans les olivaies qui bordent la route des deux côtés.
Ou-î-î-î. . . à présent les premières balles arrivent de la colline. Après les bombes d’avion de la veille, c’est toutefois un anodin concert de sifflements.
Maintenant les rouges ont également placé une mitrailleuse qui balaie les rangées de fenêtres de l’hôpital. Les coups claquent contre les murs, traversent les fenêtres qui volent en éclats et s’enfoncent dans les cloisons et les plafonds tant et si bien que le plâtre gicle de toutes parts.
En jetant un rapide regard de côté, Bernardo s’aperçoit que l’épaule droite de Francisco est toute couverte de sang. Francisco veut continuer à tirer. D’une main il charge son fusil dont la crosse et la platine sont maculées de sang. Mais lorsqu’il veut décharger il perd connaissance.
Alors Bernardo tire avec plus de calme, plus de sûreté, plus de précision encore.
Les rouges ne tentent pas de nouvelle attaque. Peu à peu le feu s’éteint. Ici et là encore un coup isolé.
Serait-ce qu’ils abandonnent déjà la partie ?
L’arrivée des femmes, le combat et la retraite
À l’Alcázar tout est en effervescence. Le téléphone lance de toutes parts ordres et instructions, reçoit des informations, répond aux questions et inquiétudes.
Les munitions de la fabrique qui, la veille, n’avaient été que provisoirement entreposées sont mises à l’abri en plusieurs points sûrs. À proximité des postes, notamment près du plus avancé, celui du commandement, on répartit de petits stocks de munitions en des endroits protégés afin d’éviter la pénurie au cas où le ravitaillement serait interrompu.
Puis un nouveau problème, plein de responsabilités pour Moscardó. Il aurait permis tout naturellement que les hommes des partis de droite se réfugiassent dans l’Alcázar. Bien que la ville soit encore entre les mains des militaires on a distribué des armes aux travailleurs rouges, et qui alors, pourrait éviter que ceux-ci attaquent brusquement une victime choisie à dessein ? Mais voici la nouvelle question qui se pose : Les familles de ces hommes, des officiers et des membres de la guardia civil devront-elles être aussi recueillies à l’Alcázar ?
La famille ? Oui, Moscardó pense à sa propre famille, à sa femme et ses deux fils. Luis qui a vingt-trois ans et veut se faire ingénieur, et Carmelo, un mince garçon de quinze ans, un enfant encore.
On lui a fait savoir qu’ils étaient dans une maison amie. Il ne peut pas s’occuper d’eux. En ce moment, sa famille c’est l’Alcázar. Certes, que les autres se soucient de leur famille autant que cela est encore possible. Lui, le chef de tous, qui tient entre les mains la responsabilité de tous ne peut et ne doit plus être qu’officier, commandant. Ce qui est en jeu, ce ne sont ni des biens matériels, ni la gloire militaire. Pour lui, Moscardó, il y va de la religion chrétienne persécutée et conspuée par les rouges qu’excitent des agitateurs étrangers et des fautes commises à l’intérieur du pays. Il y va de l’Espagne, du pays, de ses habitants et de sa civilisation, de son histoire et de son avenir. « Dios y Patria – Dieu et Patrie ! » Voilà les biens pour lesquels on va se battre et à lui, colonel José Moscardó, un secteur du front de combat a été confié par la Providence. Un devoir majeur l’appelle ici. Que Dieu protège son épouse et ses deux enfants – ainsi prient et implorent ses pensées et son cœur.
Pendant un instant, Moscardó a oublié qu’un officier attend sa réponse.
Les femmes et les enfants à l’Alcázar ? Une lourde charge. Mais a-t-il le droit de dire non ? Hier déjà, des bombes sont tombées sur la ville. Les avions vont revenir. Combien de temps pourra-t-il d’ailleurs tenir le vaste territoire de la ville avec ses faibles forces et son insuffisant matériel de défense ?
– J’accepte. Veuillez vous occuper de la façon dont on les logera. Ce ne sera pas commode. Il faudra sans doute tous les caser dans les sótanos, les souterrains ; les étages supérieurs n’offrent pas assez de sécurité.
À peine la porte s’est-elle refermée derrière l’officier qu’on annonce que trois avions viennent d’être repérés ; venant du Nord, ils se dirigent sur la ville. Peu après, le sifflement des bombes et le fracas des détonations se mêlent au vrombissement des moteurs.
Le bombardement vise spécialement l’hospital de afueras, point stratégique de la ville.
Et soudain un autre bruit : plus fort, plus sourd. Des canons. Leur but est également l’hôpital.
Avec les jumelles, il est possible de se rendre compte de la situation. Les rouges ont replié leur première ligne derrière les hauteurs, et maintenant leurs obus arrivent.
Les premiers tirs sont trop courts ; leurs coups tombent dans les olivaies où ils labourent la terre et la soulèvent en tourbillons, si bien que pendant un instant elle s’élève à plusieurs mètres comme une fontaine de poussière et de sable, puis s’éparpille lentement dans le vent. Ils éclatent de plus en plus près. Les obus avidement perforent le sol, avancent toujours, toujours. Ils tombent de-ci, de-là : sur la route qui conduit à la ville, sur l’arène. En voici un sur l’hôpital, encore un ! Mon Dieu ! dans quel état doivent-ils être là-bas.
Si seulement nous avions ici une pièce d’artillerie ! On repère avec tant de précision la position de la batterie rouge, dans une forêt à quelques huit kilomètres ! À intervalles réguliers les bouches de feu crachent et ensuite plane juste au dessus un léger petit nuage. Puis un silence de quelques secondes et un obus explose de nouveau, semant de tous côtés son métal meurtrier.
Les rouges ne se sont guère préoccupés de masquer leurs positions. Pourquoi l’auraient-ils fait ? Ils doivent savoir que Moscardó est impuissant contre leurs batteries. Deux pièces de 75 se trouvent bien quelque part dans l’Alcázar, mais hors d’usage depuis longtemps, sans appareil de pointage, il leur reste tout juste encore l’affût et le canon. Cela ne suffirait même pas à effrayer les rouges et bien moins encore à les atteindre efficacement.
*
Moscardó jette un coup d’œil sur la cour intérieure de l’Alcázar. Voici déjà les premières femmes et les enfants. Elles ont fui leurs foyers sans préparatifs. Le feu de l’artillerie déclenché, elles se sont décidées plus vite encore à se réfugier dans les murs protecteurs de l’Alcázar. Deux vieilles femmes aux cheveux blancs traversent la cour d’un pas lent et traînant, l’une d’elle s’appuie sur une canne. Un officier les escorte.
Des mères avec leurs enfants âgés de quatre, cinq et six ans.
Des garçons et des fillettes.
Les épouses des hommes de la guardia civil et d’autres de la bonne société.
Des jeunes filles et des femmes qui préfèrent descendre dans les cachots ténébreux des sótanos, dans la sombre incertitude du sort partagé avec les hommes, que vivre à la lumière et au soleil mais à la merci de l’ennemi qui approche.
Les voici qui entrent sous le tonnerre du canon, dans le vacarme des bombes et des obus qui éclatent, le souci et l’angoisse sur les traits, mais aussi le courage et l’intrépidité.
*
Tout à coup, le feu de la batterie cesse. Maintenant les rouges vont encore attaquer. Oui ! Ce n’est cependant pas un flot humain qui se déverse sur la colline, mais un tank pesant et grondant qui apparaît et emprunte la route qui dévale. Un autre par derrière. Mais déjà le feu clair des défenseurs de l’hôpital reprend, martelant les lourdes plaques des engins blindés. Ceux-ci pourtant – ils sont quatre maintenant – continuent imperturbablement leur route ; de leurs tourelles rondes et des minuscules meurtrières qui vous fixent, tels des yeux méchants, arrive un écho sauvage qui sème la mort.
Rien n’arrêtera donc ces monstres métalliques ?
Plus d’un sent le poids de l’angoisse lorsque les tanks approchent de plus en plus, semblables à des géants aveugles et carapatés qui suivent leur chemin sans voir où ils vont et contre lesquels nul ne peut rien.
Soudain le second engin s’arrête. Les deux suivants le rejoignent et s’immobilisent également. Ce géant avait-il tout de même un point vulnérable qui vient d’être atteint par un heureux coup ? Il n’avance, ni ne recule.
Entre temps, la première voiture a continué son chemin. Elle est déjà si près qu’on distingue à l’œil nu le canon de la mitrailleuse dans la fente étroite ; et cette bouche de feu crache la mort et la destruction. À l’hôpital, le nombre des blessés augmente.
À cet instant précis. . . ! D’une porte latérale de l’hôpital deux officiers se détachent en courant, et avant que l’ennemi ait pu braquer son feu sur les deux téméraires, ceux-ci ont lancé plusieurs grenades contre le colosse et ont réussi à se remettre à l’abri.
Rapidement ils préparent la prochaine charge qui pourra être mortelle. Mais le géant aux allures apathiques, qui ne s’aperçoit peut-être que maintenant de ce qu’il a été laissé seul, se retire comme une énorme écrevisse jusqu’à l’endroit où stationnent les autres et, masquant l’équipe de l’engin bloqué, les trois tanks trépidants disparaissent de nouveau derrière les hauteurs.
Mais aussitôt après, là-haut tout se ranime. Se dirigeant vers la gauche, empruntant la pente régulière de la colline, un détachement assez considérable s’avance vers la fabrique de munitions en longeant le cimetière.
Les bons tireurs de la guardia civil postés à l’hôpital le prennent sur le flanc, infligeant aux rouges quelques pertes, mais sans pouvoir arrêter leur marche parce que les légères élévations du terrain et les olivaies leur offrent un abri sûr.
Bientôt cela va changer, lorsqu’à la fabrique de munitions ils ouvriront le feu. La fabrique se tait encore. Les occupants semblent vouloir laisser l’ennemi s’approcher davantage afin de mieux l’avoir dans leur rayon de tir.
À présent les rouges sont à quatre cents mètres.
La fabrique se tait toujours. Puis à trois cents, deux cents. Ciel ! ils dorment donc là-bas !
Environ cent-cinquante mètres encore ! Les rouges attaquent.
– Feu ! Feu !. . .
Un de ceux de l’hôpital lance cet ordre désespéré vers la fabrique cependant beaucoup trop éloignée pour que sa voie tonnante puisse l’atteindre.
Maintenant les rouges sont dans la cour de la fabrique. Pas un coup n’est tiré, tout reste calme.
« Qu’est-ce-que cela signifie », se demandent-ils tous, au comble de l’énervement.
Le commandant Villalba est debout, pâle, les dents serrées. Ainsi quand même !
« Ah ! le traître, le lâche ! » dit-il la gorge sèche.
À peine arrive-t-il à articuler lorsque, au téléphone, il informe le colonel Moscardó du fait que la fabrique de munitions s’est rendue aux rouges.
La voix posée et calme de Moscardó l’apaise.
– Tenez-moi immédiatement au courant de tout changement que subirait la situation.
– À vos ordres, mon colonel.
Comme le commandant raccroche, on lui fait savoir que la fabrique aussi vient d’ouvrir le feu sur l’hôpital. C’était à prévoir. La perte de la fabrique met la situation de l’hôpital dans le plus grand danger car de la fabrique, un peu en retrait de côté, il est possible d’attaquer l’hôpital sur le flanc gauche et à revers. La route qui conduit à la ville peut être prise dans le feu : la liaison avec l’arrière, le ravitaillement en vivres et en munitions sont menacés.
Bientôt les rouges ont reconnu l’avantage de ce changement de situation.
Derechef les obus hurlent, les bombes d’avion sifflent, les mitrailleuses crépitent sur l’avant, sur le côté et à moitié déjà sur l’arrière. Puis, ce sont encore les tanks et les attaques des milices rouges, bien supérieures en nombre. La petite garnison de l’hôpital lutte avec rage et obstination. La piteuse capitulation de la fabrique de munitions qui s’est rendue sans combat ne l’a point ébranlée, mais bien au contraire l’incite à tenir avec plus d’âpreté. À maintes reprises les rouges marchent à l’assaut, mais chaque fois le feu de l’hôpital décime leurs rangs et arrête leur attaque. Ils ne parviennent pas à leur but.
Mais l’hôpital n’est pas une forteresse. En face de l’énorme supériorité des forces ennemies qui déjà l’ont encerclé à moitié, sans possibilité de recevoir des secours de l’arrière, sans abri contre les bombes et les obus, sa position est intenable.
Vers le soir, Moscardó décide la retraite. Tous les blessés sont emmenés, toutes les armes et munitions emportées et l’incroyable se réalise : ils atteignent l’Alcázar sans la moindre perte.
– Los rojos son torpes – Les rouges sont des maladroits, déclare Villalba lorsqu’il annonce à Moscardó la façon dont il a conduit la retraite.
À la même heure, les petits détachements du Miradero et des autres postes sont retirés : tenir plus longuement ces positions équivaudrait à une mort insensée.
À présent, les troupes rouges ont libre accès à la ville. Elles se composent de milices du front populaire et de compagnies de la guardia de asalto, de la police de sûreté dans laquelle le gouvernement depuis longtemps n’a plus guère fait incorporer que des hommes qui lui sont soumis.
Sauvagement, les milices pénètrent dans Tolède. Des poings se dressent en l’air. Des cris fusent : « À bas l’armée ! – Vive la liberté ! » On chante l’Internationale, çà et là même un : « À bas l’Espagne ! ».
Le chef des rouges s’installe dans le palais épiscopal. Au lieu du simple et fruste lit de fer du précédent propriétaire – l’archevêque lui-même n’est pas dans la cité en ce moment – il fait apporter de somptueux lits de bronze.
Les troupes rouges se mettent à leur aise dans la ville. Ils se sentent déjà les vainqueurs. L’Alcázar, ces quelques centaines de mètres de terrain, pouah !. . . bientôt ils l’auront aussi.
En hâte, des barricades sont élevées en plusieurs points, quelques-unes des maisons situées tout autour de l’Alcázar sont occupées, et de temps en temps des coups de feu partent en direction de la forteresse. Des patrouilles sillonnent la ville.
Ce soir-là dans les bars et les cafés c’est la grande vie. La guardia de asalto a plus de tenue, mais les milices rouges ne savent plus que faire. Garçon. . . par-ci, garçon. . . par-là ! Il faut que ça marche pour ces nouveaux seigneurs, messagers de la liberté venant de Madrid et payant avec des bons sans valeur qu’ils ont fabriqués eux-mêmes. On boit et on braille. Quelqu’un monte sur une table pour faire un discours. Des verres se brisent, le vin coule.
– Camaradas, Compañeros. . . Mais sa langue est déjà lourde, si bien qu’il se contente d’un : « Muere el ejercito ! Viva la libertad ! » Et d’un seul coup il vide son verre, puis le lance dans un coin.
*
À la même heure, le téléphone retentit à l’Alcázar.
– Ici Barnés, ministre de l’éducation nationale. Le colonel Moscardó, je vous prie.
– . . . ..
– Bonsoir, mon colonel. Écoutez, je voudrais vous parler à propos de la reddition de l’Alcázar.
– Peine perdue, monsieur le ministre.
– Parlons-en avec calme. Vous n’êtes que quelques hommes à l’Alcázar. Nous pouvons envoyer contre vous des hommes et du matériel d’une supériorité écrasante. Vous êtes impuissants contre les bombardements de l’artillerie et des avions. Il faut bien que vous vous rendiez compte qu’il est insensé de vouloir se défendre. Je respecte vos convictions, votre courage. Mais la résistance de l’Alcázar n’est qu’un coup de tête bon pour des jeunes, sympathique certes, mais voué à un échec.
– Du moment que c’est un coup de tête bon pour les jeunes, monsieur le ministre. . . vous savez que jeunesse rarement écoute les conseils.
– Vous voulez donc que les magnifiques monuments de Tolède soient détruits, que l’Alcázar lui-même, ce fier témoin de la tradition espagnole, soit réduit en ruines ? Vous prétendez lutter pour l’Espagne et vous la démolissez.
– Si vous tenez tant à l’Espagne, monsieur le ministre, et aux monuments de son histoire, vous n’avez pas besoin de détruire quoi que ce soit, sans abandonner pour autant votre lutte contre nous. Vous pouvez nous avoir par la faim.
– Mon colonel, laissez-vous donc convaincre.
– Je n’ai plus rien à dire.
La conversation est terminée.
L’organisation
Pas de repos cette nuit-là dans l’Alcázar. Il héberge environ mille sept cents personnes en ses murs : plus de cinq cents femmes et jeunes filles ; cinquante enfants ; un certain nombre de vieillards qui ne sont plus aptes au combat et d’autres hommes à qui l’instruction militaire fait défaut.
Les troupes qui pourront réellement combattre comptent huit cents hommes.
D’ici le matin, la défense devra être réorganisée, car depuis la retraite elle doit être envisagée sous un tout autre aspect. Il est à prévoir que l’ennemi attaquera encore le lendemain, et alors dans le vaste et compliqué réseau de défense il ne faudra pas qu’il y ait la moindre lacune.
L’entrée principale de l’Alcázar située sur le côté nord, donne sur une assez grande place vers laquelle grimpe en forte pente ce qu’on appelle le « chemin en Zigzag » tandis que la véritable rue d’accès partant de la plaza Zocodover va tout d’abord vers le Sud, puis oblique brusquement et monte en une large rampe en longeant l’Alcázar en direction nord jusqu’à la hauteur de la place. Celle-ci est en partie constituée par un terre-plein artificiel et à l’Ouest où elle domine presque verticalement la rue, un étroit corridor souterrain venant de l’Alcázar passe sous elle et ouvre ses fenêtres latéralement sur cette rue située plus bas. Dans ce corridor est placé un détachement de civils armés composé de membres de l’acción popular et de traditionalistes. La tour d’angle de l’Alcázar située du même côté reçoit un détachement de membres de la falange espanola, la phalange espagnole.
Les quatre immenses façades de la forteresse sont garnies chacune d’environ cent cinquante hommes de la guardia civil. L’effectif de la compagnie de soldats est porté à cent hommes grâce aux membres de la guardia civil qu’on lui adjoint. Quatre groupes de vingt-cinq hommes sont formés dont deux occupent le poste de commandement, tandis que les deux autres sont placés dans le bâtiment de la compagnie qui se trouve au côté opposé de l’esplanade, c’est-à-dire au Sud, derrière le manège.
Le détachement des soldats de l’escuela de gimnasia qui ont participé au combat à l’hôpital, bénéficient pour le moment d’un bref repos.
Les officiers et les cadets sont répartis sur des points de commande et d’observation et postés aux mitrailleuses. Les principaux services de l’intérieur, comme le ravitaillement en vivres et en eau, sont également confiés à des officiers.
Les femmes et les enfants sont logés dans les caves, à deux étages en dessous de la cour, formées partie par de longs corridors voûtés, partie par des locaux carrés. Les pièces qui se trouvent à l’intérieur ne sont éclairées qu’à l’électricité ; celles qui sont situées vers le dehors, celles surtout qui donnent vers le sud reçoivent parfois une parcimonieuse lumière du jour, car le rocher sur lequel l’Alcázar est construit s’abaisse vers le sud, de sorte que les caves profondément installées sous le niveau de la cour captent le jour par quelques lucarnes. À l’exception du portail principal, les autres entrées de la forteresse se trouvent en contrebas d’un étage par rapport à la cour intérieure. Sur la façade sud, près de la puerta de Capuchinos, la porte des Capucins, on aménage des locaux pour recevoir les blessés ; car ce côté est le plus sûr étant donné que la configuration du terrain n’y laisse point prévoir d’attaques de l’ennemi et que les bombes et les obus ne pourront guère causer de ravages en ce point.
Ensuite on élabore des plans et on fait des préparatifs en vue d’assurer pour les jours suivants le ravitaillement des mille sept cents personnes. On désigne des porteurs de vivres pour chaque troupe, on choisit des femmes qui iront chercher les repas pour un nombre déterminé de femmes et d’enfants, afin qu’il n’y ait pas trop de bousculade à la cuisine qui ne se trouve pas à l’Alcázar même mais entre la forteresse et le bâtiment de la compagnie et à laquelle on accède par un corridor couvert, le « paso turbo ».
Par ces multiples mesures préparatoires on cherche à prendre les devants pour les temps proches des combats. La nuit se passe dans leur exécution.
Les premiers morts
Il fait à peine jour lorsque les assaillants rouges ouvrent le feu sur l’Alcázar.
Tout d’abord il ne s’agit que de tireurs isolés qui surveillent le front ennemi et qui mettent en action leurs fusils ou leurs mitrailleuses dès qu’ils voient bouger quelque chose.
Dans le langage des militaires et du peuple, on appelle ces tireurs « paco ». C’est là une abréviation populaire du nom Francisco. Mais le nouveau sens de ce mot a été rapporté par les soldats des luttes marocaines de 1909, car dans ces régions montagneuses, les coups isolés résonnaient à quelque distance : pa–co, pa–co. Et cette façon de tirer toute entière se nomme « paqueo ».
Les « pacos » rouges doivent s’être postés au bon endroit ; car sitôt que quelque chose se déplace à une fenêtre de la façade nord de l’Alcázar leurs balles sifflent ; et ils sont loin d’avoir mal visé.
Plusieurs vitres sont déjà brisées et les cloisons derrière les fenêtres présentent les premières traces de balles.
Dans la tour nord-ouest, le capitaine Serrano se tient près des hommes de la phalange espagnole.
– Où diable peuvent-ils être, ces pacos ? Nicolás, passe-moi les jumelles.
Nicolás, jeune phalangiste dont la mère a une boucherie en ville, s’est enfermé avec les autres dans l’Alcázar afin de combattre pour la liberté et l’avenir de l’Espagne. Il a déjà scruté les toits des maisons qui se trouvent à proximité ; à présent, il passe les jumelles à son capitaine.
Serrano examine minutieusement chaque toit, chaque fenêtre ; mais là en face, dans les premières rangées de maisons, les pacos ne peuvent pas s’être postés. Tout y est calme et mort, abandonné par les habitants et non encore occupé par les assaillants.
Les tireurs doivent se trouver plus loin. Il y en a un surtout qui tire avec une sûreté et une précision épouvantable. C’est à lui que Serrano en veut. Le capitaine est lui-même un tireur émérite et la passion du combat commence à l’animer. Il y a peut-être moyen de découvrir quelque chose du sommet de la tour. Serrano monte jusqu’à la plus haute fenêtre, suivi de Nicolás qui tient son fusil à la main. Avec les jumelles le capitaine fait le tour des toits plus éloignés.
Là, sur celui de l’hôtel Castilla, à l’abri derrière quelques sacs de sable, une mitrailleuse et deux hommes. C’est sûrement eux.
– Nicolás ! chuchote Serrano comme si ceux d’en face pouvaient l’entendre, et d’un geste de la main qu’il porte en arrière, il demande le fusil.
Il lève la tête un peu au-dessus du rebord de la fenêtre afin de pouvoir épauler et viser. Un sifflement, une brève rafale de balles, et le capitaine Serrano se renverse sur les genoux de Nicolás qui s’était accroupi pour se mettre à l’abri. Il n’avait pas eu le temps de dire un mot.
*
Quelques minutes plus tard, la seconde victime.
Le capitaine Badenas voulait se rendre compte de la position des rouges sur la plaza Zocodover et les maisons attenantes. Sur la place principale devant le grand portail de l’Alcázar, on avait, la veille, dressé une petite barricade, tout là-bas au bord du parapet où la place tombe en pente raide. Pendant quelques secondes, la porte principale de l’école est ouverte, et en grandes enjambées le capitaine Badenas traverse la place et se jette derrière la barricade. De là, il a une vue complète sur la place Zocodover. Les rouges ont occupé toute une rangée de maisons et y ont muré les fenêtres jusqu’à mi-hauteur avec des sacs de sable et des matelas, de sorte qu’à présent ils peuvent tirer à travers les petits interstices des sacs tout en étant à l’abri. En bas, sur la place Zocodover ils ont élevé une énorme barricade faite de pavés et de sacs de sable, et il semble qu’ils y ont placé une mitrailleuse. De cette barricade, ils peuvent tenir la rue de l’Alcázar jusqu’au point où celle-ci oblique vers le Nord.
– Là, les rouges ont fait du bon travail, murmure Badenas. Car une sortie de l’Alcázar sur la place Zocodover peut être arrêtée immédiatement de cette barricade.
Il s’agit de retourner maintenant !
Mais les tireurs rouges avaient remarqué la course de Badenas vers la barricade. À présent ils arrosent son chemin de balles, et plusieurs fois atteint, le capitaine tombe dans l’étroite fente du portail que lui avaient ouvert ses camarades en attente. Il peut tout juste encore, d’une langue défaillante, raconter ce qu’il a vu.
Un dernier « Sainte Mère de Dieu ! » et la mort a fait sa seconde victime.
Guzman, el Bueno
Les chefs rouges se sont réunis en conseil.
La veille au soir, lorsqu’ils étaient entrés dans la ville, ivres de la joie d’une victoire prochaine et du vin bu en abondance, les choses avaient un tout autre aspect. À présent la lumière du jour les dégrise : devant eux il y a l’Alcázar, ce bloc puissant dont les tours et plus encore les hommes seront vaincus par la lutte seulement et non par des discours et des fanfaronnades. Et quand bien même la ville tout entière crierait « Muere et ejercito ! » cela n’ébranlerait ni l’Alcázar, ni ses défenseurs.
Ils se sont donc réunis pour discuter de la manière dont il faut procéder.
On est quelque peu pressé d’aligner des victoires, car le peuple en révolte et sans cesse surexcité en réclame chaque jour. Et d’après ce que racontent les journaux, les rouges se sont, au fond, déjà emparés de l’Alcázar. À présent il faut qu’ils se hâtent de faire suivre les victoires aux nouvelles qui les annoncent.
Le chef est appelé au téléphone.
– . . . ..
– Comment ! C’est vrai, ça ?
– . . . ..
Quand avez-vous pris cet oiseau ?
– . . . ..
– Votre groupe aura donc, à titre de récompense exceptionnelle, une bouteille de Rioja par tête. À mon compte, c’est-à-dire, contre des bons, comme bien vous pensez. Et amenez-nous tout de suite le fiston !
Le chef quitte la pièce en se frottant les mains. Aux regards qui le questionnent :
– Une surprise, camarades, une belle surprise !
Bientôt, il est de retour.
– Camaradas, ce soir l’Alcázar est à nous !
Tous lèvent la tête.
– Comment veux-tu faire cela ?
– Un moment de patience. J’ai mon petit plan. Un seul être va nous le conquérir.
Les autres hochent la tête sans comprendre.
Les gardes annoncent trois miliciens avec un prisonnier.
– Faites toujours entrer.
Fusil en main, les miliciens pénètrent dans la pièce, le prisonnier au milieu : un jeune homme bien bâti, d’une vingtaine d’années.
– Dis donc, comment tu t’appelles ? lui demande le chef.
– Luis Moscardó. La réplique tombe ferme et fière des lèvres du jeune prisonnier.
– C’est toi le fils de cette canaille qui est là-haut à l’Alcázar ?
– Mon père est le colonel José Moscardó, gouverneur militaire de Tolède.
– Dis donc, un peu de modération. Tu ne nous en imposes pas avec ton « colonel », et quant au gouverneur militaire de Tolède, c’est moi qui le suis à présent, et ton père est bien obligé de se contenter du petit reste que je lui ai laissé provisoirement. . . Reconduisez le prisonnier. Mais veillez à ce que le gamin ne vous échappe pas.
*
La fière histoire de l’Espagne nous raconte :
. . . En ces temps là – les Espagnols catholiques luttaient dans leur pays contre les Maures, adeptes de l’Islam – vivait Guzman, un chevalier d’Espagne.
Son épée était forte et tranchante et lorsqu’elle étincelait avant de s’abattre en sifflant, les ennemis étaient saisis de frayeur. Son courage était inégalé, sa bravoure admirée par tous les guerriers. Le peuple l’aimait pour son esprit juste et son cœur joyeux.
Un jour les Maures réussirent à encercler Guzman dans un château-fort et pendant de longs jours ils l’assaillirent avec une masse d’hommes et de matériel de guerre sans arriver à ébranler les puissantes murailles de la forteresse ni le courage, plus puissant encore, de Guzman et de ses guerriers.
Des cavaliers Maures amenèrent le fils de Guzman qu’ils avaient capturé, et le chef des Maures fit lancer dans la forteresse où Guzman se défendait, une flèche à laquelle était attachée une lettre disant que son fils était fait prisonnier et qu’il serait tué si Guzman ne se rendait pas avec ses hommes.
Lorsque Guzman la lut, il s’attrista sur son fils bien-aimé et se mit en colère à cause de la basse perfidie de ses ennemis. Mais il savait qu’il n’avait pas le droit de trahir pour son fils ni la religion chrétienne, ni l’Espagne, ni la fidélité de ses hommes.
Il monta sur les créneaux des remparts qui encerclaient son château-fort et lança une épée dans le camp des ennemis en s’écriant :
– Si vous n’avez point d’épée pour tuer mon fils, en voici une. Mais jamais Guzman ne trahira la cause sacrée !
À partir de ce jour, le peuple surnomma Guzman, le vaillant héros : « Guzman el Bueno, Guzman le bon. »
*
Dans la centrale téléphonique de l’Alcázar, la sonnerie retentit.
Fernandez Cela, le jeune soldat à qui on a confié le poste de téléphone, arrive en rampant et en se tenant prudemment à l’abri, car la centrale est située au Nord, à côté de l’entrée principale. La fenêtre ne peut déjà plus y être fermée, le cadre atteint par plusieurs balles étant à moitié démoli.
Et les rouges sont continuellement à l’affût.
– Mets-moi en communication avec le colonel ! ordonne une voix rauque et brutale.
– Qui désire lui parler ?
– La communication, te dis-je. . . une affaire pressée !
– . . . ..
– C’est vous, le colonel Moscardó ?
– Lui-même.
– Je suis le chef des milices rouges et j’exige la reddition immédiate de l’Alcázar. Votre fils est entre mes mains et je le ferai fusiller si vous ne vous rendez point.
– Vous n’êtes ni soldat, ni honnête homme, car si vous l’étiez vous sauriez que l’honneur d’un soldat n’est jamais amené par des menaces à accepter un compromis. Vous pouvez massacrer non seulement mon fils, mais ma famille toute entière sans que je m’écarte, ne fût-ce que d’un pas, du chemin que me prescrit mon devoir.
– Vous croyez peut-être que ma menace n’est pas sérieuse. Vous allez pouvoir parler vous-même à votre fils. Un instant. . . qu’on m’amène Moscardó.
Dans l’appareil, le colonel entend les pas de son fils qui s’approche.
– Allô, papa !
– Alors, qu’y a-t-il ?
– Rien d’extraordinaire, papa. Ils disent qu’ils vont me fusiller si tu ne te rends pas.
– Tu sais bien ce que j’en pense. Et lorsqu’ils te fusilleront, tu recommanderas ton âme à Dieu et tu demanderas à la Sainte Vierge de venir à ton secours. Quand tu entendras le commandement « Feu ! » tu crieras une dernière fois « Viva España ! »
– Dios y Patria, père !
*
Quelques jours plus tard – ni le père, ni la mère ne savent exactement quand – Luis et Carmelo, les deux frères – car les rouges ont également découvert le cadet – traversent à l’aube les rues de Tolède, liés l’un à l’autre aux poignets par une solide corde. Ils sont entourés d’un tas d’hommes armés.
Murmurant des prières, les deux frères marchent à travers les ruelles étroites et tortueuses. Un des chefs rouges rencontre le cortège.
– Où allez-vous avec ceux-là ?
Celui qui conduit la horde fait claquer la langue et esquisse un geste, comme s’il déchargeait un revolver.
Le chef rouge a le front barré d’une ride. Il est partisan de la lutte et de la guerre, mais non du lâche assassinat. Il sait que les autres sont contre lui et que l’aîné a été condamné à mort par un tribunal. Il n’y a plus moyen d’intervenir.
– Mais le plus jeune est encore un enfant. Vous voulez fusiller des enfants ?
D’un pas rapide il s’approche des deux frères et avec la baïonnette d’un des miliciens rouges, il tranche la corde avec laquelle Carmelo est attaché à son frère aîné.
– À présent, tu me suis !
Les deux frères s’embrassent pour un dernier adieu.
– Luis !
– Carmelo ! Tu embrasseras notre mère. . . et notre père et tu lui diras qu’il n’a pas à avoir honte de moi.
Le plus jeune a les larmes aux yeux.
– Luis ! A Dios !
Les frères se séparent.
La horde d’hommes armés continue son chemin jusqu’à l’extrémité de la ville.
Devant un mur, ils s’arrêtent. . .
Au-dessus des coups de feu, un cri clair et aigu s’élance :
– Viva, viva España !
Le cercle se referme
À présent, les rouges ont pris leurs positions.
Les gens qui habitaient tout autour de l’Alcázar ont quitté leurs appartements.
Les maisons à l’Ouest qui ne sont séparées de la forteresse que par la large rampe que forme la rue d’accès, ainsi que celles situées plus haut en arrière, sont occupées par les ennemis.
Les maisons qui se trouvent au Sud ne le sont point, car, trop voisines de la forteresse, elles ne présentent pas une sécurité suffisante. Mais à un peu plus de cent mètres de distance, sur un clocher et sur une place d’où la vue est libre jusqu’aux bâtiments de la compagnie, de puissants postes ont été disposés avec des mitrailleuses lourdes.
Trois autres clochers à l’Ouest et au Nord-Ouest sont occupés de la même façon. Sur l’hôtel Castilla et sur une très haute maison de la plaza Zocodover, il y a également des mitrailleuses lourdes. Et partout, les tireurs rouges avec leurs carabines.
Chaque rue et même les plus petites ruelles qui conduisent à l’Alcázar sont bloquées par des barricades.
Dans l’ancien hôpital Santa Cruz et dans le couvent de la Concepción qui lui fait suite à l’Est et dont les religieuses ont été expulsées, sans que personne sache pour quelle destination, les assaillants rouges ont constitué une sorte de forteresse. C’est là que se trouve le front contre le gobierno militar, poste de commandement.
À quarante mètres de distance, les parties adverses se font face. Nuit et jour, cette position exige un maximum de vigilance. Un unique petit instant d’inattention, et les rouges peuvent faire une brusque sortie par la grande porte de l’hôpital et surprendre les défenseurs du gobierno militar.
– Tire tranquillement, Manuel, tu as tout ton temps pour viser. Place-moi quelques balles dans cette fenêtre-là, juste au-dessus de l’entrée principale. Cette punaise rouge là-haut compte sans doute prendre un bain de soleil, du moment qu’elle sort tellement sa tête. Fais-lui un petit accompagnement de musique.
À moitié baissé, le lieutenant Espigas se glisse de fenêtre en fenêtre et contrôle tout et partout. Les rouges tiraillent comme des fous furieux, et il est obligé de retenir ses soldats pour qu’ils ne répliquent pas à ce feu insensé.
Z-z-z-z-z. . . ! – Z-z-z-z. . . ! Un sifflement passe à côté du lieutenant. Diable ! Cette fois-ci, le coup a failli le frôler. Sur le mur d’en-face, à mi-hauteur d’homme, la chaux s’effrite et tombe à terre.
Derrière les sacs de sable qui le protègent, Espigas se met à genoux, épaulant le fusil. Puis un coup de feu. . . et l’un des fusils qui visait le gobierno militar d’une fenêtre en face, bascule brusquement et glisse ensuite en arrière le long du rebord de la fenêtre.
Bientôt c’est l’heure de manger, on va apporter la soupe.
C’est une chose difficile, car de la cuisine jusqu’au gobierno militar il y a près de quatre-vingts mètres de trajet à travers l’esplanade ; et quelques endroits seulement y offrent de légers abris, tandis que sur l’autre rive du Tage qui se trouve à la même hauteur que l’esplanade, des milices se sont nichées dans des maisons et balaient le parcours.
Mais de la façade est de l’Alcázar on leur fournit un feu bien envoyé. Dans une fenêtre de l’étage inférieur, deux cadets servent une mitrailleuse lourde. Pointée en direction des maisons d’en face et à hauteur de ses fenêtres, cette mitrailleuse entre en action. Quel vacarme et quelle répercussion interminable dans les pièces voûtées. Là-bas, le feu des rouges cesse pour quelques instants, puis il reprend de plus belle. Mais la brève interruption a suffi aux porteurs de vivres pour parcourir près de la moitié du trajet qui les sépare du gobierno militar.
La seconde moitié du parcours est mieux abritée.
Se précipitant d’abri en abri, sautant, rampant, selon que la situation l’exige et pour autant que les marmites pleines le permettent, environnés du sifflement des balles, ces valeureux avancent.
Ping ! ping !. . . une balle vient de perforer une des marmites, heureusement près du bord supérieur si bien que rien ne coule.
Enfin ils ont réussi leur coup. Et vingt-cinq soldats affamés se jettent sur le « cocido », une espèce de ragoût de pommes de terre, de légumes et de viande, plat très apprécié en Espagne.
Puis c’est le tour des autres vingt-cinq hommes qui défendent le gobierno militar.
Les deux cadets aussi font leur pause de midi, et dévorent leur « cocido ».
– Pendant combien de temps allons-nous bien rester ici ?
– Quatre à cinq jours, à mon avis.
– Combien ? demande le capitaine Mira qui vient de les rejoindre. Cinq jours ! Mais ce n’est qu’alors que l’affaire commence pour de bon, mes jeunes amis, vous pouvez m’en croire. . . Mais que cela ne nous coupe pas l’appétit. Et tirez toujours proprement comme je vous l’ai appris.
La nuit
C’est la nuit et le silence. . . çà et là seulement, un coup de feu isolé. D’épais nuages voilent la lune et les étoiles, l’Alcázar est enveloppé d’une obscurité totale.
Comme si tout dormait.
Mais aux fenêtres, dans les tours, derrière les parapets, les gardes semblables à des ombres sont accroupis, le fusil chargé, les bandes de cartouches dans les mitrailleuses. Et tout à côté, entassés sur des matelas, des sacs, des sièges d’auto arrachés – les camions qui ont apporté les munitions et qui, vides maintenant, stationnent sur l’esplanade ont fourni un matériel précieux – enveloppés dans une couverture ou une capote, les autres camarades prennent quelques heures, bien brèves, de repos.
Plusieurs dorment ; d’autres sont étendus sur le dos, les yeux ouverts, le regard perdu dans l’obscurité. Les évènements du jour, encore inaccoutumés et étrangers, les empêchent de dormir. De temps en temps une lampe de poche s’allume. Ce sont les veilleurs de nuit qui font leur ronde à travers l’Alcázar, d’une façade à l’autre, d’un étage à l’autre, descendant dans les sótanos où les femmes et lès enfants sont obligés de vivre.
Elles aussi sont sommairement installées sur des matelas. On a fait ce qu’on a pu. Pour un certain nombre de femmes déjà âgées et un peu impotentes et pour une autre, qui est dans un état de grossesse avancée, on a dressé quelques lits de camp en fer qui proviennent des appartements des cadets.
En quelques points, de minuscules veilleuses à huile clignotent de leur flamme trouble. Depuis longtemps l’ennemi a coupé le courant électrique aux assiégés. On entend la lourde respiration des dormeuses, parfois un soupir, un gémissement – la réalité du jour qui se mélange au rêve – une plainte assourdie d’enfant et le chuchotement apaisant d’une mère.
*
Un cortège de six hommes s’achemine vers le manège, dont le toit léger a déjà été éventré par des coups de canon. L’un des hommes tient des bêches à la main ; à deux, les autres portent un lourd fardeau enveloppé de couvertures. Le capitaine Sanz de Diego marche en tête, un falot voilé à la main.
Dans un coin du manège, les hommes déposent leur fardeau. De leurs bêches ils écartent la litière puis commencent à creuser. Deux étroites fosses de six pieds de long et de deux pieds de large. Ils y déposent les fardeaux qu’ils portaient : les morts de la journée, les victimes du combat.
Les hommes se tiennent un instant devant les tombes ouvertes, les mains jointes : une prière pour les camarades morts auxquels ils rendent l’ultime devoir dans le silence de la nuit noire et protectrice.
Puis les bêches s’attaquent à la terre entassée qui, avec un léger bruit, retourne dans les tombes. Là où gisent les morts, la terre forme une petite butte. Une croix étroite s’y dresse, faite de deux morceaux de bois reliés.
Les hommes s’en reviennent, les bêches à la main, le capitaine Sanz de Diego en tête, portant le falot qui éclaire le chemin de sa faible lueur.
Chansons et obus
Il fait à peine jour lorsque les dormeurs sont réveillés. La batterie composée de quatre canons de 75 et placée à trois kilomètres de distance, près de Pinedo, leur lance le tonnerre de quelques salves d’artillerie qui font plusieurs trous dans la façade nord de l’Alcázar.
– Cela ne fait rien, dit un officier à un groupe de femmes qui, le visage angoissé, écoutent le bruit des éclats. Aujourd’hui, les canons sont encore vos réveille-matin, mais bientôt, vous y serez habituées comme au tic-tac de votre montre bracelet.
Il ne faut pas songer à se laver, car l’eau a également été coupée aux assiégés. Et bien qu’il y ait quatre grands réservoirs, il faut, dès le début, ménager ces précieuses provisions, vu le grand nombre d’êtres enfermés dans l’Alcázar. On se frotte le visage et les mains avec des linges mouillés, et par ailleurs, l’eau n’est distribuée qu’en tant que boisson.
Ensuite, on est obligé de faire « cola », c’est-à-dire faire queue pour avoir le café. Dans toute sorte de récipients bizarres qui, à midi et le soir, servent également au repas, on boit le café. Tasses, assiettes, pots, boîtes de conserve, voire même les petits abat-jour métalliques des lampes qui se trouvaient dans les salles d’étude des cadets et les salles de travail des officiers, tout sert à cet effet.
Puis on coiffe et arrange les enfants, on roule les matelas, et comme le feu de l’artillerie a cessé, on peut même se promener un peu dans la cour intérieure de l’Alcázar.
Le ciel est bleu et le soleil brille. Cela contribue au bon moral. Les hommes qui ne sont pas de service descendent également dans la cour pour y voir leur famille.
Les soldats plaisantent avec les jeunes filles.
– Juanita, tu n’es plus la même sans poudre ni fard.
– Personne ne te dis de me regarder !
– Veux-tu que je te cherche un peu de suie pour refaire la ligne de tes sourcils ?
– Dis donc, chez moi là-haut il y a un obus : il nous est arrivé ce matin et il n’a pas explosé. Cela ferait un formidable bâton de rouge.
– Tu ferais mieux de prendre ta baïonnette et de te raser.
Jusqu’à présent, les bombardements n’ont pas fait de dégâts encore dans la cour de l’Alcázar, et déjà on a trouvé un texte humoristique, qui va à merveille sur un air connu. À présent, ils le chantent ou le chantonnent pour leur propre plaisir.
« El patio del Alcázar es particular,
« Cuando le bombardean, no le pasa na. »
. . . . .
Dans la cour de l’Alcázar, c’est épatant.
Malgré les bombes on y est content.
À ce moment-là, les gardes qui observent les batteries ennemies avec leurs jumelles y constatent une recrudescence d’animation.
– Fuego ! crient-ils dans la cour.
Tout de suite après, ils repèrent même un avion.
– Avion !
Tout le monde se précipite dans les sótanos et avant que le premier coup soit tiré, avant que la première bombe éclate, la cour est de nouveau déserte.
Il y a, dans les écuries, environ cent trente chevaux et trente mulets.
Au déjeuner on sert pour la première fois de la viande de cheval.
Le cuisinier l’a fort bien préparée. Avec ça du riz ; le soir, la même chose avec des haricots. C’est plus savoureux qu’on n’aurait pu croire.
*
Les avions et les canons ne leur laissent pas de répit.
Les aviateurs rouges semblent avoir moins de chance au-dessus de l’Alcázar que sur leurs propres positions.
Une bombe incendiaire atteint la tour sud-ouest de la forteresse. Des tuiles dégringolent avec fracas, les poutres en bois du faîte brûlent, mais en arrivant aux puissantes constructions métalliques et aux murs de pierre extérieurs, le feu est bientôt arrêté sans avoir pu faire de grands dégâts.
Quelques autres bombes semblables, par contre, lancées avec moins de précision, tombent dans les maisons situées sur le côté est de la plaza Zocodover. Dans la charpente des toits, le feu immédiatement crépite, saute de-ci, de-là, et bientôt les flammes s’élancent de toutes parts vers le ciel. Des heures durant, les maisons brûlent, personne ne cherche à éteindre l’incendie et ce n’est qu’à grand-peine que les miliciens installés là-bas arrivent à se sauver en emportant leurs armes et leurs munitions.
Les défenseurs de l’Alcázar contemplent le jeu des flammes, faisant fi d’un abri.
Les pacos rouges ne peuvent pas faire grand-chose pour le moment, car le feu et la fumée obstruent la vue et une partie des assaillants est obligée de se réinstaller tout d’abord dans des maisons situées un peu plus en arrière.
– Si les rouges continuent de la sorte, ils finiront par s’expulser eux-mêmes de la ville.
– Tant mieux pour eux. Car si Franco arrive avec ses troupes, ils se trouveront pris dans un mauvais étau. Et ça ne tardera pas de se produire.
– Comment ? Est-ce que vous avez eu quelque nouvelle ?
– Hélas, non ! Notre lamentable boîte de T. S. F. ne prend que Madrid et ce qu’ils débitent comme mensonges n’est pas dans une musette. Hier, ils ont annoncé que nous nous étions rendus.
– Non, sans blague !
– C’est authentique. Je l’ai entendu de mes propres oreilles.
– Mais si Franco entend ça et s’imagine que réellement nous nous sommes rendus. . . mais alors, il se pourrait qu’il ne vienne pas. . .
Le capitaine Alba a exprimé sa pensée presque inconsciemment. Il voudrait bien reprendre ses mots, mais c’est trop tard. Déjà, les autres ont compris et le regardent d’un air étrange.
Les officiers n’avaient pas pensé à pareil effet de cette information mensongère. Si Franco s’imagine. . .
Au pétillement des flammes et au bruit des poutres et des parois qui s’effondrent, un sifflement aigu vient de se mêler. En un éclair ils se jettent à terre ou s’aplatissent contre les murs. Un fracas et une explosion à vous déchirer le tympan. De la terre et des pierres sont soulevées à une hauteur considérable. Un nuage de poussière pénètre par la fenêtre.
– Dis donc, ça ne peut plus être des 75.
Déjà le hurlement reprend, tout, tout près.
– Nous n’y coupons pas, se dit Alba.
Tous s’écrasent comme s’ils voulaient rentrer dans le sol. Un coup sec et sourd : ça y est, l’explosion ! Mais rien ne se produit.
Une légère fumée de plâtre, et de la poussière de pierre emplissent la pièce. Lentement, ils soulèvent la tête, cherchant, les yeux dilatés de frayeur, la bouche grande ouverte.
L’obus s’est vrillé dans le sol et y est resté fiché sans éclater. Une ratée. Mais quel morceau ! Ce n’est plus un obus de 75 ; il a plus du double. Il provient d’une pièce de 155.
Un moment de répit. Puis deux de ces lourds engins arrivent encore. Cette fois-ci, on entend aussi le bruit du coup qui part. Pendant quelques secondes les jumelles explorent les hauteurs d’en face. Puis en arrière, à l’abri. Les obus éclatent en bas sur la place principale. Encore aux aguets. Voici la position. Au coup suivant on aperçoit distinctement la bouche de feu et le nuage de fumée : tout à côté de la batterie des 75.
Immédiatement le rapport : « Deux pièces de 155 près de Pinedo. » Il est important d’en connaître la position exacte. Bien que de l’Alcázar ils ne puissent point répliquer au feu de l’artillerie ennemie, ils ont au moins la possibilité d’observer les départs, et les secondes que met le projectile pour faire sa trajectoire suffisent pour regagner les abris.
À intervalles réguliers, les lourdes pièces font feu. Un obus a pénétré sous le seuil de la porte principale en le démolissant à moitié. Un autre tombe dans la cour, et le déplacement d’air provoqué par son explosion est si fort que le monument de Charles-Quint, fondateur de l’Alcázar, est précipité du haut de son socle. Mais la statue est indemne. La grande horloge placée tout en haut dans le pignon du toit, sur le côté sud de la cour, est brisée et arrachée par un obus.
La cour est parsemée des premiers débris. Le gai refrain du « patio del Alcázar » s’est tu. En bas, dans les ténèbres des sótanos, les femmes et les enfants prient, agenouillés, tandis que les obus hurlent leur sauvage chanson.
Sur le chemin de la mort
Le capitaine Alba n’a plus de repos. Sans cesse la pensée le harcèle que Franco peut croire à la reddition de l’Alcázar.
Les assiégés forment un petit îlot dans le déchaînement d’une Mer Rouge, sans poste de T. S. F., sans aucun moyen de communication, sans la possibilité de faire savoir au monde et au général Franco qu’ils vivent et combattent, inébranlables, fidèles et intrépides, pour Dieu et la patrie.
Lorsque le capitaine a appris la fausse nouvelle de l’Union Radio Madrid, il aurait voulu crier au monde entier : « Mensonge ! mensonge ! » Mais les ondes électriques sont plus puissantes que la force de ses poumons et pénètrent partout, tandis que ses cris se perdraient sans être entendus.
Ce matin, l’avion rouge en survolant la forteresse pour la première fois a fait tomber, au lieu de bombes, des journaux communistes et socialistes afin de décourager les hommes par les nouvelles tendancieuses relatant les victoires des milices.
Une de ces feuilles publiait la photographie de soldats et de guardia civil avançant en rangs de cinq, les bras levés. Un cliché un peu trouble avec un arrière-plan brouillé. Et dessous la légende : « Nous annoncions hier la reddition de l’Alcázar de Tolède, survenue lorsque la garnison rebelle n’a plus pu résister à l’assaut héroïque de nos milices et des guardias de asalto. Notre photo montre la garnison de l’Alcázar quittant la forteresse sans armes, les bras levés. »
Le monde n’est-il pas obligé de croire que cela s’est réellement ainsi passé ?
Alba est soulevé de colère. Il grince des dents, en proie à une rage impuissante.
Alors quoi. . . s’il se mettait lui-même en route ?. . . Il connaît bien le pays par la chasse, car il est un chasseur passionné.
Va-t-il se risquer ? C’est un jeu dangereux qui peut lui coûter la vie. Mais n’est-ce pas la vie de tous qui est en jeu ?
*
Le soir même tout est prêt. Moscardó est d’accord avec Alba quant à son plan. On ne sait pas exactement jusqu’où le général Franco a déjà avancé au Sud. Mais d’après les indications que donnent les journaux madrilènes sur les lieux de combat au Nord, il est permis de croire que les troupes du général Mola se trouvent dans la Sierra de Guadarrama. Le chemin qui y mène, le plus court qui relie l’île de l’Alcázar à un sol ami, traverse les flots tumultueux des troupes ennemies.
On a confisqué les papiers d’un des chauffeurs qui conduisaient les munitions et qui se trouvent maintenant à l’Alcázar, les uns prisonniers, les autres, hôtes forcés que l’on considère avec une certaine méfiance. Parmi les documents, il y a la carte de membre, le « carnet », du parti communiste. Le chauffeur est également obligé d’échanger ses vêtements contre un vieil uniforme militaire.
Bientôt le capitaine Alba a parachevé sa transformation. Un peu d’argent, quelques vivres et pour finir un brassard rouge : à présent, il est le chauffeur Antonio Gomez, membre No 173 du parti communiste, section de Tolède.
Ce qui est dur, c’est de se séparer de sa famille. Les deux enfants sont déjà endormis. Doucement il les embrasse au front. L’un d’eux ouvre les yeux.
– Papa ?
– Chut ! rendors-toi bien vite.
Son épouse est courageuse et forte. Son cœur voudrait bien se briser de douleur et d’angoisse. Mais dans son héroïsme qui souffre et accepte, elle ne le cède en rien à la témérité de son mari. La peur lui serre la gorge et tout la pousse à lui dire de rester, qu’elle préfère, s’il le faut, mourir avec lui dans les cavernes sombres des souterrains que de le voir partir et se risquer à cause d’elle dans les mains de l’ennemi. Mais ce n’est pas seulement à cause d’elle qu’il part ; il y va également à cause des enfants, et de tous les autres.
Il faut donc qu’elle taise sa souffrance, et elle sait se taire.
Lentement, il lui passe la main sur les cheveux et il l’embrasse.
– Adieu, Luis !
– Adieu, mon amour. Soigne-toi bien jusqu’à mon retour, toi et les enfants, afin que je vous retrouve en bonne santé. A Dios !
– Que Dieu te protège !
Sa main tremble comme elle trace le signe de croix sur son front.
*
Une poignée de main silencieuse entre Alba et Moscardó, et sans bruit le capitaine-chauffeur traverse l’esplanade obscure. Il passe à côté des sentinelles qui sont au courant.
– Salud, camaradas ! dit Alba en levant le poing. J’ai bien l’air d’un vrai de vrai, n’est-ce pas ?
– Tout-à-fait ! Nous avons failli tirer.
Ces paroles s’accompagnent d’un rire étouffé.
Il lui faut descendre la pente abrupte à l’Est. Dans l’obscurité, c’est une entreprise difficile, surtout qu’il ne s’agirait pas de faire dégringoler une pierre. Puis en trois enjambées il traverse la route, et remonte un peu le Tage.
Voici le premier obstacle : le pont d’Alcántara. À la tête du pont il y a, près d’un petit feu, quatre sentinelles. Alba ne peut donc pas traverser la route. Il lui est impossible de contourner sur sa gauche, car là se dresse, au sommet d’un mur abrupt, la hauteur où se trouve Tolède.
Il n’y a rien à faire, le seul passage c’est le fleuve. Il entre dans l’eau et remonte lentement le courant du Tage qui, en cette saison, ne charrie qu’une faible quantité d’eau.
Sous l’arche basse du pont, il se repose un moment. Ici, l’eau lui monte plus haut et le courant est plus fort, mais aussi il y est à l’abri de tout regard.
Si les sentinelles rouges là-haut savaient qui se trouve sous eux. Ah ! mais ce n’est que le chauffeur Antonio Gomez, et par-dessus le marché un membre du parti communiste ! Quoi qu’il en soit, on aurait de la méfiance même pour un Antonio Gomez si on le trouvait en pareille position.
À trente mètres en amont, Alba remonte sur la berge. Il continue pendant un kilomètre en longeant le fleuve vers le Nord, puis brusquement il oblique vers l’Ouest. De cette façon-là il a évité Antequeruela et Covachuelas, les deux faubourgs de Tolède où se trouve l’hospital de afueras. Car avec ses vêtements mouillés il ne peut se montrer nulle part et en outre, à Tolède, il pourrait trop facilement tomber entre les mains d’une sentinelle qui connaît le véritable Antonio Gomez.
Antonio Gomez-Alba continue son chemin. Il coupe la route de Madrid à angle droit, passe à côté du cimetière à quelques centaines de mètres au Nord, et rejoint finalement la route de Talavera de la Reina.
La route en pleine campagne ! Tolède se trouve à quelques kilomètres en arrière. Ici, il n’y aura plus de sentinelles rouges. Il emprunte donc la chaussée même, car on y marche mieux et plus rapidement. Entre temps, un petit trajet au pas de course, car bien que la nuit d’été soit tiède, il a froid dans ses vêtements mouillés.
Il évite par de petits détours quelques maisons isolées, situées au bord de la route. Pourtant tout y est tranquille. Il se pourrait que les habitants eussent pris la fuite.
Il a risqué de faire une mauvaise rencontre, lorsqu’à un endroit où la route traverse en plusieurs boucles une région assez accidentée, brusquement les phares d’une auto projettent leur faisceau de lumière. Mais avant que la voiture elle-même ait pris le virage et que les regards de ses occupants tombent en plein sur la route, Alba est étendu dans le fossé. L’auto porte le matricule de Madrid, et un fanion rouge flotte sur son radiateur.
À l’aube, il est à Venta del Hoyo, où la route traverse la rivière de Guadarrama.
Il contourne encore ce petit bourg, laisse la route passer la rivière toute seule et remonté lui-même le cours du Guadarrama. C’est une contrée déserte. Il cherche un endroit propice où il soit au soleil sans risquer d’être découvert par la curiosité de quelque sentinelle ou patrouille. Il s’y couche afin de dormir et de faire sécher complètement ses vêtements. La veille encore, de service à l’Alcázar, pendant toute la nuit en marche, en proie à une tension continuelle, surveillant le moindre bruit, tout cela fatigue.
Quelques heures de sommeil lui font du bien. Au réveil il se réconforte avec les vivres qu’il a sur lui ; et de nouveau en route.
Le soleil est haut dans le ciel. Gomez-Alba rejoint encore une route qu’il pourrait suivre sur un assez long parcours sans s’écarter de sa direction. Va-t-il s’y hasarder ?
Pourquoi pas ? En fin de compte il sera quand même obligé de rencontrer des hommes. Il ne peut pas non plus éviter chaque maison ; à la longue, ses provisions ne suffiraient pas. Il n’était d’ailleurs pas possible d’en emporter davantage, d’abord à cause de la périlleuse descente de l’Alcázar et ensuite parce qu’il en aurait été gêné dans sa marche.
Sur la route il allonge le pas. Tout à coup, il entend derrière lui le ronronnement d’un moteur qui s’approche.
Ah, ah ! Cela va être la première épreuve.
C’est un camion, comme il le constate en jetant un rapide coup d’œil en arrière.
Lorsque la voiture approche, il entend que celle-ci ralentit.
Que lui veulent-ils donc ?
Il s’agit maintenant de les devancer.
Rapidement, Alba se retourne et fait signe, comme s’il voulait arrêter le camion.
– Salud, camaradas !
Et le poing en l’air.
– Qu’y a-t-il ? lui demandent les deux occupants.
– Ne pouvez-vous pas m’emmener ? Et il leur dit être le chauffeur Antonio Gomez de Tolède, pour le moment domicilié à Peguerinos. Il leur raconte en détail comment il a conduit à Tolède un camion de vivres, don spécial des habitants de Peguerinos destiné aux héroïques assaillants de l’Alcázar ; comment au retour, tombé avec sa voiture dans le fossé près de Tolède, il a été obligé de la laisser sur place et de retourner à pied.
Ce disant il agite ses papiers.
Le récit paraît vraisemblable, car les autos démolies ne sont pas chose rare ; on en voit fréquemment au bord des routes.
Tiens, il vient donc de Tolède. Qu’il monte toujours. Ils lui demandent si les rebelles de l’Alcázar ne se sont pas encore rendus.
Il leur répond que ceux de l’Alcázar sont une bande de sacrés gaillards. On leur a fait goûter pas mal de poudre et de métal, dit-il, mais ils ne se sont pas encore rendus.
– Tu ne veux tout de même pas nous dire qu’ils vont résister longtemps encore aux courageux miliciens qui les attaquent ?
– Non, non. . . pour sûr que non ! Je suis persuadé que le siège va bientôt prendre fin.
On traverse un village. À l’entrée, des sentinelles rouges. D’où venez-vous, où allez-vous ? Vos papiers. Puis de nouveau des questions à propos de Tolède dont on veut tout savoir. Et le camion peut reprendre sa route.
Le capitaine Alba est satisfait ; l’affaire marche bien. Entre temps, il s’est copieusement informé sur les positions de l’armée rouge et sur d’autres sujets importants, auprès de ses deux compagnons de route qui viennent de transporter des munitions à Oropesa.
Tout cela intéressera le général Mola.
Vers le soir, ils arrivent dans un petit village. Alba le connaît pour y avoir fait des parties de chasse. Le contrôle s’effectue sans accroc. Ses compagnons veulent passer la nuit dans le village.
Mais lui désire continuer sa route. Il leur dit qu’il est pressé, que sa femme et ses enfants doivent être assez en souci déjà.
Ils insistent pour qu’il dîne encore avec eux.
Alba voudrait bien être seul de nouveau, mais s’il refuse ce repas il pourrait leur venir des soupçons.
Ils entrent dans l’auberge. Quelques paysans, beaucoup de jeunes gens ; des miliciens, le fusil entre les jambes.
Au moment où ils s’approchent du comptoir quelqu’un appelle, dans un coin :
– Hola, mi capitán !
Alba feint de ne rien entendre.
Mais déjà celui qui l’a interpellé s’avance, et aussitôt l’attention des autres est éveillée.
– Mon capitaine, comment allez-vous ?
C’est un traqueur, naguère employé dans une chasse, qui l’a reconnu et qui vient le saluer sans se rendre compte des conséquences de ce geste apparemment anodin.
– Hola, José ! Te voilà aussi. Mais depuis quand suis-je donc capitaine ? Tu veux dire que j’ai toujours été le capitaine de la bande lorsque je passais avec mon camion et que nous buvions à tarir la cave de l’aubergiste ; mais. . .
Alba a pris le traqueur par le bras et fait avec lui, qui est tout décontenancé, quelques pas vers la porte.
Trop tard. Les autres qui se sont aperçus de sa manœuvre l’encerclent. Les miliciens, en proie à l’ennui dans ce misérable petit village si loin du front, s’approchent en se bousculant, leur arme en main.
En le menaçant du revolver, ils forcent le traqueur à dire ce qu’il sait sur Alba.
Tout est perdu.
On ligote les mains du capitaine Alba, et à coups de crosse on le pousse dans l’écurie de l’auberge. Quatre hommes le garderont pendant la nuit.
Le lendemain matin arrivent une demi-douzaine d’autres miliciens, et Alba est conduit derrière l’écurie.
À plusieurs endroits, le sol est rougi : les traces du sang qui l’a imbibé.
Et un peu plus tard, du sang frais et chaud coule sur les marques desséchées.
Dans la forteresse de Tolède, une femme attend son époux, deux enfants leur père.
L’Alcázar attend le retour de son messager.
Attente vaine, infructueuse. Trop tard seulement on comprend ce que la tentative avait d’insensé.
Trigo ! – Pain !
Chaque jour dont le siège se prolonge augmente le bon moral et le courage des assiégés. Les premières journées avec tout ce qu’elles avaient d’inaccoutumé, d’extraordinaire, de nouveau, sont passées. Déjà on commence à s’y habituer : les hommes à veiller, à tirer et à se jeter à terre lorsque les bombes et les obus meurtriers arrivent en sifflant – les femmes et les enfants à vivre dans l’obscurité et le renfermé des sótanos, avec de rapides lampées d’air frais dans la cour, d’où le cri « avion » ou « fuego » les chasse toujours de nouveau, à vivre dans un dénuement presque complet où manque non seulement tout confort mais même les choses les plus simples et généralement considérées comme indispensables.
Mais chez ceux qui sont le cœur et le cerveau de la défense, qui dirigent la vie de cette nouvelle communauté si brusquement formée, en sentent la responsabilité et se soucient de son avenir, un problème sérieux et décisif se pose qui, s’il ne trouve pas de solution, rendra impossible la défense future de l’Alcázar en dépit de toute compétence militaire et de tout courage personnel.
Les vivres !
Où se procurer, à l’avenir, les vivres pour les dix-sept cents personnes ?
Certes, il y a encore assez de chevaux et de mulets, bien que les quatre chevaux abattus chaque jour au début aient dû être bientôt réduits à trois, et ensuite à deux, et que deux obus ennemis qui sont tombés sur les écuries aient tué vingt bêtes. Mais les hommes de l’Alcázar ne peuvent pas se nourrir uniquement de viande de cheval et de mulet ; et les autres provisions sont presque épuisées. Il n’y a plus de pain ; car dès le troisième jour du siège la petite réserve de farine était entièrement employée ; il n’y a plus qu’une très petite quantité de lait condensé qui, copieusement allongé d’eau, est destiné aux blessés et aux petits enfants. Aujourd’hui, huitième jour du siège, les pommes de terre ont touché à leur fin.
Il reste toujours une provision de riz, mais même avec une parcimonie extrême, elle n’ira pas au delà de cinq ou six jours.
Et puis alors ?
Est-ce que, à ce moment-là, le secours sera venu du dehors ? Bien que tous le désirent et l’espèrent, non seulement à cause d’eux-mêmes mais pour l’Espagne à laquelle une guerre promptement terminée épargnerait beaucoup de souffrances, ils n’osent pas escompter une rapide délivrance. Union Radio Madrid, la seule station qu’ils puissent prendre, use de mille truquages, et ils ne réussissent que rarement à filtrer dans les eaux troubles des mensonges de propagande, une goutte claire de vérité toute pure. Mais cette vérité pour réconfortante qu’elle soit, ne leur permet pas de conclure à une proche libération.
Que faire ?
Ce magnifique esprit de sacrifice, cet enthousiasme ardent, cette abnégation totale et ce perpétuel dévouement des dix-sept cents hommes et femmes, seront-ils donc anéantis par la faim ? Mourront-ils d’une misérable faiblesse, non pas de l’esprit ni de la volonté, mais du corps, dépérissant lamentablement dans les coins sombres des sótanos et à l’abri des remparts sur lesquels s’abat la grêle des obus ?
Il faut trouver une issue.
Dans le cerveau des chefs, une pensée germe ; un projet audacieux, téméraire. Mais va-t-il réussir ? Il ne doit pas ne pas réussir. C’est là la dernière possibilité.
Avec les plus forts et les plus adroits des combattants de l’Alcázar, on va mettre sur pied deux bataillons comprenant quatre cent quatre-vingts hommes en tout, chacun de ces bataillons subdivisé en six compagnies de quarante hommes. Munis de grenades et de pistolets automatiques, ceux-ci feront, de nuit, une sortie brusque, surprenant l’ennemi, essayant de le refouler de ses positions et barricades, et de poursuivre les adversaires en déroute jusqu’aux limites de la ville. Il leur faudra repousser alors toutes les tentatives que les milices rouges feront pour reconquérir leurs positions à l’assaut, tant qu’on n’aura pas réussi à dénicher, dans les maisons privées, les magasins et les hôtels, de copieuses quantités de vivre et à les apporter à l’Alcázar.
Quel plan !
Quel courage de mort et quelle inflexible volonté de vie s’y trouvent en même temps. Quel mépris pour une reddition pitoyable et quelle ferme et héroïque décision de tenir.
Tout autour il y a l’ennemi ; tout autour, la mort qui guette. Elle est accroupie derrière les barricades qui obstruent toutes les rues, et dans les fenêtres d’où elle observe chaque pas. Elle est dans les gueules des canons et dans les bouches étroites des mitrailleuses. Elle pleut dans les bombes que lâchent les avions et dans les grenades lancées par des mains rapides ; elle gicle de toutes parts.
L’ennemi est dix fois supérieur de par son nombre, et vingt fois plus fort de par ses positions.
Rien de cela n’arrête les hommes de l’Alcázar dans leur plan.
Le jour et l’heure sont fixés, les positions ennemies à enlever sont repérées, la tactique à suivre est mise au point.
*
– Mon capitaine, il faut que je parle au colonel Moscardó.
– Impossible. En ce moment il est pris par des affaires d’une extrême importance.
– À l’heure présente, il n’y a rien de plus important que ce que j’apporte.
L’homme, un des civils réfugiés dans l’Alcázar, se fait plus insistant.
– Et qu’apportez-vous donc ? Il y a dans les mots du capitaine un certain scepticisme et presque un refus ironique.
– Du pain.
*
La nouvelle arrive au beau milieu des discussions et des préparatifs de la sortie. « Du pain ! » Le capitaine l’annonce au commandant de service. « Du pain ! » Le commandant sans tarder le communique à Moscardó.
– Où ? demande Moscardó.
Le civil entre.
Il raconte qu’une banque ayant l’habitude d’accorder des crédits agricoles, possède deux magasins en ville où elle fait entreposer le blé qu’on lui donne comme garantie des capitaux prêtés. Un de ces dépôts doit se trouver à proximité de l’Alcázar, quelque part sur le versant est, où le rocher domine le fleuve.
– En êtes-vous sûr ?
Il le sait pertinemment, car un de ses parents qui est roulier de son métier, y a souvent apporté du blé ou y est allé en prendre.
*
Prudemment, à travers l’obscurité de la nuit, le commandant Araujo longe en tâtonnant le bord de l’esplanade. Deux hommes le suivent avec une scie et une hache. En face, sur l’autre rive du Tage, on aperçoit des lumières et des lueurs de feu. C’est là que se trouvent les assaillants rouges, et leurs sentinelles observent l’Alcázar. Et quoique rien n’y bouge, de temps à autre ils lui envoient une salve qui déchire le calme nocturne et effraie les dormeurs.
Lentement et à grand-peine, Araujo et ses deux hommes avancent.
Cette chose pointue là-bas, n’est-ce point un pignon, le triangle saillant d’un toit ?
En se retenant avec difficulté le commandant descend une bonne partie de la pente, presque jusqu’à la route, et il s’aperçoit tout à coup que ce n’est qu’une pierre, un rocher dont la forme a trompé l’imagination surexcitée des hommes en quête de la maison.
Ils continuent à longer l’esplanade du Sud au Nord. Et l’impatience des trois hommes augmente de plus en plus.
S’il s’agissait pourtant d’une erreur.
Soudain, dans un coin un peu à l’écart de l’esplanade, ils découvrent quelques marches qui s’enfoncent dans l’ombre. Sur la droite, une masse sombre et anguleuse, mais c’est trop bas pour être une maison. Avec précaution Araujo descend les marches, le revolver au poing. Le voici arrivé, il s’approche à tâtons. Il n’y a pas d’erreur possible : un toit à la hauteur de ses hanches. Il distingue nettement sous ses mains la forme des tuiles. Les rouges se trouvent peut-être à proximité. S’aplatissant contre le mur bas de la maison, serrant son arme dans la main, il tape avec le pied, puis il tend l’oreille dans la nuit. Tout reste tranquille. Encore une fois le même essai, mais un peu plus fort. Cette fois-ci encore, rien ne bouge. Il appelle ses hommes à voix basse ; il longe ensuite lentement le toit un peu incliné du côté de l’esplanade. À gauche, ce toit touche presque le mur abrupt de celle-ci ; à droite, il est possible d’en contourner le coin en tâtant prudemment avec les pieds jusqu’au moment où soudain, sous eux, le sol se dérobe. Voilà ce qui explique ce toit bas. À l’arrière, la maison s’adosse à un rocher – celui sur lequel ils se trouvent – mais le terrain où elle est bâtie est situé à quelques mètres plus bas.
Le commandant se fait passer la hache et s’en sert pour soulever quelques tuiles en évitant tout bruit. Elles ne sont que posées les unes sur les autres ; il est facile de les déplacer.
Pendant une fraction de seconde, il allume sa lampe de poche, le temps d’un éclair seulement, si bien que ce qu’il a vu n’est réalisé par son cerveau qu’au moment où la lumière est de nouveau éteinte. Au lieu de plonger dans un local profond, le regard se heurte à la surface lisse d’un sac bourré. Il le touche d’une main tremblante, y pratique une incision avec son canif rapidement ouvert et ses doigts avides triturent du blé.
Il voudrait pouvoir crier de joie, de façon à se faire entendre de tout l’Alcázar.
– Trigo, trigo ! Estamos salvado ! – Du blé, du blé ! Nous sommes sauvés.
Une vie nouvelle
Quelques hommes seulement étaient au courant de la pénurie des vivres et du souci qui en résultait. La joie provoquée par le salut inespéré est commune à tous.
N’est-ce pas un miracle de la Providence qu’à la dernière heure ils aient trouvé cette maison ? Tous le pensent.
L’entrepôt de blé est rempli jusqu’au toit. Dans la même nuit encore, de nombreux sacs pleins à craquer sont transférés dans l’Alcázar.
Quel blé magnifique ! Les soldats font couler les petits grains jaunes à travers leurs doigts, les mettent dans la lumière et les contemplent, étonnés et joyeux comme des enfants à qui on a fait un cadeau admirable et inattendu.
À présent, ils auront de nouveau du pain.
Mais du grain au pain, le chemin est long.
Comment va-t-on pouvoir moudre ce froment ? Là aussi, la solution est trouvée. Les défenseurs de l’Alcázar ne se laissent intimider par aucune difficulté, et la joie commune donne des ailes au génie inventif et à l’esprit d’entreprise.
Un moulin à main est trouvé. Un homme de la guardia civil a sa moto dans l’Alcázar. On la fait amener, les pneus des deux roues sont enlevés, coupés en lanières elles-mêmes réunies en une seule bande. La courroie de transmission est prête, on n’a plus qu’à la glisser autour de la roue arrière de la moto soulevée et autour de la plaque tournante du moulin.
On fait partir le moteur, on met les gaz, la roue arrière se met à tourner, la courroie tourne. . . et en bourdonnant le moulin « motorisé » se met en marche. L’essence ne manque pas, car on a vidé les réservoirs des camions qui ont apporté les munitions. Le moulin marche pendant une demi-heure, puis s’arrête pendant une heure afin que le moteur se refroidisse et pour qu’on puisse nettoyer le petit moulin. C’est à ce rythme qu’on va tout le jour, de quatre heures du matin à onze heures du soir.
Par ailleurs aussi, c’est une journée joyeuse. Aucun avion dans le ciel. L’artillerie lourde de l’ennemi se tait, les canons de 75 tirent, mais les coups sont si mal visés qu’un jeune cadet déclare :
– Ils tirent aujourd’hui comme s’ils avaient l’intention de ne pas nous atteindre.
– Qui sait ! L’officier qui dirige le feu est peut-être de cœur avec nous, et les rouges l’ont forcé à prendre le commandement. Et maintenant il s’acquitte de sa tâche aussi mal que possible.
– Pourvu seulement que les camarades ne s’aperçoivent pas du jeu.
Ils ont trouvé un ballon, on ne sait où, et déjà deux teams se sont groupés et la moitié de la cour s’est muée en terrain de football. Deux colonnes forment les buts, et hardi, en avant, en plaisantant, en poussant des cris et en se bousculant. Ces jeunes hommes qui, la veille encore, le fusil en joue, étaient tapis derrière des sacs de sable, endurant les rafales de bombes et d’obus, s’adonnent maintenant à leur jeu, oubliant pour quelques instants l’Alcázar, le siège et l’ennemi, et ne paraissent plus avoir d’autre but que de lancer le ballon dans le goal adverse.
Vers le soir, ils s’assoient dans la cour, réunis sous les arcades, et chantent de sauvages chants de guerre et d’ardentes romances andalouses.
La lune et les étoiles les contemplent.
Magie et métamorphose.
Vraiment, sont-ils assiégés ?
*
Le matin du lendemain apporte de nouveau toutes les affres du siège et du combat avec une cruauté terrible, sanguinaire.
Les chansons et les jeux sont oubliés bien que dans les cœurs des hommes recouchés derrière les parapets, et des femmes redescendues dans l’obscurité des souterrains, un léger écho persiste, joyeux prolongement de mélodies gaies.
Les deux pièces de 155 paraissent s’être définitivement tues ; ce sont peut-être les munitions qui leur font défaut. Mais à leur place il y a quatre canons de 105 et le quadruple chœur lance ses hurlements, ses coups de fanfare soutenus par les voix des pièces légères et les sonorités aiguës des fusils et des mitrailleuses.
Avec une rage épouvantable les obus martèlent la façade nord de l’Alcázar.
Le portail principal n’existe plus ; à sa place, un horrible amas de gravats et de décombres qui gênent aussi bien les sorties que les entrées. Le faîte de la tour du Nord-Est est arraché, il y a des trous et des failles dans sa puissante masse. Son pendant à l’Ouest qui protège l’autre flanc du côté nord est atteint en plusieurs points.
Les avions arrivent et lancent leurs bombes. Ils sont parfois deux ou trois grands biplans qui, en l’air, se gênent presque mutuellement ; car l’espace qui fait l’objet de toute cette destruction est bien restreint : guère plus de cent à cent cinquante mètres en long et en large.
Mais le courage combatif des défenseurs reste inébranlable ; et leur volonté de vivre se trouve raffermie et renforcée lorsque, au moment même où tout autour la mort et la destruction sévissent, un enfant vient au monde dans l’obscurité profonde des casemates voûtées.
La nouvelle vole de bouche en bouche, de poste en poste : un enfant est né, une vie nouvelle dans l’Alcázar.
Les hommes se sentent fiers et joyeux parce qu’ils ne sont pas seulement capables de sauvegarder la vie des femmes et des enfants qui se sont confiés à leur protection, mais parce qu’une vie nouvelle a osé naître sous le bouclier de leur courage et de leur vigilance.
Quand le père, un caporal de la guardia civil qui est de garde au sommet d’une des tours, apprend la nouvelle, il crie tout haut vers l’azur du ciel : « Viva ! viva ! – vive ! vive ! » et tire en l’air, en guise de salut, une série de coups avec son pistolet automatique, si bien que les rouges se demandent avec étonnement ce qui peut bien se passer là-haut ; car d’habitude lorsqu’on tire de l’Alcázar ce sont des coups bien visés – beaucoup d’entre eux déjà en ont fait l’expérience !
Le baptême de l’enfant est un moment solennel, plein d’émotion.
Dans la chapelle située dans les caves voûtées de l’aile nord, de petites veilleuses alimentées avec de la graisse des chevaux et mulets abattus brûlent d’une flamme vacillante. Au centre, l’image de la Vierge avec l’Enfant divin dans les bras.
Pendant que les obus éclatent avec fracas et que les avions lancent des bombes sifflantes, Sanz de Diego, le capitaine, verse sur le front de l’enfant l’eau baptismale, et dans le grondement sourd des explosions qui arrive jusqu’à eux, sa voix résonne, claire et puissante, pleine d’une émotion sacrée :
– Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Les gaz lacrymogènes
Les jours succèdent aux jours.
Un obus a mis le feu au manège et la charpente, légère et sèche, brûle jusqu’au ras des murs comme de la paille. Il n’en reste plus que les quatre murailles, elles-mêmes labourées par maints projectiles. À présent, le soleil, la lune et les étoiles peuvent tour à tour contempler les tombes des morts dont le nombre augmente, et les pluies et les vents viennent les saluer.
La tour nord-est s’est effondrée sous les tempêtes d’obus ; disséminés partout, ses débris recouvrent un large espace, et l’aile est, privée de sa tête nord et par là de sa protection, est ouverte à toutes les intempéries, aux obus et aux balles.
Sans répit le feu sévit sur le front nord. C’est un but que l’ennemi vise avec acharnement. Il semble bien que les assaillants rouges aient voulu y pratiquer une brèche pour un assaut précipité et afin de pouvoir tirer dans la cour sans être gênés par aucun obstacle. Le toit est troué de balles.
Des murs chancellent et s’abattent.
Avec une persistance et une régularité opiniâtre, l’ennemi tire sur la forteresse assiégée.
De temps à autre, des heures et des journées où le feu enfle jusqu’à être un ouragan dans lequel toutes les puissances destructrices de la mort se conjuguent pour anéantir l’Alcázar et ses occupants.
Le 8 août est un de ces jours. Le déchaînement ne dure qu’un peu plus d’une heure, mais c’est une heure épouvantable.
Les quatre pièces légères et les quatre lourdes font feu d’une manière ininterrompue. Toujours il reprend et toujours encore : La décharge – la détonation ! La décharge – la détonation ! La décharge – la détonation !
Les mitrailleuses aboient sauvagement, tirant dans les fenêtres, sur les parapets.
Les plafonds et les cloisons d’en face sont trouées, tamisées par des milliers de coups, et sur les murs extérieurs, une couronne formée des traces de balles entoure chaque fenêtre.
Et c’est le vrombissement des avions qui lancent des bombes et des bidons d’essence s’enflammant au moment où ils frappent le sol par le jeu d’un mécanisme spécial.
Et ils lancent autre chose encore qui passe inaperçu tout d’abord mais qui ensuite fait brusquement son effet : les gaz lacrymogènes.
On dispose d’un certain nombre de masques à gaz. On les distribue immédiatement mais ils ne suffisent pas.
La cour tout entière est infestée par ces gaz.
Si les assaillants rouges risquaient une attaque en ce moment, ils réussiraient peut-être, en exploitant l’affaiblissement des défenseurs provoqué par les gaz, à pénétrer dans l’Alcázar.
C’est une situation désespérée.
Mais déjà le remède est trouvé pour nettoyer la cour des gaz nocifs.
Andrés Marín, un civil, chimiste réputé, fait vivement entasser du bois dans la cour et allume un grand brasier. Ainsi l’air se chauffe, et un appel d’air vers le haut est provoqué qui, dans son ascension, emporte les gaz. Peu de temps après, le danger principal est écarté.
Lorsque le feu des batteries rouges s’est tu, ils attendent tous l’attaque brusquée. Les mitrailleuses sont braquées. Tout est prêt pour la réception. Mais en face, rien ne bouge dans les positions ennemies.
– Ils ont bien raison, les rouges. Nous ne sommes pas mûrs encore, dit le capitaine Frejo, furibond.
– . . . et j’espère bien que nous ne le serons jamais, mon capitaine.
– Nous pas, mais eux là-bas le seront un jour, et nous les expulserons.
Soldats héroïques, rendez-vous !
Toujours pas de nouvelles de l’approche des sauveurs. Où peuvent-ils être ? Serait-ce qu’on a oublié les assiégés de l’Alcázar ?
L’inquiétude les tourmente et les mine.
Des soldats montent la garde au gobierno militar. Toutes les vingt-quatre heures ils sont relayés par d’autres qui ont un poste relativement calme dans le bâtiment de la compagnie. Après en avoir joui à leur tour pendant toute une journée, ils remontent au poste meurtrier. En face, l’ennemi est aux aguets dans l’hôpital Santa Cruz situé sur une hauteur et un peu en retrait par rapport à la rue.
Les caves de l’hôpital vont jusqu’à cette rue où elles ont une porte, et c’est derrière celle-ci que l’ennemi s’est mis en position, soigneusement abrité, à dix mètres du poste de commandement.
Malheur au soldat qui imprudemment quitte son abri de façon à être vu par ceux de la cave.
Malheur aussi, toutefois, à ceux qui sont assis là-bas lorsqu’un des soldats de l’Alcázar aperçoit d’eux ne fût-ce qu’une ombre. Parce qu’alors c’est une grêle de coups ; plus d’une fois les miliciens rouges ont été obligés de ramener en arrière un des leurs, le front troué, la poitrine perforée.
Les rouges chahutent dans l’hôpital. Un puissant poste de T. S. F. déverse de la musique, puis des informations : Victoire, victoire, victoire.
Que ce soit bien bruyant afin que ceux de l’Alcázar l’entendent. Mais les assiégés s’en moquent. Depuis le 26 juillet, ils ont, dans l’Alcázar, leur propre journal, paraissant chaque jour, donnant des ordres, des nouvelles de la vie de la forteresse, des devinettes et, avant tout, des comptes rendus détaillés sur la situation des combats en Espagne. Au début le poste de Madrid était leur seule source d’information ; mais ensuite les bricoleurs de T. S. F. ont travaillé et fait des essais en empruntant tout un matériel à la section de physique de l’école des cadets et hier enfin, le 17 août, soudain le haut-parleur lança :
– Attenzione, attenzione, Radio Milano !
– Milan ! l’Italie !
Ce que dès le début ils avaient cru comprendre en interprétant les démentis et les contradictions du poste de Madrid leur est confirmé à présent, clairement et nettement : le mouvement espagnol fait des progrès. La jonction entre l’armée du Nord et celle du Sud s’est effectuée, et le général Franco est à Burgos. Ils ont également pu prendre un poste portugais quoique avec de nombreux parasites, et une fois, bien que tout le reste ne pût être compris, le nom de Tolède retentit.
Quelle joie, quelle jubilation parmi les défenseurs de l’Alcázar.
Que les rouges fassent toujours marcher leur haut-parleur et lancent le venin de leurs mensonges, les soldats sont immunisés contre ce poison. Auparavant déjà, ils l’étaient par leur courage inébranlable et leur ferme résolution de tenir ; à présent, ils le sont doublement depuis qu’ils ont appris ces nouvelles.
– Laissez toujours pérorer la radio rouge.
Mais brusquement l’appareil se tait.
– Ils prennent probablement des nouvelles qui ne nous sont pas destinées, opine Francisco, guéri de sa blessure à l’épaule.
Puis le concert change de genre. Un milicien rouge se met à tirer de sa mitrailleuse sur un rythme bien défini, toujours huit coups, et un arrêt, puis le jeu reprend. Sans viser spécialement, il dirige son feu sur les fenêtres du gobierno militar.
– Angel, sais-tu ce que c’est ?
– Oui, un fou.
– Peut-être bien, il joue en tout cas la rengaine « una copita de ojén ».
Les soldats ont reconnu le rythme et maintenant ils chantent en chœur la chanson en se moquant des rouges. Cela excite manifestement le singulier joueur et les sentinelles rouges ; d’autant plus qu’un des soldats fait danser dans la fenêtre son bonnet de police au bout de sa baïonnette selon le rythme de la chanson.
Brusquement, c’en est fini du piano-mitrailleuse et une sauvage salve traverse la fenêtre, perforant les murs et les plafonds depuis fort longtemps déjà tamisés de coups et où les papiers peints pendent tout déchiquetés, s’agitant dans le vent des fusillades comme des êtres vivants.
Carlos, le plus exubérant de tous, crie en riant du côté des tireurs rouges :
– Une prime au tireur émérite : il vient d’atteindre un somptueux papillon.
Et tous de rire avec tant de bruit et de gaîté que le lieutenant Abejón vient les rejoindre.
– Mais que se passe-t-il donc ? Dites-moi de quoi il s’agit pour que je rie avec vous.
Ils lui racontent le tour de la « copita de ojén » et du papillon. Abejón se réjouit avec eux, mais c’est surtout à cause de leur moral excellent et de leur attitude joyeuse.
– Tenez, j’ai quelque chose pour nous. Cela n’est pas allé sans difficulté. Mais finalement notre magasinier s’est laissé attendrir lorsque je lui ai fait comprendre de quelle façon terrible les rouges nous traitent ici à quarante mètres de distance, si bien qu’il nous fallait, pour une fois, un petit extra.
Ce disant, le lieutenant Abejón tire deux bouteilles de vin des poches de son manteau. On les accueille dans un grand brouhaha.
– Pas si fort, sinon les rouges vont être jaloux et voudront également en avoir.
Il n’y a qu’une gorgée pour chacun. Mais ce n’est pas cela qui importe. Ce qui réjouit ces jeunes soldats valeureux, c’est de voir comment leurs officiers pensent à eux, se soucient d’eux, ne le cédant ni en courage ni en esprit de sacrifice à leurs hommes, mais étant toujours les premiers, pleins d’un élan joyeux.
Les rouges semblent encore vouloir dire quelque chose. À quarante mètres, il est facile de s’interpeller.
– Alors, comment cela va-t-il en face ? Vous savourez toujours vos côtelettes de cheval et vos gigots de mulet ? À présent, nous allons dîner : du bon riz, du filet de veau et du pinard ; ça fait du bien ! Et ensuite, un excellent cigare. (Ah ! depuis combien de temps les assiégés n’ont-ils plus rien à fumer. Les dernières feuilles d’arbre, les derniers paquets de camomille et de tilleul trouvés dans la pharmacie ont été fumés.) Pauvres diables, vous nous faites pitié. Tenez, voilà quelque chose pour vous !
Un paquet de cigarettes tombe dans la rue, à une distance vraiment tentante. Mais si l’un d’eux voulait essayer d’aller le chercher. . . il ne reviendrait pas vivant.
Puis une autre voix, venant de l’hôpital, renforcée cette fois-ci par un haut-parleur :
– Soldats héroïques ! Héroïque guardia civil ! Les officiers sont des traîtres et des lâches qui vous font combattre pour eux. Abandonnez-les ! Faites-les prisonniers, les gredins, et rendez-vous. Venez par groupes de cinq, sans armes. Nous vous donnerons la liberté et vous aurez à manger et à boire.
Le lieutenant Abejón contemple ses soldats d’un regard interrogateur, un léger sourire sur les lèvres.
– Ils vous le disent, ce que je suis.
Sans mot dire, un des soldats saisit son fusil et s’approche de la fenêtre. Un instant plus tard, un coup retentit et au même moment, la voix d’en face se tait.
– Je n’ai malheureusement atteint que le haut-parleur, mon lieutenant ; le brailleur lui-même n’était pas visible, mais au moins ça la lui a bouclée. . .
Abejón reste silencieux et remercie par un simple regard de ses yeux noirs, puis il tire quelques feuilles de papier de sa poche intérieure.
– Tenez, voilà encore pour vous. Ni ça se mange, ni ça se boit, mais cela vous fera plaisir quand même.
Curieux, les soldats entourent le lieutenant. Même Bernardo et Carlos, de garde derrière les fenêtres, tournent la tête pour un instant.
– C’est un cadeau que nous font, à nous tous, le commandant Martinez Leal et Martin Gil, notre musicien : « L’hymne de l’Alcázar ». En voici le texte et la musique. Du calme ! une feuille pour chacun ; sinon, il n’y en a pas assez.
À présent, les héros de l’Alcázar ont leur chant, leur hymne à eux, où ils pourront chanter la gloire de l’Alcázar, leur lutte contre les ennemis de la religion et de la patrie, leur courage indomptable, leur volonté de résister fût-ce au prix de la vie.
À voix haute, l’un d’eux lit le texte :
« Cantemos del Alcázar las glorias de la raza.
Cantemos con orgullo sus rasgos de valor,
a fin de que resurja grandiosa muestra España
con plétora de vida y espléndida de honor.
Luchemos con denuedo
y llenos de vigor ;
rompamos el asedio
con impetu y ardor.
Heróicos militares ! Intrépidos paisanos !
Templemos los aceros al rudo pelear.
Juremos no rendirnos, diciendo a los tiranos,
nosotros a la Patria tenemos que salvar.
Traidores y farsantes
que negais la Religión,
y albergan vuestros pechos
et rencor y la pasión ;
no olvideis que en la contienda
se decide el provenir,
y por eso lucharemos
ya dispuestos a morir.
Esas bombas y granadas
que nos tiran sin cesar,
estallando en nuestro Alcázar,
no lo pueden derribar.
La victoria está cercana
y precisa combatir,
demonstrando a los rufianos
que podemos resistir.
Valerosos defensores del Alcázar !
Viva España ! !
Le texte est lu et relu.
Doucement, hésitant, puis se risquant ils chantonnent l’air. Et soudain cela va. Au rythme de la marche, ils entonnent à pleine voix, en s’adressant aux rouges, l’hymne de l’Alcázar :
La victoria está cercana
y precisa combatir
demonstrando a los rufianos
que podemos resistir.
Viva España ! !
Les assaillants rouges, fous furieux, recommencent le feu pour que, s’ils n’arrivent pas à vaincre les défenseurs de l’Alcázar, ils puissent au moins couvrir leurs chants.
Mais une fois de plus, les soldats lancent dans le feu ennemi leur « Viva España ! »
Le « toast de blé »
Depuis des semaines, les assiégés ne mangent que de la viande de cheval ou de mulet et le pain fait avec le blé trouvé. Le bon petit moulin « motorisé » fait courageusement son devoir ; de son côté, le four fait ce qu’il peut. C’est pourtant un pain dur et sec que fournit le froment insuffisamment moulu et à peine broyé.
Mais ce n’est pas là le plus grand inconvénient. Ce qui est plus ennuyeux, c’est que la production journalière du moulin et du four ne suffit pas pour tout le monde.
Chacun n’a droit par jour qu’à un petit pain mince qui n’a guère plus de quinze centimètres de long.
Pourtant, ce n’est pas le blé qui manque.
Un débrouillard à qui la faim a inspiré de bonnes idées va quérir dans le laboratoire de physique des cadets un antique moulin de pierre qui y figurait comme pièce de musée historique ; puis il pilonne les grains entre les pierres de ce moulin, se fait donner par le cuisinier un peu de graisse de cheval et en confectionne une espèce de gâteau gluant.
Il trouve que c’est appétissant. . . lorsqu’on a faim surtout.
– Le gusta ? dit-il en offrant un morceau à un officier qui passe et qui, étonné et l’estomac vide, se demande ce qu’il peut bien y avoir à manger à une heure aussi inaccoutumée.
– Una cosa muy buena, muy, muy fina : trigo tostado – une très bonne chose, très, très fine : du toast de blé.
Cet exemple fait rapidement école. Un groupe de soldats a réussi à s’emparer du mortier de la pharmacie qui servait auparavant pour toute espèce de mixtures et de poudres. D’autres prennent des obus autant que possible presque intacts – on en trouve tant qu’on en veut – et quelques cailloux en guise de pilon.
– De préférence pas d’obus non éclatés comme pilon ! leur conseille en riant le commandant Lecanda.
Les femmes et les enfants aussi se mettent à moudre. Pour la plupart des cas, le vieux moulin de pierre leur a servi de modèle ; et dans les ruines – cela sert tout de même, les ruines ! – ils se sont procuré des pierres qui font leur affaire, et à présent, on les voit partout au travail.
Les grains sont malaxés et triturés, le chef de cuisine leur fait cadeau d’un peu de cette graisse que les chevaux et les mulets nourris de froment, et dont on continue à tuer deux par jour, fournissent en abondance. Puis, graisse et pâte de blé sont mélangées, cuites et mangées avec délices.
Seules les dents ne trouvent pas du tout que ce soit un délice. Quelle chance que parmi les civils il y ait un dentiste. Il n’a toutefois pas d’instrument, et chaque extraction est une opération cruellement douloureuse. La pauvre victime – ce sont surtout les hommes dont les dents capitulent devant ce pain dur et le toast de blé – est obligée de s’asseoir sur une chaise ; une puissante pince saisit la dent malade et celle-ci est, suivant le cas, arrachée d’un seul coup ou lentement extraite.
Mais là où la faim commande, il faut bien s’accommoder de telles douleurs. Ainsi donc les femmes, les enfants et les hommes continuent à pilonner et à moudre le blé, à y mélanger de la graisse, à faire cuire la pâte et à la manger de bon appétit.
Une excellente idée, que ce « toast de blé ».
Un message de Franco
Les canons des assaillants rouges sont de nouveau au travail. À présent, les deux pièces de 155 qui s’étaient tues pendant longtemps sont encore en action. La tour nord-ouest est à moitié démolie, le toit de la façade nord et le dernier étage, dans sa partie centrale, sont complètement détruits. La plus haute des deux galeries de la cour intérieure sur le côté ouest est aussi atteinte en maints endroits, et dans son dallage il y a de nombreux trous béants si bien que sur ce parcours elle n’est plus praticable.
Il y a quelques jours, on a dû changer la cuisine de place. Jusqu’à présent, elle était restée là où elle avait toujours été : au rez-de-chaussée de la maison des cadets. Mais les batteries ennemies y dirigèrent le feu de leur artillerie lourde, le toit et les étages furent traversés d’obus de part en part, et il n’y avait plus d’autre solution que de transporter la cuisine ailleurs. On la réinstalla sur le grand palier, au milieu de l’escalier qui, de la cour de l’Alcázar, s’élève de quelques marches à l’abri des arcades, puis se divise et monte à gauche et à droite jusqu’à la première galerie.
Mais lorsque les puissants canons de 155 se remettent à hurler et à tonner, que les lourds obus causent des dégâts de plus en plus terribles et que des coups isolés pénètrent profondément dans l’aile sud de la cour où se trouve l’escalier en question, il faut qu’un nouveau changement se fasse. Cette fois-ci, l’on descend dans les sótanos. Là en bas, dans son troisième emplacement, la cuisine sera en sûreté. De toute façon si même ici les projectiles ennemis l’atteignaient, tout serait perdu.
La cour de l’Alcázar est parsemée de décombres. Finies les parties de football. Il n’y a plus que sous les arcades qu’on puisse se promener lorsque les canons se taisent et souvent ils ne le font que pendant un bref moment du jour qui offre alors, aux femmes et aux enfants enfermés dans les caves, l’unique possibilité de prendre un peu l’air et de voir le soleil.
C’est précisément pendant une de ces accalmies. Tous se précipitent vers la cour. Là-haut dans les tours, se tiennent les sentinelles qui observent avec une attention minutieuse les batteries ennemies et scrutent le ciel, du côté nord surtout, d’où arrivent les avions rouges. Ils écoutent d’une oreille tendue si le ronronnement lointain des moteurs ne trahit pas l’approche d’une attaque aérienne. Ces heures de guet pendant lesquelles les femmes et les enfants paraissent pour un petit instant dans la cour sont les plus dures, celles qui impliquent le plus de responsabilité ; car les hommes ont fait le serment de protéger les femmes et les enfants jusqu’au dernier instant, et tant qu’un seul homme sera en vie, il ne leur arrivera rien.
*
Bien au Sud de Tolède vole un biplan, un puissant avion de bombardement. Il se dirige vers le Nord, se tenant à quatre mille mètres d’altitude. Les moteurs vrombissent à vous assourdir, le pilote, l’observateur et celui qui lance les bombes n’arrivent à s’entendre qu’en hurlant ou en gesticulant.
Avec la lunette d’approche, l’observateur fouille l’horizon au Nord. De vastes étendues parsemées de collines passent sous eux.
Soudain, il fait une découverte.
– Tolède ! crie-t-il au pilote qui répond d’un simple mouvement de tête.
Lentement les contours de la ville se précisent dans l’atmosphère vaporeuse.
On distingue nettement avec la lunette perfectionnée l’Alcázar et, un peu à gauche, le clocher élancé de la cathédrale. La chaîne de collines est de plus en plus reconnaissable qui, sur l’autre rive du Tage, entoure Tolède au Sud et, de par son altitude, domine partiellement la ville.
Un mouvement du gouvernail horizontal et rapidement l’avion descend, à trois mille, à deux mille mètres. Plus nette encore, la ville se détache.
Mille mètres. Déjà la terre qui auparavant ne semblait, à l’œil nu, qu’une monotone étendue gris-vert – la terre commence à prendre des formes et des couleurs différenciées.
À présent, l’appareil vole à cent mètres au-dessus du sol.
– Tout est prêt ? demande l’observateur en se retournant.
– Oui, lui répond le bombardier d’une voix tonitruante après avoir vérifié une dernière fois le mécanisme de bombardement.
L’avion de plus en plus s’approche de Tolède, volant si bas que de la ville il ne peut pas être aperçu, car les collines ne permettent pas de voir la campagne qui s’étend au Sud.
*
Sous les arcades, dans la cour de l’Alcázar, les femmes se promènent, se réjouissant d’être à l’air et au soleil. Les enfants se démènent, courent les uns après les autres et s’amusent à toutes sortes de jeux.
Au sommet de la tour, les sentinelles sont à leur poste et montent la garde. Tout est calme aux batteries et dans le ciel.
*
Le formidable avion de bombardement continue sa route. Déjà il est si près des collines qu’on dirait qu’il va les heurter. Au dernier moment seulement le pilote fait brusquement remonter l’appareil. En les rasant presque, il passe les collines.
Tolède est devant eux, et l’Alcázar.
Droit dessus !
– Avion ! avion ! avion ! Les sentinelles lancent leur cri d’alarme dans la cour.
Les femmes et les enfants se précipitent vers les sótanos.
Déjà le vrombissement du moteur est là.
L’avion apparaît au-dessus de la cour de l’Alcázar.
– Lâchez ! hurle l’observateur, et l’autre actionne le levier de la trappe de bombardement.
Quelque chose de lourd, d’étincelant s’abat dans la cour de l’Alcázar.
Un choc sourd que ne suit aucune explosion.
Presque au même moment les rouges déclenchent une sauvage fusillade soutenue par le feu des mitrailleuses, non pas contre l’Alcázar mais contre l’avion. Mais celui-ci a déjà survolé la ville en trombe, il s’élève, s’élève toujours et bientôt inaccessible aux tireurs rouges, il décrit une courbe et retourne vers le midi.
Sous les arcades de la cour, les femmes sont à demi paralysées de peur.
Le projectile gît dans la partie nord de la cour. Va-t-il encore éclater ?
Mais voici que quelques officiers accourent, le commandant Villalba à leur tête. Ils ont compris la manœuvre, ils savent pourquoi les rouges ont dirigé leur feu sur cet avion.
– C’était un des nôtres !
Ils entourent aussitôt la « bombe » étincelante : une caissette en tôle brillante dont la forme s’adapte parfaitement à l’appareil lance-bombes de l’avion. Le choc brutal a défoncé un côté de la caisse, quelques boîtes de lait condensé ont roulé dans la poussière.
– Du lait pour les enfants et les malades !
Un des officiers, levant une boîte à bout de bras, la montre aux femmes qui manifestent leur joie.
– Mais maintenant, les femmes et les enfants immédiatement dans les sótanos et la caisse en sûreté. Qui sait pendant combien de temps les batteries rouges nous laisseront en paix ?
Le commandant Villalba s’impatiente.
Tous descendent dans les caves mais non comme tant de fois déjà dans un état d’oppression ; aujourd’hui ils sont joyeusement excités.
– Un des nôtres !
– Que peut-elle bien contenir ?
– Seront-ils bientôt là pour nous délivrer ?
Et il ne faut pas beaucoup de temps pour que paraisse, ornée d’un en-tête imaginé pour la circonstance, une édition spéciale du quotidien de l’Alcázar.
Chaque groupe reçoit son numéro et dans les caves, entourant les petites veilleuses vacillantes, les femmes déchiffrent « l’édition spéciale » à la faible lueur des lumignons.
Bernardo qui est de garde veille à une fenêtre du gobierno militar. Attentivement il surveille l’hôpital proche, le doigt légèrement appuyé sur la détente de la mitrailleuse.
Francisco se glisse vers lui.
– Dis donc ! Une édition spéciale du journal.
– Il y a quelque chose, rapport à cet avion ?
– Oui. Là, tiens !
– Il faut que je veille, mon vieux. Lis-le-moi !
– Alors écoute :
« Ordre du jour du gouverneur militaire, le 22 août 1936.
« Aujourd’hui, nous avons eu la joie de voir qu’un avion d’Espagne, après un vol héroïque et dangereux, est venu pour nous exprimer l’attachement de notre pays et pour rendre hommage aux efforts que nous avons fournis pour la cause sacrée de notre patrie. Mais cet évènement joyeux qui, dans des jours futurs, sera suivi d’autres, exige de notre part que nous considérions l’avenir avec la certitude du triomphe. Et tous, nous savons ce que cela nous demande : pour obtenir la victoire finale, des efforts nouveaux, plus grands peut-être, seront nécessaires. Et il faut que nous nous y préparions avec le plus grand courage et avec la plus forte volonté de tenir bon, maintenant comme toujours, prêts aux plus grands sacrifices, même celui de notre vie, de cette vie qui ne saurait jamais être mieux offerte qu’au service d’une Espagne future qui sera aussi grande que nos désirs l’appellent.
« Voilà ce qu’attend de vous celui qui regarde comme le plus grand honneur de sa vie le fait d’être votre chef en ces heures historiques.
Le gouverneur militaire :
Colonel Moscardó. »
Puis suit le texte d’une lettre que Franco nous a envoyée.
– Comment ! Franco nous a écrit une lettre ?
– Oui. Et avec ça, toute une caisse de vivres : lait, chocolat, sardines, que sais-je encore.
– Du moment que tu n’as pas de sardines ici, lis-moi cette lettre.
– Fais bien attention :
« Le général en chef de l’armée d’Afrique et de l’Espagne du Sud. Un salut fraternel de cette armée aux intrépides défenseurs de l’Alcázar ! De plus en plus nous nous approchons de vous et allons accourir à votre secours tandis que vous résistez. Dès à présent, nous vous apportons de petits secours. Ayant vaincu toutes les difficultés, nos troupes avancent, anéantissant toute opposition. Vive l’Espagne ! Vivent les courageux défenseurs de l’Alcázar.
Général Franco. »
Alors, qu’est-ce-que tu en dis ?
– Vois-tu, les sardines et le chocolat. . . que les autres les mangent tranquillement. Qu’on les donne aux femmes et aux enfants, ou encore aux blessés. Mais que Franco. . . un instant ! Tu as vu ce sans-gêne !. . . (Une balle siffle et traverse une fenêtre de l’hôpital d’en face.) . . . que Franco, te dis-je, pense à nous et ne nous oublie pas et qu’il nous écrive à nous tous et pas seulement aux officiers. . . vois-tu, ça c’est beau.
Sous la domination rouge
À l’intérieur de l’Alcázar, les défenseurs combattent, les femmes et les enfants supportent. Deux fois par jour tous ceux qui ne sont pas retenus par leur service se rassemblent pour prier, hommes, femmes et enfants. À ces moments-là, les portes de la chapelle sont grandes ouvertes, car elle est trop petite pour les contenir tous, si bien que sur un long parcours du sombre couloir voûté, à peine éclairé par de faibles lumignons, il y a des hommes qui prient debout ou à genoux.
Forte et nette, la voix de l’officier résonne à travers l’obscurité :
– Seigneur, ayez pitié de nous.
Et le grand chœur de ceux qui prient répond avec de multiples voix : voix sonores de la jeunesse, voix douces et harmonieuses des femmes, voix graves des hommes, voix ténues de la vieillesse :
– Christ, ayez pitié de nous.
Ici, véritablement, on prie et on implore. Pour beaucoup, autrefois, dans la monotonie d’une vie calme, sans trop de difficultés, la prière a pu se réduire à un mouvement des lèvres, à une convention. Mais ici elle est redevenue un élan du cœur ; et dans l’union des cœurs, de cette nouvelle communauté de l’Alcázar, naît spontanément la prière commune dans la misère commune.
De l’autre côté, les assaillants rouges, pleins de haine et d’abomination, excités, troublés, aveuglés par leurs propres fautes et celles des autres.
Les églises sont en partie détruites ou incendiées ; d’autres, comme la cathédrale, fermées ; et à l’intérieur des mains sacrilèges raflent les trésors et les emballent en vue d’une fuite éventuelle où il s’agira de les emporter. Ce sont des tableaux, des calices, le grand ostensoir des processions, le manteau de la Vierge et ses couronnes, des trésors de l’art, mais pour le peuple bien plus encore des trésors de piété qui permettent à ses pensées et à ses prières de s’élever et d’aller de l’image extérieure et terrestre vers l’invisible réalité surnaturelle.
Les religieuses ont été expulsées de leurs couvents.
Les milices rouges ont fait irruption dans la paix du cloître de la Concepción et ont fait de celui-ci une place-forte contre l’adversaire qui est dans la forteresse. Passe encore, c’est la guerre. Mais ils veulent davantage : ce qu’ils recherchent, ce sont les trésors, l’argent et l’or ; ce qu’ils haïssent, c’est la religion du Christ et de son Église.
Ils démolissent les autels et les tabernacles dans les chapelles des couvents, ils y arrachent les tableaux et transpercent avec leur baïonnette la face du Christ douloureux et de sa Mère.
Les statues des saints tombent lourdement, et avec des haches on fracasse leurs têtes.
Puis ils se mettent à fouiller et bêcher pour trouver des trésors qui n’ont jamais existé dans le couvent des inoffensives religieuses. Aucune pièce, aucune chambrette, si cachée soit-elle, n’est épargnée. Partout des yeux avides cherchent, dans les placards, les armoires, les bahuts, cherchent de l’argent, toujours de l’argent.
Les chambres sont terriblement dévastées. Dans les blanches cellules où naguère des mains de nonnes rangeaient toute chose à sa place, tout est sens dessus dessous. Des livres, des vêtements, des objets d’usage courant, gisent pêle-mêle sur le sol, éparpillés entre les bahuts ouverts où des doigts fouisseurs ont vainement cherché des objets précieux.
L’avidité et la soif de l’or ne s’arrêtent même pas devant les tombes. Le sol du cloître attenant à la chapelle est formé de larges dalles dont chacune recouvre de sa masse imposante le dernier repos d’un être humain.
Avec des ciseaux et autres instruments de ce genre, ils les font sauter.
– Attention, Vicente, tâche de ne pas me faire tomber la pierre sur les pieds.
– Donne-moi la bêche.
La bêche creuse dans le sol sableux, et il faut peu de temps pour qu’elle heurte quelque chose de solide qui résiste : un cercueil.
Il est bientôt soulevé et posé hors de la fosse. Quelques coups de hache font voler les pauvres planches en éclats.
Voici la mort et son œuvre.
Vicente, milicien de dix-sept ans, se détourne, la gorge serrée de dégoût, le rouge de la honte envahit son visage. Dans son cœur encore bien jeune, il prend conscience de cette brutale profanation. Vicente fuit ses camarades qui se moquent de la mort, bien que demain, après-demain, qui sait, elle s’approchera d’eux tous, ténébreuse et incertaine.
*
Depuis longtemps les prisons de Tolède sont archipleines. Ceux qui, de loin ou de près, étaient de droite, ceux qui étaient mal vus, ceux dont le nom a traversé le cerveau d’un milicien par quelque brève lubie, ont été faits prisonniers. Chaque jour, à midi, des femmes s’approchent de la prison, apportant à manger, les épouses à leurs maris, les mères à leurs fils, les sœurs à leurs frères. Les voici en une longue file – il y en a donc tant que cela qui languissent dans ces murs ! – chacune attendant son tour. Et cela dure parfois pendant des heures.
Des miliciennes, vêtues comme les hommes de salopettes bleues, le revolver à la ceinture, se tiennent à la porte de la prison.
Devant elles, le long cortège qui, lentement, chemine.
– Qui veux-tu voir ?
– . . .
– Bon. Passe. La suivante.
– C’est toi la femme au docteur que nous avons cueilli la semaine passée ?
– Oui, répond une jeune femme au visage pâle que la douleur et le souci ont buriné sans avoir pu toutefois en effacer la noblesse des traits.
– Alors, tu peux retourner chez toi. Ton mari. . . nous lui avons fait faire une petite promenade ce matin.
Le cabas contenant le repas glisse des mains de la jeune femme et tombe par terre. Elle se serait elle-même effondrée si les bras secourables de celles qui la suivent n’avaient point soutenu son corps inanimé !
Encore une femme à qui on a fusillé son mari et à qui une autre femme, avec une brutalité cynique, lance au visage l’horrible vérité. Qui sait si celles qui accourent pour l’aider n’entendront pas, aujourd’hui ou demain, ou dans huit jours, les mêmes paroles : « Ha dado un paseito esta mañana : il a fait une petite promenade ce matin. »
*
Un long cortège serpente à travers la ville : des hommes armés en grand nombre et d’autres, non armés, attachés deux par deux au poignet, et tous reliés entre eux par une corde qui va d’un bout à l’autre de la file. Ce sont des prisonniers à qui on fait faire une « petite promenade », la promenade, la dernière de leur vie.
Ils sont soixante aujourd’hui ; surtout des prêtres. Sur les soixante-dix ou quatre-vingts ecclésiastiques qu’il y avait à Tolède, dans cette chasse à l’homme, tous ont été repérés hormis quatre, et ces quatre seront les seuls à survivre.
Lentement, le cortège s’achemine dans le premier matin. Les rares passants se dissimulent timidement dans des entrées de maison pour attendre qu’il soit passé. Mus par la peur ils lèvent le poing afin de ne pas se faire mal voir des tyrans du jour, qui veulent tout asservir à leur dictature brutale.
Le premier du cortège est Polo Benito, prêtre, doyen du chapitre, administrateur du trésor de la cathédrale, écrivain distingué. C’est un homme affable, plein d’amabilité, grand philanthrope ; il n’a pas, comme tant d’autres, commis la faute de se tenir à l’écart du peuple, cédant à un mauvais orgueil de caste. C’est un bon prêtre, un homme rayonnant de joie qui n’a jamais abordé les hommes qu’en considérant en eux l’être humain et sans leur demander s’ils étaient de droite ou de gauche.
Mais voilà, il est prêtre. Et cela lui vaut la peine de mort. C’est la raison pour laquelle il marche en tête de la colonne. Sa haute et forte stature indique aux autres le chemin extérieur qui mène aux lieux du supplice, tandis que sa voix grave leur montre le chemin intérieur de la mort. Dans le cinquième mystère douloureux, il implore Jésus qui a été crucifié pour nous, et les autres lui répondent par les paroles si souvent répétées dans lesquelles le « maintenant » et « l’heure de la mort » se rejoignent aujourd’hui.
– . . . priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. Ainsi soit-il.
Sur une place, à proximité de la maison du Greco, le cortège s’arrête.
Par groupes, les prisonniers sont fusillés.
Des prières accompagnent chaque salve, les prières de ceux qui vivent encore. Mais leur chœur se fait de plus en plus faible ; leur nombre, de plus en plus petit.
Polo Benito fait partie du dernier groupe. Sa voix soutient celle des autres, elle ne tremble pas. À cette heure qui précède la mort, où tout ce qui est mensonge tombe et ne reste que ce qui est vérité, on entend, avant que retentisse l’ultime commandement « Feu ! » valable à présent pour Polo Benito lui-même, tombant de ses lèvres et venant du plus profond de son cœur, le :
– Seigneur, pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font.
Puis la salve crépite.
Carmelo et sa mère
Lorsque le chef rouge eut sauvé de la mort Carmelo Moscardó, le jeune homme fut conduit à la maison des syndicats. Pendant quatre ou cinq jours, il y jouit de la liberté tout en étant surveillé.
Les miliciens rouges l’emmenaient avec eux dans les bistros, lui donnaient du vin et le traitaient de « hijo del marxismo », c’est-à-dire de fils du marxisme.
Puis un beau jour ils l’entraînèrent à la plaza Zocodover derrière une des barricades, lui mirent un fusil entre les mains en l’obligeant à l’épauler en direction de l’Alcázar. Et c’est ainsi qu’il fut photographié.
« Père, pensait-il, ne te fâche pas ; je ne tirerai pas sur vous, ils feront de moi ce qu’ils voudront. Mais si je me révolte, maintenant que les rouges ne font encore que jouer avec moi, ils me tueront peut-être, et ma mère sera toute seule. »
Sa mère était en prison, depuis des semaines déjà. De temps à autre, il était permis à Carmelo de la voir.
C’était toujours au chef rouge qu’il devait cette faveur.
– Dis, maman, lorsque les troupes seront venues nous sauver, que papa sera de nouveau libre et que les rouges seront faits prisonniers, je lui demanderai de ne rien faire à ce chef. C’est un brave homme.
– Oui, mon petit, c’est ce que nous ferons. . . quand papa sera délivré.
Pour Carmelo, le bref moment passé avec sa mère est chaque fois une consolation. Mais lorsqu’il est encore obligé de la quitter, commencent pour lui de nouveaux tourments.
Pour passer leur temps, les miliciens rouges lui jouent toute sorte de tours, mais ce sont des plaisanteries de brutes qui bien souvent effraient le jeune Carmelo et le remplissent d’angoisse.
– Dis voir, tu crois en Dieu, toi ? lui demande un milicien en le mettant en joue.
– Oui.
Alors le milicien place le canon de son arme presque sur la poitrine de Carmelo et fait des gestes menaçants.
– Et si je tire maintenant, qui te sauve ?
– Dieu, s’il le veut.
– Là, tu te trompes, mon garçon, mais je veux tout de même t’épargner l’essai.
Une autre fois, on lui dit qu’il va comparaître avec sa mère devant un tribunal du peuple.
En face d’une rangée d’hommes assis à une table, Carmelo doit subir un interrogatoire.
– Comment t’appelles-tu ?
– Qui est ton père ?
Comme s’ils ne le savaient pas ! se dit Carmelo.
Mais la séance est rapidement terminée, car les juges sont bien obligés de se rendre compte de ce que cet adolescent de quinze ans ne peut rien avoir à faire avec des projets de sédition quels qu’ils soient.
Les juges ordonnent qu’on l’emmène. Comme la prison est comble, on le conduit à l’asile de fous où il sera gardé prisonnier dans la chapelle.
Carmelo entre dans la demi-obscurité de cette chapelle où la haine des rouges a également sévi.
Il est laissé seul. Un instant plus tard, un infirmier arrive portant deux matelas.
– Deux ? se demande Carmelo.
Quelques minutes encore, et la porte s’ouvre de nouveau.
– Maman !
Sa mère est là.
Elle lui raconte comment elle aussi a été interrogée et comment on a donné l’ordre de l’enfermer ici. Mais il leur serait interdit de recevoir aucune visite ; il fallait qu’ils fussent complètement isolés du reste du monde.
Cela ne sera pas si terrible néanmoins, maintenant que sa mère est là.
Ils sont assis sur les matelas, adossés à quelque banc renversé.
– Comme je suis heureux, Maman, que tu sois avec moi, maintenant. Et bientôt nous reverrons Papa, dès que Franco sera venu.
Doucement, la mère embrasse, sur ses joues pâles et creuses, son fils, le seul qui lui reste.
Des larmes tombent sur les cheveux de Carmelo.
– Maman, qu’est-ce que tu as ?
– Rien, Carmelo.
Mais Carmelo sent bien où vont les pensées de sa mère ; bien souvent les siennes y vont aussi : vers Luis, son frère.
Il ne pose plus d’autre question, mais se contente de caresser les mains de sa mère.
Et ses pensées glissent au rêve.
Il dort.
Le rocher résonne
La lutte autour de l’Alcázar se poursuit sans répit.
Souvent, en une seule journée, soixante-dix, cent, cent-cinquante obus provenant des pièces lourdes et des projectiles d’un calibre plus faible en nombre incalculable. Et tout cela sur l’espace restreint qu’occupent l’Alcázar et ses dépendances, sur l’esplanade, sur la façade nord et la cour surtout.
La façade nord, en sa partie centrale, est maintenant complètement détruite par le feu de l’artillerie – du toit au rez-de-chaussée.
Plus une paroi, plus un mur debout ; tout est en ruines.
Mais ces ruines mêmes protègent les assiégés, car elles s’amoncellent en masses énormes, encombrant la cour et, sur un large espace, la place principale. Ainsi de nouveaux remparts se sont formés, et bien que les obus s’y enfoncent avec une véhémence sauvage, ils s’étouffent dans leur propre travail.
Mais cela n’arrête pas leur besogne ; ils pénètrent de plus en plus profondément dans les décombres, déchiquetant, concassant, finissant par réduire les pierres en poudre.
Il y a des jours où les sentinelles sont obligées, sans interruption, de faire retentir leur cri d’alarme « fuego ! ». Minutieusement, ces hommes observent les batteries ennemies. Pour les sentinelles elles-mêmes, c’est souvent un jeu audacieux : repérer le coup à son départ, donner l’alarme, chercher un abri quelconque et se remettre au poste aussitôt après l’éclatement. Car qui sait si ce coup n’a pas été le dernier et si l’ennemi ne va pas passer à l’assaut.
La destruction que l’artillerie rouge cause dans l’Alcázar est indescriptible, mais les pertes qu’elle inflige aux défenseurs eux-mêmes sont minimes grâce à l’héroïque vigilance des sentinelles.
Après une interruption du feu qui a permis aux femmes et aux enfants de faire quelques pas dans la cour, le signal « fuego ! » retentit encore ; comme à chaque reprise, tous disparaissent dans les sótanos.
Il n’y a que quelques gamins de dix à douze ans qui s’attardent dans l’escalier et passent leur tête entre les petites colonnes de pierre qui bordent la cour du côté où l’escalier descend.
– Voilà un 75, Carlos !
– Pourquoi tressailles-tu, Paco, lorsqu’ils éclatent ? Au fond il y a longtemps que ça ne vaut plus la peine de déguerpir à cause de ceux-là, intervient José.
– Quand j’étais à Barcelone avec mes parents, les pompiers avaient des sirènes qui sifflaient comme ces machins-là.
– Encore un !
– Il n’a pas fait explosion.
– C’est donc un non-éclaté, tu veux dire, José, fait remarquer Paco d’un air de connaisseur et en se vengeant un peu du « tressaillement » d’il y a un moment.
– J’en emporterai un à la maison, de ceux-là, pour que le Vicente d’à côté de chez nous puisse voir avec quoi les rouges nous ont bombardés ici.
. . . Jusqu’au moment où apparaît un officier.
– Espèce de petits galopins, voulez-vous bien enlever votre nez de là ! Et filer vivement à la cave !
Vite, vite, les petits pieds martèlent l’escalier en descendant, et José remarque :
– Je ne sais pas du tout ce qu’ils ont, ces officiers. Nous, ils nous font descendre lorsque nous nous tenons un peu par ici, et eux vont se mettre là-bas devant où tout a été démoli et avec des jumelles ils regardent comment les autres tirent.
En protestant ainsi contre l’injustice du monde la petite bande disparaît dans les caves.
*
Dans les sótanos où il n’y a plus guère de différence entre la nuit et le jour, on distribue le dîner. Aujourd’hui il y a de la viande de mulet et avec ça un morceau de pain : un petit repas bien vite mangé.
Les femmes s’entretiennent encore des dernières nouvelles que le journal leur a apportées. Une colonne de l’armée de Franco est en route pour Tolède sous la direction du colonel Yague. Hier elle s’est emparée des deux villages de Calera et Gamonal. Personne ne les connaît, ces villages, mais grâce aux précisions topographiques du journal et de cartes publiées de temps à autre, elles sont à même de s’en faire une idée. Ces villages ne doivent pas être bien loin de Talavera de la Reina.
Les amis sont donc si près déjà !
Puis tout le monde se couche de bonne heure, car le matin on se lève très tôt lorsque le jour pointe et que reprend le tonnerre de l’artillerie.
À part quelques unes, les petites veilleuses sont éteintes et le calme se fait.
À côté aussi, où sont couchés les blessés, le repos nocturne arrive. Il y a là des officiers, des soldats, des hommes de la guardia civil et des civils.
Les majors et les médecins ont un dur travail.
Certes, les pharmacies de l’école et du gobierno militar contenaient des bandes à pansement, de la ouate, de l’alcool et du chloroforme en quantité suffisante. De même tout ce qu’il faut pour des interventions chirurgicales. Mais dans quelles conditions les opérations elles-mêmes doivent-elles être faites !
Une table ordinaire sert de table d’opération. Il fallait installer la salle d’opération et l’infirmerie dans la partie la plus abritée des sótanos donc dans le coin sud-ouest où la lumière du jour ne pénètre guère. La lueur d’une lampe de poche, deux, trois bougies ou quelques veilleuses qu’alimente toujours la graisse des chevaux et des mulets abattus, sont le seul éclairage possible sous lequel on est obligé de faire des amputations et autres difficiles opérations.
Les médecins ne ménagent pas leurs forces ni leur talent pour sauver la vie de ceux des défenseurs de l’Alcázar qui ont été blessés dans les combats ; et dans de très nombreux cas, ils réussissent dans leurs entreprises. Cinq religieuses qui se trouvent dans la forteresse avec les assiégés et qui se sont chargées des blessés et des malades les aident dans leur travail.
Hermanas de caridad – les sœurs de charité !
Avec une bonne grâce silencieuse et une minutie dictée par l’amour, elles accomplissent leur tâche ; les blessés le sentent et les remercient de quelques mots simples ou d’un regard.
Tout au fond, près du mur, un soldat est couché. Ce matin-même, une balle lui a perforé l’abdomen ; les médecins ont fait leur possible, mais rien n’est encore décidé dans cette lutte entre la vie et la mort et on ne saurait dire de quel côté penchera la balance de cette jeune vie courageuse.
– Ma sœur, appelle-t-il.
– Oui, Rafael ?
– Vous ne pourriez pas me donner à boire ?
– Pas à boire, Rafael ; mais je vais vous humecter les lèvres. . . Voilà. Cela va déjà mieux, n’est-ce-pas ?
– Oui, ma sœur, merci !
À peine quelques minutes plus tard, il appelle encore.
– Ma sœur ?
– Oui, Rafael. Vous ne dormez pas encore ?
– Je ne peux pas dormir. Mais ma sœur, quelle heure est-il à présent ?
– Il doit être autour de dix heures.
– Il fait sombre dehors ?
– Mais naturellement, Rafael.
– Et les canons ont cessé leur feu ?
À ces mots, sa voix trahit une émotion croissante.
– Bien entendu, Rafael. D’ailleurs tout est calme.
– Mais moi, j’entends quelque chose.
C’est la fièvre, se dit la sœur en saisissant le poignet du malade pour lui prendre le pouls.
– Comme un grondement, bien loin, tout, tout loin. . . mais c’est réel et je l’entends.
– Vous êtes énervé, Rafael, et vous croyez entendre quelque chose.
– Non, non, ma sœur. Je suis bien éveillé et lucide. Et lorsque j’appuie ma tête contre le mur, j’entends un bruit sourd comme quelque chose qui vibre.
– Mais là, à côté de vous, il n’y a plus rien, il n’y a plus que le rocher.
– Mais je l’entends quand même. Comme si c’était à l’intérieur du rocher. Tenez, maintenant c’est bien net.
. . . . .
– Ma sœur, allez donc en avertir quelqu’un, je vous prie, un officier, afin que les autres l’entendent aussi et soient avertis.
– Bien, Rafael, je vais le dire.
La sœur elle-même finit par perdre son assurance. Rafael a tant insisté. Il n’a pas beaucoup de fièvre, son pouls est rapide, mais cela a très bien pu être provoqué par l’émotion.
La sœur sort donc et met un officier au courant de l’affaire.
– Ne serait-ce pas une simple divagation due à la fièvre ?
– C’est bien possible. Mais il a peu de température, et il y a surtout ceci : il n’arrive pas à se calmer. Si vous pouviez venir et écouter vous-même. Cela l’apaiserait du moins.
La sœur revient alors avec l’officier dans la pièce où se trouvent les blessés.
De loin, Rafael l’appelle d’un faible signe de la main. Il est tout excité.
– Mon capitaine, quelle chance que vous soyez là. Venez écouter ici, contre ce mur.
– Bien, bien ; nous allons voir ça, lui dit le capitaine en le calmant sans toutefois prendre la chose au sérieux.
Il se penche un peu et appuie son oreille contre le mur.
Qu’est-ce que cela ?
Soudain l’officier a pâli.
Est-ce Rafael qui lui a communiqué sa fièvre ? Est-il trompé par le sang qui lui est monté à la tête lorsqu’il s’est penché ?
Essayons encore une fois, gardons tout notre calme !
Mais en effet : très, très lointain, on entend un bruit, on dirait une vibration souterraine ou le bruit. . . d’une foreuse. À peine s’il a le courage d’aller jusqu’au bout de sa pensée.
Rafael a raison.
Faut-il qu’il le lui avoue ou qu’il l’en dissuade ? Mais alors le blessé ne voudra pas se calmer, car ce bruit de forage existe réellement, on le perçoit très bien.
– Rafael, lui dit le capitaine à voix basse – ils ont éveillé l’attention de quelques autres blessés qui lèvent la tête – tu as raison. Il y a là un bruit. Je vais faire le rapport et nous suivrons l’affaire. Mais pas un mot à personne là-dessus, tu entends ?
– À. . . à vos ordres, mon capitaine, murmure Rafael à qui l’émotion et l’effort ont coupé la respiration.
*
Le colonel Moscardó a réuni un groupe d’officiers supérieurs à l’état-major.
– Messieurs, j’ai une nouvelle grave à vous annoncer. Tout nous porte à croire que l’ennemi tente de miner, au Sud-Ouest, le rocher sur lequel se dresse l’Alcázar et de nous faire sauter.
Un blessé a perçu les premiers bruits de la foreuse. Notre officier du génie et un homme de la guardia civil qui a été autrefois mineur ont étudié la chose et sont arrivés au résultat que je viens de vous communiquer.
Jusqu’à présent, il n’y a aucun danger immédiat, car la galerie de mine n’est pas encore assez avancée, tant s’en faut. Le travail doit être à ses débuts. Le rocher qui est très dur ne laissera pas d’opposer quelque résistance.
Il faut pourtant que nous nous préparions en vue du pire.
En temps voulu, nous prendrons les mesures nécessaires. Inutile d’ajouter que cette affaire doit être tenue secrète aussi longtemps que possible.
Je vous remercie, messieurs.
La lutte pour le gobierno militer
– Manuel, que fabriquent les rouges là-bas derrière ?
– Je l’ignore. Ils font un trou dans la porte. Peut-être pour y placer une nouvelle mitrailleuse. Qu’ils en mettent même deux.
À côté de l’hôpital Santa Cruz, mais ayant sa façade à trente mètres en arrière, il y a le couvent de la Concepción. Dans la partie inférieure de la grande porte de noyer du monastère, la boiserie vole en éclats sous les coups bruyants de lourdes haches par lesquels on la démolit du dedans. Peu à peu l’ouverture atteint un mètre carré ; mais immédiatement elle est refermée par des tas de sable et des planches.
– Est-ce que les rouges seraient devenus fous ? Ce n’est pas une mitrailleuse, mais un canon.
– Nom d’un chien ! À soixante-dix mètres ! Mais il va tous nous mettre en morceaux. . . où est le lieutenant Espigas ?
– Qu’y a-t-il, les gars ?
– À vos ordres, mon lieutenant. Les rouges viennent de placer un canon juste en face, et. . .
Z-z-z-z. . . boum ! Le premier coup ébranle le mur du gobierno militar.
D’un bond, Espigas est à la fenêtre et se rend compte de la situation. En face, une bouche à feu sort de l’ouverture du portail : c’est un canon de 75.
Z-z-z-z. . . boum ! le second coup arrive.
– Fuego ! hurle Espigas, mais à une si petite distance, le coup porte à la seconde même où il est tiré.
Immédiatement, le lieutenant retire ses hommes des fenêtres situées à proximité de l’endroit où ont frappé les deux coups. Jusqu’à présent, aucun des soldats ni des hommes de la guardia civil n’a été blessé. Une chance prodigieuse !
Espigas étudie en suite plus minutieusement la position de la pièce. La porte du couvent est située tout à côté du mur de l’hôpital Santa Cruz qui avance de trente mètres. De ce fait, la partie ouest du gobierno militar est à l’abri des coups de ce canon, car il ne se trouve plus dans le rayon de celui-ci. La partie sud du poste de commandement ne doit guère pouvoir être atteinte ; sur la petite distance de soixante-dix mètres cela nécessiterait un angle de braquage tel que la dimension de l’ouverture ne le permettrait pas.
Aussitôt, son plan est fait.
Chaque fois que le trou s’ouvre et la bouche à feu apparaît, les postes du secteur menacé s’écartent à droite et à gauche. Que l’ennemi, alors, tire tant qu’il voudra.
Puis le lieutenant fait diriger un feu nourri de mitrailleuse sur le canon. C’est un essai ; mais il semble qu’aucune balle n’arrive à pénétrer. Les rouges se sont sans doute bien abrités avec leur pièce.
Pendant plusieurs jours, le canon reste dans la même position et dirige son feu sur le proche gobierno militar. Mais la tactique des assiégés réussit à merveille. La pièce détruit les murs mais aucune vie humaine.
Plus terribles, plus dangereux que toute artillerie, il y a toujours les tireurs rouges. Ils guettent le moindre mouvement qu’ils aperçoivent derrière les fenêtres et y placent sur le champ quelques balles.
Le 4 septembre au matin, le feu atteint une violence sans pareille. Le canon crache ses obus sans interruption. Les mitrailleuses balaient les fenêtres.
Déjà, on signale quelques blessés.
Les rouges, ont-ils une intention spéciale ?
Des grenades à main et des projectiles contenant des matières inflammables sont lancés à travers le soupirail avancé de la cave de l’hôpital. De petits incendies se déclarent, mais on arrive à les étouffer immédiatement. D’autres grenades arrivent de l’hôpital même, causant toutefois très peu de dommages car elles n’entrent que rarement dans les fenêtres.
Tout à coup, l’embouchure d’un tuyau émerge du soupirail et déjà le jet part : de l’essence.
Aujourd’hui, ils veulent nous exterminer, se dit Francisco ; avec une colère sourde il tire en plein dans l’ouverture de la cave et il se rend bien compte que ses coups portent ; des cris brefs dominent le sifflement des balles, et le feu des rouges subit des interruptions. Mais il semble que toujours les miliciens ont recours à de nouvelles réserves.
Un homme de la guardia civil qui combat aux côtés de Francisco tombe brusquement à genoux et s’appuie, inanimé, contre le mur. De sa poitrine un sang clair jaillit sur l’uniforme gris. Francisco frémit : « Voilà le sort qui m’attend aussi. . . » Mais déjà sa faiblesse est passée. « Tire, tire ! » se crie-t-il à lui-même, et ses coups crépitent sans arrêt.
Dès le début de la brusque attaque, Lecanda qui, aujourd’hui, a le commandement ici a envoyé Pablo afin qu’il annonce ce qui est arrivé et demande, avant tout, qu’on leur envoie des réserves et qu’on retire leurs blessés. Il lui faut tous ses hommes pour le combat.
Pablo est le plus jeune des soldats, trompette de la compagnie. Il a quatorze ans. C’est un petit gringalet. Il ne sait pas encore tenir un fusil ; mais il participe à tout, infatigable et toujours là quand on a besoin de lui. Comme un éclair, il vient de traverser l’esplanade prise dans le feu des rouges qui sont postés du côté du Tage. Un petit parapet qui la longe d’un bout à l’autre la protège pourtant mieux à présent ; en rampant on fait le trajet presque sans danger. Mais Pablo trouve que cela dure trop longtemps. Courant tant qu’il peut il traverse l’esplanade sans se baisser. Autour de lui, les balles sifflent, l’une d’elle passe si près qu’il se dit : « Cette fois-ci, je suis bon ! » Mais comme il ne sent rien, il continue sa course jusqu’à l’Alcázar, il y communique son rapport et s’en retourne. Avec un peu plus de prudence cette fois-ci, à l’abri du parapet. Il se présente de nouveau au commandant Lecanda :
– L’ordre est exécuté.
– Mais dis donc, qu’est-ce-que tu as là ?
Lecanda saisit le bonnet de police de Pablo.
– Je ne sais pas.
– Tu as eu de la veine, Pablo. Tu es un gaillard.
Une balle de fusil avait traversé son bonnet. Voilà donc ce que tout à l’heure il avait senti passer si près.
À ce moment, un tank arrive dans un fracas métallique, poursuivant sa route, rapide et irrésistible. Tout à fait comme à l’hôpital de afueras, se dit Bernardo. Mais depuis lors, il y a une éternité.
L’engin entre dans la ruelle qui longe le gobierno militar.
De l’hôpital d’en face, le feu est ininterrompu.
Le tank fonce dans la porte de fer, la puerta de hierro, en l’écartant.
Maintenant les rouges vont monter à l’assaut.
Un mouvement se fait à la porte de l’hôpital. Ont-ils l’intention d’attaquer ? Immédiatement, Bernardo y dirige la pluie métallique de sa mitrailleuse. Comme le sifflement enfle et résonne ! Pas un des rouges n’ose sortir.
Le tank a traversé la porte de fer et continuant sa route il vient s’arrêter à l’intérieur. Pourquoi les autres n’attaquent-ils pas ? Seul, il ne peut rien faire. Des grenades à main éclatent autour de lui. Leur action isolée n’arrive pas à entamer sa carapace d’acier ; mais il suffirait d’une seule gerbe de grenades, et ses plaques ne pourraient plus guère résister. Un soldat a sauté derrière le tank et s’y tapit pour tirer à l’intérieur par les petites fentes. Mais brusquement l’engin fait marche arrière et l’homme n’a plus qu’à s’étendre par terre et à s’aplatir autant que possible. Le tank passe sur lui sans le blesser.
C’est une lutte atrocement inhumaine. Le jet d’essence jaillit toujours de la cave. Les uniformes des soldats en sont en partie imbibés. Lorsqu’ils voient que le tank se retire, ils poussent des cris de joie.
Mais les rouges ne ralentissent pas leur feu. Plus nombreuses, les grenades incendiaires volent vers le poste de commandement, quelques-unes sont tombées dans la pharmacie. Et déjà des flammes lèchent les rayons en bois qui leur offrent un aliment abondant.
Bientôt, le local où se trouve la pharmacie est tout entier la proie des flammes qui continuent à sévir, sifflant, bondissant d’une pièce à l’autre.
Une situation désespérée.
Il est impossible de vaincre l’incendie. Le feu violent des rouges ne s’interrompt pas une seconde. Les soldats avec leurs uniformes trempés d’essence courent un risque effroyable.
L’incendie étend ses ravages.
Le cœur serré, mais cédant à la nécessité qui l’oblige à leur épargner à tous d’être brûlés vifs, Lecanda ordonne la retraite.
Cette dernière manœuvre se fait en bon ordre : ils emmènent tous leurs blessés, ils ne laissent ni un fusil, ni une mitrailleuse. L’affreux combat a duré pendant deux heures. Au moment précis où ils atteignent l’Alcázar, de hautes flammes s’élancent du toit du gobierno militar.
Lecanda n’aurait pas eu le droit d’attendre un instant de plus.
*
Cette journée passe, puis une autre, et l’incendie du gobierno militar ne s’est pas encore apaisé. Mais le matin suivant, le colonel Moscardó donne l’ordre de réoccuper le poste de commandement.
Des flammèches sautillent encore sur les lieux du sinistre. Les miliciens rouges n’ont pas osé y pénétrer. Ils ont tout juste occupé les petites maisons et le garage situés de l’autre côté de la puerta de hierro.
Les soldats et les guardias avancent.
Un bref prélude exécuté avec des mitrailleuses et des grenades à main.
Puis ils déclenchent l’attaque à la baïonnette.
Au milieu des soldats, sans qu’il soit en service commandé, mais avec sa compagnie, Pablo marche à l’assaut, sa baïonnette à la main.
Les miliciens tirent des fenêtres et des portes des maisons. Mais cela n’arrive pas à arrêter l’élan des soldats intrépides. De-ci, de-là, il y en a un qui tombe ; plus d’un est blessé, et le sang coule sur l’uniforme où il forme un mélange noirâtre avec la poussière et la saleté de plusieurs semaines.
Toujours en avant.
Des officiers en tête, le pistolet à la main, les autres suivant par derrière.
– Viva España ! Leur violence se fait jour dans ce cri.
Déjà ils atteignent les maisons et ils s’y précipitent par les portes et les fenêtres.
Mais il n’y a pas de corps à corps ; les miliciens s’enfuient par les fenêtres de l’arrière avant d’être atteints par leurs adversaires.
Une furieuse grêle de balles les poursuit.
Sans hésiter, les soldats s’élancent vers le gobierno militar.
Ayant quelque peu relâché leur surveillance en face du poste de commandement abandonné aux flammes, les assaillants rouges installés à l’hôpital sont pris de panique lorsqu’ils voient reparaître leurs ennemis au milieu des cendres encore chaudes et parmi les flammes qui n’ont pas eu le temps de s’éteindre.
Voici donc les soldats et les guardias dans l’enchevêtrement des poutres carbonisées et dans les cadres de fenêtre à moitié consumés. On voit sautiller, çà et là, de petites flammes. Les décombres des murs abattus et des plafonds effondrés s’amoncellent dans les pièces. Des murailles branlantes, des cloisons aux fissures béantes menacent ruine. Mais tout cela ne retient pas les occupants téméraires. Sur-le-champ, ils ont pris provisoirement position, et leurs balles s’abattent sur les milices rouges toutes désemparées.
En face de cet exploit audacieux, les assaillants sont comme paralysés. On ne sait quelle superstition s’insinue dans le scepticisme des rouges ; ils se le disent entre eux, et le mot fait le tour de la ville : « Es el demonio – c’est le diable qui, du milieu des flammes, fait feu sur nous. »
Non pas des diables, mais des hommes, des hommes courageux qui se sont entièrement consacrés à leur tâche : les héroïques défenseurs de l’Alcázar.
Plus de canons – plus de courage !
Il y a deux jours, l’évacuation du gobierno militar, devenue brusquement nécessaire, avait provoqué pas mal de consternation et avait surtout causé une peur considérable dans les sótanos.
Mais lorsque le terrain abandonné fut reconquis tout entier, après que les ravages du feu eurent cessé, une joie sincère et bruyante se remit à régner.
Le moral des hommes et des officiers surtout fut à un point culminant.
Enfin, après de longues semaines durant lesquelles l’ennemi ne s’était jamais présenté, mais s’était toujours contenté de tirer et de bombarder à l’abri derrière les fenêtres et les barricades ou de ses batteries inaccessibles et de ses avions passant en trombe, enfin une rencontre a eu lieu, enfin il a donné l’assaut dans lequel les forces véritables et le courage réel ont pu s’affronter.
Évidemment, il n’y avait pas eu de corps à corps. En prenant la fuite, l’ennemi avait évité cette dernière rencontre d’homme à homme. Mais c’est précisément ce qui prouvait sa faiblesse intérieure, son insuffisante force de résistance, et la supériorité énorme des défenseurs de l’Alcázar, supériorité non en nombre et en matériel de guerre, mais en courage, en dévouement, même au péril de la vie.
Plus d’une fois, et au gobierno militar surtout, l’hymne joyeux de l’Alcázar retentit, en particulier les derniers vers :
– La victoire est prochaine. . .
. . . et nous pourrons résister.
Dans son ordre du jour, le colonel Moscardó remercia et félicita les officiers, les hommes et les civils de tous les groupes ; car, pendant ces journées, il n’y allait pas seulement du gobierno militar, mais en d’autres endroits aussi, les vaillants défenseurs eurent l’occasion de mettre leur courage tout spécialement à l’épreuve.
À l’angle nord-est de l’Alcázar, l’ennemi avait mis le feu en y lançant des bombes incendiaires. L’incendie aurait pu prendre des proportions considérables, si les guardias et les combattants civils ne l’avaient pas circonscrit puis éteint et cela sous le feu de l’artillerie lourde, ce qui avait demandé l’emploi de toutes les forces et une abnégation surhumaine.
Les batteries ennemies avaient ensuite dirigé un feu d’une violence inouïe contre la façade nord. Au moment de l’attaque tentée contre le gobierno militar, il était dans le domaine des choses possibles que l’ennemi, après une préparation suffisante par l’artillerie, passât ici aussi à l’assaut.
Pour prévenir toute éventualité, des hommes de la guardia civil étaient restés à leur poste malgré le bombardement, sous des abris qui les couvriraient à peine, constamment menacés, mais prêts à chaque instant à étouffer dans ses débuts toute attaque de l’adversaire.
Par suite de cette pression renforcée que l’ennemi exerçait sur les différents fronts, ces journées avaient été une période de tension extrême, portant l’héroïsme à son comble ; et le fait d’avoir résisté victorieusement redonnait des forces aux défenseurs.
Ces jours devaient se terminer par de nouvelles difficultés, par de nouveaux encouragements.
*
Les canons placés au nord de Pinedo dirigent leur feu contre l’Alcázar dont la façade nord, ce véritable chef-d’œuvre artistique, ressemble de plus en plus à un gigantesque tas de ruines et de décombres.
À l’Ouest, les sentinelles échangent des balles avec les assiégeants postés sur l’autre rive du Tage.
Et là-bas en face, dans le Castilio San Servando qui domine le pont d’Alcántara, il semble que quelque chose se prépare. On y observe toute espèce de mouvements, et déjà on comprend par quoi cela est causé. Un canon vient d’y être mis en position une pièce de 75.
– Dis donc, Jaime, ils s’approchent de plus en plus de nous avec leurs canons, dit Juan, un jeune cadet à son camarade.
Quelle drôle d’allure ils ont tous deux, dans leurs uniformes râpés, tout couverts de poussière, et avec ces barbes noires qui encadrent leur jeune visage.
– Cela ne fait toujours pas soixante-dix mètres comme pour le gobierno militar. D’ailleurs, plus ils s’approchent, mieux nous pouvons les atteindre.
– Et plus les rouges ont la frousse. On a bien pu le constater ce matin, près de la puerta de hierro. Il fallait voir comme ils ont décampé.
– Ce petit roquet de 75, là en face, ouvre le feu. Laisse-moi prendre place à la mitrailleuse ; il y a peut-être moyen de le faire taire illico.
Jaime s’assied sur le siège de la mitrailleuse et se met à viser. Mais déjà le premier obus ennemi arrive et éclate sur l’esplanade. Avec le périscope, Juan examine la cour du château-fort.
Jaime ouvre le feu.
– Vise plus bas ! ordonne Juan en se tournant vers Jaime. Voilà qui est bien ! Ils ont peut-être cru que nous n’allions pas les voir d’ici ou que nous étions de trop mauvais tireurs. . . Un peu plus à droite encore. . . Comme ça ! Et maintenant, vas-y ! Deux hommes tombent, les autres. . .
À cet instant précis, un sifflement suivi d’une explosion formidable.
– Caramba ! D’où vient-il, celui-là ? Notre petit canon d’en face n’a pourtant pas bougé. . . d’ailleurs il n’arriverait pas à produire des machins de cette envergure.
En voilà un second. Un nuage de poussière traversé d’éclats de ferraille s’élève de l’esplanade ; l’engin a dû tomber sur un des camions vides qui avaient apporté les munitions.
– Tiens, un bruit d’avion. Était-ce peut être lui ?
– Impossible. Les bombes d’avion ont un autre sifflement. N’avais-tu pas entendu le coup de départ ?. . . Ce que ces rouges peuvent encore tirer avec leurs mitrailleuses !. . . Voilà : un coup, un second, un. . . Nom d’un chien ! toute une salve : cinq coups !
À peine quelques secondes et les obus éclatent sur l’esplanade.
– C’est du nouveau. Laisse-moi voir ça.
Jaime inspecte les arrière-plans sur l’autre rive du Tage. Il ne découvre absolument rien. Encore une salve. D’après le bruit, ce doit être plus à droite.
Serait-ce que cette nouvelle batterie est placée sur le champ de manœuvres ? Il y braque son périscope. La salve suivante n’arrive qu’une ou deux minutes plus tard.
– Naturellement, Juan, ils sont là-bas.
– Comment « naturellement » ? Et où donc ?
– Ah oui. . . sur le Campamento. Ils sont plantés sur la gauche, vers la forêt.
– Gentiment. . . Carai !
Les obus tapent si près que les deux cadets instantanément se jettent par terre. Un fracas de tonnerre, des nuées de poussière.
– Gentiment alignés l’un à côté de l’autre, voulais-je dire. Un, deux, trois, quatre, cinq.
– Halte ; cela suffit. Ou bien il y en a plus encore ?
– Non, pas pour le moment.
– Bon, je vais vivement faire le rapport. Je reviens tout de suite.
*
Le temps passe. Ces pièces nouvellement placées fournissent un feu lent mais régulier.
« C’est leur dernière surprise », se dit Jaime, maintenant ils bombardent aussi la façade est.
Quelque part, dans la partie supérieure de l’Alcázar, un de ces obus a dû éclater. Des pierres dégringolent, suivies de poussière.
Sur l’esplanade, les explosions de ces engins ont creusé de profonds entonnoirs. Quelques camions sont à moitié démolis et ensevelis.
*
– Dis donc, Juan, tu es bien resté longtemps.
– C’est que j’ai eu à faire. Le facteur venait de passer.
– Pas de plaisanterie, hein ! Qu’y avait-il ?
– Mais si je te dis que c’était le courrier. Tiens, voilà une lettre pour toi.
– Quoi ? Donne !. . . Une lettre de mon père.
– Par poste aérienne, bien qu’il n’y ait pas de timbre.
– Tu feras tes discours après ; avant, je veux lire ma lettre. . . Dis, mon père m’écrit qu’il est sur le front de Guadarrama, qu’il va très bien et qu’il est fier de me savoir ici à l’Alcázar et qu’il espère que je me conduise en homme.
– Oh ! pour ça. . . avec une pareille barbe ! plaisante Juan.
– Mais comment cette lettre est-elle arrivée ici ?
– Mais je te l’ai dit : par poste aérienne. Te souviens-tu de l’avion que nous avons entendu tout à l’heure et du feu sauvage des mitrailleuses rouges ? C’était un des nôtres. Il a lancé deux caisses de vivres, une lettre de Mola, une autre pour moi et celle de ton père.
– Qui est-ce qui t’a écrit, à toi ?
– Ah ! vois-tu. . . pas pour moi seul, c’est une lettre adressée à tous les cadets, donc à moi aussi ! Et ce sont les jeunes filles de Burgos qui nous l’ont écrite.
– Tu l’as là ?
– Penses-tu ! Cette lettre est là-haut sur la table du chef. Mais elle sera tout de suite reproduite dans le journal. Le numéro d’aujourd’hui allait justement être polycopié. Alors cette affaire est venue, et à présent tout cela doit y figurer.
– Et les deux caisses sont bien arrivées aussi ?
– Oui. . . c’est-à-dire, Pune est tombée dans la cour et l’autre à l’extérieur, à dix mètres environ de la puerta de carros. Trois hommes ont été postés à la fenêtre au-dessus qui veillent à ce que les rouges ne nous la barbotent pas ; et ce soir, dès qu’il fera nuit, nous effectuerons une petite sortie pour aller chercher la caisse.
– Je suis de la partie.
– Si on te relève ici, bon. Sinon, ça ne va pas. Car je me suis déjà fait inscrire, et tu ne voudrais pas que nous laissions notre mitrailleuse toute seule.
Un peu plus tard, le journal arrive avec la lettre du général Mola :
Ejercito del Norte
El General Jefe a los bravos defensores
del Alcázar de Toledo
Vencemos en todos los frentos y caminamos con paso seguro hacia la victoria. Espero seais libertados dentro de poco. La columna Yagüe va camino de Talavera ; la mia más avanzada cerca de El Escorial. Viva España ! Vivan los bravos defensores del Alcázar de Toledo !
Un abrazo a todos de vuestro General
Emilio Mola.
Armée du Nord
Le général en chef aux braves défenseurs de
l’Alcázar de Tolède.
Nous sommes vainqueurs sur tous les fronts et avançons à pas sûrs vers la victoire. J’espère que vous serez délivrés d’ici peu. La colonne Yague est sur le chemin de Talavera. Mes troupes les plus avancées sont à proximité de El Escorial. Vive l’Espagne ! Vivent les braves défenseurs de l’Alcázar de Tolède !
Une embrassade à tous de votre général
Emilio Mola.
La lettre des jeunes filles de Burgos est un message plein d’admiration et de reconnaissance, un hymne à la défense héroïque de l’Alcázar, aux cadets-chevaliers et à leurs glorieux frères d’armes.
– Sais-tu ce qui me réjouit par-dessus tout dans cette lettre ?
– Oui. Que ces jeunes filles ne nous l’aient pas apportée elles-mêmes. Car, si elles nous voyaient en ce moment. . . les « cadets-chevaliers ». . . !
En souriant, Juan contemple ses bottes déchirées, son uniforme dont la couleur est à peine distincte de celle du sol, puis en tirant sa barbe il conclut :
– Plutôt des « chevaliers à la triste figure ! »
– Il n’y a que la figure de triste, mais rien d’autre, Juan. D’ailleurs, ce n’est pas du tout ce que je voulais dire. Ce qui me réjouit, c’est qu’elles n’aient pas oublié les camarades. Car ce n’est pas nous autres cadets seulement, mais tous, tant que nous sommes ici, qui avons le mérite d’avoir gardé l’Alcázar invinciblement debout malgré toutes les ruines.
Les sorties
Les maisons situées au sud de l’Alcázar sont de misérables bicoques dont les toits arrivent à peine aux fenêtres du premier étage de la forteresse. Leurs habitants, dès le début du siège, ont fui la périlleuse proximité de l’Alcázar, car plus d’un obus, plus d’une bombe d’avion, manquant son véritable but, est tombé dans les maisons avoisinantes. Les ennemis n’ont pas osé les occuper ; les défenseurs de la citadelle auraient facilement pu y lancer des grenades à main.
Au moment de s’enfuir, les habitants avaient tout abandonné, tel quel. Et depuis, les assiégés ont fait de nombreuses razzias dans ces maisons, y trouvant toujours quelques vivres.
Systématiquement, ils ont inspecté une cuisine après l’autre et ils y ont découvert bien des choses qui, durant ce temps de pénurie, présentaient pour les emmurés de l’Alcázar une valeur d’objet précieux : du sel, des boîtes de sardines, de l’huile, des conserves, des légumes secs, un peu de chocolat, bref tout ce qui se trouve normalement dans un ménage ordinaire. Le fruit de ces incursions revenait alors aux blessés et aux malades, puis aux femmes et aux enfants qui en avaient particulièrement besoin.
Et ils y trouvèrent une chose encore dont les défenseurs eux-mêmes devaient bénéficier : du tabac. Pour ceux qui avaient l’habitude de fumer, ç’avait été une forte privation que de manquer de ce plaisir pendant de longues semaines. On se souvient que tout avait été utilisé ; ils avaient fumé les feuilles des arbres et le marc de café. Dans les rayons de la pharmacie il ne restait pas la moindre petite feuille des provisions de filleul et de camomille ; tout leur était bon.
C’était donc chaque fois une satisfaction spéciale quand, dans ces razzias, on réussissait à mettre la main sur du tabac.
Ces sorties n’allaient pas sans danger, car dans les ruelles prises entre les magasins et l’école des cadets, les ennemis étaient aux aguets derrière les barricades d’où ils pouvaient balayer de leur feu la petite place qui était à traverser. Mais ceux de l’Alcázar n’eurent jamais de pertes graves.
Pendant ces premiers jours de septembre, lorsque l’ennemi commença à exercer une pression plus forte sur l’Alcázar, Unión-Radio-Madrid venait encore d’annoncer, avec beaucoup de détails, la chute de la citadelle, conquise cette fois-ci par les miliciens rouges – l’ennemi essaya d’occuper également ces maisons situées au sud. Mais le feu terrible des assiégés, dirigé par le capitaine Vela, les rejeta en les obligeant de se retirer avec de fortes pertes. Ils avaient emporté leurs morts et leurs blessés à l’exception d’un jeune officier de la guardia de asalto qui, après être resté en première ligne et sous le feu jusqu’au moment de la retraite, avait été tué par une balle.
Depuis quelques heures déjà, il est étendu. Les miliciens n’osent pas aller le chercher, craignant que de l’Alcázar on ne les atteigne.
Alors le capitaine Vela donne l’ordre de cesser le feu pour quelques minutes, et il crie aux miliciens, cachés derrière des barricades dans les rues attenantes, de venir chercher leur officier tombé, assurant que durant ce temps-là on ne tirerait point de l’Alcázar.
Après un moment d’hésitation, quatre miliciens paraissent et emportent leur officier mort.
Pendant la nuit, peu de repos. Les pacos rouges tiraillent sans répit.
Au début, leurs balles avaient causé maintes pertes à la garnison de l’Alcázar, lorsque les défenseurs s’étaient imprudemment risqués hors de leurs abris pour voir ce que signifiait ce feu. Mais à présent, les soldats et les hommes de la guardia civil savent à quoi s’en tenir. L’un d’eux est à un poste de vigie bien abrité tandis que les autres sont assis en rond et s’entretiennent à voix basse sans se soucier de l’ennemi qui tire.
Voilà que les rouges font encore leurs discours :
– Atención, atención, aqué Radio Zigarral de los leones rojos ! – Attention, attention, ici Radio Pavillon des Lions rouges !. . . Soldats ! Guardia civil ! Rendez-vous ! Nous vous promettons la liberté, des vêtements neufs, de quoi manger, boire et fumer. Vous pourrez alors retourner chez vous, dans vos familles. La colonne Yague ne vient pas. Apportez-nous les têtes de Moscardó et de Vela. . .
Et ainsi de suite, ils énumèrent encore quatre ou cinq autres noms d’hommes pour les têtes desquels on veut accorder la liberté aux autres. Mais les miliciens ne reçoivent aucune réponse à leurs propositions.
Puis ils se remettent à tirer comme des fous furieux, et le fait que les défenseurs de l’Alcázar, là non plus, ne songent à répliquer et qu’apparemment cette tiraillerie ne les dérange pas, augmente encore leur rage.
– Au moins, tirez, espèce de canailles, hurlent-ils ; mais pour toute réponse, ils entendent des éclats de rire.
*
Le lendemain matin, on organise encore une de ces sorties pour ainsi dire privées, afin de mettre la main sur quelques vivres. Dans les maisons situées juste en face de la porte des Capucins, il n’y a toutefois plus rien à trouver, car tout y a été fouillé, jusque dans les derniers recoins. Aujourd’hui, la sortie est dirigée un peu plus vers la droite, vers les habitations qui se trouvent à proximité de la tour sud-ouest de l’Alcázar.
C’est plus dangereux que d’habitude, car le parcours est plus long et il existe deux ruelles d’où les miliciens peuvent tirer.
D’une main prudente, on ouvre la porte des Capucins d’où l’on quitte l’Alcázar au Sud.
Six hommes de la phalange espagnole, munis seulement de leur revolver et de grenades à main, se coulent le long de l’escalier qui descend dans la rue.
Ils avancent encore un peu.
Il s’en manque d’un pas pour qu’ils pénètrent dans le champ visuel des assiégeants postés derrière les barricades.
En quelques bonds rapides, les six hommes traversent les passages dangereux, et avant que les miliciens ahuris arrivent à tirer, les phalangistes se trouvent à l’abri dans les maisons.
Ils s’y ruent à travers les portes et les fenêtres cassées ; deux d’entre eux surveillent les sorties à l’arrière des maisons afin que l’ennemi ne les surprenne pas de ce côté-là.
Aux fenêtres de l’Alcázar, il y a également des hommes postés qui montent la garde afin que les miliciens, sautant brusquement leurs barricades, ne prennent pas à revers les phalangistes qui ont effectué la sortie.
Entre temps, ceux-ci ont rapidement ramassé quelques vivres.
Le plus dur reste à faire : le retour en traversant le rayon de tir des miliciens dont l’attention est éveillée.
Là encore, il n’y a que la surprise et la célérité qui puissent les sauver, comme bien des fois déjà.
Lentement, ils se glissent de nouveau aussi loin que possible, deux hommes portent les vivres raflés qu’on a bien calés dans des sacs emportés à cet effet. Les autres tiennent les grenades en main, prêts à les lancer.
Ils arrachent le nœud des cuillers, un, deux, trois. . . vlan ! Les grenades volent du côté des barricades et au moment où elles éclatent avec fracas, les six hommes foncent.
Mais déjà sifflent les balles des miliciens.
Les phalangistes se jettent dans la porte ouverte de l’Alcázar.
Agustino trébuche et tombe à terre. Le sang jaillit de sa bouche.
Mais cinq seulement sont de retour.
– Où est Maximiliano ?
Les hommes postés aux fenêtres là-haut l’avaient observé. Maximiliano était le dernier des six hommes. À dix ou douze mètres de la porte et du salut, brusquement il s’était arrêté comme s’il avait heurté un obstacle invisible, avait fait un demi-tour sur lui-même en levant les bras, ses genoux avaient fléchi, et il s’était effondré, mort.
Les quatre qui sont revenus indemnes de la sortie Agustino est grièvement blessé – ont déjà pris une décision : nous ramenons Maximiliano.
Dans le bouleversement de ces minutes, ils n’ont pas le temps de réfléchir.
Les voici qui ressortent.
Mais l’ennemi les reçoit avec une pluie de balles, et avant qu’ils soient parvenus auprès de Maximiliano, Godofredo durement touché, s’abat à son tour. Ils le soulèvent et le rapportent en courant.
Le sang du blessé, que plusieurs balles ont dû atteindre, rougit leurs mains.
Lorsque, encore arrivés à l’Alcázar, ils veulent confier Godofredo aux mains secourables qui les accueillent, ils s’aperçoivent qu’ils ont porté un mort.
*
Le tonnerre du canon, ininterrompu durant le jour, se tait à l’approche de la nuit. À l’heure du crépuscule, le feu des fusils s’amplifie, mais lorsque l’obscurité est complète, à son tour, il cesse presque entièrement.
La porte sud de l’Alcázar s’ouvre ; rien qu’une fente étroite. Le capitaine Vela s’y glisse. Souple et silencieux, sans une arme à la main, le seul pistolet à la ceinture, il rampe à travers la place plongée dans le calme et les ténèbres.
À quatre pattes, lentement, il avance, évitant avec soin le moindre bruit.
Intérieurement, il n’est que tranquillité et attention, tout tendu vers l’ennemi. Ce qu’il se propose de faire a coûté la vie à un jeune homme quelques heures plus tôt.
À présent, il pénètre dans la zone dangereuse des barricades. Derrière l’une d’elles, il voit trembler la lueur d’un feu, et dans les étroites meurtrières il aperçoit les canons de quelques fusils et d’une mitrailleuse qui se détachent avec netteté sur le fond éclairé par le feu. Sur le brillant des pièces métalliques, danse le reflet des flammes. Quelque part là-bas, des yeux vigilants scrutent la place.
Le verront-ils ?
Doucement, doucement, il avance.
Maintenant il est arrivé près de Maximiliano, son frère d’armes mort.
Sur le chemin du retour, il ne pourra pas être aussi silencieux. Mais il l’avait prévu et pris les mesures nécessaires.
Soudain de quelques fenêtres de la façade sud de l’Alcázar, une série de coups part, et dans le calme si brusquement déchiré, ils paraissent résonner plus fort encore que d’habitude. Vela a saisi Maximiliano par la ceinture, et toujours en rampant il le traîne vers la forteresse. Il sent battre le sang à ses tempes. Sa respiration se fait haletante.
Enfin il a réussi : il est hors du cercle mortel. Sortant de l’Alcázar, quelques hommes accourent et le débarrassent de sa lourde charge. Lui-même les suit en titubant.
Derrière lui, la porte se referme.
Pendant quelques secondes, il se tient appuyé contre un mur, les yeux fermés.
– Mon capitaine, vous êtes blessé. . . là, à votre main.
Vela jette un regard le long de son uniforme sali et déchiré, sur sa main droite couverte de poussière grise et de quelque chose de gluant et noirâtre. Puis il secoue la tête :
– Non. . . ce. . . n’est pas de moi.
Le parlementaire
Le jour suivant, vers le soir, le haut-parleur rouge se met encore à débiter.
Les défenseurs de l’Alcázar n’y prêtent guère attention. Ce doit être la vieille chanson : « Apportez-nous la tête de Moscardó et rendez-vous ! » Ou bien encore des injures comme ils en ont entendu assez souvent.
Et pourtant non. Pour une fois, c’est autre chose.
On avertit le colonel Moscardó. Il a son bureau d’état-major dans l’aile sud de l’Alcázar et de là il entend très bien la voix qui parle de l’autre côté :
– Attention, attention, communication importante :
Les chefs des troupes opérant à Tolède ont pris la décision d’envoyer aux assiégés de l’Alcázar un parlementaire chargé de négocier avec eux la reddition de la forteresse. Les chefs proposent pour demain matin dès neuf heures un armistice mutuel durant lequel le parlementaire soumettra au chef de la garnison de l’Alcázar les conditions et mènera les négociations.
Le communiqué est répété, puis suit un silence durant lequel aucun coup n’est tiré.
Moscardó réfléchit. Les conditions du parlementaire ne seront guère acceptables, car ce que l’ennemi veut c’est la reddition de l’Alcázar, c’est l’abandon de la forteresse ; et jamais Moscardó n’y consentira, dussent-ils leur garantir la vie sauve à tous.
Mais il a un autre désir, et par cette voie celui-ci pourra peut-être se réaliser.
Par l’intermédiaire d’un adjudant, il fait dire à l’ennemi qu’il accepte la proposition.
*
Le lendemain, sur le coup de neuf heures, le paqueo des fusils et des mitrailleuses se tait. Venant de la ruelle qui longe la tour sud-ouest de l’Alcázar, trois officiers avec un drapeau blanc avancent de quelques pas. Ce sont des officiers de l’armée espagnole qui combattent pour le gouvernement de Madrid ; à présent, ils portent l’uniforme des miliciens, « et mono azul », la salopette bleue du mécanicien.
Celui du milieu a marqué son grade par l’étoile à huit pointes : c’est le commandant Rojo, le négociateur des assiégeants.
Le portail à l’est de la forteresse, la puerta de carros, s’ouvre. L’adjudant de Moscardó, le capitaine Morena, reçoit le commandant.
La dureté du siège, la tension continuelle, un sommeil à peine suffisant et une alimentation défectueuse ont amoindri l’état physique et surtout l’énergie des assiégés. Mais rien n’en transparaît dans l’attitude du capitaine Morena. Sans fléchir, il salue le parlementaire. Ils échangent quelques brèves précisions concernant l’armistice. Puis Morena bande les yeux du commandant et le fait entrer dans la forteresse.
Les deux officiers qui l’accompagnent restent dehors.
Le capitaine Vela les rejoint, vêtu uniquement d’un pantalon et d’une chemise, sans aucun signe qui pourrait le faire reconnaître comme officier.
– Buenos dias, señores !
– Bonjour, répliquent les officiers.
L’un d’eux lui offre une cigarette suivant une courtoise coutume.
– Vd. fuma ?
– Muchas gracias, señor, remercie Vela en l’acceptant, et il est obligé de faire un effort pour ne pas trop trahir dans sa voix la grande joie que lui procure ce menu rien dont ils ont été si longtemps privés.
Comme l’officier s’approche pour lui donner du feu il lui dit, tout bas :
– Rendez-vous. Pourquoi résister plus longtemps !
– Il me semble, messieurs, que seul le commandant Rojo a titre de parlementaire ; c’est lui qui négocie là-haut avec le colonel Moscardó. Nous ferons donc bien de ne point nous en mêler, dit Vela, un petit sourire aux lèvres. Par ailleurs, mes compliments, votre tabac est exquis.
Vela savoure sa cigarette en avalant la fumée.
À la fenêtre au-dessus, les pâles visages barbus des assiégés paraissent, un peu craintifs encore et restant quelque peu à l’abri. Pleins d’envie, les hommes contemplent les officiers qui fument.
– Il y a sans doute longtemps que vous n’avez pas fumé.
– Oui, en effet. Il nous reste du papier à cigarette, mais nous n’avons plus de tabac.
– Si je puis vous faire un plaisir, je vous en prie.
L’un des officiers lui offre un paquet de tabac.
– Même dans le cas où nous ne nous rendrions point ? interroge Vela avec un fin sourire.
– En ce moment, c’est l’armistice. Ce qu’il y aura après ne nous intéresse pas pour l’instant.
– Je vous remercie.
De la fenêtre du premier étage, une ficelle descend ; un appel à voix basse et sifflante :
– Vela !
Le capitaine lève les yeux. Là-haut, il voit quelques-uns de ses camarades qui, de la main, lui font des signes dont il a très vite saisi le sens.
– Une minute, je vous prie, messieurs, dit-il en se tournant vers les deux officiers. Puis il attache le paquet de tabac au bout de la ficelle. Une rapide secousse, et déjà le paquet est là-haut.
– Puisqu’il en est ainsi, monsieur. . .
–Capitaine Vela, complète Vela en faisant le salut militaire.
L’officier des milices en a la respiration coupée pour quelques secondes. Ainsi donc c’est le capitaine Vela, un des hommes de l’Alcázar que les miliciens redoutent le plus ; il est connu pour sa bravoure et son implacabilité. . . C’est donc celui-là.
– Puisqu’il en est ainsi, mon capitaine, je vous en prie. . . nous en avons en abondance.
L’officier lui passe sept ou huit paquets de tabac.
– Mais tout cela. . . ?
– . . . nous pouvons en répondre. On ne pourra pas dire que par là nous favorisons l’adversaire, réplique l’officier, souriant à son tour.
– Bien. Je les accepte donc pour mes camarades et vous en remercie en leur nom.
La ficelle redescend, puis remonte avec les paquets.
*
Les yeux bandés, le commandant Rojo a été conduit à travers la forteresse.
On le fait tourner autour des coins et on lui fait gravir des escaliers.
Il ne voit rien, mais il croit sentir sur lui les regards des assiégés parmi lesquels on le fait circuler, il croit saisir la misère qu’abritent les murs de l’Alcázar.
Soudain son guide l’arrête. On lui enlève le bandeau. Bien qu’il se trouve dans une pièce qui n’est que faiblement éclairée, il faut que ses yeux se réhabituent tout d’abord à la lumière.
Il est dans le bureau de Moscardó. Voici le colonel. Ses cheveux sont devenus tout gris durant les dernières semaines. Les rides de son visage qu’entoure un collier de barbe grise se sont creusées, on les dirait burinées.
Les deux hommes se saluent et prennent place à la grande table qui occupe presque un quart de la vaste pièce. La fenêtre a été murée jusqu’à un peu plus de hauteur d’homme ; la pièce est plongée dans la pénombre. Aux murs, quelques cartes et les photographies de directeurs de l’école des cadets. Tout est fruste et austère.
Sauf Moscardó et le commandant Rojo, il n’y a qu’un officier, Blas Piñal, qui assiste comme témoin.
Le commandant sent le froid, la distance, le refus qui l’accueillent, malgré la politesse que le colonel observe.
Lui, officier, se rend compte de tout le poids, de toute la difficulté de sa mission qui consiste à proposer la reddition à un adversaire qui, bien qu’inférieur en forces, au moins numériquement, reste inflexible et inentamé dans son courage, dans sa fermeté et surtout dans son honneur.
Sans long préambule, Rojo commence l’entretien, en pesant chaque mot et en en venant tout de suite au fait.
Il dit se présenter au nom des chefs des milices cantonnées à Tolède pour exiger du commandant de l’Alcázar qu’il rende la forteresse.
– Voici les conditions.
Rojo tire de sa poche une feuille de papier, pas plus grande qu’une page de cahier d’écolier, et le soumet au colonel.
Moscardó lit ces conditions :
1. Garantía completa de la vida de todos los residentes en el Alcázar.
2. Libertad inmediato de todas las mujeres, soldados y niños menos de 16 años.
3. Todos los demás serán entregados à los Jueces para que delimiten su culpabilidad.
1. Garantie complète de la vie à tous les occupants de l’Alcázar.
2. Liberté immédiate à toutes les femmes, aux soldats et enfants de moins de seize ans.
3. Tous les autres seront traduits devant les juges afin que ceux-ci délimitent leur culpabilité.
Le document porte le tampon : « Comité de Defensa, Jefatura de la Columna de Operaciones, Toledo. » Il est signé d’environ une douzaine de noms.
*
Vela et les deux officiers s’entretiennent en bas devant la porte. Il y a quelque chose de trouble dans l’ambiance. Ils sont ennemis et ils se sentent rapprochés par un passé commun vécu dans l’armée espagnole. Ils sont adversaires de par leurs opinions mais ils sont apparentés, tous trois, par leur esprit chevaleresque et honnête. Et les deux officiers-miliciens – il semble presque que leurs paroles et le sujet de leur conversation le trahissent – déplorent en quelque sorte que cette qualité manque à ceux qu’ils commandent.
Vela dit :
– Il y a quelques jours, lorsque nous avons blessé à mort un de vos officiers, là en face, nous avons offert et accordé à vos hommes une interruption du feu afin qu’ils pussent venir chercher son corps. Lorsque eux ont tué un des nôtres lors d’une petite sortie, ils ne nous ont pas répondu par un geste analogue. Mais nous sommes néanmoins allés chercher notre frère d’armes mort, pendant la nuit. C’est moi qui l’ai fait.
Ce n’est pas l’orgueil personnel qui s’exprime par les mots de Vela, mais un sentiment qui semble leur dire : « Vous pouvez faire ce que vous voulez, nous sommes une communauté formée par la peine, la lutte et les mêmes buts. Pas un seul, dans cette communauté, n’abandonnerait un des autres, même pas dans la mort, même pas au péril de sa vie. »
Dans une fenêtre de l’Alcázar, Nicolás, le jeune phalangiste se penche légèrement. Quelle joie de pouvoir, pour une fois, contempler sans souci la ville au delà des positions qu’occupent les assiégeants dans les maisons avoisinantes.
Là-bas, quelque part dans le fouillis de ces toits, il y a la maison où vit sa mère, où elle tient son commerce. Comment vont-ils là-bas, à présent ?
Comme tout cela est déjà loin : Tolède, la vie dans la cité, le calme train-train de tous les jours. Il en a la nostalgie. Il souhaite le calme et le repos de l’existence normale qui, si souvent, parurent insupportables à sa juvénile exubérance.
Ah ! pouvoir se laver convenablement une bonne fois, avoir des vêtements propres, s’asseoir à une table propre. Et dormir, se reposer, dormir ! Mère ! Quand donc cela sera-t-il encore ?
Soudain. . . dans le silence de l’armistice observé sur la foi d’un serment, le sifflement aigu d’un coup de feu tiré de loin.
Nicolás pousse un cri. C’est un cri atroce, perçant, qui contient tout à la fois l’épouvante, l’accusation, l’indignation et on ne sait quelle tristesse plaintive.
La bouche pâle de l’adolescent s’est tue à jamais. La poitrine percée – le coup était trop bien visé – le jeune phalangiste est étendu par terre.
Le sang ruisselle de la blessure qui se trouve juste au-dessus du cœur. Inutilement, ses camarades s’affairent autour de lui. Nicolás dort pour toujours.
Les deux officiers qui avaient accompagné le parlementaire sont devenus blêmes. Serait-ce que quelqu’un a tiré qui, par hasard, n’avait pas connaissance de l’armistice ? Serait-ce que cela a été fait par une abjecte perfidie ?
Ils l’ignorent, mais ils sentent que tous les regards les accusent, et leur jettent l’opprobre de la lâcheté, de la traîtrise.
Ils se tiennent en face du capitaine Vela, dont les lèvres frémissent d’indignation, et ils n’ont plus le courage de le regarder. Ils ne trouvent nulle parole d’excuse ou de regret. Dans ce cas, les mots sont impuissants ; il n’y a plus qu’à se taire.
*
– . . . . .
– Vous savez, mon colonel, ce que cela signifierait si vous refusiez nos conditions.
– La lutte comme auparavant.
– Sans merci et avec l’emploi de tous les moyens que tolèrent les lois de la guerre.
Serait-ce une allusion à la mine ?
– Nous sommes prêts à combattre, commandant Rojo, mais non à nous rendre.
– Et les femmes et les enfants ?
– Nous les protégerons jusqu’à notre dernier souffle s’il le faut. Pour ce qui arrivera alors, il faut que nous nous en remettions à un autre.
– Votre réponse est-elle définitive ?
– Elle l’est. Si nous rendions cette forteresse nous salirions notre honneur en trahissant le devoir que nous avons reconnu comme étant le nôtre. Et l’Alcázar ne mériterait plus d’être l’école des officiers d’Espagne, mais le dépotoir de Tolède. Commandant ! l’Alcázar se transformera plutôt en cimetière qu’en fumier. C’est ce que je vous prie de dire à ceux qui vous ont envoyé.
– Là-dessus, ma mission paraît être terminée.
– Parfaitement. Mais je vous demanderai une chose encore, et cette grâce que l’on accorde à tout criminel, vous ne me la refuserez pas, bien qu’une lutte à mort nous sépare : envoyez-nous un prêtre.
Pendant quelques secondes, le commandant Rojo reste stupéfait. Il s’était attendu à tout autre chose, à une requête concernant quelque faveur matérielle, motivée par une raison quelconque. . . mais non à cela.
Cet homme, ce colonel Moscardó, doit avoir une foi vivante et forte, du moment que dans de pareilles conditions il ne demande pas autre chose.
– Mon colonel, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu’on donne satisfaction à votre demande.
Les deux hommes échangent un bref salut, et on replace le bandeau sur les yeux du commandant.
Les deux officiers qui l’avaient accompagné le reprennent à la puerta de carros.
Quelques pas seulement, et tous trois ont disparus dans la ruelle par laquelle ils étaient venus.
Là-bas, on les attend.
Le commandant Rojo fait un petit signe de la main :
– Refusé !
Immédiatement le téléphone transmet la nouvelle.
Cinq minutes plus tard à peine, les premiers obus hurlent et éclatent dans un bruit de tonnerre contre l’Alcázar.
Le parlementaire qui n’est pas pris au sérieux
Il ne se passe guère de jour sans que la presse mondiale donne des nouvelles de l’Alcázar de Tolède. Et ce n’est pas avec de l’intérêt seulement, mais avec une sincère compassion que de nombreux lecteurs suivent la lutte héroïque de la garnison, cette défense qui dure depuis des semaines.
La situation des emmurés doit être terrible, sans la moindre possibilité de bouger, sans lumière, sans air, sans nourriture suffisante, sous le feu ininterrompu de l’artillerie lourde.
Et des femmes et des enfants dans cette forteresse. Quel peut être leur sort ; combien d’entre eux sont encore en vie ?
Le monde peut se faire une image approximative de la misère extérieure des défenseurs. Pourtant il ne connaît pas assez le courage, la ténacité, la volonté indomptable des défenseurs qui sont résolus à tenir l’Alcázar, fût-ce au prix le plus cher.
Ce qu’il ignore complètement, c’est la protection paternelle dont les combattants entourent les femmes et les enfants. Aucune femme, aucun enfant n’a encore été atteint d’une balle ennemie. Toutes les vies sont encore indemnes, seules deux vieilles femmes, l’une de soixante-dix, l’autre de soixante-douze ans, ont eu leur mort naturelle.
Ce que le monde ignore encore, c’est la touchante insouciance avec laquelle les enfants supportent les affres du siège.
Et ce qu’il ignore finalement, c’est l’indescriptible vaillance des femmes de l’Alcázar, vaillance qui trouve son expression glorieuse non en des actions héroïques isolées, mais dans l’acceptation continue et silencieuse des peines, des privations que chaque jour, durant cette vie dans les ténèbres et la crasse des sótanos, leur inflige à nouveau, vaillance qui se traduit dans l’héroïsme de la souffrance et dans la volonté de tenir aux côtés des hommes. Elles ne paralysent pas l’énergie de ceux-ci par les plaintes d’une molle faiblesse, mais elles l’encouragent et l’augmentent par la force endurante propre à la femme. Elles préfèrent mourir avec les hommes, s’il le faut, que vivre sans eux.
Le monde, que sait-il de tout cela ?
*
Au lendemain des négociations qui eurent lieu avec le commandant Rojo, le haut-parleur, vers le soir, retentit encore.
D’une ruelle protégée par des maisons situées entre elle et l’Alcázar, la voix arrive :
– Son excellence l’ambassadeur du Chili désire parler au commandant.
Moscardó l’a entendu de son bureau.
Qu’est-ce que cela signifie ? L’ambassadeur du Chili devant l’Alcázar ?
Puis une autre voix :
– Colonel Moscardó. Au nom du corps diplomatique je tente, moi, ambassadeur du Chili à Madrid, une démarche de conciliation. La vie des femmes et des enfants est garantie par le gouvernement de Madrid ; laissez-les sortir. Il ne leur sera rien fait.
Ah ! c’est encore la même chose : Reddition, extradition.
Hier, Moscardó n’a-t-il donc pas donné au commandant Rojo une réponse claire et décisive à toutes ces questions ?
Que signifient ces continuelles visites de parlementaires ? Veulent-ils nous mater ?
Ou bien les assaillants rouges se moquent-ils d’eux ? Pour quelle raison l’ambassadeur du Chili serait-il amené à jouer ici le rôle de médiateur ? Et à cette heure indue, et sans s’être annoncé au préalable ?
– Dites-moi, capitaine, ce parlementaire, est-il visible d’ici ? Quelle allure a-t-il ?
– À vos ordres, mon colonel. Il n’y a personne sur la place devant l’Alcázar. Ceux qui nous parlent doivent se trouver dans une rue voisine.
Pendant un moment, Moscardó reste indécis. Il n’ajoutera rien à ce qu’il a dit hier au commandant Rojo. D’autres négociations n’ont donc pas de sens.
D’ailleurs, qui sait au juste ce qu’est ce soi-disant parlementaire ? Tout cela n’est peut-être qu’une comédie des rouges.
– Toute cette histoire ne vous paraît-elle pas aussi quelque peu invraisemblable, cher capitaine ?
– À parler franchement : oui, mon colonel. Mais si c’était réellement l’ambassadeur du Chili, ne serait-il pas indiqué alors de le renvoyer à notre gouvernement de Burgos ? Les négociations avec les puissances étrangères sont son affaire et non la nôtre.
– Excellente idée. Faites-le-lui savoir. S’il est réellement l’ambassadeur du Chili, il ne pourra pas être blessé par cette réponse. Si ce n’est qu’un jeu des rouges, nous leur volons l’effet de la fin.
Le prêtre
Le 12 septembre, dès les premières lueurs de l’aube, les canons reprennent leur feu meurtrier. Coup sur coup, les obus arrivent, et le bruit sourd des détonations pénètre jusqu’au fond des caves. Pourtant il est presque un soulagement pour les femmes qui, dans le silence de la nuit, perçoivent nettement la foreuse sinistre qui ronge le rocher. Au début, ce n’était qu’un bruit vague, ininterrompu qui s’amplifiait insensiblement. À ce moment-là, les premières questions furent posées ; mais tant que cela était possible, les officiers évitaient d’y répondre. Puis on finit par avouer que c’était l’ennemi qui poussait une galerie de mine dans le rocher, mais que ce travail n’était pas encore assez avancé ; comme dans les autres cas, là aussi, les mesures nécessaires seraient prises à temps afin que les vies des femmes et des enfants fussent sauvegardées coûte que coûte.
Cela réussit à apaiser la première excitation nerveuse, mais il reste une inquiétude qui vous tourmente à l’intérieur et que le bruit, ébranlant le rocher tel un tremblement, nourrit sans cesse. Cela pèse sur le moral des femmes contraintes à vivre dans l’obscurité des sótanos où tout danger, et surtout un pareil péril invisible et souterrain, prend une apparence doublement menaçante.
Mais aujourd’hui, le 12 septembre, une singulière lueur illumine tous les visages, une joie rayonne dans tous les regards.
Un prêtre va venir, bien que pour trois heures seulement. C’est tout ce que le gouvernement madrilène a concédé. Mais il va venir, aujourd’hui même.
Quelques minutes avant huit heures, le feu se tait.
Un homme sort de la Calle de la Soledad, vêtu d’un complet de ville sombre, une croix dans la main droite. C’est Camarasa, le prédicateur de la cathédrale de Madrid, le prêtre.
Des officiers de l’Alcázar l’attendent à la puerta de carros. On lui bande les yeux, puis il entre.
Et c’est pour lui le même trajet que naguère pour le commandant Rojo, jusqu’à l’état-major du commandant en chef.
Là, le bandeau lui est ôté.
Moscardó le salue d’une voix grave.
– Je vous remercie, mon père, d’être venu à nous.
Dans les souterrains où deux longs corridors se rencontrent à l’angle sud-ouest, on dresse immédiatement un autel. Une simple table. Des nappes blanches la recouvrent sous lesquelles se dessine le rectangle de la pierre consacrée. Deux cierges répandent une lumière tranquille et claire. Dans les corridors, les femmes, les enfants et la plupart des hommes se rassemblent. Dehors, c’est le repos d’armes pour trois heures. On n’a laissé que les sentinelles indispensables pour s’assurer contre les surprises d’un manque de parole.
Dans le bureau du commandant, le prêtre confesse quelques officiers, des soldats et des femmes. Puis, vêtu des ornements sacerdotaux, il descend dans les casemates. À travers la double haie des hommes et des femmes, il avance jusqu’à l’autel. De là, il leur parle.
Quel spectacle s’offre à ses yeux.
Dans les premières rangées, il y a des blessés que l’on a amenés et couchés par terre ; derrière eux les enfants, debout, des enfants aux joues pâles et creuses, aux yeux cernés, dont le corps trop efflanqué est recouvert de toute espèce de bouts d’étoffe et de haillons.
L’aspect des femmes n’est pas différent. Toutes d’une pâleur transparente, la bouche serrée comme si, continuellement, elles retenaient une douleur que la joie de cette heure semble pourtant un peu alléger. Leurs cheveux sont en désordre, et leurs yeux brillent comme sous le coup de la fièvre, dans la lueur vacillante des petites veilleuses et la clarté des cierges.
Les hommes sont campés derrière. Leurs uniformes sont à peine reconnaissables, ils ont tous la même couleur unie, grise et sale ; ils sont déchirés de partout et grossièrement rapiécés. Leur physique est affaibli par la faim et toutes les privations. Les pommettes saillent dans les visages barbus, les yeux sont enfoncés dans les orbites, et les faces ont l’immobilité de la fatigue. Mais autour de la bouche il reste un trait dur, résolu : la volonté de combattre, de résister.
Le prêtre parle à ces hommes qu’il voit devant lui.
Sur leur visage à tous se lit la solennité de l’heure présente, mais aussi la menace sérieuse qui pèse sur eux, il n’a pas besoin de beaucoup de mots ; intérieurement, ces êtres sont prêts à tout : à vivre si Dieu leur accorde la vie, à mourir si Dieu la leur réclame.
Tous se sont mis à genoux et récitent l’acte de contrition et le confiteor. La prière de la foule résonne sous les voûtes souterraines, c’est la prière vraie et sincère d’hommes que l’ennemi n’a pas pu humilier, mais qui s’humilient eux-mêmes devant Dieu en s’agenouillant dans la poussière et en implorant la grâce et la miséricorde divine.
Le prêtre leur donne ensuite à tous l’absolution et commence le saint sacrifice qui n’a pas souvent été célébré dans une ambiance aussi misérable et lugubre, mais qui rarement a été accompagné de prières aussi ferventes, d’une foi aussi vive.
Les blessés et d’autres, nombreux, font la communion.
Le dernier « Deo gratias » est dit.
Le prêtre reprend le chemin du bureau du commandant. Il est bouleversé de ce qu’il a vécu durant ces heures.
Moscardó entre.
– Mon colonel, l’existence au fond de ces caves doit être terrible, épouvantable. La faim, l’obscurité, un air qui vous soulève le cœur, le danger imminent. . .
– Je sais : la mine.
– Mon colonel, si vous ne voulez pas vous rendre, laissez au moins partir les femmes et les enfants, donnez-leur la liberté.
Camarasa le dit d’une voix insinuante où passe comme un reproche.
– Je sais ce que vous pensez, M. l’abbé. Vous nous prenez peut-être, moi et tous mes hommes, pour des militaires ambitieux, avides de gloire, qui enferment cruellement les femmes et les enfants dans cette forteresse pour satisfaire leur vanité. Ce n’est pas moi qui vous donnerai la réponse ; car vous estimeriez que je suis partial. . . Ordonnance ! Appelez une femme !
– À vos ordres, mon colonel. Laquelle ?
– N’importe laquelle.
Quelques minutes d’attente.
La porte s’ouvre, et une jeune femme entre. Ses vêtements sont misérablement rapiécés et flottent autour d’un corps qui est devenu trop maigre pour eux. Elle ne porte pas de bas ; le cuir de ses souliers est déchiré ; ses cheveux pendent sur son visage cireux et cave. D’un geste rapide, elle les rejette en arrière ; elle est un peu troublée de se trouver brusquement en face du prêtre et du commandant en chef, et elle est encore tout essoufflée de l’effort qu’elle a dû faire pour monter les escaliers – ses forces se sont à ce point affaiblies.
– Je vous prie, M. l’abbé, posez-lui votre question, dit Moscardó au prêtre en reculant de quelques pas.
– Je viens de voir la misère terrible qui règne dans vos casemates et je voudrais vous demander ce que j’ai déjà demandé au colonel Moscardó. Toutes, vous pouvez sauver votre vie et quitter les pernicieuses ténèbres des sótanos. Sortez d’ici ! Le gouvernement vous garantit votre vie et la liberté.
Pendant quelques secondes, la jeune femme est comme figée. Tel un éclair, le dur regard de ses yeux sombres atteint le prêtre, tandis qu’avec fierté elle redresse la tête.
– Mon père, si Dieu le veut, il nous sauvera. Mais nous, toutes les femmes, jamais nous ne quitterons cette forteresse pour nous remettre entre les mains de l’ennemi. Et si les hommes doivent tomber, c’est nous qui prendrons les armes.
Camarasa a pâli. Après tout ce qu’il a vu, il ne s’attendait guère à un refus. Jamais il n’aurait pu prévoir tant de courageuse fierté.
Le temps est passé.
Camarasa s’en retourne, les yeux de nouveau bandés.
À la puerta de carros, on lui ôte encore le mouchoir, et il reprend le chemin par lequel il était venu.
Puis le silence inaccoutumé de cette journée est soudain envahi par la tempête de l’artillerie.
Nantie de nouvelles forces, la garnison de l’Alcázar se tourne vers l’avenir.
Si cela leur est demandé, ils sacrifieront même leur vie dans la lutte qu’ils mènent pour leur patrie.
En bas dans la cour, sur le socle en pierre du monument élevé au plus grand monarque d’Espagne, Charles-Quint, une parole est gravée en lettres d’airain, et la parole de ce grand homme est également la leur :
« SI EN LA PELEA VEIS CAER MI CABALLO
Y MI ESTANDARTE LEVANTAD PRIMERO
ESTE QUE A MI. »
« LORSQUE, DANS LE COMBAT, VOUS
VOYEZ TOMBER MON CHEVAL ET MON
ÉTENDARD, VOUS RELÈVEREZ D’ABORD
CELUI-CI, ET MOI ENSUITE. »
Des bombes d’avion – de l’antre côté
Le feu de l’artillerie lourde augmente toujours de violence. Les dégâts sont de plus en plus importants et particulièrement dangereux dans l’aile ouest, car, en cet endroit, les décombres ne s’amoncellent pas au niveau de la cour intérieure comme c’est le cas au nord, mais ils s’éboulent sur l’esplanade située en contrebas, si bien qu’ils n’offrent pas cette protection dont on bénéficie sur le côté nord.
Là-bas, la tour du Nord-Est a été démolie jusqu’à la dernière pierre, celle du Nord-Ouest est rasée jusqu’à sa base, et ses ruines ont dégringolé dans la rue qui conduit à la plaza Zocodover. C’est pourtant grâce à la destruction de cette tour, et plus précisément aux énormes blocs qui s’en détachaient, que les défenseurs se sont trouvés, tout à coup, dans une nouvelle position favorable. Sous la place principale, un couloir souterrain part de l’Alcázar en direction ouest ; il possède plusieurs fenêtres donnant sur la rue. Dans leur chute, les puissantes masses de pierre ont défoncé ce couloir, et le trou qui en résulte, semblable à une fenêtre, ouvre presque au Sud-Ouest Immédiatement les assiégés y ont placé une mitrailleuse légère qui permet de protéger la façade ouest de l’Alcázar contre les attaques. Et bientôt l’humour trouve un nom pour ce corridor muni de la mitrailleuse, nom qui fait fortune : « Le tunnel du Simplon. »
Autour du gobierno militer, la situation est inchangée : les soldats tiennent le bâtiment d’une main ferme et les milices rouges n’osent plus l’attaquer. Le canon de 75 a disparu. Grâce à la tactique supérieure des assiégés, il n’obtenait plus aucun résultat. Par ailleurs aussi, le feu de l’artillerie, malgré tout l’effet destructeur qu’il exerce sur les murs de l’Alcázar, n’a fait que très peu de victimes parmi les hommes. Il y a des jours où il n’y a ni mort, ni même blessé à déplorer, bien que les batteries rouges aient augmenté leur feu et que la moyenne journalière des lourdes pièces de 155 oscille autour de cent cinquante coups. Il faut y ajouter les innombrables obus de moindre calibre et le bombardement par avion dont l’intensité est variable.
Parmi les multiples obus qui tombent chaque jour sur l’Alcázar, il y a un nombre considérable de non-éclatés dont beaucoup s’exagèrent le caractère inoffensif ; tant et si bien que le colonel Moscardó est obligé, dans son ordre du jour, de les mettre en garde contre une trop grande insouciance, car, dit-il, « il est impardonnable que nous nous causions nous-mêmes les dommages que l’ennemi ne nous fait pas », et le journal, dans un entrefilet humoristique, constate qu’il est impoli de toucher des obus avant qu’ils aient eu l’occasion de remplir leur mission.
*
Dans toute cette misère et oppression, des évènements heureux se produisent périodiquement qui donnent aux assiégés l’impression d’être providentiels et, de ce fait, incitent leur ardeur au combat.
Un obus de 155 s’abat dans la cour de l’Alcázar et brise une des arches que supportent les colonnes ; les deux lourdes pierres dont elle se compose traversent, dans leur chute, un étroit puits au jour donnant dans les souterrains, au milieu d’un groupe de femmes et d’enfants. Mais voilà que personne n’est blessé.
Une bombe incendiaire met le feu dans la salle de dessin de l’Alcázar. Malgré le tir violent de l’artillerie rouge, les cadets, les phalangistes et quelques autres entreprennent de maîtriser l’incendie. Trois de ces gros obus de 155 arrivent à ce moment précis, et tandis que leurs prédécesseurs et successeurs éclatent tout alentour, aucun de ces trois-là ne fait explosion. Tous des ratés.
*
Dans le fracas des batteries, soudain le cri d’alarme : « Avion ! »
Trois énormes avions de bombardement viennent du Nord.
– Ils ont tout à fait l’air de vouloir encore gratifier nos têtes de bombes de cinquante kilos.
– Si seulement ils descendaient un jour si bas qu’on puisse leur envoyer un pruneau avec la mitrailleuse.
– Ne te fais pas d’illusion, Alejandro. Voilà un plaisir que, pour sûr, ils ne te feront pas.
– Faut dire qu’on ne peut guère avoir de pareilles exigences, grommelle Felipe d’un air goguenard.
Il se tient au périscope et observe la batterie que l’ennemi a placée au nord.
– Fuego ! crie-t-il ensuite du côté de la cour, puis : Z-z-z-z-z. . . boum ! Z-z-z-z-z. . . boum ! deux gros obus sifflent et éclatent. Lorsque les trois hommes relèvent la tête, les avions sont déjà tout près.
– Dis donc, dit Ramón en donnant un coup dans les côtes de Felipe qui s’est remis à observer la batterie.
– Alors quoi ?
– Ces avions ne viennent pas du tout pour nous.
– Mais il y a donc un second Alcázar par ici ?
– Non, mais. . .
– Fuego !
– . . . mais ce sont peut-être des nôtres, chuchote Ramón, lorsqu’ils sont à l’abri, étendus par terre.
– Crois-tu ? Écoute, je commence à être. . . (Boum ! boum ! les deux obus !). . . enroué tant j’ai crié « Fuego ! ». Tu pourrais bien un peu me relayer au périscope, et moi j’observerais les avions à ta place. C’est d’ailleurs beaucoup plus difficile de contrôler le ciel tout entier que ces quelques canons, là en face.
– Toi, mon vieux, tu es un malin ! Mais du moment que ça te fait plaisir !
À présent, c’est Felipe qui distribue des coups dans les côtes de Ramón.
– Tu as eu raison. Allez-y toujours avec vos bombes, ce sont des nôtres. Plaçons-en une ici, voilà ! Mais pas dans le fleuve, par exemple. Ou bien serait-ce que les rouges veulent nous attaquer à la nage ? Dans ce cas-là, nous nous en chargerions.
C’est ainsi que Felipe, dans son enthousiasme, se complaît dans des monologues et des dialogues avec les avions là-haut dans le ciel.
– Tu vois, Ramón, comme les batteries se sont tues ? Continuez toujours de cette façon ! Quelques petites bombes en face me font plus de plaisir que dix caisses de sardines chez nous. Oh ! là, là ! Tu m’as vu le calibre de celle-ci ? Avec ces bombes nous serons plus vite délivrés qu’avec des sardines ; ce qui ne veut pas dire qu’elles n’ont pas été bonnes.
– Enfin, Felipe, depuis quand fais-tu tant de discours ?
– Depuis que nos avions sont là ; ça vous rend bavard comme lorsqu’on boit un bon vin. À propos, il y a longtemps que je n’en ai plus bu. Maintenant, ils passent au-dessus de nous. . . Viva España ! Tu ne peux donc pas crier avec moi, Ramón ? Viva España, viva España !. . . Voilà, ils sont partis. Pourquoi n’as-tu pas crié ?
– Ils ne l’entendent quand même pas.
– Mais je m’en fous !
À la recherche de la mine
Les miliciens rouges sont pleins d’imagination dans le choix de leurs moyens de combat. Ils ont déniché en ville des parents de défenseurs de l’Alcázar, des épouses, des sœurs, et la fiancée d’un soldat.
– Va chercher un peu de tabac, du linge frais et puis viens avec nous. Tu pourras tout faire parvenir à ton fiancé.
– Vraiment ?
– Oui, oui ; dépêche-toi !
Toute à sa joyeuse attente, la jeune « novia » de Florentino se procure le nécessaire, ensuite on l’emmène à l’hôpital Santa Cruz.
– Voilà. Ton novio est là en face. Mets-toi dans cette fenêtre. Et maintenant, dis-lui qu’il vienne chercher ces affaires.
– Mais. . .
– Nous ne lui ferons rien, il n’a qu’à venir. Gare à toi si tu dis autre chose. Tu vois ce revolver, il est chargé ; c’est lui qui te surveille. Compris ?
C’est ainsi que la petite fiancée, sous la menace du revolver braqué dans son dos, appelle son Florentino, et lui dit de venir, en lui montrant ce qu’elle lui a apporté.
Et lui de répondre que cela lui est impossible, mais qu’elle n’a qu’à venir, elle, qu’aucun des siens ne tirerait.
À son tour, elle réplique que ça ne va pas, mais qu’il peut bien risquer ces quelques pas.
– Demande-lui de se rendre, et il sera libre, chuchote la voix dans son dos, et le revolver l’accompagne d’un coup stimulant.
De cette façon, le dialogue s’échange de part et d’autre ; mais par ce moyen non plus, les miliciens n’obtiennent rien.
*
La fermeté des défenseurs est inentamée et leur courage inébranlable, et cela non seulement dans la défense passive, mais également dans l’agression.
Pour ce soir-là, on a projeté une sortie : rien qu’un essai, mais il faut le tenter.
Les bruits de foreuse s’amplifient et se précisent dans le rocher ; il est même assez probable que l’ennemi pousse deux galeries vers l’Alcázar en partant dans des directions différentes.
On ne sait pas exactement où se trouve l’entrée de la galerie souterraine. Pourtant, à quatre-vingts ou cent mètres au Sud-Ouest de la forteresse, on aperçoit chaque soir une puissante lumière. C’est de là que vient le ronflement du moteur.
Si on réussissait à découvrir l’orifice de la galerie et à le détruire avec quelques grenades à main, on retarderait l’explosion de la mine.
*
– Capitaine Vela, je vous remercie d’avoir volontairement accepté la direction de cette sortie. Essayez de pousser jusqu’à l’endroit où nous supposons que se trouve l’entrée ; mais pas à un prix de vies humaines qui serait trop élevé.
– À vos ordres, mon colonel.
*
Il est deux heures du matin, l’heure à laquelle le paqueo des rouges est le plus faible – ce n’est que vers l’aube qu’il retrouve sa violence.
Dans l’Alcázar, derrière la porte ouest, quarante hommes se tiennent prêts : des soldats, des guardias, des cadets, des officiers, tous volontaires. Voici le capitaine Vela.
– Tout est au point ? Grenades à main, carabines ?
D’un rapide regard, il inspecte ses hommes.
– Bon, en avant ! Vous savez de quoi il s’agit.
Sans bruit, la porte s’ouvre dans l’aile ouest de l’Alcázar, la puerta de carros.
Cinq hommes partent à fond de train, les grenades à la main ; en pleine course ils les lancent dans les proches maisons que les milices rouges ont occupées.
Les autres profitent de ce premier moment d’affolement de l’ennemi pour suivre et se ruer dans les maisons.
Les miliciens, complètement désemparés, se mettent à fuir à travers les maisons qui ont des issues de toute part. Les hommes de l’Alcázar sont à leurs trousses.
Une barricade des assiégeants bloque une ruelle qui, à l’Ouest de la forteresse, descend vers la ville. Elle est contournée au Sud dans le premier élan de cette chasse à travers les maisons. On y jette quelques grenades, et ses occupants sont tués ou mis en fuite.
Les maisons situées de l’autre côté de la ruelle doivent être également nettoyées des ennemis, sinon les volontaires qui effectuent la sortie pourraient être pris à revers, à l’intérieur des maisons, sans que les hommes postés dans les fenêtres de l’Alcázar fussent à même de l’empêcher. Ceux-ci d’ailleurs ne peuvent guère faire autre chose qu’éviter qu’un détachement ennemi passe droit devant l’Alcázar et coupe, avec de nombreuses forces, la rentrée des volontaires.
Dans les immeubles d’en face, l’attention de l’ennemi est éveillée depuis un moment ; mais son front d’attaque y est dirigé du côté de l’Alcázar ; et maintenant il est pris sur son flanc qui est à découvert. Vainement, les miliciens essayent au dernier moment de changer encore de front. Comme ils n’ont aucune expérience de tactique et sont sans chef énergique, ils s’enfuient dès que les premières balles et grenades ont fait des victimes dans leurs rangs.
À l’abri de la barricade, un groupe des volontaires de l’Alcázar traverse la ruelle et occupe les maisons que les miliciens viennent d’abandonner. Lentement, les combattants avancent ensuite dans les maisons des deux côtés de la rue.
C’est une lutte âpre et dangereuse.
Il fait nuit noire. Les vieilles maisons sont enchevêtrées les unes dans les autres, tout en recoins et en saillies, avec des issues en tous sens qui ont facilité la fuite rapide des miliciens mais qui pourraient leur permettre un retour tout aussi foudroyant.
Le capitaine Vela est partout. Il tire, il donne des ordres, il encourage sa troupe et enregistre au fur et à mesure les avantages et les inconvénients de la situation.
– Trois hommes à gauche pour couvrir le flanc !
– Feu continu dans la ruelle !
Puis il avance encore, avec quelques-uns de ses hommes, par la porte d’une cour intérieure dans la maison suivante. Derrière le rebord d’une fenêtre, un milicien est aux aguets, le fusil en joue. Mais Vela le devance d’une fraction de seconde ; le coup de son pistolet part le premier.
Toujours en avant.
Quelques hommes restent encore pour couvrir le flanc.
Les grenades fraient le chemin à travers les maisons, ces maisons qui se dressent, menaçantes, dans l’obscurité et dont on ne sait jamais si elles sont occupées par l’ennemi. Les hommes de l’Alcázar suivent le passage ouvert par les grenades.
Le groupe qui combat au nord de la ruelle est arrivé jusqu’à une petite place. Il faut qu’il y reste pour assurer le retour.
Au Sud, l’autre groupe, qui est plus fort, est arrivé jusqu’à une étroite ruelle au delà de laquelle l’ennemi a des positions plus sérieuses ; car là, les miliciens ont eu le temps de se préparer et d’attendre l’adversaire.
De part et d’autre, le feu des carabines crépite sauvagement. La ruelle n’a que trois mètres de large. Les miliciens ont l’avantage d’être dans des maisons plus hautes. C’est de là qu’ils tiraient sur l’Alcázar, par dessus les toits des maisons situées au premier plan. Mais les miliciens n’ont fortifié que les étages supérieurs des maisons qu’ils occupent. Et Vela tire parti de cet avantage.
Plusieurs de ses hommes restent sur place pour continuer à combattre les miliciens postés dans ces étages. Mais lui-même redescend avec un autre groupe jusqu’au rez-de-chaussée. Quelques grenades et un feu nourri nettoient la partie inférieure de la maison d’en face. Un saut et Vela s’y trouve à son tour.
Le groupe resté sur la petite place a suivi cette manœuvre et tire sur le flanc des miliciens ; ceux-ci, reconnaissant leur périlleuse situation, s’enfuient encore.
Plus Vela avance victorieusement, et plus son équipée devient dangereuse. C’est là le trait caractéristique de tout combat de rue, et surtout d’une pareille lutte dans les maisons. Dans toute la ruelle que Vela vient de traverser, les maisons en descendant sont occupées par des miliciens. Ils sont considérablement supérieurs en nombre. Depuis que le groupe qui combat au Nord s’est séparé de lui, et que des hommes isolés jalonnent le chemin du retour, le peloton de Vela s’est singulièrement réduit. Mais le nombre de ceux qui participent à cette sortie devait être restreint, sinon la première avance brusquée n’aurait pas réussi, car un détachement quelque peu important eût été une cible trop facile pour le feu de l’ennemi.
Malgré certains scrupules, Vela continue d’avancer avec ses hommes.
C’est qu’il y a la mine, la mine !
À présent, ils sont obligés de gagner pièce après pièce. Le feu des pistolets zèbre l’obscurité. De temps à autre, une lampe de poche éclaire une chambre pendant une fraction de seconde. Des visages, des fusils surgissent et disparaissent, des coups de feu claquent, cherchant leur but. De cette façon, la troupe de Vela va jusqu’à la Calle de Juan Labrador. C’est là que doit être l’entrée de la galerie, mais à cinquante mètres plus au Sud.
Le capitaine, suivi de quelques hommes, traverse la rue en trombe, jusqu’à un petit tournant. Là-bas, plusieurs miliciens sont accroupis derrière un abri hâtivement dressé.
Serait-ce que l’entrée de la galerie de mine se trouve à cet endroit ?
Des coups partent. Derrière l’abri deux hommes tombent et se traînent péniblement dans l’entrée d’une maison.
C’est là que doit être le but.
Y aller ?
Non, c’est impossible.
L’ennemi a fait venir du renfort de la plaza Zocodover, et d’un feu efficace il peut balayer la rue que les hommes de Vela seraient obligés de descendre. Le petit groupe qui combat au nord est impuissant contre ce danger. D’ailleurs, les premiers coups fusent déjà. Le chemin est barré.
Il est impossible de pénétrer plus avant dans les maisons au sud. Les forces considérables que l’ennemi a logées dans les immeubles de l’étroite petite ruelle que Vela a traversée et des détachements qui seraient venus s’y joindre pourraient écraser les hommes de l’Alcázar en les prenant dans le dos.
Et Vela n’a pas le droit de risquer imprudemment la vie de ses hommes. Jusqu’à présent, il n’y a pas eu un seul mort, et il n’est pas permis maintenant de mettre en danger le peloton tout entier pour une action presque sûrement vouée à l’échec et qui n’est pas nécessaire d’une façon absolue.
La retraite.
Pour Vela qui, impétueux, veut toujours foncer sur l’obstacle, il n’est pas facile de donner pareil ordre.
Mais il le faut.
Au dessus de la volonté individuelle, il y a la responsabilité à l’égard de tous.
« Mais pas à un prix qui serait trop élevé. » Moscardó le lui a dit.
La retraite.
Mais au moins ils emportent tous les vivres trouvés dans les positions des rouges.
Sans une seule perte, la petite troupe regagne l’Alcázar qu’enveloppe la nuit.
La mine
Une fois de jour, une fois de nuit, ils répètent leur tentative pour arriver jusqu’à l’endroit où l’on présume que se trouve le point de départ de la galerie souterraine. Mais toutes deux échouent. Il aurait fallu une avance sanglante et sans égard, dont auraient été victimes, dans ce meurtrier combat de rues et de maisons, de nombreux défenseurs de l’Alcázar, sans que la grandeur d’un pareil sacrifice eût été justifiée par l’ampleur du succès – d’ailleurs incertain. Le colonel Moscardó ne le veut pas.
À présent, les bruits sont nettement et fortement perceptibles.
À l’intérieur du rocher qui porte la forteresse, il y a comme un grondement, un ébranlement ou une vibration.
Les perforatrices se fraient le chemin dans le dur granit, toujours plus près de l’Alcázar, dont la tour au Sud-Ouest se dresse encore fièrement, comme fièrement lutte la garnison.
Avide, le métal perce la pierre dans un grincement. Toujours plus fort, toujours plus près.
Ce sont les heures les plus épouvantables que vivent les femmes et les enfants dans leurs prisons souterraines de l’Alcázar.
Toujours ce bruit vorace de foreuse dans l’oreille, et toujours la peur d’un brusque déchirement de la terre dans le cœur ; plus que le rocher, cela mine la force des femmes.
Mais elles tiennent bon, ces femmes, en s’appuyant les unes sur les autres, et leurs journées et leurs nuits blanches se passent en prières muettes mais insistantes.
D’après la différence des bruits, il est permis de croire avec certitude que deux galeries percent le rocher de l’Alcázar : l’une allant vers la tour sud-ouest, l’autre vers le milieu de l’aile ouest.
On ne peut pas dire à l’avance quand les mines sauteront ; mais il est sûr que l’ennemi, le travail une fois achevé, ne retardera pas d’un jour l’explosion. Mais jusqu’à quel endroit veulent-ils faire avancer leurs galeries sous l’Alcázar ?
Pour parer à toute éventualité, le colonel Moscardó a fait évacuer à temps les parties menacées de la forteresse. Les femmes et les enfants qui avaient été logés dans la zone dangereuse déménagent dans la partie est des caves et vont habiter la piscine souterraine des cadets.
L’infirmerie est transférée dans l’ancienne chapelle de l’aile nord, là où, depuis longtemps, les chevaux et les mulets ont été placés dans les couloirs, à l’abri de l’artillerie ennemie.
La chapelle à son tour est transférée dans la partie sud, à la périphérie des lieux menacés.
La zone dangereuse tout entière est déclarée « terrain interdit » sur lequel plus personne n’a le droit de pénétrer.
Ainsi, tout a été réalisé de ce qui pouvait être fait.
À quel moment la mine va-t-elle sauter ?
Avec la violence accoutumée, les canons tirent sur l’Alcázar. D’énormes brèches ont entamé l’aile ouest ; la maison d’habitation et le bâtiment scolaire des cadets sont presque détruits ; quelques murailles seulement tiennent encore. Les plafonds, les cloisons, tout est à bas.
L’aile nord ne forme plus qu’un seul amas de ruines qui, à l’intérieur et à l’extérieur, montent en pente douce jusqu’à la hauteur du premier étage, c’est-à-dire jusqu’à la grande galerie qui fait le tour de la cour.
C’est l’heure du crépuscule. Déjà à l’est, le paysage est gris et mort, dans ce stade intermédiaire entre la lumière vivante du jour et les ténèbres animées de la nuit.
Le soleil a disparu à l’Ouest, mais ses derniers rayons s’accrochent à un nuage, vaisseau qui vogue dans la clarté du ciel, et le rougissent d’une teinte claire comme la joie. . . ou comme un sang jeune et frais.
Subitement, les couleurs se sont évanouies, et les nuages ont pâli dans le ciel.
Et la nuit est venue ; la nuit du 17 au 18 septembre, la nuit du jeudi au vendredi.
Mais autour de l’Alcázar, point d’obscurité. Depuis plusieurs nuits déjà, l’ennemi a placé de puissants projecteurs qui lancent leur lumière crue sur les murs de la forteresse afin d’en faire, même pendant la nuit, la cible des obus destructeurs et afin de rendre plus difficiles les sorties téméraires des assiégés. Mais cela ne suffit pas : les miliciens ont semé autour d’une partie de l’Alcázar toute espèce de débris de fer blanc dont le cliquetis trahirait ceux de la citadelle qui voudraient tenter une sortie. Ainsi ce qui échappe aux yeux des assaillants, se révèle à leurs oreilles.
*
Dans l’ombre de la nuit, des mineurs des Asturies sont au travail. La galerie a été profondément avancée dans la masse du rocher : un étroit corridor qui, au delà d’une entrée spacieuse, se rétrécit de telle façon qu’un homme y pénètre baissé seulement, à son extrémité il s’élargit en une sorte de caverne. Sur une distance de plus de quatre-vingts mètres, les deux galeries, partant des caves sûres de deux maisons, passent sous terre.
Peinant et haletant, les mineurs portent la charge d’explosif dans les galeries : deux mille kilos de dynamite dans chacune. Le mécanisme qui les fera sauter est installé, la conduite, après avoir parcouru la galerie, continue au dehors jusqu’au grand séminaire qui se trouve à plus de cinq cents mètres de l’Alcázar. Les galeries sont murées avec soin. Tout est prêt.
Dès l’aube, des crieurs publics parcourent la ville de maison en maison :
– Quittez la ville. Ceux qui y restent le font à leurs risques et périls. La mine va sauter.
Sous la lumière blafarde du matin, un cortège de Tolédans effarouchés, encombrés de toute espèce de paquets, longe les rues et quitte la ville par les ponts au Sud et à l’Ouest.
*
Dans l’Alcázar, les sentinelles veillent. Ombres muettes, elles se tiennent debout, assises ou accroupies derrière les parapets ou à l’abri des fenêtres.
Au début du siège il faisait jour entre quatre et cinq heures. Entre temps, deux mois ont passé et le soleil hésite plus longuement avant de paraître.
Les premières lueurs de l’aube percent. À cet instant, un coup de feu part d’un des canons ennemis.
– Fuego !
La sentinelle a lancé son cri au Nord.
– Fuego !
Le même cri à l’Est.
C’est la brutale arrivée des obus qui éclatent dans leur fracas de tonnerre. Les coups se succèdent avec une telle rapidité que leurs bruits se mêlent. Six pièces lourdes et quatre légères crachent de leur bouche noire l’éclair du feu et le hurlement des obus.
Une seule fois, la première, les sentinelles placées au Nord et à l’Est dans l’Alcázar ont poussé, durant cette heure, leur cri d’alarme ; ensuite la tempête ininterrompue des canons était une alerte suffisante.
*
Prudemment et sans se montrer, les assiégeants postés à proximité de l’Alcázar se retirent pour se garer de la chose terrible et inconnue qui se prépare. Ayant quitté leurs positions, ils se rassemblent avec d’autres forces au nord de la ville, entre la porte de Visagra et celle de Cambrón. Ils sont quatre mille hommes : guardia de asalto et milice rouge, prêts à l’assaut, nantis d’armes, de munitions et de grenades à main, en partie montés sur des camions qui les mèneront immédiatement sur les lieux du combat.
Dans les sótanos de l’Alcázar où tout le monde a été tiré d’un sommeil agité par le grondement des canons, les femmes et les enfants, les yeux grands ouverts de terreur, écoutent les sauvages explosions des obus, et leurs mains se joignent pour une prière muette.
*
Dans la partie nord-ouest de l’Alcázar, le lieutenant Cuesta se tient avec six hommes de la guardia civil. Pendant près d’une heure il reste dans le feu déchaîné de l’ennemi qui, du Nord et de l’Ouest, défonce la forteresse et qui les incite avec tant de persuasion à se retirer dans la tour du Sud-Ouest. Les obus sifflent autour du lieutenant et de ses six hommes, projetant leur métal meurtrier, perforant les cloisons et les murs si bien que ceux-ci s’effondrent.
Sans cesse, la mort menace ces hommes.
Il faut quitter ce poste avancé qui ne sert qu’à rejeter l’assaut des masses ennemies, assaut que rien, en ce moment, ne laisse prévoir.
Fuyant la mort, les sept hommes se retirent en courant. À cet instant précis, le feu cesse d’un seul coup, et dans l’air il y a pendant quelques secondes le silence angoissant qui tremble entre deux évènements terribles.
Lorsque les sept hommes dépassent l’aile ouest, à cinq cents mètres d’eux, un petit bouton est pressé. À une vitesse vertigineuse l’étincelle électrique parcourt le chemin que lui impose le fil. . .
Un fracas formidable déchire le silence. La terre tremble, se soulève, se fend intérieurement avec une force inimaginable qui lance la tour, des murs et des étages entiers à cent mètres au-dessus du sol.
Pour un instant, les masses de pierres semblent rester suspendues en l’air, puis elles retombent en s’éparpillant en tous sens et tandis que le roulement de tonnerre persiste toujours, une énorme fontaine de terre et de poussière jaillit vers le ciel.
L’assaut
Tandis que les gardes de la forteresse ont aperçu, avec un frisson de terreur, le déchirement de la terre et que le vacarme seul a failli les projeter par terre, l’explosion ne s’est guère manifestée autrement qu’un coup de canon proche et puissant, dans les casemates de l’Alcázar qui ont été envahies, pendant quelques minutes, par une opaque fumée noire.
La mine ! Tous le savent et en ressentent de la frayeur, le temps de quelques pulsations.
La mine. . . Et déjà leur cœur se sent soulagé.
À travers le nuage de fumée qui couvre les lieux de l’explosion, on commence à reconnaître l’effet du sinistre. La tour sud-ouest tout entière avec une partie de l’aile attenante a été arrachée puis disloquée, il en est de même de toute la partie centrale de l’aile ouest, démolie de fond en comble. Il n’y a plus que le mur donnant sur la cour intérieure qui reste en partie debout.
*
Les camions qui transportent les miliciens, et dont les moteurs avait déjà été mis en marche lorsque la mine fit explosion, démarrent et amènent les détachements prévus pour l’assaut sur les emplacements qui leur sont destinés.
De trois côtés différents, l’attaque est simultanément déclenchée contre la masse éventrée de la forteresse. L’offensive la plus dangereuse se fait au Nord.
Des guardias de asalto escaladent audacieusement le tas de décombres sur le front nord de la forteresse que les défenseurs n’ont pas occupé parce que là, ils ne s’attendaient pas à une attaque possible. Déjà, les guardias de asalto ont atteint la hauteur de ces décombres et plantent en triomphe le drapeau rouge parmi les ruines. Ils pénètrent ensuite dans les pièces du premier étage de l’aile ouest où il n’y a pas de défenseurs non plus et où, après vingt mètres, on se trouve sur l’à-pic de l’entonnoir que la mine a creusé.
L’ennemi est dans l’Alcizar !
Au rez-de-chaussée qui donne sur le front ouest où l’ennemi, au même moment, tente une offensive à travers la brèche faite par la mine, il y a des officiers et des hommes qui ne se doutent pas de ce que l’ennemi est au-dessus d’eux.
À travers les trous percés par les obus de leurs canons, les guardias de asalto lancent des grenades à main dans la cour et les étages inférieurs.
Ces grenades éclatent au milieu des hommes brusquement surpris. Le commandant Herrera, le capitaine Pastor tombent, mortellement touchés ; et huit autres sont blessés. Des renforts de la guardia de asalto avancent à leur tour à travers les décombres.
L’ennemi gagne du terrain !
C’est alors que riposte le feu des défenseurs. Les guardias civils, postés dans le premier étage de l’aile est viennent de s’apercevoir que les rouges ont pénétré dans l’autre aile du bâtiment. Ils déplacent immédiatement leur front de l’Est à l’Ouest et fournissent un feu puissant à l’ennemi qui se trouve au même niveau qu’eux, de l’autre côté de la cour.
De part et d’autre, la lutte est enragée. À l’abri derrière des gravats, les adversaires se font face à trente mètres de distance.
Les balles s’abattent à un rythme foudroyant sur les positions des uns et des autres.
C’est une question de vie ou de mort. C’est la phase décisive.
Des deux côtés, il y a des blessés. Les agresseurs ramènent les leurs en lieux sûrs. Mais aucun nouveau renfort ne vient à leur aide. Au dehors, face aux ruines, il y a des miliciens rouges, mais ils n’osent pas monter à l’assaut.
On tire également sur les agresseurs de l’angle sud-est de la cour.
C’est un déchaînement sauvage : les carabines et les mitrailleuses crépitent, les grenades éclatent.
En bas, dans la cour, se tient le colonel Moscardó. Avec calme, circonspection et audace, il dirige la manœuvre.
Plusieurs petites échelles sont rapidement mises bout à bout pour en former une grande qui atteigne la hauteur du premier étage. Vingt hommes traversent la cour pour aller chercher les blessés. Ils emportent cette échelle. Le lieutenant Oliveros et quelques officiers les suivent, le pistolet à la ceinture, en main des grenades prêtes à être lancées.
Le feu des guardias de asalto qui ont pénétré dans la forteresse faiblit. Ils ont de grosses pertes et restent toujours sans renfort. Ces quelques hommes peuvent à peine tenir leurs positions.
Du côté nord, un capitaine de la guardia de asalto escalade les ruines. Le voici au sommet de celles-ci, à l’endroit même où flotte le drapeau rouge. Le revolver dans la main levée, il se retourne du côté des miliciens rouges restés en arrière au bas des décombres et leur crie :
– Cobardes, seguirme ! Lâches, suivez-moi !
Mais ces lâches ne suivent pas leur chef courageux. Sous la rafale de balles qu’envoient les assiégés de l’Alcázar, il s’effondre, blessé à mort.
Lorsque le lieutenant Oliveros et les autres officiers montent l’échelle adossée au mur et pénètrent par un trou dans le premier étage, ils n’y rencontrent plus un seul adversaire, il n’y a plus que quelques coiffures ensanglantées de guardias de asalto et le drapeau rouge qui, solitaire, claque au-dessus des ruines.
L’ennemi a été expulsé de l’Alcázar et rejeté sur tout le front nord ; et aux deux autres points de l’attaque il en est de même.
À l’Ouest les masses qui montaient à l’assaut ont été tellement décimées par le feu que, du « tunnel du Simplon », on envoyait dans leur flanc qu’elles ont été obligées d’interrompre leur attaque et de se replier. Au Sud-Est également, bien que l’ennemi ait fait entrer en action un char d’assaut afin d’attaquer le bâtiment de la compagnie et d’y déployer son front, les rouges n’ont pas pu avancer d’un pas.
La bataille du 18 septembre livrée autour de l’Alcázar est perdue pour les assaillants rouges, malgré les deux énormes mines, malgré le nombre considérable d’hommes envoyés à l’assaut, malgré toutes les pertes que les défenseurs ont subies.
Dans la forteresse, ce jour-là, un enfant est venu au monde.
L’abandon des postes extérieurs
Le 20 septembre au petit matin, un puissant feu d’artillerie, venant surtout du Campamento, reprend encore contre la façade ouest de l’Alcázar et l’esplanade.
Et ce sont de nouveau les attaques brusquées de l’ennemi.
Vainement, les assaillants, après une forte préparation fournie par le feu de l’artillerie, essaient de s’emparer du gobierno militar.
Toutes ces tentatives en vue de le conquérir se brisent contre le courage et l’abnégation des soldats qui y sont cantonnés. Ces hommes accomplissent de véritables tours d’héroïsme.
Bernardo qui sert sa mitrailleuse au milieu d’une pluie de balles sent brusquement une douleur lancinante dans sa jambe droite. Un rapide coup d’œil lui révèle qu’il est blessé, sans doute par un ricochet de balle.
Sans lâcher sa mitrailleuse il arrache sa ceinture de cuir et en entoure sa jambe afin de la lier, car le sang coule abondamment de sa blessure. Puis il continue son feu, en ramassant ses dernières forces. Les dents serrées, la volonté violemment tendue, il tient tandis que les ennemis montent à l’assaut, et sa mitrailleuse fauche leurs rangs. Durant toute une heure, il lutte contre eux, en dépit de sa blessure. Puis il est relevé.
Pablo qui a quatorze ans se révèle de nouveau comme un aide fidèle. L’esplanade est prise sous le feu acharné des pièces ennemies. Il est impossible aux porteurs de repas de la traverser. Le groupe du gobierno militar est forcé de tenir pendant toute la journée, à peu près sans manger. La seule chose qu’on trouve encore dans une petite réserve gardée sur place, c’est, pour chaque homme, un petit bout de saucisson sec à peine long comme un doigt. Mais le pire, c’est la soif. Et il n’y a pas d’eau. C’est encore le petit Pablo qui ne peut pas combattre comme les autres, mais qui peut rendre des services tout aussi importants, qui fait la navette et leur apporte à boire.
Non seulement contre le gobierno militar, mais également contre la façade nord de l’Alcázar même, l’ennemi déclenche une nouvelle attaque afin de parvenir à travers les ruines à l’intérieur de la forteresse. Mais les défenseurs se tiennent sur leurs gardes. À l’extrémité nord de l’aile est, au milieu des décombres, on a logé un poste avec une mitrailleuse et à d’autres endroits, des détachements de fusiliers.
Empruntant le chemin en zigzag, les rouges se glissent aussi près que possible, puis se ruent sur la place ; mais le feu des défenseurs arrête l’élan des assaillants, et ceux-ci font demi-tour.
Apparaît alors un tank muni d’une pièce de 75 qui bombarde à une distance de quarante mètres les positions des assiégés. Mais ceux-ci évitent le feu du canon par d’adroites manœuvres et empêchent en même temps, par leur propre tir, que l’ennemi avance à l’abri du char d’assaut.
Après plusieurs élans infructueux, le tank se retire à son tour. À présent, les rouges en viennent à leur ultime ressource : une fois de plus, ils se servent d’essence que, du fameux chemin en zigzag, ils lancent en grande quantité. Elle est accompagnée de bombes incendiaires. Mais le jet d’essence qui, traversant la place, arrive à peine jusqu’aux ruines ne trouve rien d’inflammable dans les pierres disloquées par des milliers d’obus. L’essence brûle donc d’une grande flamme sifflante sans provoquer le moindre dégât.
Les agresseurs se retirent, il semble cependant qu’ils se soient nichés quelque part dans les lacets du chemin et projettent d’y rester ; car, continuellement, des coups de feu fusent de là-bas.
C’est une proximité périlleuse pour les défenseurs ; de nuit surtout, une attaque brusquée est à craindre. Voilà pourquoi Moscardó, malgré le feu de l’artillerie qui a encore repris, ordonne une avance soudaine et énergique.
Les hommes de l’Alcázar montent à l’assaut, baïonnette au canon ; une lutte sanglante s’ensuit qui cause également des pertes aux défenseurs mais qui rejette l’ennemi et conjure le péril.
Mais déjà un nouveau problème se pose, sérieux entre tous.
Les dévastations que les batteries rouges causent dans l’aile ouest de l’Alcázar sont de plus en plus importantes. En partie par des obus bien dirigés, en partie par les débris qui tombent du haut des murailles, les entrées de l’Alcázar de ce côté-là sont de plus en plus ensevelies. Si elles venaient à être complètement recouvertes, tous les détachements qui s’occupent de la défense à l’extérieur de la forteresse proprement dite se trouveraient isolés, leur retraite serait coupée et eux-mêmes perdus.
Le « paso curbo » par lequel on accède ordinairement à l’Alcázar sur le côté ouest n’est plus praticable. Il ne reste plus qu’une voie d’accès, à peu près au milieu de cette façade ; mais celle-ci aussi est déjà à demi ensevelie, et de jour, on ne peut s’en servir qu’en encourant un maximum de danger, car elle est exposée en entier au feu des mitrailleuses que l’ennemi a placées sur l’autre rive du Tage.
Toutes ces considérations amènent Moscardó au même résultat qui s’impose : il n’est plus possible d’éviter l’abandon de la totalité des postes extérieurs.
Dans cette décision, une chose est douloureuse : avec toutes ces positions-là il est obligé de laisser aussi aux mains de l’ennemi le manège démoli et les tombes des morts de l’Alcázar. Mais il n’a pas le droit de sacrifier les vivants aux morts.
Moscardó ordonne la retraite pour sept heures du soir. Tout va mieux que l’on n’osait espérer. Les positions sont évacuées dans le calme et l’ordre, avec toute la prudence nécessaire. Rien de ce qui a quelque valeur ou quelque importance n’est abandonné.
À onze heures du soir, la retraite est effectuée. Cette manœuvre a été faite avec une telle rapidité et dans un tel silence que l’ennemi, soit par ignorance, soit par crainte d’un piège, n’entre que deux jours plus tard dans les positions abandonnées.
La lutte décisive
Cette retraite qui s’était avérée nécessaire n’a pu ébranler ni le courage ni les forces des assiégés. Ils sentent tous que la dernière phase de leur défense est arrivée et qu’il ne s’agit plus maintenant que de tenir l’Alcázar coûte que coûte, mais avec un minimum de perte.
Les avions des leurs ont fait des apparitions plus fréquentes au-dessus de Tolède et ont bombardé les positions des ennemis si bien que les rouges ont même été obligés de faire venir quelques canons de défense antiaérienne dont les succès sont cependant nuls.
L’enthousiasme règne parmi les défenseurs de l’Alcázar. Les troupes du colonel Yague qui doivent leur apporter la liberté ont pris Maqueda et se trouvent sur le chemin même de Tolède.
Les assiégeants rouges mettent tout en branle pour s’emparer tout de même encore de l’Alcázar.
Le feu de leur artillerie atteint une intensité et une violence comme jamais jusqu’alors. Quatre cent soixante-treize coups des lourdes pièces de 155 en un seul jour, sans compter ceux des canons légers, voilà le chiffre maximum durant ces journées et d’ailleurs durant le siège tout entier.
Un obus pénètre dans le bureau de l’état-major de Moscardó, au moment même où il s’y trouve avec un groupe assez important d’officiers. Sept d’entre eux sont blessés, mais tous légèrement ; le commandant en chef lui-même reste indemne. Cette nouvelle presque incroyable est accueillie avec joie par tous les hommes de l’Alcázar.
En ce qui concerne la position précise des libérateurs qui approchent, les nouvelles font défaut. Les postes de T. S. F. n’en donnent pas d’informations nettes. C’est d’ailleurs pendant ces jours-là que le colonel Yague tombe malade et que le général Varela prend à sa place le commandement de l’armée de secours. Mais les défenseurs de l’Alcázar aperçoivent d’autres signes annonçant la proche délivrance : les canons naguère situés au Campamento ont disparus un beau jour, les canons antiaériens de même.
Après avoir pénétré dans les positions extérieures qu’il avait fallu abandonner, les assaillants ont resserré leur cercle autour de l’Alcázar. À soixante ou quatre-vingts mètres de la forteresse, ils se sont terrés sur l’esplanade inférieure et dans la salle à manger des cadets que les obus ont détruite.
Comme ils n’ont jamais pu se saisir des défenseurs vivants, ils s’attaquent aux tombeaux des morts et arrachent les croix que les combattants de l’Alcázar avaient dressées comme symbole suprême à leurs frères d’armes tombés.
Vers le soir, les miliciens rouges recommencent leurs discours :
– Rendez-vous ! La colonne ne vient pas. Mais nous vous apporterons la tête de Yague.
Seul, un éclat de rire railleur répond à leurs gauches essais de persuader aux vainqueurs qu’ils se déclarent eux-mêmes les vaincus.
*
Dans la chapelle de l’asile de fous, Carmelo et sa mère sont toujours gardés prisonniers.
Les cheveux de la femme sont devenus gris ; autour de sa bouche, de profondes rides se sont creusées. Elle a perdu Luis, l’aîné. À présent, son mari aussi. Car elle a entendu l’explosion terrible des mines, et le gardien lui a confirmé ses craintes.
– De l’Alcázar, il ne reste exactement rien. Et ceux qui s’y trouvaient sont tous morts.
Lorsque Carmelo, qui a encore pâli et maigri, a entendu ces paroles il s’est réfugié auprès de sa mère.
– Maman, est-ce vrai ?. . . mais alors, nous n’allons jamais plus revoir Papa ?
Des sanglots secouent le corps de l’enfant ; et comme naguère, les larmes de la mère tombent sur ses cheveux. Alors, elle pleurait son fils ; aujourd’hui, son fils et son époux.
Et eux-mêmes que deviendront-ils ?
Pourvu seulement qu’on lui laisse Carmelo ! De ses deux bras, elle entoure les épaules de l’enfant qui, agenouillé devant elle, a enfoui son visage dans sa jupe.
*
Les pensées des défenseurs s’envolent au delà des étroites limites de l’Alcázar, au delà aussi des étroites limites du temps qui les sépare encore du jour de la liberté.
Qu’adviendra-t-il alors ? Reverront-ils leurs familles ? Est-ce que tout sera comme avant ?
À peine peuvent-ils s’en faire une idée, d’ailleurs. . .
– Non, il ne faut pas que cela redevienne comme avant ; pas comme il y a quatre mois, ni il y a quatre ans, ou six ou sept. . .
– Tu as raison, Joaquin. Non, nous n’avons pas combattu pour que tout reste comme auparavant, ni pour que tout continue dans cette éternelle lutte fratricide. Toute cette guerre d’aujourd’hui ne serait pas venue si l’état de choses avait été différent. . . meilleur.
Les têtes des jeunes et des vieux s’échauffent lorsqu’il est question de l’existence future de l’Espagne.
*
L’ennemi essaie à plusieurs reprises encore d’avancer sur le front nord, comme les fois précédentes, c’est-à-dire avec des tanks et des attaques brusquées.
Mais de nouveau toutes ces tentatives échouent en face de la résistance inébranlable des défenseurs qui ne connaissent aucune relâche.
Dans l’ordre du jour que le colonel Moscardó établit le lendemain, se manifeste toute sa légitime fierté quant aux troupes héroïques dont il est le commandant en chef :
« . . . ont été brillamment repoussées par les forces stationnées dans le secteur attaqué avec l’aide des troupes d’assaut. La tenue de tous ceux qui y ont participé me remplit de fierté, et je tiens à leur exprimer ici mes félicitations les plus chaleureuses, tant aux hommes qu’aux chefs. Au cours de l’action à laquelle j’ai assisté à ma grande satisfaction, j’ai acquis la conviction que si nous restons tous à notre poste avec ce moral excellent qui était déjà de tradition dans vos entreprises, nous pouvons être sûrs que l’ennemi ne mettra jamais le pied sur ce sol que votre attitude a sacré. J’ose espérer que dans un proche avenir nous pourrons offrir ce sol glorieux à notre chef suprême, avec la satisfaction et l’honneur d’avoir accompli notre devoir au service de notre Espagne. »
Le jour suivant, le vendredi 25 septembre, Angel qui est à son poste de vigie s’écrie brusquement :
– Fuego ! Fuego !
Peu s’en faut que tous courent vers les abris à ce signal qui, si souvent déjà, les a mis en garde. Mais il y a comme une joie, une jubilation dans ce cri, et Angel lui-même continue d’ailleurs à regarder au dehors sans chercher d’abri.
– Angel, qu’y a-t-il donc ? Qu’est-ce qui te prend de crier ainsi « Fuego ! » ?
– Ciel ! dans mon émotion je n’y ai même pas pensé ! En face, à Venta del Hoyo, des fontaines de sable jaillissent à plusieurs mètres au-dessus du sol. Cela ne peut provenir que de nos batteries qui tirent sur les rouges. Et les bouches à feu qu’on y voit cracher, ce sont celles de l’ennemi.
Comme un éclair, cette nouvelle fait le tour de l’Alcázar, et le journal qui, d’habitude, est si diligent ne peut plus que constater que la nouvelle est déjà connue.
On ne saurait dire où la joie est plus grande : parmi les valeureux combattants ou parmi les femmes et les enfants. Depuis l’explosion de la mine, ceux-ci n’ont plus parus dans la cour mais sont toujours restés enfermés dans les casemates, car le feu de l’artillerie lourde et les agressions que les assaillants dirigeaient contre l’aile nord ne permettaient plus que l’on se promenât sans danger dans la cour intérieure.
Toutes les autres attaques de l’ennemi sont rejetées avec une supériorité marquante et quand, le lendemain, les sentinelles observent que les batteries ennemies ont été retirées de quatre à cinq kilomètres et que les coups de l’artillerie des libérateurs, également rapprochés, tombent à cet endroit, la joyeuse animation qui, durant les derniers jours, a littéralement métamorphosé les hommes fatigués et déguenillés de l’Alcázar prend de telles proportions que le journal, en un petit avertissement, écrit : « Les calculs et les indications d’heure qui circulent à propos du moment de la libération dépassent ce que l’imagination la plus féconde saurait se représenter. Nous insistons derechef sur ce que, hier déjà, nous vous avons conseillé : une joie calme et une attention redoublée dans toutes les affaires de service. »
– Vois-tu, Felipe, à présent il ne peut plus s’agir que d’heures. Et ce que dans ton pessimisme tu nous as dit au sujet d’une troisième mine est une bêtise complète.
– Pour sûr que c’est une bêtise. . . maintenant ! Qui sait si les rouges ne nous auraient pas quand même placé une troisième mine sous le matelas ! Mais à présent, nous avons gagné la partie.
*
Dans la matinée du dimanche, les batteries rouges qui ont conservé leurs positions se remettent à hurler. À côté des pièces légères, il y a encore quelques canons de 155 qui donnent tout ce dont ils sont capables, et rarement les artilleurs rouges ont fourni un feu aussi rapide.
– En guise d’adieu ils nous offrent une aubade. C’est très gentil de leur part, dit en riant à l’un de ses camarades Juan, le cadet.
Tous deux sont assis dans les sótanos à côté de leur mitrailleuse placée à une fenêtre donnant sur l’esplanade. C’est là un poste particulièrement important depuis que les assiégeants ont occupé l’esplanade ; si on les laissait approcher ils pourraient pénétrer sans grande difficulté par la fenêtre ouvrant assez bas.
C’est une fraîche matinée de septembre.
En frissonnant, Jaime serre les épaules et bâille de fatigue.
– Il y a une éternité depuis que nous sommes entrés ici. Te rappelles-tu encore que nous disions à Mira : « quatre à cinq jours » ?
– Oui. Il a eu raison. Aujourd’hui pourtant, c’est fini.
– Mais aussi il était grand temps.
– Ma foi, s’il le fallait nous. . .
– Nous, sans nul doute. Mais sais-tu combien de nos mitrailleuses lourdes sont encore utilisables ?
– Non.
– Tout juste cinq pièces. Toutes les autres sont hors d’usage. À l’infirmerie, ils ont encore une ampoule de chloroforme, d’après ce que me disait Marin hier soir. Cela suffit pour une dernière narcose. . . avec ça, un demi-litre d’alc. . .
Le fracas d’un coup de tonnerre.
Les deux cadets sont projetés de trois mètres en arrière, contre le mur.
Autour d’eux, c’est l’obscurité complète. Un nuage noir de poussière vient du dehors.
– Juan ?
– Oui.
– Rien de cassé ?
– Non. Mais maintenant, à la mitrailleuse. Tu y vas ?
– Oui, à condition que je la retrouve.
– Voilà, j’y suis. Nom d’un chien, quelle crasse !
Fiévreusement, tous deux s’échinent à nettoyer la mitrailleuse tout en ayant l’œil sur l’esplanade où l’épais nuage de poussière peu à peu se dissipe.
Voici les miliciens qui montent à l’assaut.
Tac - tac - tac - tac. . . la mitrailleuse se met à crépiter.
Soudain elle s’arrête. Bloquée. Caramba ! Et juste au moment critique !
Juan a déjà sorti son revolver et le décharge en direction des rouges.
Jaune travaille à la mitrailleuse.
– Fini !
La pièce se remet à aboyer, et cette fois-ci plus rien ne la bloque.
Les miliciens se sont jetés par terre et déclenchent le feu à leur tour. Un de leurs officiers se relève et avance, toujours en tirant. Les autres le suivent.
La mitrailleuse fauche leurs rangs. Son feu est soutenu par celui d’autres fenêtres.
Les rouges font demi-tour, quelques uns d’abord, puis tous ; l’officier cherche en vain à les retenir. Ils se retirent en courant, et plus d’un n’arrive pas jusqu’à son ancienne position.
– Caramba ! Quelle sale histoire ! dit Juan en crachant le sable et les saletés qui lui avaient rempli la bouche.
– C’était la mine, la troisième. Tu vois bien qu’il y en avait encore une !
– Mais elle a sauté trop tôt. Si les rouges avaient eu plus de temps pour avancer leur galerie, elle aurait fait explosion exactement sous nous. Regarde-moi cet entonnoir là-devant. Nous aurions pu nous y loger confortablement ; il y avait de la place et même pour une bonne partie de l’Alcázar en outre.
On dirait que les assiégeants aujourd’hui veulent forcer la chose. Inlassablement ils attaquent, à l’Est, au Nord et à l’Ouest. Entre temps, ce sont les coups de voix de l’artillerie ennemie qui expulse les défenseurs des positions qu’ils occupent dans les décombres de l’aile nord. Puis brusquement, les batteries se taisent et au même instant les assiégeants remontent à l’assaut.
Mais toujours les défenseurs arrivent à temps.
Les rouges luttent aujourd’hui comme des démons déchaînés. C’est un combat épouvantable pour les hommes de l’Alcázar.
Depuis soixante-dix jours ils sont emmurés ; les mille privations dont ils ont souffert ont fini par affaiblir leurs forces. Mais ils se ressaisissent. Il y va du tout : du succès qui doit couronner ces soixante-dix jours.
Pendant des heures, la lutte se prolonge.
Francisco est couché avec Bernardo et quelques camarades dans une « position » au milieu des ruines.
Leurs visages sont souillés de poussière et de crasse. Leurs yeux ont un éclat fiévreux au-dessus de leurs joues caves. Ils sont si fatigués, affreusement fatigués.
« Mes bras. . . mes bras », se dit Francisco. C’est à peine s’il peut encore les allonger, à peine s’il peut encore tenir son fusil. Mais il ne faut pas qu’il le laisse retomber. Il se répète : « Il faut que je tienne, il faut ! » Il tire dans les ennemis qui attaquent. Il ne sait plus guère ce qu’il fait. Au fond, il ne sait plus qu’une chose : là-bas, cette masse de points noirs qui s’agitent ne doit pas arriver jusqu’ici, sinon tout est perdu.
Toujours dans le tas, toujours dans le tas ! Il respire fortement et par saccades. La sueur a collé ses cheveux sur son front.
– Seigneur, pendant combien de temps encore ?
Les rouges tirent et attaquent avec une irritation sourde et sauvage. Mais ceux de l’Alcázar ne les laissent pas passer ; toutes les offensives échouent, causant des pertes considérables.
La lutte reste indécise.
Enfin, vers midi, les attaques diminuent et finissent par cesser.
Le combat a duré six heures.
Les pièces de l’adversaire lancent quelques derniers obus que les cris d’alarme des sentinelles annoncent à temps.
Puis arrive une information qui soulage :
« Les pièces ennemies s’éloignent sur la route d’Azucaica-Mocejón. »
Et peu après, une autre nouvelle : « Au Nord-Ouest apparaissent des troupes. Nos troupes ! Des Marocains et des légionnaires. »
En effet, avec les jumelles on arrive déjà à distinguer leurs uniformes.
Les défenseurs de l’Alcázar sont trop épuisés après cette longue lutte harassante pour exprimer bruyamment leur joie ; mais telle une lueur, elle illumine leurs visages et leurs yeux.
La liberté
Les assaillants rouges encerclent toujours étroitement la forteresse.
L’un d’eux ose même crier :
– Rendez-vous ! La colonne ne vient pas.
Mais alors, le commandant lui-même qui l’a entendu riposte d’une voix indignée :
– Abruti, nous la voyons déjà de nos propres yeux !
Vers le soir, protégé par le crépuscule puis par la nuit qui tombe, un détachement de Marocains pénètre, par des chemins détournés, dans la ville toujours occupée par les rouges et, se frayant un passage à travers l’ennemi complètement abasourdi, arrive jusqu’à l’Alcázar, n’ayant qu’un seul homme de blessé. Il prend position ensuite, afin de ne pas être exposé au feu nourri d’un ennemi supérieur en nombre, dans une maison en face du « tunnel du Simplon » et située dans la rue qui va vers la plaza Zocodover. De là, il lui est possible d’attirer sur soi l’attention des défenseurs de l’Alcázar.
À peu près en même temps, une compagnie de légionnaires, passant devant la puerta de hierro, avance jusqu’à l’esplanade que les assiégeants rouges n’ont pas réussi à occuper dans sa partie supérieure.
Déjà les défenseurs ont reconnu les uniformes des légionnaires et les laissent arriver jusqu’à eux.
Des coups de crosse ébranlent la porte.
– Ouvrez !
– Qui vive ?
– Legionarios de la quinta bandera del Tercio !
À l’intérieur, une brève hésitation encore, comme s’ils craignaient une suprême ruse de l’ennemi.
La porte s’ouvre. Les légionnaires se trouvent devant une couronne de fusils mis en joue.
Mais alors, les défenseurs et les libérateurs se reconnaissent, les armes s’abaissent. Le cri de « Viva España » fuse puis éveille un écho multiple sous les voûtes, et l’Alcázar tout entier en retentit : « Viva España ! »
Les légionnaires entrent, les officiers et les soldats, les anciens et les nouveaux assiégés – l’ennemi n’a pas desserré son étreinte – s’embrassent de joie, et nombreux sont ceux qui ont les larmes aux yeux et nul n’en a honte.
La dernière nuit dans l’Alcázar !
Pour les emmurés elle se passe dans le silence.
Ils s’assemblent dans la chapelle pour prier. Par l’effet formidable de l’explosion de la mine, la pièce où l’on avait fini par loger la chapelle a été à moitié détruite. Des pierres et des gravats y ont été projetés, l’autel a été fracassé, mais la statue de la Vierge portant l’Enfant Jésus dans ses bras a été retrouvée intacte à côté de l’autel en ruine.
À présent, ceux qui ont combattu et prié pendant de si longues semaines sont réunis une dernière fois dans les ténèbres des sótanos.
Dans cette même nuit meurent deux hommes de la guardia civil gravement blessés au cours des derniers combats.
La joie rayonne sur leurs faces.
– Ma sœur, demande l’un d’eux dans un ultime effort, comme pour en avoir encore une fois la confirmation, . . . ma sœur, l’Alcázar est délivré ?
– Oui, il est délivré.
– Gracias a Dios !
*
Le lendemain matin, de nombreux assiégeants de l’Alcázar ont disparus. Les troupes commandées par le général Varela prennent la fabrique de munitions et dirigent le feu de leur artillerie sur plusieurs positions que l’ennemi occupe dans la ville, puis elles déclenchent l’offensive.
De l’Alcázar, des légionnaires, des Marocains et une partie de la garnison font trois sorties différentes dans la ville et rencontrent bientôt les troupes amies qui viennent vers eux.
*
Dans la chapelle de l’asile de fous, Carmelo et sa mère sont en proie à une forte inquiétude. Ce matin même, quelques obus ont éclaté tout près d’eux.
Puis il y a eu un branle-bas formidable dans les vastes corridors de l’asile où les rouges s’étaient installés. Ensuite, tout a été calme.
Depuis, ils n’ont plus rien entendu et attendent sans pouvoir s’imaginer ce qui s’est passé.
Soudain, un homme que ni l’un ni l’autre n’ont jamais vu fait irruption dans la pièce.
– Señora, estamos salvado ! – Madame, nous sommes sauvés !
Qu’est-ce que cela signifie ? Sauvés ?
Et déjà des soldats marocains arrivent à leur tour. L’inconnu leur explique qui sont ces deux prisonniers, et les Marocains, pleins de respect, se tiennent à la porte et disent simplement de leur voix rauque :
– Si, Señora, venga ! – Oui, madame, venez.
– Savez-vous, demande Mme Moscardó à l’inconnu, où je. . . pourrais trouver mon mari ?
– Sur la plaza Zocodover. Il s’entretient justement avec le général Varela.
Mme Moscardó chancelle, et des mains secourables doivent la soutenir.
– Mais alors, Papa vit !
Toute la joie de Carmelo jaillit dans ce cri.
*
Le jour suivant, on dit la messe parmi les ruines de la cour de l’Alcázar pour que s’accomplisse le vœu fait par les emmurés au début du siège.
Quelle différence avec cette messe qui les avait réunis dans l’atmosphère lourde des sótanos.
Alors, c’était l’oppression, les ténèbres et les menaces de la mort.
À présent, la liberté, la lumière et la vie.
Tout est différent, incroyablement, invraisemblablement différent. Seule une chose est restée : la ferveur avec laquelle les assiégés imploraient alors le secours de Dieu, c’est avec la même ferveur qu’aujourd’hui les libérés lui adressent leurs actions de grâce tout en pensant aux quatre-vingt-deux combattants tombés pour l’Alcázar.
Ensuite le général Franco, qui est lui-même accouru, dit quelques brèves paroles à ceux de la forteresse.
Il célèbre leur courage, leur héroïsme, leur dévouement enthousiaste à l’idée d’une Espagne rénovée, grande et unie, vertus que non seulement l’Espagne, mais le monde entier admire. Le colonel Moscardó, le glorieux commandant de l’Alcázar est promu général et en même temps, il est décoré de l’insigne suprême de l’armée espagnole : la croix laurée de saint Ferdinand, honneur conféré simultanément à tous les assiégés de l’Alcázar en commun.
L’abnégation et la force dont eux tous ont fait preuve durant ce siège, l’Espagne en aura besoin demain pour se reconstruire et pour réaliser son destin.
– Viva España ! Vivan los héroes del Alcázar ! – Vive l’Espagne ! Vivent les héros de l’Alcázar !
Postface
Dans les pages qui précèdent, j’ai essayé de peindre avec des mots ce que les défenseurs de l’Alcázar de Tolède ont vécu pendant les soixante-douze jours de siège. Ces pages ne veulent pas être un roman dans le sens d’une transposition littéraire, non plus un « roman » dans le sens d’une exagération des faits en vue d’une publicité tapageuse, mais, comme le dit le sous-titre : un « récit authentique » rapporté de Tolède. Un récit toutefois, qui n’a pas été écrit uniquement avec le froid prosaïsme de celui qui n’est que spectateur, mais dans lequel la véracité de la description s’allie à l’admiration pour les faits. Ce n’est pas que je sois « vite » allé en Espagne parce qu’il y avait justement du « grabuge » donnant matière à un livre. Je connais et j’aime l’Espagne. J’y ai vécu jusqu’à ce que, au mois d’août 1936, les circonstances m’aient obligé à quitter brusquement Barcelone. Ce livre n’est donc pas le fruit d’un hasard ; il était déjà préparé par des études antérieures et par une inclination personnelle, et je l’ai écrit avec d’autant plus de joie qu’il m’a donné l’occasion de peindre la grandeur humaine telle qu’elle m’a été révélée en Espagne, telle surtout qu’elle s’est incarnée, sous sa forme la plus haute, dans les défenseurs de l’Alcázar.
J’étais à Tolède et dans l’Alcázar lorsque l’ennemi tenait encore ses positions sur l’autre rive du Tage et que ses balles sifflaient au-dessus du fleuve, lorsque les batteries rouges, après s’être retirées, bombardaient encore la ville et que les avions de l’adversaire jetaient toujours leurs bombes. Je me suis entretenu avec les défenseurs de l’Alcázar : officiers, cadets, soldats, hommes de la guardia civil, femmes et enfants. Ce qui a été pour moi une joie et un honneur tout particuliers c’est que le général Moscardó m’ait accordé une longue entrevue et m’ait lui-même parlé de cette héroïque lutte pour la défense de l’Alcázar dont il a été le chef responsable, et qu’il ait bien voulu m’écrire quelques lignes qui sont placées en guise de dédicace au début de ce livre. C’est précisément ce fait qui me donne le courage de mettre entre les mains du lecteur ces pages auxquelles le général Moscardó a témoigné cette faveur spéciale.
Il me reste une chose à dire. Dans ce livre j’ai cité un certain nombre de noms, mais qu’on n’y voie nullement l’intention de mettre en évidence ces hommes plutôt que ceux qui restent anonymes. Cela s’explique par la nécessité de donner des noms et par l’impossibilité de les donner tous ; mais aussi par le désir formel de plusieurs défenseurs de l’Alcázar de ne point être cités dans ce livre étant donné que leurs parents se trouvent dans des provinces qui sont encore sous la domination de l’ennemi.
Novembre 1936. Rodolphe Timmermans.
Rodolphe TIMMERMANS,
Les héros de l’Alcázar, 1937.
Traduit de l’allemand
par Marcel Pobé.