Sous le joug
par
Ivan VAZOV
PREMIÈRE PARTIE
1 UNE VISITE
Par une fraîche soirée de mai, le tchorbadji 1 Marko, nu-tête et enveloppé de sa robe bordée de fourrure, soupait en plein air, entouré de sa famille.
La table du maître était, comme à l’ordinaire, dressée sous la treille, entre la fontaine qui versait nuit et jour, en gazouillant comme une hirondelle, l’eau claire et froide du ruisselet, et les grands buis touffus, verts en toute saison, qui se découpaient en noir sur le mur. Accrochée à un rameau de lilas dont les fleurs odorantes s’inclinaient amicalement sur les têtes de la famille, la lanterne répandait sa clarté.
La famille de Marko était nombreuse.
Autour de lui, de sa vieille mère et de sa femme, armés de couteaux et de fourchettes, un essaim d’enfants, grands et petits, incarnations parfaites du pittoresque mot turc samoun douchmanlara 2, engloutissaient à vue d’œil les victuailles servies sur la table.
Le père jetait de temps à autre un regard débonnaire à ces travailleurs haletants, aux dents tranchantes et à l’estomac vigoureux et, souriant, guilleret, les encourageait :
– Allez-y, mes petits ! mangez pour devenir grands ! Péna, remplis encore la jatte !
La servante allait à la fontaine où le vin pétillant était mis au frais, remplissait la jatte de faïence et l’offrait à son maître. Marko la passait aux enfants en disant avec bienveillance :
– Allons, buvez, polissons !
Et la jatte passait à la ronde. Les yeux prenaient de l’éclat, les joues s’enflammaient, tout ce petit monde se pourléchait avec délices. Comme sa femme prenait un petit air réprobateur et renfrogné, Marko dit d’un ton bref :
– Laisse-les boire chez moi, qu’ils ne soient pas avides de vin... Je ne veux pas les voir ivrognes quand ils auront grandi !
Marko avait de l’éducation une conception pratique et bien à lui. Homme du passé, peu instruit, grâce à son bon sens inné, il ne se méprenait pas sur la nature humaine et savait que le fruit défendu est particulièrement désiré. Ainsi, pour préserver ses enfants de toute inclination au vol, leur confiait-il la clef du coffre où il tenait son argent.
– Gotcho, va ouvrir le bahut et apporte-moi la bourse aux mintz 3.
Ou bien il disait à un autre :
– Tiens, mon enfant, va compter dans le panier aux pièces d’or vingt roubés 4, tu me les donneras quand je rentrerai.
Et il sortait.
Malgré l’usage de la plupart des pères de ce temps-là, qui voulait que les enfants se tiennent debout pendant le repas, pour leur apprendre à vénérer les personnes âgées, Marko, lui, asseyait toujours les siens à sa table. De même, lorsqu’il y avait des visites, il exigeait la présence de ses fils.
– Qu’ils acquièrent des manières de maître, expliquait-il, je ne les veux pas sauvages et timides comme Anko le Défroqué.
En effet, un simple accoutrement à l’européenne intimidait celui-ci qui, à la seule vue d’un quidam portant un pantalon de drap noir, pataugeait, interdit.
Toujours absorbé par ses affaires, Marko ne voyait ses enfants réunis qu’à table ; il complétait alors leur éducation d’une manière peu banale :
– Dimitri, ne te sers pas avant ta grand-mère, franc-maçon 5, va !
– Ilya, pourquoi tiens-tu donc ton couteau comme un boucher ? Tu n’as pas besoin d’égorger le pain, coupe-le comme il faut !
– Gotcho, qu’est-ce que cette manière de te déboutonner comme un Turc ? Et puis, enlève ton fez avant de te mettre à table. Tes cheveux sont de nouveau longs comme ceux d’un Toutrakanois 6. Va chez Ganko, qu’il te les coupe à la cosaque !
– Vassil, retire tes guibolles, fais de la place aux autres. Tu t’étendras à ton aise quand nous serons à la campagne.
– Avram, dis-moi, tu te lèves de table sans faire le signe de croix, espèce de protestant !
Mais Marko ne parlait sur ce ton que lorsqu’il était de bonne humeur. Était-il fâché : un silence sépulcral régnait à sa table.
Profondément croyant et pieux, Marko avait grand soin d’inspirer des sentiments religieux à ses fils. Le soir, pendant qu’il priait devant l’iconostase, les aînés étaient obligés de se tenir à ses côtés. Le dimanche et les jours de fête, la famille au grand complet devait aller à l’église. C’était une loi inviolable et toute entorse qu’on lui donnait déchaînait l’orage sur la maison.
Lors d’un carême, à la veille d’une communion, il avait envoyé son fils Kiro se confesser. Celui-ci rentra très vite, il n’avait même pas vu le pope.
– Tu t’es déjà confessé ? lui demande le père avec méfiance.
– Oui, papa, répondit le fils.
– À qui ?
Kiro se troubla mais répondit avec aplomb :
– Au pope Enyo.
Il mentait, car le pope Enyo, trop jeune, ne confessait pas.
Marko devina le mensonge et se fâcha ; dressé d’un bond, il attrapa son fils par l’oreille et l’emmena ainsi dans la rue. Puis il le fit marcher devant lui jusqu’à l’église où il le remit au père Stavri avec ces mots :
– Père pénitencier, faites confesser cet âne !
Et lui-même attendit sur un prie-Dieu.
Il était plus sévère encore envers ceux qui manquaient l’école. Resté lui-même inculte, Marko aimait l’instruction et les personnes cultivées. Il était de la trempe de ces patriotes zélés, avidement soucieux de voir réussir le nouveau mouvement intellectuel, et par les soins desquels, en peu de temps, la Bulgarie fut parsemée d’écoles. Il avait une notion assez vague de l’avantage pratique que le savoir pouvait procurer à son peuple d’agriculteurs, d’artisans et de commerçants, et même il observait avec inquiétude que la vie n’assurait guère le gagne-pain à ceux qui sortaient de l’école, mais il sentait que dans la science se cachait une force mystérieuse qui allait changer le monde. Il croyait à la science comme en Dieu, sans raisonner. Et c’est justement pourquoi il s’appliquait à la servir dans la limite de ses moyens. Il ne nourrissait qu’une ambition : être élu au comité d’école de sa petite ville natale, Biala-Tcherkva 7. Et il y était, en effet, toujours élu, car il jouissait de l’estime et de la confiance générales. Dans l’exercice de cette modeste fonction sociale, Marko n’épargnait ni son labeur ni son temps, mais il en fuyait toutes les autres distinctions, fussent-elles accompagnées d’autorité et de bénéfices et, surtout, il fuyait le konak 8.
La table desservie, Marko se leva. C’était un homme d’une cinquantaine d’années, de taille gigantesque, légèrement voûté, mais svelte encore. Son visage couperosé, un peu hâlé et gercé par le soleil et les vents de ses fréquents voyages à travers champs et foires, gardait une expression grave et froide, même quand il souriait. Les gros sourcils tombant sur ses yeux bleus renforçaient l’aspect sévère de sa physionomie. Mais la bonhomie, l’honnêteté et la franchise de l’expression, forçaient la sympathie.
Marko s’assit de nouveau sur la couverture à longs poils qui recouvrait le petit divan niché au pied du grand buis, et alluma son chibouk 9. Sa famille à son tour s’installa plus à l’aise sur le tapis à côté du ruisselet, et la servante apporta le café.
Ce soir-là, Marko était de bonne humeur. Il suivait avec intérêt les ébats de ses enfants rassasiés, aux joues roses, et dont les rires sonores fendaient l’air. À chaque instant ils formaient un nouveau groupe pittoresque d’où fusaient bruyamment des piailleries, des éclats de rire, des cris fâchés de petites voix ; on aurait dit une bande d’oiseaux folâtrant dans les branches. Tout à coup le jeu innocent prit un caractère plus violent : les menottes s’agitèrent plus vivement et un pugilat s’engagea ; les cris devinrent menaçants, un tumulte s’éleva : le concert d’oiseaux se changeait en bataille... Vainqueurs et vaincus se précipitèrent vers le père pour porter plainte ou demander justice. L’un confiait sa défense à sa grand-mère, l’autre nommait sa mère procureur. De spectateur neutre Marko se voyait changé par surprise en juge : de par ces fonctions autant que de droit, il devait examiner l’affaire. Mais le juge, malgré les normes judiciaires, rendit son verdict sans avoir voulu entendre accusation ni plaidoyer : aux uns il caressa la tête, aux autres il tira les oreilles, enfin, il embrassa les plus petits, les souffre-douleur.
Et le petit monde se calma.
Tout à coup le dernier-né, qui dormait dans les bras de grand-mère Ivanitsa, réveillé par le bruit, se mit à pleurer.
– Dors, mon petit, dors, sinon les Turcs viendront t’enlever, disait Ivanitsa en le berçant sur ses genoux.
Marko fronça les sourcils.
– Mère, dit-il, tu n’en finiras pas de faire peur aux enfants avec tes Turcs ? Cette peur restera à jamais dans leur cœur.
– Ah ! que veux-tu..., répondit Ivanitsa, nous aussi on nous faisait peur avec les Turcs... Que le bon Dieu les foudroie ! Ne sont-ils pas à faire peur ? Je suis une femme de soixante-dix ans et je mourrai, comme on dit, les yeux ouverts de n’avoir pas vu l’arrivée des Russes, les croyants.
– Grand-mère, s’écria le petit Pètre, quand nous serons grands, moi, mon frère Vassil et mon frère Guéorgui, nous prendrons notre sabre et nous tuerons tous les Turcs.
– Épargnez-en au moins un, mon trésor ! fit l’aïeule.
– Comment va Assen ? demanda Marko à sa femme qui sortait de la maison.
– La fièvre a baissé, il dort maintenant, répondit-elle.
– Pourquoi avoir regardé ces horreurs ? dit Ivanitsa inquiète, le voilà malade à présent.
Marko fronça les sourcils, mais ne répondit rien. Le petit Assen avait pris la fièvre dans la journée : il avait vu, en effet, par les fenêtres de l’école, le cadavre décapité de l’enfant de Guentcho qu’on venait d’amener de la campagne dans la cour de l’église. Marko s’empressa de changer le sujet de la conversation et dit aux enfants :
– Restez tranquilles maintenant, nous allons entendre ce que votre frère aîné va nous raconter. Puis vous chanterez tous une chanson. Voyons, Vassil, raconte-nous ce qu’on vous a enseigné aujourd’hui.
– L’histoire générale.
– Bon, va pour l’histoire ; qu’est-ce que c’était ?
– La guerre de succession d’Espagne.
– Les Espagnols ? Laisse ça ! Ça ne nous regarde pas... Dis-nous plutôt quelque chose sur la Russie.
– Quoi donc ? demanda Vassil.
– Parle-nous, par exemple, d’Ivan le Terrible, de Bonaparte qui incendia Moscou...
Marko n’eut pas le temps d’achever la phrase. Du fond obscur de la cour parvint le bruit d’une chute ; des tuiles tombèrent avec fracas du chaperon du mur. La volaille se mit à caqueter, s’envolant vers la maison, le plumage hérissé. La servante en train de ramasser le linge étendu poussa des cris d’effroi : « Au voleur ! Au voleur ! »
Un désordre affreux s’ensuivit. Les femmes effrayées s’enfuirent dans les chambres, les enfants décampèrent subitement. Marko, qui était courageux, jeta un coup d’œil vers le lieu d’où venait tout ce bruit et disparut par une porte pour reparaître sous peu par une autre ouverture, près de l’écurie, deux pistolets à la main.
C’était aussi audacieux qu’imprudent, mais le geste fut si rapide que la femme de Marko n’eut même pas l’idée de le retenir. Dès qu’il sortit, on entendit la voix étouffée de sa femme mêlée aux aboiements furieux du chien qui restait, effrayé, près de la fontaine.
En effet, il devait y avoir quelqu’un dans l’ombre, entre le poulailler et l’écurie, là où l’obscurité était si profonde qu’on ne pouvait rien distinguer. Quand Marko sortit de la lumière projetée par la lanterne, l’obscurité lui parut plus opaque encore.
Alors, à pas de loup, il entra dans l’écurie, caressa la croupe du cheval pour le rassurer, et regarda entre les barres de bois de la petite fenêtre. S’était-il déjà habitué ou se l’imaginait-il, mais il lui sembla distinguer, dans un coin obscur du côté de la petite fenêtre, quelque chose qui ressemblait à une forme humaine immobile.
Marko braqua son pistolet sur l’inconnu, se pencha et cria en turc, d’une voix terrible :
– Davranmna 10 !
Il attendit un instant, le doigt sur la gâchette.
– Baï 11 Marko ? chuchota une voix.
– Qui est là ? demanda Marko en bulgare.
– Ne craignez rien, baï Marko, je suis des vôtres !
Et l’inconnu se planta devant la fenêtre, si bien que Marko distinguait nettement sa silhouette.
– Qui es-tu ? demanda-t-il avec méfiance et brusquerie, abaissant son pistolet.
– Je suis Ivan, fils de Manol Kralitch de Vidine.
– Je ne te connais pas..., que fais-tu ici ?
– Je vais te le dire, baï Marko, répondit l’intrus en baissant la voix.
– Je ne peux pas te voir... D’où viens-tu ?
– Je vous le dirai, baï Marko... de loin.
– D’où ? de quel endroit ?
– De très loin, baï Marko, souffla le visiteur.
– Mais réponds-moi enfin !
– De Diarbékir 12.
Marko se souvint. Manol avait un fils déporté à Diarbékir. Manol était son vieil ami, lui aussi faisait le commerce et lui avait rendu un grand service.
Marko sortit alors de l’écurie, s’approcha dans l’obscurité du visiteur nocturne, le prit par la main et l’emmena au fenil.
– Est-ce toi, Ivan ? Je te connais depuis le temps où tu étais encore tout petit. Tu vas passer la nuit ici et demain nous verrons, lui dit Marko tout bas.
– Je vous remercie bien, baï Marko... je ne connais personne ici à part vous..., lui chuchota Kralitch.
– Ne t’en fais pas ! je suis le meilleur ami de ton père. Tu es ici comme chez toi. Quelqu’un t’a-t-il vu venir ?
– Je ne crois pas... Il n’y avait personne dans la rue quand je suis entré.
– Entrer ? Est-ce comme ça qu’on entre, mon petit ? Par le toit, à l’assaut ? Mais cela ne fait rien. Le fils de mon ami Manol est toujours le bienvenu chez moi, surtout lorsqu’il vient de si loin. As-tu faim, Ivan ?
– Non, je vous remercie, baï Marko.
– Allons, voyons, il faut te mettre quelque chose sous la dent. Je m’en vais tout d’abord rassurer la famille, je viendrai ensuite pour causer un peu... et pour arranger cette affaire-là. Que Dieu te bénisse, mon enfant ! Qu’allais-je donc faire ! dit Marko en désarmant son pistolet.
– Excusez-moi, baï Marko, c’est une grande bêtise que j’ai faite.
– Patiente un peu jusqu’à mon retour.
Et Marko sortit en fermant derrière lui la porte de l’écurie.
Il trouva sa femme et sa mère en proie à la plus grande frayeur. Le voyant rentrer sain et sauf, elles poussèrent des cris de joie, le saisissant par les mains comme si elles avaient peur qu’il leur échappât de nouveau. Marko prit un air tranquille et n’hésita pas à les tromper en leur affirmant qu’il n’avait rien trouvé dans la cour ; que probablement un chien ou un chat aurait fait tomber les tuiles, cette sotte de servante avait donné l’alarme pour rien.
– Nous n’avons réussi qu’à réveiller le quartier, dit-il en fourrant les pistolets dans leurs fontes accrochées au mur.
Et la famille se calma.
Grand-mère Ivanitsa appela la servante :
– Au diable tes visions, Péna ! Tu nous as fait une belle frousse. Va-t’en vite faire pisser les enfants sur une pierre bleue 13.
Juste à ce moment, on cogna fortement à la porte cochère. Marko sortit dans la cour et demanda :
– Qui est là ?
– Tchorbadji, ouvre ! cria-t-on en turc
– L’onbachi 14 ! murmura Marko inquiet. « Il faut cacher l’autre ailleurs ! »
Et, sans prendre garde aux coups redoublés frappés à la porte, il se précipita à l’écurie :
– Ivan ! appela-t-il dans le fenil.
Pas de réponse.
– Il a dû s’endormir. Ivan ! appela-t-il plus haut.
Personne ne répondit.
– Ah ! le pauvre, il a dû se sauver ! s’exclama Marko en se rappelant qu’il avait trouvé la porte de l’écurie ouverte. Puis il ajouta anxieusement : Que lui arrivera-t-il maintenant, à ce pauvre garçon ?
À tout hasard, il l’appela encore plusieurs fois et, n’ayant pas obtenu de réponse, revint à la porte cochère qui vibrait sous les coups comme si elle allait être enfoncée.
2 L’ORAGE
En effet, dès qu’on eut heurté à la grande porte, Ivan Kralitch, sans savoir au juste comment il s’y prenait, enjamba de nouveau le mur et tomba dans la rue où il resta un moment tout étourdi. Regardant attentivement autour de lui. Il ne vit que ténèbres. Le ciel était couvert de nuages orageux ; la fraîcheur du soir s’était changée en un vent froid qui soufflait tristement dans les rues désertes.
Kralitch enfila au hasard la première rue, marchant vite et à tâtons le long des murs, pataugeant dans les ruisseaux. Toutes les portes, les volets, les fenêtres étaient fermés et muets. Pas une lueur à travers les fentes, aucun signe de vie : la ville semblait morte – comme d’ailleurs toutes les villes de province bien avant minuit.
Il erra ainsi longuement à l’aveuglette, cherchant à sortir de la ville. Tout à coup, il tressaillit et s’arrêta net sous un large porche : il venait d’apercevoir des silhouettes inquiétantes. Kralitch resta sur place et s’appuya avec précaution à la porte contre laquelle il s’était arrêté. Mais un grognement sourd, suivi d’aboiements menaçants, le fit reculer. Il venait de réveiller un chien de garde, assoupi derrière la porte. Son mouvement et l’aboiement le trahirent. La patrouille qui faisait une ronde de nuit, alertée, prit les armes : un « Halte-là ! » en turc se fit entendre. Kralitch n’avait qu’à faire un pas en arrière, et l’obscurité aurait aussitôt mit une barrière infranchissable entre lui et la patrouille, mais en de tels moments de danger imminent, le bon sens s’émousse ; l’aveugle instinct de conservation se substitue aux facultés mentales et, comme l’on dit, une fois qu’on a perdu la tête il ne reste plus que les bras pour se défendre et les jambes pour se sauver.
Aussi Kralitch fonça-t-il droit sur la patrouille, passa comme un tourbillon au milieu des seïmens 15 et réussit à prendre quelque distance. La garde s’était naturellement mise à sa poursuite et la rue retentissait de cris et de bruits de pas. Au milieu du tumulte, on entendait la voix stridente du pandour 16 bulgare :
– Halte-là, le gars, sinon on tire !
Mais Kralitch courait à toutes jambes sans un regard en arrière. Des coups de fusil crépitèrent derrière lui, l’obscurité aidant, il resta indemne. Pourtant, il n’était pas léger à la course, aussi, à un moment donné, il sentit quelqu’un l’attraper par la manche. D’une secousse il se dégagea de sa veste et la laissa entre les mains du poursuivant.
Deux coups de fusil retentirent encore derrière lui. Kralitch continuait à fuir sans savoir où il allait et, le souffle coupé, il avait peine à mettre un pied devant l’autre ; harassé, ses jambes se pliaient sous lui ; à chaque pas il était prêt à tomber pour ne plus se relever. Soudain, un éclair éblouissant illumina l’obscurité ; Kralitch s’aperçut qu’il se trouvait en pleine campagne et qu’on ne le poursuivait plus. Alors, il s’affala, éreinté, pour reprendre haleine, au pied d’un noyer. Le vent soufflait plus fort de la montagne et se faisait plus froid. Son bruit se mêlait au frémissement des feuilles et au grondement du tonnerre. Bientôt la foudre éclata au-dessus de la tête du fugitif, puis s’évanouit dans l’espace infini.
Le bref repos et l’air pur réconfortèrent un peu le fugitif. Il flaira la pluie et se remit à marcher à grands pas pour chercher un abri. Autour de lui les arbres se lamentaient tristement. Les grands ormes se courbaient sous la rafale, les herbes et les chardons s’agitaient, la nature entière semblait sur le qui-vive et se déchaînait avec furie. De grosses gouttes éparses commencèrent à rebondir sur la terre comme des projectiles. Les éclairs léchèrent en zigzag la crête du Balkan et le tonnerre galopa bruyamment dans le ciel, comme s’il voulait le faire écrouler. Une pluie battante, pourchassée par la tempête furieuse, s’abattit sur la campagne. Les éclairs sillonnaient les nuages, déchiraient les ténèbres et leur éclat bleuâtre donnait un aspect fantastique aux arbres et à la montagne. Ces lueurs magiques et rapides, succédant subitement aux profondes ténèbres, composaient une féerie prodigieuse et effrayante. Une étonnante beauté naissait de cette lutte des éléments, de ce dialogue des horizons, de cette illumination infernale des abîmes ; le choc monstrueux du mystérieux et de l’infini produisait une harmonie démoniaque. Peut-être est-ce dans l’orage que la nature atteint son plus haut degré de poésie.
Kralitch, trempé jusqu’aux os, ébloui par les éclairs, assourdi par le tonnerre, continuait sa marche à travers fourrés, taillis et meulons, qui ne lui offraient aucun abri. Cependant, parmi tout ce fracas, le bruit d’une chute d’eau parvint à son oreille. Ce devait être le canal d’un moulin. Un nouvel éclair lui fit d’ailleurs distinguer le toit du moulin lui-même, blotti dans les branches des saules. Kralitch s’arrêta sous la gouttière. Il poussa doucement la porte qui s’ouvrit, entra. Le moulin était obscur et désert. Dehors l’orage se calmait, la pluie cessa subitement. La lumière argentée de la lune éclairait les bords des nuages dispersés. Et, par un de ces brusques retirements si fréquents au mois de mai, la nuit s’éclaircit.
Bientôt des pas venant du dehors s’approchèrent et Kralitch se fourra entre le grenier et le mur.
– Tiens, le vent qui a ouvert la porte, dit une voix rude dans l’obscurité et, en même temps, on alluma une petite lampe à pétrole.
Kralitch, caché dans son coin, leva la tête et aperçut le meunier, grand paysan maigre, et près de lui une jeune fille, pieds nus, vêtue d’une courte jupe mauve passementée, probablement sa fille, qui fermait la porte et s’efforçait de mettre le loquet. Elle avait l’air encore très enfantin, bien qu’elle parût avoir déjà treize ou quatorze ans et, sous ses longs cils, coulait de ses yeux noirs un regard innocent. Son costume négligé laissait deviner la taille svelte d’une beauté à venir.
Tous deux rentraient sans doute d’un moulin voisin, puisque leurs vêtements étaient secs. Le meunier reprit :
– Nous avons bien fait d’arrêter la roue, autrement le torrent l’aurait cassée ; les histoires du vieux Stantcho ne tarissent jamais. Heureusement que personne n’est venu nous voler. Le meunier regarda autour de lui : – Marika, va te coucher. Je me demande pourquoi ta mère t’a envoyée ici ? Rien que pour me causer du tracas, pour sûr, ajouta le meunier tout en clouant une planche qui pendait à la trémie et fredonnant un air.
Marika, sans se le faire répéter, alla au fond du moulin, prépara un lit pour elle et pour son père, fit quelques génuflexions accompagnées de signes de croix, se roula sur la carpette de poil de chèvre et, avec l’insouciance de son âge, s’endormit sur l’heure.
Kralitch regardait avec un intérêt ému cette scène rustique. Le visage plutôt rude mais bienveillant du meunier lui inspirait confiance. Il était impossible qu’une figure aussi honnête cachât une âme de traître. Il se décidait à se confier à cet homme et à lui demander aide et assistance, quand le meunier cessa de fredonner et se redressa, prêtant l’oreille à des voix qui venaient du dehors. Aussitôt la porte retentit sous des coups redoublés :
– Ouvre, meunier ! criait-on en turc.
Il s’approcha de la porte, la verrouilla de son mieux et se retourna tout blême.
On frappa de nouveau et la même injonction, suivie cette fois d’un jappement de chien, se répéta.
– Des chasseurs, murmura le meunier, ayant reconnu l’aboiement d’un lévrier. Qu’est-ce qu’ils viennent chercher ici, les maudits ! C’est Emexis Pechlivan 17 !
Emexis Pechlivan, le plus farouche scélérat qu’on eût jamais connu, avait semé la terreur dans toute la contrée. Deux semaines auparavant, il avait massacré toute la famille de Guentcho Daali au village d’Ivanovo. On disait, non sans raison, que c’était lui encore qui avait décapité l’enfant dont on avait la veille ramené le cadavre en ville.
La porte craquait sous les coups.
Le meunier resta un moment à réfléchit et se prit la tête entre les mains, ne sachant quelle résolution prendre. De grosses gouttes de sueur perlaient à son front. Tout à coup, il se pencha sous une étagère poussiéreuse, en sortit une hache et se dressa près de la porte qui menaçait d’être enfoncée sous la poussée des survenants. Mais son audace l’abandonna dès qu’il eut regardé sa fille et son visage refléta un désespoir et une souffrance cruels. Le sentiment paternel fit taire sa révolte. Se rappelant le proverbe : « Mieux vaut plier l’échine que de se rompre le cou », au lieu de résister, il se décida à demander grâce aux impitoyables. Glissant vite la hache derrière le grenier où était caché Kralitch, il recouvrit bien Marika et ouvrit enfin la porte.
Deux Turcs armés, carnassières au dos, apparurent sur le seuil. L’un d’eux tenait un lévrier en laisse. L’autre, qui était en effet le sanguinaire Emexis Pechlivan, jeta avant d’entrer un regard scrutateur à l’intérieur. Il était grand, voûté, maigre, décharné et imberbe. Dans sa physionomie, moins terrifiante que ne l’étaient ses méfaits et sa réputation, seuls ses petits yeux gris incolores et chargés d’une ruse simiesque furetaient, d’un regard mauvais. Son compagnon, trapu, musclé, boiteux, au visage bestial où se lisaient la cruauté et les instincts les plus bas, entra après lui avec le lévrier et ferma la porte. Ils enlevèrent leurs houppelandes trempées.
Emexis Pechlivan regarda le meunier d’un air courroucé :
– Pourquoi n’ouvrais-tu pas, meunier ? demanda-t-il.
Le meunier marmotta confusément une excuse, en se courbant humblement jusqu’à terre, et jeta un regard inquiet vers le fond où dormait Marika.
– Es-tu seul ici ? et Emexis se retourna.
– Oui, répondit le meunier mais, après avoir réfléchi, il trouva le mensonge inutile et ajouta : – Et l’enfant qui dort là-bas.
À ce moment Marika se découvrit et tourna son visage de leur côté, la lueur pâle de la lampe tomba sur sa petite gorge blanche et arrondie. Les Turcs dévorèrent de regards avides la jeune fille endormie. Une sueur froide couvrit le front du meunier. Emexis se tourna vers lui d’un air d’amitié feinte :
– Tchorbadji, veux-tu bien te donner la peine d’aller nous acheter une bouteille de raki 18 ?
– Mais Pechlivan-aga 19, il est minuit, tous les cabarets sont fermés en ville, répondit le meunier tremblant à la pensée de laisser sa fille seule avec ces brutes.
Le boiteux riposta :
– Va, va, on aura bien la veine que tu trouves quelque part une boutique ouverte. On veut trinquer ici avec toi, c’est comme ça que se nouent les amitiés.
Le boiteux prononça ces paroles d’une voix railleuse, assuré qu’il était de sa victoire. Il ne voulait même pas dissimuler au malheureux père ses mauvaises intentions.
Emexis couvait des yeux la jeune fille, si séduisante dans son abandon insouciant. Remarquant que le meunier ne bougeait pas, il se rembrunit mais feignit encore la douceur et fit sur un ton débonnaire :
– Tchorbadji, tu as une jolie fille, machalla 20 ! Ça tombe bien, elle servira tes hôtes... Allons, va donc nous chercher du raki et l’on aura soin de ton moulin. Puis il ajouta d’un ton menaçant : – Tu connais Emexis Pechlivan, n’est-ce pas ?
Le meunier avait dès le début compris quelle mauvaise intention se cachait sous cette ruse facile à percer. Son âme simple et honnête se révolta. Mais il était pris au piège ; seul contre deux brigands armés, lutter eût été insensé ; sa perte même, dont à présent il ne se souciait guère, n’eût pu sauver sa fille. Il essaya encore d’apitoyer ces bourreaux en les priant.
– Agas, ayez pitié d’un homme malade, de ma vieille carcasse... Je suis éreinté par ma journée de travail... Laissez-moi me reposer, ne me couvrez pas d’opprobre !
Mais il parlait à des sourds. Le boiteux grogna :
– Allons, allons ! mon bonhomme, on a soif... Tu bavardes trop... On voit bien que tu perches dans un moulin... Va donc chercher du raki !
Et il le poussa vers la porte.
– À cette heure-ci, je ne vais nulle part, laissez-moi ! fit d’une voix sourde le meunier.
Les Turcs jetèrent alors leur masque de douceur. Leurs regards sauvages percèrent le meunier comme des flèches.
– Ah ! hanzar-érif 21 ! Il montre les dents. Vois-tu ça ? fit Emexis en tirant son yatagan. (Ses yeux s’injectèrent de sang.)
– Tuez-moi, si vous voulez, je ne laisse pas mon enfant seule ! dit le meunier humblement mais d’un air résolu.
Emexis se leva :
– Topal-Hassan 22 ! Mets-moi ce chien dehors – je ne veux pas souiller mon poignard !
Le boiteux se jeta sur le meunier, le secoua et le jeta à terre devant la porte puis, pour le mettre dehors, il l’accabla de coups de pied. Le meunier se releva et se précipita à l’intérieur en criant :
– Grâce ! Grâce !
Marika, réveillée par le bruit, s’était levée. À la vue du yatagan que brandissait Emexis, elle poussa un cri et courut vers son père.
– Aman 23 ! Pitié, aga ! criait le malheureux père, serrant dans ses bras la tête de sa fille.
Sur un signe d’Emexis, le robuste Topal-Hassan bondit comme un tigre derrière le meunier, attrapa celui-ci par les mains et lui tordit les bras.
– Bien, Topal-Hassan, allons attacher ce vieux rat de moulin ; qu’il reste ici si cela lui fait plaisir... On lui en fera voir bien d’autres... Il ne l’aura pas volé, l’imbécile ! Quand on mettra le feu au moulin, on aura, nous aussi, de quoi rigoler.
Les deux brigands, sans faire attention aux cris du meunier, le poussèrent vers un poteau et se mirent en devoir de l’y attacher.
À la pensée de ce qui allait encore se passer devant ses yeux, le meunier éperdu de peur rugissait comme une bête féroce, implorant une aide qu’il ne pouvait s’attendre à trouver dans cette solitude.
Marika ouvrit la porte, criant désespérément, mais l’écho seul répondit à ses cris entrecoupés de sanglots.
– Reste ici, meunière ! Nous aurons bientôt besoin de toi ! fit Emexis et, pour qu’elle ne fuie pas, il la ramena à l’intérieur du moulin. Puis il rejoignit Topal-Hassan.
– Miséricorde ! criait désespérément le meunier ! Au secours ! Il n’y a donc personne pour m’aider ? Marika, viens donc ! criait-il, appelant inconsciemment cette frêle enfant à son secours.
Kralitch avait jusqu’alors suivi la scène qui se déroulait devant lui, immobile, les jambes flageolantes, les cheveux hérissés, frissonnant.
Il croyait rêver, tant ce qu’il avait éprouvé et vu ce soir, depuis la maison de Marko jusqu’au moulin, avait été inattendu et horrible. Le sifflement des balles puis le grondement du tonnerre résonnaient encore à ses oreilles. Ses pensées s’embrouillaient. D’abord, il crut que les Turcs venaient pour lui et que son sort était décidé. Sa volonté croula sous le poids du sentiment qu’il avait de son entière impuissance ; le peu d’énergie qui lui restait ne pouvait plus lui servir que pour aller se livrer aux mains des Turcs et épargner ainsi au meunier de lourdes responsabilités. Mais, lorsqu’il devint clair qu’il allait assister à quelque chose de plus horrible encore, et surtout quand il entendit le meunier appeler Marika à son secours, son sang bouillonna d’une colère folle. Et, bien qu’il n’eût jamais versé de sang, les Turcs lui apparurent aussi peu redoutables que des mouches. Fatigue, faiblesse, tout s’évanouit. D’un geste d’automate sa main avança vers la hache, la saisit ; il sortit machinalement de sa cachette, se glissa courbé derrière les sacs de blé et, blême comme la mort, surgit d’un bond derrière Emexis et lui enfonça la hache dans la nuque. Ce qu’il venait de faire, il l’avait exécuté comme en rêve.
Le Turc culbuta sans un râle.
Topal-Hassan fit face à cet ennemi inattendu, lâchant la corde avec laquelle il ligotait le meunier, il brandit son pistolet et le déchargea sur Kralitch. Le moulin se remplit de fumée. La lampe s’éteignit sous l’effet de la détonation et tous furent subitement plongés dans l’obscurité la plus complète. Alors une lutte enragée à coups de poing, d’ongles, de pied et de dents s’engagea dans les ténèbres. Les combattants, d’abord deux, ensuite trois, roulèrent ensemble à terre ; leurs vociférations sauvages, leur halètement et leurs gémissements se mêlaient à l’aboiement féroce du lévrier. Topal-Hassan, fort comme un taureau, résistait désespérément à ses deux adversaires qui devaient vaincre à tout prix ou périr.
Quand la lampe fut rallumée, Topal-Hassan se tordait tans les soubresauts de l’agonie. Au milieu de la mêlée, son poignard était tombé par hasard sous la main de Kralitch qui le lui avait enfoncé dans la gorge. Les cadavres des deux Turcs gisaient dans la mare de leur sang
Alors le meunier se redressa et contempla, étonné, cet inconnu dont l’aide lui était venue de façon si inattendue. Il vit un grand jeune homme brun, aux yeux noirs et perçants enfoncés dans un visage mortellement pâle, aux cheveux longs ébouriffés et pleins de poussière ; sa veste trempée, couverte de boue, était en loques ; son gilet sans boutons laissait voir qu’il n’avait pas de chemise ; le pantalon était en lambeaux et ses grosses chaussures défoncées. En un mot son aspect était celui de quelqu’un qui vient de s’évader de prison ou qui va bientôt y entrer, ainsi du moins le meunier en jugea-t-il. Son regard, pourtant, était plein de compassion lorsque, fort ému, il lui dit :
– Mon bon monsieur, je ne sais qui tu es, ni comment tu es ici. Mais je sais que, tant que je vivrai, je ne pourrai te rendre tout le bien que tu m’as fait. Tu m’as sauvé d’une mort certaine, mais aussi tu as sauvé mon enfant et mes vieux jours d’une chose pire encore – de l’infamie. Que Dieu te bénisse et te récompense ! Et tout le pays te sera reconnaissant ! Le connais-tu celui-là ? (Il montra Emexis.) C’est celui qui a fait pleurer les enfants dans les entrailles de leur mère. Le monde est maintenant débarrassé de ce monstre. Sois béni, mon fils !
Kralitch écouta, les larmes aux yeux, ces simples paroles empreintes de sincérité. Puis, tout haletant encore, il répondit :
– Ce n’est pas beaucoup ce que j’ai fait, grand-père ; nous n’en avons tué que deux, mais des monstres pareils il y en a encore des milliers et des milliers. Le peuple bulgare ne s’en débarrassera et ne jouira de la liberté que lorsque tout entier il brandira les haches pour exterminer ces oppresseurs. Mais, dis-moi, grand-père, où enfouir ces deux cadavres. C’est qu’il ne faut pas laisser de traces !
– J’ai une fosse toute prête pour les infidèles, donne-moi un coup de main pour les traîner jusque-là, dit le vieillard.
Alors les deux hommes, que cette sanglante nuit avait liés à tout jamais, emportèrent les cadavres dans les buissons derrière le moulin et les enfouirent dans une vieille fosse qu’ils nivelèrent pour qu’il ne reste aucune trace. Quand ils revinrent avec la pelle et la pioche, une forme blanche glissa à côté d’eux.
– Ah ! le lévrier ! s’écria Kralitch. Il va rôder par-là et nous trahir.
Il le guetta et lui assena un coup de pioche sur la tête. L’animal, hurlant lamentablement, se traîna sur le ventre au bord de l’eau. Kralitch l’y poussa de sa pioche et l’eau l’engloutit aussitôt.
– Ah ! il fallait enfouir ce chien-ci auprès des deux autres, remarqua le meunier.
Ils nettoyèrent le sang de leurs vêtements et recouvrirent la fosse de terre fraîche.
– Qu’est-ce que c’est ? Tu saignes ? demanda le meunier, voyant le sang couler du bras de Kralitch.
– Rien, il m’a mordu, le salaud ! quand je l’étranglais.
– Viens vite que je te fasse un pansement, dit le meunier, et il le banda avec un mouchoir déchiré. Puis, lâchant le bras, il le regarda dans les yeux et lui demanda : Excuse-moi, mon fils, mais de quel côté viens-tu ?
Et de nouveau il enveloppait l’étranger d’un regard curieux.
– Je te le dirai tout à l’heure, grand-père. Pour le moment, sache que je suis Bulgare, et un bon Bulgare. Ne doute pas de moi.
– À Dieu ne plaise ! Est-ce que je ne le vois pas ? Tu es des nôtres, mon bon monsieur, et pour des frères comme toi je suis prêt à donner ma vie.
– Où trouverai-je maintenant, grand-père, d’autres vêtements et un gîte pour la nuit ?
– Viens, nous irons au monastère, chez le diacre Vikenti. C’est un parent à moi. Que de bien il a fait à des gens comme toi !... Lui aussi, c’est un bon Bulgare fidèle, mon bon monsieur. Allons, nous y passerons tous la nuit. C’est bien que personne ne nous ait vus.
Le père Stoïan se trompait : car près du tronc d’un noyer la lune éclairait la forme d’un homme qui, immobile et inaperçu, avait suivi l’ensevelissement des deux Turcs.
Peu après, le meunier, Kralitch et Marika qui, pendant la lutte, s’était enfuie et sanglotait éperdument au pied d’un orme, se dirigeaient vers le monastère dont les hautes murailles blanches éclairées par la lune surgissaient à travers l’enchevêtrement noir des noyers et des peupliers.
La forme inconnue leur avait emboîté le pas.
3 LE MONASTÈRE
Ils traversèrent une clairière parsemée de grosses pierres, sous les branches de noyers centenaires aux troncs éventrés par l’âge, et bientôt leur apparurent les hautes murailles du monastère qui, à la lueur mystérieuse de la lune, rappelait la silhouette d’un château gothique aux créneaux fantastiquement dessinés.
Quelques années auparavant, un sapin gigantesque abritait l’église de son feuillage touffu retentissant du chant de milliers d’oiseaux ; il faisait l’orgueil du vieil édifice. Mais un orage survint qui déracina le sapin, et le père supérieur fit construire une nouvelle église. Celle-ci, avec sa haute coupole moderne qui se découpe sur l’ensemble des bâtiments comme un bout de papier neuf collé sur un vieux parchemin, jure étrangement avec les vestiges du passé. La vieille église et le vieux sapin tombés sous les coups du destin, le monastère semblait s’être assombri : le gigantesque sapin qui jadis se perdait dans les nues ne réjouissait plus la vue ; et, sur les murs remontés, les pieuses images des saints, archanges, Pères de l’Église et martyrs, aux yeux crevés par des Kardjalis 24 et des Délibachis 25, n’émouvaient plus l’âme de la même piété.
Nos trois amis contournèrent le couvent et l’abordèrent par-derrière ; la muraille y était plus accessible et plus proche de la cellule du diacre Vikenti. De ce côté on n’avait pas non plus à craindre les chiens, ni les garçons de ferme du monastère.
Tout auprès, les cascades qui tombaient de la montagne avec un bruit de tonnerre remplissaient les alentours de leurs échos sauvages.
L’un des compagnons devait franchir la muraille pour chercher une échelle et la passer aux deux autres. Kralitch, qui avait commencé la soirée par un assaut de ce genre, s’acquitta fort bien de cette tâche. Bientôt tous les trois franchissaient la muraille, en danger d’ailleurs d’être criblés de balles par le belliqueux igoumen 26, qui les aurait mis en joue s’il les avait aperçus de sa fenêtre. Ils se trouvèrent dans une petite cour qui communiquait avec une autre plus vaste par une porte verrouillée du dedans. La cellule du diacre donnait, au rez-de-chaussée, sur la petite cour. Ils s’avancèrent vers la fenêtre éclairée.
– Vikenti est encore occupé à lire, dit le meunier, se levant sur la pointe des pieds pour regarder par la fenêtre à laquelle il frappa.
La petite fenêtre s’ouvrit ; quelqu’un se pencha, regarda et demanda :
– Est-ce toi, oncle Stoïan ? Qu’est-ce que tu viens chercher ici ?
– Passe-moi ta clef, je te le dirai tout à l’heure. Es-tu seul ?
– Oui, tout le monde dort. Tiens : la clef !
Le meunier disparut dans l’obscurité. Deux ou trois minutes plus tard, il revint et introduisit Kralitch et sa fille dans la cour intérieure, prenant bien soin de refermer la porte.
La cour où ils pénétrèrent était silencieuse et lugubre : le glouglou monotone et somnolent de la fontaine faisait songer à quelque psalmodie chantée pour le repos des âmes ; des vérandas sombres, silencieuses et désertes régnaient tout au long des bâtiments, et les cyprès noirs inclinaient leurs cimes comme des spectres gigantesques.
La porte de la cellule du diacre s’ouvrit pour laisser passer les hôtes nocturnes.
Vikenti, un tout jeune homme, au visage éveillé, aux yeux noirs, intelligents, à la barbe naissante, reçut amicalement Kralitch qu’il connaissait déjà d’après ce que son oncle venait de lui dire sommairement. Il regardait avec respect et admiration ce héros qui ayant tué deux scélérats comme de simples poulets, avait sauvé le vieillard et sa fille ; le cœur honnête du diacre devinait chez son hôte un homme à la fois généreux et brave. Le père Stoïan, très ému, répétait à la hâte ce qui venait de se passer dans le moulin et bénissait son sauveur. Vikenti, voyant l’extrême fatigue et la pâleur de celui-ci, lui proposa de l’emmener dans la cellule où il devait passer la nuit. Ils sortirent, le diacre en tête, un paquet de vêtements et de nourriture sous le bras, et traversèrent la cour endormie. Arrivés au pied de l’escalier desservant les trois étages de vérandas du bâtiment opposé, ils montèrent jusqu’au dernier.
Dans le vide de cette construction en bois, et bien qu’ils eussent pris soin de marcher tout doucement, leurs pas faisaient sonner toute la bâtisse. Vikenti alluma un cierge et éclaira la cellule où ils entrèrent. Elle était quasi vide et d’un aspect fort triste : un matelas, une couverture et une cruche d’eau formaient tout son ameublement. Ce refuge ressemblait plutôt à une prison mais, pour le moment, Kralitch ne pouvait désirer mieux.
Après avoir parlé encore de l’aventure du moulin, Vikenti souhaita bonne nuit à son hôte :
– Vous êtes éreinté et vous avez besoin de repos, je ne veux donc pas vous accabler de questions... D’ailleurs à quoi bon ?... Votre courage de ce soir en dit long. Nous nous reverrons demain mais, rassurez-vous, dorénavant vous n’avez plus à vous inquiéter, le diacre Vikenti est tout à votre disposition... Bonne nuit !
Et il lui tendit la main. Kralitch la prit et la retint dans la sienne.
– Non, dit-il, attendez : vous me donnez l’hospitalité aveuglément et vous vous exposez ainsi au danger. Vous devriez au moins savoir qui je suis. Je m’appelle Ivan Kralitch.
– Ivan Kralitch, le déporté ? Quand vous a-t-on libéré ?
– Libéré ? Je me suis évadé de Diarbékir ! Je suis un fugitif.
Vikenti lui serra la main avec effusion :
– Soyez le bienvenu, baï Kralitch ! Vous êtes maintenant pour moi un hôte encore plus cher, et un frère. La Bulgarie a besoin de ses fils fidèles. Il y a beaucoup à faire à présent, beaucoup. La tyrannie des Turcs est insupportable et le mécontentement du peuple sera bientôt porté à son comble. Il faut nous préparer. Restez chez vous, gospodin 27 Kralitch, ici personne ne vous reconnaîtra ; travaillons ensemble, voulez-vous ? disait avec enthousiasme le jeune diacre.
– Telle est en effet mon intention, frère Vikenti.
– Demain nous reparlerons plus longuement... Ici vous êtes en sûreté. J’ai caché Levski 28 dans cette même cellule. Personne n’y vient... On y aurait plutôt peur des revenants que des humains. Bonne nuit ! fit allègrement le diacre en sortant.
– Bonne nuit, frère ! répondit Kralitch en fermant la porte.
Il s’empressa de changer de vêtements et d’apaiser sa faim. Puis il se coucha, éteignit la bougie, mais s’agita longtemps sur sa couche sans trouver le sommeil. Des images sanglantes troublaient son esprit. Il revoyait dans leur horrible et répugnante netteté les scènes affreuses de la soirée. Cet état pénible dura longtemps, mais enfin la nature l’emporta et ses forces physiques et morales cédèrent au sommeil ; il s’endormit. Soudain, il se réveilla en sursaut et ouvrit les yeux dans l’obscurité. Quelqu’un marchait à pas mesurés dans le corridor. Puis un chant pareil à un hululement se fit entendre. Les pas s’approchaient, le chant devenait de plus en plus fort ; il ressemblait à un chant funèbre, à une lamentation. Kralitch crut qu’il venait de loin et que le silence profond du lieu le répercutait en le dénaturant, pourtant il distinguait nettement les pas sur le plancher du corridor. Tout à coup, une figure sombre apparut à la fenêtre. Kralitch, stupéfait, fixa son regard sur l’ombre et remarqua qu’elle gesticulait et semblait l’appeler. La vague lueur de la nuit permettait de la voir distinctement. Kralitch ne quittait pas la fenêtre du regard ; il lui semblait que la figure mystérieuse avait les traits de cet Emexis Pechlivan qu’il avait tué. Rêvait-il ? Il se frotta les yeux, regarda de nouveau : la figure le fixait toujours.
Kralitch n’était pas superstitieux, mais cette bâtisse déserte, son calme désolé, son silence de mort, étaient assez effrayants : il se rappela l’allusion faite par le diacre aux revenants ; et, tout à coup, il se sentit mal à l’aise, saisi par une peur incompréhensible. Honteux de lui-même, il se ressaisit, chercha son revolver à tâtons, ouvrit doucement la porte et sortit nu-pieds. Une grande forme arpentait le plancher, poursuivant son étrange mélopée. Kralitch s’approcha hardiment. Le spectre, au lieu de disparaître, comme il arrive toujours dans les histoires de revenants, poussa un cri de terreur car, vêtu du linge blanc que le diacre lui avait prêté, Kralitch ressemblait lui-même beaucoup à un spectre.
– Qui es-tu ? demanda le nouveau fantôme à son collègue en l’attrapant par la veste.
Le malheureux, bouche béante de frayeur, multipliait les signes de croix et roulait de gros yeux en tournant la tête comme un idiot. Kralitch comprit qu’il avait affaire à un être dénué de raison et le lâcha.
Vikenti avait oublié de prévenir son hôte des habitudes nocturnes du pauvre Mountcho, un idiot inoffensif qui, depuis de nombreuses années, habitait le monastère. C’était lui l’inconnu qui avait assisté à l’enfouissement des deux Turcs...
4 CHEZ LE TCHORBADJI MARKO
Lorsque, après la fuite de Kralitch, Marko ouvrit la porte cochère, l’onbachi s’y rua suivi de ses zaptiés 29, tous sur le qui-vive.
– Que se passe-t-il ici, tchorbadji Marko ? demanda-t-il.
Avec calme, Marko expliqua qu’il n’y avait pas là de quoi s’inquiéter et que sa servante trop peureuse s’était alarmée d’un rien. L’onbachi se hâta d’accepter ces explications, content de pouvoir donner à l’incident une solution exempte d’imprévu désagréable.
Marko allait refermer la porte quand son voisin apparut :
– À la bonne heure, baï Marko, vous l’avez échappé belle.
– Tiens, Ivantcho 30, viens donc prendre le café !
– Bonsoir, baï Marko ! Assen va-t-il mieux ? dit en accourant du milieu de la rue un jeune homme de haute taille.
– Venez, docteur, venez !
Et Marko les introduisit dans la chambre qu’éclairèrent soudain deux belles bougies fixées à des candélabres en bronze étincelants.
Cette pièce de petites dimensions, mais d’un aspect calme et gai, était destinée aux visiteurs. Elle était nattée et ornée selon ce goût naïf de l’époque qui, de nos jours, règne encore paisiblement sur certaines villes de province. Le plancher était recouvert de tapis bariolés et les deux divans de grosses couvertures rouges, le tout tissé à la maison. Près d’un des murs se trouvait un poêle de fonte qui servait de meuble en été et qu’on allumait en hiver. Sur le mur opposé, on voyait, à la lueur vacillante de la veilleuse, des icônes derrière lesquelles apparaissaient des images venues du mont Athos, pieux cadeaux de pèlerins. Les Images saintes étaient de très vieilles peintures à l’huile, ce qui leur donnait, aux yeux de la grand-mère Ivanitsa, une valeur encore plus considérable – de même que les armes anciennes ont, pour les amateurs de panoplies, une valeur exceptionnelle. Une de ces images, très ancienne, jouissait entre toutes de la vénération particulière d’Ivanitsa. Elle aimait à raconter, avec fierté, que le révérend père hadji 31 Arséni, son bisaïeul, avait exécuté cette merveilleuse peinture avec son pied, assertion que nul n’avait l’idée de démentir tant elle était péremptoire. Une touffe de basilic bénit et une branche de saule apportée le dimanche des Rameaux, et qui toutes deux devaient assurer la santé et la prospérité de la maison, ornaient l’iconostase. Sur les murs se trouvaient des étagères garnies de faïences, décoration inévitable de toute maison qui se respecte et, dans les coins, des consoles triangulaires supportant des jardinières. Depuis belle lurette la vieille mode des murs ornés de chibouks aux jaunes embouchures d’ambre et de pipes aux fourneaux vernis était passée. Sacrifiant à la tradition, Marko en avait gardé un seul pour son usage personnel. Le mur faisant face aux fenêtres jouait le rôle important de galerie d’art. C’était là « l’ermitage » de la maison de bal Marko. Il était doté de six lithographies, aux cadres dorés, venant du pays des Valaques. Leur choix bizarre témoignait du peu de prétention de ce temps-là au goût artistique. Certains représentaient des scènes de vie de famille allemandes, un autre le sultan Abdul-Medjid à cheval avec sa suite. Le reste offrait des épisodes de la guerre de Crimée : la bataille de l’Alma, la bataille d’Eupatoria, la levée du siège de Silistrie en 1852. Ce dernier tableau portait en roumain l’inscription inexacte « Rasboiul Silistru 32 » et une main servile avait traduit en bulgare et placé en sous-titre : « La bataille de Silistrie ». Le sixième représentait les chers militaires russes de la guerre de Crimée debout, mais à mi-corps, ce qui, ayant fait dire au pope Stavri que les obus des Anglais leur avaient emporté les pieds, suggéra à grand-mère Ivanitsa de les appeler « les martyrs » : « Qui a encore touché aux martyrs ? » demandait-elle aux enfants d’un air fâché. Une pendule dont les chahuts et les poids retombaient jusqu’aux coussins du divan était accrochée au-dessus du tableau des martyrs. Cette vieille pendule avait depuis longtemps droit à la retraite : les rouages en étaient usés, les ressorts détendus, l’émail du cadran fêlé, et les aiguilles déformées et relâchées ; ce n’était plus qu’une ruine vivante, mais Marko soutenait son reste d’existence avec beaucoup de zèle et d’art. Il la réparait lui-même, la démontait, la remontait, la nettoyait avec une petite plume trempée dans de l’huile d’olive, enveloppait l’axe des petites roues dans du papier et ainsi lui redonnait vie pour quelque temps, en attendant un nouvel arrêt. Marko l’appelait pour rire : « Ma pauvre poitrinaire », mais lui et les siens s’étaient tellement habitués à cette malade que lorsque son pouls, c’est-à-dire son balancier, s’arrêtait, la maison semblait étrangement vide. Et quand Marko saisissait les chaînes pour la remonter, les poumons de « ma pauvre poitrinaire » exhalaient des ronflements grondeurs et courroucés qui faisaient déguerpir le chat.
Sur le même mur, deux photographies de famille complétaient la galerie d’art dont l’antique pendule faisait en même temps un musée.
Le Dr Sokolov était un jeune homme de vingt-huit ans, de belle prestance, aux cheveux blonds luisants, aux yeux bleus, au visage franc, empreint de bonté. C’était un homme bizarre, de tempérament fougueux, de caractère insouciant ; ayant servi comme aide-chirurgien dans un camp turc à la frontière du Monténégro, il s’était fait à la langue et aux habitudes des Turcs, buvait du raki et fraternisait le soir avec l’onbachi qu’il terrorisait la nuit en tirant des coups de pistolet dans la cheminée ; en outre, il faisait l’éducation d’une ourse ! Mal vu des notables qui avaient plus de confiance dans le médecin grec qu’en lui, le Dr Sokolov était sympathique aux jeunes à cause de son tempérament gai et franc et de son ardent patriotisme. Âme des divertissements et des conjurations, il leur consacrait tout son temps. Bien qu’il n’eût jamais fait aucune étude dans une école de médecine, la jeunesse le gratifiait du titre de docteur contre lequel il ne jugeait pas nécessaire de protester : c’était une marque de considération dont le médecin grec ne jouissait pas. Quant au traitement des malades, Sokolov en laissait le soin à deux aides éprouvés : le sain climat de ce pays montagneux et la nature. Il avait rarement recours à la pharmacopée dont il ne comprenait pas les formules latines. Toutes ses drogues tenaient sur une petite étagère. Il n’était pas étonnant qu’il l’eût vite emporté sur son rival !
Sokolov était le médecin habituel de la famille de Marko ; ce jour-là, il venait voir le petit Assen.
L’autre visiteur, Ivantcho, surnommé Iotata, était venu en bon voisin rassurer Marko et faire un brin de causette.
La conversation roula un certain temps sur l’aventure du soir tandis qu’Ivantcho décrivait fort éloquemment ses impressions et ses inquiétudes.
– Et comme je vous le disais, poursuivait Iotata, juste au moment où notre Lala desservait le dîner, etc., j’entendis l’agitation chez vous, baï Marko. Le chien donnait aussi étonnamment de la voix. J’ai pris peur, c’est-à-dire que je n’ai pas pris peur mais j’ai dit à Lala : « Dis, Lala, que se passe-t-il chez baï Marko ? De la véranda jette donc un coup d’œil dans leur cour. » Mais après j’ai pensé : « Ça n’est pas une affaire pour des femmes. » Je monte vaillamment à la véranda et je regarde dans votre cour – des ténèbres... « Qu’est-ce que c’était alors que cette agitation ? me suis-je dit mentalement, qu’est-ce qui met le quartier en éveil ?... » Et Lala qui reste derrière moi, me tenant par le pan de la veste... « Où vas-tu ? qu’elle dit... tu ne vas pas sauter chez baï Marko ?... – Mais non, il n’y a rien, que je lui dis, va verrouiller la porte du côté de chez Marko. »
– Ce n’était pas la peine, Ivantcho, il n’y avait rien, fit observer Marko, un sourire aux lèvres.
– Alors, continua Iotata, je me suis dit mentalement : « Faut prévenir le konak ; M. baï Marko est notre voisin et on ne peut pas le lâcher dans la sécurité... » Je dégringole les escaliers et Lala qui toujours piaille après moi... « Ferme-la », lui dis-je hardiment... Je vais à la porte cochère, je regarde – silence universel.
– Assen dort-il maintenant, baï Marko ? demanda le docteur pour tenter de mettre un terme à la faconde d’Ivantcho. Mais celui-ci se hâta de continuer :
– Comme je vois le silence universel dans la rue, je me suis dit : « Voilà de quoi te méfier, Ivantcho » ; alors, je fais demi-tour, je passe par la porte de derrière, c’est-à-dire je me trouve dans l’impasse, de l’impasse je vais par le portillon de baï Nedko, par chez les Mahmoudkine puis, à travers le fumier du cousin Guenko, directement au konak. J’entre, je regarde et instantanément je rapporte vaillamment à l’onbachi qu’il y a des brigands chez vous et que les poules volent à travers la cour.
– Mais je te dis qu’il n’y avait personne. Tu t’es donné de la peine pour rien, Ivantcho, dit Marko.
La tempête faisait rage au-dehors.
– Ah ! baï Marko, dit soudain le docteur, j’ai oublié de te demander : un jeune homme t’a-t-il trouvé ce soir ?
– Quel jeune homme ?
– Un étranger, assez mal habillé.., mais à l’air intelligent autant que j’ai pu remarquer... il demandait ta maison.
– Où l’as-tu vu ? Personne ne m’a cherché, répondit Marko visiblement embarrassé – mais ses hôtes n’avaient aucune raison de s’en apercevoir.
Le docteur poursuivit tranquillement :
– Un jeune homme m’a joint ce soir près de la roseraie de hadji Pavli et m’a demandé poliment : « Monsieur, pouvez-vous m’indiquer la maison de Marko Ivanov ? Je veux le trouver, qu’il disait, je viens pour la première fois ici... » Comme je venais de ce côté-ci je lui ai proposé de l’accompagner. Chemin faisant je l’observais – le pauvre garçon était presque nu... autant que j’ai pu distinguer dans l’obscurité : il n’avait sur lui qu’une mince veste déchirée... et, avec cela, maigre, faible, tenant à peine sur ses jambes... par le temps qui fraîchissait... Je n’osais pas lui demander d’où il venait et pourquoi il était dans cet état, mais j’avais pitié de ce malheureux... J’ai regardé mon pardessus – un pardessus tout râpé, ne tenant pour ainsi dire plus : « Permettez-moi de vous offrir ce vêtement... vous allez prendre froid ! – Merci », a-t-il dit en le prenant. Nous sommes arrivés ainsi devant chez vous et je l’ai quitté. Je voulais vous demander qui c’était.
– Je vous ai déjà dit que personne n’est venu me chercher.
– Tiens, c’est bizarre ! fit le docteur.
– Cet homme-là, n’était-ce pas le brigand qui escaladait votre mur ? demanda Ivantcho. Cette agitation-là n’était pas pour rien alors.
– Impossible que cet homme soit un brigand... On reconnaît ces gens-là à leur physionomie, observa le docteur.
Pour changer la conversation qui prenait mauvaise tournure, Marko demanda au docteur :
– Docteur, tu as lu le journal ? Où en est l’insurrection d’Herzégovine 33 ?
– Elle est à l’agonie, baï Marko. Ce peuple de héros a fait des merveilles ; mais que peut-il contre de telles forces ?
– Parbleu ! une poignée d’hommes, mais quelle résistance ! Si on pouvait faire autant nous aussi, hein ? dit Marko.
– Avons-nous seulement essayé ? rétorqua le docteur. Nous sommes cinq fois plus nombreux que les Herzégoviniens, mais nous ne sommes pas encore conscients de notre force.
– N’en parle même pas, docteur, dit Marko. Les Herzégoviniens et nous cela fait deux, nous sommes aux entrailles de l’enfer ; si nous bougeons seulement, on nous égorgera comme des moutons. Et personne pour nous prêter main-forte !
– Je vous le demande : avons-nous seulement essayé ? répéta le docteur qui s’animait. On nous égorge et on nous massacre sans aucune raison. Plus nous nous tenons comme des moutons et plus on nous assomme. Quelle faute avait commise l’innocent petit de Guentcho qu’on a ramené hier, décapité ? Dès que nous élevons la voix contre la tyrannie, on nous menace de la corde, mais les Emexis Pechlivan, eux, peuvent impunément accomplir leurs méfaits. Quelle est cette justice ! Le plus endurci pourrait-il supporter ces horreurs ? Les pierres mêmes en seraient émues.
Ivanitsa entra.
– Savez-vous, demanda-telle, que peu avant l’averse, Péna a entendu des coups de fusil ?... Qu’est-ce que cela peut signifier ? Sainte Vierge ! c’est encore, pour sûr, quelque chrétien qu’on aura tué...
Marko tressaillit et changea de couleur. Un sinistre pressentiment l’assaillait : il pensait à Kralitch. Le cœur gros, il ne put cacher tout à fait son émotion.
– Qu’avez-vous donc, baï Marko ? lui demanda le docteur, remarquant son visage troublé.
La pluie avait cessé. Les hôtes s’apprêtèrent à partir. La nouvelle apportée par Ivanitsa les avait troublés.
– Bah ! ça ne peut être que des volets qui claquent, la servante a dû se tromper encore... N’ayez pas peur... hardiment ! plastronnait Ivantcho Iotata. – Mère Ivanitsa, le portillon du côté de chez nous est-il ouvert ?
Et tandis que Marko reconduisait le docteur par la porte cochère, Ivantcho se sauva par le portillon que lui avait ouvert sa femme.
5 LA SUITE DE LA NUIT
Sokolov frappa à la porte de sa maison. Une vieille femme vint lui ouvrir. Il entra et demanda vivement :
– Comment va Cléopâtre ?
– Elle est inquiète de toi, répondit la vieille souriante.
Le docteur traversa une longue cour et entra dans sa chambre. Cette pièce spacieuse, qui était à la fois son cabinet de travail, sa pharmacie et sa chambre à coucher, était à peu près nue, le mur était garni de placards, une cheminée profonde occupait un coin. Les drogues tenaient toutes sur une seule étagère ; sur le guéridon, un mortier, quelques livres de médecine épars, un revolver. Au-dessus de son lit étaient accrochés un fusil à double canon, une carnassière. Un seul tableau décorait la pièce : l’image du prince Nicolas de Monténégro et, au-dessous, la photographie d’une actrice. Tout avait un air de désordre et de liberté, l’air qui convenait au célibataire un peu loufoque qui habitait là.
Au fond de la pièce bâillait la porte d’un cellier : trois ans plus tôt Levski, depuis disparu, y avait trouvé refuge.
Le docteur jeta négligemment son fez et sa veste, s’approcha du cellier, battit des mains et appela :
– Cléopâtre ! Cléopâtre !
Pas de réponse.
– Cléopâtre, viens, ma colombe !
Un murmure bizarre parvint du cellier. Le docteur s’assit sur une chaise au milieu de la pièce et appela de nouveau :
– Ici, Cléopâtre !
Un ours apparut, ou plutôt un ourson – une femelle.
Traînant ses grosses pattes sur le plancher, l’ourse s’approcha, poussant des grognements de joie ; puis elle se dressa, appuya ses pattes de devant sur les genoux du docteur et ouvrit toute grande sa gueule garnie d’une double rangée de dents blanches et acérées, se laissant caresser comme un chien. Le docteur enfonça ses doigts dans le poil duveteux de la tête et donna à la bête la main qu’elle lécha et prit ensuite tout entière dans sa gueule.
Ce fauve, capturé tout petit dans la Sredna-Gora 34, était le cadeau d’un paysan chasseur dont Sokolov avait sauvé le fils d’une grave maladie. Le docteur s’était pris d’un grand attachement pour la bête et veillait tout particulièrement à son éducation. Sous sa douce tutelle, Cléopâtre, en grandissant à vue d’œil, profitait à merveille des leçons de gymnastique de son maître, et son attachement pour lui augmentait chaque jour.
Déjà Cléopâtre pouvait danser la polka, tenir le chapeau du docteur et monter la garde comme un chien. C’était là un vrai a « service d’ours 35 », puisque sa présence dans la maison du docteur en chassait les patients. Mais le docteur ne s’en souciait guère.
Arrivée au point culminant de sa danse, Cléopâtre l’accompagnait de rugissements terrifiants et le voisinage était alors averti. À ce moment, n’y tenant plus, le joyeux Sokolov dansait avec elle.
Ce soir-là il était animé de sentiments particulièrement bienveillants à l’égard de l’aimable Cléopâtre. Il lui offrit de la viande qu’elle mangea dans sa main.
– Mange, ma colombe ! « Ours affamé, dit-on, ne danse point 36 », pourtant j’aimerais qu’au rythme de ma voix tu danses comme une princesse.
L’ourse comprit sans doute, elle rugit, ce qui voulait dire : « Me voilà ! » Et le docteur, battant la mesure sur une tourtière, entonna une ronde joyeuse :
Dimitra, ma belle fille blonde,
Va dire, Dimitra, à ta maman,
Qu’elle ne mette plus au monde
Une seconde fille comme toi...
Cléopâtre, enthousiaste, se dressa et, tout en grondant, dansa sur ses pattes de derrière. Tout à coup, avec fureur, elle se précipita vers la fenêtre et le docteur, stupéfait, vit que la cour était pleine de monde. Il saisit son revolver.
– Qui est là ? cria-t-il, faisant taire Cléopâtre.
– Docteur, donnez-vous la peine de nous suivre au konak.
– Est-ce toi, chérif-aga ? Pourquoi, diable ! m’appelez-vous à cette heure-ci ? Qui est malade ?
– Enferme d’abord l’ourse.
Sur un signe du docteur, Cléopâtre, mécontente, regagna sa chambrette en grognant. Il ferma vite la petite porte sur elle.
– Nous avons l’ordre de t’emmener au konak ! Tu es arrêté, proféra d’un ton sévère l’onbachi.
– Pourquoi arrêté ? Qui m’arrête ?
– Tu le sauras tout à l’heure. Allons, je t’en prie !
Et l’on emmena le docteur profondément troublé et pressentant quelque malheur. En sortant il entendit le grognement navrant de Cléopâtre ; on aurait dit qu’elle pleurait.
Le konak était agité. Sokolov fut introduit chez le bey 37.
Celui-ci était, comme toujours, assis devant l’âtre. Près de lui, Kiriak Steftchov compulsait des papiers sur lesquels le conseiller Netcho Pironkov jetait de temps à autre un coup d’œil.
Le bey, un vieillard d’une soixantaine d’années, reçut le docteur froidement, mais l’invita cependant à s’asseoir : c’était la tactique employée par les Turcs pour encourager les prévenus à parler ; de plus, Sokolov était le médecin de la famille du bey et celui-ci avait de l’estime pour lui.
Le docteur jeta un coup d’œil autour de lui et grand fut son étonnement quand il aperçut sur le divan le pardessus qu’il avait donné le soir même à Kralitch. Cette découverte lui fit tout de suite comprendre de quoi il s’agissait,
– Docteur, ce pardessus est-il à toi ?
Le docteur ne pouvait nier l’évidence et n’y pensait même pas. Il répondit donc affirmativement.
– Et pourquoi n’est-il pas chez toi ?
– Je l’ai donné ce soir à un pauvre.
– Où ça ?
– Dans la rue Hadjichadova.
– À quelle heure ?
– Vers neuf heures.
– Connaissais-tu cet homme ?
– Non, mais il était en loques et j’ai eu pitié de lui.
– Comme il ment, le malheureux ! ricana Netcho.
– Que veux-tu, Netcho !... Un noyé s’accroche même à un brin de paille, lui chuchota Kiriak Steftchov.
Le bey sourit avec malice comme s’il venait de percer à jour un mensonge grossier. Il était convaincu que le pardessus avait été arraché du dos du docteur par la patrouille et c’est ce qu’affirmaient les hommes qui la composaient.
– Kiriak-efendi 38, passe-moi les papiers... Et ces papiers-là, les connais-tu ?
Le docteur aperçut un numéro de l’Indépendance 39 et une proclamation révolutionnaire. Il nia.
– Alors, qui les a mis dans ta poche ?
– Je vous ai déjà dit que j’avais donné mon pardessus à un autre. Peut-être ces papiers lui appartiennent-ils ?
Le bey sourit de nouveau. Sokolov sentait que l’affaire tournait mal pour lui : on l’accusait bel et bien d’entretenir des relations avec un rebelle.
Ainsi l’inconnu de ce soir était un rebelle ! Si seulement il l’avait su, il aurait pu épargner ce malheur à tous deux.
– Faites entrer le blessé Osman, ordonna le bey.
Un zaptié entra. Il avait le bras pansé au-dessus du coude. C’était le même qui avait arraché le pardessus du dos de Kralitch et c’est à ce moment qu’il avait été atteint par une des balles tirées par l’un de ses camarades. Mais, soit de parti pris, soit par erreur, il prétendait avoir été blessé par le rebelle poursuivi.
Osman s’approcha du docteur :
– C’était bien lui, efendi.
– C’est à lui que tu as arraché le pardessus ? Le connais-tu bien ?
– Oui, c’est celui-là qui m’a blessé dans la rue Petkantchova.
Le docteur le regarda, abasourdi. Devant cette calomnie le sang lui monta à la figure.
– Ce zaptié ment sans vergogne ! cria-t-il.
– Tu peux disposer, Osman-aga ! Tchélébi 40, reprit le bey d’un air grave, peux-tu nier tout cela ?
– C’est un mensonge ! Je ne porte pas de revolver sur moi et ce soir je ne suis même pas passé par la rue Petkantchova.
L’onbachi s’approcha de la bougie, examina le revolver qu’il avait pris sur la table du docteur et dit en pesant chaque mot :
– Quatre balles y sont, la cinquième manque.
Le bey fit un signe de tête significatif.
– Vous vous trompez cette fois encore. Ce soir je n’ai pas porté de revolver...
– Tchélébi, ce soir, vers dix heures, quand tout cela se passait, où étais-tu ?
Cette question inattendue tomba sur le docteur comme un coup de foudre. Il répondit pourtant avec aplomb :
– Ce soir à dix heures, j’ai été chez Marko Ivanov, son enfant est malade.
– Il était presque onze heures quand tu es entré chez le tchorbadji Marko. Nous en sortions justement, riposta l’onbachi qui avait rencontré le docteur quand celui-ci se rendait chez Marko.
Le docteur se taisait. Tout concourait à le perdre. Il se rendait compte qu’il s’empêtrait.
– Eh bien ! dis-nous alors où tu es allé après avoir donné ton pardessus, rue Hadjichadova, avant de te rendre chez Marko Ivanov ? demanda le bey.
Cette question catégorique appelait une réponse claire, mais le Dr Sokolov n’en donna aucune. Son visage ouvert trahissait une forte lutte intérieure, il décelait la souffrance.
Ce trouble et ce silence étaient plus éloquents que des aveux et venaient s’ajouter aux preuves qui déjà l’accablaient. Le bey croyait bien tenir le coupable. Cependant il lui demanda une fois de plus :
– Dis, tchélébi, où étais-tu pendant ce temps-là ?
– Je ne peux pas vous le dire, répondit d’un ton ferme le docteur.
Cette réponse tomba dans un silence consterné. Netcho cligna de l’œil à Steftchov comme pour lui dire : « Le malheureux est tombé dans le piège. »
– Réponds, tchélébi, où étais-tu ?
– Il m’est absolument impossible de vous le dire. C’est un secret que mon honneur d’homme et de médecin m’interdit de vous révéler. En tout cas je peux vous dire que je ne suis pas allé rue Petkantchova !
Le bey insistait, rappelant au docteur les conséquences funestes que pouvait avoir son mutisme. Celui-ci demeurait impassible comme un homme qui n’a plus rien ajouter.
– N’as-tu rien à dire ?
– J’ai tout dit.
– Alors, tchélébi, en ce cas tu seras notre hôte cette nuit... Emmenez-le en prison, dit sévèrement le bey.
Abasourdi, le docteur sortit, écrasé par cette avalanche d’accusations qu’il lui était impossible d’écarter, car il l’avait lui-même reconnu, il ne pouvait à aucun prix indiquer l’endroit où il s’était trouvé la veille vers dix heures.
6 LA LETTRE
Marko, troublé par les évènements de la soirée, dormit mal. Au matin il se rendit bien avant son heure habituelle à l’estaminet de Ganko, où il prenait sa tasse de café. Le patron venait d’ouvrir sa boutique et d’allumer le feu, Marko était son premier client.
Après les plaisanteries de rigueur qu’il débita en servant le café, Ganko se hâta de faire part à Marko de l’aventure du docteur dans la rue Petkantchova et de ses suites, prenant soin d’enjoliver son récit d’un ramassis d’insanités, et débitant le tout avec beaucoup d’animation.
Le malheur d’autrui suscite immanquablement dans une âme vulgaire trois sentiments nés des plus profonds instincts de l’âme humaine : la surprise, la satisfaction que le malheur se soit abattu sur une autre tête et, enfin, une secrète joie maligne. Quant à Ganko, il avait en outre une bonne raison d’en vouloir au docteur : celui-ci n’avait-il pas rabattu de son compte la valeur de douze tasses de café comme prix d’une visite ? Ganko ne pouvait lui pardonner ce comportement inouï.
Marko n’en revenait pas. La veille, quand il avait causé avec le docteur, ni la physionomie ni les paroles de celui-ci n’avaient laissé deviner une aventure pareille. De plus, Sokolov ne la lui aurait certainement pas cachée.
À ce moment, l’apparition de l’onbachi dans l’estaminet permit à Marko de se renseigner. Il comprit d’un trait que le docteur était victime d’une épouvantable erreur de la police et, d’autre part, que Kralitch avait réussi à échapper à ses griffes. Le visage rasséréné, il se tourna vers l’onbachi
– Je parierais, sur ma tête, que le docteur est innocent.
– Plaise à Dieu ! fit l’onbachi, mais je me demande comment il pourrait se tirer d’affaire.
– Il le pourra mais, en attendant, on lui en fera voir de toutes les couleurs. Quand le bey viendra-t-il au konak ?
– Dans une heure. Il ne vient jamais tard.
– Il faut mettre le docteur en liberté, je me porte garant pour lui. J’y engage ma maison et mes enfants. Il est innocent.
L’onbachi le regarda, étonné :
– Ce n’est plus la peine. On l’a déjà emmené.
– Quand ? Où ? s’écria Marko.
– Cette nuit même nous l’avons envoyé à K... sous bonne escorte.
Marko bouillonna d’une indignation qu’il ne pouvait pas dissimuler.
L’onbachi avait du respect pour Marko, il lui conseilla amicalement mais sur un ton suggestif :
– Tchorbadji Marko, vous ferez mieux de ne pas vous mêler de cette sale affaire. À quoi bon ! Par les temps qui courent, mieux vaut ne pas se connaître les uns les autres. L’onbachi but son café et ajouta : – Je pars, moi aussi, dans une demi-heure porter la lettre du bey contenant les papiers révolutionnaires du docteur. Si vous voulez mon avis, il n’y a d’important que les papiers. C’est à cause d’eux qu’il est perdu... Parce que le reste... la blessure d’Osman, il paraît que le docteur n’y est pour rien... C’est notre faute à nous, à ce qu’il paraît. Ça s’est vu à la plaie. Enfin, cela regarde les chefs. Ganko, passe-moi un bout de papier pour cette lettre, je vais l’envelopper pour qu’elle ne se froisse pas.
Il sortit alors de sa veste une grande enveloppe cachetée et l’enveloppa dans le papier que le cafetier lui avait donné ; puis, après avoir fumé encore une cigarette, l’onbachi serra la main de Marko et sortit.
Marko demeura un moment pensif. Le patron, qui lui tournait le dos, faisait la barbe de Petko Basouniak. Marko se leva et sortit à son tour.
– Au revoir, Marko ! Pourquoi te dépêches-tu ? criait le barbier, tout en savonnant énergiquement la figure de son client. Il ne faut pas te faire de mauvais sang pour le docteur. « Comme on fait son lit on se couche. » Pourquoi ne vient-on pas prendre Petko Basouniak ? Qu’est-ce que tu en dis, Basouniak ?
La tête savonneuse marmotta quelque chose qui se perdit dans la mousse. Le lavage fini, le cafetier essuya la tête et le visage de Basouniak avec une serviette de propreté douteuse et lui tendit un miroir fêlé en lui souhaitant une bonne santé. Il allait à la porte pour jeter les rinçures au-dehors quand il rencontra Marko qui revenait très vite.
– J’ai oublié ma tabatière, dit celui-ci, en se précipitant vers le divan où il avait laissé l’objet.
Basouniak posa une pièce de quatre sous sur le miroir et sortit. Ganko rentra.
– Dis donc, Ganko ! Pendant que nous y sommes, fais-moi l’addition. J’aime payer à la fin du mois.
Ganko désigna du doigt le plafond recouvert de traits tracés à la craie :
– Voilà le livre, compte et paye !...
– Je n’y vois pas mon nom !
– Chez moi, c’est comme cela. À la bonne franquette !
– Tu n’iras pas loin avec cette comptabilité-là !... plaisanta Marko en sortant son porte-monnaie. Oh ! tiens, regarde ! l’onbachi a oublié sa lettre, ajouta-t-il en désignant l’étagère.
– Bon sang ! C’est bien la lettre, s’écria Ganko étonné et il jeta un coup d’œil interrogatif à Marko comme s’il voulait savoir son avis.
– Il faut la lui envoyer au plus vite, dit Marko en fronçant les sourcils. Tiens, voilà vingt-huit groches 41. Tu m’as dépouillé !
Ganko le regarda tout éberlué ; il se disait : « Curieux bonhomme, ce baï Marko. Il engagerait sa maison pour ce dompteur d’ours et ne pense pas à jeter cette lettre au feu. Un instant et le tour était joué. »
De nouveaux clients entrèrent, le café se remplit vite de fumée et les conversations sur l’infortune du docteur allèrent bon train.
7 HÉROÏSME
Le soleil, déjà haut, dardait ses rayons sur les vignes grimpantes qui étendaient leur vert feuillage sur la cour du monastère. Cette cour si sombre et si effrayante la nuit, où chaque objet prenait un aspect fantomatique, était maintenant pleine de gaieté sereine, de calme et de lumière. Les oiseaux remplissaient l’air de gazouillements joyeux. Le clapotement des eaux limpides de la source était gai. Les cyprès et les peupliers élancés frémissaient délicieusement sous le souffle du vent matinal venu de la forêt. Tout était fête et clarté. Même les vérandas et leurs cellules sombres avaient pris un air plus avenant et retentissaient des cris des hirondelles qui voltigeaient autour de leurs nids.
Au milieu de la cour, sous la treille, s’avançait un noble et digne vieillard en robe ouatinée de couleur violette, tête nue, la barbe blanche tombant jusqu’à la ceinture. Âgé de quatre-vingt-cinq ans, le père Iéroteï était une relique du siècle dernier, presque une ruine, mais une ruine imposante et qui inspirait le respect. Il vivait les derniers jours de sa longue existence dans le calme et la simplicité. Tous les matins, il faisait sa promenade, respirait l’air frais de la montagne et se laissait réjouir par le soleil et le ciel vers lequel il s’acheminait peu à peu. Un peu plus loin, vivant contraste de ce monument du passé, se tenait debout, un livre à la main, le diacre Vikenti. Il préparait son examen d’admission au séminaire russe. La jeunesse et l’espérance émanaient de son visage candide, la force et la vie brillaient dans son regard rêveur. Ce jeune homme personnifiait l’avenir vers lequel il regardait avec cette même confiance que le vieillard éprouvait en face de l’éternité.
La méditation ne pouvait trouver un terrain plus propice que cette enceinte monastique.
Sur les marches de pierre de l’église était installé le père Guédéon, à l’embonpoint sphérique ; d’un air absorbé, il contemplait avec attendrissement les dindons qui se pavanaient dans la cour, la queue déployée en éventail ; il les comparait à l’orgueilleux pharisien du Nouveau Testament et leur glouglou lui rappelait le sage Salomon, qui comprenait le langage des oiseaux. Plongé dans ces pieuses réflexions, le père Guédéon attendait tranquillement l’appel béni de la cloche annonçant le déjeuner qu’il savourait, d’avance, en respirant les agréables parfums qui s’échappaient de la cuisine.
À la porte de celle-ci se chauffait au soleil le louchon idiot du couvent, le camarade de Mountcho. Du même regard philosophique il contemplait lui aussi la vie domestique des dindons. « Contempler » pourtant n’est peut-être pas le vrai mot, en réalité, la vue de l’idiot embrassait non seulement la famille des dindons, mais l’horizon tout entier, un œil regardant à l’est et l’autre à l’ouest.
À côté de lui, Mountcho, debout, se tordait les mains, tournant la tête et jetant des regards craintifs vers la véranda de l’étage supérieur ; lui seul savait pourquoi.
À part le supérieur, absent pour le moment, et quelques valets de ferme, nous avons ainsi dénombré tous les occupants du couvent.
Justement le supérieur arrivait, au petit trot de son cheval. Il mit pied à terre, laissa la monture au louchon et dit à Vikenti, d’un air sombre :
– J’apporte de mauvaises nouvelles de la ville. (Et il raconta dans tous ses détails l’infortune de Sokolov.) Pauvre Sokolov ! termina-t-il en soupirant.
Le supérieur Natanaïl était grand, velu, robuste et agile. Du moine il n’y avait guère chez lui que le froc. Les murs de sa cellule étaient ornés de fusils ; excellent tireur, il jurait comme un troupier, s’entendait à guérir les blessures causées par les armes et n’était pas moins habile à les infliger. C’était par hasard qu’il était devenu supérieur d’un monastère, au lieu d’être voïvode dans le Balkan 42. D’ailleurs, le bruit courait qu’il l’avait été et que, maintenant, il faisait pénitence...
– Où est le père Guédéon ? demanda le supérieur en le cherchant des yeux.
– Me voilà ! s’écria d’une voix aiguë le père Guédéon, sortant de la cuisine où il était allé s’informer du déjeuner.
– Tu t’es de nouveau glissé dans la cuisine, père Guédéon, la gourmandise est un péché capital, tu le sais, n’est-ce pas ?
Et il lui ordonna d’aller faire à dos d’âne le tour des prairies du couvent où des faucheurs coupaient l’herbe, du côté de Voyniagovo.
Le père Guédéon était ventripotent, rond comme une outre pleine d’huile. Le peu de mouvements qu’il venait de faire avait amené une sueur abondante sur son visage qui s’attristait. À aucun prix il ne voulait accomplir ce voyage à travers un monde damné, aussi dit-il, d’une voix suppliante, haletant, les mains sur le ventre :
– Père, ne vous serait-il pas possible de dispenser votre humble frère de ce calice d’amertume ?
Et il s’inclina jusqu’à terre.
– Quel calice d’amertume ? Penses-tu que je songe à t’y envoyer à pied ? Tu monteras l’âne et toute la peine que tu te donneras sera de tenir la bride d’une main et de donner des bénédictions de l’autre.
Et le supérieur le regarda en souriant.
– Père Natanaïl, ce n’est pas la peine que je crains. Nous sommes dans ce lieu saint pour cela, et pour y mener une vie d’apostolat, mais les temps sont mauvais.
– Est-ce qu’il ne fait pas beau temps aujourd’hui ? Se promener au mois de mai est bon pour la santé.
– Les temps, père, les temps !... dit vivement le père Guédéon. Tenez, on a arrêté Sokolov et qui sait ! il y va peut-être de la vie du malheureux chrétien ! Les infidèles sont sans pitié !... Que Dieu me préserve ! si l’on me soupçonnait d’avoir agité le peuple, le couvent en pâtirait. Danger immense, vous dis-je, immense !
Le supérieur partit d’un rire tonitruant :
– Ha ! ha ! ha ! (Il éclatait, les poings sur les hanches, en jaugeant l’embonpoint de Guédéon.) Est-ce que tu crois que les Turcs vont te juger suspect ? Le père Guédéon, agitateur politique ! C’est bien le cas de dire le proverbe : « Qu’un paresseux t’apprenne ce que c’est que la fatigue. » Tu m’as fait rire quand je n’en avais pas envie ! Diacre Vikenti ! Diacre Vikenti ! Viens écouter ce que dit le père Guédéon... Mountcho, va chercher le diacre Vikenti, je vais étouffer de rire. (En effet, ses éclats de rire faisaient retentir tous les échos des alentours.)
À cet ordre, Mountcho roula encore plus affreusement ses yeux terriblement écarquillés, empreints d’une peur obtuse.
– Rus-si-an ! cria-t-il, tremblant et montrant du doigt la véranda où venait de disparaître le diacre Vikenti. Et, pour ne pas recevoir un nouvel ordre, il partit du côté opposé.
– Russian ! Qu’est-ce que ce Russian-là veut dire ?
– Il veut dire un loup-garou, révérend, fit le père Guédéon.
– Depuis quand Mountcho est-il devenu si poltron ? Lui qui vivait comme un hibou dans les bois !
En vérité, père Natanaïl, un esprit des ténèbres se promène sur la véranda de l’étage supérieur. Cette nuit même, Mountcho, mort de peur, est venu me trouver. Il aurait vu un fantôme habillé de blanc sortir de la cellule vitrée. Il m’a raconté d’autres choses encore, mais le diable lui-même n’y pourrait rien comprendre... Il faudra asperger d’eau bénite la véranda du haut.
Mountcho, planté à bonne distance de là, regardait vers la véranda d’un air épouvanté.
– Qu’est-ce qu’il a bien pu voir ? Viens, père Guédéon, faire un tour, dit le supérieur, qui pensa que peut-être des voleurs s’étaient introduits pendant la nuit.
– Dieu m’en garde ! fit le père Guédéon se signant vite plusieurs fois.
Le supérieur se dirigea seul vers les vérandas.
Vikenti était entré chez Kralitch au moment même où le supérieur le cherchait.
– Qu’y a-t-il de nouveau, frère ? demanda Kralitch. Il avait lu l’inquiétude sur le visage du diacre.
– Rien de grave..., s’empressa de dire Vikenti. Seulement la nouvelle que le supérieur a apportée de la ville est très désagréable. Cette nuit on a arrêté Sokolov et on l’a emmené à Karlovo.
– Qui est ce Sokolov ?
– Un médecin de la ville. Un brave jeune homme. On aurait trouvé dans son pardessus des papiers subversifs... Qui sait ? Je le connais pour un bon patriote, dit le diacre, soucieux, qui reprit peu après : – Hier au soir, il a fait feu sur la garde qui le poursuivait, et il a blessé un zaptié qui lui a arraché son pardessus... Le pauvre docteur, il est fichu !... Dieu soit loué ! vous vous en êtes tiré... On n’entend pas parler de vous en ville.
À peine le diacre avait-il fini que Kralitch se mit à arpenter comme un fou la chambre, de long en large, la tête dans les mains, évidemment saisi par une détresse poignante à laquelle Vikenti ne pouvait rien comprendre. Il s’écria :
– Mais que fais-tu, sapristi ? Il n’y a rien, Dieu soit loué !
Kralitch s’arrêta devant lui ; le visage décomposé par la douleur, il cria furieusement :
– Il n’y a rien ! Il n’y a rien ! C’est facile à dire ! et Kralitch se frappa le front. Pourquoi me regardes-tu, Vikenti ? Il paraît que tu n’y comprends rien ! Ah ! mon Dieu, j’ai oublié de te dire ce matin que le pardessus était sur moi. Un jeune homme très aimable, voyant mes habits en lambeaux, m’en avait fait cadeau hier soir, à l’entrée de la ville. Il m’avait indiqué aussi la maison de Marko Ivanov. Or, j’ai mis dans la poche un numéro du journal l’Indépendance, et une proclamation qu’on m’avait donnée dans un hameau où j’avais passé la nuit... On l’accuse par-dessus le marché d’avoir fait feu contre la garde quand je n’ai même pas touché à mon revolver !... Ah ! les maudits !... Maintenant tu y es ? Cet homme est accusé à ma place... Le Destin m’a maudit en me condamnant à porter malheur à ceux qui me font du bien.
– Quel terrible malheur ! murmura Vikenti affligé. Le pis c’est qu’il est impossible de lui venir en aide... Tu vois où on en est.
Kralitch se retourna, le visage cramoisi :
– On ne peut pas lui venir en aide ? Crois-tu que je laisserai périr pour moi un homme si généreux et, par-dessus tout, un bon patriote, à ce que tu dis. Ce serait une lâcheté !
Le diacre regardait Kralitch, tout ébahi.
– Non, je l’arracherai à ce malheur, fût-ce au prix de ma tête !
– Comment faire, reprit Vikenti, dis ? Je suis prêt à tout.
– C’est moi qui le sauverai et pas un autre !
– Toi ?
– C’est moi qui le délivrerai... C’est mon devoir, et il n’y a que moi qui puisse le sauver, criait furieusement Kralitch courant par la cellule, le visage empreint d’une résolution farouche. Veux-tu alors qu’on attaque la prison ?
Le diacre regardait Kralitch d’un air étonné, même effrayé, se demandant s’il n’avait pas perdu la raison.
– Monsieur Kralitch, de quelle façon crois-tu délivrer le docteur ?
– Tu ne devines pas ?
– Non.
– Je me livrerai à la police.
– Comment ? Te livrer toi-même ?
– Comment faire autrement ? charger quelqu’un d’autre ? Écoute, frère Vikenti, je suis un honnête homme et je ne veux pas racheter ma vie au prix du malheur d’autrui. Je n’ai pas marché pendant six cents heures pour venir commettre une lâcheté. Si je ne peux offrir ma vie à la gloire de ma patrie, je peux au moins la sacrifier honnêtement... Tu comprends ? Si je ne me présente pas aujourd’hui même devant les autorités turques, si je ne déclare pas : « Cet homme-là est innocent, il n’a aucune relation avec moi, le pardessus m’a été enlevé, les papiers m’appartiennent, c’est moi le coupable et même c’est moi qui ai tiré sur la garde, faites ce que vous voudrez de moi », le Dr Sokolov est perdu, surtout s’il n’a pas pu, ou n’a pas voulu, se justifier. Y a-t-il un autre moyen ? Dis-le-moi !
Le diacre gardait le silence. Il sentait au plus profond de son âme honnête que Kralitch avait raison : ce renoncement à lui-même était imposé par la justice et par l’humanité. Et l’homme lui parut désormais plus noble, plus digne d’admiration. Sur son visage se répandit une lueur céleste, reflet du sublime élan de vertu dont il était le témoin. Les paroles ardentes et passionnées de Kralitch résonnaient délicieusement et solennellement dans son âme : il aurait voulu être à sa place, prononcer ses paroles, agir comme lui. Les larmes lui vinrent aux yeux.
– Montre-moi le chemin de K..., dit Kralitch.
Soudain la grande figure barbue du supérieur parut à la fenêtre. Emportés par la conversation, ils n’avaient pas entendu ses pas dans la véranda.
Kralitch tressaillit et jeta un regard interrogateur au diacre. Celui-ci sortit aussitôt, emmena le supérieur vers la balustrade et lui parla longtemps avec animation et en gesticulant : il jetait de temps en temps un coup d’œil vers la cellule où Kralitch attendait, impatient et troublé. La porte livra enfin passage à Vikenti et à Natanaïl. Kralitch s’empressa de baiser la main du supérieur.
– Attendez, je ne mérite pas que vous me baisiez la main ! fit le supérieur, les larmes aux yeux ; et donnant l’accolade à Kralitch, il l’embrassa chaleureusement, tel un père retrouvant son fils après une longue absence.
8 LA FAMILLE DE IORDAN
Le vieux tchorbadji Iordan offrait un déjeuner auquel il avait invité des parents, des amis de sa famille et les gens de sa clientèle.
D’un âge déjà avancé, maladif, maussade et grincheux, Iordan Diamandiev était un de ces notables bulgares qui avaient rendu odieux le titre de tchorbadji. Son bien augmentait sans cesse, sa progéniture était à l’aise, et sa parole avait du poids, mais personne ne l’aimait. Ses injustices et ses indélicatesses envers les pauvres gens, aussi bien que son entente continuelle avec les Turcs, l’avaient fait détester, et l’on continuait à le haïr, bien qu’il ne fît ou ne pût plus faire du mal. C’était tout à fait un homme du passé.
Malgré l’air maussade de Iordan, le repas était gai. Guinka, la fille mariée, encore jolie, bavarde et taquine qui, de temps en temps, attaquait son timide mari, amusait les invités par son badinage et par les agaceries que sa langue infatigable distribuait à droite et à gauche. Les trois religieuses du couvent riaient plus encore que les autres et, parmi elles, Mme hadji Rovoama, la sœur de Iordan, boiteuse, bilieuse et intrigante, prenait le ton de Guinka pour lancer des méchancetés aux dépens des absents. Hadji Smion, gendre du maître de céans, éclatait souvent de rire, la bouche pleine. Hadji Pavli, le beau-père, emporté lui aussi par le rire, mangeait avec la fourchette de Mikhalaki « Alafranga 43 ».
Ce dernier, quelque peu choqué par une telle méprise, regardait d’un air renfrogné autour de lui. Mikhalaki méritait bien son sobriquet « À la française », car il avait été, trente ans auparavant, le premier, dans toute la ville, à porter un pantalon de coupe européenne, et c’était encore lui qui y avait prononcé les premiers mots de français. Mais il en était resté là. Sa veste était toujours de l’époque de la guerre de Crimée, et pas un mot n’était venu s’ajouter à son maigre vocabulaire français. Néanmoins une renommée d’érudit lui restait acquise, en même temps que son sobriquet. Mikhalaki le savait et il en était fier : il faisait l’important, parlait posément et ne permettait à personne de l’appeler « baï Mikhal », de peur d’être confondu avec le pandour Mikhal. En effet, Mikhalaki était très pointilleux quant à son titre ; il avait même poursuivi d’une haine tenace son voisin Ivantcho Iotata qui, par deux fois, dans une réunion, l’avait appelé « Malafranza » au lieu de « Alafranga », croyant en toute bonne foi qu’il n’y avait pas là de différence.
En face de notre Français se tenait Damiantcho le Crigor, un homme sec d’une cinquantaine d’années, brun, au visage long et au regard malin et rusé, aux lèvres ironiquement pincées, à l’air très grave. Il était beau parleur et son répertoire d’histoires de toutes sortes était profond comme un puits et enrichi par l’imagination de tous les trésors des Mille et une Nuits. D’une goutte d’eau il pouvait faire une mer et d’un grain de sable une montagne. Il pouvait même se passer des grains de sable ! L’essentiel était que Damiantcho crût lui-même à ce qu’il disait : c’était évidemment le meilleur moyen d’y faire croire les autres. À part cela, l’un des premiers commerçants de la ville, patriote et homme de bon conseil.
Le mari de Guinka mangeait modestement, sans lever la tête, car, dès qu’il osait dire un mot ou rire un peu fort, sa femme lui jetait des regards farouches : il n’avait pas le droit de prendre cette liberté devant elle. Faible et sans caractère, il s’était effacé devant sa femme au point de se laisser appeler Guenko Guinkine, alors qu’au contraire c’était sa femme qui, devant prendre le nom de son mari, aurait dû s’appeler Guinka Guenkova.
À côté de Guenko Guinkine, Netcho Pironkov, le conseiller, se penchait toutes les deux minutes à l’oreille de Kiriak Steftchov. Celui-ci, tiré à quatre épingles, inclinait la tête sans écouter et coulait des regards souriants à Lalka, l’autre fille du tchorbadji Iordan. Cette irrévérence porta son châtiment en elle-même : Netcho, ayant eu l’idée de trinquer, répandit le contenu de son verre sur le pantalon blanc de Steftchov.
Ce dernier, jeune homme que nous avons déjà rencontré chez le bey, et qui tiendra un rôle important dans notre récit, était empreint de l’esprit et imbu des idées des tchorbadjis ; c’était le fils d’un notable du même acabit que Iordan Diamandiev. Jeune encore, mais pliant déjà sous le faix de notions périmées, il restait inaccessible au souffle généreux des idées nouvelles de liberté. Aussi, bien vu des Turcs, il était détesté par les jeunes gens, qui voyaient en lui un mouchard. Son orgueil, l’envie, la haine et la perversité qui emplissaient son âme le faisaient détester encore davantage. Malgré tout cela, ou peut-être à cause de tout cela, le tchorbadji Iordan avait pour Steftchov une faiblesse qu’il se gardait de cacher. Aussi la rumeur faisait-elle de Steftchov, à tort ou à raison, le futur gendre du tchorbadji Iordan.
La table desservie, le café fut apporté par une svelte jeune fille brune aux joues roses qui, dans sa petite robe noire, n’attira l’attention de personne. Les conversations commencées à table et qu’animait la volubile vivacité de Guinka allaient leur train. Bientôt, et sans s’en apercevoir, on tomba sur l’évènement du jour : la mésaventure du docteur. D’emblée, ce sujet capta toute l’attention : il donnait un agréable regain d’animation au moment qui précède la sieste.
– Il serait curieux de savoir ce que fait maintenant madame la doctoresse, disait sœur Séraphima.
– Quelle doctoresse ? demanda sa belle-sœur.
– Cléopâtre, pardi !
– On devrait aller lui faire un brin de causette, la consoler et lui dire d’écrire au docteur, qui doit s’ennuyer sans sa dame, fit Guinka.
– Cléopâtre ? qu’est-ce que cela veut dire, Cléopâtre ? demanda la belle-sœur à Mikhalaki Alafranga. Grand-mère ne peut pas prononcer ce nom-là ; elle dit : « patatras ».
Mikhalaki fronça les sourcils, parut un moment tout absorbé, puis dit en traînant sur les mots :
– Cléopâtre, c’est un mot hellénique, c’est-à-dire grec ; il veut dire : pleurer après..., verser des larmes pour...
– Dis tout simplement : pleurer après le docteur, commenta en souriant hadji Smion ; et il enfonça ses mains dans les poches de sa veste.
– Dame ! elle ne l’aura pas volé, ce nom, dit sœur hadji Rovoama. Mais quelqu’un d’autre pleurera davantage encore le docteur, et se penchant à l’oreille de la femme de hadji Smion et puis à celle d’une autre commère, elle y chuchota des choses qui les firent éclater d’un rire malicieux qui se communiqua à tous les invités.
– Est-il possible, Guinka ! Serait-ce toujours la femme du bey ? demanda la femme de Netcho.
– Sois tranquille : brebis comptées, le loup les mange..., fit Guinka.
Et les rires d’éclater de nouveau.
– Dis, Kiriak, quels papiers a-t-on trouvés sur le docteur ? demanda le tchorbadji Iordan, qui ne saisissait pas la cause de la gaieté de ses invités.
– Révolutionnaires d’un bout à l’autre ! Le bey m’a fait appeler au beau milieu de la nuit pour les lui traduire. C’étaient des insanités et des ordures que seuls les imbéciles peuvent inventer. La proclamation du Comité révolutionnaire central de Bucarest nous invitait à mettre plutôt tout en cendres, mais à nous libérer, coûte que coûte.
– Mourez tous et on sera libres !..., insinua ironiquement Netcho Pironkov.
– Ces chenapans veulent mettre tout à feu et à sang, mais pas leurs biens à eux, évidemment. D’ailleurs, ils n’en possèdent guère. Réduire en cendres, c’est facile à dire ! Espèces de vauriens ! dit d’un air outré le tchorbadji Iordan.
– Scélérats ! grogna hadji Smion.
Damiantcho le Grigor qui, jusqu’alors, avait en vain cherché l’occasion de placer une de ses longues histoires amusantes, s’accrocha aux dernières paroles de hadji Smion et dit :
– Des scélérats, dis-tu, hein ? Mais il y a scélérats et scélérats... Moi, il m’a fallu me rendre un jour à Chtip 44... C’était en 1863, au mois de mai, comme à présent, le vingt-deux, à trois heures du matin, un samedi. Le ciel était couvert...
Et baï Damiantcho plaça enfin son histoire de brigands, longue à n’en pas finir, où étaient mêlés l’aubergiste de Chtip, deux pachas, un capitaine grec et la sœur du prince valaque Cuza.
Chacun prêtait toute son attention, sinon toute sa confiance, au récit alléchant de Damiantcho, tout en sirotant avec délices son café.
– Alors, s’ils veulent tout brûler, notre couvent y passera-t-il aussi ? demanda sœur hadji Séraphima.
– Que le feu du Ciel leur tombe dessus, proféra sœur hadji Rovoama.
– Pensez-y, continua Steftchov, n’est-ce pas scandaleux de répandre des idées pareilles ? Cela corrompt la jeunesse, la rend fainéante et la conduit au gibet. Tenez, comme Sokolov, par exemple, c’est dommage, n’est-ce pas ?
– Oui, c’est dommage, en effet ! confirma hadji Smion.
Mikhalaki Alafranga prit alors la parole :
– Hier encore, j’ai compris, par une conversation que j’ai eue avec le docteur, ce qu’il avait en tête. Il regrettait que nous n’ayons pas chez nous des Lubobratitchis 45.
– Et que lui as-tu répondu ?
– Je lui ai répondu que si nous n’avons pas de Lubobratitchis, nous ne manquions pas de gibets...
– C’est bien répondu ! dit le tchorbadji Iordan.
– Qu’est-ce que c’est que ces Lubobratitchis ? demanda la curieuse belle-sœur.
Guenko Guinkine, qui lisait régulièrement le journal Pravo et se tenait au courant de la politique, entrouvrait la bouche pour répondre, mais sa femme le foudroya du regard et répondit à sa place :
– C’est un voïvode herzégovinien, grand-mère. Si nous avions un Lubobratitch... je me ferais son porte-drapeau et nous irions couper les choux...
– Diantre ! s’il y avait des Lubobratitchis, alors, c’est différent... Je me rangerais, moi aussi, sous leur étendard ! dit hadji Smion.
Le tchorbadji Iordan fronça les sourcils :
– On ne dit pas de choses pareilles, même en plaisantant, ma fille. Hadji, tu parles à tort et à travers. Puis, se tournant du côté de Mikhalaki, il questionna : Et que va devenir le docteur maintenant ?
– Selon la loi, répondit Steftchov, tout attentat contre un fonctionnaire impérial entraîne la peine de mort ou la déportation à perpétuité à Diarbékir.
Et il jeta tout autour des regards triomphants.
– Il ne l’a pas volé ! marmotta hadji Rovoama, qu’a-t-il donc à vouloir mettre le feu au couvent ?
– C’est lui-même qui l’aura cherché ! fit Netcho. La pétarade d’hier soir n’a pas été pour rien.
– À propos de pétarade... Cela me rappelle... Dieu me vienne en aide ! Un jour de la guerre de Crimée où moi et Ivan Bochnakov nous nous dirigions vers la Bosnie... Je me rappelle comme si c’était aujourd’hui..., c’était un jour ou deux avant la Saint-Nicolas. La nuit était tombée lorsque l’orage nous surprit au-delà de Pirote, mais quel orage !...
Et Grigor raconta comment la foudre était tombée au-dessus de leurs têtes, incendiant un noyer, foudroyant une cinquantaine de brebis et emportant la queue de son cheval bai, qu’il avait ensuite vendu pour presque rien.
Grigor débita son récit avec tant de minutie et d’éloquence que l’auditoire ne put s’empêcher d’en suivre jusqu’au bout les péripéties avec une attention soutenue. Steftchov et le conseiller Netcho se regardaient en souriant. Mikhalaki avait pris un air grave, cependant que hadji Smion, bouche bée, semblait foudroyé par la force destructive de la foudre de Damiantcho, tombée, chose étrange, en plein hiver.
Là-dessus Guinka chercha du regard Lalka.
– Dis-donc, Rada, où a disparu Lalka ? Va la chercher ! dit d’un ton impérieux hadji Rovoama à la jeune fille vêtue de noir.
Lalka, la fille cadette du tchorbadji Iordan, ayant entendu les paroles proférées avec tant de calme cruauté par Steftchov, s’était retirée doucement dans sa chambre, toute voisine ; elle s’était jetée sur le divan, la figure cachée dans la couverture et pleurait à haute voix comme une enfant ; un flot de larmes longtemps retenues coulait de ses yeux, les sanglots l’étouffaient, la souffrance et la pitié se lisaient sur sa figure. Ces gens qui se moquaient avec tant de cruauté du malheur du docteur mettaient son âme en révolte et leurs propos avivaient sa souffrance... « Mon Dieu, ils n’ont donc aucune pitié ! » pensait-elle.
Les larmes soulagent même les chagrins inconsolables, et le sort du docteur, encore incertain, n’interdisait pas tout espoir. Lalka se leva, essuya son clair et joli visage, et s’assit près de la fenêtre grande ouverte pour sécher plus vite les traces de ses larmes. Elle regardait distraitement la rue, sans faire attention aux passants qui poursuivaient leur chemin, indifférents et insouciants. Ce monde cruel n’existait pas pour elle car son cœur était rempli d’une seule image : elle ne voulait voir ni entendre personne.
Tout à coup le trot d’un cheval attira son attention et elle resta stupéfaite en voyant le Dr Sokolov qui, la figure épanouie, rentrait en ville, monté sur un cheval blanc. Il la salua poliment et s’éloigna. Dans sa joie, elle oublia de répondre à son salut et, irrésistiblement poussée par son allégresse, elle se précipita vers les invités en criant :
– Le Dr Sokolov est de retour !
Une expression de désagréable surprise parut sur les visages de la plupart des convives. Steftchov pâlit mais, feignant l’indifférence, il dit :
– Sans doute on l’a fait venir pour un nouvel interrogatoire. Il n’échappera pas facilement à Diarbékir, ou à la corde !
À ce moment il rencontra le regard dédaigneux de Rada qui le blessa cruellement ; son visage s’enflamma de colère.
– Taisez-vous, Kiriak ! Plaise à Dieu qu’il s’en tire, le malheureux ! Je plains sa jeunesse, dit avec chaleur Guinka.
Les railleries lancées contre le docteur étaient au fond sans malice. L’étincelle divine, pourvu qu’elle s’y trouve, est toujours prête à jaillir du cœur humain. Il faut dire à l’honneur de hadji Smion que lui aussi se réjouissait sincèrement du retour du docteur, bien qu’il n’osât pas le dire en présence du tchorbadji Iordan, comme l’avait fait cette folle de Guinka, sa fille.
9 EXPLICATIONS
Aussitôt arrivé chez lui, Sokolov repartit pour aller chez Marko Ivanov. Il passa vite devant l’estaminet de Ganko où plusieurs personnes le saluèrent avec un : « Vous l’avez échappé, belle 46 ! » et, parmi eux, le patron se faisait remarquer par son zèle. Comme il entrait chez Marko, il vit Steftchov sortir de chez le tchorbadji Iordan.
– Mes hommages, monsieur l’interprète, lui dit-il, un sourire méprisant aux lèvres.
Marko, qui venait de se lever de table, savourait son café sur le divan placé entre les grands buis. Il reçut le docteur avec enthousiasme. Celui-ci, après avoir répondu joyeusement aux félicitations de Marko et de sa famille, raconta son histoire :
– Et maintenant, je vais te dire de drôles de choses, baï Marko...
– Qu’est-ce qui s’est passé, bon sang ?
– Je n’y comprends rien... Il me semble avoir rêvé. Cette nuit, à peine rentré de chez vous, voilà qu’on vient me chercher pour m’emmener au konak. Tu as déjà entendu de quoi on m’accusait. Qui aurait pu supposer que mon vieux pardessus râpé allait provoquer tant d’histoires ! On m’emprisonne. Une heure environ après, je vois entrer deux zaptiés : « Préparez-vous, docteur, qu’ils me disent. – Pourquoi ? – On va à K... Ordre du bey. –Très bien.
« Aussitôt, nous nous mettons en route, l’un des zaptiés devant moi, l’autre derrière, tous deux armés jusqu’aux dents. À K... nous arrivons de bon matin. On me met sous les verrous, car le tribunal n’était pas encore ouvert. Je passe ainsi quatre heures qui me paraissent de longues années. Enfin, on m’introduit auprès du magistrat et de quelques notables qui me lisent un procès-verbal auquel je n’ai rien compris. Et puis des questions et des bêtises à n’en pas finir au sujet de mon malheureux pardessus qui, lui, reposait sur le tapis vert de la table et me regardait plutôt tristement. Le magistrat ouvre une lettre, probablement celle de notre bey, en tire des papiers et me demande : « Ces papiers sont-ils à vous ? – Je ne les ai jamais vus ! – Alors, comment se fait-il qu’ils aient été dans votre poche ? – Ma main n’y a jamais touché ! » Alors il continue à lire la lettre. Baï Tinko Baltoolou prend le journal et le déploie : « Efendi, dit-il à voix basse au magistrat, dans ce journal il n’y a rien de compromettant, il paraît à Constantinople. » Et il me regarde en souriant. Décidément, je n’y comprenais rien et je restais planté là comme une bûche. « N’est-ce pas le journal des komitadjis en Valachie ? demande le kadi 47. – Pas du tout, efendi, il n’y a pas de politique, on n’y parle que religion, c’est un journal protestant. » Moi-même je n’en croyais pas mes yeux : c’était le journal Zornitsa 48 de Constantinople. Tinko Baltoolou prend la proclamation, lit et rit de nouveau : « Efendi, c’est un prospectus, et il lut à haute voix : Manuel de médecine pratique du Dr Ivan Bogorov 49. » Le kadi reste abasourdi, les autres se mettent à rire, le juge rit aussi, et moi de même. Que faire ? Pas moyen de s’en empêcher... Mais l’essentiel, c’est que je ne comprends rien au miracle par lequel les papiers avaient été changés ! Quoi qu’il en soit, après un court conciliabule avec les notables, le kadi me dit : « Docteur, il y a là une erreur. Excusez-nous de vous avoir causé toute cette peine ! » Il appelait « peine » les heures que j’ai passées en prison et le trimbalement pendant la nuit d’un konak à l’autre. « Présentez un répondant et vous êtes libre ! » J’en étais complètement étourdi.
– A-t-il été question du zaptié blessé ? fit Marko.
– Pas un mot. À ce que j’ai compris, quelqu’un a dû parler au bey, ou bien il aura lui-même mieux approfondi la question car, finalement, il a ajouté dans sa lettre qu’il ne me tenait pas pour coupable de la blessure du zaptié. Celui-ci aurait-il reconnu avoir menti ?
Le visage de Marko s’éclaira. Il avait cru que le fils de son ami Manol avait réellement tiré sur la garde et s’inquiétait des conséquences possibles de cet acte.
– Dieu merci, tu es libre à présent.
– Comme tu le vois ! Mais, attends, il y a une chose encore plus curieuse, ajouta le docteur en regardant si personne n’était là pour l’entendre. Baï Nikoltcho, qui s’était porté mon garant, m’avait aussi donné son cheval pour rentrer. Comme je sortais de la ville, à peine arrivé au cimetière juif, voilà que j’aperçois deux personnes qui venaient du côté de la montagne. L’un était le diacre Vikenti qui me fait signe de m’arrêter. « Où allez-vous, monsieur Sokolov ? demanda-t-il, comme étonné de me voir libre. – Je m’en vais, c’est fini. » Il avait l’air tout ahuri. Je lui explique la chose et il se jette alors à mon cou, m’embrasse et me serre dans ses bras. « Mais qu’y a-t-il donc, frère Vikenti ? – Tu permets que je te présente monsieur Boïtcho Ognianov ? et il me désigne son compagnon. Je le regarde. – Ah ! ça y est, je le reconnais. » C’était le même à qui j’avais donné le pardessus la veille.
– Comment ? le fils de Manol Kralitch ? s’écria involontairement Marko Ivanov.
– Tu le connais ? demanda le docteur étonné.
Marko, remis de sa surprise, bien qu’encore ému, éluda la question :
– Voyons la suite !
– Nous nous sommes serré la main et nous avons fait connaissance. Il me remercia pour le pardessus et, d’une voix où perçait le désespoir, commença à s’excuser. « Ce n’est rien, monsieur Ognianov, je ne me repens jamais lorsque je réussis à faire un peu de bien. Et vous, où allez-vous ? – M. Ognianov venait vous chercher ici, répond Vikenti. – Moi ! – Oui, il voulait vous délivrer. – Me délivrer ?... – Oui, en se livrant à la police et en reconnaissant tout. – Est-ce vraiment pour cela que vous veniez ? Ah ! monsieur Ognianov, qu’alliez-vous faire ? m’écriai-je. – C’était mon devoir ! » fit-il simplement. Je ne pus retenir mes larmes et je l’embrassai là, au beau milieu de la route, comme un frère. Ah ! quelle âme noble, baï Marko ! Quel héroïsme ! Voilà, c’est de tels hommes que la Bulgarie a besoin !
Marko ne répondit rien. Deux grosses larmes roulèrent sur ses joues. Il était heureux que son ami Manol eût de quoi être fier.
Le docteur se tut un moment puis continua :
– Nous nous sommes séparés. Ils ont pris par les champs, moi je suis venu directement ici. Mais je suis tout bouleversé par cette rencontre et encore plus par la substitution des papiers. Je te dis que j’ai vu ici de mes propres yeux le journal l’Indépendance et une vraie proclamation. Et puis, là-bas, tout d’un coup on vous sort le journal protestant Zornitsa et le prospectus de Bogorov. Comment cela a-t-il pu arriver ? Qui a fait l’échange ? Est-ce une erreur du bey ? Je ne fais que me tourmenter la cervelle sans rien y comprendre. Qu’est-ce que tu en penses, baï Marko ?
Et, croisant les bras, le docteur attendit la réponse.
Marko tira gravement sur son chibouk et dit avec un sourire à peine perceptible :
– Ne comprends-tu pas que c’est un ami qui a dû faire tout cela ? Il ne peut pas être question d’une erreur ! Comment, d’ailleurs, y aurait-il chez le bey des journaux protestants et des prospectus de Bogorov ?
– Mais qui peut bien être ce bienfaiteur inconnu qui m’a sauvé d’un si grand danger, et a sauvé Ognianov de la mort ? Aide-moi à le découvrir. Je veux le remercier, lui baiser les mains et les pieds.
Marko se pencha à l’oreille du docteur et lui dit tout bas :
– Écoute, docteur ! Le secret que je vais te confier, nous devrons le garder jusqu’à la tombe.
– Ma parole d’honneur !
– C’est moi qui ai changé les papiers.
– Toi, baï Marko ! s’écria le docteur en se levant d’un bond.
– Du calme, assieds-toi... Écoute maintenant, que je te raconte. J’entre ce matin de très bonne heure à l’estaminet de Ganko et j’apprends la nouvelle de ton arrestation de la bouche même du patron. Je n’en revenais pas. À ce moment-là, voilà l’onbachi qui arrive et me dit que l’on t’avait envoyé à K..., où il devait se rendre sous peu, avec la lettre du bey renfermant les papiers compromettants. Je ne savais plus que faire ! Peu après l’onbachi sort et je m’aperçois qu’il avait oublié la lettre ! Ganko était occupé à laver la tête d’un client. J’hésite un moment. Prendre cette lettre et la jeter au feu ? Cela n’avancerait à rien. Le soupçon subsisterait et l’on te traînerait d’une prison à l’autre. Le temps pressait. Alors j’ai pensé à faire une chose dont je ne me serais jamais cru capable... Tel que tu me vois, docteur, blanchi par les longues années de commerce, je n’ai jamais ouvert une lettre adressée à autrui. Que Dieu me pardonne ! j’y ai pensé toujours comme à la pire des infamies, mais je l’ai fait ce matin pour la première fois, et je ne recommencerai jamais. Je cours donc chez moi, je m’enferme dans mon bureau, j’enlève soigneusement le cachet rouge et je glisse dans l’enveloppe les premiers papiers qui me tombent sous la main. Les Turcs ne sont pas très méticuleux, tu les connais... Puis je remets la lettre à sa place, sans que le patron s’en aperçoive. Dieu merci, tout s’est bien passé et, à présent, je n’ai plus autant de remords !
Le docteur, qui avait écouté, tout ébahi, dit d’une voix émue :
– Oh ! baï Marko, je t’en serai reconnaissant toute ma vie. Tu appelles cela une infamie ! Mais c’est un acte glorieux, un exploit ! Tu t’es exposé afin de sauver deux compatriotes de l’abîme. Un père n’aurait pas fait davantage pour son fils...
L’émotion lui coupa la parole.
Marko reprit :
– Le fils de Manol Kralitch est en effet venu me trouve hier soir ; seulement, ayant passé par le toit, il avait fait tout le tapage qui amena ensuite la police.
– Boïtcho Ognianov ?
– Est-ce comme cela que vous l’appelez ? Oui, c’est bien lui. Son père est mon meilleur ami et lui, le malheureux, ne connaissant personne d’autre, essayait de trouver un asile chez moi. C’est toi qui l’avais amené, mais je ne voulais pas t’en parler hier soir devant Ivantcho. D’ailleurs, il s’est enfui presque aussitôt.
– D’où venait-il ? demanda le docteur, qui déjà se sentait sous le charme de ce personnage extraordinaire.
– Il ne te l’a pas dit ? C’est un évadé de Diarbékir.
– De Diarbékir ?
– Mais attends, où vas-tu comme ça ?
– Je file au couvent chez le diacre qui cache Kralitch. Je dois m’entretenir avec lui. Me permets-tu de lui faire part du secret ? Il doit savoir à qui il doit la vie car, sans toi, si l’on ne m’avait pas relâché, il se serait livré.
– Non, je t’en conjure. Garde ce secret tant que tu vivras et même tâche, à la longue, de l’oublier. Je te l’ai dit à toi seul, comme à un confesseur, pour me soulager. Dis seulement un bonjour au fils du vieux Manol. Qu’il passe chez moi si cela lui fait plaisir, mais par la grande porte...
10 UN COUVENT DE FEMMES
À l’opposé du monastère des moines qui, isolé au pied de la montagne, demeurait toujours morne et désert, le couvent des religieuses de Biala-Tcherkva était très animé. Soixante à soixante-dix nonnes, jeunes et vieilles, allaient et venaient à longueur de journée dans la cour et sous les vérandas, faisant retentir de leur babillage le vaste enclos qui les protégeait contre la vaine agitation du monde des pécheurs.
Ce couvent se piquait d’être la plus productive fabrique de nouvelles de toute la ville, le berceau de tous les commérages qui, allant leur petit bonhomme de train, troublaient les foyers des laïques pécheurs. C’est ici qu’on prédisait et qu’on préparait les fiançailles, ici que l’on faisait rater les mariages. C’est d’ici que partaient tous les échos badins qui, après avoir fait le tour de la ville, revenaient aisément, mais démesurément grandis ; ils y entraient pas plus grands que des fétus, ils en ressortaient imposants comme des montagnes. Un milieu aussi bruyant attirait surtout aux jours de fête, quantité d’hôtes laïques que les pieuses femmes s’empressaient de régaler d’anecdotes sur la ville et de confiture de griottes.
Sœur hadji Rovoama, dont nous avons déjà fait la connaissance chez son frère, le tchorbadji Iordan, passait pour la plus habile devineuse de secrets de toute la ville : une infatigable potinière. Autrefois supérieure du couvent, elle avait été destituée à la suite d’une mutinerie dans la république des nonnes. Néanmoins, elle gardait la haute main sur les esprits. On la consultait sur toutes choses ; elle confirmait les commérages fondés ou, tout aussi bien, donnait sa bénédiction aux calomnies. Guidée par son caprice, elle répandait des cancans qui servaient quelque temps de pâture aux âmes de la communauté, et ensuite franchissaient l’enceinte.
Or, ces jours-là, sœur Rovoama, très mécontente de ce qu’on eût relâché le docteur, ce dangereux ennemi du couvent, distillait partout le poison, cherchant à découvrir d’où était venue l’aide qu’avait reçue Sokolov. Qui donc avait osé la priver du plaisir d’entendre et même de forger de nouvelles histoires sur l’infortune du docteur ? Le fait était inouï ! Elle n’en dormait plus depuis quatre ou cinq jours. Elle se torturait l’esprit à deviner quelle raison avait empêché le docteur de dire au bey l’endroit où il se trouvait, à onze heures, le fameux soir de son arrestation. Et puis, qui avait changé les journaux ?
Tout à coup, pendant sa prière du soir, un éclair illumina sa pensée, de joie elle battit des mains, tel Archimède découvrant son fameux principe. Elle se rendit aussitôt chez sœur Séraphima, qui s’était déjà déshabillée et, d’une voix frémissante, lui dit :
– Sœur Séraphima, sais-tu où était le docteur le soir de son arrestation, sais-tu pourquoi il n’a pas voulu le dire au bey ?
Sœur Séraphima devint tout oreilles.
– Chez la femme du bey, pardi !
– Pas possible !
– Mais si, et c’est pour cela qu’il n’a pas voulu répondre au bey. Il n’est pas si bête ! Sainte Vierge ! étais-je nigaude de n’avoir pas deviné tout cela plus tôt ! disait sœur Rovoama tout en se couvrant de signes de croix devant l’iconostase. Et sais-tu qui a fait mettre le docteur en liberté ?
– Mais non, ma sœur.
– Voyons, ma sœur, c’est encore la femme du bey.
– Non, vraiment, ma sœur ?
– Mon Dieu, où avais-je la tête ? Sainte Vierge !
Après avoir donné libre cours à son émotion, hadji Rovoama regagna sa cellule, finit sa prière interrompue et se mit au lit, l’âme en paix.
Le lendemain matin, le couvent tout entier n’était préoccupé que d’une seule et même question : l’histoire du docteur et de la femme du bey s’amplifiait et prenait des proportions inquiétantes. Chacune demandait :
– D’où vient la nouvelle ?
– Mais, de hadji Rovoama !
Ce nom désarmait tous les Thomas incrédules. Et l’on se précipitait chez elle pour avoir de plus amples détails. Au bout de deux heures la nouvelle avait fait le tour de la ville.
Mais toute nouvelle, même la plus piquante, vieillit au bout de trois jours. La communauté, en quête d’une nouvelle pitance, commençait à s’ennuyer de nouveau. L’apparition subite de Kralitch, que personne ne connaissait en ville, donna un regain d’animation à la vie du couvent qui se remit à bourdonner. Qui est-il ? D’où vient-il ? Pourquoi est-il venu ? On l’ignorait. Les sœurs les plus curieuses se rendirent en ville. Mais, sauf en ce qui concerne le nom, elles rapportèrent des nouvelles contradictoires.
Sœur Sofia disait qu’il était venu pour rétablir sa santé. Sœur Ripsimie assurait qu’il était marchand d’essence de roses 50. Sœur Niphidore affirmait qu’il allait être nommé instituteur. Sœur Solomona et sœur Parachkéva, rejetant toutes les versions, affirmaient qu’il était venu demander une jeune fille en mariage ; elles savaient même laquelle...
Enfin, sœur Apraxie jurait que c’était un prince russe travesti, venu pour examiner l’ancienne forteresse, et qui allait offrir des présents à leur chapelle. Mais on ne croyait pas beaucoup ce que disait sœur Apraxie car, sans relations avec les familles en vue de la ville, elle s’approvisionnait de nouvelles auprès de la compagne de Petko Basouniak et des belles filles de Fatcho l’Animal. Et puis, surtout, elle était dure d’oreille.
Sœur Rovoama écoutait tous ces bavardages et riait sous cape. Elle en savait long, disposant même de deux versions, mais elle voulait tourmenter un peu les sœurs. C’est vers le soir qu’enfin l’oracle parla... Le lendemain, le couvent tout entier savait que cet inconnu, cet Ognianov, n’était qu’un espion turc...
Le fait qu’Ognianov n’avait pas encore honoré hadji Rovoama de sa visite – ce qu’elle considérait comme un outrage flagrant à sa dignité – était peut-être l’unique raison qui avait poussé celle-ci à répandre cette rumeur hostile. Ognianov s’était fait là une ennemie dangereuse.
C’était dimanche. L’office touchait à sa fin et l’église du couvent regorgeait de femmes ; elles s’entassaient dans la cour, le long des fenêtres, sous le poirier touffu. Une partie de ces fidèles aux costumes bigarrés étaient de pimpantes jeunes femmes, parées comme des poupées ; elles bavardaient joyeusement et regardaient la porte pour examiner la parure des nouvelles représentantes du beau sexe qui arrivaient sans cesse. Il y avait là aussi les sœurs du couvent, des jeunes pour la plupart, qui, tout comme les autres, chuchotaient entre elles et souvent riaient de bon cœur. De temps à autre elles se précipitaient par volées sous l’arbre pour y ramasser, en jouant des coudes, une poire mûre et dorée qui venait de tomber. Puis, la figure empourprée, elles revenaient sur leurs pas en se signant avec piété.
L’office prit fin. Un flot de fidèles sortit de l’église, se dispersa et fut englouti par les cellules.
La petite cellule douillette, et assez richement meublée, de hadji Rovoama pouvait à peine contenir les hôtes. Un sourire aux lèvres, la nonne les recevait et les reconduisait. Rada, dans une jupe noire neuve, avec une coiffe de même couleur, servait la confiture et le café sur un plateau rouge.
Au bout d’une heure les allées et venues diminuèrent. Hadji Rovoama jetait de temps en temps un coup d’œil avide par la fenêtre, comme si elle attendait des visiteurs de marque. De nouveaux hôtes entrèrent en effet et, parmi eux, Alafranga, Steftchov, le pope Stavri, Netcho Pironkov et un petit instituteur. Alors la figure de sœur Rovoama s’éclaira : c’étaient eux, sans nul doute, qu’elle avait attendus. Elle serra les mains qui se tendaient vers elle et vers Rada. Mais le clignement d’œil et la poignée de main significative de Steftchov mirent subitement la jeune fille en colère ; elle devint rouge comme une pivoine.
– Kiriak, dit sœur Rovoama, je vais te demander encore une fois comment s’est passée cette affaire du docteur. Sais-tu qu’on en glose ?
–Et que dit-on ?
– On dit que tu as présenté exprès les journaux comme révolutionnaires pour perdre le docteur.
Steftchov s’emporta :
– Qui dit cela ? C’est un âne ! C’est un lâche ! Le numéro 30 de l’Indépendance et une véritable proclamation se trouvaient dans la poche du pardessus. Voilà, demandez donc aussi à baï Netcho.
Netcho confirma les faits avec empressement.
– Quel besoin de le demander à Netcho ? Qu’est-ce qu’il en sait, lui ? s’écria le père Stavri. Nous autres, on sait mieux de quoi il retourne. Qui ne sait que, partout où il va, le docteur porte sa corde avec lui ? C’est ce que je disais avant-hier à Séliamsas, chez qui j’étais allé déguster sa nouvelle eau-de-vie : il s’y connaît ! L’anis est à point ! Et toi, ma sœur, ça va bien ?
– Comme tu le vois, mon père, je me fais jeune avec les jeunes, répondit sœur Rovoama. Et, s’adressant de nouveau à Steftchov : – Je vois que tu ne sais pas qui a changé les papiers.
– La police le découvrira.
– Votre police ne vaut rien... Veux-tu que je te le dise ?
Et elle lui souffla un nom à l’oreille. Mais le secret fut dit si haut que tous l’entendirent. Netcho jeta son chapelet en l’air en riant, le visage tourné vers le plafond ; le jeune instituteur échangea des regards significatifs avec un des assistants, et le père Stavri marmotta :
– Dieu nous garde des tentations impies !
Rada, pudique, s’était réfugiée dans le cellier.
– Regardez-le donc ! Mais regardez-le donc ! s’écria Steftchov, montrant Sokolov qui traversait la cour, accompagné de deux personnes. L’une était Vikenti, l’autre Kralitch, vêtu d’un costume neuf de bure grise, coupé à l’européenne.
Tous se précipitèrent à la fenêtre. C’est ce qui donna à sœur Rovoama le prétexte attendu pour divulguer sa deuxième découverte :
– Le connaissez-vous, celui-là ?
– L’étranger ? C’est un nommé Boïtcho Ognianov, répondit Steftchov. Lui aussi, paraît-il, trempe dans les conspirations.
Hadji Rovoama fit de la tête un signe de dénégation.
– Pas vrai ? demanda Steftchov.
– Non, ce n’est pas ça... Parions !...
– C’est un agitateur.
– Non, c’est un espion ! dit sœur Rovoama, martelant ses mots.
Steftchov la regarda, bouche bée.
– C’est un secret de polichinelle, et tu n’en sais encore rien !
– Anathème ! proféra le père Stavri.
Sœur Rovoama, intriguée, épiait méchamment l’endroit où les trois personnes allaient entrer.
– Ils sont entrés chez sœur Christine, s’écria-t-elle.
Sœur Christine avait mauvaise réputation. Elle passait pour une patriote et s’intéressait aux affaires des comités révolutionnaires. Le diacre Levski avait autrefois passé une nuit chez elle.
– Les diacres l’aiment bien, cette Christine, ajouta sœur Rovoama, en souriant malicieusement. Savez-vous que Vikenti veut jeter le froc ? Et il fera bien, le pauvre garçon ! Il a reçu la tonsure trop jeune.
– Il a bien fait. Il faut être jeune aussi bien pour se marier que pour prendre l’habit, répliqua le père Stavri.
– Mon père, il me semble qu’il prendra le premier parti.
– Dieu nous en garde !
– Il va demander en mariage la fille d’Orliank ; dès qu’elle l’aurait accepté, il jetterait son froc aux orties et irait se marier en Roumanie..., mais je crois qu’il en sera pour ses frais.
Et sœur Rovoama jeta un regard protecteur au petit instituteur à qui elle destinait cette jeune fille. Le jeune homme, confus, rougit. De nouveaux visiteurs apparurent.
– Ah ! voilà mon frère qui vient ! s’écria sœur Rovoama, et elle se précipita à la rencontre du tchorbadji Iordan Diamandiev.
Les hôtes se levèrent et sortirent derrière elle. Steftchov resta un moment en arrière puis, en prenant congé de Rada, appliqua effrontément un baiser sur sa joue rose. Rada lui allongea un soufflet en s’échappant.
– Vous n’avez pas honte ! balbutia-t-elle, la voix étouffée et les yeux pleins de larmes, et elle s’enfuit dans le cellier.
Steftchov, aussi impudent envers les femmes qu’il était bouffi d’orgueil à l’égard des hommes, arrangea son fez qu’avait déplacé la gifle de Rada et sortit, la rage au cœur et la menace à la bouche.
11 LES ÉMOTIONS DE RADA
Rada Gospojina 51 était une grande jeune fille, svelte et jolie, au regard ingénu, au visage plein de bonté et au teint pur dont sa coiffe noire accentuait encore la blancheur.
Orpheline dès l’enfance, elle vivait depuis de nombreuses années chez hadji Rovoama qui l’avait adoptée. Plus tard sa protectrice la fit admettre comme novice au couvent où elle prit le vêtement noir de rigueur. Pour le moment, Rada était institutrice, aux modeste appointements de mille groches par an, à l’école de jeunes filles : elle enseignait aux enfants de la première classe primaire.
Le sort des orphelines est dur. Privées dès leur plus tendre enfance de l’amour et de la protection de leur père et des soins maternels, laissées à la merci de la pitié, et aussi de la dureté de cœur d’autrui, elles grandissent parmi les indifférents, sans que jamais un sourire vivifiant vienne les réchauffer. Ce sont des fleurs de jardin d’hiver, sans parfum, mais il suffit d’un rayon de lumière bienveillant pour qu’aussitôt leur charme capiteux s’épanouisse.
Rada avait grandi dans l’atmosphère étouffante des cellules, sous la surveillance sans tendresse d’une vieille intrigante : jamais il n’était venu à l’esprit de hadji Rovoama qu’un peu plus de douceur humaine pouvait nuancer sa conduite envers la pauvre orpheline ; et elle ne pouvait pas davantage sentir combien son despotisme devenait insupportable pour Rada à mesure que se développaient l’esprit et l’amour-propre de celle-ci.
Ceci nous explique pourquoi, bien que déjà institutrice, nous avons vu Rada il y a quelques jours, servir à la table du frère de hadji Rovoama. Les jours précédents, Rada avait été très absorbée par l’approche des examens de fin d’année. Le jour fixé pour ceux-ci ne tarda pas à arriver. Dès le matin les petites filles habillées, peignées et parées par leurs mères comme des papillons, commencèrent à remplir l’école. Répétant leurs leçons pour la dernière fois, elles bourdonnaient sur leurs livres comme un essaim d’abeilles.
À la sortie de la messe, le public, comme c’était la coutume, entra à l’école pour assister aux examens de fin d’année. Des couronnes de fleurs ornaient les portes, les fenêtres et les chaires. L’image des saints Cyrille et Méthode 52 regardait à travers un magnifique cadre de roses et de fleurs fraîches, de rameaux de sapin et de buis. Bientôt les premiers bancs furent occupés par les élèves, les autres par le public. Les notables occupaient les premières places ; certains même s’étaient assis sur des chaises. Parmi l’assistance on aurait pu trouver des personnes de notre connaissance. Des chaises étaient réservées aux notables retardataires.
Rada mettait timidement ses élèves en rang dans les bancs et leur donnait des conseils à voix basse. Son gentil visage, animé par l’émotion de ce moment solennel, et éclairé par le regard humide de ses grands yeux châtains, prenait un attrait charmant. Le rose qui errait sur ses joues trahissait le frémissement de son cœur timide. Se sentant l’objet d’une centaine de regards curieux, Rada perdait contenance. Quand l’institutrice principale commença son allocution, déviant ainsi vers elle l’attention du public, la jeune fille se sentit plus à l’aise, son âme se rasséréna et elle regarda autour d’elle avec plus d’assurance ; constatant avec joie l’absence de Kiriak Steftchov, elle reprit courage. L’allocution prit fin au milieu d’un silence solennel. (On n’avait pas encore pris l’habitude d’applaudir.) L’examen commença, selon le programme, par la première classe. Le visage bienveillant du directeur et sa douce parole inspiraient confiance aux petites filles. Rada suivait les réponses avec une attention tendue. Chaque hésitation des fillettes se reflétait douloureusement sur sa figure. Ces voix sonores et limpides, ces petites bouches roses, gentilles à croquer, allaient décider de son sort. Elle les enveloppait de son doux regard lumineux, elle les encourageait de son sourire céleste, elle mettait toute son âme sur leurs lèvres frémissantes.
À ce moment, l’encombrement de la porte livra passage à deux retardataires qui prirent place en silence sur deux chaises réservées. Rada leva la tête et les vit. L’un d’eux était le tchorbadji Mitcho, membre du comité scolaire, l’autre Kiriak Steftchov. Elle pâlit légèrement, mais s’efforça d’ignorer cette présence déplaisante qui la troublait et l’effrayait.
Kiriak Steftchov fit quelques signes de tête, sans toutefois saluer son voisin Sokolov qui, d’ailleurs, semblait ne pas le voir ; croisant les jambes et fronçant les sourcils, il se mit à regarder autour de lui avec arrogance. Il écoutait distraitement et, le plus souvent, regardait vers le groupe où se trouvait Lalka Iordanova. Une ou deux fois seulement, il toisa Rada des pieds à la tête d’un regard fur et dédaigneux. Son visage n’exprimait que sécheresse d’âme et dureté de cœur ; de temps en temps, il se mettait sous le nez un œillet qu’il tenait à la main, et puis regardait de nouveau autour de lui, l’air froid et hautain.
Le directeur Klimeinte, un livre à la main, s’adressa à Alafranga, lui proposant d’interroger les élèves, mais ce dernier déclina cet honneur, disant qu’il ferait passer l’examen de français. Le directeur se tourna alors à droite et fit la même proposition à Steftchov. Celui-ci accepta et avança sa chaise.
Un frémissement confus passa dans la salle. Tous les regards se dirigèrent vers lui. On en était à l’histoire des Bulgares, le cours abrégé. Steftchov mit le livre sur la table, se frotta la tempe, comme s’il voulait réveiller sa mémoire et posa une question à haute voix. La fillette ne répondit pas. Ce regard froid et malveillant la glaçait ; confuse, elle oublia même la question. Elle jeta à Rada des regards de détresse, implorant du secours. Steftchov répéta la question. La fillette se taisait toujours.
– Cela suffit, dit-il sèchement à l’institutrice. À la suivante !
Une autre élève sortit des rangs. Steftchov lui posa une question. Elle n’y comprit rien et resta muette. Le public, saisi de malaise, était également muet. La fillette restait clouée sur place, et des larmes qu’elle s’efforçait de refouler inondaient ses yeux. Elle essaya de répondre, bégaya quelque chose et se tut. Steftchov dirigea un regard glacé vers Rada et marmotta :
– Cet enseignement a été bien négligé. Appelez une autre élève !...
Rada prononça sourdement un autre nom.
La troisième élève répondit à rebours. Elle n’avait pas compris ce qu’on lui demandait. Lisant la désapprobation dans le regard de Steftchov, elle s’étonna et, désespérée, regarda autour d’elle. Steftchov lui posa une autre question. Cette fois l’enfant ne répondit rien. Le trouble voila son regard, ses lèvres pâles tremblèrent et, tout à coup, elle éclata en sanglots et courut se cacher près de sa mère. L’assistance tout entière ressentit plus lourdement encore le poids du malaise qui déjà pesait sur elle. Les mères dont les enfants n’étaient pas encore interrogées fixaient devant elles des regards perplexes et craintifs. Chacune tremblait à la pensée d’entendre le nom de sa fille.
Blême, Rada restait atterrée ; des frémissements douloureux parcouraient ses joues pâles ; sur son front, où tout à l’heure l’on pouvait deviner tant de sentiments délicats, perlaient de grosses gouttes de sueur qui mouillaient les mèches folles de sa chevelure. Elle n’osait pas lever les yeux. Elle aurait voulu rentrer sous terre. La poitrine oppressée, elle retenait à grand-peine ses larmes.
Le public, incapable de supporter davantage cette atmosphère tendue, remua avec inquiétude. Les spectateurs, échangeant des regards ahuris, semblaient se demander : « Qu’est-ce que tout cela veut dire ? » Chacun aurait voulu sortir de cette situation intenable. Seul, le visage de Steftchov reflétait le triomphe et la satisfaction. Le bruit et le vacarme s’enflaient. Mais soudain un grand silence se fit dans la salle, les regards s’orientèrent : Boïtcho Ognianov qui, jusqu’alors, était resté à l’écart, sortait du public et, s’adressant à Steftchov, lui dit d’un ton ferme :
– Monsieur, je n’ai pas l’honneur de vous connaître mais vous aurez la bonté de m’excuser. Vos questions, confuses et abstraites, auraient embarrassé même des élèves de cinquième. Ayez pitié de ces enfants sans expérience ! Puis, s’adressant à Rada, il demanda : Mademoiselle, permettez-vous ?
Et, restant debout, il pria qu’on appelât une des élèves déjà interrogées.
La salle se sentit allégée du poids qui l’oppressait. Une rumeur de sympathie et d’approbation accueillit la démarche d’Ognianov. En un clin d’œil, il fixa tous les regards, gagna toutes les sympathies. La calomnie montée par hadji Rovoama s’effondra. Son noble visage d’une pâleur de martyr, qu’éclairait un regard martial, gagnait irrésistiblement les cœurs. Les visages des spectateurs se rassérénèrent ; les poumons se dilatèrent. On se rendit compte qu’Ognianov dominait la situation et l’on en était content.
Boïtcho Ognianov répéta le plus simplement possible les questions de Steftchov. Cette fois l’élève répondit. Les mères respirèrent de soulagement et gratifièrent l’étranger de regards reconnaissants. Son nom, étrange et inconnu, faisait le tour de toute la salle et s’imprimait dans les cœurs.
On appela la seconde fillette. Elle aussi répondit de façon satisfaisante eu égard à son âge. Dès lors toutes ces enfants, terriblement effrayées tout à l’heure, fixèrent des regards de sympathie sur Ognianov. Remontées, elles se disputaient à qui sortirait la première du rang pour s’entretenir avec cet homme si aimable qu’elles aimaient déjà.
Rada ne revenait pas de cette nouvelle surprise ; éperdue, ahurie, émue jusqu’aux larmes, elle contemplait avec reconnaissance l’homme généreux qui s’était porté à son secours dans un moment aussi critique. C’était, et venant d’un inconnu, le premier sentiment cordial et fraternel qu’on lui témoignait. Était-ce donc là le mouchard que dénonçait sœur Rovoama ? Cet homme qui écrasait Steftchov comme un ver, était maintenant son ange gardien ! Rada triomphait ; elle redressa la tête, regarda autour d’elle, fière et heureuse, le cœur rempli de gratitude émue et les yeux envahis par les larmes, et elle rencontra de tous côtés des regards bienveillants.
À la troisième élève, Ognianov demanda :
– Raïna, dis-moi sous quel roi les Bulgares sont devenus chrétiens, se sont convertis au christianisme ?
Et il plongeait son regard amical chargé de douceur dans les yeux, humides encore des larmes versées, tournés innocemment vers lui.
La fillette réfléchit un moment, remua les lèvres et répandit d’une voix claire, sonore et filée, comme celle de l’alouette qui chante au vol le matin :
– C’est le roi bulgare Boris 53 qui fit baptiser les Bulgares.
– Très bien, bravo, Raïna... Dis-moi à présent qui inventa notre alphabet ?
Cette question embarrassa quelque peu la petite. Elle cligna des yeux pour trouver la réponse, ouvrit la bouche, sans souffler mot, hésitante, prête à perdre pied.
Ognianov vint à son aide :
– Notre A, B, C, Raïna, de qui nous vient-il ?
Le regard de l’enfant s’illumina. Raïna tendit son bras nu jusqu’au coude sans mot dire. Elle montrait du doigt l’image des saints Cyrille et Méthode, qui dardaient vers elle leurs regards affectueux.
– C’est ça ! C’est ça ! s’écrièrent plusieurs voix des premiers bancs.
– Bonne santé, Raïna ! Plaise aux saints Cyrille et Méthode que tu deviennes princesse ! égrena le pope Stavri.
– Bravo, Raïna, va-t’en à ta place, dit gentiment Ognianov.
Raïna, rayonnante, l’air vainqueur, courut auprès de sa mère qui la prit dans ses bras et la couvrit follement de baisers et de larmes.
Ognianov rendit le livre au directeur Klimeinte.
– Monsieur, interrogez aussi, je vous prie, ma fille Sebka, dit le tchorbadji Mitcho à Ognianov.
Une fillette blonde, à l’air éveillé, s’était déjà plantée devant lui et le regardait avec confiance. Ognianov réfléchit un moment et lui demanda :
– Sabka, dis-moi le nom du roi qui délivra les Bulgares du joug grec ?
– Les Bulgares furent délivrés du joug turc..., commença l’enfant...
Le tchorbadji Mitcho s’écria :
– Attends, Sabka ! Dis, ma fille, le nom du roi qui les a délivrés du joug grec, quant au joug turc, il y a bien un tsar qui les en délivrera...
– Ce qui est arrêté de par la volonté de Dieu arrivera toujours, dit le pope Stavri.
L’allusion naïve du tchorbadji Mitcho provoqua le sourire approbateur de plusieurs personnes. Un murmure mêlé à des éclats de rire se fit entendre dans la salle.
La voix de Sabka retentit comme une clochette :
– C’est le roi Assen 54 qui délivra les Bulgares du joug grec et le tsar Alexandre de Russie les délivrera du joug turc.
Elle avait mal compris les paroles de son père.
Un silence profond suivit la réponse de l’élève. La perplexité et l’inquiétude apparurent sur plusieurs visages. Tous les regards – les uns approbateurs, les autres désapprobateurs – se dirigèrent machinalement vers Rada qui rougit et baissa les yeux. Sa poitrine se souleva d’émotion. Le malaise plana de nouveau sur la salle. Steftchov, jusqu’à présent anéanti, releva la tête et, de nouveau, regarda triomphalement autour de lui. On connaissait ses étroites attaches avec le bey et les sentiments affectueux qu’il vouait aux Turcs, et l’on s’efforçait de lire sa pensée sur son visage. Le sentiment de sympathie éprouvé tout à l’heure pour Rada et Ognianov se refroidit, fit place à un certain mécontentement. Les partisans de Steftchov ricanaient et s’indignaient à haute voix, les autres se taisaient. Le pope Stavri était très embarrassé. Il eut peur de ce qu’il venait de dire et se mit à réciter mentalement son missel. Quant aux femmes, elles eurent moins d’hésitation à montrer de quel côté elles se rangeaient. Hadji Rovoama surtout, furieuse de l’affront infligé à Steftchov, jetait des regards farouches à Rada et à Ognianov et s’indignait à haute voix. Elle traita Ognianov d’insurgé, oubliant complètement qu’elle-même l’avait appelé espion turc quelques jours auparavant. Certains, pourtant, osaient proclamer leur sympathie pour Rada et Ognianov.
Guinka criait à qui voulait l’entendre :
– De quoi avez-vous l’air ! L’enfant n’a pas crucifié le bon Dieu ! Elle a dit la vérité. Moi aussi, je dis que c’est le tsar Alexandre et pas un autre qui nous apportera la liberté.
– Tu es folle ! Tais-toi ! soufflait sa mère.
Sabka restait interdite. Elle avait entendu tous les jours son père et ses invités raconter les choses qu’elle venait de dire et ne comprenait pas pourquoi on faisait tout ce bruit.
– Messieurs, on répand ici des idées révolutionnaires dirigées contre l’État de Sa Majesté le Sultan ; je ne peux plus rester et je me retire...
Netcho Pironkov avec encore trois ou quatre personnes suivirent Steftchov. Mais leur exemple ne fut pas suivi.
Le premier moment de frayeur passé, on comprit qu’il ne fallait pas prendre au sérieux cette affaire. Une enfant sans discernement avait prononcé quelques mots inopportuns mais vrais, et après ? Le silence se rétablit et simultanément le sentiment de sympathie pour Ognianov regagna le public qui lui lança des regards d’amitié. Ognianov était le héros du jour ; il avait pour lui tous les cœurs honnêtes et toutes les mères.
L’examen continua et finit sans autre incident.
Les élèves chantèrent un chœur et le public satisfait commença à s’en aller. Quand Ognianov aborda Rada pour prendre congé, celle-ci lui dit, émue :
– Monsieur Ognianov, je vous remercie de tout cœur pour moi et pour mes élèves. Je n’oublierai jamais le service que vous m’avez rendu.
Son regard brillait d’un attendrissement passionné.
– Mademoiselle, moi aussi j’ai été instituteur et j’ai compris votre position. Voilà tout. Je vous félicite des progrès de vos élèves, dit-il, en serrant sa main avec effusion.
Après le départ de Boïtcho, Rada ne sembla plus voir les personnes, qui venaient prendre congé d’elle.
12 BOÏTCHO OGNIANOV
Kralitch avait adopté ce nom de Boïtcho Ognianov sous lequel Vikenti, lors de leur rencontre près du cimetière de Karlovo, l’avait présenté à Sokolov. Son apparition dans la ville, qui avait très vite attiré l’attention de tout le monde, fut décidée au cours d’une délibération qu’il tint avec ses nouveaux amis, Vikenti, le Dr Sokolov et le supérieur du couvent. Au début, ils n’approuvaient pas son projet, mais Ognianov réussit facilement à vaincre leurs appréhensions. Il les assura qu’à Vidine, sa lointaine ville natale, où les habitants de Biala-Tcherkva, à l’exception de Marko Ivanov, ne se rendaient presque jamais, personne ne le connaissait, aussi ne courait-il aucun risque d’être reconnu. Du reste, pendant les huit ans qu’il avait passés au bagne d’Asie, les souffrances subies et l’effet du climat l’avaient fait beaucoup vieillir !
L’exil et ses peines, au lieu de refroidir en lui l’amour de la cause pour laquelle il avait souffert, le ramenaient en Bulgarie plus enthousiaste encore, audacieux jusqu’à la folie, épris de sa patrie jusqu’au fanatisme, et convaincu jusqu’au sacrifice. Il ne rentrait en Bulgarie que pour y travailler à la libération du pays. Un homme tel que lui, forçat en rupture de ban, vivant sous un faux nom, sans parents et sans liens sociaux, constamment exposé à être dénoncé et repris, menant sans avenir une vie sans lumière, ne pouvait être attiré en Bulgarie que par cette idée sublime ; elle seule pouvait l’y retenir après les deux meurtres... Comment allait-il se rendre utile ? Quel était le terrain ? Que pourrait-il faire ? Son but était-il accessible ? Il n’en savait rien. Il savait seulement qu’il allait à la rencontre de grandes difficultés, voire de graves dangers. D’ailleurs, ils ne tardèrent pas à l’assaillir et dès ses débuts.
Mais ces natures chevaleresques trouvent dans les obstacles et les périls l’élément même où leurs forces se retrempent. L’adversité les fortifie, la persécution les attire, le danger les encourage, car chaque lutte ennoblit et rend plus viril. La lutte du ver de terre, qui redresse la tête pour se défendre contre le pied qui l’écrase, est belle ; elle peut être héroïque quand l’homme combat pour sa conservation ; elle devient divine lorsqu’elle est menée dans l’intérêt de l’humanité.
Pendant les premiers jours, le bruit qu’avait fait courir sœur hadji Rovoama éloigna d’Ognianov les personnes avec qui ses amis voulaient lui faire faire connaissance. Sa noble intervention à l’examen, provoquée par la bassesse de Steftchov, arrêta du coup toute calomnie, elle lui ouvrit portes et cœurs. Ognianov devint un hôte que tous désiraient. Avec plaisir, il accepta le poste d’instituteur que Marko Ivanov et Mitcho Beïzédéto lui offrirent et qui donnait une raison plausible à son séjour dans la ville. Il avait pour collègues : Beltchev, le directeur Frangov, le suppléant Popov et le chantre et professeur de langue turque Merdévendjiev. Le premier était un séminariste russe, débonnaire, enthousiaste et d’esprit peu pratique. Quand les membres de la commission scolaire se rendaient chez lui, il leur récitait des vers de Khomiakov 55 et de Derjavine 56. Mais Marko Ivanov préférait qu’il leur parlât de la Russie et de Bonaparte. Popov, jeune homme d’un caractère turbulent, ami de Levski, rêvait, même éveillé, de comités révolutionnaires, de rébellion et de bandes d’insurgés. Il accueillit avec enthousiasme son nouveau collègue et s’attacha passionnément à lui... Merdévendjiev seul se rendait antipathique par sa vénération pour le psautier et son amour de la langue turque. La première de ces inclinations trahissait un esprit arriéré ; la seconde, l’admirateur de la cravache. Car, pour qu’un Bulgare pût aimer la langue turque, il lui eût fallu aimer les Turcs eux-mêmes, ou espérer d’eux des faveurs. Évidemment, c’est cette affinité de goûts qui le liait à Kiriak Steftchov.
Ognianov s’était engagé à professer aussi à l’école de jeunes filles, de sorte qu’il voyait Rada tous les jours et, chaque fois, il découvrait de nouveaux attraits dans l’âme de cette jeune fille. Un beau jour, il se réveilla épris d’elle. Faut-il dire que, de son côté, elle l’aimait déjà en secret ? Du jour où il avait si généreusement pris sa défense, elle avait été saisie par cet irrésistible sentiment de reconnaissance qui, chez la femme, se change vite en amour. Ce pauvre cœur, assoiffé de caresses et de sympathie, se prit pour Ognianov d’un amour ardent, pur et sans bornes. Rada avait fixé en lui l’idéal jusqu’alors diffus de ses rêves et de ses espérances ; ce sentiment vivifiant l’embellissait, elle s’épanouissait comme une rose de printemps. Il ne fallut pas un temps bien long ni beaucoup d’explications, pour que ces deux cœurs sincères et honnêtes arrivent à se comprendre. Tous les jours Ognianov quittait Rada un peu plus enchanté et un peu plus heureux que la veille ; cet amour l’épanouissait lui aussi, il embaumait son âme. L’un à côté de l’autre, le sapin gigantesque qui attendait les tempêtes orageuses et la tendre fleur avide de soleil et de rosée croissaient sur le même sol, mais deux soleils différents les éclairaient.
Souvent des pensées accablantes tombaient sur Ognianov comme une chape de plomb. Que deviendrait cet être innocent qu’il attachait à un sort incertain ? Où la conduirait-il ? Où allaient-ils tous les deux ? Lui, le combattant, l’homme qui courait les hasards et les dangers, il entraînait sur son terrible chemin cette enfant aimante qui commençait à peine à vivre sous les rayons bienfaisants de l’amour. Rada désirait, attendait de lui, un avenir heureux et lumineux, des jours joyeux et sereins sous le nouveau ciel qu’elle s’était créé. Pourquoi cette jeune fille devait-elle endurer les coups que le destin avait réservés pour lui seul ? Non, il devait lui avouer tout, déchirer le voile de son aveuglement, lui dire à quel homme elle s’attachait.
Ces pensées pesaient trop sur son cœur honnête, il décida de se soulager par un aveu, par une noble confession. Il se dirigea vers la demeure de Rada.
Depuis quelque temps, elle avait quitté le couvent et habitait, dans le bâtiment de l’école, une pièce meublée on ne peut plus modestement. Le seul ornement qu’on pouvait y voir était Rada elle-même.
Ognianov poussa la porte et entra.
Rada le reçut avec un sourire, mais son visage gardait des traces de larmes.
– Tu as pleuré, Rada ? Pourquoi ces larmes, ma chérie ? Et de son bras il entoura tendrement la tête de la jeune fille, en caressant ses joues incarnates.
Rada s’écarta de lui en essuyant ses larmes.
– Pourquoi ? demanda Ognianov, déconcerté.
– Sœur hadji Rovoama était ici tout à l’heure, répondit Rada, d’une voix entrecoupée.
– Elle t’a offensée, cette religieuse ? Elle essaie de te tyranniser ? Tiens, mes poèmes par terre, on dirait que quelqu’un les a foulés aux pieds !... Explique-moi, Rada.
– Vols-tu, Boïtcho, sœur hadji Rovoama les a trouvés sur la table et les a piétinés. « Poèmes révolutionnaires ! » s’est-elle écriée, et elle a vociféré quantité de choses cruelles sur toi... Comment veux-tu que je ne pleure pas ?
Ognianov prit un air sérieux :
– Qu’a-t-elle pu dire sur moi ?
– Mais tout ; elle t’a traité de rebelle, de brigand, d’assassin !...
– Mon Dieu ! cette femme est impitoyable !
Pensif, Ognianov regarda Rada et reprit :
– Écoute, Rada, nous ne nous connaissons pas encore ou, plutôt, tu ne me connais pas. C’est ma faute. M’aimerais-tu si j’étais vraiment tel que l’on me dépeint ?
– Non, Boïtcho. Je te connais bien, tu as l’âme noble, et c’est pourquoi je t’aime.
Et elle lui sauta au cou, le regardant de l’air câlin d’une enfant. Ognianov, touché par cette naïve confiance, sourit amèrement.
– Tu me connais aussi, n’est-ce pas ? Autrement nous ne nous serions pas aimés, chuchota Rada, le fixant de ses yeux ardents.
Ognianov les baisa tendrement.
– Ma petite Rada, mon enfant, dit-il, pour que je sois une âme noble, comme tu viens de le dire, je dois te révéler des choses que tu ne connais pas. Mon amour voudrait m’empêcher de te faire du chagrin, mais ma conscience exige le contraire. Tu dois connaître l’homme auquel tu te lies. Je n’ai pas le droit de me taire plus longtemps...
– Tu peux tout me dire, tu seras toujours le même pour moi, dit Rada.
Ognianov la fit asseoir et s’installa près d’elle.
– Ma chère Rada, hadji Rovoama dit que je suis un révolutionnaire : elle n’en sait rien, elle baptise ainsi tout jeune homme honnête.
– Mais oui, Boïtcho, c’est une très méchante femme se hâta de dire Rada.
– Mais je suis vraiment un révolutionnaire, Rada.
Rada le regarda, surprise.
– Oui, Rada, révolutionnaire et pas seulement en paroles, je prépare l’insurrection.
Il se tut, et Rada demeura silencieuse.
– Nous nous préparons pour le printemps prochain, reprit-il. C’est pour cela que je suis venu dans cette ville.
Rada se taisait toujours.
– Voilà mon avenir, il est plein d’incertitude et de dangers...
Elle le regardait, stupéfaite et sans voix. Ce silence prolongé paraissait au jeune homme pénible comme une sentence. Il avait l’impression que chacune de ses paroles ébranlait les sentiments de Rada. Faisant effort sur lui-même, il poursuivit sa confession :
– Cela, c’est mon avenir ; à présent je vais te dire mon passé.
Le regard de Rada se fit plus inquiet.
– Mon passé est plus sombre encore, sinon plus orageux. Sache que j’ai été pendant huit ans déporté en Asie pour des raisons politiques... et que je me suis évadé de Diarbékir, Rada !
Celle-ci ne bronchait pas.
– Dis-moi, Rada, la religieuse t’a-t-elle parlé de cela aussi ?
– Je ne sais rien, répondit sèchement Rada.
Ognianov resta un moment pensif et sombre ; puis il continua :
– Elle m’a appelé aussi assassin. De cela aussi elle ne sait rien, Rada ; il y a quelque temps elle m’appelait espion !... Mais écoute...
Cette fois Rada, pressentant quelque chose d’effroyable, pâlit.
– Écoute : j’ai tué, il n’y a pas longtemps, deux hommes.
Rada recula involontairement.
Ognianov n’osait plus la regarder. Il parlait tourné vers le mur ; il lui semblait que son cœur, tenaillé, allait se déchirer.
– Oui, j’ai tué deux Turcs, moi qui n’avais jamais fait de mal à une mouche... Il fallait que je les tue cal ils allaient violer une jeune fille devant moi et devant son père qu’ils avaient ligoté. Oui, je suis un assassin menacé par le bagne de Diarbékir ou par la corde.
– Oh, parle ! parle ! dit-elle, réunissant ses forces.
– J’ai tout dit. Maintenant tu sais tout de moi, ajouta Ognianov, d’une voix tremblante.
Il attendait la terrible sentence qu’il croyait lire sur son visage. Mais Rada se jeta à son cou.
– Tu es à moi, tu es l’homme le plus noble qui soit, s’écria-t-elle. Tu es mon héros, mon beau chevalier.
Et tous deux, soulevés par un élan passionné, se jetèrent dans les bras l’un de l’autre, en sanglotant d’amour et de bonheur.
13 LA BROCHURE
Des pas lourds retentirent dans l’escalier. L’allure de l’homme qui montait était si violente et si rapide qu’il ébranlait toute la bâtisse de bois. Les deux amoureux desserrèrent leur douce étreinte. Boïtcho prêta l’oreille :
– Cet ouragan-là ne peut être que le docteur.
Rada s’approcha de la fenêtre et appuya son front brûlant contre la vitre pour dissimuler son émotion.
Le docteur arriva et, comme toujours, en trombe.
– Lisez ! dit-il en tendant une brochure à Ognianov. C’est du feu, mon vieux, du feu !... Il y a de quoi devenir fou !... Je voudrais baiser la gentille petite main qui a écrit cela !
Ognianov ouvrit la brochure, publiée par les soins des émigrés bulgares en Roumanie. Comme la plupart des écrits de ce genre, celui-ci était médiocre, d’une rhétorique fade mal relevée par des phrases patriotiques usées, des exclamations exaspérées et des invectives contre les Turcs. Mais justement elle enthousiasmait l’âme des Bulgares, avides de paroles neuves. L’état pitoyable de ses feuilles maculées, presque usées par les doigts des lecteurs, prouvait que la brochure avait passé par des centaines de mains et que sa flamme patriotique avait nourri des milliers d’âmes.
Sokolov était enivré par sa lecture. Ognianov lui-même, dont le goût était un peu mieux formé, subissait le charme et ne pouvait arracher ses yeux de la plaquette.
– Attends, attends, je vais te la lire moi-même ! s’écria le docteur.
Il commença, en effet, à lire à haute voix et bientôt s’enflamma tout à fait ; sa main gauche fendait l’air tandis que, du pied, il ponctuait les phrases fulminantes. En même temps, il lançait des regards fulgurants à Boïtcho et à Rada dont les âmes, se détachant des émotions délicieuses de l’instant précédent, se laissèrent gagner par l’enthousiasme guerrier de Sokolov dont la voix parcourant l’octave, résonnait dans la pièce et même à travers toute l’école. Déjà il avait lu la plus grande partie de la brochure et arrivait au long poème qui la terminait. Haletant, inondé de sueur, il s’arrêta et dit à Ognianov :
– C’est du feu, mon vieux, du feu... Tiens, lis-moi ça ! Moi, je n’en peux plus... Non, pas toi, tu lis les vers comme le pope Stavri son Pater. Tu vas gâter le poème. Lis, toi, Rada !...
– Prends, Rada, tu lis très bien ! dit Ognianov.
Rada se mit à lire.
Comme la prose, la poésie péchait par trop de grandiloquence, par des exclamations oiseuses, par un manque de talent trop évident. Mais Rada sut y faire passer le souffle de son âme : sa voix frémissante donnait à chaque vers un surplus de vigueur et de vie.
Le docteur dévorait chaque mot, frappant le plancher en cadence. Au moment le plus pathétique, quelqu’un poussa la porte sans frapper. La sacristine apparut :
– M’appelez-vous ? demanda-t-elle.
Sokolov lui jeta un regard furieux, la poussa violemment dehors et donna un coup de pied à la porte qu’il verrouilla derrière la bonne femme. La pauvre vieille descendit toute confuse vers son rez-de-chaussée et imposa silence aux enfants du sacristain : « L’institutrice, leur dit-elle, donne des leçons à l’instituteur et au docteur. »
– Qui diable vient de nouveau ? fulmina le docteur. Je vais le jeter par la fenêtre.
Une petite fille entra, tenant une lettre à la main.
– Pour qui ça ? lui demanda-t-il sur un ton sévère.
La fillette s’approcha de Rada et lui remit la missive.
Rada examina l’adresse ; l’écriture lui était inconnue. Un peu surprise, elle ouvrit la lettre et se mit à la lire.
Boïtcho, debout devant elle, la regardait, étonné lui aussi. Une rougeur monta au visage de Rada, puis un sourire y apparut.
– Qu’y a-t-il ? demanda Boïtcho.
– Tiens, lis !
Boïtcho prit la lettre. C’était une lettre d’amour de Merdévendjiev.
Boïtcho éclata de rire :
– Ah, ce Merdévendjiev ! Le voilà mon rival, et un rival redoutable ! Je me demande comment cette tête fêlée a pu fabriquer cette lettre. Il a dû pêcher dans un manuel d’art épistolaire.
Rada déchira la lettre en riant.
– Pourquoi la déchirer ? Réponds-lui, dit Sokolov.
– Comment lui répondre ?
– Écris-lui : « Ô rossignol à la voix enchanteresse ! ô canard au gosier musical ! ô huppe au cœur tendre ! j’ai eu l’insigne honneur, aujourd’hui, à six heures... », poursuivit Sokolov en regardant la pendule. Puis s’adressant à Ognianov : – Vois-tu à présent que cet imbécile est aussi un lâche ?... Reconnais-tu le sale petit intrigant, le mouchard ? Écoute, quand tu iras aujourd’hui à l’école, crache-lui à la figure ! À ta place même, je le giflerais.
– Laisse cet imbécile en paix !
– Pas du tout, il ne suffit pas de détester les lâches, il faut les punir... Laisse-moi faire ! dit le docteur d’un ton menaçant.
– Qu’importe ! Qui touche à la poix s’y empêtre !
– Un moment ! s’écria le docteur et il se prit le front entre les mains comme s’il voulait retenir une idée qui lui était venue.
– Quoi ?
– J’ai une idée ! et il éclata de rire.
Ognianov le regardait sans comprendre.
– Rien !... adieu. Demain, n’oublie pas, on se réunit sur le chemin de Silistra
– De nouveau ! Voilà qui devient sardanapalesque !
– À demain !...
Et le docteur sortit vivement. Rentré chez lui, il se mit à écrire à Merdévendjiev en imitant une écriture de femme :
« Merci. Au lieu de vous écrire, je préfère vous attendre dans le jardin de la mère Iakimtchina. Je laisserai la petite porte ouverte. Bien à vous. 28 septembre 1875. »
Le chantre fut exact au rendez-vous. Mais au lieu d’y trouver Rada, il fut accueilli par le terrible grondement de Cléopâtre, que Sokolov tenait en laisse dans un coin sombre du jardin, voisin de sa demeure.
14 LE CHEMIN DE SILISTRA
On appelait ainsi une belle prairie qui s’étendait dans le vallon du monastère, baignée par la rivière, entourée de saules touffus, de grands ormes et de noyers. Dans l’automne déjà avancé, ce coin charmant gardait intactes sa verdure et sa fraîcheur, comme une île de Calypso au perpétuel printemps. De cette heureuse prairie, on entrevoyait, à travers les branches épaisses, deux cimes du Balkan : Krivini et Ostro-Barko, séparées par une gorge aux versants raides et aux rochers à pic, au fond de laquelle chantait la rivière. Le souffle frais de la montagne berçait doucement les feuillages, apportant l’odeur des bois et le bruit sourd des cascades. Au-delà de la rivière commençaient à s’élever des éboulis de pierres blanchâtres, ébréchées par le ruissellement. Le soleil presque au zénith faisait tomber sur le gazon, à travers le feuillage, une pluie de rayons scintillants Une fraîcheur délicieuse et une paix parfaite régnaient.
Ce coin si poétique portait pourtant un nom prosaïque et d’ailleurs impropre car, en réalité, nul chemin, et le chemin de Silistra moins que tout autre, ne passait par cette prairie isolée, nichée au pied du Balkan, inaccessible en cet endroit. Elle devait ce nom à des raisons plus historiques que géographiques. Son isolement, son charme et sa fraîcheur l’avaient fait, depuis quelques années, choisir pour théâtre de festins et de réjouissances, voire de quelques orgies. Ainsi, dans cette Capoue de Biala-Tcherkva, maints commerçants s’étaient ruinés. Ils avaient été ensuite obligés d’aller refaire fortune aux environs de Silistra où tout était arriéré, mais où l’abondance régnait et qui offraient donc un terrain très propice aux affaires. La réussite dans cette terre promise, des premiers Jasons de Biala-Tcherkva, avait attiré à eux d’autres frères déchus et Silistra comme ses alentours comptaient alors, grâce à cela, parmi leurs habitants, de nombreux émigrés de Biala-Tcherkva. Ils y jouaient le rôle de pionniers de la civilisation : entre autres ils donnèrent une dizaine de prêtres et vingt-deux instituteurs. Pour les habitants de Biala-Tcherkva, la fameuse prairie était bien le vrai « chemin de Silistra ».
Sa fatale renommée ne ternissait pas la gloire du chemin de Silistra et il attirait toujours les amateurs de festins et de réjouissances ; or ils étaient nombreux. Car le joug qui pèse sur les peuples, s’il a de mauvais côtés, possède au moins un privilège remarquable : il rend ces peuples gais. Une société à laquelle est interdite tout activité politique et spirituelle, où rien ne peut exciter l’appétit du gain, où les grandes ambitions ne peuvent entrer en compétition, cette société, qui dépense ses forces à des cancans mesquins ou à de menues intrigues locales, trouve son plaisir dans les jouissances les plus faciles de la vie. Une baklitsa 57 de vin vidée à l’ombre fraîche des saules au bord d’un ruisseau turbulent et limpide fait oublier le servage ; un guvetch 58 fait de persil odorant, de poivrons succulents et de tomates vermeilles, mangé sur l’herbe, sous les branches à travers lesquelles transparaît le haut ciel bleu, remplace fort bien la souveraineté politique et, si des violons s’y ajoutent, on atteint au comble du bonheur humain. Les peuples asservis ont leur philosophie à eux, qui les réconcilie avec la vie. Un homme ruiné finit souvent par se faire sauter la cervelle ou se passer une corde au cou. Un peuple esclave, même sans espoir, ne se suicide jamais ; il mange, boit et fait des enfants. Il s’amuse. Prenez la poésie populaire, où se reflètent si bien l’âme, la vie et les conceptions du peuple. Là, aux souffrances subies, aux lourdes chaînes portées, aux sombres prisons, aux plaies horribles, se mêlent des agneaux gras cuits à la broche, des vins rouges pétillants, de la bonne eau-de-vie, des noces plantureuses, des rondes endiablées, des forêts vertes et des ombres épaisses : les sources de chansons innombrables.
Quand Sokolov et Ognianov arrivèrent, la gaieté des convives faisait déjà retentir les échos du chemin de Silistra. Il y avait là, entre autres, Nikolaï Nedkovitch, jeune homme intelligent et instruit ; Kandov, étudiant d’une université russe, qui avait beaucoup lu, mais idéologue outré, séduit par les utopies du socialisme ; Fratiou ; le professeur Frangov, une tête chaude ; Popov, patriote exalté ; le pope Dimtcho, patriote et ivrogne, et Koltcho l’aveugle. Ce dernier, un jeune homme de petite taille privé complètement de la vue, et dont le visage était émacié par la souffrance, jouait de la flûte d’une façon remarquable, appréciée dans toute la Bulgarie ; conteur amusant, prompt à la bouffonnerie, il était indispensable à tous les festins.
Le repas était servi sur une nappe bariolée, étendue sur l’herbe. Deux seaux, l’un de vin rouge et l’autre de vin blanc, avaient été mis au frais dans le ruisseau qui longeait la prairie. Les tziganes tiraient l’archet de leurs rebecs et chantaient à plein gosier des airs turcs. Une clarinette et deux tambourins au cliquetis métallique complétaient cet orchestre assourdissant. Le repas était très gai. Les toasts se succédèrent, selon la coutume de l’époque, sans que personne se levât.
Ilytcho le Curieux fut le premier à lever son verre :
– À ta santé, belle compagnie ! Que Dieu exauce tous tes souhaits ! Que Dieu punisse ceux qui nous en veulent et que ceux qui nous haïssent rampent à plat ventre sur terre !
Les verres se vidèrent d’un trait.
– Je bois au chemin de Silistra et à ses adorateurs, proclama le pope Dimtcho.
Popov leva son verre :
– Mes frères, je bois au lion 59 du Balkan !
Les musiciens, qui avaient cessé de jouer, reprirent de plus belle et mirent fin aux toasts. Mais Fratiou, qui n’avait pas encore porté le sien, arrêta d’un signe les tziganes, se leva, regarda autour de lui et s’écria, d’un air extasié, le verre en main :
– Messieurs, je porte un toast à la Liberté bulgare, vivat !
Il prononça ces dernières paroles en français et vida son verre.
Les convives, n’ayant pas compris son discours, gardaient toujours leurs verres pleins : à le voir si exalté, ils s’attendaient à ce qu’il leur fît un discours. M. Fratiou s’étonna de n’avoir pas été applaudi et s’assit tout penaud.
– Que voulez-vous dire, monsieur ? demanda froidement Kandov qui lui faisait face.
Fratiou se renfrogna :
– Je crois avoir parlé assez clairement, monsieur. J’ai bu à la Liberté bulgare. (Il prononça ces dernières paroles à voix basse, en lançant un regard méfiant vers les tziganes.)
– Qu’entendez-vous par le mot liberté ? demanda de nouveau l’étudiant.
Sokolov intervint :
– Il me semble que tu aurais dû boire à l’esclavage bulgare ; la liberté bulgare n’existe pas.
– Elle n’existe pas, mais nous la gagnerons, mon ami.
– Comment ?
– En buvant ! plaisanta quelqu’un.
– Mais non ! En combattant ! répondit Fratiou ardemment.
– Fratiou, fais attention ! Il faut tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler, dit malicieusement Ilytcho le Curieux.
– Oui, par le glaive, messieurs ! cria Fratiou, enflammé, en montrant le poing.
– Alors, je bois à la gloire du glaive, le dieu des esclaves ! fit Ognianov en levant son verre.
Ces paroles excitèrent la compagnie.
– Agouche, cria quelqu’un, jouez : Le désir de Nicéphore le fier 60.
Cet air était alors la Marseillaise bulgare.
La musique retentit et tout le monde se mit à chanter en chœur. Lorsqu’on arriva au vers : « Massacrez, égorgez pour la liberté de la Patrie », l’excitation fut à son comble et l’on brandit couteaux et fourchettes.
M. Fratiou, armé d’un long couteau, fendait furieusement l’air. Dans un de ses gestes, il brisa une grande carafe de vin rouge que portait le garçon ; le liquide se répandit sur Fratiou et tacha son costume d’été.
– Quel âne ! cria Fratiou.
– Monsieur Fratiou, inutile de te fâcher ; du moment qu’il y a massacre, le sang doit couler, cela va sans dire.
Tout le monde parlait en même temps sans qu’on pût rien comprendre, car l’orchestre venait d’entamer une marche turque et les tambourins faisaient un bruit assourdissant.
Ognianov et Kandov s’étaient retirés sous un arbre et discutaient ardemment. Nikolaï Nedkovitch alla les rejoindre.
– Vous dites, poursuivait Kandov, qu’il faut entreprendre cette lutte car elle a pour but la liberté. La liberté ? Quelle est cette liberté : d’avoir de nouveau un prince, c’est-à-dire un petit sultan, des fonctionnaires qui nous volent, des moines et des prêtres qui s’engraissent à nos dépens et une armée qui suce la sève du peuple ! C’est ça votre liberté ? Pour elle, je ne verserai pas la moindre goutte de sang.
– Écoutez, monsieur Kandov, répondit Nedkovitch. Je respecte vos principes, mais ils n’ont rien à faire ici. Nous avons besoin avant tout d’une liberté politique, c’est-à-dire, nous voulons être maîtres de notre terre et de nos destinées.
Kandov hocha la tête :
– Mais vous venez de m’expliquer à l’instant une tout autre chose. Vous élevez de nouveaux seigneurs à la place des anciens. Puisque vous ne voulez pas du Cheikulislam 61, vous embrassez la cause d’un autre qui porte le titre d’exarque 62, c’est-à-dire que vous troquez les tyrans contre des despotes. Vous imposez au peuple des chefs et vous annihilez toute idée d’égalité. Vous consacrez le droit d’exploitation du faible par le fort, du travail par le capital. Donnez à votre lutte un but plus moderne, plus humanitaire ; faites-en une lutte non seulement contre le joug turc, mais aussi pour le triomphe des principes actuels, c’est-à-dire pour l’abolition de ces formes stupides consacrées par des préjugés séculaires : le trône, la religion, le droit de propriété et le droit du plus fort, que la bêtise humaine a érigés en principes inviolables. Messieurs, lisez Herzen, Bakounine, Lassalle... Débarrassez-vous de ce patriotisme étroit au point d’être animal, et levez l’étendard de la raison humaine contemporaine et de la science éclairée par la raison... Alors je suis avec vous...
– Les idées que vous avez exprimées, répliqua vivement Ognianov, sont celles d’un homme qui a beaucoup lu, mais elles en disent long sur votre ignorance de la question bulgare. Vous serez seul sous votre drapeau. Le peuple ne vous comprendra pas. Notez bien, monsieur Kandov, que nous ne pouvons lui proposer qu’un seul but possible et raisonnable : briser le joug turc. Nous n’avons, pour le moment, qu’un seul ennemi – les Turcs – et nous nous insurgeons contre eux. Quant aux principes dont vous voulez bien nous régaler, ils ne sont pas pour notre estomac ; le bon sens bulgare ne les accepte pas ; ils ne trouvent et ne trouveront jamais un terrain propice en Bulgarie. Vos principes grandiloquents, l’étendard de la raison humaine contemporaine et de la science éclairée par la raison, autant de mots sonores qui vous sont chers, ne font qu’estomper le but poursuivi. Il s’agit avant tout de défendre notre foyer, notre honneur et notre vie contre le premier zaptié venu. Avant de résoudre des questions propres à toute l’humanité ou, pour mieux dire, des théories nébuleuses, il nous faut nous débarrasser de nos chaînes... Ceux dont vous lisez les théories ne s’inquiètent pas de nous et ne soupçonnent même pas notre existence ni nos malheurs. Nous ne pouvons nous appuyer que sur le peuple, et les tchorbadjis, le clergé en font également partie : ils représentent une force que nous saurons utiliser. Supprimez le zaptié et le peuple atteindra son idéal. Si vous en avez un autre, ce n’est pas le sien.
Entre-temps, l’orchestre avait cessé de jouer, le bruit s’apaisait. L’aveugle se mit à jouer de sa flûte dont les sens mélodieux planaient dans l’air.
– Qu’avez-vous à philosopher là-bas ? Venez par ici ! criait-on aux trois interlocuteurs.
Mais, tout à leur conversation animée, ceux-ci ne répondirent pas.
L’aveugle joua quelques minutes au milieu d’un silence recueilli ; malgré l’ivresse ambiante, chacun jouissait de la suave mélodie.
– Savez-vous ce que je vois en ce moment ? dit l’aveugle.
– Tout le monde sourit.
– Devinez ! fit Koltcho.
– Qu’est-ce que tu nous donnes si nous devinons ?
– Je vous donnerai mon télescope astronomique.
– Où est-il maintenant ?
– Dans la lune.
– Eh bien ! tu vois les joues roses de Milka Todoritchkina, dit le pope Dimtcho.
– Ce n’est pas ça. Je préférerais les mordre que de les voir.
– Tu vois M. Fratiou, dit Popov, car celui-ci agitait à ce moment-là ses mains devant les yeux de l’aveugle.
– Pas du tout. Est-ce qu’on peut voir le vent ?
– Le soleil ?
– Non. Vous savez bien que je me suis brouillé avec lui. J’ai juré que je ne le verrais plus de ma vie.
– Tu vois la nuit, dit le docteur.
– Ce n’est pas cela non plus. Je vois un verre de vin qu’on m’offre. Vous m’avez oublié, sapristi !
Plusieurs verres de vin se tendirent vers l’aveugle.
– À la vôtre, fit Koltcho et il vida son verre.
– Et puisque vous n’avez pas deviné, qu’est-ce que je gagne, moi ?
– Le reste des verres remplis.
– Combien ?
– Sept.
– Moi, je pourrais en boire davantage, remarqua le pope Dimtcho.
– À la vôtre !
– Vivat !
– Vive la Bulgarie, vive la république du Balkan ! s’écria Fratiou.
Koltcho entama le cantique des religieuses. Là-dessus, on se leva pour rentrer en ville.
– Messieurs, n’oubliez pas demain la répétition à l’école ! s’écria Ognianov.
– Quelle pièce allez-vous jouer ? demanda Kandov.
– Geneviève.
– Pourquoi avez-vous choisi cette vieillerie ?
– Pour deux raisons : d’abord, elle n’a pas un caractère excitant – c’est le désir des tchorbadjis ; deuxièmement, tout le monde l’a lue et désire la voir sur la scène. Il fallait contenter tous les goûts. L’essentiel, n’est-ce pas, c’est de faire une bonne recette ? Car nous avons besoin de journaux et de livres pour la bibliothèque, ainsi que « d’autre chose ».
La bruyante compagnie se dirigea gaiement vers la ville. Bientôt elle disparut entre les jardins potagers sur lesquels tombait le crépuscule. Un quart d’heure après, elle entrait victorieusement dans les rues sombres en chantant à pleine gorge des chansons révolutionnaires. Le passage de ce cortège bruyant attroupait les femmes et les enfants devant les portes.
Seul Ognianov manquait. Dans la prairie une gamine lui avait soufflé quelques mots à l’oreille et il s’était éloigné, inaperçu.
15 UNE RENCONTRE INATTENDUE
Ognianov se dirigea vers le nord, du côté de la gorge du Balkan.
Le soleil s’était couché, calme et majestueux. Ses derniers rayons, après avoir doré la crête de la Vieille Montagne, s’évanouirent. Seuls, vers l’ouest, quelques petits nuages rutilants souriaient encore au soleil, de très haut. Le val entier était dans l’ombre. À l’ouest, les éboulis de pierres blanches disparaissaient dans le crépuscule qui, peu à peu, envahissait aussi les prairies du couvent, les rochers, les ormes et les poiriers, dont les contours s’estompaient. Pas un chant d’oiseau, pas un gazouillement La gent ailée qui, pendant le jour, égayait le val, restait muette, nichée dans les branches ou dans les tuiles des murs du couvent. Avec l’obscurité s’installait le silence mélancolique et enchanteur de la nuit. Seul le fracas des cascades rompait le silence. De temps à autre, la brise apportait le tintement lointain des clochettes de troupeaux attardés qui rentraient. Bientôt la lune apparut qui acheva l’enchantement. Une clarté argentée baignait la prairie et les arbres qui projetaient des ombres fantastiques. L’éboulis de pierres blanches se dessina plus net, telle une muraille de ruines antiques, et la coupole neuve de l’église se détacha en blanc au-dessus des toits et des peupliers du couvent ; derrière elle, les cimes du Balkan s’élevaient, vers le ciel où elles se perdaient dans l’azur devenu couleur de plomb.
Ognianov passa derrière le couvent et pénétra dans le val désert. Après quelques minutes de chemin par le terrain pierreux, il s’approcha d’un moulin. Devant la porte, l’oncle Stoïan l’accueillit.
– Qu’y a-t-il ? demanda vivement Ognianov.
– Un ami est arrivé.
– Quel ami ?
– Un des nôtres, pardi !
– Un des nôtres ?
– Un patriote, tu comprends ?
– Qui est-ce ?
– Je ne le connais pas. Il est descendu ce soir du Balkan et il est venu droit chez moi. Je l’ai pris tout d’abord pour un brigand et j’ai eu peur. Si tu voyais sa tenue !... Il a des jambes comme des flûtes. Il s’est trouvé que c’est un des nôtres. Je lui ai donné à manger.
– Eh bien, conduis-moi près de lui !
– Je l’ai mis dans une cachette, suis-moi !
Et l’oncle Stoïan fit entrer Ognianov dans le moulin. À l’intérieur il faisait sombre. Le meunier alluma une lampe et fit passer Boïtcho entre le mur et les meules puis entre deux greniers ; ils s’arrêtèrent devant une petite porte où pendaient des toiles d’araignée récemment déchirées, ce qui témoignait qu’elle était restée longtemps fermée.
– Comment, il est enfermé dedans ?
– Que veux-tu ? Lait bien couvert, les chats ne le mangent pas !
L’oncle Stoïan frappa à la porte et cria :
– Monsieur, sortez, s’il vous plaît !
La porte s’ouvrit et livra passage à un jeune homme blond, de petite taille, au visage aminci, à la barbe négligée, au regard vif et aux mouvements légers. L’uniforme blanc des insurgés moulait son corps décharné. Garni des brandebourgs traditionnels au dos, à la poitrine et aux genoux, tout en loques, l’habillement laissait voir la chair meurtrie du vagabond.
Au premier coup d’œil lui et Ognianov poussèrent des cris de surprise.
– Mouratliiski !
– Kralitch !
Ils se serrèrent les mains et s’embrassèrent.
– C’est toi ? D’où viens-tu ? demandait Ognianov qui avait reconnu en Mouratliiski un camarade de son bataillon d’insurgés.
– Oui, c’est moi ! Et toi, où étais-tu et comment est-ce possible que je te revoie ici ? Est-ce vraiment toi, Kralitch ?
Ce dernier se retourna brusquement en regardant autour de lui ; l’oncle Stoïan tenait toujours la lampe devant eux.
– Oncle Stoïan, éteins la lumière et ferme la porte... Mais non, nous serons mieux dehors. Ici on ne peut rien entendre à cause du bruit du moulin.
L’oncle Stoïan sortit le premier avec la bougie et ferma la porte derrière eux, en leur disant :
– Eh bien ! allez causer à votre aise ! Moi je vais me coucher. Quand le sommeil vous gagnera, revenez ici et débrouillez-vous pour dormir.
Dans le val, il faisait nuit. Un seul versant restait éclairé par la lune. Ognianov et son camarade cherchèrent le coin le plus obscur et s’installèrent enfin sur une grosse pierre au bord de la rivière qui murmurait doucement.
– Embrassons-nous encore une fois, mon frète, dit Ognianov tout ému.
– Dis-moi, Kralitch, qui diable t’amène ici ? Je te savais au paradis de Diarbékir !
– Et toi, Dobri, on ne t’a pas encore passé la corde au cou ? dit en riant Boïtcho.
Ils retrouvaient leur ton familier... Un destin et des souffrances semblables rapprochent les êtres les plus étrangers l’un à l’autre, or, Boïtcho et Mouratliiski étaient déjà frères d’armes et animés par le même idéal.
– Eh bien ! parle maintenant ! dit Mouratliiski. Tu viens de plus loin, donc tu as la priorité. Depuis quand es-tu de retour de Diarbékir ?
– Tu veux dire depuis quand je me suis évadé ?
– Comment, tu t’es évadé ?
– Oui, au mois de mai !
– Et tu as réussi à arriver ici sans encombre ? Par où es-tu passé ?
– J’ai marché à pied jusqu’à l’Arménie russe et, de là, par le Caucase jusqu’en Russie, à Odessa, toujours aidé par les Russes ; d’Odessa, en bateau jusqu’à Varna et, de là, à travers les montagnes, jusqu’aux chaumières voisines de Troyan. Puis, par le Balkan, à Biala-Tcherkva.
– Et pourquoi as-tu choisi cette ville ?
– J’avais peur d’aller où je ne connaissais personne. Là où je connaissais des gens, je ne savais ce qu’ils étaient devenus et je ne voulais pas les déranger. Mais je me suis rappelé qu’à Biala-Tcherkva habitait le meilleur ami de mon père, un homme digne de confiance, et j’étais sûr qu’ici, personne ne me reconnaîtrait. Lui-même ne m’aurait pas reconnu si je ne lui avais pas dit qui j’étais.
– Et moi qui t’ai reconnu tout de suite ! Tu restes ici ?
– Oui, grâce à cet ami de mon père, j’ai été nommé instituteur. Dieu merci, jusqu’à présent tout va bien.
– Alors tu es instituteur pour de bon, Kralitch ?
– Officiellement, oui, secrètement je fais mon ancien métier.
– L’apostolat ?
– Oui, la révolution...
– Et comment cela va-t-il chez vous ? Quant à nous autres, nous avons gâté l’affaire.
– Pour le moment tout va bien. Les esprits sont fortement agités, le terrain est volcanique : Biala-Tcherkva a été un des foyers de Vassil Levski.
– Et quel est votre plan ?
– Nous n’en avons pas. Nous nous préparons théoriquement, pour ainsi dire, en vue de l’insurrection, et nous attendons que le temps vienne et nous montre la voie à suivre. Entre-temps, l’effervescence augmente d’un jour à l’autre, en ville et aux alentours : tôt ou tard, nous aurons l’insurrection....
– Bravo ! superbe ! Tu es brave, Kralitch !
– À toi de raconter maintenant tes aventures, dit Ognianov.
– Tu connais l’affaire. À Stara-Zagora 63 nous avons lamentablement échoué et nous n’osons plus relever la tête...
– Non, non, commence dès le début, depuis la défaite du bataillon et notre séparation. Pendant les huit années que j’ai passées à Diarbékir, je n’ai rien appris ni de toi, ni des autres camarades.
Mouratliiski s’étendit de tout son long sur la pierre et, les mains croisées sous la tête, raconta sa longue histoire. Il avait pris part à la conspiration de Sofia et au pillage du trésor d’Orkhanié conduit par Dimitar Obchti 64. Dénoncé, il avait été jeté en prison et c’était par miracle qu’il avait échappé au bagne de Diarbékir ou à la corde. Puis, il s’était rendu en Roumanie et, après un an et demi de vie errante, dans une misère noire, il était revenu en Bulgarie, chargé d’une mission pour laquelle il affrontait de nouveau le danger. Au printemps dernier, il était allé à Stara-Zagora où il avait travaillé à préparer l’insurrection. Après l’issue malheureuse du mouvement, légèrement blessé par les Turcs au cours d’une escarmouche près d’Elkhovo, il avait gagné la Vieille Montagne, poursuivi par des escouades de milice et par les montagnards bulgares à qui il avait demandé du pain et des habits pour se défaire de son costume d’insurgé. Il avait erré ainsi pendant une dizaine de jours. La faim l’avait forcé à descendre du Balkan, décidé à demander du pain en braquant son revolver sur la première personne qu’il allait rencontrer. Heureusement, ç’avait été l’oncle Stoïan ! Il était très touché par l’accueil cordial que lui avait fait le meunier, le premier homme qui l’eût traité en frère depuis qu’il errait dans la Vieille Montagne.
Ognianov suivait avec émotion le récit des dangereuses aventures de Mouratliiski. Il ressentait profondément les inquiétudes, les souffrances, les déceptions amères de son camarade, aussi bien que la lâcheté de certains individus, la lâcheté qui accueille la défaite. Avec une fraternelle sympathie, il pensait à l’avenir de Mouratliiski.
Celui-ci se tut. La rivière murmurait à leurs pieds. Autour d’eux, le silence planait sur la solitude. Sur la crête des rochers muets, le souffle de la nuit agitait légèrement les lilas sauvages.
18 LE TOMBEAU PARLE
Le lendemain, Ognianov regagna la ville. Laissant derrière lui la gorge, il s’approcha du couvent. Le supérieur Natanaïl, nu-tête, se promenait sous les noyers centenaires. Respirant à longs traits l’air frais et vivifiant de la montagne, il goûtait la beauté du matin, le charme de l’automne, l’or des feuillages, le velouté roux des flancs de la montagne, toute la délicieuse mélancolie de la nature.
Ognianov et le supérieur se serrèrent la main.
– Bel endroit, mon père ! Que vous êtes heureux d’avoir la nature si près de vous et de pouvoir jouir en toute tranquillité de ses charmes divins. Si jamais je décidais de me faire moine, je le ferais uniquement par amour de cette nature toujours belle.
– Prends garde, Ognianov, tu risques de t’abaisser de plusieurs degrés si, étant « apôtre 65 », tu te fais moine. Reste en paix. Et puis, je ne t’accepterais pas au couvent. Athée comme tu l’es, tu rendrais incrédule le père Iéroteï lui-même ! dit en plaisantant le supérieur.
– Quel genre d’homme est-ce, ce vieillard ? demanda brusquement Ognianov.
– Un frère très pieux et très honnête qui fait penser à Dieu le Père, tel qu’on le représente ; il a malgré tout un défaut : celui de mettre son argent en terre, où il moisit. Toutes les fois qu’on lui laisse entendre qu’il faut débourser, il fait la sourde oreille... Il en est devenu proverbial ; et nous disons de quelqu’un : « Il fait la sourde oreille comme le père Iéroteï. » Mais d’où viens-tu de si bon matin ?
– J’ai passé la nuit au moulin, chez l’oncle Stoïan.
Le supérieur le regarda quelque peu surpris :
– As-tu des ennuis ?
– Pas du tout, mais un ami est arrivé.
Et Ognianov raconta brièvement sa rencontre avec Mouratliiski.
– Et pourquoi n’êtes-vous pas venus au couvent ? dit le supérieur sur un ton de reproche. Vous avez passé la nuit sur des sacs de blé...
– À la guerre comme à la guerre !
– Que Dieu vous bénisse !... Et comment as-tu baptisé ton ami ?
– Iaroslav Barzobégounek, Tchèque autrichien et photographe à Biala-Tcherkva.
Le père Natanaïl éclata de rire :
– Vous autres, apôtres, vous êtes très hardis, mais prenez garde qu’à la fin la cruche ne se casse !
– Ne t’inquiète pas, il y a un Dieu pour les révolutionnaires ; comme il y en a un pour les haïdouks, fit Boïtcho, souriant d’un air qui en disait long. Tiens, tu as apporté ta carabine ? ajouta-t-il en apercevant le fusil appuyé un saule.
– L’idée m’est venue ce matin de l’essayer. Il y a longtemps que je n’y ai pas touché. Tu as mis en branle les jeunes gens et voilà que maintenant tous les jours j’entends la fusillade autour du couvent. Quelle ardeur ! Non seulement un vieux pécheur comme moi, mais les morts eux-mêmes y prendraient goût.
Marchant ensemble, ils s’étaient approchés du moulin funeste. À sa vue, le front d’Ognianov se couvrit de rides profondes. Le moulin était fermé ; le meunier Stoïan, l’ayant abandonné, en avait loué un autre situé sur la rivière du couvent ; comme on le sait déjà, Ognianov et son ami y avaient passé la nuit.
Sur ces entrefaites, Mountcho s’était approché à la dérobée et observait Ognianov. Un sourire bizarre effleurait la figure de l’idiot. Dans ce regard privé de raison on lisait l’amitié, la peur et l’admiration que la présence de Boïtcho soulevait dans l’âme de Mountcho. Quelques années auparavant, Mountcho avait blasphémé Mahomet devant un caporal turc qui l’avait battu presque à le tuer. Depuis lors, il n’avait gardé dans sa conscience assombrie qu’un seul sentiment : une rancune démoniaque contre les Turcs. Témoin involontaire du meurtre des deux Turcs dans le moulin et de leur enfouissement dans la fosse, il avait conçu pour Ognianov un sentiment d’admiration et de vénération infinies. Ce sentiment tenait du culte. Il l’appelait « Russian ! », on ne saurait dire exactement pourquoi. Il avait tout d’abord eu peur de lui au cours de la fameuse nuit puis, peu à peu, il s’était habitué à la présence d’Ognianov qui fréquentait le couvent. Il le regardait en écarquillant tout grands les yeux et le considérait comme son protecteur. Lorsque les valets de ferme du couvent l’offensaient, il les menaçait de son Russian : « Je d’rai à Rus-si-an qu’il vous é-gorge au-ssi. » Et il faisait le geste de se couper la gorge avec le doigt. Mais personne ne comprenait ce qu’il voulait dire, heureusement, car il parlait en ces termes même en ville, quand il s’y rendait.
Le supérieur et Boïtcho ne firent aucune attention à Mountcho qui ne cessait de tourner la tête et de ricaner amicalement.
– Tiens ! l’onbachi qui vient par ici ! fit le supérieur.
En effet, l’onbachi apparut, fusil en bandoulière et gibecière au dos. Il allait à la chasse. C’était un homme de trente-cinq ans, au visage boursouflé, au teint jaunâtre, au front bombé, dont les petits yeux gris avaient le regard languissant et terne de l’homme qui s’adonne à l’opium. Après avoir échangé saluts et remarques sur la récolte de l’année, l’onbachi prit la carabine du supérieur, l’examina en connaisseur et en chasseur, et dit :
– Une bonne carabine ! Où vas-tu tirer ?
– Justement, je me le demandais, chérif-aga... Il y a au moins un an que je ne l’ai pas touchée, et j’ai envie de la décharger...
– Quelle cible choisis-tu ? demanda l’onbachi, ôtant son fusil de l’épaule dans l’intention manifeste de démontrer son adresse.
– Tiens, vois-tu là-bas, sur la pente en face, une touffe d’herbes qui ressemble à un chapeau, tout près de l’endroit où l’on a cherché de l’argile ? lui dit simplement le supérieur.
L’onbachi le regarda tout étonné :
– Sapristi, mais c’est très loin !
Toutefois, il s’agenouilla derrière un rocher, appuya son fusil et visa un moment. Le coup partit ; un petit nuage de poussière s’éleva à quelques pas du but.
Un léger dépit se peignit sur le front empourpré du chérif-aga.
– Encore une fois ! dit-il, se mettant de nouveau derrière le rocher, mais prenant cette fois tout son temps pour viser.
Lorsque le coup partit, l’onbachi se redressa et fixa la touffe d’herbes. La poussière apparut cette fois beaucoup plus loin sur la pente.
– Pas de veine, dit-il, l’air fâché. Voyons, efendi, on ne choisit pas un but aussi éloigné ! À ton tour maintenant ! je t’avertis que ce sera pour rien !... Tâche au moins d’atteindre la pente, ajouta-t-il, d’un ton sarcastique.
En un clin d’œil, le supérieur leva son fusil, visa et fit feu. La touffe d’herbes se couvrit de poussière.
– Ce fusil m’obéit encore, sacrebleu ! fit le supérieur.
– Dis donc, encore une fois ! s’écria l’onbachi.
Le supérieur visa encore et tira. La balle retrouva la touffe d’herbes.
L’onbachi pâlit et dit, d’un air fâché :
– Efendi, tu as l’œil juste, mais tu ne me feras pas croire que tu n’as pas tiré depuis un an... Cela vaut la peine de donner des leçons aux jeunes qui s’exercent tous les jours par ici... Puis il ajouta, d’un ton méchant :
– Ces jeunes gens sont possédés du démon, quelque chose les démange...
Son regard, devenu furieux et plein de haine, se reposait sur Ognianov...
Mountcho se tenait toujours à distance respectueuse, mais son expression avait tout à fait changé... Une terreur folle et une haine farouche avaient subitement décomposé les traits de son visage. Bouche béante et les bras levés, il lançait à l’onbachi des regards menaçants, comme s’il avait l’intention de se jeter sur lui. L’onbachi se retourna machinalement et le regarda avec dédain. Le regard de l’idiot devint alors encore plus féroce. Il cria, en bavant de rage :
– Rus-si-an, t’tuera toi aussi ! et lui lança des injures.
L’onbachi comprenait mal le bulgare et ne saisit rien des mots incohérents de Mountcho.
– Qu’est-ce qu’il radote cet animal ? demanda-t-il.
– Oh ! il est sans malice, efendi, ne vois-tu pas ?
– Pourquoi Mountcho est-il en colère ? Je l’ai toujours vu très doux en ville, fit Ognianov.
– Ne sais-tu pas que chacun ne se sent libre que chez soi ?
À ce moment un beau lévrier aux flancs tachés de noir, un collier de cuir au cou, accourut à travers le gazon, traînant sa laisse.
Tout le monde se tourna vers lui.
– Voilà un lévrier qui a dû s’échapper. Il y a probablement des chasseurs par-là, dit le supérieur.
Ognianov tressaillit instinctivement.
Le lévrier s’approcha du moulin, s’arrêta pour flairer la porte puis se mit à rôder en hurlant tristement. Ognianov sentit des frissons le parcourir.
– Ah ! mais c’est le lévrier d’Emexis Pechlivan, le disparu ! s’écria l’onbachi.
Le lévrier qu’Ognianov avait tout de suite reconnu courait çà et là autour du moulin, grattait le seuil, fouillait l’herbe et hurlait de nouveau. Puis il leva son long museau humide comme s’il voulait attirer l’attention sur lui et se mit à aboyer d’un air méchant. Cet aboiement troubla profondément Ognianov, il échangea un coup d’œil stupéfait avec le supérieur. L’onbachi, étonné, observait avec attention ce qui se passait.
Le lévrier ne cessait d’aboyer et de hurler, en regardant le groupe. Tout à coup, il se jeta sur Ognianov. Celui-ci pâlit et recula, car l’animal avait bondi comme un loup avec des glapissements de désespoir.
Machinalement il sortit son poignard pour se défendre contre l’animal furieux que le supérieur, ne trouvant pas de pierre à sa portée, essayait de chasser en gesticulant.
L’onbachi assistait silencieusement à cette scène étrange. Il lançait des regards sinistres et méfiants sur Ognianov et son poignard étincelant. Mais lorsqu’il vit qu’Ognianov, en se défendant, pourrait atteindre le chien qui évitait adroitement le poignard et attaquait d’un côté et de l’autre, il intervint et puis, s’adressant à Ognianov, tout rouge et essoufflé :
– Efendi, pourquoi ce chien t’en veut-il ainsi ?
– Un jour, je ne me rappelle pas où, je l’ai frappé d’une pierre, répondit-il avec un sang-froid forcé.
L’onbachi le scrutait avec méfiance. Évidemment il n’était pas satisfait de cette réponse. Un vague soupçon lui vint à l’esprit, mais il voulait prendre son temps pour réfléchir. Il dit :
– Cette espèce de chien est très rancunière.
Saluant le supérieur, il se dirigea vers la gorge du Balkan où bientôt il disparut.
Le lévrier, la queue en l’air, s’éloigna à son tour à travers la prairie pour aller rejoindre son nouveau maître.
– Vous l’aviez pourtant tué, tonnerre de Dieu ! s’exclama le supérieur étonné.
– Je l’ai jeté à demi mort dans l’eau pour le noyer, mais le voilà de nouveau en vie. C’est un vrai malheur, balbutia Ognianov soucieux. L’oncle Stoïan avait raison. Il aurait fallu enterrer ce chien avec les deux autres. Et pourquoi cet imbécile de chérif s’est-il trouvé ici ? Un malheur ne vient jamais seul.
– Les avez-vous au moins bien tués, eux ? Pourvu que l’un d’eux ne ressuscite pas un beau jour, comme le chien ! Quand on commence une affaire pareille, il faut la pousser jusqu’au bout... tu es encore un novice dans ce métier. Dieu veuille que cela n’aille pas plus loin ! Le bruit que nous avons fait courir a tranquillisé les Turcs. En tout cas, il faut se tenir sur ses gardes.
Entre-temps, Ognianov, jetant les yeux sur l’endroit où avaient été ensevelis les Turcs, vit avec étonnement qu’on y avait amoncelé des pierres ; or ni lui ni le meunier n’avaient rien mis. Il le fit remarquer au supérieur. Ce dernier le rassura en lui disant que c’était là un simple hasard. L’un et l’autre ignoraient que Mountcho était allé tous les jours jeter des pierres sur la tombe des deux Turcs en vociférant des insultes. Ce faisant, il avait bel et bien ramassé toutes les pierres d’alentour.
Ognianov tendit la main au supérieur.
– Où vas-tu !
– Adieu, je suis pressé, j’ai beaucoup à faire avec cette représentation. Ce maudit chien m’a fait oublier mon rôle.
– Quel rôle as-tu ?
– Celui du comte.
– Comte ! et quel est ton comté ? plaisanta le supérieur.
– C’est le fort Diarbékir... et j’en fais cadeau à qui en voudra, dit Ognianov en s’éloignant.
17 LA REPRÉSENTATION
Les lecteurs d’aujourd’hui ne connaissent plus ce drame : Le Martyre de Geneviève 66, qui devait être joué ce soir-là à l’école des garçons. Cependant, il y a une trentaine d’années, ce drame avait formé le goût de toute la génération d’alors et faisait son admiration, en même temps que Alexandrie, Le rusé Berthold, Michel et autres pièces oubliées.
Siegfried, un comte allemand, s’en va guerroyer contre les Maures d’Espagne, laissant sa jeune femme, la comtesse Geneviève, plongée dans une inconsolable douleur. Le mari à peine parti, son intendant Golo tente de séduire la comtesse qui repousse avec indignation ses avances. Le vindicatif Golo tue Drako, le fidèle serviteur de la dame, et la jette elle-même en prison. Il réussit à la calomnier aux yeux de son époux en l’assurant qu’il l’a surprise avec Drako. Furieux, le comte lui envoie l’ordre de faire périr l’épouse infidèle. Pourtant, les bourreaux auxquels Golo a confié cette besogne ont pitié de la comtesse et l’abandonnent – elle et son enfant – dans une grotte de la forêt, au hasard du sort, tandis qu’ils font croire à Golo qu’ils l’ont bel et bien exécutée.
Sept ans après, le comte revient de la guerre, profondément malheureux. Une lettre laissée par sa femme lui apprend l’innocence de celle-ci. Alors il pleure amèrement sa mort prématurée. Il jette en prison Golo qui devient fou de remords. Un jour, pour se distraire, le comte s’en va à la chasse dans la forêt où le hasard lui fait retrouver la comtesse et son enfant dans la grotte, ainsi qu’une biche qui les nourrissait de son lait. Ils se reconnaissent et rentrent joyeux au palais.
Cette œuvre naïve et touchante avait fait pleurer les jeunes et les vieilles femmes de la ville. Aussi beaucoup se souvenaient-elles de la pièce et même quelques-unes de ces dames la connaissaient par cœur.
Voilà pourquoi, depuis plusieurs jours, la représentation de ce soir agitait toute la société. On l’attendait avec impatience comme un grand évènement qui devait apporter une diversion à la vie monotone de Biala-Tcherkva. Tout le monde s’apprêtait à aller au théâtre. Les dames riches préparaient leurs atours et les pauvres vendaient au marché leurs écheveaux de fil et s’empressaient de se procurer des billets, de peur que leur argent ne s’en allât payer du sel et du savon. On ne parlait que du spectacle qui avait supplanté tous les potins et cancans privés et publics.
À l’église, les commères se demandaient entre elles : « Guéna, iras-tu voir ce soir Geneviève ? » et se préparaient à verser des larmes sur le sort de la comtesse martyre. Dans les familles on s’informait avec curiosité de la distribution des rôles et on apprenait avec satisfaction qu’Ognianov jouerait celui du comte. M. Fratiou, qui aimait les sensations fortes, avait pris le rôle du perfide Golo... qui finirait par perdre la raison. Pour produire plus d’effet, M. Fratiou avait laissé pousser exprès ses cheveux depuis un mois. Ilytcho le Curieux était le fidèle serviteur Drako et il avait répété aujourd’hui plus de vingt fois comment il devait mourir de l’épée de Golo. Il était aussi chargé d’imiter l’aboiement du chien de chasse du comte et s’y exerça avec la même persévérance. Pour le rôle de Geneviève, quelques-uns avaient d’abord proposé le diacre Vikenti, à cause de sa belle et longue chevelure, mais lorsqu’on apprit qu’il était interdit aux gens d’église de monter sur les planches, ce rôle, avec une boîte de pommade blanche pour dissimuler la moustache, fut donné finalement à un autre. Les rôles secondaires furent également distribués.
Les décors donnèrent bien plus de peine car il fallait procurer tout à peu de frais. Le rideau seul absorba presque tout l’argent disponible. On le fit d’andrinople rouge ; quant à sa décoration, on recommanda à un artiste d’y peindre une lyre et l’on obtint quelque chose qui ressemblait vaguement à une fourche à remuer le foin. Pour former dignement le palais du comte, on dut emprunter tous les meubles convenables de la ville. À hadji Gourla on prit les rideaux avec des dessins de peupliers ; à Kara-Guiozoglou on emprunta deux petits tapis de prière venant d’Anatolie ; Mitcho Beizédéto fournit de beaux vases à fleurs en cristal ; Mitcho Saranov prêta son grand tapis, Nikolaï Nedkovitch mit à la disposition des acteurs ses tableaux représentant des batailles de la guerre franco-allemande. Un vieux canapé troué, unique dans la ville, venait de chez Bentchoolou et, de chez Marko Ivanov, la grande glace qu’il avait apportée de Bucarest et un tableau : les Martyrs. Le couvent des femmes avait fourni des coussins ; l’école, la carte d’Australie et un globe, et l’église, un petit lustre qui éclairait cette exposition universelle. Même la prison du konak avait prêté les chaînes pour Golo. Quant aux costumes, ils étaient simplement ceux qui avaient servi trois ans auparavant, pour mettre en scène la Princesse Raïna 67. De sorte que le comte s’affubla de la robe du prince Svétoslav et que Geneviève prit celle de Raïna. Golo ajouta à son costume des espères d’épaulettes et des bottes à l’écuyère. Gantcho Popov, qui jouait le rôle de Houns (un des bourreaux), mit à sa ceinture le long poignard qu’il préparait pour l’insurrection. La tête de Drako s’orna du haut-de-forme bosselé de Mikhalaki Alafranga. Ce fut en vain que Boïtcho Ognianov voulut protester contre ce mélange hétéroclite : comme la plupart des acteurs ne pensaient qu’à faire plus d’effet sur la scène, il les laissa faire.
Le soleil à peine couché, le public commença à affluer. Les premiers rangs étaient occupés par les notables au milieu desquels trônait le bey, spécialement invité. À ses côtés s’était assis Damiantcho le Grigor, chargé de le distraire comme il savait le faire. À toutes les autres places grouillait un monde disparate qui bourdonnait en attendant le lever du rideau. Parmi les femmes, Guinka était celle qui faisait le plus de bruit ; elle savait le drame par cœur et racontait à droite et à gauche ce qu’allait dire le comte. Hadji Smion, sur un autre banc, faisait remarquer combien le théâtre de Bucarest était plus grand et expliquait la signification de la fourche qui ornait le rideau. L’orchestre était composé de tziganes de la ville, joueurs de rebec, qui interprétaient l’hymne autrichien, probablement en l’honneur de la comtesse allemande.
Enfin l’instant solennel arriva ! L’hymne autrichien s’arrêta et le rideau se leva avec des grincements affreux. Le comte apparut le premier. Un silence absolu se fit.
Puis le comte parla tandis que, depuis sa place, Guinka lui soufflait à mesure son rôle ; s’il lui arrivait d’oublier ou de changer un mot, elle s’écriait : « T’as fait une faute ! »
Mais voilà que le cor sonne annonçant l’arrivée des envoyés de Charlemagne qui invitent le comte à prendre part à la guerre contre les Maures. Le comte fait ses adieux à Geneviève. Elle tombe évanouie tandis qu’il s’en va. Quand la comtesse revient à elle et ne trouve plus son mari à ses côtés, elle pleure. Mais ses pleurs font rire tout le monde. Et de nouveau c’est Guinka qui jette :
– Pleure donc comme il faut ! Ne sais-tu pas comment on pleure ?
La comtesse se mit à hurler de plus belle et la salle lui répond par un rire à pleine gorge ! Mais c’est le rire de Guinka qui tonne le plus fort. Elle crie :
– Faut-il que je monte là-haut pour te montrer comment on doit pleurer ?
Hadji Smion fait alors remarquer au public que pleurer est un art et qu’en Roumanie on paye des femmes pour pleurer les morts. Quelqu’un lui crie « Chut ! » pour le faire taire, mais il s’en prend à ceux qui l’écoutaient.
Cependant l’apparition de Golo change la situation. Il cherche à séduire Geneviève qui lui répond par le mépris et appelle Drako pour l’envoyer porter une lettre au comte. Drako entre et tout le monde de pouffer de rire à la vue de son tube ; cela trouble Drako. Guinka lui lance :
– Drako, enlève vite cette espèce de marmite ! Nu-tête !
Obéissant, il enlève son haut-de-forme. Le public rit de nouveau. Cependant la scène prend un caractère tragique. Golo, furieux, tire son épée pour transpercer Drako. Mais avant même d’être touché, Drako tombe tout d’une pièce, mort et immobile. Le public n’est pas du tout satisfait de cette stupide façon de mourir et quelques spectateurs crient à Drako de gigoter un peu. Là-dessus, les serviteurs tirent le cadavre par les jambes tandis que sa tête traîne par terre. Mais Drako supporte héroïquement la douleur et tient pour de bon son rôle de mort.
On jette la comtesse en prison.
L’acte finit et l’hymne autrichien se fait de nouveau entendre. La salle retentit de critiques et de rires. Les vieilles femmes ne sont pas contentes de Geneviève qui, d’après elle, ne joue pas avec assez de sentiment. Par contre Golo rend bien son rôle ingrat et s’attire la haine méritée de quelques commères. L’une d’elles s’approche de la mère de Fratiou et lui dit :
– Dis donc, Tana, ce n’est pas bien beau la conduite de ton Fratiou ! Quel mal lui a donc fait la petite femme !
Au premier rang, Damiantcho le Grigor expliquait au bey, en grand détail, l’action du premier acte. Il se laissa entraîner par son éloquence et lui raconta l’histoire d’un consul français qui avait abandonné sa femme à la suite d’une intrigue semblable. Le bey l’écoutait fort attentivement et finalement comprit que le comte était un consul français et il le tint pour tel jusqu’à la fin.
– Ce consul-là est bien bête, dit-il sévèrement. Comment peut-il ordonner la mort de sa femme avant de faire une enquête détaillée ? Moi, par exemple, je ne fais pas coffrer même un simple ivrogne de la rue avant de lui avoir fait souffler son haleine à la face des gendarmes.
– Bey-efendi, dit Damiantcho, cela a été écrit ainsi pour rendre la pièce plus amusante.
– Dans ce cas l’auteur est un imbécile et le consul en est un autre plus grand !
Assis tout près, Steftchov critiquait aussi le comte.
– Ognianov, disait-il avec emphase, n’a jamais vu un vrai théâtre, même à travers une claie.
– Mais pourquoi donc ? Il joue très bien, riposta hadji Smion.
– Très bien comme un vrai singe qu’il est. Il n’a aucun respect pour le public.
– C’est vrai ça ! Je vois aussi qu’il ne respecte pas le public. As-tu vu sa façon de s’asseoir sur le canapé de Bentchoolou ? Comme s’il était le propre frère du prince Cuza ! dit avec sévérité hadji Smion.
– Il faut le siffler ! ajouta Steftchov avec colère.
– Il le faut, il le faut, acquiesça hadji Smion.
– Qui veut siffler ? se fit entendre une voix partant du même groupe.
Steftchov et hadji Smion rencontrèrent en se retournant le regard étincelant de Kablechkov 68. Celui-el n’était pas encore « apôtre ». Il se trouvait par hasard à Biala-Tcherkva, en visite chez des parents.
Hadji Smion se troubla sous l’œil de feu du futur révolutionnaire. Il recula un peu pour laisser voir le coupable Kiriak Steftchov.
– C’est moi ! riposta Steftchov.
– Vous êtes libre, monsieur, seulement il vous faut aller dans la rue pour siffler.
– De quoi vous mêlez-vous ?
– C’est un spectacle de bienfaisance. Les acteurs sont des amateurs. Si vous pouvez jouer mieux, vous n’avez qu’à monter sur la scène ! dit vivement Kablechkov.
– J’ai payé ma place et je n’ai pas besoin de leçons !
Kablechkov s’enflamma. La querelle allait s’envenimer. Mais Mitcho Beizédéto se hâta d’y mettre un terme :
– Voyons, Kiriak, tu es un homme raisonnable. Et toi, Todor, reste tranquille !
L’hymne autrichien s’arrêta ; le rideau se relevait.
Cette fois-ci la scène représente une prison éclairée par un lampion. Geneviève, l’enfant dans les bras, cet enfant qu’elle a eu en prison, égrène des mots touchants et des pleurs. Elle est maintenant plus naturelle. La nuit, la sinistre prison, les gémissements de la malheureuse mère que personne ne vient secourir – tout cela touche profondément les cœurs. Des larmes roulent sur la face de plusieurs femmes. Les larmes, comme le rire, sont contagieuses. Le nombre des spectateurs qui pleuraient alla en augmentant, et même quelques hommes fondirent en larmes quand la comtesse écrivait la lettre à son mari. Kablechkov, ému, applaudit un passage pathétique. Son applaudissement résonna solitaire dans ce silence profond et il expira sans écho. Des regards furibonds criblèrent le trouble-fête qui faisait du bruit au moment le plus poignant. Ivan Séliamsas, qui reniflait en pleurant, lui iota un regard sanguinaire.
On emmène Geneviève dans la forêt pour la faire périr. Le rideau tombe. Kablechkov applaudit encore une fois, mais ne trouve personne pour l’imiter. L’habitude d’applaudir n’avait pas encore pénétré à Biala-Tcherkva.
– Il devait y avoir de mauvais sujets dans ce pays-là, chuchota le bey à l’oreille de Damiantcho. Voyons, où se passe tout cela ?
– En Allemagne.
– En Allemagne ? Je n’ai pas encore vu de ces giaours-là 69...
– Comment donc, bey-efendi, nous avons un Allemand dans notre ville !
– Serait-ce cet homme sans moustaches, aux favoris et aux lunettes bleues ?
– C’est bien cela, le photographe.
– C’est donc celui-là ? Un bon giaour... Il me salue comme on salue en France. Je le prenais pour un Français.
– Non, pas du tout, c’est un vrai Allemand, de Drandabour 70...
On en était au troisième acte. La scène se passe de nouveau au palais. Le comte, revenu de la guerre, est soucieux et sombre, n’ayant plus retrouvé Geneviève. Une servante lui remet la lettre de sa femme, écrite en prison la veille de sa mort. Elle lui dit qu’elle est victime de l’infamie de Golo, qu’elle meurt innocente et qu’elle lui pardonne... Le comte lit tout cela à haute voix, en sanglotant. Il pleure, il est au désespoir. Les spectateurs vivent avec lui sa douleur, ils pleurent aussi, quelques-uns sanglotent bruyamment. Le bey pleure de son côté, il n’a pas besoin des explications de Grigor. L’émotion est à son comble lorsque le comte donne l’ordre de lui amener Golo, coupable de ses malheurs. Golo s’avance échevelé, hideux, en proie aux plus affreux remords, les pieds rivés aux chaînes du konak. Un bourdonnement hostile du public l’accueille. On lui lance des regards furieux. Le comte lui lit la lettre de la comtesse qui pardonne aussi à Golo. Le comte éclate de nouveau en sanglots, s’arrache les cheveux, se frappe la poitrine. De nouveau le public sanglote sans pouvoir se contenir.
Guinka, qui pleure aussi, tâche de consoler les autres :
– Ne pleurez pas, voyons, Geneviève est vivante, dans la forêt, criait-elle.
– Est-ce vrai, Guinka ? Mais alors il faut le dire à ce malheureux pour qu’il cesse de se lamenter, dit grand-mère Petkovitsa.
Et là-dessus, grand-mère Pavlovitsa, ne pouvant plus se retenir, crie, à travers ses larmes, au comte :
– Ne pleure pas, mon petit, ta petite femme est vivante !...
Pendant ce temps, Golo se démène. Les yeux écarquillés, le regard effrayant, les cheveux hérissés en désordre, il gesticule, se tord et grince affreusement des dents. Il est en proie aux plus atroces remords. Mais ses souffrances apportent un soulagement au public. Les visages sont malveillants.
– Bien fait ! disent les femmes.
Elles en veulent même à Geneviève d’avoir pardonné à Golo dans sa lettre. La mère de Fratiou, voyant le triste état de son fils succombant sous le poids des fers et de l’indignation générale, ne savait où donner de la tête.
– Mon garçon ! On l’a perdu ! On l’a déshonoré ! s’écria-telle, se préparant à aller le tirer hors de la scène, mais on la retint.
Cet acte eut un succès fou. L’Ophélie de Shakespeare n’a jamais fait verser tant de larmes en une seule soirée.
Le dernier acte se passe dans la forêt. Là une grotte, à l’entrée de laquelle apparaissent Geneviève, habillée de peaux de bêtes sauvages, et son enfant. Une chèvre, devant laquelle on avait mis des branches tendres pour qu’elle ne se sauvât pas de la scène, représentait la biche qui les nourrit de son lait. Geneviève parle tristement à l’enfant, de son père. Elle entend les aboiements des chiens de chasse et se cache dans la grotte avec son enfant en tirant après elle la chèvre par les cornes. Les aboiements deviennent plus forts et le public trouve qu’Ilytcho le Curieux est plus habile dans ce rôle-ci. Il fait plus de zèle, et son aboiement éveille celui de quelques chiens du voisinage. Enfin, voilà le comte en habit de chasse qui s’avance avec sa suite. Le public retient sa respiration. Il est tout yeux et tout oreilles pour ne rien perdre de la rencontre du comte avec sa femme.
La grand-mère Ivanitsa, craignant qu’il ne passe outre, propose de l’avertir que sa femme est là.
Pourtant le comte l’a déjà aperçue. Il se baisse et crie dans la grosse :
– Toi qui es ici, homme ou bête, sors !
Mais au lieu de la grotte, ce fut de la salle qu’on lui répondit : un mince coup de sifflet se fit entendre. Tous se tournèrent vers Steftchov. Il était devenu écarlate !
– Qui est-ce qui se permet de siffler ? s’écria avec fureur un spectateur.
Un murmure de mécontentement remplit le théâtre. Ognianov chercha du regard le siffleur. En apercevant Steftchov qui le fixait avec impertinence, il lui souffla :
– Je t’arracherai tes longues oreilles !
Nouveau coup de sifflet, plus fort cette fois. Le public est scandalisé. Un brouhaha d’indignation éclate.
– Attrapez-le, ce protestant-là, jetons-le par la fenêtre, hurle avec férocité Anguel Iovkov, un géant de deux mètres.
D’autres voix firent chorus :
– Hors d’ici, celui qui siffle ! Steftchov hors d’ici !
– Nous ne sommes pas venus ici pour entendre siffler et battre des mains, criait Séliamsas qui avait mal compris tout à l’heure les applaudissements de Kablechkov.
– Kiriak, je n’accepte pas cela ! s’écria Guinka, assise à côté de Rada qui avait le visage mouillé de larmes.
Hadji Smion soufflait à l’oreille de Steftchov :
– Je te l’ai bien dit, tout à l’heure, vois-tu qu’il ne faut pas siffler... Ici les gens sont simples, tu le vois bien, disait hadji Smion.
– Pourquoi ce monsieur siffle-t-il ? demanda le bey.
Damiantcho haussa les épaules. Alors le bey dit quelque chose à l’oreille d’un zaptié qui s’approcha de Steftchov.
– Kiriak, lui dit-il, le bey te fait dire d’aller fumer dehors une cigarette, si tu es mal à l’aise.
Steftchov, content d’avoir gâté la bonne impression produite par le jeu d’Ognianov, sortit, un sourire fier sur les lèvres.
Aussitôt la salle se calma et le spectacle continua.
Le comte avait enfin retrouvé la comtesse. Des embrassements, des exclamations, des larmes...
Nouvelle émotion du public... Le bien triomphait du mal... Le comte et la comtesse se racontent leurs souffrances et leurs joies. La mère Petkovitsa leur dit :
– Rentrez chez vous, mes enfants, et vivez en paix. Gardez-vous bien de croire à ces maudits Golos.
– C’est toi qui es maudite ! siffla, derrière elle, la mère de Fratiou.
Le bey donna le même conseil, mais d’une façon discrète. Un sentiment général de joie et de satisfaction se répandit dans la salle. Le comte rencontrait partout des regards de sympathie.
Dans la scène finale, le comte, la comtesse et leur suite entonnèrent la chanson :
Ô Siegfried, et toi, ville natale,
Réjouis-toi à présent !...
Mais lorsque les deux premiers couplets de cette chanson vertueuse eurent été exécutés, on entendit sur la scène le chant révolutionnaire :
Brûle, brûle en nous, ô toi, amour sacré !
Donne-nous la force de résister aux Turcs...
Ce fut comme un coup de foudre dans la salle. Une seule voix avait commencé, une partie de la troupe avait suivi, puis toute la troupe et enfin le public. Une extase patriotique subite avait saisi les assistants. L’enthousiasme anima tout le monde. Le vigoureux motif de ce chant afflua comme une vague invisible, emplit la salle, inonda la cour et déborda dans la nuit. Le chant retentissait dans l’air, enflammait et enivrait les cœurs. Ces sons puissants firent vibrer chez le public une nouvelle corde. Tous ceux qui connaissaient la chanson – jeunes gens et jeunes filles – se mirent à la chanter. Elle fit fondre toutes les âmes en une seule, réunit la salle à la scène et s’éleva vers le ciel comme une prière...
– Chantez, les gars ! Que Dieu vous garde ! criait Mitcho en extase.
Mais d’autres, parmi les vieux, trouvaient déplacé cet enthousiasme insensé.
Le bey qui n’y comprenait pas un mot, écoutait lui aussi le chant avec plaisir. Il demandait à Damiantcho le Grigor de lui expliquer chaque strophe. Tout autre à sa place aurait été embarrassé, mais Damiantcho n’était pas de ceux qui ne savent pas répondre aux questions épineuses : c’était là une trop belle occasion d’essayer ses facultés. De la manière la plus naturelle, il fit prendre au bey les vessies pour des lanternes ; d’après lui, le chant exprimait l’amour tendre du comte pour la comtesse. Le comte disait : « Je t’aime à présent cent fois plus », et elle répliquait : « Je t’aime mille fois plus... » Il dit qu’il fera construire une église commémorative à l’endroit où se trouvait la grotte ; elle répond qu’elle vendra tous ses bijoux pour faire des aumônes aux pauvres et pour faire ériger cent fontaines de marbre.
– Cela fait trop de fontaines ! Elle fera mieux de construire aussi des ponts ! interrompit le bey.
– Non, non, des fontaines, car en Allemagne l’eau manque et les gens y boivent plutôt de la bière, fut la réponse de Damiantcho.
Le bey approuva de la tête.
– Et où est Golo ? demanda-t-il de nouveau en cherchant en vain Fratiou parmi les acteurs.
– Il n’a pas à paraître dans cette scène.
– C’est vrai... Mais, cet animal-là, on aurait mieux fait de le pendre. Si l’on joue encore une fois, dis au consul qu’on ne le laisse pas vivant. Ce serait mieux.
En effet, Fratiou n’était plus parmi ses camarades. Sans attendre les lauriers du public, il s’était prudemment éclipsé dès qu’on avait entonné le dangereux chant révolutionnaire.
Le chant cessa et le rideau tomba au milieu des bravos. L’hymne autrichien retentit de nouveau pour saluer le public quittant rapidement la salle.
Les acteurs changeaient de costume derrière le rideau et causaient gaiement avec leurs amis accourus pour les féliciter.
– Dis donc, Kablechkov, que le diable t’emporte ! disait Ognianov, tout en enlevant les bottes du prince Svétoslav. Quelle était cette folie ? Sans crier gare, tu te trouves derrière moi et tu commences à chanter à tue-tête notre chant révolutionnaire ! Sacré jeune homme, va !
– Je n’ai pas pu y tenir, mon vieux, j’en avais assez de tous ces soupirs et de ces larmes pour « la grande martyre ». Il fallait secouer le public. Alors j’ai eu l’idée de me faufiler sur la scène... Tu as vu quel effet nous avons produit !
– Je me retournais tout le temps pour voir si quelque zaptié ne me mettait pas la main au collet, plaisantait Ognianov.
– Ne vous inquiétez pas, Steftchov avait déguerpi bien avant, dit Sokolov.
– C’est le bey qui l’a fait mettre dehors ! dit l’instituteur Frangov.
– Mais le bey est resté, dit un autre. Et avec quelle attention il écoutait ! Demain nous aurons des embêtements.
– N’ayez pas peur ! Damiantcho le Grigor n’était-il pas auprès de lui ? Il a certainement su se tirer d’affaire. S’il ne l’a pas fait, on va lui retirer son diplôme...
– Je l’avais invité exprès et placé à côté du bey, qui aime les blagues. Ne vous inquiétez de rien, tout sera pour le mieux, remarqua Nikolaï Nedkovitch qui enlevait la soutane du pope Dimtcho, dans laquelle il avait joué son rôle de père de Geneviève...
Il avait compté sans la trahison. Le lendemain matin Ognianov fut appelé au konak.
Il entra chez le bey qu’il trouva fort sombre.
– Consul-efendi, dit-il, hier au soir vous avez chanté des chansons révolutionnaires. Est-ce vrai ?
Ognianov protesta.
– Jamais !
– L’onbachi me l’a affirmé.
– Il est mal informé. Vous-même vous étiez dans la salle.
Le bey fit venir l’onbachi :
– Chérif-aga, à quel moment a-t-on chanté ces chansons, en ma présence ou après ?
– C’est devant vous qu’on a chanté des chants révolutionnaires, bey-efendi. Kiriak Steftchov ne me démentirait pas.
– Qu’est-ce que tu me chantes là, chérif-aga ? Est-ce Kiriak qui était présent ou bien moi ? N’ai-je pas entendu de mes propres oreilles ? Le tchorbadji Damiantcho ne m’a-t-il pas traduit la chanson mot à mot ? J’en ai parlé hier au soir avec le tchorbadji Marko. Lui aussi a trouvé l’air très beau... Une autre fois, ne faites pas de telles bêtises, gronda sévèrement le bey. Enfin, se tournant vers Ognianov : – Consul, excuse de t’avoir dérangé. Il y a eu erreur. Mais, dis donc, comment s’appelait celui-là qui portait les fers ?
– Golo.
– C’est cela, Golo ! Il fallait le faire pendre. C’est comme cela que j’aurais agi. Tu n’aurais pas dû écouter les raisons d’une femme. Mais c’était beau quand même et la chanson encore plus belle, fit le bey en se levant avec peine.
Ognianov le salua et sortit.
« Tu entendras bientôt une tout autre chanson et celle-là tu la comprendras sans le secours de Damiantcho », se dit-il en sortant.
Il n’avait pas remarqué le regard sinistre que lui lança l’onbachi.
18 AU CAFÉ DE GANKO
Quelques jours après, le café de Ganko était de très bonne heure bondé de monde, plein de bruit et de fumée. C’était le lieu de rendez-vous des vieux et des jeunes, on y discutait les questions communales, la question d’Orient et toute la politique intérieure et extérieure de l’Europe... un petit Parlement. Pour le moment, la représentation de Geneviève était encore à l’ordre du jour et alimentait toutes les conversations. D’ailleurs, cette représentation allait les occuper encore longtemps, et l’on devait en garder une profonde impression.
On parlait aussi beaucoup du chant révolutionnaire, qui suscitait les plus vives discussions. Maintenant, en y réfléchissant avec sang-froid, plusieurs personnes blâmaient Ognianov qu’on affublait désormais du surnom de « comte », ainsi qu’il advient à tous les acteurs-amateurs dont le jeu a vivement impressionné le public ; il en fut de même avec M. Fratiou, qui resta « Golo ». Ce matin-là encore il fut étonné de rencontrer le regard malveillant de quelques vieillards respectables qui ne pouvaient pas lui pardonner sa conduite envers Geneviève. Une vieille femme l’interpella même dans la rue :
– Voyons, jeune homme, pourquoi as-tu fait ça ? N’as-tu pas peur de Dieu ?
Mais l’entrée du tchorbadji Mitcho Beïzédéto dans le café replaça les conversations dans le domaine illimité de la politique.
Le tchorbadji Mitcho Beïzédéto était un petit homme âgé, noiraud, portant le pantalon bouffant et le pourpoint de drap. Comme tous les hommes de sa génération, il était peu instruit, mais la vie et de multiples épreuves lui avaient fait acquérir de l’expérience et du jugement. Ses yeux noirs, vifs et mobiles, brillaient sur son visage sec et labouré de rides profondes. Sa singularité, qui l’avait rendu très populaire parmi ses concitoyens, était son extrême passion pour la politique et sa conviction inébranlable de la chute imminente de la Turquie. Naturellement il était russophile jusqu’au fanatisme, jusqu’au ridicule même. Tout le monde se souvenait que, lors d’un examen, il s’était mis en colère parce qu’un élève avait dit que la Russie avait été vaincue à Sébastopol.
– Tu te trompes, petit, la Russie ne peut être vaincue ; tu devrais réclamer ton argent à l’instituteur qui t’a donné des leçons, avait dit le tchorbadji Mitcho, fâché.
Mais comme l’instituteur, qui se trouvait là, prouva sur-le-champ, le manuel d’histoire en main, que la Russie avait été battue pendant la guerre de Crimée, Mitcho s’emporta et déclara que le manuel d’histoire mentait ; comme il était membre de la commission scolaire, il s’opposa carrément à ce que ledit instituteur fût nommé pour l’année suivante.
Nerveux par nature et prompt à la riposte, il se fâchait chaque fois que l’on osait le contredire dans ses chères convictions. Alors il s’emportait, criait et insultait. Aujourd’hui cependant, il était de bonne humeur et, en s’asseyant, il dit sur un ton de triomphe :
– Ils ont été de nouveau battus, les Turcs.
– Comment cela ? demandèrent avec étonnement plusieurs voix.
– Lubobratitch et Bojo Petrovitch ont massacré quelques milliers de Turcs, dit Mitcho qui lâchait la nouvelle par petits morceaux, pour faire durer le plaisir.
– Bravo ! Que Dieu les bénisse ! crièrent quelques voix.
– Et Podgoritsa est prise, continuait le tchorbadji Mitcho.
L’étonnement était à son comble, comme si c’était Vienne qui était prise et non Podgoritsa.
– Des armes, des volontaires viennent d’Autriche.
– Pas possible !
– La Bosnie est de nouveau en flammes. La Serbie bouge et prépare des troupes. Et dès que la Serbie se mettra en marche, elle nous entraînera avec elle. Il est fichu, le Turc...
– Que le diable l’emporte !
– L’Autriche ne bougera pas, car Gortchakov de Pétersbourg lui dira : « Halte-là ! laisse-les faire, s’ils se battent ou s’ils s’égorgent, c’est leur affaire à eux ! » Ils sont fichus, fichus les Turcs !...
Tout le monde dressait l’oreille et écoutait avec reconnaissance les bonnes nouvelles que donnait le tchorbadji Mitcho.
– Combien de Turcs a-t-on tués ? demanda Nicodime.
– Combien ? Je l’ai déjà dit : des milliers, si tu disais deux, cinq ou dix mille, tu ne te tromperais pas.
– Ah ! ces braves Herzégoviniens ne plaisantent pas.
– C’est très bien si c’est vrai !
– Je te dis que c’est vrai !
– D’où le sais-tu ? demanda le tchorbadji Marko.
– Je le tiens de source sûre, voyons. C’est Guéorgui Izmirliev qui l’a appris de quelqu’un de K..., que c’était écrit dans le journal de Trieste Clio.
– Je ne crois pas que les Herzégoviniens puissent faire grand-chose... Ils finiront par se fatiguer. Combien sont-ils ? Une poignée ! dit Pavlaki, cherchant l’approbation dans les yeux des autres.
– Je dis la même chose, Pavlaki, combien sont-ils les Herzégoviniens ? Une poignée ! La Turquie ne les craint pas, remarqua hadji Smion, en caressant la chaussette de son pied gauche.
Le tchorbadji Mitcho répondit, tout hérissé :
– Toi, Pavlaki, et toi, hadji Smion, je vous demande pardon, vous ne vous y connaissez pas... En politique, il suffit parfois d’un rien. Gortchakov lui-même a dit que c’est d’Herzégovine que jaillira l’étincelle qui embrasera l’empire ottoman tout entier.
– Je crois que c’est Derby qui l’a dit, remarqua Fratiou d’un air grave.
Le tchorbadji Mitcho fronça les sourcils.
– Derby est un Anglais et il ne peut pas tenir des propos contre le Sultan... Je connais la politique anglaise : « Tout est bon en Turquie, tout prospère en Turquie. » Je te dis que Derby ne peut pas dire de telles paroles.
– Non, non, Derby n’a pas dit ça, confirma hadji Smion.
– Pourvu que l’incendie éclate et brûle Constantinople ! Comme ça nous nous débarrasserons une fois pour toutes de ces mécréants ! dit Ivantcho Doudito, cordonnier de son métier, qui, à vrai dire, était novice en matière de politique.
– On parle ici d’un tout autre Incendie, Ivantcho, remarqua Pavlaki avec beaucoup de sérieux.
– Le véritable Incendie éclatera lorsque s’enflammera la Bulgarie, remarqua M. Fratiou.
– Pourquoi faut-il que la Bulgarie s’enflamme ? Je ne le veux pas. Il faut nous tenir tranquilles, voilà tout. Vous avez entendu quelle pagaye cela a fait l’autre jour à Stara-Zagora ? répondit d’un air sombre le tchorbadji Dimo.
– Toi, Fratiou, tu parles à ton aise, dit Dantcho le boulanger, car, lorsque l’incendie éclatera, tu te sauveras en Roumanie, et c’est de là que tu crieras : « En avant ! » tandis qu’ici on nous cassera la tête à nous autres. Ne m’en parle pas, moi je m’y connais.
– Au contraire, je serai ici et je ferai les sacrifices qu’il faudra.
– Si cela flambe, que ce soit le plus tôt possible. Quel État pitoyable que la Turquie ! Le feu y couve, bien qu’il n’y ait pas de fumée. On nous a écorchés... Nous n’osons plus mettre le nez hors de la ville ! Un État, ça ? du fumier.
– Ne vous en faites pas, cela ne tardera pas, dit le tchorbadji Mitcho. Il est écrit que la Turquie tombera bientôt.
– La Turquie est un État entièrement pourri, un squelette, rien de plus. À la moindre secousse, il s’écroulera, fit un autre.
– Si nous ne la secouons pas, nous serons des imbéciles ! dit le pope Dimtcho avec ardeur.
– Ça, oui ! dit le pope Stavri. Il y a de l’orage dans l’air. Tout le monde ne parle que de cela, même les femmes et les enfants. Avez-vous entendu les chansons qu’ils chantent ? Plus de soupirs, rien que le cliquetis des fusils et des sabres... « Mon cœur bat, levez-vous pour combattre les Turcs ! » et d’autres chants semblables ! Les jeunes passent leur temps dans la prairie du couvent : pan ! pan ! avec les fusils, toute la journée. C’est même dangereux pour les passants. Mon fils, l’instituteur, a ramassé je ne sais où un tas de fusils et de pistolets, et dès qu’il lâche les enfants, il rentre à la maison et passe son temps à tripoter ses engins. Je lui demande : « Pourquoi cette pacotille ? » Et il me fait : « Nous en aurons bientôt besoin, papa. Le temps n’est pas loin où un pistolet, même détraqué, se vendra au poids de l’or. » Entre nous soit dit, le feu est près du baril de poudre et il en sortira quelque chose, Dieu nous garde !
Les paroles sincères et simples du pope Stavri étaient vraies. Depuis quelques mois ou, plus exactement, depuis l’apparition d’Ognianov, comme l’avait remarqué aussi Steftchov, une certaine effervescence gagnait les esprits et s’amplifiait chaque jour, surtout après le mouvement insurrectionnel de Stara-Zagora en septembre. Aux festins, en portait des toasts patriotiques et on parlait ouvertement d’insurrection ; du matin au soir les environs du couvent retentissaient des coups de fusil des jeunes qui s’y exerçaient. Les chants révolutionnaires étaient à la mode et pénétraient partout : de la maison et des veillées, ils gagnaient allégrement les rues ; partout les hymnes patriotiques supplantaient les fades chansons d’amour. On s’étonnait d’entendre les jeunes filles chanter aux veillées :
Ô ma mère, triste mère !
Ne pleure pas, mère, ne te lamente pas
De ce que je suis devenu haïdouk,
Haïdouk, mère, révolutionnaire !
ou des mères honorables chanter avec ardeur à leurs enfants :
Courage, bataillons de braves,
Nous ne sommes plus des serfs obéissants !
Mais ce n’étaient que des cris platoniques auxquels les Turcs faisaient la sourde oreille, parce qu’ils les méprisaient. Cependant, après le soulèvement de Stara-Zagora, la population turque s’inquiéta, puis se fâcha, et sa fureur se manifesta par une suite de crimes sanglants. Aux coups de fusil tirés sur les pentes dénudées, les Turcs répondaient par des balles qui déchiraient la chair bulgare ; aux chants séditieux des femmes bulgares, ils répondaient en violant leurs sœurs ou en égorgeant leurs frères. Les Turcs multipliaient les atrocités, massacraient les voyageurs inoffensifs, pillaient et bridaient les maisons, partageant le butin avec les gendarmes. Toute la Thrace retentit bientôt de cris d’horreur.
Marko Ivanov était d’accord avec le tchorbadji Mitcho sur bien des questions. Mais il avait une tout autre opinion au sujet de l’insurrection. Pour lui, c’était une folie que d’y penser. Certes, il aimait et protégeait Boïtcho Ognianov, mais cela ne l’empêchait pas de le gronder sévèrement chaque fois qu’il l’entendait parler de révolte armée.
– Je ne m’étonne pas qu’il y ait des chasseurs de chimères qui s’en vont tirer des coups de fusil dans la prairie du couvent et qui rêvent de coups d’éclat ; ce qui me dépasse c’est que des gens aux cheveux blancs nourrissent les mêmes idées insensées... Nous jouons avec le feu ! Comment voulez-vous qu’un empire vieux de cinq cents ans, et qui faisait trembler le monde entier, s’écroule sous les coups de quelques blancs-becs armés de fusils à silex ? Tenez ! hier j’ai rencontré dans la rue mon fils Vassil emportant mon fusil vers le monastère – lui aussi veut renverser la Turquie... Et chaque fois que je lui dis de tuer un poulet, il va dans la rue demander ce service à un autre : il a peur de voir une goutte de sang. « Va-t’en à la maison ! espèce de cinglé, que je lui dis ; tuer des Turcs, toi ! Laisse à Dieu le soin de tuer ! Ici nous sommes dans l’enfer ! Une révolte ? Dieu nous en préserve ! Cela nous jetterait dans l’abîme... Il ne resterait pas pierre sur pierre de notre pays... »
Le cafetier Ganko approuva :
– Baï Marko a raison. L’insurrection serait un abîme pour nous, un abîme où nous péririons.
Et le cafetier regarda le plafond où des traits tracés à la craie, s’alignant comme des régiments, marquaient le crédit des clients.
Les paroles de Marko contrarièrent le tchorbadji Mitcho.
– Marko, dit-il, tes paroles sont sages, mais il y a chez nous des gens plus sages que nous et qui ont prévu ce qui doit arriver. De toute façon, la Turquie n’en a plus pour longtemps.
– Je ne crois pas à vos prophètes, répondit Marko, visant Martin Zadek 71 auquel croyait pieusement le tchorbadji Mitcho. Je ne crois pas aux prophéties de ton Zadek, je ne croirais même pas le roi Salomon, s’il venait me dire que nous pouvons faire quelque chose. Je ne veux pas d’enfantillages !
– Dis donc, Marko, mais si c’est Dieu qui le veut ? remarqua le pope Stavri.
– Dieu veut que nous nous tenions tranquilles. S’il a décidé de faire périr la Turquie, ce n’est pas nous qu’il chargera de cela, morveux que nous sommes !
– On sait dès maintenant qui en sera chargé, voyons, dit Pavlaki.
– Le grand-père Ivan 72 ! le grand-père Ivan ! dirent plusieurs voix.
Un air de satisfaction éclaira le visage du tchorbadji Mitcho. Il reprit vivement :
– Je vous dis que ce n’est pas à moi qu’il faut en parler. Je sais très bien que nous marcherons en avant et le grand-père Ivan nous suivra de près avec son gourdin... jusqu’à Sainte-Sophie. Sans son approbation, ça ne va pas. Lubobratitch lui-même n’aurait pas pu massacrer des milliers de ces canailles s’il ne s’appuyait pas sur son dos solide. Mais je veux dire que les jours de l’empire turc sont comptés, comme ceux d’un poitrinaire. C’est écrit noir sur blanc, je n’invente rien. Écoutez, vous qui n’y croyez pas : « Constantinople, capitale du Sultan, sera prise sans la moindre effusion de sang. L’État turc sera ruiné, la famine et la mort décimeront les Turcs qui périront lamentablement. » Et ailleurs il est dit : « Vos mosquées seront renversées, vos idoles et votre Coran seront détruits. Toi, Mahomet, l’antéchrist d’Orient, ton heure a sonné, ta tombe sera incendiée et tes os seront dispersés... »
Dans son ardeur le tchorbadji Mitcho s’était levé et fendait l’air de son bras.
– Mais quand arrivera tout cela ? demanda le pope Stavri
– Je vous le dis : bientôt, l’heure de la Turquie a sonné !
Au même instant la porte s’ouvrit et Nikolai Nedkovitch entra. Il tenait dans sa main le journal le Siècle qu’il venait de recevoir.
– Nikolaï, est-ce que c’est le dernier numéro ? demandèrent plusieurs voix. Lis donc !
– Dis-nous combien de têtes a fait tomber Lubobratitch, insistèrent d’autres parmi les plus impatients.
– Des milliers, je vous dis ! Viens t’asseoir ici, Nikolaï ! dit le tchorbadji Mitcho en lui désignant la place à côté de lui.
Nikolaï Nedkovitch déplia le journal.
– Lis tout d’abord ce qu’on écrit sur l’insurrection d’Herzégovine ! ordonna le tchorbadji Mitcho.
Nedkovitch commença à lire au milieu d’un silence solennel, tout le monde dressant l’oreille. Mais la nouvelle de la victoire annoncée par Clio n’était pas confirmée. Au contraire, les communiqués du champ de bataille étaient mauvais : Podgoritsa n’avait pas été prise, le dernier bataillon de Lubobratitch était battu à plates coutures et lui-même s’était réfugié en Autriche.
Tous allongeaient le nez ; sur tous les visages, on lisait le dépit et le chagrin. Nikolaï Nedkovitch lui-même avait l’air désemparé. Sa voix s’enroua et faiblit. Subitement inondé de sueur, Mitcho Beïzédéto, pâle et tremblant de rage, s’écria :
– Ce sont des mensonges ! Rien que des mensonges ! Le journal a beau nous conter des sornettes ! Lubobratitch les a rudement battus, il les a écrasés !... Ne croyez pas un mot de ce que dit ce journal !
– Mais, baï Mitcho, observa Nedkovitch, ces télégrammes sont tirés de divers journaux européens. Il doit y avoir là, quand même, un grain de vérité.
– Des mensonges ! Des mensonges turcs, forgés à Constantinople ! C’est Clio qu’il te faut lire !
– Moi, je n’y crois pas non plus, dit hadji Smion, les journalistes mentent comme des tziganes. Je me rappelle qu’en Moldavie il y avait un journal qui ne publiait que des mensonges.
– Des nouvelles montées de toutes pièces, quoi !
– Je vous l’ai bien dit, il faut lire les communiqué turcs à l’envers : s’ils annoncent cent Herzégoviniens de tués, tu dois être sûr que ce sont des Turcs, tu peux même dire mille, sans craindre de te tromper.
Les paroles du tchorbadji Mitcho calmèrent quelque peu les esprits. Elles étaient convaincantes car elles répondaient au désir intime de chacun : les communiqué étaient faux, parce que mauvais ; on ne devait plus croire le journal. Mais lorsque le même journal avait annoncé les succès de Lubobratitch, personne n’avait eu l’idée d’en suspecter l’authenticité. Malgré tout, les nouvelles de ce jour-là troublèrent l’esprit des clients du café. Les conversations qui suivirent furent ternes, on était mal à l’aise. Mitcho lui-même ne se sentait pas dans son assiette. Il était en colère contre lui-même, il en voulait au journal et au monde entier de ce que la nouvelle du Clio n’eût pas été confirmée. Aussi fut-il pris d’une rage subite quand, d’un ton ironique, Petraki Chyïkov dit au milieu du silence général :
– Comme on le voit, baï Mitcho, ton étincelle herzégovinienne restera une étincelle et rien de plus... Écoute ce que je te dis : la Turquie se portera bien cette année encore, et l’année prochaine aussi et dans cent ans, tandis que nous nous laisserons bercer de tes prophéties jusqu’à notre mort.
– Tais-toi, Chylkov, criait Mitcho, enragé, tu n’as pas assez de cervelle pour comprendre ça. Les ânes comme toi seront toujours sourds et aveugles.
Une querelle s’ensuivit. Mais l’apparition de Steftchov y mit fin, en même temps qu’à la conversation subversive au sujet de la chute de la Turquie.
19 ÉCHOS
Le silence se rétablit : la présence de Steftchov gênait les assistants. Il prit place, serra quelques mains et prêta l’oreille d’un air avantageux ; il croyait que la conversation interrompue concernait les factums contre Ognianov et Sokolov qui avaient été répandus en grand nombre, la nuit dernière, par la ville ; mais personne n’en souffla mot, soit qu’on les ignorât, soit qu’on n’eût que dédain pour eux.
Le tchorbadji Mitcho quitta le café, fâché. Quelques clients le suivirent. Là-dessus entrèrent Ognianov et Sokolov. Ils s’asseyaient à peine quand hadji Smion s’adressa au premier :
– Comte, tu ne joueras pas une nouvelle comédie pour Noël ?
– Geneviève n’était pas une comédie, mais une tragédie, remarqua M. Fratiou ; on appelle comédie une représentation amusante, comique ; on appelle cette représentation, tragédie, quand il y a des scènes tragiques et des pleurs... La pièce qu’on a jouée était une tragédie... mon rôle était tragique...
– Je sais, je sais, j’en ai vu un tas à Bucarest ! Ah ! tu as très bien joué le fou ! Que Dieu te préserve, Fratiou ! je me suis dit : c’est un vrai fou celui-là !... Tes cheveux y étaient pour quelque chose, évidemment ! dit hadji Smion, complimenteur.
Ivantcho Iotata, qui venait d’entrer, prit part à la conversation.
– Vous parlez de théâtre ? dit-il. Il y a deux ans, j’ai vu un théâtre à K... où l’on jouait... je ne me rappelle pas ce que c’était... Ah oui ! c’était Ivan le haïdouk 73.
– Ivanko l’assassin 74, rectifia M. Fratiou.
– Oui, c’est ça... l’assassin, mais cette représentation-là avait été plus douce... Après Geneviève, ma femme Lala a déliré toute la nuit ; elle criait à tue-tête : « Golo ! Golo ! » et elle tremblait de peur.
M. Fratiou, flatté de ces louanges, prit un air digne.
– Ah oui ? Voilà pourquoi je dis au comte de nous donner encore une comédie. Cela fera du bien, crois-moi ! Seulement la chanson ne doit pas être la même ! dit hadji Smion, et il commença à fouiller ses poches, inquiet du blâme qu’indirectement il venait de donner.
– Geneviève n’est pas une comédie mais une tragédie, remarqua sévèrement de nouveau M. Fratiou.
– Oui, oui, une tragédie, c’est-à-dire du théâtre.
– Mais non, c’était une comédie puisqu’elle faisait rire, dit Steftchov en souriant méchamment.
Ognianov interrompit sa conversation avec Sokolov et dit :
– J’ai peur, hadji Smion, d’être de nouveau blâmé.
Steftchov leva les yeux du journal qu’il était en train de lire.
– Qui te blâmera, toi ? personne ne peut te blâmer ! murmura le père Nistor. Tu dois jouer encore une fois Geneviève, les enfants en parlent toujours. La première fois ma fille Penka avait la fièvre et ne pouvait pas venir. Maintenant, elle ne fait que répéter : « Papa, je veux voir Geneviève, je veux la voir, papa ! »
– C’est bien, père Nistor, mais je crains le sifflet, dit Ognianov en fixant Steftchov.
– Surtout quand c’est un sifflet ramassé dans le fumier, ajouta Sokolov d’un ton mordant.
Steftchov rougit de colère, mais il continua à lire le journal. Il se sentait mal à l’aise sous le regard méprisant d’Ognianov qu’il redoutait ; en effet, les yeux de l’instituteur brillaient en ce moment d’un éclat farouche.
– Moi je dis comme toi, père Nistor, fit Tchono Doïtchinov, je veux revoir Geneviève... Seulement Golo doit être joué par Kiriak Steftchov, ce rôle lui va très bien. Fratiou est un peu compliqué, mais c’est un brave type et c’est injuste de l’avoir insulté.
Ce compliment aussi venimeux que naïf fit rougir violemment Steftchov. Fratiou, lui, en fut vexé.
Ognianov et Sokolov sourirent. Hadji Smion en fit autant, sans savoir pourquoi.
Steftchov leva les yeux et jeta un regard furieux à Ognianov et à Sokolov. Il dit, gardant en apparence du sang-froid mais la voix tremblante de rage :
– Oui, j’espère bien qu’Ognianov de Lozengrad nous donnera bientôt une tragédie. Il peut être sûr que personne n’y rira, lui moins que les autres.
Steftchov appuya sur le mot de Lozengrad (Ognianov avait dit qu’il y était né). Ognianov s’en aperçut et son visage changea de couleur, mais il répondit avec fermeté :
– Du moment que derrière le rideau se tiennent des machinistes, je veux dire des espions, aussi adroits que Steftchov, il ne serait pas étonnant qu’il y eût de la tragédie.
Et il lui jeta un regard de mépris. À ce moment Sokolov tira son ami par la manche et lui dit à l’oreille :
– Laisse-le, pour qu’il n’empuantisse plus l’air !
– Je ne peux pas supporter les lâches ! dit Ognianov à voix assez haute pour être entendu par Steftchov.
À ce moment, Boïtcho aperçut Mountcho à la porte du café, qui était ouverte. L’idiot fixait ses yeux sur Ognianov, hochait la tête et lui souriait amicalement. Mountcho avait l’air si gentil, si bon enfant, si heureux ! Boïtcho avait déjà remarqué que Mountcho le regardait avec attendrissement, mais il ne pouvait deviner la cause de cette sympathie. Lorsque leurs regards se croisèrent, la physionomie de Mountcho s’éclaira d’un sourire encore plus heureux, ses yeux brillèrent d’une extase incompréhensible et stupide ; il tendit la tête, les yeux toujours fixés sur Ognianov et, ricanant de tous les muscles de sa figure, il s’écria :
– Rus-si-an !... Et il mit le doigt à son cou en l’agitant de manière à exprimer l’action d’égorger quelqu’un.
Tous les assistants le regardaient, perplexes.
Le plus perplexe était Ognianov : ce n’était pas la première fois que Mountcho lui faisait de tels signes.
– Comte, que te dit Mountcho ? lui demandèrent plusieurs voix.
– Je ne sais pas, répondit Ognianov souriant, il m’aime beaucoup.
Mountcho comprit, semble-t-il, leur perplexité et pour leur expliquer mieux son admiration pour Ognianov, il regarda tout le monde d’un air solennellement stupide puis, désignant du doigt Ognianov, il s’écria encore plus fort :
– Rus-si-an !... et, tendant le bras vers le nord, il commença à scier plus énergiquement encore son cou avec l’index.
Cette répétition troubla Ognianov. L’idée subite lui vint que, par un enchaînement fatal de circonstances, Mountcho avait entrevu ou deviné le meurtre commis au moulin de l’oncle Stoïan. Inquiet, il regarda Steftchov, mais se ressaisit aussitôt car celui-ci avait tourné le dos et chuchotait avec un client sans faire attention à Mountcho ; au même instant, d’ailleurs, il se leva, écarta Mountcho de la porte et sortit en jetant à Ognianov un regard haineux et vindicatif.
Steftchov bouillait de rage. Son amour-propre avait essuyé bien des coups de la part d’Ognianov, sans qu’il trouvât l’occasion de se venger. Il voulait se venger, mais de façon dissimulée, car il redoutait d’entrer en lutte ouverte avec Boïtcho. Le chant révolutionnaire au théâtre lui avait fourni une arme contre Ognianov mais, ainsi nous l’avons vu, cette fois encore sa faux avait buté sur une pierre : le bey n’avait pas voulu admettre qu’Ognianov eût chanté en sa présence un chant révolutionnaire ; il avait désavoué Steftchov. Celui-ci eut la prudence de ne pas insister, mais il se consola grâce à une révélation : trois jours avant, il avait appris à K..., par un habitant de Lozengrad, que, dans cette ville, il n’y avait pas plus de Boïtcho que d’Ognianov. Ce fut un éclair qui devait le mener à de nouvelles découvertes. Sans doute derrière le nom de Boïtcho Ognianov se cachait une autre personne, pour une raison qui ne pouvait pas être fortuite. Cet homme fréquentait le Dr Sokolov, depuis longtemps connu comme un esprit rebelle. Sans doute quelque chose les liait, mais quoi ? Il ne voyait pas encore très clair. Pourtant, peu à peu, en passant d’une considération à l’autre, Steftchov eut l’impression qu’Ognianov n’était pas étranger à cet incident de la rue Petkantchova qui, aujourd’hui encore, restait un mystère pour lui. C’était précisément à cette époque-là qu’Ognianov était apparu dans la ville et que cette forte effervescence à laquelle lui-même était resté hostile avait commencé à gagner les esprits. Steftchov décida de percer ces ténèbres, et il s’y attacha avec la ténacité et la passion que la haine peut donner à une âme envieuse et méchante.
Malheureusement, de nouveaux et sinistres évènements vinrent l’aider dans sa lutte sournoise contre Ognianov.
20 INQUIÉTUDES
Des nuées orageuses parurent donc au-dessus de la tête d’Ognianov, mais il ne s’en douta pour ainsi dire pas. Les six mois qu’il avait passés sans accident à Biala-Tcherkva lui avaient donné un aplomb allant jusqu’à l’insouciance. Absorbé par des préoccupations d’une tout autre nature, il lui restait peu de temps pour penser à cette bagatelle : sa sécurité personnelle, car, de tous les sentiments, celui de la peur était le moins développé chez lui. Ajoutons que son amour pour Rada était un prisme lumineux et multicolore qui s’interposait entre lui et le monde.
Pourtant il n’était pas tout à fait tranquille ; en sortant du café, il dit au docteur :
– Qu’en penses-tu ? Y a-t-il quelque chose de sérieux dans ces menaces de Steftchov ?
– Steftchov te garde une dent et s’il pouvait te faire du mal, ce lâche qu’il est, il l’aurait déjà fait et ne se serait pas contenté de quelques intrigues.
– Et ce Mountcho ? Que signifient ses grimaces ? Il commence à m’inquiéter.
Le docteur pouffa de rire :
– Ne fais pas l’enfant, voyons !
– Tu as raison, cela ne mérite aucune attention, mais Steftchov, c’est autre chose. Se pourrait-il qu’il sache quelque chose ?
– Que peut-il savoir ? Probablement, sœur Rovoama lui aura lâché un canard à notre sujet. Tu sais que c’est une bavarde qui ne peut se passer de faire des cancans.
– Ah ! c’est une sorcière dangereuse qui peut flairer ce qu’un autre doit voir ou entendre. Elle est le mentor de Steftchov et le tyran de Rada...
– Tu te souviens qu’elle avait fait courir le bruit que tu étais un espion ! Tu vois bien qu’elle ne fait que jaser.
– Oui, mais elle avait dit de toi une chose qui était vraie. D’ailleurs, elle est surtout habile en intrigues qui regardent les femmes. Mais sais-tu que demain auront lieu les fiançailles de Steftchov ?
Le visage du docteur changea de couleur :
– Avec Lalka ?
– Oui, avec elle.
– D’où le sais-tu ?
– Rada l’a appris. Hadji Rovoama est la marieuse, naturellement. Les témoins sont hadji Smion, cet inévitable caméléon, et Alafranga.
Le docteur ne put dissimuler son émotion. Il pressa le pas. Ognianov le regarda, étonné :
– Tu ne m’avais pas dit, docteur, que ton cœur n’était pas libre.
– J’aime Lalka, répondit Sokolov d’un air sombre.
– Le sait-elle ?
– Elle m’aime aussi... ou pour mieux dire, je lui plais davantage que Steftchov, mais je ne crois pas qu’il y ait chez elle un sentiment plus profond. (Et une rougeur subite monta au visage du docteur.)
– Eh bien, mon vieux ! pour ton bonheur ou pour ton malheur, ce sentiment chez Lalka est plus profond que tu ne le penses, j’en suis sûr, dit Ognianov en regardant son ami avec sympathie.
– De qui le tiens-tu ?
– De Rada. Elles sont amies, tu le sais. Lalka lui fait ses confidences. Tu n’as pas idée combien de larmes elle a versées quand on t’a emmené à K... et quelle a été sa joie quand on t’a relâché. Rada a vu tout cela.
– C’est une enfant innocente, dit le docteur sourdement ; si on la livre à cet individu-là, elle en mourra !
– Pourquoi ne l’as-tu pas demandée en mariage jus qu’à présent ?
Le docteur le regarda, surpris :
– Voyons, tu sais bien que son père ne veut pas me voir !
– Alors, tu n’as qu’à l’enlever.
– Maintenant que nous préparons l’insurrection et qu’elle peut éclater dans deux ans ou demain ! Qui le sait ? Je ne veux pas penser au mariage en ces temps troublés ; ce serait péché que d’entraîner cette jeune fille dans le malheur.
– Tu as raison, fit Ognianov pensif. C’est ce qui m’empêche d’épouser Rada. J’aurais épargné à cette malheureuse orpheline tant de déboires ; je l’aurais rendue si heureuse... Rada est un cœur magnifique, mon ami, mais elle se perd en liant son sort au mien. Pauvre Rada !
Le front d’Ognianov s’assombrit.
Le docteur ne se rendait pas un compte exact des sentiments qu’il éprouvait pour Lalka. Les temps troublés ne l’auraient pas empêché de l’épouser : le véritable amour se joue des périls et des obstacles. S’il éprouvait une certaine affection pour la fille du tchorbadji Iordan, ce sentiment était encore trop frêle ; ce n’était pas une passion mais plutôt une sympathie fortuite et sans racines profondes. Son tempérament, sa vie volage et joyeuse le rendaient incapable de s’attacher passionnément à un seul objet. Son cœur se partageait entre la femme du bey – si l’on ajoutait foi à la rumeur publique – puis Cléopâtre et puis Lalka et puis la révolution, et qui sait quoi encore ? Mais en apprenant par Ognianov les sentiments de Lalka et, en même temps, le malheur qui la guettait, il sentit son cœur serré par une douleur et une angoisse subites. Il lui sembla qu’il avait toujours été épris de Lalka et qu’il ne pourrait pas vivre sans elle. Était-ce un effet de l’égoïsme si profondément ancré dans la nature humaine, était-ce une passion sincère, on n’aurait pu le dire mais, en vérité, il se sentait écrasé à la pensée de perdre à jamais Lalka. Comment ajourner ces fiançailles Comment anéantir ce rival ? Comment sauver Lalka ? Autant de questions qui le tourmentaient et qu’on pouvait lire très clairement sur son visage assombri et douloureux.
Ognianov le comprit. Le tourment du docteur et le sort de Lalka l’émouvaient également.
– Je le provoquerai en duel, ce salaud ! Je dois le tuer, autrement c’est lui qui nous tuera ! déclara-t-il tout d’un coup.
Les deux amis firent quelques pas, puis Ognianov s’arrêta d’un air décidé :
– Veux-tu que j’aille lui dire de se tenir tranquille et que je lui donne une gifle en plein café ?
– Il l’avalerait comme les autres... C’est un personnage ignoble ; cela ne servirait à rien.
– Au moins, je le déshonorerais.
– Une gifle ne déshonore pas, aux yeux de Iordan Diamandiev.
– Mais il le sera aux yeux de la jeune fille, elle l’apprendra !
– Elle n’a pas voix au chapitre, et puis Lalka respecte la volonté de son père, répondit mélancoliquement le docteur, et il tendit la main à Ognianov : Adieu !
– Comment, tu t’en vas ? Ce soir on ira chez le pope Stavri, n’est-ce pas ?
– Je n’en ai pas envie, vas-y seul.
– Impossible. Il faut y aller, puisque nous avons donné notre parole. Le pope Stavri est une tête bourrue, mais il a le cœur honnête... Et puis, nous réfléchirons à tout cela...
– Bon, je t’attends chez moi.
Et les deux amis se séparèrent.
Ognianov se rendit à l’école. Dans la chambre des maîtres, il n’y avait que Merdévendjiev, plongé dans un livre turc. Ognianov ne le salua pas. Il avait pris, dès le début, en aversion ce jeune homme qui se promenait le psautier sous un bras et un livre turc sous l’autre : deux certificats probants de l’état de son esprit. La lettre à Rada avait mué ce sentiment en une répulsion qui devenait plus violente à la vue des manières obséquieuses du chantre devant Steftchov. Ognianov arpentait vivement la pièce en laissant s’échapper de sa cigarette de longues bouffées de fumée ; encore sous l’empire de la conversation avec le docteur, il ne prêtait aucune attention à la figure engourdie du chantre penché sur son livre. Mais Ognianov aperçut sur la table le dernier numéro du journal le Danube, le seul exemplaire qu’on recevait en ville, celui de Merdévendjiev, qui en était l’abonné à cause des articles publiés en langue turque. Il jeta un coup d’œil distrait sur les colonnes en langue bulgare et allait abandonner la feuille, quand son attention fut attirée par un titre en gros caractères. Il lut et resta stupéfait :
UN ÉVADÉ DE DIARBÉKIR
« Ivan Kralitch, né à Vidine, région du Danube, 28 ans, de grande taille, yeux noirs, cheveux bouclés, teint brun ; condamné à l’exil perpétuel au fort de Diarbékir, pour avoir participé aux émeutes de 1868, s’est évadé au mois de mars de cette année, puis est rentré dans l’empire de Sa Majesté Impériale. Il est recherché par les autorités qui ont reçu les instructions nécessaires. Les sujets fidèles sont tenus, sous peine de poursuites judiciaires, à dénoncer ou à livrer, dès qu’ils le découvriront, ledit criminel évadé aux autorités légales, afin qu’il soit traité selon les justes lois impériales. »
Malgré toute sa force de volonté, Ognianov ne put garder son sang-froid. Son visage changea de couleur, ses lèvres pâlirent. La surprise était trop forte. Il jeta un rapide coup d’œil sur Merdévendjiev. Le chantre, sans changer d’attitude, était toujours penché sur son livre. Probablement, il n’avait rien vu de l’émotion d’Ognianov, pas plus qu’il n’avait fait attention au petit article qui n’avait guère d’intérêt pour un lecteur ordinaire. Sur cette supposition rassurante, Ognianov reprit son sang-froid. Tout de suite il eut l’idée de supprimer le journal compromettant.
Ravalant son aversion pour le chantre, il se fit violence pour lui adresser la parole :
– Monsieur Merdévendjiev, dit-il tranquillement, si vous avez lu le journal, laissez-le-moi, s’il vous plaît ; je le parcourrai chez moi. Sa chronique est très intéressante.
– Je ne l’ai pas lu, mais vous pouvez l’emporter ! dit le chantre nonchalamment, et il se replongea dans sa lecture.
Ognianov sortit avec le numéro du sinistre Danube, le seul exemplaire qu’on recevait à Biala-Tcherkva.
21 INTRIGUES
Kiriak Steftchov déserta, lui aussi, ce jour-là, le café, ce champ de bataille, mais avec l’intention d’y revenir pour se jeter avec plus de violence sur son adversaire.
Sa haine, attisée par ce qu’il apprenait, étouffa dans son âme le peu de sentiments d’honnêteté qui y subsistaient, étouffés dans l’ivraie des bas instincts.
Lors de la rencontre au café, il eut pour la première fois l’idée d’anéantir son ennemi en le dénonçant. Pour y arriver il avait suffisamment de preuves et de moyens. Ses petites intrigues, les calomnies qu’il semait ne servaient à rien ; au contraire, Ognianov les brisait facilement et grandissait encore aux yeux du public : l’intervention des spectateurs lors de la représentation de Geneviève en était la preuve. S’il s’était agi de Mikhalaki Alafranga, Steftchov aurait accompli sa trahison en toute tranquillité comme s’il s’agissait d’un acte de bonté, mais malgré toute sa perversion, il sentait la bassesse de ce qu’il allait faire. Il n’avait pas la force de reculer : il brûlait de se venger, et il se résolut à la trahison.
« Non, ce vagabond ne s’appelle pas Ognianov et il n’est pas né à Lozengrad ; de plus, c’est bien lui que la patrouille a poursuivi rue Petkantchova et les papiers révolutionnaires lui appartenaient. Le Dr Sokolov devait, en effet, avoir été chez la femme du bey, ce soir-là. Hadji Rovoama a raison, et le pandour Filiou m’a aussi fait une allusion... C’est elle qui a subtilisé les papiers. Comment ? je ne le sais pas. Troisièmement... mais cela nous le saurons bientôt, c’est le plus terrible et qui lui vaudra la corde au lieu de Diarbékir ! Ah ! je vais, ce vaurien, l’anéantir ! »
Kiriak se dirigeait vers le couvent où il avait donné rendez-vous à Merdévendjiev.
– Tu as raison, ma sœur ! dit-il en entrant.
– Dieu te bénisse, Kiriak ! Et moi qui croyais avoir dévié quelque peu du bon chemin ! dit-elle, amusée, et voyant de quoi il s’agissait. Qu’y a-t-il ? Tu es tout essoufflé.
– Je viens de me disputer avec Ognianov.
– Ah, le maudit ! Il a tourné la tête à cette niaise de Rada ! dit la sœur en colère. Il lui fait apprendre je ne sais quelles chansons révolutionnaires. Quelle peste ! Les vieilles femmes même en chantent ! Ces êtres-là viennent pour réformer le monde par le sang et par le feu ! Les uns passent leur vie à travailler comme des fourmis en se saignant aux quatre veines, et les autres mettent tout en cendres en un instant. Tas de vauriens et de morveux ! Notre Rada en est ! Sainte Vierge ! Demain elle fera comme Christine : elle recevra des révolutionnaires et sera la risée des tziganes. Tiens, l’autre jour encore, on a chanté des saletés au théâtre. Les Turcs dorment-ils ? bon sang !
– Je me suis disputé sérieusement avec Ognianov, j’ai décidé de l’anéantir, dit Steftchov d’un ton bourru ; et, jugeant mal à propos de se fier à une religieuse bavarde, il ajouta : C’est-à-dire que c’est la police qui agira. Silence seulement, ma sœur !
– Je crois que tu me connais...
– Oui, c’est pour cela que je dis : silence !
On entendit des pas dans le corridor. Steftchov regarda par la fenêtre et dit, joyeux :
– Merdévendjiev vient ! Eh bien ? demanda-t-il au chantre qui entra en courant.
– Le renard est pris au piège, dit Merdévendjiev, enlevant son cache-nez.
– Comment ? l’a-t-il laissé voir ?
– Il est devenu pâle et il a tressailli.
– Qu’a-t-il dit ?
– Il m’a demandé d’emporter le journal..., ce qu’il fait pour la première fois, car, jusqu’à présent, il méprisait mon journal, comme il me méprise.
Steftchov se leva et battit des mains avec joie.
– Qu’y a-t-il ? demanda sœur Rovoama.
– N’a-t-il pas flairé le piège ?
– Pas le moins du monde. Je faisais semblant de lire et de ne rien voir, mais j’ai tout vu. L’ours dort, mais il a les oreilles aux aguets, ajouta Merdévendjiev avec fierté.
– Bravo, Merdéven ! Et tes petites notes sur notre homme étaient écrites de main de maître. Tu pourrais faire un bon rédacteur de journal !
– Oui, mais je ne m’oublie pas : tu seras gentil d’agir en ma faveur pour la place qui va être vacante.
– Sois tranquille !
Le chantre remercia en faisant des gestes à la turque.
– Je voudrais bien aussi attraper ce Popov. Il vous toise de haut en bas, et c’est un chien fidèle de Kralitch.
– Qu’est-ce que c’est que ce Kralitch ? demanda sœur Rovoama tout étonnée d’entendre parler de quelqu’un qu’elle ne connaissait pas.
Absorbé par ses pensées, Steftchov regardait d’un air distrait par la fenêtre, sans lui répondre.
– À propos, tu sais qu’hier les membres de la commission scolaire sont venus à l’école, dit Merdévendjiev.
– Lesquels ?
– Tous... Mikhalaki a proposé de mettre à la porte Ognianov... Mais tous les autres ont pris sa défense, surtout Marko Ivanov... On lui a fait seulement une observation au sujet du chant révolutionnaire au théâtre. En un mot : on n’a rien fait.
– Baï Marko est très tendre pour ce Kralitch, mais un jour il s’en repentira. Pourquoi se mêle-t-il de cela cet imbécile ?
– Et Mitcho ?
– Baï Mitcho est, lui aussi, pour Ognianov.
– Évidemment... Les loups ne se mangent pas entre eux. Ce Mitcho dit du mal du gouvernement à chaque instant, comme Marko dit du mal de sa religion.
– Ils se valent tous, fit hadji Rovoama.
– Et Grigor ? Et Pinkov ?
– Ils nagent aussi dans les eaux de Marko et de Mitcho.
– Quand le diable y serait, je fermerai leur école ! Seuls les hiboux et les chouettes y nicheront ! s’écria Steftchov furieux, marchant de long en large.
– Très bien ! Comme cela nous serons tranquilles. C’est de ces écoles que nous viennent tous les chants pervers et séditieux, intervint hadji Rovoama. Mais enfin, Kiriak, dis-moi, qui est-ce, ce Kralitch ?
– Kralitch ? C’est le futur roitelet de la Bulgarie, répondit ironiquement Steftchov.
Là-dessus Merdévendjiev prit son fez et ouvrit la porte.
– N’oublie pas mon affaire, Kiriak ! supplia Merdévendjiev en sortant ; le pauvre chantre croyait qu’il ne s’agissait que du licenciement d’Ognianov qu’il remplacerait.
– Il n’en sera que ce qu’il te plaira, répondit Steftchov.
Ce dernier resta encore un moment pour s’entretenir avec hadji Rovoama d’un autre évènement important : ses fiançailles avec Lalka, puis, au déclin du jour, il se dirigea vers le konak. Dans la rue, il rencontra Mikhalaki Alafranga.
– Où vas-tu comme ça ? lui demanda ce dernier.
– Sais-tu que le Danube arrache tout à fait le masque d’Ognianov ? Il y est tout entier. C’est un évadé de Diarbékir que l’on recherche partout. Je jure que c’est lui, sous un faux nom.
– Que dis-tu là, Kiriak ? C’est un homme dangereux qui causera la perte de gens tout à fait innocents. J’ai bien fait hier de proposer qu’on le mette à la porte ; ce n’est pas un homme pour nous... Mais, où vas-tu ? Il faut le dire au bey, pour qu’il prenne des mesures.
– Ce n’est pas mon affaire. Le journal est à Merdévendjiev et c’est lui qui est au courant, dit le rusé Steftchov, qui ne voulait en aucune façon être suspecté de trahison, les soupçons devant peser sur le chantre.
– Va informer le bey, tu feras du bien au peuple, répéta Mikhalaki aussi naturellement et aussi simplement que s’il avait annoncé à Steftchov qu’au marché on avait apporté du poisson. Demain, avec hadji Smion nous allons chez le tchorbadji Iordan. Je te félicite dès maintenant C’est chose faite !
Et Mikhalaki lui serra la main.
– Merci, merci !
Il faisait déjà sombre. Steftchov continua son chemin en fredonnant en turc une chanson d’amour. Il se rendait au konak.
22 CHEZ LE POPE STAVRI
La nuit était tombée quand Sokolov et Ognianov prirent le chemin de la maison du pope Stavri.
Celle-ci était presque au bout de la ville. Les deux amis traversèrent quelques rues sombres sans mot dire. Tous les deux marchaient absorbés dans leurs réflexions. Ognianov avait détruit le seul numéro du journal le Danube arrivé en ville et ce geste l’avait quelque peu apaisé. Depuis lors il ne remarquait rien d’insolite dans l’attitude de Merdévendjiev. Il faut le dire, Ognianov était devenu téméraire jusqu’à la folie, ce qui est le cas de tous ceux dont le péril est devenu l’élément naturel. Pourtant, un léger nuage d’incertitude troublait son âme. Sokolov, bien entendu, était plus soucieux.
Le va-et-vient diminuait dans les rues à mesure que nos amis s’éloignaient du centre de la ville. Les rues, étroites et tortueuses, devenaient silencieuses et désertes. Seuls des aboiements de chiens se faisaient entendre plus souvent.
– Tiens, qu’y a-t-il là-bas ? fit le docteur en montrant une ombre d’homme collée au mur.
Au même instant l’inconnu détalait :
– Il a eu peur, ce monsieur ! Si on lui courait après pour lui demander pourquoi il n’accepte pas qu’on lui dise bonjour ? dit Ognianov, et il se mit à sa poursuite.
Le docteur, très préoccupé, n’était pas tout d’abord disposé à prendre un pareil exercice, mais il se mit à courir aussi.
L’inconnu se sauvait à toutes jambes. Ce devait être un homme louche ou qui croyait avoir rencontré des gens louches. Bientôt il prit les devants car, si la témérité donne des ailes aux épaules, la peur les attache aux jambes. Enfin, les deux amis s’aperçurent qu’ils couraient en vain : l’inconnu s’était glissé dans une porte et l’on n’entendait plus aucun bruit. Ognianov et Sokolov éclatèrent de rire.
– Pourquoi avons-nous couru après ce pauvre diable ? demanda le docteur.
– Je le soupçonnais d’être un agent de Steftchov, un de ceux qui sèment le soir de petits papiers diffamatoires. J’aimerais attraper un de ces individus-là.
Sokolov continuait à marcher, pensif.
– Docteur, où vas-tu de ce pas ? La maison du pope, c’est ici ! cria Ognianov, et il frappa à la porte.
La porte s’ouvrit et dans l’embrasure, se dressa la sombre figure du pope.
– « Frappez et il vous sera ouvert ! » Entrez, mon cher docteur et toi, comte ! dit le pope Stavri, joyeux.
Comme nous l’avons dit, on avait donné à Ognianov le nom de son rôle. – Le bey, lui, l’appelait consul. – La sympathie que l’époux de Geneviève avait suscitée au théâtre s’était communiquée à Ognianov et, dans la rue, les enfants lui couraient après en criant : « Le comte ! le comte » et se laissaient caresser sur les joues. Au début, Stavri avait un peu grogné contre lui, mais, depuis la représentation, Steftchov avait perdu un allié en la personne du pope.
Un air de flûte partait de la chambre du premier, qui donnait sur la véranda. Le pope introduisit les deux invités dans le salon où ils trouvèrent Kandov, Nikolaï Nedkovitch, l’aveugle Koltcho et d’autres. Le fils du pope, ami d’Ognianov, apporta de l’eau-de-vie et du mésé 75. La flûte s’était tue.
– Continue donc, Koltcho, dit Nedkovitch.
Koltcho prit la flûte et joua avec maîtrise quelques airs européens.
– Versez de l’eau-de-vie et servez-moi du mésé pour ajuster la flûte, vous m’avez oublié ! dit-il.
– Tu fais bien, Koltcho. « Quiconque demande reçoit », dit le pope.
Ognianov offrit un verre à l’aveugle. Celui-ci lui toucha la main et dit :
– Baï Ognianov, n’est-ce pas ?... Merci ! Les autres vous appellent comte, moi je ne le puis car un rien m’a empêché de vous voir au théâtre.
Les invités sourirent.
– Koltcho, chante-nous le cantique des religieuses ! fit Ognianov, le sourire aux lèvres.
L’aveugle prit un air solennel, toussa et entonna les litanies, imitant le vieux chantre hadji Athanassi.
– Seigneur, bénis soient tes fidèles : la pieuse Séraphima et la douce Chérubine, la brune Sofia et la blonde Ripsimie, la grosse Madeleine et la mince Irina ; la belle Enokha – soleil du couvent – la sœur Parachkéva ; la docile Ève et hadji Rovoama, sœur sans reproche...
Koltcho passait en revue toutes les religieuses, en leur appliquant les épithètes les plus opposées à leurs véritables qualités. Les invités riaient.
– Allons, mettons-nous à table ! Laissez en paix les pieuses femmes, gronda plaisamment la femme du pope Stavri.
On prit place autour de la table.
Le pope Stavri dit le bénédicité et les invités se mirent à faire honneur au repas. Seul, Sokolov ne paraissait pas à son aise. Une carafe gigantesque pleine d’un vin couleur d’ambre était placée devant le pope Stavri, qui faisait couler le liquide à droite et à gauche.
– « Le vin réjouit le cœur et fortifie le corps de l’homme ! » dit le pope en remplissant les verres. Bois donc, comte ! Nikoltcho, tire comme il faut ! Kandov, vas-y d’un trait, tu es un Russe ! Docteur, bois ferme, mon ami, ce n’est pas une drogue, c’est un don de Dieu ! Koltcho, bois, mon fils, puis tu nous chanteras une chanson roumaine.
C’est par ces injonctions que le pope, fort en train, excitait et étanchait la soif de ses invités. Et les verres se croisaient, se rencontraient, se choquaient et semblaient danser le quadrille.
Après le souper, les conversations prirent un tour plus animé et plus varié. On parla naturellement de Geneviève et du « sifflet » de Steftchov, que le pope Stavri condamna sans appel. Ognianov ramena adroitement la conversation sur un terrain moins dangereux : les crus de l’année. Le pope Stavri était là dans son élément, comme le poisson dans l’eau, et il énuméra par le menu les vertus des vins de tous les vignobles. Il plaçait tel vin au-dessus du champagne.
– Il chauffe comme le soleil, luit comme l’or ; jaune comme de l’ambre, il vous pique au vif. Le prophète David en but et rajeunit... L’homme qui en boit dix gouttes devient philosophe ; cinquante gouttes lui font croire qu’il est roi ; cent gouttes le changent en saint ! disait le pope Stavri, avec une verve qui aurait fait venir l’eau à la bouche d’un ermite.
Et il poussa un cri de satisfaction qui fit s’éteindre la bougie.
– Allez, rallumez ! dit-il.
– Pope Stavri, dit Koltcho, chez toi il y a trois choses : pope, bougeoir et bougie, mais moi je n’en vois pas une, à vrai dire.
– Et chez toi, qu’y a-t-il, mon fils ?
– Chez moi, il y a : Koltcho, va-nu-pieds et aveugle !
Les conversations ne tarissaient pas. Soudain, une chanson se fit entendre dans la rue. C’était, sans doute, un gamin ayant un peu de voix qui la chantait :
Qui t’a acheté ton collier,
Jolie Milka Todorkina,
Ton collier d’argent ?
Kiriak me l’a acheté
Pour ma gorge blanche,
Je le porterai, lui regardera.
Qui t’a acheté ta jupe,
Jolie Milka Todorkina,
Ta jupe en toile de soie ?
Kiriak me l’a achetée
Pour ma taille mince,
Je la porterai, lui regardera.
La chanson s’éloigna dans les rues sombres. Elle amena la conversation sur Milka Todoritchkina, une voisine du pope Stavri. Milka, une jolie fille un peu légère, était l’objet de potins qui couraient la ville. Sa mauvaise réputation commença à s’enfler, et les commères bavardes en faisaient des gorges chaudes. Bientôt on lança une chanson sur Milka ; les voisins étaient mécontents. Ils ne voulaient pas de cette tentation dans leur voisinage. Rien n’est si contagieux que le mauvais exemple ! On donnait le conseil à son père et à sa mère de la marier à Ratcho Lilov, le chaudronnier, qui était épris d’elle, mais les parents de ce dernier ne voulaient pas en entendre parler Qui donnerait son enfant à une telle fille ?
– Au fond, je ne comprends pas pourquoi le chaudronnier Lilov ne veut pas qu’on lui en parle ? disait la femme du pope. Avec qui veut-il marier son goitreux de Ratchko ? Voudrait-il la fille d’un tchorbadji ou d’un boyard 76 ? Après tout, il n’y a pas grand mal si Milka s’est trompée par bêtise, elle deviendra plus sage avec le temps. Qu’ils se marient s’ils s’aiment ! Qu’ils vivent dans l’amour et dans l’entente comme le veut le bon Dieu. De quoi cela a l’air, à présent !
– Il n’y a pas à dire, la fille est légère mais, tout de même, on ne la laisse pas tranquille. Tout ce qu’il y a de polissons lui court après, des chansons parlent d’elle. Que faire ? Les gens font un lion d’une fourmi ; rien d’étonnant si Milka a une mauvaise réputation. J’ai bien dit à son père : qu’il enferme ce chenapan de Ratchko quand il est chez lui, qu’on les marie en vitesse et tout sera dit ! La bénédiction couvre tout.
– Mais on disait avant que c’était le fils du tchorbadji Steftchov qui allait épouser Milka, dit une invitée, il est vrai que la petite n’avait pas encore perdu son honneur.
– On a parlé de beaucoup d’autres. Finalement, la fille a pris mauvaise réputation, fit une autre invitée.
– Mais savez-vous que Kiriak Steftchov se fiance avec Lalka Iordanova ? dit une troisième.
On eût dit que ces paroles transperçaient Sokolov.
– Pas bête, Steftchov, il a l’œil fixé sur les grosses fortunes, remarqua le pope Stavri.
– Milka aime-t-elle Ratchko ? demanda Ognianov, pour changer de conversation.
– Puisque je vous le dis. Il se rend en secret chez la jeune fille. Tous les deux s’aiment, quoi !! Il ne faut pas laisser traîner l’affaire. Qu’on les marie et tout le monde sera tranquille. Seigneur Jésus ! à combien de tentations ne sommes-nous pas exposés !... Et demain, c’est la Saint-André. Gantcho, verse du vin, on a la gorge sèche. Anka, Mikhaltcho, allez vous coucher, mes petits, il est tard.
Les enfants se levèrent et s’éloignèrent, l’air mécontent : les histoires de Milka Todoritchkina les intéressaient.
– D’après moi, il faut la laisser libre, cette Milka ; pourquoi la forcer à se marier coûte que coûte ? fit Kandov.
Le pope Stavri dévisagea Kandov.
– Comment ne pas se marier ? demanda-t-il, perplexe.
– Il faut la laisser libre, car elle a aussi ses droits, dit gravement l’étudiant.
– Qu’entendez-vous par là ? Est-ce qu’il faut la laisser jeter son bonnet par-dessus les moulins ? Expliquez-vous.
– Vous avez des vues bizarres sur les droits des hommes, remarqua Nikolaï Nedkovitch.
– Du moment qu’elle ne gêne pas la liberté d’autrui, elle peut vivre comme bon lui semble, cela ne fait de mal à personne ! expliqua Kandov.
– Et si elle faisait la cocotte, cela ne ferait-il de mal à personne ? demanda le pope.
Kandov le regarda, tout étonné :
– C’est là une question de principe, répondit-il gravement. Les idées de notre siècle libéral visent à émanciper la femme de sa dépendance servile de l’homme, héritage des époques barbares.
– Et après ? À quoi ça rime ? demanda le pope qui n’y comprenait rien.
Kandov se tourna vers Ognianov et Nedkovitch :
– La science contemporaine reconnaît à la femme des facultés et des droits égaux à ceux de l’homme. Jusqu’à présent elle a été victime d’une série de préjugés stupides qui enchaînaient sa volonté ; elle a gémi sous le poids de servitudes humiliantes qui lui ont été imposées par la tyrannie ou par les instincts bestiaux de l’homme. Une pyramide d’institutions et d’ordonnances a été édifiée pour l’entraver à chaque instant dans la vie !
Kandov parlait avec conviction. C’était un cœur honnête, mais, à force d’avaler pêle-mêle toutes les utopies de divers doctrinaires socialistes, il avait fini par confondre les vérités et les erreurs. Les mots sonores et les phrases bien tournées avaient pour lui plus de crédit que la réalité de la vie ; frappé par leur nouveauté il les répétait pour se faire valoir. En réalité, Kandov souffrait de l’idéalisme morbide du milieu où il avait longtemps vécu, il lui suffirait de rester un certain temps en Bulgarie pour se dégriser.
– Eh ! que signifient, dites-moi, continua l’étudiant, ces mots grandiloquents : chasteté, mariage, fidélité conjugale, obligations maternelles et autres absurdités ? Ils couvrent purement et simplement l’exploitation de la faiblesse féminine.
– Il parle comme un livre ! murmura le pope.
– Monsieur Kandov, riposta Nedkovitch, il n’est pas d’homme sensé qui ne sympathise avec les idées que vous avez exprimées au début. Mais vous faites un saut périlleux et vous tombez dans des extrémités insensées. Vous arrivez à rejeter non seulement les lois de l’homme, mais celles de la nature, Vous sapez les fondements éternels de la société humaine. Qu’adviendrait-il si nous abolissions le mariage, la famille, la mère, et si nous privions la femme de sa haute destinée ?
Le pope Stavri avait enfin compris : il fronça les sourcils.
– Je demande l’émancipation de la femme, dit Kandov.
– Pardon, vous voulez sa dégradation ! fit Ognianov.
– Monsieur Ognianov, avez-vous lu les philosophes qui ont traité de la question féminine ? Je vous conseille de le faire.
– Et toi, mon cher Kandov, as-tu lu l’Évangile ? demanda le pope Stavri.
– Je l’ai lu... dans le temps.
– Connais-tu l’endroit où il est dit : « Femmes, soyez soumises à vos maris ! » Et plus loin : « C’est pour cela que l’homme quittera son père et sa mère pour s’attacher à sa femme 77 ! »
– Je me fonde uniquement sur la science positive, mon père !
– Et la science du bon Dieu n’est-elle pas la plus positive ? demanda le pope d’un air fâché. Toi, mon petit Kandov, tu dois te débarrasser de ces idées protestantes. Le mariage est un sacrement solennel. Peut-on s’en passer, mon fils ? À quoi serviraient l’église, la religion, les prêtres, si les gens pouvaient se multiplier comme des cochons, sans bénédiction ?
La porte s’ouvrit et Gantcho entra. Il dit :
– Il y a chez Milka un vacarme effroyable.
– Qu’y a-t-il ?
– Je ne sais pas très bien, répondit Gantcho en bégayant, mais je crois que Ratchko y est enfermé. Tout le quartier est rassemblé là.
– Si c’est Ratchko, je sais ce que cela va donner, lit le pope Stavri. Allons voir, mes enfants. Peut-être y aura-t-on besoin de votre pope... Rien ne peut se faire sans la bénédiction du pope, quoi qu’en dise le petit Kandov ! J’en sais plus long que lui !
23 UN AUTRE TOMBE DANS LE PIÈGE
La porte du pope Stavri s’ouvrait non loin de celle de Milka Todoritchkina. Dans la cour exiguë, devant l’escalier, plusieurs voix se faisaient entendre ; autour, la foule et le brouhaha augmentaient d’un moment à l’autre ; des voisins curieux grossissaient la cohue où deux ou trois lanternes jetaient une mince lumière : on essayait d’apercevoir, par la fenêtre, les amants enfermés. Le père de Milka criait, sa mère caquetait et se démenait comme une poule couveuse effarouchée. Le père de Ratchko arriva, se fraya un passage à travers la foule et essaya d’enfoncer la porte pour délivrer son fils, mais quelques robustes bras le refoulèrent.
– Quelle est cette tyrannie, voyons ! s’écria-t-il, et il fonça de nouveau sur la porte.
– Baï Lilov, reste tranquille ! lui cria un voisin, tu vois bien où l’on en est.
– Mon enfant ! glapissait la mère de Ratchko. Je ne donne pas mon fils à cette traînée, à cette coureuse !
Et elle fondait comme un épervier sur ceux qui lui barraient le chemin.
– Une traînée ! Une coureuse ! cria une voix rude. Alors, Ratchko, que cherche-t-il chez elle ? Nous arrangerons cela selon l’usage !
– Que voulez-vous faire ? Allez-vous le pendre ? Est-ce qu’il a tué quelqu’un ?
Et la mère ébouriffée, l’air féroce, se jeta de nouveau sur la porte.
– On va les marier comme il convient.
– Je ne la veux pas, cette sorcière !
– Ton fils la veut, et c’est lui que nous allons marier.
La mère, désespérée, ne savait plus où donner de la tête ; elle sentait que le jugement de la foule la dominait. Elle continuait à se lamenter :
– Mon enfant est perdu ! Ma vie est brisée ! La peste soit de cette coquine qui emberlificota mon enfant !
Le bruit s’enflait avec la foule.
– Bénédiction ! Bénédiction !
– « Tout miracle ne dure que trois jours, après on n’en parle plus 78 », criait l’un.
– C’est le moment d’en finir une fois pour toutes ! disait un autre.
– Il a trouvé ce qu’il cherchait, ajoutait un troisième.
– Voyons, est-ce que c’est elle qui l’a appelé ?
– Le gars la veut, parbleu !
– Alors, pourquoi tant de bruit ?
– On attend quelqu’un du konak pour ouvrir.
– Voilà, l’onbachi arrive.
En effet, le chérif-aga, accompagné de deux zaptiés, se frayait un passage dans la multitude.
– Il faut les marier ici, tout de suite ! hurla une voix,
– Mais non, d’abord on les mènera aux bains publics, musique en tête ! riposta Gantcho l’Araignée.
– Pas besoin de se déranger, sapristi ! On n’a qu’à les marier ici, sans façon. Après cela, ils nous offriront un verre de vin, dit Nistor Frakaltzéto.
– A-t-on appelé le pope ?
– Il est ici ! répondit le pope Stavri, et il se glissa avec ses invités au milieu de la foule. Ne vous inquiétez pas, votre pope connaît la loi chrétienne ! – Gantcho, va me chercher le rabat et le missel !
À ce moment la porte s’ouvrit.
– Allez, sortez ! cria l’onbachi.
– Milka, Ratchko, sortez ! crièrent d’autres voix.
On s’empressait autour de l’onbachi. Tout le monde tendait le cou pour entrevoir le garçon et la fille, comme si on ne les avait jamais vus. Les lanternes levées au-dessus des têtes éclairaient la porte grande ouverte. Tout d’abord apparut Milka ; honteuse, bouleversée, elle n’osait lever les yeux, ne répondait même pas aux paroles, d’ailleurs incompréhensibles, de sa mère. Une seule fois elle leva la tête et regarda d’un air effaré – elle était encore plus jolie ainsi – et d’emblée la sympathie des voisins lui revint ; sa jeunesse et sa beauté désarmèrent bientôt la foule houleuse. Sur plusieurs visages, on lisait le pardon.
– Elle fera une belle mariée ! fit quelqu’un.
– L’affaire s’arrangera très bien !... Que Dieu les bénisse ! fit Nistor Frakaltzéto.
Le pope Stavri se tenait près de la porte. Il était entouré de ses invités dont quelques-uns ne connaissaient pas le garçon.
– Ratchko, sors, toi aussi ! cria le pope Stavri, scrutant par la porte l’obscurité de la chambre.
– Ne te gêne pas, mon gars, sors ! disait un autre. On va vous pardonner tout et le pope vous bénira pour les siècles des siècles.
Kandov s’adressa à ses amis :
– Position embarrassante ! dit-il doucement. Dans des moments pareils on vieillit d’une dizaine d’années.
– Coutume populaire qui ne manque pas d’originalité, fit Nedkovitch. Il y a deux semaines on a marié de cette manière deux autres amants.
– Cela sent un peu la violence ! remarqua Ognianov.
Le jeune homme n’apparaissait toujours pas.
– Il est dedans, n’est-ce pas ? Alors, pourquoi ne sort-il pas ? demanda le pope Stavri à Milka.
Elle fit un signe affirmatif de la tête et jeta un coup d’œil étonné vers la porte.
L’onbachi eut un mouvement d’impatience :
– Eh, toi, là-bas, sors !
D’autres voix appelèrent Ratchko. La foule poussait. Sa curiosité était aussi intense que lorsqu’on attend au théâtre le lever du rideau : ici, le rideau était levé, on n’attendait que le héros et celui-ci n’apparaissait pas.
Alors l’onbachi entra et la foule s’engouffra après lui. Dans un coin se tenait un jeune homme, immobile.
Mais ce n’était pas Ratchko le chaudronnier.
C’était Steftchov.
Tous restèrent figés. L’onbachi recula. Il n’en croyait pas ses yeux. Les autres non plus. Le pope Stavri laissa tomber son rabat. Ses amis échangèrent des regards stupéfaits. Sokolov fixa un regard haineux, triomphant, sur son rival, un sourire malveillant dérida son visage, il se délectait au spectacle de ce déshonneur accablant. Steftchov, écrasé sous tant de regards, honteux, perdu, anéanti, était devenu méconnaissable. Il lançait des regards timides autour de lui. Un murmure porta son nom au loin : « Steftchov ! Steftchov ! » Il avait l’air d’un homme qui voudrait disparaître sous terre.
Comment Steftchov se trouvait-il là ? Par la fatalité !
Ce soir-là, quand il s’était séparé de Mikhalaki Alafranga, il avait poursuivi son chemin vers le konak. Mais, lorsqu’il y fut arrivé, il s’arrêta devant la porte, tout troublé. Si ténébreuse et endurcie que fût son âme, le sentiment patriotique se réveilla en lui et s’insurgea. Effrayé de sa démarche, il la remit au lendemain, pensant l’accomplir alors avec plus d’audace. Il passa donc outre et se dirigea vers la maison d’un de ses parents, au bout de la ville, mais, ne trouvant pas ce dernier chez lui, il retourna sur ses pas. C’est alors que, dans l’obscurité, il rencontra le docteur et Ognianov, qu’il reconnut d’instinct. Il s’enfuit, saisi par une frayeur folle, car « qui se sent morveux se mouche ». Cherchant partout refuge, et passant devant la porte de Milka Todoritchkina, il la poussa machinalement, entra et se blottit dans les hautes herbes. Il y resta assez longtemps, puis il n’entendit plus aucun bruit dans la rue. Une femme traversa la cour et monta l’escalier. Steftchov reconnut Milka. C’était lui qui, le premier, avait séduit Milka, puis, quelque temps après, il l’avait abandonnée. Une chute en entraîne une autre ; ainsi Milka glissa sur la pente qui la menait irrésistiblement vers l’abîme.
Or, justement, ce jour-là, veille de ses fiançailles, Steftchov s’était rappelé avec une certaine appréhension qu’il y avait chez Milka quelques lettres de lui avec lesquelles elle pourrait lui susciter des ennuis quand elle apprendrait ses fiançailles, et quelqu’un de ses ennemis pourrait facilement exciter l’irritation de la jeune fille. Puisqu’il était là, il décida de reprendre, s’il le pouvait, dès ce soir, ces papiers compromettants. Il monta donc l’escalier à pas de loup et entra chez son ancienne maîtresse.
Mais tous ses mouvements avaient été observés par le père de Milka qui attendait l’arrivée de Ratchko pour le traiter d’après les conseils de ses voisins. Dans l’obscurité, il avait pris Steftchov pour Ratchko le chaudronnier et l’enferma chez sa fille. Puis il appela vite ses plus proches voisins, lesquels furent bientôt suivis par tout le quartier.
L’onbachi sut tout de suite à quoi s’en tenir.
– Allez, videz les lieux ! Je demanderai des explications à ce monsieur au konak ! cria-t-il rudement à la foule, puis il prit Steftchov par la main.
– Non ! Non ! pas au konak ! Il faut en finir ici ! criait quelqu’un qui n’avait pas encore compris.
– C’est Steftchov, voyons ! dirent plusieurs voix.
– Steftchov ? Par exemple !
Le bruit augmentait.
– Qu’est-ce que ça peut faire si c’est le fils d’un tchorbadji ? Il faut le traiter comme si c’était Ratchko. Il n’est pas plus qu’un autre, lui !
– Oui, oui, marions-les ! criait un autre.
– Mais il n’est pas pour cette fille, voyons ! dit une voix bienveillante.
– Et qu’est-ce qu’il cherche chez elle pendant la nuit ? Les riches peuvent-ils se jouer de l’honneur d’autrui ? La loi est-elle seulement pour les pauvres ?
Des voix s’élevèrent encore en faveur de Steftchov.
– Au bain ! Au bain ! criait toujours Gantcho l’Araignée.
Ognianov dit tout bas à l’onbachi :
– Chérif-aga, emmène au plus vite ce monsieur ; tant de monde le regarde... C’est humiliant pour lui !
Il avait oublié son ennemi et ne voyait en lui qu’une victime écrasée de honte : il ne pouvait pas supporter le spectacle de l’humiliation d’un homme.
L’onbachi regarda Ognianov d’un air méfiant.
– Laisse-le donc ! Qu’il rougisse ! fit Sokolov, vindicatif.
C’est à ce moment seulement que Steftchov aperçut ses deux ennemis. Il crut les voir sourire, il les crut les auteurs de son déshonneur. Une colère terrible s’empara de son âme. Il leur jeta un regard qui les aurait épouvantés s’ils l’avaient aperçu.
L’onbachi emmenait Steftchov.
– Écartez-vous, cria-t-il. Ce n’est plus votre affaire. Vous cherchiez Ratchko le chaudronnier. Allons, tchélébi !
La foule leur livra passage.
– Comment cela est-il arrivé ? lui demanda l’onbachi doucement et même avec compassion.
– Sokolov et Ognianov m’ont trahi, souffla Steftchov.
La foule s’ébranla derrière eux.
– Remettez-le-nous, celui-là, efendi, cette jeune fille est maintenant sur le pavé, il ne lui reste que la mort ! cria Ivan Séliamsas qui venait d’arriver.
Beaucoup protestaient avec lui, mais on en restait là.
– Pourquoi vous taisez-vous ? Élevez la voix, nom d’un chien ! criait Séliamsas d’une voix de tonnerre. Le fils de tchorbadji Steftchov vous a-t-il mis une prune dans la bouche ?
Séliamsas haïssait depuis longtemps Steftchov. Toutefois, son appel n’eut pas d’écho.
Pendant ce temps-là des voisins s’entassaient sur l’escalier où l’on jetait de l’eau à Milka, évanouie. La malheureuse fille n’avait pas pu supporter plus longtemps ces vives émotions qui la brisèrent pour toujours.
La foule se dispersa, mécontente.
24 DEUX PROVIDENCES
Le lendemain était jour de fête, le supérieur Natanaïl assistait à la messe du couvent. Il allait terminer un cantique qu’il chantait au lutrin quand quelqu’un le tira par le pan de son vêtement.
C’était Mountcho.
– Que veux-tu, Mountcho ? Allons, va-t’en ! gronda le supérieur, et il reprit son cantique.
Mais Mountcho serra fortement le coude du supérieur et ne le lâcha plus. Ce dernier se retourna de nouveau, saisi de colère, et vit que Mountcho était hors d’haleine ; ses yeux brillaient d’une frayeur étrange, tout son corps tremblait.
– Qu’y a-t-il, Mountcho ? demanda le supérieur d’un ton sévère.
Mountcho secoua effroyablement sa tête, écarquilla encore davantage ses yeux, se cabra et cria avec force :
– Rus-si-an !... près du moulin... Des Turcs !... et il fit le signe de creuser le sol.
D’abord le supérieur le regarda, ahuri, puis un éclair sinistre traversa soudain son esprit. Mountcho devait savoir ce qui était enterré près du moulin et puisqu’il avait nommé Russian, il devait connaître tout le mystère. Comment ? le supérieur l’ignorait. Il comprit seulement que ce secret était connu des autorités.
– Boïtcho est perdu !... murmura le père Natanaïl en détresse.
Il oubliait litanies et chants, il ne voyait pas le père Guédéon qui, près du lutrin d’en face, lui faisait des signes désespérés pour lui rappeler que c’était son tour de chanter. Il jeta un coup d’œil vers l’autel où le diacre Vikenti disait la messe, laissa le père Guédéon se débrouiller seul avec les litanies et sortit de l’église. En un clin d’œil, il gagna l’écurie, monta à cheval et se lança à bride abattue vers la ville.
Il faisait très froid ce matin-là et le vent soufflait par bourrasques. Pendant la nuit, la neige était tombée, saupoudrant de blanc les prairies et les branches des arbres. Le supérieur éperonnait impitoyablement les flancs de son cheval moreau qui laissait échapper par ses naseaux des nuages de vapeur. L’abbé savait que le bruit qu’il avait fait courir au sujet de la disparition des deux Turcs avait réussi à écarter tout soupçon. Alors, qui avait donné l’éveil à un chef de police inactif ? Il y avait sûrement trahison. Mais de qui ? il l’ignorait encore. Ne serait-ce pas Mountcho, si tant est qu’il sût tout ? Le supérieur ne le croyait pas : il savait que l’idiot vouait à Ognianov une adoration sans bornes. L’aurait-il dénoncé inconsciemment ? De toute façon il y avait trahison, une trahison lourde de terribles conséquences pour Ognianov.
Le supérieur mit quatre minutes au lieu de quinze pour aller en ville. Le cheval écumait ; il le laissa chez son frère en passant et se rendit à pied à la maison d’Ognianov.
– Boïtcho est-il chez lui ? demanda-t-il avec inquiétude.
– Il est sorti. Les zaptiés sont venus juste avant vous et l’ont cherché dans tous les coins. Que lui veulent-ils, les maudits ? On dirait qu’il a assassiné quelqu’un ! répondit le propriétaire furieux.
– Où est-il allé ?
– Je n’en sais rien.
– Ça va mal, mais il y a encore de l’espoir, se disait le supérieur et il se dirigea en courant vers la maison du docteur.
Il n’eut pas l’idée de chercher Ognianov à l’église, le sachant peu religieux, mais en passant devant le café de Ganko il y jeta un coup d’œil : Ognianov n’y était pas. « J’apprendrai de Sokolov où il est, si toutefois il n’est pas encore sous les verrous ! » se dit Natanaïl, traversant en trombe la cour de la maison du docteur.
– Y a-t-il quelqu’un chez vous, grand-mère ?
– Il n’y a personne, mon père, répondit la servante, et elle jeta le balai pour venir baiser la main du supérieur.
– Où est le docteur ? demanda-t-il, mécontent.
– Je ne sais pas, mon père ! répondit la femme, en bégayant, d’un air confus.
– Ah ! sacrebleu ! gémit le supérieur et il se dirigea vers là porte.
La servante courut derrière lui :
– Attends, attends, mon père !
– Qu’y a-t-il ? demanda-t-il avec impatience.
La bonne femme prit un air mystérieux et lui dit doucement :
– Il est là mais il se cache, car ces maudits Turcs sont venus le chercher, tout à l’heure !... Excusez-moi, mon père !
– Est-ce qu’il se cache de moi ? Pourquoi ne me l’as-pas dit tout de suite, bon sang ?
Et le supérieur traversa rapidement la cour, se dirigeant vers la porte que le docteur lui ouvrit aussitôt.
– Où est Boitcho ? fut son premier mot.
– Chez Rada..., qu’y a-t-il ?
Sokolov pressentait un malheur il était pâle.
– À cet instant même, on fouille près du moulin. Il y a trahison.
– Ah ! c’en est fait d’Ognianov ! s’écria le docteur désespéré. Il faut le prévenir tout de suite.
– On l’a cherché chez lui mais il n’y était pas, poursuivit le supérieur. J’arrive en coup de vent avec un cheval pour l’avertir le plus tôt possible. Mon Dieu, que va-t-il arriver à ce garçon ? Seigneur, préservez-le ! Mais où vas-tu comme ça ? demanda le supérieur, étonné.
– Je cours chez Boïtcho... Il faut le sauver, s’il n’est pas trop tard, fit le docteur en ouvrant la porte...
Le supérieur le regardait, consterné :
– Mais puisqu’on te recherche toi aussi ? Laisse-moi aller.
Le docteur fit un signe de sa main :
– Impossible. Ton apparition dans la chambre de Rada à cette heure-ci serait remarquée, ça ferait même jaser...
– Mais si tu leur tombes entre les mains ?
– N’importe. Je dois l’avertir coûte que coûte... Boïtcho court un grand danger. Je passerai par les rues les moins fréquentées.
Et Sokolov sortit en coup de vent.
Le supérieur le bénit, les larmes aux yeux.
Le docteur savait que, ce matin-là, Ognianov devait se trouver à l’école des jeunes filles où il avait rendez-vous avec le courrier du comité révolutionnaire de P... Il bondit dans la cour de l’école sans être aperçu des zaptiés et monta l’escalier de l’aile où habitait Rada. Il se précipita dans sa chambre comme un ouragan. L’apparition inattendue de Sokolov la surprit.
– Boïtcho est-il venu ici ? demanda Sokolov, hors d’haleine, sans dire bonjour.
– Il vient de sortir, fit Rada. Pourquoi es-tu si pâle ?
– Où est-il allé ?
– À l’église... Mais qu’y a-t-il ?
– À l’église ? s’écria Sokolov, et sans lui donner d’explications il ouvrit la porte, mais recula, terrifié : l’onbachi plaçait des sentinelles aux issues de l’édifice.
– Mais qu’est-ce que tu as, docteur ? s’écria la pauvre institutrice, pressentant un malheur.
Sokolov lui montra par la fenêtre les zaptiés devant l’église.
– Regarde ! On guette Boïtcho. Il a été trahi, Rada. On me recherche moi aussi... Quel malheur ! quel terrible malheur ! disait-il, en se prenant la tête entre les mains.
Rada s’affala sur le divan. De peur, son visage était devenu blanc comme du marbre.
Sokolov regardait par la fenêtre. Il ne pouvait plus se montrer devant les zaptiés. Aussi cherchait-il du regard un ami sûr qui pourrait avertir Ognianov du danger qui le guettait. En même temps il mesurait l’ampleur du péril.
Soudain il aperçut Fratiou qui passait sous la fenêtre et allait entrer à l’église.
– Fratiou, Fratiou ! appela le docteur doucement. Viens ici, je t’en prie !
Fratiou s’arrêta près de la fenêtre.
– Fratiou, tu vas à l’église, n’est-ce pas ?
– Oui, comme d’habitude ! répondit Fratiou.
– Je t’en prie, dis à Boïtcho que les zaptiés l’attendent à la porte, pour qu’il prenne ses précautions.
Fratiou jeta un regard inquiet vers l’église et vit qu’en effet les trois issues de l’église étaient gardées par des zaptiés. La peur défit aussitôt son mince visage.
– Feras-tu ma commission ? demanda avec impatience le docteur.
– Moi ?... Bien, je lui dirai, répondit le prudent Fratiou avec une visible hésitation... Et il ajouta d’un air méfiant : – Et toi, pourquoi n’y vas-tu pas, docteur ?
– La police me cherche moi aussi, chuchota-t-il.
Le visage de Fratiou se défit encore plus ; il s’empressa de s’éloigner de cet interlocuteur dangereux.
– Fratiou, plus vite, entends-tu ? insista Sokolov.
Fratiou feignit d’acquiescer, fit quelques pas et disparut dans le couvent des religieuses.
Le docteur s’arrachait les cheveux de désespoir. À cette minute il ne pensait pas à lui-même ; il ne se tourmentait que pour son ami : même si on l’avertissait maintenant, il ne pourrait échapper que par miracle aux griffes de la police, mais c’était la seule étincelle d’espoir qui restait.
En effet, il y avait eu dénonciation. La nuit dernière, Steftchov, mandé au konak, avait fait part au bey de tout ce qu’il avait appris et de ses soupçons sur l’identité d’Ognianov. Comme il parlait, un souvenir lui traversa l’esprit. Il se rappela le lévrier, dont l’onbachi lui avait cerné peu avant l’histoire. Steftchov, pas plus que l’onbachi, n’avait eu l’idée de chercher à pénétrer le sens de l’accès de fureur du chien contre Ognianov ou de son insistance à gratter le sol près du moulin. Que cherchait le chien ? Et pourquoi s’était-il acharné contre Ognianov ? Ne devait-on pas chercher de ce côté la clef du mystère de la disparition des deux Turcs, disparition qui d’ailleurs, coïncidait avec l’apparition d’Ognianov en ville ? Ognianov devait avoir trempé dans l’affaire, c’était sûr. L’esprit haineux de Steftchov rassembla tout cela avec la rapidité de l’éclair et le terrible soupçon s’affirma avec une évidence et une force irrésistibles.
Steftchov conseilla de creuser tout de suite près du moulin de l’oncle Stoïan. Le bey se mordit les lèvres et fit sur-le-champ le nécessaire. Il décida de faire arrêter Ognianov de bonne heure le matin ; il voulait éviter une arrestation de nuit, craignant que l’instituteur ne réussît à fuir et redoutant l’effusion de sang. Donc, dès le matin, on avait déterré les deux cadavres et la perte d’Ognianov avait été décidée. Maintenant, c’était une bête traquée. L’onbachi avait préféré le guetter aux issues de l’église plutôt que de l’appréhender dans l’édifice même, ce qui aurait mis la foule en émoi et acculé Ognianov à une défense désespérée. La surprise valait mieux.
Sokolov se désespérait, Rada était effondrée. On entendit des pas lourds dans l’escalier. Le docteur se ressaisit et prêta l’oreille. Les pas approchaient lentement, accompagnés des heurts d’un bâton et s’arrêtèrent devant la porte. Et une voix de chantre d’église entonna le fameux cantique de Koltcho :
– Seigneur, bénis soient tes fidèles : la pieuse Séraphima et la douce Chérubine, la brune Sofia et la blonde Ripsimie, la grosse Madeleine et la mince Irina ; la saur Rovoama – pourvu qu’elle n’y soit pas !
– Koltcho ! fit le docteur en ouvrant la porte.
L’aveugle entra allégrement. Il était partout le bienvenu.
– Tu viens de l’église, Koltcho ?
– Oui !...
– Y as-tu vu Ognianov ? demanda Sokolov anxieux.
– Je n’ai pas encore reçu mes lunettes d’Amérique, donc je ne l’ai pas vu. Mais je sais qu’il est dans une stalle à côté de Frangov.
– Plus de plaisanteries, Koltcho ! lui dit Sokolov rapidement. Ognianov est recherché par la police ; les zaptiés le guettent aux issues de l’église. Il n’en sait rien. Il est perdu si on ne l’avertit pas.
– J’y vais !
– Je t’en supplie, baï Koltcho ! fit Rada, qu’une lueur d’espérance ranimait.
– J’y serais allé moi-même, mais la police me recherche aussi. Toi, on te laissera passer, vas-y ! dit Sokolov.
– Je donnerais pour Ognianov ma triste vie s’il le fallait. Que faut-il lui dire ? demanda Koltcho d’un air ému.
– Dis-lui seulement ceci : « La police sait tout ; les zaptiés gardent les portes de l’église, sauve-toi, comme tu peux ! » Et le docteur ajouta tristement : « Pourvu qu’on ne lui ait dépêché personne pour le faire sortir par ruse ! »
Koltcho comprit l’importance de chaque instant et sortit au plus vite.
25 UNE MISSION ÉPINEUSE
Koltcho descendit l’escalier à tâtons, frappant chaque marche de sa canne. Mais, arrivé dans la cour, il se hâta, d’un pas plus assuré et pénétra dans le parvis. Là, il s’arrêta et, fouillant dans toutes ses poches, fit semblant de chercher son mouchoir, afin d’entendre les ordres que donnait le chérif-aga.
– Hassan-aga, disait à voix basse celui-ci, va dire aux autres de tenir les yeux ouverts... S’il résiste, qu’ils tirent sans m’en demander la permission.
– Nenko, va, mon garçon, fais vite, appelle le comte Ognianov, l’instituteur. Dis-lui qu’on le demande, disait de son côté une voix, qui parut à Koltcho celle de Filtcho, le pandour.
Saisi par la crainte d’être devancé, il souleva, sans plus attendre, les lourdes draperies de la grande porte et entra. L’église regorgeait de monde. Hadji Athanassi achevait le dernier cantique, la messe allait finir. La foule était extrêmement dense car il y avait eu de nombreux communiants et quelques prières pour les morts. Le passage au milieu de l’église était obstrué. L’aveugle s’enfonça dans la foule comme dans une forêt, aussi impénétrable et noire que cette nuit, qui pour lui, était éternelle. Son instinct le guidait dans la bonne direction, mais comment percer ce mur de bras, de hanches, de poitrines, de dos et de jambes étroitement serrés ? Nul espoir pour cet être frêle et menu de se frayer un chemin jusqu’à la stalle d’Ognianov, près de l’autel, ce qui aurait été difficile même pour un goliath ! Avec peine, il avança de quelques pas puis s’arrêta, exténué ; persévérant encore, il se reprit, poussa par-ci par-là, dans la nuit, en vain ; le mur était inébranlable. On lui fit même observer, sur un ton désobligeant, que, s’il persistait à se faufiler en avant, il risquait d’être étouffé ou écrasé. Des coudes de fer serrèrent à les rompre ses côtes débiles. Il haletait. Dans deux minutes ce serait la fin de la messe ; la foule allait se précipiter comme un flot et entraîner Koltcho dans son courant ; alors Ognianov serait perdu ! Et si, à l’instant même, le gamin arrivait par un autre chemin jusqu’à Boïtcho, qui, sans se douter du piège, le suivrait ! Peut-être même le garçon le frôlait-il, touchait-il le coude de Koltcho, sans que ce dernier s’en rendît compte. Instinctivement il agita sa main autour de lui pour chercher le gamin, et elle rencontra, en effet, quelqu’un qui lui sembla être un adolescent et, au milieu de son bouleversement, il crut reconnaître le redoutable garçon envoyé à la recherche d’Ognianov. Dans une sorte de délire il l’agrippa par le bras et, l’attirant vers lui, il cria presque ci-consciemment : « Est-ce toi, mon garçon ? Comment t’appelle-t-on, jeune homme ? Reste en arrière, petit ! » Mais une poussée de la foule les sépara. Koltcho était au désespoir. Son pauvre et noble cœur souffrait le martyre. Avec horreur, il se rendait compte que la vie d’Ognianov ne tenait qu’à un fil et que ce fil c’était lui, le faible, l’insignifiant Koltcho, perdu, presque invisible dans cette mer d’êtres humains. La messe tirait à sa fin. Et cet hadji Athanassi, d’habitude si traînant et si lent dans son chant, lui semblait maintenant terriblement pressé. Que faire ?
Mais les situations critiques appellent des solutions extrêmes. Tout d’un coup, Koltcho, cognant sur les dos dressés devant lui, se mit à gémir désespérément :
– Laissez-moi donc passer ! Je me meurs, je me meurs, oh ! ma mère ! j’expire.
À ces cris, bien qu’à grand-peine, chacun se déplaçait un peu, afin d’ouvrir un passage au pauvre aveugle agonisant que personne ne voulait sentir expirer sur son dos. C’est ainsi qu’à demi mort Koltcho se traîna enfin jusqu’au siège d’Ognianov. Il le trouva sans peine, tant est miraculeuse la force de l’instinct chez les êtres privés de la vue. Attrapant résolument les pans d’un manteau, il demanda à voix basse :
– Est-ce vous, baï Boïtcho ?
– Qu’y a-t-il ? répondit Ognianov, et il colla son oreille à la bouche de l’aveugle.
Lorsqu’il releva la tête, il était livide.
Pendant une minute il réfléchit, seules les veines extrêmement tendues de ses tempes trahissaient l’intensité du travail qui se faisait dans son esprit. Enfin, se penchant de nouveau à l’oreille de Koltcho, il lui souffla quelque chose et, quittant son siège, il se faufila à travers la foule et se perdit parmi les communiants massés devant l’autel.
Au même instant, l’hostie à la main, le pope Nicodime ouvrit toutes grandes les portes de l’autel et chanta les dernières paroles de la messe. La foule, en courant impétueux, se rua vers la sortie. Au bout d’une demi-heure les dernières vieilles attardées quittaient à leur tour l’église. Derrière l’autel le pope enlevait ses habits sacerdotaux.
Alors les zaptiés envahirent l’église. L’onbachi, furieux qu’Ognianov ne fût pas sorti, et persuadé qu’il ne pouvait être qu’à l’intérieur, fit verrouiller les portes et la perquisition commença. Les zaptiés pénétrèrent derrière les grilles de la partie de la nef réservée aux femmes, fouillèrent parmi les sièges et dans les coins, pénétrèrent enfin dans le chœur par les portes latérales. Ils mirent tout sens dessus dessous, fouillèrent tous les coins qui auraient pu servir de cachette, montèrent sur l’ambon, déplacèrent les lutrins, regardèrent sous le maître-autel et dans les tabernacles où étaient gardés les objets sacrés, examinèrent les caisses aux vieilles icônes et jusque dans les embrasures des fenêtres, mais en vain. Ognianov semblait être entré sous terre ! Le sacristain, persuadé qu’Ognianov n’était pas là, indiquait de lui-même tous les endroits suspects. Soudain le pope Nicodime devint perplexe et se mit aussi à chercher, à tourner de-ci de-là. Il fouilla même parmi les habits sacerdotaux, soulevant les objets et les livres posés sur l’autel. L’onbachi lui-même fut surpris par ce zèle inattendu du pope et le pandour Mial lui fit observer que jamais un être humain ne pourrait se cacher parmi ces objets, où même un oiseau aurait eu de la peine à se nicher.
– Comment ! Mais je cherche tout autre chose ! répondit le pope.
– Quoi alors ?
– Je n’ai plus ni ma soutane, ni mon chapeau, ni les lunettes bleues qui étaient dedans.
Le pauvre pope était déjà transi.
– Ah ! nous y voilà enfin ! chérif-aga, cria le père Mial.
Le chérif accourut, essoufflé et trempé de sueur.
– Un bandit, c’est toujours un bandit, reprit le pandour, dissimulant sa joie intérieure ; il a chipé les habits du pope !
Le chérif restait éberlué :
– Comment ça ?
– Je ne trouve ni ma soutane, ni mon chapeau, ni mes lunettes. Je ne les trouve nulle part, répétait le pope, ahuri.
– C’est l’autre qui a dû les emporter, remarqua le chérif, de l’air de quelqu’un qui vient de faire une importante découverte.
– Aucun doute ! Le comte a dû s’affubler de la soutane et du chapeau et sortir sans être reconnu, ajouta le pandour.
– C’est comme ça que ça a dû se passer, confirma le pope ; pendant que j’étais occupé à la communion, quelqu’un a dû les prendre.
– C’est vrai, j’ai vu à la sortie un pope portant des lunettes bleues, dit l’un des zaptiés.
– Et tu ne l’as pas arrêté, imbécile ! hurla son chef.
– Comment pouvais-je y penser ? Ce n’est pas un pope, c’est un homme que l’on attendait, disait le zaptié pour se justifier.
– Ah ! c’était lui alors, bon Dieu ! se dit Mial étonné. C’est pour ça qu’il était si emmitouflé, je n’ai vu que ses lunettes... Son père lui-même n’aurait pas pu le reconnaître.
On frappait à la porte. Le chérif ordonna d’ouvrir.
C’était Filtcho, le pandour, et le percepteur.
– Chérif-aga ! Le comte est pris au piège, cria Filtcho,
– Il est au couvent, on l’y a vu entrer, ajouta le percepteur.
– Vite au couvent !
Et tous se ruèrent au-dehors.
28 UNE VISITE DÉSAGRÉABLE
En quelques foulées les policiers se trouvèrent à la porte du couvent. Le chérif-aga y laissa deux zaptiés sabre au clair, revolver au poing.
– Ne laissez entrer ni sortir personne, ordonna-t-il en pénétrant avec les autres dans la cour.
Leur irruption troubla profondément le couvent et répandit la terreur et le désordre dans toutes les cellules. Les religieuses s’éparpillèrent sur les terrasses qu’elles arpentèrent en courant, leurs visiteurs les suivirent et ce furent des cris, du tapage. En vain l’onbachi les invitait au calme, gesticulant et leur criant en turc des choses qu’elles ne comprenaient pas. Entre-temps, les zaptiés attrapèrent tous les popes qui leur tombaient sous la main, et même tous les porteurs de lunettes, bleues ou blanches, et même deux personnes qui portaient le prénom de Boïtcho, et ils les enfermèrent tous dans une chambre. Kandov et Barzobégounek étaient du nombre. Ce dernier fut immédiatement mis en liberté avec toutes les excuses de l’onbachi, auxquelles il paraissait avoir droit eu égard à sa qualité de ressortissant de l’empereur d’Autriche, si dissemblable de la condition commune de la raïa 79. Kandov, au paroxysme de la fureur, criait par la fenêtre des protestations indignées contre cette atteinte flagrante à sa liberté : ses camarades, rompus à l’arbitraire de l’administration turque, se tenaient plus tranquilles.
– On dirait que tu n’as jamais vu de Turc, mon vieux, disait l’un des popes.
– Mais c’est de la violence, de l’arbitraire, c’est illégal ! hurlait l’étudiant.
– Ça n’est pas par des cris qu’il faut répondre à ces iniquités, ça ne peut pas rentrer dans la tête dure d’un chérif-aga ; voilà une réponse pour lui ! disait Boïtcho le boucher en brandissant son couteau.
Dans sa hâte, le chérif n’avait pas pensé à demander qui au juste avait vu Ognianov entrer au couvent, ni comment il était habillé, mais il se mit aussitôt à fouiller l’étage où, selon lui, l’instituteur devait s’être réfugié. C’est là justement que se trouvait la cellule de hadji Rovoama. Sur ces entrefaites les religieuses avaient repris un peu leurs esprits et protestaient, indignées d’avoir été soupçonnées de cacher au couvent un ennemi de l’Empire. Cet indigne soupçon provoquait surtout la juste colère de hadji Rovoama qui, bien qu’elle ne sût pas le turc, se répandit en imprécations véhémentes contre l’onbachi ; celui-ci fut enfin honteusement chassé de chez elle. Mais la perquisition se poursuivit, fiévreuse, dans les autres cellules : on cherchait Ognianov dans les coins les plus invraisemblables ; on devait bien finir par le trouver ! Le chérif-aga avait mis toute son ambition dans le succès de cette fouille enragée des armoires, caisses, chambres de débarras et recoins secrets. Presque tous attendaient avec angoisse la découverte du pauvre comte.
On entendit quelqu’un crier d’une voix lugubre : « On l’a eu ! » mais on s’aperçut que ce n’était que M. Fratiou, que l’on tira de dessous le lit de Mme Nimphidore et qui fut relâché sur l’heure.
Appuyée à la balustrade, Rada suivait avec une attention douloureuse les progrès de la perquisition. La peur la tenaillait, ses joues ruisselaient de larmes. Cet imprudent épanchement ne laissa bientôt plus aucun doute sur ses relations avec Ognianov. On la regardait avec animosité, mais elle ne se souciait guère de ce que pouvaient penser d’elle ces vieilles hargneuses, si indifférentes au malheur qui menaçait son ami ; elle laissait libre cours à ses larmes.
À côté d’elle, deux religieuses bavardaient à voix basse en montrant des yeux la cellule de hadji Daria, la tante du Dr Sokolov et la protectrice de Boïtcho. Il devait se cacher dans cette cellule dont les zaptiés approchaient déjà. Le cœur de Rada battait à se rompre. Elle était pétrifiée d’horreur. Que faire, mon Dieu !
À ce moment, Koltcho, qui l’avait reconnue à ses sanglots, s’approcha d’elle et lui chuchota
– Rada, es-tu seule ?
– Oui, je suis seule, baï Koltcho, répondit-elle, la voix mouillée de larmes.
– Sois tranquille, ma petite, dit-il.
– Oh ! comment peux-tu dire cela, Koltcho ? Et si on le trouvait ? Il est ici... C’est toi-même qui as dit que quelqu’un l’avait aperçu au couvent.
– Je crois qu’il n’y est pas, Rada.
– Mais tout le monde dit le contraire.
– C’est moi qui ai fait courir ce bruit... Boïtcho me l’a recommandé lui-même à l’église. On a donné du fil à retordre à la police ici et maintenant Ognianov est aussi libre que le loup dans la forêt.
La malheureuse jeune fille eut de la peine à se retenir d’embrasser l’aveugle. Son visage radieux redevint rieur comme un ciel lumineux après la tempête ; elle entra, apaisée et rayonnante, chez hadji Rovoama, qui remarqua aussitôt son inexplicable bonheur.
« Cette propre à rien saurait-elle qu’il n’est pas au couvent ? » pensa-t-elle avec amertume. Et, lui jetant un regard scrutateur, elle fit :
– Alors, Rada, tu en as assez de pleurer ? Bon, bon, sois la risée des gens, pleure pour ce bandit, pour vaurien !
Le cœur de Rada débordait de bonheur.
– Eh bien, je pleure, dit-elle avec audace, pour qu’il y ait au moins une personne qui pleure pendant que les autres se réjouissent.
Cette réponse hardie parut effroyablement indécente à la religieuse qui n’était pas habituée à être ainsi rabrouée. Elle grinça des dents :
– Impudente !
– Je ne suis pas une impudente !
– Tu es une éhontée et une folle, voilà ce que tu es ! Ton vaurien se balancera aujourd’hui même au bout d’une corde.
– Si on lui met la main dessus ! fut la réponse mordante de Rada.
Hadji Rovoama s’emporta, étouffant de rage :
– Hors d’ici, maudite sotte ! Que je ne te voie plus remettre les pieds ici ! hurla-t-elle en la poussant dehors.
Rada sortit dans la véranda, calme, le cœur en liesse, comme si tout ce qui venait de se passer n’avait aucune prise sur elle. Que lui importait le mépris de hadji Rovoama, que lui importait d’être grossièrement mise à la porte ? Elle était même heureuse d’avoir rompu tout lien avec cette protectrice cruelle.
Le lendemain, le jour même peut-être, on allait la renvoyer de l’école et elle serait abandonnée, privée d’abri et du moindre moyen d’existence. Mais qu’importait ! Elle savait que Boïtcho était sauvé, qu’il était libre « comme le loup dans la forêt », selon le mot de Koltcho.
« Quel homme sympathique, pensait-elle, comme il sait compatir au malheur des autres ! Mon Dieu, il est la bonté même, ce Koltcho ! Il semble oublier son propre malheur, ne pas s’en apercevoir. Tant d’autres qui jouissent de la lumière s’aveuglent à dessein sur les peines qui ne sont pas les leurs. Et cette brute de Steftchov, avec quelle impatience ne doit-il pas attendre la perte de Boïtcho ! Mais Boïtcho est à présent hors de danger... Pas de joie pour ses ennemis, mais quelle satisfaction pour les braves gens ! »
Nul autre ne pouvait éprouver autant de bonheur qu’elle ! Bercée par ces douces pensées, elle aperçut soudain Koltcho qui, d’un pas lent, descendait les marches de l’escalier.
– Koltcho ! cria-t-elle sans trop savoir pourquoi.
– Rada, est-ce toi ? demanda Koltcho en revenant sur ses pas.
« Mon Dieu, pourquoi l’ai-je appelé, pourquoi fais-je revenir ce garçon ? » se dit-elle, honteuse. Puis elle se précipita et l’arrêta :
– Ce n’est rien, baï Koltcho... Je voulais simplement te serrer la main, et elle la lui prit avec effusion.
La perquisition allait son train. Le chérif-aga, fatigué, céda la place aux autres et alla lui-même voir ses prisonniers à soutane et à lunettes, qu’il pensa enfin à relâcher.
Kandov protesta une fois de plus contre l’arbitraire auquel sa personne avait été soumise. L’onbachi, surpris par ce flot de paroles, demanda qu’on lui traduisît ce que disait cet homme en colère.
– Répète, Kandov, que je raconte à l’efendi, lui demanda Bentcho Dermana, plus expert en turc.
– Dites-lui, je vous prie, reprit Kandov, que mon inviolabilité personnelle, que mes droits humains les plus élémentaires, contrairement à toute légalité et sans aucun fondement...
Bentcho eut un geste désespéré de la main :
– Mais ça n’existe pas en turc, toutes ces expressions ! Allons, Kandov, laisse tomber, mon vieux !
Le couvent fut enfin débarrassé de ses hôtes désagréables, qui s’en furent fouiller la ville et les environs.
27 UN ERRANT
Cette fois encore sa présence d’esprit sauva Ognianov. Son premier souci, dès qu’il se trouva hors de la ville, fut de cacher dans un buisson le chapeau et la soutane du pope.
La tempête de neige, qui lui avait permis de passer inaperçu par les rues désertes de la ville, faisait rage dans la plaine. Les rafales venues de la montagne soufflaient furieusement ; le dos de la Stara-Planina était comme saupoudré de sel. Sous leur linceul gris et glacé, les champs, déserts et morts, paraissaient désespérément tristes. Par bonheur, un rayon de soleil inattendu perça les nuages et brilla, très chaud, au-dessus de la nature engourdie par le froid.
Ognianov, n’ayant pas de sentier à suivre, allait toujours vers l’ouest, à travers les vignobles coupés de ravins et de sources taries. Sous un couvert, il s’assit pour reprendre souffle et réfléchir sur sa situation. Elle était difficile. La fatalité, qui avait constamment Steftchov pour complice, le poursuivait impitoyablement. En un clin d’œil il voyait crouler l’œuvre édifiée avec tant d’amour et d’enthousiasme. Devant ses yeux défilaient le diacre, le docteur, l’oncle Stoïan, peut-être encore d’autres amis fidèles et dévoués, jetés en prison, Rada, brisée par la douleur, leurs ennemis triomphants ! Il ne pouvait deviner par quelle suite de circonstances les desseins adverses avaient été favorisés. Entre leurs mains l’entrefilet du Danube et l’immonde espionnage du chantre avaient été des armes puissantes. Toutes les conséquences funestes lui apparurent nettement. La cause était-elle à jamais perdue ? Ce malheur n’allait-il pas entraîner ailleurs d’autres découvertes ? La fuite lui parut à présent une lâcheté. Il voulait revenir, se rendre personnellement compte de l’extension prise par le mal ; il ne pensait plus à lui-même et sa témérité le rendait capable d’un tel acte. Mais il réfléchit : il devait au moins se rendre méconnaissable. Cette pensée lui fit poursuivre son chemin. Il prit la résolution de pousser jusqu’à Ovtchéri, un village niché dans un repli des versants de la Sredna-Gora, qui lui était attaché et qu’il visitait souvent dans ses tournées ; chez le père Dialko il trouverait les meilleurs moyens de se travestir. Mais la route, traversant de nombreux villages turcs, était pour Ognianov parsemée d’embûches. Le bruit de la découverte des deux cadavres courrait aujourd’hui même à travers ces repaires de brigands à la vitesse de l’éclair ; s’il arrivait à leur échapper en tant que suspect, on ne le manquerait pas comme giaour ; chaque jour, dans cette région, plusieurs personnes disparaissaient. Ses vêtements citadins multipliaient les risques d’être attrapé ; aller au-devant d’une mort certaine eût été insensé. Il décida donc d’attendre la nuit. C’est dans ce dessein qu’il se rapprocha encore davantage des versants de la Stara-Planina, où d’épaisses futaies de charmes pouvaient le dérober aux regards.
Après deux heures d’une marche difficile à travers une contrée ravinée et sauvage, il atteignit enfin la première futaie. Là, caché entre les buissons secs, il s’étendit sur le dos, pour se reposer, ou plutôt pour concentrer sa pensée. Le ciel s’était complètement éclairci. Le soleil d’automne brillait, amène et chaud, en se reflétant dans les gouttes suspendues sur l’herbe, et transformant la neige en rosée. De rares moineaux passaient au-dessus de sa tête et s’en allaient chercher de quoi manger sur les sentiers. Un aigle des montagnes planait très haut dans le ciel. Peut-être était-il attiré par quelque charogne, peut-être prenait-il Ognianov pour une proie ? Cette pensée l’assombrit encore davantage : l’aigle lui parut vraiment lugubre, l’image même de son impitoyable destin ; comme si cet oiseau carnassier guettait, pour descendre de ses hauteurs bleues, le moment où son repas sanglant serait prêt. Tout était d’ailleurs possible : ce lieu désert, souvent parcouru par des chasseurs turcs, véritables brigands, n’était pas sans danger. Ognianov attendait avec impatience le crépuscule ; il changea plusieurs fois de place pour trouver un abri plus sûr, les heures se traînaient avec une épouvantable lenteur et le soleil avançait à peine. L’aigle planait toujours dans le ciel. Il remuait parfois ses ailes pour les étendre ensuite, immobiles et noires. Ognianov ne pouvait en détacher son regard ; toutefois, ses pensées erraient ailleurs. Des souvenirs du passé défilaient dans son esprit excité. Ses années de jeunesse, des années de lutte, d’épreuves et de foi dans les grands idéals. La Bulgarie, pour laquelle ils souffraient tant, était si belle, si digne de sacrifice ! C’était une déesse qui s’abreuvait du sang de ses adorateurs. Son auréole ensanglantée était formée de faisceaux de noms lumineux ; Ognianov y cherchait le sien, il lui semblait l’y voir. Comme il en était fier et comme il était prêt à mourir et, même plus, à lutter pour elle ! La mort était un sacrifice sublime, la lutte, un mystère sacré.
Un coup de fusil le fit sursauter. Il scruta les alentours. L’écho du Balkan reprit la détonation, puis se tut. « Des chasseurs », se dit-il.
Ognianov se calma, mais pas pour longtemps. Un quart d’heure après un chien aboya non loin de lui. L’aboiement fut suivi d’une voix d’homme : la pensée du lévrier d’Emexis, originaire de l’un des villages voisins, traversa aussitôt son esprit ; il crut reconnaître les aboiements qui approchèrent encore ; les buissons craquèrent comme secoués par le vent et deux lévriers en sortirent, flairant le sol de leurs museaux.
Ognianov respira plus à l’aise. Ce n’était pas le lévrier d’Emexis Pechlivan, qu’il avait dressé à se lancer sur les hommes comme sur du gibier. Cette maudite bête, alors que les lévriers sont d’ordinaire stupides et inoffensifs, était rancunière, et nous l’avons d’ailleurs constaté au monastère ; c’était elle qui, devenue l’alliée de Steftchov, contribua à la perte d’Ognianov. En l’apercevant dans les buissons, les lévriers s’approchèrent de lui, le flairèrent et disparurent. Soudain Ognianov entendit des pas ; sans se retourner il s’enfonça dans le fourré ; trois coups de feu retentirent, puis quelque chose le mordit à la cuisse. Il se mit à courir encore plus vite, ne sachant plus ni ce qui se passait derrière lui, ni même s’il était encore poursuivi ; le ravin d’une rivière lui barra le chemin ; il se fourra au plus épais d’un bosquet de noisetiers. Les chasseurs avaient probablement perdu sa trace. Il resta longtemps sur le qui-vive, mais n’entendit plus rien. C’est alors seulement qu’il sentit quelque chose de chaud et de gluant sur sa jambe : « Je suis touché ! » se dit-il, effrayé, en s’apercevant que son soulier était plein de sang ; il enleva gon pantalon : sa jambe gauche était couverte du sang qui jaillissait par deux trous opposés ; la balle n’avait fait que traverser la cuisse. Boïtcho arracha un lambeau de sa chemise et boucha les trous. La douleur devenait toujours plus aiguë, or un long chemin l’attendait encore. Le sang perdu l’avait affaibli et, de plus, il n’avait rien mangé de la journée. La nuit descendit rapidement et il quitta ce lieu qui allait, dès le lendemain, être envahi par les meutes turques. À mesure que l’obscurité s’épaississait, le froid devenait plus intense. Le premier village turc qu’il rencontra était désert et assoupi. Dès le crépuscule, les villages turcs sont aussi vides que des cimetières. On n’entendait du bruit que dans une épicerie, mais Ognianov n’osa frapper, bien qu’il fût à demi mort de faim. Il marcha encore deux heures, traversa d’autres villages, jusqu’à ce qu’il vît quelque chose briller devant lui : c’était la Stréma. Il la passa à grand-peine et s’assit sur l’autre rive, car l’eau avait glacé sa jambe qui lui faisait encore plus mal. S’apercevant qu’elle avait enflé, il eut peur que l’inflammation, qui pouvait se propager rapidement, l’obligeât à rester sur place. Il se leva alors, coupa du roseau sec et, après avoir enlevé son pantalon, se mit en devoir de laver sa plaie de la manière qu’il avait apprise du temps de hadji Dimitar 80. Il aspira l’eau dans le long tuyau, la souffla dans l’un des orifices de la blessure et elle s’écoula de l’autre. Il recommença plusieurs fois. Ensuite il pansa la plaie et se dirigea vers la Sredna-Gora... La nuit devenait de plus en plus noire. L’errant se dirigeait vers Ovtchéri, qu’il ne voyait toujours pas. Il se rendit tout à coup compte qu’il s’était égaré ; le lieu lui était tout à fait inconnu. Éperdu, il s’arrêta et tendit l’oreille. Il était en pleine montagne. Des voix étouffées d’hommes lui parvenaient. À cette heure tardive, ce ne pouvaient être que des charbonniers. Il se rappela avoir aperçu de loin la lueur de flammes rouges. Mais seraient-ce des Bulgares ou des Turcs ? Égaré, glacé, affaibli, s’il trouvait des chrétiens, ils pouvaient avoir pitié de lui. Il gravit une pente et aperçut le feu tout près. Il s’approcha. À travers les branches, les silhouettes humaines assises tout autour devinrent distinctes et il entendit quelques mots en bulgare. Comment se montrer maintenant ? Il était couvert de sang. Son apparition soudaine pouvait chasser ces Bulgares ou bien avoir des conséquences encore plus graves pour lui... Trois hommes entouraient le feu qui couvait, l’un d’eux étendu, les deux autres bavardant. À côté, leur cheval, une couverture sur le dos, broutait du foin. Ognianov prêta l’oreille.
– Mets-y encore quelques bûches, on a assez bavardé ; moi je vais donner du foin à la jument, dit le plus âgé en se levant.
« Mais je le connais celui-ci, pensa avec joie Ognianov, il est de Vérigovo ! Oui, c’est Nenko, le fils de baï Ivan. »
Il connaissait bien Vérigovo, village situé sur l’autre versant de la Sredna-Gora.
Nenko s’approcha du cheval et se baissa pour chercher du foin sec dans le sac de cuir. Alors Ognianov se faufila dans les buissons et, tout près de lui, dit à voix basse :
– Bonsoir, baï Nenko !
Nenko se dressa, saisi :
– Qui es-tu ?
– Tu ne m’as pas reconnu, baï Nenko ?
La faible lueur du feu éclaira le visage d’Ognianov.
– Oh ! c’est toi, daskal 81 ! Viens, viens donc ; il n’y a que des nôtres. Tzvétan, baï Doiïchine. Oh, bonne mère ! mais tu es tout glacé, tu es raidi par le froid, répétait le paysan en menant Ognianov vers le feu.
– Tzvétan, mets plus de bois dans le feu... Nous avons à sécher et à réchauffer un chrétien... Tu le connais ?
– Le maître d’école, le daskal, cria, joyeux, le jeune homme. Qu’est-ce qui t’amène par là ?
Et il arrangea des branches sèches pour qu’Ognianov puisse s’asseoir.
– Longue vie et bonne santé ! souhaita Ognianov.
– Ils lui ont logé une balle dans la cuisse, les monstres, dit, furieux, Nenko. Mais, Dieu soit loué ! il n’y a pas trop de mal.
– Oh !
– Père Doïtchine, lève-toi, on a des visites, dit-il en réveillant ou, plutôt, en poussant du pied le dormeur.
Bientôt un grand feu flamba. Compatissants, les charbonniers regardaient le visage pâli d’Ognianov, qui relatait brièvement ce qui venait de se passer. Il sentit bientôt l’action bienfaisante du feu. Ses membres glacés se détendirent, sa blessure ne lui faisait plus si mal. Le père Doïtchine sortit de son sac déchiré un croûton et un oignon, et il les lui donna :
– Voilà, c’est tout ce que nous avons à t’offrir... Quant à la chaleur, il y en a autant qu’on veut, on est plus riches que des rois. Sers-toi, daskal.
Ognianov se sentit encore mieux ; sen cœur se remplit d’un nouvel et grand espoir. Cette belle flamme dorée, bienfaisante, cette forêt séculaire autour de lui, ces visages noircis, rudes, simples, où brillait un chaud regard amical, et ces mains d’ouvriers, noires et calleuses, qui lui offraient le repas frugal de l’hospitalité bulgare, tout cela lui parut indiciblement émouvant. Sans sa souffrance physique, Ognianov aurait entonné : « Ô verte forêt... »
L’aube pointait lorsque Nenko, qui conduisait le cheval où s’était hissé Ognianov, frappa à une porte de Vérigovo. Les chiens aboyèrent dans la cour et le père Marine apparut sur le seuil. L’heure inaccoutumée lui fit pressentir l’arrivée d’une visite sortant de l’ordinaire.
En deux mots, on échangea des salutations et l’on s’expliqua.
– Qu’ils aillent au diable, espèces d’hérétiques ! Que les chiens les dévorent ! Que Dieu les punisse ! jurait l’oncle Marine, tout en faisant mettre avec précaution pied à terre à Ognianov, dont les douleurs s’étaient avivées pendant le voyage.
On l’introduisit dans une chambre écartée, où, précédemment, il avait déjà passé une nuit. Le père Marine examina attentivement la plaie et la pansa.
– Tu guériras comme un chat, conclut-il.
Il faisait déjà jour.
28 À VÉRIGOVO
La cicatrisation de la blessure d’Ognianov marquait des progrès certains, bien que moins rapides que ne l’avait prédit le père Marine. L’hospitalière famille de celui-ci multipliait ses attentions au chevet du malade, s’évertuant à soulager ses souffrances. Oncle Marine, qui s’y entendait un peu, devint son médecin habituel et grand-mère Marinitsa, sa femme, s’était mise à l’œuvre pour faire apprécier à sa juste valeur son art culinaire. Des tonneaux de vin blanc de Sredna-Gora furent entamés, un poulet décapité chaque matin dans la cour allait enrichir ensuite le menu d’Ognianov, qui faisait table à part car ses hôtes jeûnaient à l’approche de Noël.
Ognianov allait de mieux en mieux ; dans cette bonne maison bulgare, pendant trois semaines, tant de chaudes attentions et de soins lui avaient été prodigués ! Seule le tourmentait son impatience d’avoir des nouvelles de Biala-Tcherkva, de Rada, de ses amis et des progrès de la grande cause à laquelle l’avaient arraché cette série de circonstances malencontreuses. Il suppliait le père Marine d’envoyer quelqu’un aux nouvelles, mais celui-ci ne se laissait pas fléchir.
– Non, je n’enverrai personne, j’irai moi-même dimanche prochain faire des emplettes pour les fêtes. D’ici là, un peu de patience, mon garçon ! Si tu veux guérir plus vite, il faut te tenir tranquille. Le bon Dieu ne nous abandonnera pas.
– Mais dimanche prochain je pourrai y aller moi-même !
– Si je te laisse partir ! Ça, alors, c’est mon affaire. Je suis ton médecin, je sais mon métier, grondait, avec une sévérité paternelle, le paysan.
– Laisse-moi au moins faire savoir à Rada que je suis en vie.
– Puisque tu n’es pas entre les mains des Turcs, elle doit bien se douter que tu es en vie.
À la fin, il fallait qu’Ognianov cédât.
Quelques villageois fidèles venaient lui rendre visite ; à force de prières ils avaient obtenu de Marine la permission d’entrer chez le malade. Leurs cœurs étaient avides d’entendre la parole ardente du maître d’école et chaque fois ils sortaient de chez lui le visage illuminé et les yeux brillants. Celui qui jouissait de la plus grande liberté d’accès était le pope Joseph, président du comité.
D’ores et déjà, il avait été élu chef de la compagnie dont il cachait l’étendard à l’église, parmi les habits sacerdotaux. Venait aussi le père Mina, le vieux maître d’école. Ognianov était persuadé qu’à part ceux-là et la famille du père Marine, personne d’autre au village n’était au courant de son secret. C’est ce que d’ailleurs lui assurait son hôte. Pourtant il s’apercevait avec surprise que, de jour en jour, son menu devenait plus copieux ; des poulets rôtis, des œufs au plat, du riz au lait, des tartes, parfois même des canards sauvages, des lièvres et les vins les plus variés paraissaient sur sa table. Ce luxe l’inquiétait ; il était honteux d’occasionner de telles dépenses, car, parfois, en sortant dans la cour, il s’apercevait que le poulailler était vide. Un jour il dit au père Marine :
– Mais, père Marine, tu vas te ruiner. Si tu n’es pas raisonnable, je ne mangerai plus à ta table. J’achèterai à l’épicerie d’en face du pain et du fromage maigre, ça me suffira.
– Tu n’as pas à te tracasser pour savoir si je me ruine ou non. Je suis ton docteur et je te soignerai comme je l’entends. J’ai ma méthode à moi et je te prie de ne pas te mêler de mes affaires.
Alors, ému, Ognianov se taisait. Il ignorait que le village tout entier s’empressait à qui mieux-mieux pour offrir des régals à son maître d’école bien-aimé. Son secret était le secret de tout le village. Une trahison, toutefois, était inconcevable. Il jouissait de la sympathie générale. Le bruit qu’il avait abattu deux sanglants bandits s’était répandu et l’avait fait monter dans l’estime même des plus indifférents car, de toutes les vertus, c’est la bravoure qui a le plus de prise sur le cœur des gens simples.
Mais la blessure d’Ognianov se cicatrisait avec lenteur, infligeant à cette nature vive et impatiente le martyre de l’immobilité. Il était rongé par l’inquiétude. Parmi tous ses visiteurs, le bon père Mina avait l’influence la plus bienfaisante sur lui. Chaque jour ils s’entretenaient pendant plusieurs heures ensemble ; Ognianov s’était habitué à sa présence et ne pouvait plus s’en passer. Le père Mina était une authentique relique, un des rares vestiges vivants de cette lignée, éteinte aujourd’hui, d’instituteurs qui, les premiers, ouvrirent dans les monastères de Bulgarie des écoles cellulaires 82 où la lecture du bréviaire et du psautier constituait le seul moyen d’enseignement. Âgé de plus de soixante-dix ans, il était chenu, large d’épaules, large de face et portait de larges pantalons à la turque. Au bout de nombreuses années de vie nomade, il avait jeté l’ancre dans ce modeste village, achevant sa longue vieillesse dans le calme de ce trou perdu. Vieilli et ne pouvant plus faire profiter les jeunes de son savoir, il chantait encore bénévolement à l’église, où les réformes n’étaient pas admises. Les jours de fête, les paysans l’entouraient pour écouter bouche bée ses récits amusants qui, émaillés de citations de l’Écriture Sainte, ressemblaient à des prêches. La Sainte Écriture constituait d’ailleurs son unique lecture et suffisait à la nourriture de son esprit. Ognianov était pris par le charme désuet qui émanait du pionnier blanchi, l’écho vivant d’une époque révolue. Il écoutait ses sages propos avec recueillement. La souffrance le rendait mystique et la parole consolatrice du Grand Livre allégeait ses tourments comme un baume magique. Ognianov ressentait pour la première fois de sa vie l’action bienfaisante des paroles inspirées dont étaient illuminés les récits du vieillard. Lors de sa première visite à son chevet, le vieux Mina s’était récrié :
– Encore une victime chrétienne ! Encore du sang répandu sans raison ! Jusqu’à quand, mon Dieu ! l’ennemi nous fauchera-t-il ? Pourquoi détournes-tu de nous Ta droite ?... Dresse-toi, ô Dieu ! Juge ! Mets fin à nos souffrances !
Ensuite il avait salué Ognianov et l’avait questionné avec sympathie. Boïtcho fit pour se retourner un mouvement qui lui causa des douleurs atroces et lui arracha un profond gémissement.
– Tiens bon, mon fils ! « Heureux sont ceux qui souffrent car ils seront consolés ! »
– Eh ! grand-père Mina, le sort a dû verser quelques gouttes de souffrance dans mon lot ! Ne nous sommes-nous pas affublés nous-mêmes du nom d’apôtres ? dit avec un sourire Ognianov.
– C’est dur, c’est dur, mon petit, la voie que vous avez choisie sur terre, mais elle est louable et glorieuse, car Dieu lui-même vous a inspiré de servir le peuple. « Vous êtes la lumière du monde : quelle ville bâtie au sommet de la montagne saurait se dérober aux regards des hommes ? » Le Christ n’a-t-il pas dit à ses apôtres : « La moisson est riche, les moissonneurs sont peu. Allez : je vous envoie comme des agneaux parmi les loups ! »
Ces paroles versaient une douce consolation dans l’âme d’Ognianov. Il pria le vieillard de lui prêter quelque livre saint et celui-ci apporta le psautier. Ognianov se mit à lire avec ardeur cette œuvre inspirée, source d’une poésie si élevée. Ces chants de luttes, de gémissements déchirants et de prières sublimes résonnaient dans son âme troublée. Les Psaumes de David devinrent son livre de chevet.
Le temps vint enfin pour le père Marine de se rendre à Biala-Tcherkva. Ognianov attendait, anxieux, son retour, Des pensées plus sombres les unes que les autres traversaient son esprit : depuis déjà plus d’un mois, il ignorait ce qui avait pu arriver aux êtres qui lui étaient chers. Que faisait donc Rada ? Quelles offenses, quelles persécutions n’avait-elle pas dû endurer à cause de lui, après sa fuite ! Seule pour faire face à la tempête d’une société déchaînée, peut-être avait-elle dû endurer aussi la rage des autorités ? La pauvrette, son destin n’avait pas voulu qu’elle fût heureuse avec lui ! Elle était malheureuse, exposée de nouveau aux revers du sort, ses rêves les plus chers étaient bafoués ; elle-même perdue aux yeux de ses semblables dont la cruauté lui faisait un crime de son attachement pour lui. De bien amères souffrances pour le peu de joie que lui avait procuré ce sentiment ! Et il n’était même pas là pour réconforter et soutenir cette frêle enfant !
Plongé dans ces tristes réflexions, il accueillit avec une véritable joie l’arrivée du père Mina. Il aurait au moins quelqu’un à qui se confier. Le vieux Mina l’écouta, soucieux.
– Espère, mets ton espoir en Dieu, mon garçon ; ne te laisse pas abattre ; le Tout-Puissant n’abandonne pas les malheureux qui croient en Sa miséricorde. Une force aussi grande que le mont Sion anime ceux qui espèrent en Lui. Car jamais Dieu n’abandonne le sort des croyants aux mains des pécheurs. Ceux qui auront semé des larmes récolteront de la joie !
Comme pour justifier ces douces paroles, la porte s’ouvrit pour laisser entrer baï Marine.
Ognianov, anxieux, voulut lire les nouvelles sur son visage.
– Bonsoir ! Ne t’agite donc pas, Boïtcho ! Je vais tout raconter. Et, surtout, ne bouge pas trop ! dit-il en enlevant sa lourde houppelande. – Vos gens de Biala-Tcherkva, reprit-il, sont bien bizarres ; on dirait des ombres. Impossible des les faire bavarder un peu.
– Mais est-ce que tu n’es pas allé tout droit chez le docteur ?
– Il est arrêté.
– Et chez le diacre, au monastère ?
– Il s’est caché, le diacre.
– Mais le père Stoïan, tu l’as bien trouvé, lui ?
– Que Dieu ait son âme : il est mort la nuit même de son arrestation, tellement on l’a battu ; le malheureux aurait tout avoué sous les coups.
– Oh ! le pauvre Stoïan ! Et Rada, Rada ?
– Elle, je n’ai pas pu la voir.
– Comment, qu’est-elle donc devenue, Rada ?
Il blêmissait.
– Elle est là, ne t’en fais pas, mais on l’a renvoyée de l’école.
– Mais il fallait voir chez les sœurs, chez Mme hadji Rovoama ? criait Ognianov, fou d’inquiétude.
– C’est elle qui l’a impitoyablement chassée.
– Mon Dieu, mais on l’a jetée à la rue, on l’assassine !
– Le tchorbadji Marko l’a recueillie chez une de ses parentes. Je n’ai pas pu dénicher la maison, car mes compagnons étaient pressés, mais je suis renseigné, elle va bien.
– Ce baï Marko, comment pourrais-je le remercier ? Et qu’est-ce qu’on dit de moi ?
– De toi ? Mais on t’appelle autrement là-bas. Mes cheveux ont blanchi jusqu’à ce que je comprenne qu’il s’agissait de toi.
– « Le comte » ?
– Oui, « le comte ». On dit du comte que des chasseurs lui ont tiré dessus dans la montagne.
– C’est la vérité.
– Pas tout à fait. Tu es en vie, mais on te croit mort et ça vaut mieux, je pense.
Ognianov sursauta comme s’il venait d’être mordu par un serpent :
– Comment ? Mais alors, elle ? Elle me croit mort aussi ? Il ne lui manquait plus que cela, la malheureuse !
Il se mit à marcher dans la chambre comme pour se rendre compte de l’état de sa jambe.
– Ne bouge pas, tu vas envenimer la plaie.
– Je peux voyager, déclara Ognianov pour toute réponse.
– Voyager ! Et pour aller où ? demanda le père Marine, inquiet.
– À Biala-Tcherkva.
– Tu n’es pas fou, non ?
– Non, mais je le deviendrai si je reste un jour de plus ici. Procure-moi des vêtements. Est-ce que tu me prêtes aussi ton cheval ?
Connaissant l’entêtement de Boïtcho, le père Marine n’essaya même pas de le retenir.
– Prends des habits et mon cheval aussi. Mais j’ai pitié de ta jeunesse, dit-il, abattu. Des Turcs croisent sur les routes ; leurs vols et leurs méfaits ne se comptent plus... Ne penses-tu jamais à toi-même ?
– Ne t’en fais pas pour moi, je reviendrai comme un faucon, sain et sauf. Si tu ne me chasses pas, bien sûr, ajouta Ognianov en plaisantant à demi.
Le vieillard lui jeta un regard sombre.
– Non ! tu ne partiras pas, dit-il avec détermination. Je rassemblerai tout le village, on t’enfermera de force ici. Tu nous es aussi nécessaire que la communion de Dieu et tu veux aller te faire tuer ! Je ne veux pas qu’on dise après : « Baï Marine a laissé notre maître d’école Boïtcho, notre daskal, notre « apôtre », aller à sa perte ! criait hors de lui le père Marine.
– Pas si haut, baï Marine, on t’entend de loin, disait Ognianov, pour le calmer.
Le vieux Mina riait sous cape. Le visage de Marine s’éclaira aussi. Ognianov les regarda surpris. De toute évidence, ses dernières paroles les avaient mis en gaieté.
– Pourquoi riez-vous ? demanda-t-il.
– Oh ! sois béni, mon garçon ! Mais de quoi donc as-tu peur ? Le village tout entier, les enfants même savent que tu es chez moi... Tout le village travaillait à garnir ta table. Nous sommes des gens simples, mais nous ne trahissons pas les chrétiens et lorsque ce sont des chrétiens comme toi, on donnerait son âme pour eux !
Ognianov sourit aussi quand il apprit qu’en somme son secret n’était connu que de tout le village.
Il fallut pas mal de discussions encore avant qu’Ognianov eût raison des craintes de son hôte et que son départ fût décidé.
29 UN RELAIS PLEIN D’EMBÛCHES
Une heure plus tard, un Turc à cheval quittait Vérigovo. Un Turc ? – disons plutôt un Tchitak 83.
Le front couvert jusqu’aux sourcils d’un turban vert, déguenillé et complètement décoloré ; la nuque bien rasée, il portait un gilet de cotonnade aux gansettes déchirées, déboutonné au cou, et une veste en lambeaux, aux manches effrangées ; à sa ceinture sale pendaient un pistolet à silex, un poignard, un yatagan et un chibouk ; une culotte turque usée jusqu’à la corde, aux jambières déboutonnées, tombait sur des sandales à courroies. Un manteau de bure rapiécé couvrait le tout. Ainsi travesti, Ognianov était méconnaissable. L’hiver déjà avancé recouvrait la terre de son manteau blanc que perçaient les dents noires des côtes rocheuses du Balkan. La nature était silencieuse et triste, seul le vol des corbeaux troublait l’air assoupi.
La route directe de Biala-Tcherkva allait vers le nord-est, mais Ognianov se garda bien de la suivre ; il aurait fallu traverser le village d’Emexis Pechlivan, et cette perspective n’était guère rassurante. Le lévrier du mort le hantait, telle une incarnation de l’esprit abhorré du Turc qui, même d’outre-tombe, continuait à le harceler. Il avait décidé de se diriger droit vers le nord, jusqu’à l’auberge de Karnary, puis vers l’est, le long des versants de la Stara-Planina, jusqu’à Biala-Tcherkva. Sa route faisait ainsi des détours mais, bien qu’elle traversât aussi des villages turcs, elle présentait moins de dangers.
Lorsque Ognianov approcha du premier village, la neige commençait à tomber à gros flocons, voilant tout devant ses yeux. Le froid devenait plus intense et engourdissait les membres du voyageur, qui sentait à peine la bride dans ses mains. Son cheval avançait d’instinct, car il n’y avait aucune trace de chemin. Il entra sans bruit dans le village où ne paraissait pas âme qui vive et s’arrêta bientôt devant l’unique auberge, en face de la mosquée. Il voulait faire souffler sa monture éreintée par la route enneigée et se réchauffer lui-même un peu. Tendant la bride à un garçon, il pénétra dans le café qui semblait vide, car aucun bruit n’en sortait. Mais il trouva en entrant, à sa stupéfaction, l’estaminet bondé d’agas turcs. Faire demi-tour eût été imprudent. Il se résolut donc à s’asseoir et salua : on lui rendit poliment son salut. Ayant vécu longtemps parmi les Turcs, leurs mœurs et leur langue lui étaient familières. Déchaussés, accroupis sur des nattes, les clients du café tenaient leurs chibouks à la main. La fumée de leur tabac remplissait la salle basse d’un brouillard épais.
– Un café, commanda-t-il, renfrogné.
Et il se mit à bourrer son chibouk en se penchant le plus possible afin de cacher ses traits. En sirotant bruyamment son café, il prêta l’oreille à la conversation. Indifférent d’abord, il devint soudain tout ouïe : le hasard avait amené la conversation sur l’assassinat des deux Turcs. De longue date, pareille aventure n’avait troublé la région, et aujourd’hui encore l’évènement excitait les Turcs. L’assistance, si calme et flegmatique, il y a un instant, s’anima soudain. Les injures et les menaces sanglantes à l’adresse des Bulgares pleuvaient littéralement. Ognianov, les sourcils terriblement froncés, continuait à siroter bruyamment son café, signe qu’il partageait l’indignation générale. Le nom du meurtrier des deux Turcs fut prononcé et Boïtcho, ahuri, put se rendre compte de quelle popularité jouissait ici aussi sa personne. De vraies légendes circulaient déjà sur son compte.
– On ne peut ni l’attraper, ni le reconnaître, ce kiafir-consul 84, disait l’un des Turcs.
– C’est le diable en personne ! On le voit tantôt maître d’école, tantôt pope, tantôt paysan ou musulman. Il change subitement d’aspect, d’adolescent il devient vieillard ; imberbe et brun, l’instant d’après barbu et blond. Va donc l’attraper ! Ahmed-aga me disait l’autre jour qu’on est tombé une fois sur sa trace et qu’une compagnie l’a poursuivi. Il était habillé en paysan ; mais soudain, la troupe voit devant elle un corbeau ; il n’y avait plus ni paysan ni diable. Ils font tous feu, mais l’oiseau disparaît et on n’entend plus que ses croassements.
– Quelle blague ! crièrent quelques incrédules.
– Tôt ou tard, le giaour se laissera prendre ; il faut seulement découvrir son nid, remarqua un autre.
– Mais je vous dis qu’il est impossible de l’attraper, reprit le premier orateur. Il ne se cache même pas ; allez donc le reconnaître ! Il peut être ici-même parmi nous, dans ce café, et qu’on ne sache quand même pas que c’est lui.
À ces mots, les assistants levèrent machinalement les yeux, se regardant l’un l’autre. Quelques regards curieux se fixèrent sur Ognianov.
Il sirotait à grand bruit sa troisième tasse de café, soufflant à chaque instant un gros nuage de fumée pour protéger son visage, mais il sentait les regards braqués sur lui ; des gouttes de sueur perlèrent à ses tempes. Il ne pouvait plus supporter cet état de tension et n’attendait que le moment propice pour quitter le café et respirer une bouffée d’air frais.
– Si la fortune le veut, où allez-vous ? lui demanda une voix.
– À Klissoura, avec la volonté d’Allah ! répondit Ognianov en déliant tranquillement une longue bourse sale pour payer sa consommation.
– Quoi, par cette neige et cette tempête ? Mieux vaut passer la nuit ici, tu arriveras bien assez tôt demain pour le marché.
– Il est dit : « La route est pour le voyageur ce qu’est l’eau pour la grenouille », dit Ognianov, citant un sage proverbe oriental qu’il s’efforça d’accompagner d’un sourire.
– Tu racontes des blagues, Rakhman-aga, ton kiafir n’est ni le diable, ni un corbeau. C’est bel et bien un komitadji comme tous les komitadjis 85.
– Eh bien, mettez-lui donc la main dessus !
– On l’aura. On a repéré son nid.
– Ah ! si seulement il nous tombait entre les mains ! s’écrièrent, farouches, plusieurs Turcs.
– Je donne ma tête à couper que pas plus tard que demain Boïtcho le komitadji sera pris au piège.
– Et où le cherche-t-on, ce chien ?
– Il se cache à ce qu’il paraît dans un village giaour de Sredna-Gora, il est au chaud là-bas. Des zaptiés sont partis hier par Bania, d’autres par les prairies d’Albrachlari : on va le coincer...
– Tu lui donnes aussi la chasse ?
– Bien sûr. C’est à Vérigovo qu’on se réunit.
Ognianov venait de voir seulement maintenant que celui qui parlait était un zaptié qu’il n’avait pas remarqué auparavant dans son coin. La révélation du danger qui l’aurait attendu à Vérigovo lui coupa le souffle. Les regards soupçonneux s’étaient détournés de lui, mais il suffoquait. Boïtcho salua d’un salamalec et sortit.
Une fois dehors, en plein air, libre sous le ciel blanc, il respira profondément et sauta sur son cheval.
Trois heures plus tard, couvert de neige ainsi que son cheval, il s’arrêtait devant l’auberge de Karnary.
30 UN AIMABLE COMPÈRE
L’auberge de Karnary est l’étape du haut col de Troyan. Les voyageurs s’y arrêtent pour reprendre haleine, casser la croûte, se réchauffer un peu et, ayant repris des forces, continuent à grimper les côtes escarpées de la Stara-Planina. Toutefois, pendant une ou deux semaines d’hiver, l’auberge est privée de visiteurs, car les tempêtes au sommet du Balkan rendent impraticable l’ancienne route romaine qu’elles ensevelissent sous d’épaisses couches de neige. Toute communication entre la Thrace et la Bulgarie danubienne reste alors coupée jusqu’à ce que les charretiers de Troyan arrivent, au prix d’efforts surhumains, à creuser un étroit passage. Justement la route était fermée et l’auberge déserte. L’aubergiste bulgare, un petit bonhomme hilare au visage plutôt stupide, accueillit obséquieusement le voyageur et l’introduisit dans la grande salle qui servait un peu de tout. Le feu pétillait dans l’âtre ; Ognianov alluma sa pipe.
– Avez-vous d’autres clients ? demanda-t-il à l’aubergiste.
– Pas de clients. Le Balkan, quand ça se ferme, ça ferme aussi mon auberge. Et vous, de quel côté allez-vous comme ça ? demanda l’aubergiste, en examinant d’un regard étrangement curieux son hôte.
– Peux-tu me faire du café ? rétorqua, en ignorant la question, Ognianov.
– Oh, bien sûr, bien sûr ! Comment donc ? Et vous, où allez-vous comme ça ? insistait l’aubergiste.
– À Troyan.
– Et d’où venez-vous ?
– De Biala-Tcherkva. Est-ce que la route est bonne par là ?
– Je suis moi aussi de Biala-Tcherkva, mais il ne faut pas compter sur la route de Troyan. Puisque je te le dis !
L’aubergiste bavardait tout en servant le café et en fixant Ognianov comme s’il faisait un effort de mémoire pour le reconnaître.
Bourru, Boïtcho baissa la tête pour échapper à cet examen agaçant. L’aubergiste lui lança encore un coup d’œil de biais et sourit sous cape.
Posant sa tasse de café, Ognianov observa sévèrement :
– Aubergiste, tu as mis trop de sucre !
– Excuse-moi, hein, je croyais que tu l’aimais sucré. Faut-il que j’en fasse un autre ?
– Pas besoin !
– Non, bois, bois-en encore un – ça fait du bien, c’est moi qui te le dis.
– Quelles nouvelles par là ?
– Des horreurs, des assassinats, des vols tous les jours. Pas de voyageurs, le Balkan fermé, je perds... Et puis, surtout, depuis qu’on a déterré Emexis Pechlivan – tu le connais bien – les Osmanlis 86 dépassent la mesure. Ça cherche soi-disant des komitadjis et puis ça égorge des innocents. C’est vrai, puisque je te le dis, moi.
L’audace de l’aubergiste étonna beaucoup Ognianov. On ne pouvait se permettre de tels propos que devant un Bulgare. Il lui fallait donc, dans son rôle de Turc, feindre une aigre colère.
– Vaurien, si tu bavardes encore trop il t’arrivera malheur !
– Je sais bien devant qui je bavarde, mais oui, répondit l’aubergiste, familier.
Ognianov le regarda encore plus ahuri. Il voulut se fâcher.
– Giaour, on dirait que tu es saoul !
– Allons, allons, comte ! ne te fâche pas, moi aussi j’ai versé des larmes pour Geneviève, répondit en bulgare cette fois, l’aubergiste en s’emparant de la main droite de Boïtcho pour la lui serrer.
Ognianov vit bien qu’il était reconnu, ce qui l’ennuya beaucoup. D’ailleurs la figure de l’aubergiste aussi bien que ses manières impudentes l’écœuraient. Il le mesura du regard et demanda, glacial :
– De quel pays êtes-vous ?
– De Biala-Tcherkva : Ratchko le Péteux !
L’aubergiste se présenta en tendant de nouveau sa main qu’Ognianov ignora.
Mais Ratchko n’en fut pas vexé.
– N’aie pas peur de moi, comte ! Ou bien serais-tu gêné par mon nom ? Je l’ai hérité de mon père et il m’honore. D’ailleurs, qu’est-ce qu’un nom ? Ce n’est rien du tout, mais si l’on est honnête, alors le nom aussi est beau. Demande à Biala-Tcherkva, qui c’est-y qu’on appelle le Péteux, chacun te le dira. Écoute ce que je te dis. Quand on a son honneur, alors, par exemple, le nom, comme qui dirait... Je nourris ma famille, j’ai trois enfants – Dieu t’en donne autant ! – alors chacun me respecte. Pourquoi qu’on vit alors ? – Pour l’honneur et pour un beau nom.
– Tu as raison, baï Ratchko, tu parles d’or.
– J’ai raison, bien sûr, faut pas m’juger sur les apparences, je suis malin, moi aussi. J’en ai reçu ici des haïdouks. Dès que je t’ai vu tout à l’heure, je me suis dit : « Attends un peu voir si le comte te reconnaîtra. »
Ognianov ne se rappelait pas avoir déjà vu cette célébrité.
– Y a-t-il longtemps que tu tiens cette auberge ?
– Un an et demi, mais justement pour Geneviève je me suis trouvé à Biala-Tcherkva. C’était toi le comte.
– Est-ce que tu me donneras quelque chose à manger ?
– Ce que Dieu a donné.
Et Ratchko posa sur une basse table crasseuse un maigre plat de haricots blancs au piment, de la choucroute et un peu de pain.
– Je te tiendrai compagnie, ajouta aimablement Ratchko en prenant place à côté d’Ognianov.
Boïtcho mangeait en silence. Les manières insidieuses et le nom cacophonique du bonhomme, surtout maintenant qu’il s’était invité tout seul, l’irritaient singulièrement. « Qu’il est mal dégrossi, cet aubergiste, pensait-il. Un peu idiot aussi. »
Comme pour confirmer ses pensées, Ratchko remplit deux verres et dit :
– Allons, trinquons ! En avant, marche. (Et, d’une lampée, il vida son verre de vin aigrelet.) Mais je t’ai reconnu tout de suite, dis ! Que de fois j’ai reçu ici le diacre Levski et j’ai choqué le verre avec lui ! C’était un ami... J’en suis moi aussi des vôtres, un national quoi ! malgré tout ce qu’on pourrait penser de moi en me voyant comme ça...
Ognianov s’aperçut de la contradiction, ou plutôt du mensonge : Levski était mort depuis trois ans déjà. Sa méfiance s’accrut.
– Allons, bois donc ton vin ! Comment ? Tu ne bois pas ? Passe-moi ton verre alors !
Et Ratchko ingurgita d’un seul coup le contenu du verre d’Ognianov, dont le goût de vinaigre lui fit faire une affreuse grimace. Le déjeuner fut vite expédié, malgré l’entrain de Ratchko qui déjà avait son pompon.
– Attends donc, rien ne presse. Tu passeras bien la nuit ici ? Je te laisserai un peu seul, j’irai jusqu’à Karnary. Tu m’attendras. Reste ici ce soir. Nous bavarderons. Je suis, moi aussi, un national.
– Merci, baï Ratchko, sortez-moi mon cheval, je vais continuer mon chemin.
– Mais la route est mauvaise. Écoute ce que je te dis. Je donne ma tête à couper...
– Ce n’est vraiment pas la peine, répondit sèchement Ognianov, puis il ajouta avec impatience : Mon cheval !
L’aubergiste sortit.
Ognianov fit du regard le tour de la pièce et des réduits contigus. Sa pensée alla involontairement vers l’aubergiste de Kakrino par lequel Levski avait été trahi. Les taverniers dans les villages turcs – toujours des Bulgares – poussés par le besoin et l’habitude, fraternisent avec les Turcs, ce qui les rend assez dangereux. De plus ce moulin à paroles de Ratchko était capable de le trahir même le plus ingénument du monde.
– Ton cheval est prêt dehors, mais la route de Troyan est mauvaise, dit Ratchko en revenant.
– Combien pour moi et le cheval ?
– Allons, comte, n’en parlons pas, tu as été mon hôte.
– Non, laisse ça, je te suis très reconnaissant pour ton hospitalité et surtout pour ton vin, mais je désire payer, dit ironiquement Ognianov.
– Bah ! le vin n’est pas mauvais, mais ni pour lui, ni pour la mangeaille, ni pour le foin, je n’accepte de l’argent. Des amis comme toi...
– Alors, je te remercie, baï Ratchko, dit Ognianov en scrutant les alentours, n’y a-t-il personne d’autre par ici ?
– Il n’y a que moi et mon garçon, mais je l’ai envoyé à Biala-Tcherkva ; il ne rentrera pas ce soir. Moi qui voulais faire un saut jusqu’au village, et je n’ai personne à laisser ici. Reste donc, dis !
Ognianov avait repéré un poteau. Il prit l’aubergiste par la main et lui dit, le plus aimablement du monde :
– Maintenant, laisse-toi attacher, baï Ratchko, et tandis que d’une main il poussait l’aubergiste contre le poteau, de l’autre il décrocha la corde suspendue à un clou.
L’aubergiste crut d’abord à une plaisanterie.
– Alors, tu veux m’attacher maintenant ? Attache-moi, dit-il joyeusement.
Ognianov enroulait tranquillement la corde autour du poteau et de l’aubergiste. Celui-ci, se rendant compte enfin qu’on l’attachait pour tout de bon, s’étonna, puis se fâcha :
– Fais pas d’blagues, hein ! J’suis pas un brigand, quoi, pour que tu m’attaches ? (Et Ratchko s’agita furieusement.)
– Si tu râles, je t’ouvre le ventre, lui dit Ognianov en appuyant sur les mots.
L’aubergiste le regarda, éberlué. Il savait que le comte n’avait pas froid aux yeux et se tint par conséquent tranquille comme un doux enfant.
– J’aimerais pouvoir te lier la langue dans la bouche mais, comme je ne le peux pas, c’est toi que j’attache, plaisantait le voyageur, tout en ligotant solidement l’aubergiste. Puis il lui demanda : – Quand rentre-t-il ton garçon ?
– Ce soir.
Ratchko tremblait.
– Bon, c’est lui qui te détachera. Adieu, baï Ratchko. Je continue vers Troyan. Et souviens-toi du comte – mais dans ton for intérieur seulement !
Et, après lui avoir jeté quelques sous, Ognianov sauta sur son cheval et poursuivit sa route.
31 VEILLÉE À ALTANOVO
Au lieu de prendre la direction de Biala-Tcherkva, Ognianov rebroussa chemin vers le village d’Altanovo, tapi à l’extrémité ouest de la vallée, à deux heures de marche seulement. Mais son cheval crevé de fatigue et la route enneigée ralentissaient si bien son allure qu’il n’y arriva qu’à la tombée de la nuit, poursuivi jusqu’au bout par le hurlement des loups qui ne le lâchaient pas d’une semelle.
Il entra par le quartier bulgare (le village était moitié bulgare, moitié turc) et s’arrêta bientôt devant la porte de baï Tzanko.
Celui-ci, originaire de Klissoura, mais établi depuis longtemps dans ce village, était un homme simple et d’humeur joyeuse, qui aimait ardemment sa patrie. Les « apôtres » lui rendaient souvent des visites prolongées. Il accueillit Ognianov avec joie.
– Ça tombe bien que tu sois venu chez moi ! Il y a veillée ici ce soir, alors tu auras l’occasion d’admirer nos filles. Tu ne t’embêteras pas, va ! dit, le sourire aux lèvres, Tzanko, en l’introduisant dans la pièce.
Ognianov se hâta de lui dire qu’il était poursuivi et pourquoi.
– Mais oui, mais oui, on en a eu vent, nous aussi, dit baï Tzanko, tu ne pensais tout de même pas, j’espère, qu’on n’est plus de ce monde si on est terré dans ce trou-là ?
– Est-ce que tu n’auras pas d’ennuis à cause de moi ?
– T’en fais pas, je te dis ; tâche seulement de choisir une de nos filles ce soir, pour qu’elle porte le drapeau, plaisantait Tzanko ; là, de cette petite fenêtre-là, tu pourras t’en repaître les yeux à loisir, comme un roi !...
Ognianov se trouva dans un petit réduit obscur. Par la petite fenêtre à grille de bois, son regard embrassait la grande pièce où les filles et les femmes les plus en vue du village s’étaient réunies pour filer et coudre le trousseau de Donka, la fille de Tzanko. Les flammes du foyer s’élevaient joyeuses, éclairant les murs, qui n’avaient pour tout ornement qu’une estampe représentant Saint-Jean de Rila et des étagères chargées de poteries multicolores. Comme dans toute maison villageoise aisée, le mobilier se composait d’un évier, d’un placard, de quelques rayons au mur et de la grande armoire renfermant tout le bien de Tzanko. À même le plancher couvert de tapis en poil de chèvre, les invités et les invitées-travailleuses étaient assis. Deux lampes à pétrole ajoutaient ce soir-là le luxe de leur éclat coûteux à la chaude lumière de l’âtre.
Depuis longtemps, Ognianov n’avait assisté à une réunion aussi curieuse, coutume léguée par les aïeux. Tapi dans le réduit sombre, il suivait avec intérêt ces scènes naïves de la vie paysanne encore primitive. La porte de son réduit s’ouvrit et la femme de Tzanko entra. Native elle aussi de Klissoura, c’était une commère bavarde et exubérante. Elle s’accroupit près d’Ognianov et se mit en devoir de lui montrer, avec les explications de rigueur, les jeunes filles les plus pimpantes.
– Tu vois celle-là, la grosse rougeaude, c’est Staïka Tchonina. Regarde de quels yeux tristes la couve Ivan Borimetchka 87... Il aboie comme un chien de berger lorsqu’il veut la faire rire... Elle est habile au travail, bonne ménagère et proprette. Elle engraisse à vue d’œil, la pauvre ; mais quand elle sera mariée elle fondra. Vos filles, elles, s’empâtent quand elles se marient. Celle qui est à sa gauche, c’est Tzvéta, la fille de Prodan ; elle aime celui-là qui a la moustache comme roussie. Celle-là, alors, elle roule les yeux de tous côtés ! mais c’est une brave fille. À côté d’elle c’est Tzvéta, la fille à Dragan, ensuite Raïka, la fille du pope. Ces deux-là, je ne les donnerais pas pour vingt belles dames turques de Philippopoli ; regarde-les, comme elles ont la gorge blanche comme des oies ! Mon Tzanko n’a-t-il pas dit une fois que si l’une d’elles voulait se laisser mordre au cou par lui, il lui donnerait la vigne du Mal-tépé, et c’est alors que je lui allongé un coup de tisonnier ; ah ! le polisson ! Et celle qui est à droite de la grosse Staïka, tu la vois ? C’est la fille de Kara-Véliou, la plus riche. Cinq beaux gars l’ont demandée en mariage mais son père ne la donne pas. Il la garde comme porte-bonheur, espèce de marmotte ! Tu sais, il a vraiment l’air d’une marmotte. Mais je donne ma langue à couper qu’Ivan, le fils de Nédialko, l’enlèvera un jour. Là-bas, c’est Rada Milkina ; elle chante comme le rossignol de notre prunier, mais, entre nous soit dit, c’est une cagnarde. J’aime mieux Dimka Todorova, celle qui est assise près de l’étagère ; ça c’est une beauté, si j’étais un homme je l’aurais épousée ; écoute, je te la donne, veux-tu ? Quels yeux elle a, bon Dieu ! À côté de notre Donka, c’est la fille de Péyou. Elle est aussi belle que bonne ménagère, elle ne le cède pas à notre Donka. Elle a de la voix comme Rada Milkina et, quand elle rit, on dirait une hirondelle, écoute-la seulement...
Dressée ainsi dans l’obscurité à côté de Boïtcho, la femme de Tzanko le faisait penser à la Béatrice de Dante lui montrant un à un les habitants de l’Enfer et lui contant leur histoire.
Ognianov ne prêtait qu’une oreille distraite au bavardage intarissable de la commère. Plus que par le commentaire, il était absorbé par le tableau lui-même. Les filles les plus hardies taquinaient les gars, les plaisantaient malicieusement et riaient aux éclats. Les hommes répondaient par des rires retentissants qu’ils accompagnaient de flèches à l’adresse du sexe cancanier. Les plaisanteries, les taquineries, les blagues tombaient dru comme la pluie, des rires clairs répondaient aux mots équivoques, qui faisaient monter le rouge même aux joues les plus hâlées. Tzanko lui-même prenait part à la fête, tandis que sa femme s’affairait autour des plats ; sa fille Donka, s’occupant des invités, ne faisait que se lever et s’asseoir.
– Allez, vous avez assez ri, chantez maintenant un peu ! proposa joyeusement l’hôtesse qui avait quitté Boïtcho pour aller surveiller la marmite où mijotait le souper. Rada, Staïka, commencez-en une pour confondre les hommes. Ce sont des propres à rien nos gars, ils ne chantent pas !
Sans se faire prier davantage, Rada et Staïka entonnèrent une chanson reprise immédiatement par les autres qui, d’elles-mêmes, se partagèrent en deux chœurs : lorsque l’un d’eux avait chanté un couplet, l’autre le reprenait. Le premier chœur, où chantaient les meilleures voix, était composé de soprani, le second tenait une note plus basse.
Voici la chanson :
Dobro-lé, deux jeunes, Dobro-lé, s’aimaient,
Dobro-lé, s’aimaient, Dobro-lé, depuis leur enfance,
Dobro-lé, hier soir, Dobro-lé, ils se sont vus,
Dobro-lé, dans la rue, Dobro-lé, dans la nuit,
Dobro-lé, sont-ils restés, Dobro-lé, à causer...
Dobro-lé, le croissant, Dobro-lé, sortit sa corne,
Dobro-lé, le ciel, Dobro-lé, fut parsemé d’étoiles,
Dobro-lé, les deux jeunes, Dobro-lé, sont encore là,
Dobro-lé, sont toujours là, Dobro-lé, à causer...
Dobro-lé, ses seaux, Dobro-lé, furent couverts de givre,
Dobro-lé, un platane, Dobro-lé, poussa de sa palanche.
Dobro-lé, et les deux jeunes, Dobro-lé, sont toujours là.
Lorsque les filles eurent fini de chanter, il y eut des compliments de la part des jeunes gens qui, chacun se flattant d’être l’objet de ce refrain amoureux, trouvèrent la chanson fort belle. Ivan Borimetchka dévorait du regard Staïka Tchonina, à qui il faisait assidûment la cour.
– Cette ronde-là, on la chante à refrains et on la danse à pas redoublés, tonna-t-il.
Les filles riaient aux éclats, criblant Borimetchka de regards malicieux. Unissant à la taille d’un goliath la force d’un hercule, cet homme au visage osseux et rugueux était un véritable géant chez qui il n’y avait de menu que son intelligence ; un peu vexé par l’explosion de gaieté de tout à l’heure, il avait opéré une retraite silencieuse et revenait maintenant en aboyant furieusement au-dessus des têtes des jeunes filles, comme un vieux chien de berger. Le gaillard avait une voix à sa taille, qui leur fit d’abord pousser des cris d’effroi, mais aussitôt elles pouffèrent de rire et se mirent à le taquiner. L’une chanta :
Ivan, colombe bigarrée,
Ivan, peuplier élancé.
Couvrant les éclats de rire, une autre reprit :
Ivan ours décharné,
Ivan, longue perche !
De nouveaux rires fusèrent de toutes parts. Ivan sentit monter en lui la colère. Il regarda, hébété, sa Dulcinée joufflue qui n’avait guère ménagé les persiflages à son soupirant, puis il ouvrit toute grande sa gueule de boa et beugla :
Sa tante disait bien à Péïka :
– Péïka, ma fille, Péïka,
Les gens racontent, ma fille,
Les gens, nos proches voisins,
Que tu es dodue et replète,
Que tu es grosse et rondelette
Du valet de ton oncle.
– Ma tante, ma chère tante,
Laisse donc dire les gens.
Les gens nos voisins.
Si je suis dodue et replète,
Si je suis joufflue et coquette,
C’est que mon père a des biens,
Car pendant que je pétris le pain
Je mange une corbeille de raisin
Et je vide un seau de vin...
Cette raillerie cruelle fit monter le sang aux joues dg Staïka qui, du pourpre, semblèrent passer au carmin. Les ricanements de ses camarades la frappaient droit au cœur. On la blaguait sous des airs de fausse naïveté :
– Dis donc, comment peut-on manger du raisin et boire en même temps du vin ? Elle ment cette chanson.
– On le voit bien, si ce n’est pas la chanson, c’est la jeune fille qui ment...
Ces attaques perfides blessèrent Staïka. Elle jeta un regard vindicatif à Borimetchka qui triomphait et entonna, d’une voix tremblante de colère.
– Peïké-lé, fleur du jardin,
Pourvu que ton fin ouvrage
Et ma cour sans ambages
Ne soient pas en vain.
Pourvu qu’on se marie !
– Iovko-lé, valet de ferme,
Si Peïka avait aimé
Des gardiens de porcs comme toi,
Des porchers et des bergers,
Des valets sales et noirauds,
J’en aurais formé une haie,
C’est toi qui ferais le seuil,
Le seuil de ma petite porte,
Et quand je passerais, repasserais
Pour sortir et rentrer les veaux,
J’essayerais, Iovko, sur toi,
Sur toi la boue de mes sabots !
À l’affront sanglant, vengeance terrible.
Staïka toute fière regarda autour d’elle. Son dard avait frappé juste. Foudroyé, les yeux écarquillés, Ivan Borimetchka restait immobile. Tout à coup ce fut un tonnerre de rires. Sous les regards curieux qui le fixaient, des larmes de dépit jaillirent des yeux du malheureux. Elles ne firent qu’attiser les rires. Alors la femme de Tzanko se fâcha :
– En voilà des plaisanteries ! À quoi ça ressemble de vous taquiner comme ça au lieu de roucouler et de vous cajoler comme des tourtereaux ?
– Des tourtereaux, c’est ça, souffla une blagueuse, on les boirait dans le même verre !
Les rires reprirent de plus belle.
– « Qui aime bien, châtie bien », dit Tzanko d’une voix conciliante.
Ivan Borimetchka sortit, fâché, comme pour donner un démenti à ces paroles conciliantes.
– Et « Qui s’assemble se ressemble », ajouta Néda.
– Tu connais, Néda, le proverbe bulgare : « Dieu apporte son aide même à la plaisanterie » ? répondit Goran, le cousin de Borimetchka.
– Eh, les gars ! allez-y donc d’une vieille chanson haïdouk. ça va nous réchauffer le cœur ! invita Tzanko ; et les jeunes gens entonnèrent en chœur :
Pauvre Stoïan, malheureux !
Deux pièges lui tendit-on, deux,
Et puis, au troisième guet-apens
Fut pris le vaillant Stoïan ;
Ses bras mâles on lui attacha
De ses propres noires courroies
Et l’on mena ensuite le héros
Chez le pope Érine, dans l’enclos.
Le pope, comme de bien entendu,
Avait deux filles et une bru
Qui battait à la porte du lait
Cependant que les filles balayaient
Dans la cour. Les femmes disaient à Stoïan :
Baïtcho-lé, baïtcho Stoïan,
Dès l’aube tu seras, haut et court,
Pendu chez le roi dans la cour
Pour que puissent se réjouir de la peine
Les enfants du roi et de la reine.
Stoïan répondait à la bru :
Roujo-lé, belle-fille de prêtre,
À la vie je ne tiens plus peut-être,
Ni à ce monde ici-bas ;
Car jamais un preux ne pleura
Quand pour lui vint sonner le glas ;
Mais pourtant je te prie, Rouja,
Prends soin de ma chemise, qu’on la lave,
Et que mes cheveux soient bien peignés ;
Car j’aime beaucoup, Roujo-lé,
Lorsqu’on mène quelqu’un au gibet
Voir briller sa chemise de loin
Et flotter sa chevelure au vent.
Ognianov écouta avec une profonde émotion les dernières strophes de la chanson.
« Voilà, pensait-il, si sombrement calme devant la mort, ce Stoïan est le type même du légendaire haïdouk bulgare. Ni regret, ni repentir, ni espoir, il ne veut qu’être beau dans la mort ! Oh ! si ce fatalisme héroïque pouvait être transfusé au Bulgare de nos jours, je n’aurais alors aucun souci quant à l’issue de la lutte. C’est d’une telle lutte que je rêve, de pareils caractères que je cherche !... Savoir mourir, voilà la clef des victoires. »
Cependant le son aigu des kavals 88 avait succédé au chœur. Leur chant, délicat et triste tout d’abord, s’éleva peu à peu, fit briller les regards des joueurs, mit du feu sur les joues de tous, et ses notes claires vibrèrent dans la nuit qu’elles remplirent de la sauvage mélodie des montagnes. Elles évoquaient les cimes escarpées, les gorges profondes, le silence des vallées boisées, le chuchotement secret de l’ombre que recherchent les moutons à midi ; l’odorant basilic sauvage, les échos sonores des dômes et le soupir défaillant du souffle amoureux dont palpite la vallée.
Tous, fascinés par la musique chère à leurs cœurs de cette harpe des monts et des plaines bulgares qu’est le kaval, s’abreuvaient gloutonnement de poésie musicale. Debout près de l’âtre, la femme de Tzanko, les mains sur les hanches, écoutait, ravie. Ognianov lui-même, charmé, faillit applaudir à pleines mains.
Puis les rires et les conversations bruyantes reprirent. Ayant entendu son nom, Ognianov prêta l’oreille. Pètre Ovtcharov, Raïtchine, Spiridontché, Ivan l’Aiguillon et d’autres parlaient de l’insurrection.
– Moi je suis fin prêt pour la noce, je n’attends que mon revolver de Filibé 89. J’ai déjà envoyé l’argent – cent soixante-dix groches : ça fait trois béliers, disait Pètre le Berger, président du comité local.
– Mais nous ne savons pas au juste à quel moment le drapeau sera levé. On dit que c’est vers l’Annonciation qu’on va tremper les couteaux dans le sang. D’autres disent vers la Saint-Georges, tandis qu’oncle Bojil l’annonce pour la fin mai, disait Spiridontché, un beau jeune homme élancé.
– Je parie que ce sera dès que le coucou aura chanté et qu’auront repoussé les feuilles dans la forêt, mais, moi, je suis déjà prêt : on n’a qu’à fixer l’heure.
– Eh, notre vieux Balkan, qui a su accueillir tant de braves, il nous recevra nous aussi ! dit Ivan l’Aiguillon.
– Dis, Pètre, tu parlais du maître d’école : alors, il a expédié deux Turcs, hein ? C’est un brave !
– Quand est-ce qu’il passera nous voir, que je lui baise cette main qui a si bien su caresser ? demanda Raïtchine.
– Il nous a devancés, le daskal, mais nous tâcherons de le rattraper. On s’y connaît nous aussi tant soit peu, dans le métier, répondit Ivan l’Aiguillon.
C’était un garçon courageux et un tireur habile, qui passait pour avoir châtié Déli-Ahmed, l’année dernière. Les autorités locales le surveillaient de près, mais sans aucun résultat.
Au dîner, on but à la santé d’Ognianov.
– Que le bon Dieu nous l’envoie bientôt sain et sauf ! Prenez exemple sur lui, mes gars, dit Tzanko en vidant d’un trait la jatte de vin.
– Je parierais avec n’importe qui, intervint sa femme impatiente, que demain, dès l’aube, il se posera comme un faucon ici.
– Non, vraiment ? et moi qui voulais partir demain pour K... ! se lamenta Raïtchine. S’il vient, retenez-le pour le boudin. Réjouissons-nous à Noël !
– Quel est ce tumulte dehors ? cria Tzanko et, sans avoir fini de boire son vin, il se mit debout.
En effet, des voix d’hommes et de femmes se faisaient entendre dans la cour. Tzanko et sa femme se précipitèrent dehors, les invités les suivirent, mais l’hôtesse revint aussitôt et, très émue, annonça :
– Voilà, ça y est !! Que Dieu les bénisse !
– Quoi ? Qu’est-ce qu’il y a ?
– Borimetchka vient d’enlever Staïka.
Tout le monde se récria de surprise.
– Il l’a empoignée, le polisson, et il l’a emportée chez lui sur son épaule comme un agneau à la Saint-Georges !
Il y eut une rumeur joyeuse.
–Mais comment ça s’est-il passé ?
– C’est pour cela, alors, qu’il est sorti plus tôt et que son cousin Goran l’a suivi !
– Ils l’attendaient derrière les ridelles, près de la porte, poursuivait la femme de Tzanko, et il l’a emportée. Voyez-moi ce Borimetchka, qui aurait pu y penser ?
– Entre nous soit dit : « Qui se ressemble s’assemble », dit quelqu’un.
– Elle est une petite laie de Serbie bien en chair et lui une rosse de Hongrie, disait un autre en riant.
– Allons, à leur santé ! Demain on boira du raki rouge 90, dit Tzanko.
– Moi, ils me doivent bien quelque chose ; c’est mon droit, s’époumonait la femme de Tzanko. C’est moi qui les ai mariés, en somme.
Peu après, les invités égayés s’en allèrent.
32 TROP HAUT LE BON DIEU, TROP LOIN LE TSAR 91
Tzanko fit irruption dans le réduit sombre :
– Eh ! Boïtcho, est-ce qu’elle t’a plu, notre veillée ?
– Merveilleuse, magnifique, baï Tzanko !
– Et les chansons, tu les as notées ?
– Comment aurais-je pu ?... Il n’y a même pas de bougie ici, tu vois bien !
Justement, une bougie à la main, la femme de Tzanko venait les rejoindre.
– On frappe à la porte, dit-elle.
– Ça doit être quelqu’un de chez Staïka. Ils voudront peut-être que nous leur rendions leur fille. Allons, c’est le cadet de nos soucis !
Mais Donka, qui venait d’entrer, dit que c’étaient des zaptiés, amenés par le vieux moukhtar 92 Deïko.
– Qu’ils aillent tous au diable, eux et ton vieux Deïko ! Où veux-tu que je les mette, ces porcs ?... Toi, ne t’en fais pas, rassura-t-il Ognianov, mais, tout de même, il faut te mettre à l’abri. Femme, cache-le donc !
Tzanko sortit. Au bout d’un moment il introduisit deux zaptiés enveloppés de souquenilles et tout couverts de neige. Ils étaient furieux.
– Ça fait déjà une heure qu’on attend dehors, vaurien ! grogna, en secouant sa souquenille, l’un d’eux, qui était borgne.
– On a gelé jusqu’à ce que l’envie te vienne d’ouvrir, renchérit l’autre, un petit noiraud au visage marqué par la petite vérole.
Tzanko bredouillait des excuses.
– Qu’est-ce que tu marmonnes ? Tue vite un poulet et tais-nous des œufs sur le plat.
Tzanko essaya encore de placer un mot. Mais le borgne hurla :
– Assez bavardé, giaour, va plutôt dire à ta femme de préparer le dîner ! Tu ne penses pas nous offrir ta giaour de compote de pruneaux et tes coquilles de noix ? bougonnait-il en promenant son regard méprisant sur la table non encore desservie.
Comme un chien battu, Tzanko se dirigea vers la porte pour exécuter les ordres. Le petit zaptié cria derrière lui :
– Hé ! attends ! où as-tu expédié les filles ?
– Elles sont parties, il se faisait tard, répondit Tzanko, tout à coup complètement dégrisé.
– Va les chercher, qu’elles reviennent finir de manger et nous servir le raki. Pourquoi les as-tu chassées ?
Tzanko les regardait, effrayé.
– Où est ta fille ?
– Déjà couchée, aga !
– Fais-la lever, qu’elle vienne nous servir, dit le borgne qui séchait devant le feu ses molletières trempées d’où s’élevait un nuage de vapeur nauséabonde.
– N’effrayez pas mon enfant, aga, supplia Tzanko.
Le moukhtar entra et resta humblement debout.
– Espèce d’abruti ! toi aussi, tu nous as promenés pour frapper à vingt portes comme des mendiants ! C’est de force que tu nous as amenés ici ! Où est-ce que vous les cachez vos... ? (Et il gratifia les jeunes filles d’une épithète ordurière.)
Les Bulgares avalaient les injures sans broncher. Ils y étaient habitués. Le joug étranger avait déjà engendré ce proverbe si dégradant pour la dignité de tout homme libre : « Échine courbée n’est point frappée par l’épée. » Aussi Tzanko ne faisait-il qu’implorer pour sa fille la protection divine.
– Tchorbadji, demanda le borgne, vous préparez-vous à l’émeute ?
Tzanko nia hardiment.
– Et qu’est-ce que c’est que ce poignard ? demanda le courtaud en ramassant le poignard que Pètre le Berger avait laissé traîner sur le tapis.
– Alors, vous ne vous préparez pas à l’émeute, hein ? ricana sardoniquement le borgne.
– Mais non, aga, nous sommes des sujets paisibles du Sultan, répondit Tzanko, qui s’efforçait de paraître calme ; ce poignard a dû être oublié par l’un des invités.
– Lequel ?
– Je n’en sais rien, aga.
Les zaptiés étaient très absorbés par l’examen d’incrustations qu’ils avaient découvertes sur la lame du couteau. Ils y reconnurent des mots.
– Qu’est-ce que ça signifie ? demandèrent-ils à Tzanko.
Il se pencha sur le poignard : le long de la lame, incrusté en jaune, il vit des ornements et lut les mots « La liberté ou la mort 93 » et, de l’autre côté, le nom du propriétaire.
– Ce sont des enjolivures, dit-il.
De son mocassin boueux le borgne le fouetta en pleine figure.
– Giaour, je peux bien n’avoir qu’un œil, je ne suis tout de même pas aveugle.
La réponse de Tzanko avait éveillé leurs soupçons.
– Moukhtar, approche un peu !
Le moukhtar venait d’entrer, portant une tarte qu’il voulait faire cuire chez Tzanko. La vue du poignard entre les mains du zaptié le fit frissonner.
– Lis ça !
Le moukhtar lut, puis se redressa, troublé :
– Je ne comprends pas très bien, aga.
L’imberbe prit son fouet. La lanière de cuir claqua et s’enroula deux fois autour du cou du moukhtar. Un mince filet de sang coula sur sa joue.
– Sale engeance !
Le moukhtar essuyait son sang en silence.
– Lis, ou je te fourre ce couteau dans la gorge ! cria le zaptié.
Le moukhtar, hébété, comprit qu’il fallait obéir.
– Pètre Ovtcharov, lut-il en articulant avec peine.
– Tu le connais ?
– Il est du pays.
– C’est Pètre le Berger qu’on l’appelle ? demanda le borgne qui probablement entendait un peu le bulgare.
– Oui, aga, et le moukhtar lui rendit le couteau en remerciant la Sainte Trinité de ne pas avoir eu à lire les paroles terribles. Mais c’était aller trop vite.
– Regarde de ce côté aussi ! dit le zaptié.
Le moukhtar, épouvanté, se pencha de nouveau sur le poignard. Il hésitait. Mais il remarqua de son œil droit que le courtaud préparait son fouet.
– La liberté ou la mort, aga.
Le borgne sursauta.
– Liberté, hein ? ricana-t-il sinistrement. Qui fabrique ces poignards ? Où est-il donc, ce Pètre le Berger ?
– Où pourrait-il être ? Chez lui, bien sûr.
– Va le chercher...
Le moukhtar partit.
– Attends, imbécile ! je viens aussi.
Et le courtaud, jetant sur ses épaules sa souquenille, le suivit.
– Il est clair, Ioussouf-aga, que ce berger a le poil d’un loup, ajouta-t-il avant de partir.
À ce moment, Tzanko passa près de sa femme qui, en préparant le dîner, l’assaisonnait de blasphèmes :
– Qu’ils aillent au diable ! Que Dieu leur déchire les boyaux ! Qu’un os de serpent leur bouche le gosier, qu’ils crèvent, les poisons ! Moi, leur préparer de la viande juste avant Noël ! D’où viennent-ils, ces sales infidèles, pour tout gâter et nous remplir d’épouvante !
– Donka, va, mon petit, passer la nuit chez ton oncle, saute par-dessus la haie, dit Tzanko à sa fille, qui se montrait toute pâle à la porte.
– Et cet imbécile de Deïko, pourquoi les a-t-il conduits ici ? La semaine dernière, on nous en a encore amené deux autres, enchaînait sa femme.
– Il n’y pouvait rien, le pauvre ! dit Tzanko. Il les a menés un peu partout, mais c’est ici justement qu’ils voulaient venir : ils ont entendu chanter... Il a même reçu quelques coups.
Tzanko revint dans la pièce où s’était installé le borgne.
– Tchorbadji, où es-tu donc passé ? Sers-nous du raki et un peu de tourchia 94.
– Le Berger n’était pas chez lui, grogna le courtaud, qui venait de rentrer avec le moukhtar.
– On va lui mettre la main dessus, à ce komita, même si on devait pour ça retourner le village sens dessus dessous, dit en buvant le borgne.
– Et si on serrait la vis à son père ? proposa à voix basse l’autre, en ajoutant quelque chose à l’oreille du borgne, qui inclina la tête en signe d’approbation.
– Kéhaïa 95, va appeler le vieux, qu’on lui demande encore quelque chose ; prends aussi ça, dit le courtaud en lui tendant la bouteille vide.
– Mais, pour le raki, c’est déjà fermé, aga.
En guise de réponse le borgne lui colla son mocassin à la figure. D’habitude, un peu plus doux, il devenait fou furieux quand il avait bu ou lorsqu’il avait envie de boire.
Au bout d’un quart d’heure, le père Stoïko parut. C’était un homme d’une cinquantaine d’années, mais dont le visage énergique et ardent reflétait la détermination et l’obstination de son caractère.
– Stoïko, dis-nous où est ton fils – c’est toi qui l’as caché – autrement tu en pâtiras !
Ce disant, le borgne leva avidement la bouteille d’eau-de-vie. Son œil unique brillait et lançait des étincelles. Il passa ensuite la bouteille à son camarade.
– Je n’en sais rien, aga, répondit le vieillard.
– Tu le sais, giaour, tu le sais, grogna hargneusement le zaptié.
Le vieillard continuait à nier.
– Tu nous le diras bien !
– On va t’arracher les molaires et demain on te traînera à pied derrière nos chevaux, proféra le courtaud.
– Faites ce que bon vous semblera, je n’ai qu’une âme à rendre, répondit fermement le vieillard.
– Va, réfléchis un peu, autrement tu t’en repentiras, lui conseilla, avec une feinte douceur, le borgne.
Cette invitation n’était, en réalité, qu’un stratagème pour se faire graisser la patte par l’intermédiaire du moukhtar, un véritable vol déguisé sous l’apparence d’un cadeau offert ; c’était la façon habituelle de conduire ce genre de banditisme.
Mais le père Stoïko ne bougeait pas.
Les Turcs, stupéfaits par tant de témérité, lui lancèrent des regards féroces.
– Tu entends ? hurla le borgne.
– Je n’ai pas à réfléchir, laissez-moi partir, dit il sombrement.
Les zaptiés devinrent fous de rage.
– Moukhtar, renverse-le, ce vieux crétin !
Le borgne prit le fouet.
Le moukhtar et Tzanko imploraient grâce pour un vieillard. Pour toute réponse, le zaptié lui envoya un coup de pied, et il s’affaissa. Les coups commencèrent alors à pleuvoir impitoyablement sur lui. Stoïko cria d’abord, gémit, puis devint muet ; une sueur abondante coulait sur le front du bourreau, fatigué par tant de travail. Le pauvre homme fut ensuite traîné dehors afin qu’il puisse reprendre ses esprits.
– Lorsqu’il sera ranimé, faites-moi signe, je saurai le faire parler.
– Nous t’en supplions, hadji-aga, ayez pitié de ce vieil homme, il ne pourra supporter d’autres tortures, il en mourra ! intercédait Tzanko.
– Longue vie au Sultan, bandit ! cria soudain le courtaud. C’est justement toi qu’on devrait pendre : tu accueilles des komitas chez toi ! C’est toi sans doute qui caches le Berger ! On ferait bien de chercher un peu par ici.
Tzanko changea soudain de couleur. Le borgne avait beau être étourdi par l’eau-de-vie, il remarqua son trouble. Aiguillonné, il se tourna vers son camarade :
– Viens, Ioussouf-aga, on va fouiller un peu. Il doit y avoir quelque chose chez ce giaour.
Il se leva.
– Venez donc, dit sourdement Tzanko, les précédant avec une lampe.
Il les mena partout, laissant le réduit pour la fin. Il l’éclaira aussi. Sur le plafond noirci il y avait un trou qui, lorsqu’il était bouché, était invisible. Tzanko savait que par là Ognianov avait dû se faufiler au grenier et qu’il devait avoir replacé l’invisible couvercle. Aussi y introduisit-il les deux Turcs avec assez de calme.
Son premier regard alla au plafond : le trou béait, grand ouvert.
Tzanko resta pétrifié. Les Turcs examinèrent le réduit.
– Qu’est-ce que ce trou ?
– Il mène au grenier, souffla Tzanko qui, les jambes flageolantes, fut obligé de s’appuyer au mur.
Le courtaud remarqua son épouvante.
– Éclaire un peu mieux, que je monte, dit-il. Mais une pensée désagréable lui traversa l’esprit et il pria son ami de monter à sa place.
Hassan-aga s’enhardissait lorsqu’il avait bu son saoul ; la boisson le rendait féroce et allumait son sang de mauvais coucheur dans ses veines. Il monta sur le dos du moukhtar.
– Tchorbadji, passe-moi la lampe !
Tzanko, blanc comme un linge, lui passa machinalement la lanterne.
Le borgne introduisit le faisceau de lumière dans le trou, puis y passa sa tête. On reconnaissait aux mouvements de son corps qu’il se tournait de tous côtés, lanterne à la main.
Puis il se baissa, sauta sur le plancher et dit :
– Tchorbadji, qui avais-tu caché ici ?
Tzanko le regardait, anéanti. Il ne savait que répondre. Cette nuit-là, il avait éprouvé tant de craintes et d’épouvante qu’il croyait rêver. Ses pensées s’obscurcirent. Aux questions réitérées il répondit de l’air peureux d’un coupable.
– Ses réponses seront plus claires à Klissoura. La prison y est meilleure. Pour cette nuit il sera bien ici...
Et les zaptiés l’enfermèrent dans le réduit sombre. Tzanko était si profondément bouleversé qu’il lui fallut plusieurs minutes pour se ressaisir. Il se prit la tête à deux mains comme s’il essayait de retenir de la sorte le peu de raison qui y restait. Comme il manquait de fermeté, les souffrances eurent vite fait de l’abattre. Il se mit à geindre et à gémir désespérément.
La porte s’entrouvrit et il entendit la voix de Deïko :
– Qu’allons-nous faire maintenant, Tzanko ?
– Je ne sais pas, baï Deïko, que me conseilles-tu ?
– Tu connais bien le faible des Turcs. Ferme les yeux et lâche tes sous, pourvu que tu t’en tires. Autrement ils vont te traîner de konak en tribunal jusqu’à ce que tu ne sois plus qu’une loque. Pauvre vieux Stoïko, avec pas grand-chose il aurait pu s’en tirer aussi. Tzanko, lâche donc tes sous, c’est bien le moment de faire usage de ce que tu as épargné.
Sa femme arriva aussi, tout en larmes.
– Tzanko, donnons tout ce que nous avons. Tu ne sortiras pas vivant des mains de ces assassins. Le père Stoïko est déjà mort. Mon Dieu, mon Dieu, quels temps nous vivons !
– Qu’est-ce qu’on peut donner, femme ? Tu sais bien que nous n’avons pas d’argent.
– Donnons la chaîne d’or.
– Le collier de ducats de Donka ?
– Oui, c’est tout ce qu’on a, donne-le, pourvu qu’on soit débarrassé de cette peste... Écoute, ils demandent Donka, les maudits chiens !
– Vas-y, femme, fais ce que Dieu te conseille, moi je perds la raison, gémissait Tzanko dans l’obscurité.
Sa femme et Deïko sortirent.
Peu après, la lueur d’une bougie pénétra par les fentes du réduit puis la porte s’ouvrit.
– Tzanko, sors d’ici, calme-toi, dit Deïko. Ce sont des braves gens, ces agas, et même, pour que tu sois tout à fait tranquille, ils te rendent le poignard. On l’a eu à bon compte, quand même.
Puis se penchant à l’oreille de son ami, il lui murmura :
– Un peu de patience encore et alors ce sera eux ou nous, que ça finisse au moins une bonne fois pour toute. Ce n’est plus une vie ça !
33 LES VAINQUEURS RÉGALENT LES VAINCUS
Sur ces entrefaites, Ognianov frappait à la porte de Pètre Ovtcharov. Incapable de supporter davantage le spectacle ignoble des zaptiés déchaînés qu’il avait observés par une fente du plafond, il n’avait pu résister davantage au désir de vengeance sanglante qu’appelaient les méfaits de ces criminels et qui auraient pu le pousser à des actes insensés, aux conséquences désastreuses. Bondissant comme un fou dans la rue, il avait couru tout droit à la maison du père Stoïko. La porte s’ouvrit.
– Où est Pètre ? demanda-t-il à brûle-pourpoint, oubliant complètement qu’il devait encore se cacher.
– Est-ce toi, daskal ? s’enquit la mère à travers ses larmes.
– Pètre, votre fils, où est-il ?
– J’te le dirai, mais prends garde, mon garçon, qu’ils n’entendent pas, ceux-là... Pètre est chez Borimetchka.
– Où est-ce qu’il habite, lui ?
– À côté de la maison du pope, le portail neuf. Et prends bien garde, mon petit !
La pauvre femme ne soupçonnait pas que son mari était en train de rendre l’âme. Ognianov s’élança. Il ne sentait plus ses jambes. Lorsqu’il fut près de la maison du pope, un groupe joyeux de jeunes gens vint à sa rencontre. Ognianov reconnut la voix de Pètre. Il les arrêta.
– Le maître d’école ! s’écrièrent-ils.
– C’est bien moi, frères, où allez-vous ?
– On a été chez Borimetchka, répondit Pètre ; cette nuit il a pris femme, alors il fallait bien arroser ça. Faut voir comme ils s’entendent à présent ! On dirait qu’ils étaient faits l’un pour l’autre. Et toi, quand est-ce que tu es arrivé ?
– Pètre, j’ai à te parler.
Les autres s’écartèrent.
– Adieu ! bonne nuit ! dit Pètre, prenant congé de ses camarades, puis en hâte il suivit Ognianov.
Ils arrivèrent à la maison.
– Père est rentré ? demanda-t-il à sa mère.
– Pas encore, mon fils.
Ognianov l’entraîna à la cave.
– Écoute, Pètre, je t’ai déjà dit, on a maltraité ton père, à cause de toi. Ces gredins peuvent faire encore pis chez Tzanko. Nous ne pourrions les empêcher que les armes à la main. Moi-même, tout à l’heure, je pouvais leur fendre le crâne mais j’avais peur des conséquences.
– Nous ne devons même pas approcher la maison de Tzanko.
– Je dois me venger, frère ! criait Pètre, hors de lui.
– Moi aussi je ne demande que vengeance, Pètre, une vengeance terrible, mais néanmoins sans dangers pour nous.
– Que faire ? demanda Pètre en décrochant son fusil du mur.
– Prends patience, réfléchissons.
– Je ne peux pas réfléchir ! Je n’en suis pas capable ! Je dois aller voir ce qu’on fait de mon père !
L’impétueux Ognianov était maintenant forcé de faire entendre raison à plus violent que lui et d’empêcher une action aux conséquences fatales, bien qu’elle fût aussi naturelle que périlleuse. Le sang coulerait si Pètre se rendait chez Tzanko. Pour Ognianov, l’heure de la lutte décisive n’avait pas encore sonné. La perte prématurée et inutile d’un brave tel que Pètre devait être évitée.
Pourtant ses efforts restaient vains. Pètre se démenait comme un tigre :
– Même si le monde entier devait crouler, il me faut venger mon père !
Repoussant violemment Ognianov, qui le retenait, il s’élança vers la porte.
Ognianov, impuissant devant l’impétuosité de ce caractère indomptable, s’arrachait les cheveux.
Mais avant que Pètre eût atteint la porte, on vint y frapper du dehors. Il arma son fusil, puis ouvrit. Trois Bulgares, voisins de Tzanko, apportaient, dans une couverture, le cadavre du père Stoïko.
– Que soit sauve ta vie 96, Pètre ! dit, en employant une phrase toute faite, l’un des paysans.
La cour s’emplit des cris et des pleurs des femmes. La mère, se jetant éplorée sur le corps déjà froid de son époux, lacérait ses vêtements. Pètre, brisé par la douleur, fut de nouveau entraîné à la cave par Ognianov. Les larmes aux yeux, celui-ci s’ingéniait à le retenir car, abasourdi tout d’abord à la vue de son père mort, le jeune homme recommençait à se démener et à crier vengeance.
– Vengeons-nous, frère, vengeons-nous, lui répétait Ognianov en le serrant contre sa poitrine ; il n’y a plus désormais pour nous de devoir plus sacré.
– Du sang ! Du sang ! criait Pètre en proie à une rage folle. Mon père chéri, ils ont brisé tes vieux os, ces maudits chiens. Oh, mère ! que deviendras-tu maintenant, ma pauvre vieille ?
– Calme-toi, frère, ne te laisse pas aller, durcis ton cœur, notre vengeance sera terrible !
Ayant atteint ce comble où la souffrance par son intensité même commence à s’émousser, la rage de Pètre s’apaisait peu à peu. Après avoir fait jurer Ognianov, devant l’icône, l’Aiguillon et Spiridontché que les zaptiés ne seraient pas laissés en vie, Pètre consentit enfin à rester chez lui.
– Et ce Borimetchka donc, quel bon moment il a choisi pour se marier ! fit l’Aiguillon, désolé. Sans cela on l’aurait emmené lui aussi ; il nous manquera, ce dragon !
Le plan de vengeance était le suivant : garder le défilé de Liaskovo, où passe vers l’ouest la route de Klissoura. Le ravin boisé où descend, pour se jeter, tout près de là, dans la Stréma, la petite rivière de Bélachtitsa leur servirait d’embuscade. Ils décidèrent d’y guetter les deux Turcs, de les attaquer à l’arme blanche et de cacher ensuite leurs cadavres dans le fourré. Mais, pour parer à toute éventualité, ils allaient emporter aussi leurs fusils, dont, toutefois, ils n’useraient qu’à la dernière extrémité. Ce plan tenait compte des renseignements fournis par Deïko sur les intentions des zaptiés : ceux-ci, devant se rendre d’urgence à Klissoura, allaient se lever de très bon matin, avant le second chant du coq ; ils lui avaient même, à cette intention, donné l’ordre de les réveiller bien avant l’aube.
Les coqs chantèrent au moment où la petite troupe quittait le village assoupi. La neige tombait à gros flocons. Un blanc linceul recouvrait la route, ce qui permettait de mieux voir. Fusils cachés sous leurs souquenilles, les voyageurs, qu’aucun bruit ne trahissait, avançaient, comme des revenants à la veille de Noël, marchant en silence dans la neige épaisse qui ne cessait de tomber. Elle remplissait les fossés et ralentissait leur marche mais, absorbés par une seule pensée – la vengeance – ils n’en avaient cure. Les cris de douleur de Pètre, leur ami, les gémissements de sa mère résonnaient encore à leurs oreilles. Ils n’avaient qu’une crainte : celle de laisser échapper les zaptiés, tout le reste ne comptait pas. Ainsi marchèrent-ils longtemps en silence. Soudain un aboiement remplit la solitude derrière eux. Ils se retournèrent, étonnés.
– Des chiens à cette heure-ci ? demanda Boïtcho.
– C’est étrange, dit Spiridontché, inquiet.
Les aboiements reprirent de plus belle et bientôt ils virent une grande forme dégingandée, qui ne ressemblait en rien à un chien, gambader sous les arbres ; c’était plutôt un monstre, quelque ours gigantesque, debout sur ses pattes de derrière.
Boïtcho et Spiridontché reculèrent instinctivement, s’adossant à un tronc d’arbre et se préparant à se défendre contre cet ennemi inconnu, mais déjà il les rejoignait.
– Borimetchka ! crièrent-ils en chœur.
– Lui-même ! Vous l’aviez oublié, tonnerre de Dieu !
C’était en effet lui, Borimetchka. Lorsqu’il avait entendu le tumulte dans la rue, il s’était rendu chez Pètre, où on l’avait mis au courant de tout. Sans perdre une seconde, il était rentré chez lui, avait envoyé Staïka chez sa mère, avait piqué la hache à sa ceinture et s’était précipité à la suite de la bande, pour prendre part à son action punitive.
La présence de ce renfort appréciable stimula encore les jeunes gens.
– Maintenant, en avant ! dit l’Aiguillon.
– En avant ! répéta Ognianov.
– Mais attendez donc l’autre aussi, dit Borimetchka.
– Quel autre ? demandèrent-ils, étonnés.
– Danaïl, le frère cadet de Pètre, il m’accompagne.
– Mais pourquoi l’amènes-tu ?
– C’est Pètre qui l’a envoyé, pour qu’il voie de ses propres yeux ce qui va se passer.
– Alors, il n’a pas confiance en nous ?... On a pourtant prêté serment !
– Qu’est-ce que ça prouve, des serments ! Moi non plus je ne vous crois pas.
– Allons donc !
– Vous êtes partis sans Borimetchka ! tonnerre de Dieu !
Ce « tonnerre de Dieu ! » qu’il employait à tout propos exprimait mieux et avec plus d’astuce qu’il ne l’aurait pu faire autrement ses sentiments et ses pensées.
– Il ne faut pas nous en vouloir, Ivan, dit l’Aiguillon, nous avons bien pensé à toi, mais tu es jeune marié...
– Ah, voici Danaïl !
Le garçon les rejoignit, à bout de souffle ; il ne portait pour toute arme qu’un long couteau enfoncé dans sa ceinture.
De trois, le nombre des compagnons était monté à cinq.
Ils poursuivirent leur route en silence ; longeant toujours le plateau de la Sredna-Gora, d’où prend naissance le mont Bogdan et d’où descend la Bélachtitsa, qu’ils atteignirent enfin. L’endroit était vraiment propice à l’embuscade. À droite, la Stréma, que les Turcs devaient traverser ; à gauche, un ravin profond, couvert de fourrés épais et au-dessus la montagne. Le groupe s’arrêta. Il était à environ une heure de marche d’Altanovo, d’où, le cas échéant, on n’aurait pas pu entendre les coups de feu. Quand ils s’installèrent dans les buissons, l’aube commençait à poindre. La neige tombait en petits flocons drus. Bien camouflés par les buissons, les amis attendaient patiemment, le regard fixé vers l’est, par où devaient venir les deux zaptiés. Mais ce qu’ils entendirent tout d’abord fut le hurlement des loups. Il commença quelque part au-dessus de leurs têtes, puis devint de plus en plus proche : les loups descendaient sans doute vers la plaine pour y chercher leur petit déjeuner.
– Ils viennent de notre côté, dit Ivan l’Aiguillon.
– Pas de coups de fusil !
– Nous travaillerons avec les couteaux et les crosses, vous m’entendez ? dit Ognianov.
Tout le monde prêta l’oreille. Un bruissement léger dans les buissons indiquait que la meute approchait en courant. Les hurlements reprirent. Il faisait déjà grand jour.
– Ces maudits loups, ils vont tout gâter..., gémit Ognianov.
Au même moment les loups apparurent dans la clairière devant eux et s’arrêtèrent. Levant leurs museaux pointus ils commencèrent à hurler. D’autres les rejoignirent.
– Huit ! chuchota Borimetchka. Je vous en laisse quatre, les autres sont pour moi.
Ayant bien examiné leur proie, les bêtes affamées se jetèrent sur le buisson, qui devint aussitôt une place forte, attaquée par les loups, défendue par les hommes. Couteaux et poignards entrèrent en action ; les fusils se levaient et s’abaissaient. Au milieu de hurlements et de grincements atroces quelques bêtes roulèrent hors du buisson, d’autres s’occupèrent aussitôt de ces compagnons tombés, qui furent dévorés vivants ; enfin les autres loups furent chassés du buisson, d’où Ivan Borimetchka faisait de temps à autre des sorties, aboyant comme un chien de berger et cognant de sa hache sur les têtes. Il ressemblait à Gédéon 97 qui, armé d’une mâchoire d’âne, mettait en déroute les armées des Philistins.
Bientôt les loups furent chassés sur le coteau au-delà du ravin, où ils s’accroupirent pour lécher leurs plaies. Par bonheur, personne n’était passé tant qu’avait duré le combat.
– Les loups ne s’en vont pas, remarqua Ognianov.
– Tiens, il y en a même d’autres qui se sont joints à la troupe.
– Qu’ils attendent ! on va les régaler, ça les aidera à se souvenir des noces de Borimetchka, dit Spiridontché.
– Tonnerre de Dieu ! ronronna avec suffisance Borimetchka.
Un temps s’écoula.
Les Turcs n’apparaissaient toujours pas, bien qu’à travers le grand silence le second chant des coqs se fût fait entendre depuis un moment déjà. Il faisait de plus en plus clair ; les silhouettes des arbres se détachaient plus distinctes et les jeunes gens qui gelaient à leurs postes commençaient à perdre patience. Il leur vint à l’esprit que les zaptiés avaient pu passer inaperçus, à moins que, à cause de la neige, qui avait tout recouvert pendant la nuit, ou par prudence, ils n’aient remis leur départ. Il ne restait plus que très peu de temps pour agir, bientôt il ferait grand jour, la route serait de nouveau fréquentée, plus rien alors ne serait possible ! Ces pensées roulaient dans l’esprit de chacun ; l’impatience augmentait, devenait intolérable, un vrai supplice. L’Aiguillon, découragé, poussa un profond soupir.
– Nous les attendrons jusqu’au bout sans bouger d’ici, dit, d’une voix sourde, Ognianov.
– Mais si, par hasard, il y a d’autres voyageurs ?
– On les laissera poursuivre leur route, il ne nous faut que ces deux-là.
– Mais alors, ce serait une attaque ouverte !
– S’il n’y a pas d’autre moyen, oui.
– On fera feu d’ici et puis à nous la montagne. Personne ne nous verra, dans la forêt, dit l’Aiguillon.
– Bon. Mais s’ils nous arrivent en compagnie d’autres Turcs ?
– Alors il y aura une vraie bataille. Nous avons des armes, une bonne position, dit Ognianov ; seulement faites bien attention : on a juré devant l’image de Dieu de ne pas les laisser vivants.
– Tonnerre de Dieu !
– Une seule chose me fait peur, les gars ! dit Boïtcho.
– Quoi ?
– Qu’ils n’aient pris un autre chemin...
– Ne t’en fais pas pour ça, dit l’Aiguillon. Il n’y a pas d’autre route, sauf s’ils rebroussent chemin ! Il nous faudra de l’endurance, alors !
Borimetchka, debout, regardait au loin, vers l’est.
– Quelqu’un vient, dit-il.
Tous les visages se tournèrent dans la direction indiquée. Deux cavaliers apparurent entre les arbres qui longeaient la route.
– Des cavaliers ! fit Ognianov avec dépit.
– Ce n’est pas ceux que nous attendons, dit Spiridontché.
– Les nôtres vont à pied, en effet, dit l’Aiguillon.
– Tonnerre de Dieu !
Ognianov était troublé et furieux ; il continuait à fixer les deux cavaliers qui avançaient côte à côte sur la route. Bientôt ils ne furent plus qu’à une centaine de pas.
– Ce sont les nôtres, s’écria-t-il joyeux, les nôtres ! Oui, ce sont eux, je les ai reconnus à leurs souquenilles et à leurs visages. Le borgne est de l’autre côté.
Tous, l’arme à la main, suivaient du regard les deux zaptiés qui avançaient tranquillement.
– Moi, j’ai reconnu le cheval de Tzanko, dit Spiridontché.
– Et l’autre, c’est le mien, ajouta Ognianov.
– Ils les ont pris de force !
Se rendant compte que les Turcs pourraient facilement leur échapper, Ognianov se rembrunit. Impossible d’agir avec les couteaux, ils devront donc se servir des fusils et les coups de feu pourront les trahir. Les chevaux étaient un souci de plus...
– Advienne que pourra ! murmura Ognianov.
– Avec les fusils !
– Attention, les gars ! tâchons de réussir dès le début
– Lorsqu’ils seront près de l’orme, on tire, dit l’Aiguillon.
– Le borgne est à moi, fit Borimetchka.
– Pour Borimetchka et Spiridontché, le borgne ; moi et le daskal on prend l’autre, commanda l’Aiguillon.
Les cavaliers atteignirent l’orme. Les canons des fusils pointèrent à travers le fourré et leur salve éveilla les échos voisins. Les jeunes gens s’efforcèrent de percer du regard le rideau de fumée. Le borgne était tombé, l’autre avait glissé sur le côté.
Les chevaux regimbèrent puis s’arrêtèrent.
– Lequel des deux a tué mon père, daskal ? demanda Danaïl, sortant le premier du buisson.
– Le borgne, celui qui est tombé.
Danaïl s’élança vers la route. En deux secondes, il fut sur le misérable assassin de son père qu’il se mit à taillader à coups de yatagan.
Lorsque ses camarades le rejoignirent, il cognait toujours, acharné comme un fou ou comme une bête féroce. Le Turc, encore vivant, n’était plus qu’un amas de chair tailladée. Sur la neige épaisse, déjà imbibée, le sang commençait à former des flaques.
Ognianov se détourna, secoué d’horreur et de dégoût à la vue de cette boucherie. Il en aurait été indigné si ç’avait été l’œuvre d’un lâche, mais le frère de Pètre était incontestablement un brave, et seule sa soif de vengeance pouvait le pousser à cette bacchanale sauvage. Ognianov pensait :
« Vengeance féroce, bestiale, que Dieu pardonnera et que la conscience justifie. Il est assoiffé de sang, mais c’est un beau trait. Pendant cinq siècles le Bulgare n’a été qu’un doux agneau, mieux vaut qu’il soit un loup. Les hommes ont plus d’estime pour le bouc que pour la chèvre, pour le chien que pour le bouc, pour le tigre sanguinaire que pour le loup et l’ours, pour le faucon carnassier que pour la poule, qui lui offre un mets délicat. Pourquoi ? parce qu’ils sont la personnification de la force et que la force, c’est le droit et la liberté. La philosophie a beau s’épanouir ; la nature reste ce qu’elle est. Le Christ a dit de tendre aussi l’autre joue. C’est sublime et je m’incline, mais j’aime mieux Moïse, qui a dit : « Œil pour œil, dent pour dent ! » C’est naturel et c’est ce que je pratique. Tel sera le principe cruel et sacré qu’il nous faudra mettre à la base de notre lutte contre les tyrans. Avoir de la pitié pour les impitoyables serait aussi lâche que d’en attendre d’eux. »
Absorbé par ces réflexions troublantes, passionnées et cruelles comme l’instant même qu’il vivait, et tellement contraires à sa nature clémente, Ognianov se tenait auprès du cadavre, contemplant sans la voir la neige qui recouvrait les flaques rouges et la chair hachée, mêlée de lambeaux d’étoffe.
Soudain il aperçut dans ce tas ensanglanté et difforme un collier de menues monnaies d’or ; il les montra à Spiridontché.
– Prends-les, tu les donneras à des pauvres, qu’ils mettent pour Noël un peu de beurre dans leur ragoût.
Spiridontché éleva le collier du bout de la baguette de son fusil.
– Le maudit chien ! Quel Bulgare aura-t-il dépouillé ?
– Mais c’est la chaîne de Donka ! Elle-même, cria-t-il, éperdu et effrayé. (Il était fiancé à Donka.)
– C’est sans doute la rançon de ton beau-père, dit Ognianov.
– Mais je ne vois que la moitié du collier ; l’autre moitié doit être dans cette ordure.
Dégoûté, Spiridontché se mit à fouiller dans le tas du bout de sa baguette. Mais la seconde moitié était chez l’autre zaptié, que le borgne s’était fraternellement associé au butin, comme au châtiment.
En même temps, Borimetchka, armé de sa hache, donnait le coup de grâce au courtaud. Les deux cadavres furent traînés dans le fourré... Pendant ce temps, le cheval de Tzanko revenait en courant au village, tandis que l’autre, ayant flairé la présence proche des loups, traversait la Stema et fuyait, la queue en l’air, à travers champ...
– « Œil pour œil, dent pour dent ! » continuait à murmurer inconsciemment Ognianov.
Dès que les jeunes gens se furent éloignés, les loups approchèrent. La nature et la bête s’unirent pour détruire les traces du juste châtiment.
La neige tombait toujours.
Il faisait déjà jour. Les environs étaient encore déserts. Pas une âme sur la route ou dans les champs enneigés. L’heure matinale et la neige profonde retenaient les voyageurs au lit. Ainsi la mort des Turcs n’eut pas de témoins. La compagnie, toutefois, ne voulait pas se faire remarquer en revenant au village. La route qu’avaient empruntée les jeunes gens ne pouvait plus être déserte à cette heure ; par surcroît, elle desservait des moulins. Après s’être consultés, ils décidèrent d’escalader le versant septentrional, très boisé, du mont Bogdan, pour redescendre de l’autre côté au village. Cette route, quoique difficile, presque impraticable, était déserte et abritée. On renvoya Danaïl tout droit au village.
34 LA BOURRASQUE
Le sentier que prirent les gars pour sortir de la vallée de la Bélachtitsa serpentait sur la croupe boisée de la montagne. Borimetchka, qui connaissait le pays, allait devant, fusil à l’épaule. La marche dans le sentier enseveli sous la neige devenait de plus en plus pénible. Au bout d’une demi-heure, les visages hâlés des jeunes montagnards ruisselaient comme s’ils avaient grimpé pendant des heures. Ils arrivèrent à une corniche. La neige avait cessé de tomber ; le soleil perça bientôt à travers la brume légère, inondant monts et vallées de sa lumière éblouissante. La neige étincelante brillait au soleil de l’éclat du diamant, telle la chemise d’une sultane de Bagdad. Dans la vallée réveillée, des spirales de fumée s’élevaient dans l’air matinal. Des silhouettes se mouvaient çà et là, creusant des passages dans les routes enneigées. Altanovo se détachait nettement au pied même du mont.
L’animation naissait. Les jeunes gens aperçurent une masse sombre se dirigeant vers l’extrémité du village, là où se trouvait le cimetière ; ce devait être l’enterrement du vieux Stoïko ; on entendait la cloche...
Mais, endormis majestueusement sous leur linceul virginal, les crêtes et les sommets montagneux étaient inaccessibles. À l’ouest, l’imposant Ribaritsa élevait dans le ciel sa gigantesque coupole entourée de sommets plus bas ; son front restait enveloppé de nuages floconneux, mouvants comme une fumée légère. Au nord, immergé dans une mer de blancheur et de soleil, le Balkan rayait d’un trait droit l’horizon. Habituellement sombre et renfrogné, il était à présent éclatant d’une splendeur où seul le gris du lit des torrents restés nus mettait une touche sévère. Son dos, plat comme un mur, s’étendait jusqu’au pic d’Ambaritsa, où commence la chaîne de ses sommets géants.
La compagnie s’arrêtait de temps à autre pour admirer en silence ce splendide tableau hivernal. Le malheur de Pètre, et la vengeance qui avait suivi, les assombrissaient et les rendaient muets. Les brefs lambeaux de phrases qu’ils échangeaient concernaient uniquement l’itinéraire à suivre. Parfois l’un d’eux s’enfonçait dans la neige et c’est à grand-peine qu’ils l’en sortaient, la force herculéenne de Borimetchka leur était alors d’un grand secours. En dépit de haltes fréquentes, ils s’épuisaient ; la faim les tenaillait ; puis une brise glacée se mit à souffler, fouettant les visages, glaçant les nez, les oreilles, les mains. La forêt devenait de plus en plus épaisse et inhospitalière. Plus aucune trace de sentier ! il fallut s’arrêter. Une épaisse futaie de hêtres, rendue inextricable par la neige entassée, leur barrait le chemin ; la bourrasque redoublait d’intensité.
Ils échangèrent des regards soucieux.
– Alors, revenons sur nos pas jusqu’à la vallée et prenons la route du village, quoi ? dit Spiridontché.
– Non, rétorqua l’Aiguillon, changeons de direction, mais ne retournons pas.
Les autres aussi étaient de son avis. Après s’être brièvement concertés, ils décidèrent de revenir un peu en arrière, de tourner ensuite à droite en tâchant de franchir la futaie pour arriver à la clairière qui se trouve sur la crête et de descendre enfin dans le ravin du côté opposé.
– C’est là qu’est la cabane de Ditcho, dit l’Aiguillon, on va s’y réchauffer un peu et se mettre quelque chose sous la dent. Plus moyen de tenir les fusils comme ça.
– D’accord, reprit Ognianov en tournant le dos à la bise, arrêtons-nous à la cabane, tout d’abord pour nous restaurer un peu et puis pour essayer d’apprendre ce qui se passe à Altanovo. Il ne faut pas y descendre à l’aveuglette.
Il aurait pu ajouter une autre raison : la douleur à la jambe qui, avivée par la marche et le froid, avait repris de plus belle.
– C’est vrai, dit Spiridontché, le cheval de Tzanko a dû rentrer et l’alerte est donnée.
– Quant à ça, ne vous faites pas de souci, dit l’Aiguillon, à l’heure qu’il est, les loups ont sûrement dévoré jusqu’aux os les zaptiés... Si les Turcs vont les chercher, ils ne trouveront que des hardes. Et la neige a recouvert tous les chiffons ensanglantés sur la route ; j’ai regardé le cheval de Tzanko, il ne portait aucune trace de sang.
Ils arrivèrent à la clairière et se consultèrent de nouveau sur la direction à prendre.
Ivan Borimetchka examinait attentivement le ciel. Les autres attendaient son avis.
– Dépêchons-nous de gagner la hutte. Ribaritsa ne me dit rien qui vaille, tonnerre de Dieu ! dit-il, sérieux.
Alors la compagnie tourna vers le nord-est et se remit à grimper péniblement. Le vent soufflait avec rage, soulevant leurs vêtements, pénétrant dans leurs cous, tourbillonnant sous leurs chemises. À chaque pas, la bourrasque mugissait plus intense. Peu à peu Ognianov se laissa devancer par les autres. Il sentait ses forces l’abandonner ; ses oreilles bourdonnaient, il était près du vertige ; il avait conscience de son épuisement extrême mais ne voulait pas crier qu’on l’attende ; d’ailleurs, le vent aurait emporté sa voix. Il se fiait à son indomptable volonté pour arriver au but, même si ses muscles le trahissaient. Mais, fût-il doué de forces morales exceptionnelles, l’homme est finalement contraint de céder à l’action des lois de la nature ; aucun effort de volonté, aucune puissance de l’esprit ne peuvent élever la force physique au-delà d’une certaine limite ; certes l’esprit peut agir sur l’activité du corps, mais son effet se borne à exciter et à appliquer la force, qu’il est incapable d’engendrer.
La montagne tout entière rugissait ; le souffle glacé de la tempête pétrifiait les membres et glaçait le sang dans les veines. Comme les flots tumultueux et froids de la mer, la rafale se jouait des voyageurs et les rayons du soleil semblaient piquer leurs chairs plutôt que les réchauffer. Ils furent d’ailleurs bientôt complètement engloutis par la bourrasque qui remplissait l’air de tourbillons de neige. Dans sa danse enragée, l’ouragan mugissait comme l’enfer ; le soleil disparut, englouti dans un chaos blanc de flocons volant à des vitesses vertigineuses. Et l’ouragan hurlait toujours, gémissait, mugissait comme si le monde allait s’écrouler.
Cela ne dura guère que deux minutes. Puis la tempête se transporta sur un autre sommet que happa sa trombe furieuse. Le soleil réapparut, tout pâle, éclairant d’une lumière glacée le ciel incolore.
Les jeunes gens, couchés au pied d’un rocher abrupt, qui les protégeait contre la violence des éléments déchaînés, étaient par miracle restés indemnes. Ils se soulevèrent un à un comme s’ils sortaient du sommeil de la mort. Engourdis, ils ne sentaient plus leurs membres et le froid les assoupissait : c’était justement là que résidait le plus grand danger. Ivan Borimetchka fut le premier à se ressaisir. Il cria :
– Hé, levez-vous et courez, autrement on va geler !
Ils sursautèrent, serrèrent leurs fusils sous les bras et se reprirent à escalader la pente mais, soudain, Borimetchka les arrêta :
– Hé, dites donc ! et le daskal ?
Ils tournèrent de tous côtés des regards effrayés : Ognianov n’était pas là.
– La tempête l’a emporté !
– La neige l’a enseveli !
Ils se dispersèrent pour le chercher. Le précipice qui s’ouvrait à leurs pieds les faisait reculer d’horreur ; ils n’osaient y regarder.
– Le voilà, cria tout à coup l’Aiguillon.
Au bord même de l’abîme, apparaissaient deux pieds chaussés de mocassins. En fouillant la neige, on retira Ognianov inanimé, raidi, le visage bleui.
– Tonnerre de Dieu ! grogna Borimetchka, apitoyé.
– Frottez-le bien, frères ! cria l’Aiguillon, et il se mit lui-même à frictionner avec de la neige la figure, les bras, la poitrine d’Ognianov. Il est encore chaud, pourvu qu’il s’en tire !
Ils oublièrent tout, absorbés par l’unique pensée de sauver leur ami. Leurs efforts énergiques le firent bientôt revenir à lui et eurent en même temps une action bienfaisante sur eux-mêmes. Leur sang bouillonnait.
– Et maintenant, vite à la cabane ! cria l’Aiguillon.
Soulevant Ognianov, ils le portèrent sur les pentes enneigées du mont Bogdan. Là encore, les bras puissants de Borimetchka furent d’un grand secours. Après des efforts inimaginables, ils atteignirent enfin le chalet.
33 DANS LA CABANE
Blottie dans la déclivité d’une clairière, la cabane de Ditcho était abritée des vents par les hauts sommets environnants. Dans la partie nord du vaste enclos qui l’entourait, à côté des meules de foin et de feuilles sèches, nourriture pour la mauvaise saison, se réfugiait sous un large appentis le troupeau de moutons et de chèvres. La cheminée du refuge des bergers, gardiens d’hiver du troupeau, fumait joyeusement. Un chien s’élança au-devant des voyageurs, mais, ayant reconnu Ivan l’Aiguillon, il se frotta à ses jambes. Ognianov fut déposé dans la cabane accueillante et la friction recommença. Le petit berger qui se trouvait là se rendait utile, lui aussi : il enleva les mocassins de Boïtcho et se mit à frotter ses pieds avec de la neige. Lorsque, enfin, Ognianov et ses compagnons se virent hors de tout danger, ils rendirent grâce à la Providence. Le berger rajouta du bois au feu. Tous s’installèrent autour du foyer, se gardant bien, toutefois, d’en approcher trop leurs mains ou leurs pieds. Le chien, d’instinct, s’accroupit auprès de l’entrée.
– Dis, Obreïko, et ton oncle Kaltcho, où est-il à cette heure ? demanda l’Aiguillon.
Kaltcho était le frère de Ditcho et il gardait la cabane en hiver.
– Il est descendu au village hier soir, je l’attends d’un moment à l’autre.
– Fais voir, mon petit gars, ce qu’il y a dans ton sac à vivres.
Le berger étala ses provisions : quelques croûtons secs de pain de seigle, de l’oignon, du sel et de la tchoubritsa 98.
– T’as pas une goutte d’eau-de-vie, Obreïko ?
– Y en a pas.
Saperlipopette ! Un peu de raki aurait rudement fait du bien au daskal, dit l’Aiguillon avec un regard vers Ognianov qui, tout recroquevillé, se tordait les mains de douleur.
– Tout est bien qui finit bien, daskal... Tu l’as vue, notre Sredna-Gora, quelle drôlesse !
– Dieu soit loué qu’il ne vous soit rien arrivé à vous ! dit Ognianov.
– Hé ! tout de même, elle ne fait pas de mal à ses vieux amis.
– Si tu veux savoir, remarqua l’Aiguillon, c’est le Balkan, la Stara-Planina, qui nous l’a envoyée, cette tempête, Borimetchka ne se trompait pas.
– Ben ! il n’est pas né d’hier, Borimetchka, tonna celui-ci en signe d’approbation.
Le chien donna de la voix. Celle d’Ivan l’irritait. Ognianov dévisagea l’homme avec curiosité. Involontairement il l’associait dans sa pensée au sobriquet qu’on lui avait donné et qui lui allait comme un gant. Rien n’aurait pu mieux convenir à cet homme à grosse tête, à ce géant sauvage et mal dégrossi, qui semblait avoir été allaité plutôt par une ourse que par une femme. Cette taille d’une hauteur disproportionnée, cette carcasse osseuse, maigre et solide ; cette tête allongée, raboteuse et poilue, le front étroit, les petits yeux sauvages, le nez énorme aux narines épatées comme celles de certains sauvages, la grande bouche capable d’avaler sans aucune difficulté un lièvre entier – Borimetchka ne dédaignait pas la viande crue – ces longs bras puissants à l’aide desquels, comme Hercule, il aurait écartelé un lion, tout en lui semblait charpenté plutôt en vue de combats contre les bêtes féroces, auxquelles la nature l’avait fait ressembler, que pour les besoins de l’idyllique occupation de gardien de chèvres. Mais l’expression bonasse du visage, l’obtuse bonté qui s’y lisait qui contrastait de façon cocasse avec l’aspect farouche du reste ajoutaient à l’ensemble on ne sait quelle nuance de ridicule. Personne n’aurait pu soupçonner que cette nature grossière, rude et primitive, serait capable d’attachements humains et d’émotions tendres. Pourtant cela était. Son apparition du matin même, en des circonstances si extraordinaires, apparition assez comique d’ailleurs, témoignait assez de la bonté et de la noblesse de son cœur. Cet homme était capable de faire don de lui-même. En y réfléchissant, Ognianov commençait à trouver sa physionomie plus avenante et même plus intelligente.
– Qui t’a gratifié de ce surnom terrible, baï Ivan ?
– Comment, tu ne le savais pas ! dit avec vivacité l’Aiguillon, mais il a lutté avec un ours !
– Pas possible ?
– C’est un chasseur redoutable... et il l’a tué.
– Vas-y, Borimetchka, raconte toi-même comment, avec l’ours, vous avez roulé du haut du rocher, dit l’Aiguillon.
– Alors, tu as vraiment lutté avec un ours ? demanda, étonné, Boïtcho.
Pour toute réponse, Borimetchka porta la main à son cou. Ognianov y vit une cicatrice profonde ; puis, relevant sa manche, sur son bras poilu, près du coude, il fit voir une autre cicatrice qui semblait faite par un crochet de fer. Ognianov regardait, impressionné.
– Mais tu es un véritable héros, dit-il. Raconte ton aventure avec l’Ours.
Borimetchka jeta autour de lui un regard triomphant, dont l’habituelle bêtise pâlissait sous la flamme qui l’avivait au souvenir glorieux.
– Tonnerre de Dieu ! dit-il, commençant par son ouverture favorite...
Mais soudain le Chien aboya et bondit au-dehors.
– Pourquoi aboie-t-il ? Borimetchka ne fait que commencer, plaisanta l’Aiguillon.
– Oncle Kaltcho ! cria le petit berger.
Kaltcho apparut, un gourdin et un sac jetés par-dessus l’épaule.
– Mais j’ai de la visite, ma parole ! Soyez les bienvenus, les gars ! et il salua amicalement, en jetant son fardeau à terre.
– Faites donc de la place à Kaltcho près du feu !
– Ben, mon vieux, quel froid de canard ! Tous les loups y passeront ! Où est-ce qu’elle vous a surpris, la bourrasque ?
– Ici, en bas, répondit Spiridontché.
– Quelle idée d’aller à la chasse par ce temps ! C’est pas la première fois que vous venez dans le Balkan, fallait vous douter qu’il allait avoir ses lubies !
– À qui le dis-tu, père Kaltcho ? Mais on s’est laissé tenter par du gibier de choix. Tu as apporté de l’eau-de-vie, j’espère ? demanda l’Aiguillon.
– Du raki ? Bien sûr. Mais j’ai quelque chose de bien meilleur encore dans mon sac.
La gourde passa à la ronde.
– Y a-t-il à cette heure meilleure chose que le raki ?
– Oui, une nouvelle.
Tous prêtèrent l’oreille.
– Ce matin, deux zaptiés de Klissoura ont été dévorés par les loups.
– Allons donc ! s’écria d’un ton incrédule Borimetchka.
De nouveau le chien aboya.
– Leur compte est bon, il n’en reste plus un poil. Des Turcs sont allés les trouver – pas eux, mais leurs frusques et leurs os – près de la colline de Sardan. Hadji Umer-aga a dit, d’après ce que j’ai compris, que les loups se sont lancés à leur poursuite pendant qu’ils menaient leurs chevaux par la bride. Alors les zaptiés se sont enfuis d’un côté, les chevaux d’un autre. L’un des chevaux est perdu. Les loups ont sans doute pensé que la viande de messieurs les zaptiés a bien meilleur goût que celle de cheval et se sont jetés sur les efendis. À la bonne vôtre, les gars ! qu’ils crèvent tous, ces sacripants ! Les chiens les mangeront, ces chiens !
Et Kaltcho souleva la gourde. C’est alors seulement qu’il s’aperçut de la présence d’Ognianov qu’il ne connaissait pas.
– Et ce gars-là, d’où est-ce qu’il vient ? demanda-t-il en lui tendant la gourde.
– De Kara-Saralié, on s’est trouvé dans le Balkan ; il chassait le même gibier, répondit Spiridontché.
– C’est un brave ; allez ! à ta santé, Boïtcho ! tonna Borimetchka.
Le chien aboya encore. Kaltcho se tourna, rieur, vers Borimetchka :
– Dis donc, ours, qu’est-ce que tu as encore fait ?
– Mais aucun mal à qui que ce soit, Kaltcho !
– Bon Dieu ! mais tu nous as enlevé une fille, tu lui as brûlé le cœur. Allons, à la bonne vôtre ! Fais voir le gibier dont tu vas régaler tes invités à la noce.
– Je l’ai laissé en bas, Kaltcho, gronda, d’une voix de tonnerre, Borimetchka.
Cette fois-ci Mourdjo, le chien, se fâcha pour de bon.
– Écoute, Ivan, raconte-nous comment tu as lutté avec l’ours.
– Celui-là ? fit encore Kaltcho en lui jetant un regard malicieux, qu’il nous raconte plutôt comment il a lutté avec Staïka.
Tout le monde rit. Mais Ivan l’Aiguillon, qui voulait être assuré de la méprise des autorités turques, reprit :
– Alors, c’est comme ça, les loups les ont dévorés ? Et les Turcs, est-ce qu’ils ne mettent pas ça sur le compte des Bulgares ?
– Comment ! Tout le village est au courant. Le vieux Stoïko, que Dieu ait son âme !... dit Kaltcho qui avait compris de travers.
– Je le sais bien, mais je te demandais si les Turcs ne soupçonnent pas les Bulgares d’avoir tué les zaptiés ?
Kaltcho le regarda, perplexe :
– À qui ça pourrait-il venir à l’idée ? Ça ne s’est jamais vu qu’un Bulgare du pays tue un Turc. Je vous l’ai dit, c’est les loups qui ont fait de la bonne besogne et, demain, les Turcs vont lancer une meute à leur poursuite et les chasser. Ça m’arrange, moi aussi. Cet hiver, c’est effrayant, on ne peut pas sortir dans les champs. À votre santé, petits ! Souhaitons-nous un joyeux Noël et qu’on fête bien portants et joyeux la naissance de l’enfant Jésus ! Et puis suivez l’exemple de Borimetchka, mais pas pendant l’Avent. Sers-toi, ami.
Kaltcho passa l’eau-de-vie à Ognianov, qui sentait renaître ses forces sous son action bienfaisante. Il leva la gourde et dit d’une voix pénétrée :
– Buvons, frères, à la mémoire du père Stoïko, de ce martyr de la fureur des Turcs. Que Dieu console son âme de juste et soutienne nos cœurs et nos bras dans notre lutte contre l’ennemi du Christ, afin que nous lui rendions les offenses au centuple ! Que Dieu ait l’âme du père Stoïko !
– Que Dieu ait son âme ! dirent les camarades.
– Que Dieu ait son âme ! reprit Kaltcho en ôtant son bonnet. Puis se tournant aimablement vers Ognianov : – Ami, tu as dit de bonnes paroles ; qu’elles aillent de ta bouche tout droit aux oreilles de Dieu ! On supportera encore un peu, puis ça fera du grabuge. Comment t’appelle-t-on ? Faisons connaissance ! Moi, je m’appelle Kaltcho Bogdanov, et il tendit la gourde à Ognianov.
Celui-ci dit un nom d’emprunt et but à la santé de son nouvel ami.
Les jeunes gens mangèrent peu car ils voulaient économiser les maigres provisions de leur hôte, puis on échangea des adieux et Kaltcho les accompagna jusqu’à la porte. – Ami, excuse-moi, dit-il à Ognianov, j’ai oublié ton nom mais, si tu passes par ici, arrête-toi, qu’on bavarde un peu. Tu parles si bien ! Allons, bon voyage.
Les paroles d’Ognianov avaient, en effet, profondément troublé le berger. Elles ne lui étaient pas tout à fait inconnues, mais « l’ami » avait parlé de lutte. C’était un mot nouveau, qui fit fortement vibrer une nouvelle corde de son âme et celle-ci s’éveilla. Nous verrons par la suite l’influence qu’eut sur lui cette rencontre.
La compagnie se perdit bientôt dans le lointain ; le crépuscule tombait quand elle commença à descendre vers le village.
Ognianov décida de passer la nuit à l’auberge de baï Doïko. Il venait à peine d’entrer dans sa chambre qu’une quinzaine de bachi-bouzouks 99, armés de fusils, montaient l’escalier à sa suite. Ils étaient conduits par le zaptié que Boïtcho avait aperçu la veille à l’estaminet du village turc.
Hélas ! Koltcho n’était plus là pour le prévenir !
DEUXIÈME PARTIE
1 BIALA-TCHERKVA
L’aventure de la Saint-André ébranla de fond en comble l’existence paisible de Biala-Tcherkva. La découverte de la véritable identité de Boïtcho fut un coup pour tout le monde, et l’exhumation des cadavres des deux Turcs plongea la petite ville dans une horreur indicible. C’était, en effet, un évènement funeste. La méfiance des autorités turques fut mise en éveil, et la population turque environnante fut prise d’une soif de vengeance frénétique. En attendant le jour du règlement général des comptes, ses méfaits sanglants ne se comptèrent plus : les cadavres de Bulgares parsemaient les routes, les communications devinrent extrêmement difficiles. Le bruit qui courait, qu’autour de Noël il y aurait du carnage, troublait Biala-Tcherkva. La panique montait, surtout parmi les femmes ; chacun se sentait nerveux. Les déclarations patriotiques cessèrent ; l’enthousiasme s’évapora. Le jour même de la Saint-André, la police arrêta Sokolov, l’inséparable ami de Boïtcho ; on enferma le vieux Stoïan, le meunier, comme complice, et on chercha le diacre Vikenti, mais il avait disparu. De son côté, la municipalité se hâta de renvoyer Rada de l’école, en tant qu’amie du dangereux comitadji, et Mikhalaki Alafranga obtint aussi la fermeture de l’école des garçons, afin que l’air s’y purifie un peu ; on ne garda que Merdévendjiev, pour enseigner les petits. Tous ceux qui connaissaient plus ou moins Boïtcho étaient sur des charbons ardents. Le comité fut dissous par ses propres membres. Seul, Iaroslav Barzobégounek resta à l’abri de tout soupçon, sous son chapeau aux galons d’or : personne n’inquiéta « l’Autrichien ». Il continuait à photographier le plus consciencieusement du monde la population de Biala-Tcherkva et, comme il manquait de certains produits indispensables, ses photographies restaient sombres et floues et, avec ébahissement, on n’y distinguait que des figures de nègres. En tout cas, pendant ce temps, Barzobégounek fut le seul à entretenir la correspondance avec le monde extérieur.
À la fin, pourtant, les esprits s’apaisèrent un peu et les jeunes gens reprirent courage, ils plaignaient seulement le pauvre Ognianov. La rumeur de sa mort se confirmait de toutes parts. Les Tchitaks qui venaient au marché racontaient qu’il avait été touché par trois fois et qu’il était mort sur le coup dans la futaie d’Ahiévo ; l’onbachi savait bien que ce dernier fait était resté sans confirmation, mais il l’affirmait lui aussi. Certains Bulgares assuraient que « le comte » avait été enterré par Nicolas le tailleur dans le ravin où celui-ci l’avait trouvé. Mme hadji Rovoama décrivait plus tragiquement encore la fin de Boïtcho : en se traînant blessé dans le ravin, il avait été dévoré vivant par les loups.
Ces sombres bruits plongeaient la petite ville dans la tristesse. De simple héros, Ognianov devint un martyr et un saint ; il passa dans la légende. Les petites vieilles allumaient des cierges pour « le saint martyr Boïtcho » ; le pope Stavri célébra une messe de Requiem à sa mémoire, au milieu de laquelle il mentionna le nom de hadji Boïtcho : toute la jeunesse y assistait, au grand étonnement des parents du défunt, qui restèrent interdits également par le fait que le pope appelait hadji Boïtcho, Boïtcho « le martyr », au lieu de « pèlerin ». Mais d’autres, au contraire, jubilaient. Ils regardaient les autres de haut, en gens qui avaient eu raison. Steftchov, en particulier, éclatait d’orgueil en dépit de sa malencontreuse aventure chez Milka. L’étendue du malheur d’Ognianov, qui retint l’attention générale, détournait cette attention de son infâme histoire. D’ailleurs l’infamie même rend les gens plus effrontés... Au début de février, la colère d’Iordan s’apaisa : Steftchov épousa Lalka.
Ajoutons que sa trahison resta secrète : tous les torts et l’indignation générale retombèrent sur le malheureux idiot, que le supérieur du couvent contraignit à avouer qu’il avait été l’unique témoin de l’enterrement des cadavres. Ceci expliquait aussi les signes mystérieux et les exclamations de Mountcho qui, sans aucun doute, avaient contribué à la découverte de Boïtcho, de quelle façon exactement, c’était un mystère. Il fut enfermé comme fou furieux dans la tourelle du couvent.
Quant à Rada, elle semblait se mouvoir dans un songe. Les bonnes gens qui l’avaient recueillie ne savaient que faire pour la consoler. « Quel dommage pour cette pauvre petite ! » disaient-ils en se lamentant.
Le temps passait et les actes réparateurs devenaient plus fréquents. Marko et Mitcho Beïzédéto réussirent, après maintes tentatives, à faire relâcher sous caution le Dr Sokolov qui, d’ailleurs, n’avait rien à voir avec l’affaire des cadavres. Ses deux garants ne se doutaient pas qu’ils avaient un allié : cet allié secret, qui avait déjà aidé Marko lors de la première libération du docteur – il est temps de le dire – était celui dont avait parlé une fois aux vêpres hadji Rovoama : la femme du vieux bey. C’est tout à fait par hasard que cette jeune personne avait rencontré le docteur qui n’eut pas devant elle la fermeté de Joseph devant la femme de Putiphar. Grâce à cette relation depuis longtemps interrompue, cette fois encore il se tirait d’affaire : la femme du bey avait demandé à son mari de faire des démarches à K... pour que Sokolov soit reconnu innocent et relâché.
En février, quelques jours à peine après le retour du docteur, Kablechkov arriva à Biala-Tcherkva et s’installa dans la maison de Barzobégounek. Il y réunit les membres du comité dissous, les enflamma par des discours ardents et les emmena droit au monastère, où le supérieur Natanaïl leur fit prêter serment sur l’Évangile et donna sa bénédiction au comité restauré. À partir de ce moment, les préparatifs reprirent encore plus activement ; au début avril, Kablechkov revenait à Biala-Tcherkva.
C’est de ce jour-là que nous reprenons notre récit.
2 LES MALADES DU DOCTEUR SOKOLOV
Sokolov arpentait nerveusement sa chambre. Il regardait souvent par la fenêtre qui donnait sur la cour inondée de verdure. Les cerisiers et les griottiers en fleurs semblaient couverts de neige. Les pommiers étendaient leurs branches vertes pareilles à des guirlandes, couronnées de fleurs roses. Des perles ravissantes brillaient sur les pêchers et les abricotiers qui poussaient sous les fenêtres. Le sentier herbeux qui traversait la cour était ombragé par ces arbres fruitiers, qui lui donnaient l’aspect d’une année.
Sokolov avait bien changé. Son visage – toujours beau et respirant la bonté – était pâle et maigre, comme celui d’un convalescent : l’emprisonnement prolongé et la douleur morale avaient posé leur triste sceau sur ce jeune homme si vigoureux et plein de vie ; il était devenu impatient, sarcastique. À ses autres souffrances s’était ajoutée la nouvelle du mariage de Lalka avec Steftchov ; il en avait été anéanti. Telle une bête fauve, il se débattait, impuissant, entre les murs étroits de sa cellule. Il jurait de tuer Steftchov à la première occasion qui se présenterait. C’était lui la cause de tous les malheurs car, au fond de son cœur, le docteur était persuadé que la trahison était aussi l’œuvre de ce misérable. À son retour à Biala-Tcherkva, son premier souci fut d’aller remercier Marko Ivanov et Mitcho Beïzédéto. Ensuite, il se rend chez Netcho Pavlov, le chasseur, qui avait gardé Cléopâtre chez lui. La pauvre bête qui, entre-temps, avait grandi et maigri, ne put reconnaître son maître bien-aimé qu’au bout de quelques secondes d’hésitation. Cléopâtre était devenue sauvage et indifférente, ses instincts de fauve s’étaient développés ; elle se fâchait souvent, montrait facilement ses crocs pointus dans une intention peu bienveillante : le docteur voyait en pensée le maudit Steftchov, serré entre ses bras poilus, et une joie satanique éclairait alors son visage. Mais il comprit bientôt que le coupable était Mountcho et, après la restauration du comité, il fut entièrement absorbé par la grande cause, la préparation de l’insurrection. La vengeance, qui était une affaire personnelle, recula au second plan dans son esprit : c’était une chose si insignifiante, si misérable devant la grandeur de la tâche ! Il décida de remettre en liberté Cléopâtre, dont il ne savait que faire, et demanda à Netcho Pavlov de la conduire le soir même dans le Balkan – il ne pouvait se faire à l’idée de l’abattre.
Sokolov avait complètement abandonné son métier, il ne soignait plus personne, et d’ailleurs personne n’allait plus chez lui de peur de se compromettre. Les mortiers, les flacons de médicaments, les boîtes de pilules, mêlés à ses livres de médecine, étaient jetés pêle-mêle dans un petit placard, où les souris eurent bientôt fait de lire la moitié de la pharmacopée. Un seul malade continuait encore à fréquenter sa maison : c’était Iaroslav Barzobégounek. C’est par inadvertance qu’il s’était blessé au bras avec son pistolet, le lendemain même du retour du docteur. Ce malheur lui avait assuré la compassion de toute la petite ville et avait contraint le pauvre Autrichien à renoncer à son métier de photographe qui, d’ailleurs, avait depuis longtemps renoncé à lui.
La porte du jardin claqua et le docteur fixa le regard vers l’entrée. C’était précisément Barzobégounek qui arrivait. Il était toujours vêtu du costume fatigué et éraflé qu’Ognianov lui avait donné, et coiffé du chapeau aux galons dorés sous lequel dépassaient ses épais favoris blonds. Son bras droit était retenu contre sa poitrine par une écharpe attachée à son cou. Il marchait lentement et avec précaution, sans doute pour éviter la douleur que ses mouvements plus brusques auraient pu provoquer. Son visage, qui se crispait à chaque pas, avait une expression douloureuse. En entrant chez le docteur, il regarda de tous côtés, puis jeta son bandage sur le lit.
– Salut, mon vieux ! cria-t-il, en tendant sa main droite.
Le docteur la serra très fort, sans que le patient manifestât le moindre signe de souffrance. Sa blessure n’était qu’une invention ; il fallait justifier ses fréquentes visites chez le médecin.
– Quoi de neuf ? demanda le docteur.
– Kablechkov est arrivé tard cette nuit chez moi, dit Barzobégounek.
– Il faut que je le voie, dit vivement Sokolov.
– Il est malade. Toute la nuit il a brûlé de fièvre.
– Le pauvre !
– Et, au lieu de se tenir tranquille, il m’a dicté trois longues lettres qui doivent être expédiées aujourd’hui même. Un homme tout feu tout flamme, et qu’en reste-t-il ? C’est la toux qui le déchire.
– Je vais aller le voir, dit le docteur en prenant son fez.
– Non, pas maintenant, il dort. Il m’a chargé seulement de convoquer le comité pour ce soir. Il assistera aussi à la réunion.
– Non, il ne le faut pas, il doit rester couché.
– Essaye ! Tu sais comme il est têtu. Convoque les membres pour ce soir.
– Bon, je leur ferai signe.
Barzobégounek baissa la voix :
– Et les cent pièces d’or, est-ce qu’on les a trouvées ?
– Pour les fusils ? Oui, on les a trouvées. On les aura aujourd’hui.
– Bravo, Sokolov ! tu es un type magnifique, s’écria le photographe.
– Chut, tais-toi !
– Oh ! mais depuis quand as-tu ce poignard ? cria Barzobégounek, en tirant de sous le gilet du docteur la lame brillante qu’il se mit à agiter en l’air.
– C’est Ivan le Hongrois qui me l’a fabriqué. Les commandes pleuvent chez lui en ce moment. C’est beau, hein ?
Barzobégounek essayait de déchiffrer les inscriptions gravées sur la lame.
– S ou S 100 ! Qu’est-ce que ça veut dire ?
– Devine !
– Sokolov ou Steftchov ? demanda avec un soutire Barzobégounek.
– La liberté ou la mort ! dit le docteur, en appuyant sur les mots, car le nom de Steftchov éveillait en lui un sentiment désagréable. Puis il ajouta : – Maintenant Steftchov et d’autres saloperies pareilles restent à l’arrière-plan, mon cher ami... Nous n’avons pas le temps de penser à Steftchov, ni à des caprices, ni à des affronts personnels. Celui qui s’en va chasser le tigre méprise les vers. Tu dois savoir que j’ai tout oublié : celui qui va faire une révolution oublie tout.
Barzobégounek lui jeta un regard malicieux.
À son état d’irritation, il était évident que le docteur n’avait rien oublié et ne pouvait oublier aussi facilement. Le coup porté à son cœur, où à son égoïsme, avait été trop fort. La préparation de l’insurrection venait juste à point pour lui faire oublier la douleur de la plaie encore béante : cette occupation absorbante s’était emparée de tout son être, elle l’étourdissait. Dans cette sorte d’ivresse, il trouvait à sa douleur morale le même calmant que l’ivrogne trouve dans le vin. Mais, à chaque fois que, dégrisé, il se prenait à réfléchir, les pensées amères s’éveillaient dans son cœur comme des serpents qui le mordaient, le mordaient impitoyablement.
L’apparition de Kandov dans la cour mit fin à la conversation languissante et détourna l’attention du docteur.
– Qu’est-ce que c’est comme oiseau, celui-là ? demanda Barzobégounek.
– Kandov, étudiant en Russie.
– Je sais bien, mais quel genre d’individu ?
– Philosophe, diplomate, socialiste, nihiliste... et le diable sait quoi encore ! En un mot, il lui manque quelque chose ici.
Et Sokolov montra du doigt son front.
– Est-ce qu’il ne veut pas prendre part à la cause populaire ?
– Mais non, Il n’en a pas besoin ! Je crois qu’il va retourner en Russie pour obtenir son diplôme, dit le docteur, renfrogné.
– Oh ! ces singes savants ! Je ne peux pas les souffrir, cria Barzobégounek. Dès qu’ils ont leur diplôme on n’a plus qu’à les rayer de l’humanité. Ils n’ont aucun besoin du peuple, de la liberté. Ce qu’il leur faut, c’est la vie tranquille, une petite femme, une maison et de la prudence ! D’ailleurs, pourquoi se seraient-ils donné tant de peine pendant des années ? Crois-tu que c’est pour revenir en Bulgarie préparer l’insurrection et mériter ainsi l’exil à Diarbékir ou la potence ?
– Allons, Barzobégounek, tu n’es pas juste, non, tu as toi-même un diplôme.
– Moi ! Dieu m’en garde !
– C’est vrai, et Boïtcho non plus n’avait rien de ce genre, dit le docteur.
– Si j’avais un diplôme, j’aurais moi aussi été un âne. Toi, par exemple, si tu avais obtenu ton diplôme d’une faculté de médecine, et non pas sur les coteaux albanais, tu n’aurais pensé qu’à faire de l’argent et non pas des émeutes...
À cet instant on entendit dans le couloir les pas de l’étudiant qui se rapprochaient. Barzobégounek attacha rapidement le bandage autour de son cou.
– Oh ! j’ai failli oublier, donne-moi de la quinine, pour Kablechkov.
Le docteur venait juste de lui tendre le médicament, lorsqu’on frappa à la porte.
– Entrez ! cria le docteur.
Kandov entra. Iaroslav Barzobégounek s’inclina poliment et sortit. Absorbé par ses pensées, Kandov ne fit même pas attention à lui.
Il était habillé d’une veste vert foncé, bien boutonnée, un peu usée, et d’un pantalon de la même couleur, plutôt collant. Le fez écarlate allait mal à son visage brun et pâle, marqué par la réflexion et par une mélancolie qui se reflétait dans son regard rêveur. Il était évident que ce jeune homme était rongé par des pensées douloureuses qu’il ne pouvait faire partager par personne ; depuis un certain temps il tournait au misanthrope.
Sur l’invitation du docteur, il s’assit sur une chaise. Sokolov s’assit sur le lit, assez étonné par cette visite inattendue.
– Comment allez-vous, monsieur Kandov ? demanda Sokolov qui le crut malade et examina d’un regard pénétrant son visage anguleux et mal rasé.
– Ça va, grâce à Dieu, répondit sèchement, presque machinalement, Kandov. (L’animation de son regard et le battement des veines de ses tempes trahissaient une préoccupation.)
– J’en suis heureux, vous avez l’air complètement rétabli.
– Oui, je vais tout à fait bien.
– Alors, vous repartez pour la Russie ?
– Non, j’y ai renoncé.
– Complètement ?
– Pour toujours, je reste ici, dit sèchement Kandov.
Le docteur lui jeta un regard étonné, un peu ironique. Il semblait vouloir dire ; « Qu’est-ce que tu fiches ici, mon ami, va donc à ton école, chez les philosophes ; chez nous, ça chauffe trop pour toi. »
Il y eut un silence.
– Vous voulez peut-être devenir instituteur ? demanda le docteur, légèrement méprisant.
Kandov rougit un peu et, au lieu de répondre, demanda brusquement :
– Monsieur Sokolov, quand donc se tiendra la prochaine séance du comité ?
Cette question inattendue consterna le docteur.
– Quel comité ? demanda-t-il, de l’air de quelqu’un qui ne comprend rien à ce qu’on lui demande.
Kandov rougit plus fort puis reprit, les traits tendus :
– Votre comité à vous, n’essayez pas de cacher ce qu’il en est, je suis au courant de tout ; je connais les noms de ses membres, l’endroit où vous vous réunissez, absolument tout... Soyez franc avec moi.
– Il est étrange que vous sachiez tant de choses sans vous y intéresser. Mais disons que... D’ailleurs, où voulez-vous en venir ? demanda le docteur, en braquant sur son interlocuteur un regard fixe et presque provocant.
– Je vous ai demandé : la prochaine séance se tiendra-t-elle bientôt ? reprit Kandov d’un ton décidé.
– Oui, monsieur, ce soir ! répondit le docteur du même ton.
– C’est vous le président, n’est-ce pas ?
– Oui !
– Je viens vous demander un service.
– Faites donc, monsieur.
– Je vous prie de me proposer comme membre.
La voix de l’étudiant tremblait d’émotion.
Le docteur était ahuri ; il ne s’attendait à rien de pareil de la part de Kandov.
– Mais, comment cela ? Kandov, expliquez-vous.
– Simplement, en tant que Bulgare, je veux travailler, moi aussi.
Sokolov bondit :
– Laisse-moi te serrer la main, frère ! il le prit dans ses bras et lui baisa la bouche, puis il ajouta : – C’est avec joie, avec une joie profonde que nous vous verrons à nos côtés, monsieur Kandov... C’est une honte que des gens comme vous se tiennent à l’écart. Notre lutte sera grandiose. La patrie nous appelle. Que nous y soyons tous ! Honneur et gloire à toi, Kandov ! C’est les amis qui seront étonnés quand je leur dirai... Donne-moi ta main !
– Merci, docteur, dit l’étudiant ému, et vous verrez que Kandov ne sera pas de trop.
– Oh ! je le sais, je le sais ! Pourquoi n’as-tu pas accepté lorsque Ognianov te le demandait ? Tiens, mon cœur saigne de douleur. Mon pauvre Boïtcho ! C’est moi qui aurais dû mourir, et qu’il vive, lui, qu’il enflamme le peuple de sa parole ardente, de son exemple ! Tu sais, Kandov, c’était un véritable héros, un grand cœur !... Oh ! nous le vengerons cruellement ! Pour un, cent ! On leur fera voir à ces barbares !
– La vengeance, c’est ça ! répondit Kandov. C’est l’unique sentiment qui m’anime, moi aussi ! Une personnalité comme Ognianov, on ne fera pas grâce à son assassin !
– Vengeance, vengeance terrible, s’écria le docteur.
– C’est bien ce soir que se réunit le comité ?
– Oui, chez baï Mitcho ; nous irons ensemble.
– Dès que je serai admis, je ferai une proposition.
– Laquelle ?
– De tuer l’assassin d’Ognianov.
– Mais il n’y en a pas qu’un, mon ami, ils sont plusieurs, où les trouver ? C’est même tout l’empire ottoman, si tu veux le savoir.
– Je pense qu’il n’y a qu’un seul coupable.
Le docteur le regarda, étonné.
– Il n’y en a qu’un et il est parmi nous.
– Parmi nous ?
– Oui, le vrai coupable de sa mort.
– Oh, Kandov ! vaut-il la peine de se venger sur un simple d’esprit ? Mountcho ne savait pas ce qu’il faisait. Il était attaché à Boïtcho. Laisse-le donc.
Kandov s’empourpra. Les soupçons de Sokolov le blessaient.
– Vous vous trompez, monsieur Sokolov ! Vous vous trompez. Qui vous parle de Mountcho ?
– Alors de qui parlez-vous ?
– De Steftchov !
– Steftchov ! s’exclama le docteur stupéfait.
– Oui, Steftchov, c’est lui le traître. Je le sais avec certitude.
– Oh, le salaud ! Moi aussi je le soupçonnais au début.
– Je sais, de source sûre, que c’est lui qui a tout raconté aux Turcs. Mountcho est absolument innocent. Vous vous êtes tous hâtés de jeter les torts sur lui. La nuit même de son infâme aventure, Steftchov est allé conseiller aux autorités de creuser près du moulin ; c’est lui qui a découvert la véritable identité d’Ognianov, grâce à la perfidie de Merdévendjiev. C’est lui l’auteur de tous les crimes, c’est lui qui est responsable de tous les malheurs. Je connais cette sombre histoire dans tous ses détails, et cela de la source la plus sûre.
– Ah ! le fils de démon !
Depuis quelques instants, Kandov ne faisait que s’élever aux yeux de Sokolov. Il fut extrêmement touché lorsqu’il le vit prêt à tuer Steftchov, l’ennemi de la cause sacrée. Kandov voulait se charger d’un exploit sanglant et s’exposer aux risques les plus terribles pour témoigner son dévouement à l’idée qu’il faisait sienne. Chez tout autre, une telle ardeur aurait paru suspecte, chez Kandov elle était sincère. Cela se voyait à la flamme inquiète qui brillait dans ses yeux, au tremblement nerveux qui crispait son visage inspiré.
Un moment, Sokolov le regarda droit dans les yeux, puis il bondit en s’écriant :
– Attends un peu, nous enverrons cette fripouille au diable. Le comité prendra une décision ce soir même...
– Bien, dit sourdement Kandov.
– Ah ! le voilà ! s’écria Sokolov en apercevant un beau jeune homme, habillé à la française.
Il était évident que le docteur ne s’attendait pas à cette visite, car il semblait ému.
– C’est un malade ? demanda l’étudiant.
– Oui, excuse-moi, dit le docteur en s’élançant vers la porte.
Lorsqu’il revint, son visage brillait de satisfaction.
– Qui était-ce ? demanda Kandov, en suivant des yeux la silhouette qui s’éloignait.
– Pentcho Diamandiev, il vient de rentrer du Lycée de Gabrovo.
– Comment, le beau-frère du traître Steftchov et le fils de ce salaud de Iordan ? demanda Kandov. Seriez-vous des amis tous les deux ?
– Nous ne sommes pas amis, mais quelque chose de plus qu’amis et frères ; nous sommes des camarades, il est membre du comité.
3 DEUX PÔLES
Le tchorbadji Iordan vieillissait à vue d’œil. Un mal gastrique, qui l’avait retenu longtemps au lit, avait eu des répercussions sur son caractère. Il était devenu encore plus irascible et plus impatient.
Ce matin-là, le temps était beau et il était sorti faire un tour jusqu’au jardin qu’il possédait à l’extrémité de la ville. La vue de ce vaste jardin, entouré de murs solides et planté d’arbres fruitiers et de fleurs, plongé dans une fraîche verdure, fit du bien au malade, qui gardait la chambre depuis longtemps. L’air frais et le soleil printanier le ranimèrent il se sentait beaucoup mieux sur le chemin du retour. Mais, juste au moment où il arrivait devant la maison de Guenko Guinkine, son beau fils, il sentit une faiblesse dans les jambes. Il s’arrêta chez Guenko pour reprendre souffle.
Dans la cour, ce dernier, encore plus ratatiné et insignifiant que d’habitude, promenait un mioche braillard dans ses bras, le dandinant et le serrant, comme une nourrice, contre sa poitrine.
Iordan se dirigea vers le banc et s’assit lourdement en disant, renfrogné :
– Eh, la femmelette ! c’est toi qui gardes l’enfant ? Où est l’autre ?
« L’autre », c’était sa fille.
Guenko se troubla (le trouble était d’ailleurs son état normal) et il bégaya :
– Elle a à faire, alors c’est moi qui garde le petit Iordan. Elle m’a dit de le promener un peu, elle a à faire.
– Et sa quenouille, elle ne te la fait pas tenir aussi ? demanda Iordan avec un sourire méprisant.
– Eh ! Guinka ! fais-moi du café ! cria-t-il sans savoir au juste où elle était.
– Elle est en train de pétrir la pâte ; elle a à faire, beau-père, c’est pour cela que je garde l’enfant. Du café ? mais je vais t’en faire, moi, voilà ! j’y cours. Je sais où elle met la boîte à café et le sucre, marmonna Guenko, en posant le bébé sur les genoux de son beau-père. Puis il disparut.
Le nourrisson hurla de plus belle.
Iordan se fâcha. Il posa sur le banc le désagréable marmot, se leva et cria :
– Mais où vous êtes-vous fourrés tous ! Est-ce que je suis un âne pour qu’on ne fasse aucune attention à moi ? Guinka, eh ! Guinka !
– Papa, sois le bienvenu ! Comment ça marche ? Est-ce que tu vas mieux ? Tu te portes bien ? Quel beau temps, tu as bien fait de sortir !
Debout sur le seuil, Guinka l’accueillait, joyeuse et souriante. Ceinte d’un tablier bleu, les manches retroussées jusqu’aux coudes, une écharpe verte nouée en arrière sur ses cheveux, son beau visage généreusement poudré de farine, elle figurait assez bien une jolie commère d’un tableau de l’école flamande.
– Qu’est-ce que tu fais ? Qu’est-ce qu’il me raconte l’autre, la femmelette ? Mais tu as l’air d’une meunière, ma parole ! Il n’y a personne ici pour me faire du café ! grommelait le vieillard, mécontent et impératif.
– Excuse-nous, papa, je me suis mise au travail. Je vais tout de suite te faire du café. Guenko ! Où s’est-il fourré, celui-là ? Prends le petit et mets-le au berceau. Pourvu que tu arrives à le faire dormir !
– Qu’est-ce que tu fais ?
– Je pétris la pâte, il le faut bien, on n’est pas n’importe qui, tout de même ! On est de bons Bulgares, nous aussi, dit Guinka en riant aux éclats.
– Quels Bulgares ? Qu’est-ce que tu fais au juste ? demanda son père fâché.
– De la pâte, j’en ferai des biscuits.
– Des biscuits ?
– Mais bien sûr, il en faut !
– Pourquoi vous en faut-il ? Vous allez aux eaux ou quoi ? Qu’est-ce que c’est que ces bêtises ?
Pour toute réponse, Guinka pouffa de rire. Iordan la regarda, exaspéré. Il ne pouvait pas supporter le rire constant et sans raison de sa fille dont le caractère enjoué était tout à l’opposé de son tempérament colérique.
Elle s’approcha de lui et lui souffla tout bas :
– Qui pense aux eaux maintenant ? C’est pour tout autre chose qu’on prépare le biscuit ; il en faut pour les gars.
Iordan la regardait, ahuri :
– Quels gars ?
– Mais les Jeunes héros bulgares, papa, quand ils s’en iront dans le Balkan.
– Quels héros as-tu dans la tête, espèce de sotte ? demanda Iordan, de plus en plus éberlué.
Guinka s’approcha davantage et souffla :
– Pour l’insurrection. C’est le comité qui l’ordonne.
Et elle pouffa de nouveau.
Iordan sursauta. Il n’en croyait pas ses oreilles.
– Mais quelle insurrection ? quel comité ? Alors, c’est pour l’émeute ?
– Oui, oui, pour l’émeute. On n’en veut plus de ce Sultan galeux ! répondit avec impertinence Guinka, mais bondissant aussitôt de côté, car son père leva le chibouk pour la frapper.
Livide, tremblant de rage, il se mit à vociférer de toute sa voix :
– Espèce de fille d’âne, espèce de toquée, toi aussi tu vas préparer l’émeute ? Est-ce qu’il n’y a pas de quenouille et d’aiguille pour toi, pour que tu te laisses bourrer le crâne par des haïdouks et des vauriens, pour les gaver de biscuits ? Tu n’as pas honte, espèce de folle ! Elle ne veut pas de Sultan, voyez-moi ça ? Chienne ! Qu’est-ce qu’il t’a donc fait le Sultan ? Est-ce qu’il t’a pris ton enfant ou quoi ? Elle a planté là sa maison et son enfant, pour aller renverser le Sultan ! – Qu’est-ce que tu me regardes, toi, espèce de gourde, tu es sans doute de son avis, tu suivras aussi le drapeau, hein ? dit-il, reportant sa rage sur Guenko qui se tenait, effrayé, près de la porte.
Guenko Guinkine balbutia quelque chose, puis alla vite se cacher dans la maison. Guinka se changeait rapidement, parce qu’elle voyait que les cris de son père attiraient des curieux. En apercevant Guenko, elle saisit sa pantoufle et se mit à le taper sur la tête.
– Andouille, qu’est-ce qui t’a pris de lui dire que je faisais du biscuit ?
Mais Guenko, rempli de la fière conscience de sa dignité d’homme, ne l’honora d’aucune réponse. Il s’élança courageusement dans l’autre chambre en verrouillant la porte. Ayant placé cette barricade entre son dos et la pantoufle de sa femme, il protesta énergiquement :
– Vas-y maintenant, frappe si tu peux ! Je suis ton mari et tu es ma femme ! Frappe donc voir !
Mais Guinka ne l’entendait plus. Elle s’était précipitée dans la cour, car son père était sorti dans la rue, furibond et tremblant de rage.
Il arriva chez lui très fatigué. Il traversa la cour en gémissant d’épuisement, puis s’assit sur la première marche de l’escalier qui menait au deuxième étage.
Le tchorbadji Iordan suffoquait d’indignation. Bien qu’il fût obligé de garder depuis longtemps la chambre, certains bruits lui étaient pourtant parvenus. Le secret d’une insurrection toute proche n’en était plus un et même les sourds l’avaient entendu. On la préparait quelque part vers Panagurichté, au-delà des monts et des vallées, d’après ce qu’avait compris Iordan ; le feu était donc loin de sa maison. Maintenant, il apprenait de sa fille écervelée que même Biala-Tcherkva commençait à fumer. « Et les Turcs, qu’est-ce qu’ils fichent donc ? Sont-ils aveugles, sont-ils sourds pour ne pas s’apercevoir qu’on creuse un abîme sous l’Empire ? » se demandait-il.
À ce moment il entendit des voix enfantines. Elles venaient d’une petite fenêtre placée juste au-dessus de sa tête. Iordan se leva pour monter ; à la troisième marche il s’arrêta machinalement et regarda par l’ouverture. Il vit que ses deux plus jeunes fils, dont l’aîné avait à peine treize ans, étaient fort occupés devant le foyer plein de braise ; ils étaient si absorbés par leur travail qu’ils n’aperçurent pas la tête de leur père.
L’un des garçons tenait une poêle au-dessus du feu et surveillait très attentivement ce qui était en train de cuire ou de frire dedans. L’autre découpait et polissait avec un couteau des sortes de billes brillantes amassées en tas devant lui. C’était tout simplement des balles qu’ils étaient en train de couler, et la poêle contenait du plomb fondu qu’ils versaient dans des moules.
– Chenapans ! Bandits ! hurla Iordan fou de colère et il s’élança, le chibouk levé.
Les garçons abandonnèrent leur laboratoire et s’envolèrent en coup de vent pour disparaître dans la rue.
– Haïdouks ! Scélérats ! Incendiaires ! Maudits sacripants ! Ils préparent l’émeute, eux aussi ! criait Iordan en montant rapidement l’escalier, car la colère galvanisait ses jambes.
En haut, il rencontra sa femme.
– Dona ? Tu fais aussi partie de la bande ? lui demanda-t-il, le regard terrible. Tous mes enfants sont fous. On va me réduire en cendres. On va me tuer !
Il suffoquait de rage. Sa femme le regardait, saisie.
– Pentcho, Pentcho ! cria-t-il. Où est-il fourré ? Demandons-lui ce qu’il fabrique ? Si les petits coulent des balles, lui il doit couler des canons. Scélérats !
– Il n’est pas là, dit sa femme, il est parti pour K...
– Pour quel diable y est-il allé ?
– Il est peut-être allé à la tannerie y porter les cent lires.
– Chez Tossoun-Bey ! Mais c’est demain qu’il devait y aller, le scélérat. Alors il part comme ça, sans même prévenir ?
Le tchorbadji Iordan se dirigea vers son bureau. Il l’ouvrit rapidement et se mit à fouiller dans ses papiers, mais le groupe était introuvable. À sa place, sous les paperasses, il trouva un magnifique revolver.
– D’où vient ce pistolet ? À qui est ce pistolet ? Qui fourre son nez dans mes affaires ? Je cherche le groupe ; le trouve un pistolet !
– Mais personne ne touche à rien ici, sauf toi et Pentcho, essaya d’expliquer sa femme.
– Oh, ce fils de chienne ! Ce chenapan ! Il n’en sortira rien de bon ! Lui aussi, ennemi du Sultan ! Le voilà rebelle. Il n’y a pas à dire, c’est lui qui a donné à ces morveux l’idée de couler des balles ! Ils s’y sont tous mis : ils fabriquent eux-mêmes la corde pour les pendre ! Mais qu’est-ce que ces bêtises, bon sang ! Les chats aussi vont devenir rebelles si ça va de ce train-là. Est-ce que Kiriak est rentré ?
– Il est ici, il ficelle les ballots.
Iordan se dirigea en courant vers la chambre où devait se trouver Steftchov.
4 GENDRE ET BEAU-PÈRE
Steftchov, qui était l’associé de son beau-père, ficelait, avec l’aide de deux garçons, des balles de galons destinées à la foire de Djoumaïa, qui se tenait chaque année à la Saint-Georges. Il avait enlevé son veston et son fez pour pouvoir mieux travailler ; son visage, rougi par l’exercice, gardait son expression repoussante de sécheresse d’âme, de médiocrité et de dureté.
Près de la fenêtre, Lalka, sa femme, modestement vêtue de bleu, cousait des étiquettes sur les balles déjà prêtes. Sa figure calme, épanouie, empreinte de douceur, ne trahissait pas le malheur de son mariage de convenance. Bonne fille sans expérience, tout à fait dépourvue d’un romantisme que d’ailleurs elle n’aurait pu acquérir dans le milieu despotique qui était le sien, elle s’en était allée vers l’autel, le cœur en peine et des larmes sous le voile. Mais le temps vint à son secours, comme cela arrive ; elle s’habitua à sa nouvelle condition. Elle n’aimait pas Steftchov, et il était impossible de l’aimer, mais elle lui obéissait et le craignait. De son côté, il ne lui demandait pas davantage. Au lieu d’un cœur qu’il n’avait pas particulièrement brigué, il avait acquis des droits à un riche héritage, il était devenu l’un des héritiers directs d’Iordan Diamandiev. Cela lui suffisait.
Steftchov lâcha la corde qu’il enroulait autour de la balle, et Lalka son aiguille, quand apparut Iordan, livide, tremblant, le front sillonné de rides profondes.
– Hein, Kiriak, s’écria-t-il en entrant. Je crois qu’il n’y a que toi et moi qui soyons les sujets fidèles du Sultan dans cette maison. Même les chats préparent la rébellion, achètent des revolvers, coulent des balles... On prépare l’incendie et nous deux, nous pensons à la foire ! Moi, passe encore, je suis malade, mais toi, au moins, est-ce que tu ne vois et n’entends rien ? Pourquoi placer tant d’argent en marchandises par ce temps de brigands ?
Les deux ouvriers sortirent sur la pointe des pieds.
Steftchov le regardait, ahuri.
– Pourquoi me regardes-tu, tête de mule ? dit Iordan, de plus en plus emporté. Je te dis que mes enfants à moi sont également infectés de cette maladie : la rébellion. Les enfants du tchorbadji Iordan, le sujet le plus fidèle du Sultan, dont la maison est le pied-à-terre des kaïmakams 101 et des pachas ! Que doit-il en être des autres, du peuple ? Quelques voyous forment un comité ici même, à notre barbe, et nous bayons aux corneilles !
Et le tchorbadji Iordan conta les découvertes qu’il avait faites pendant la journée. À mesure que son récit avançait, il sentait la colère l’étouffer.
– J’avais justement l’intention d’aller aujourd’hui chez le bey, dit Steftchov ; ils se réunissent dans le jardin de Beïzédéto. Qu’on les prenne sur le fait et qu’on les soumette à un interrogatoire. Deux cents coups de bâton et ils diront tout ce qu’ils savent. Il y a longtemps que j’aurais dû mettre fin à cette sale propagande contre l’État. Que celui qui n’est pas content du gouvernement s’en aille donc en Russie, au lieu de mettre le feu à nos maisons !
À ce moment, Steftchov entrouvrit la porte et murmura quelque chose à une personne invisible.
– Est-ce que tu les connais, ces fils de chienne ? demanda son beau-père.
– Le meneur, c’est Sokolov, dit Steftchov, jetant un coup d’œil furtif à Lalka ; et son visage se tordit.
À sa haine contre le docteur se mêlait un sentiment de jalousie secrète, brûlante comme de la braise. Ce cœur glacé n’était accessible à l’amour que sous cette forme détestable.
– Toujours ce vaurien ?
Steftchov fouilla dans la poche de son gilet. Iordan le regardait faire avec attention.
– Voici une lettre que j’ai trouvée hier dans la rue, juste devant votre maison.
– Qu’est-ce que c’est, comme lettre ?
– Signée par Sokolov, il l’envoie à Panagurichté, d’autres voyous comme lui.
– Et qu’est-ce qu’il dit ? Il y est sûrement question de feu, d’incendies, d’émeutes, n’est-ce pas ?
– Mais non, ce sont des propos soi-disant innocents, pourtant je suis prêt à jurer que ça cache tout autre chose, dit Steftchov en dépliant la lettre ; Zamanov la comprendra et l’expliquera ; c’est un fin limier qui flaire le rebelle à cent arpents.
En entendant ce dialogue, Lalka avait pâli. Elle s’esquiva doucement et descendit rejoindre sa mère.
– Qu’est-ce que tu as, ma petite ? lui demanda cette dernière.
– Rien, mère, répondit Laika faiblement, puis elle s’assit et appuya sa tête entre ses mains.
La mère, affairée autour du dîner, ne fit plus attention à sa fille ; elle était extrêmement irritée et maudissait ses fils, tout en remuant quelque chose dans la poêle.
– Qu’ils crèvent ! Qu’ils aillent tous au diable au lieu de faire mourir prématurément leur père ! Il venait tout juste de se lever et il va de nouveau se trouver mal. Au diable leur insurrection ! Mais ils sont tous devenus fous et enragés, ma parole ! Jusqu’à Guinka, la folle, et même cette tête fêlée de Guenko, qui préparent des biscuits pour nourrir les voyous ! Qu’ils puissent donc les étouffer !
À cet instant entra Guinka. Sa mère fit retomber sa colère sur elle.
– Pourquoi te fâcher, mère ? Tu devrais même être contente. Ce sont les tchorbadjis qui doivent donner l’exemple.
– Guinka, tais-toi ! hurla sa mère. Je ne veux même pas t’écouter, tu es folle !
– Je ne suis pas folle, je suis une Bulgare patriote, voilà ! répondit Guinka avec ardeur.
– Une Bulgare patriote ! C’est pour cela que tu bats chaque jour ton mari ?
– Je le bats parce qu’il est à moi, c’est une autre politique, la politique intérieure.
– Oh, la folle ! Alors tu te crois meilleure Bulgare que ton père ? S’il savait que tu lis les journaux de Sokolov, il t’en ferait voir, malgré tes quarante ans !
– Mère, tu mens comme un arracheur de dents ! J’ai eu trente et un ans à Noël : je sais mieux que toi l’âge que j’ai.
Ce dialogue fut interrompu par une servante.
– Venez vite, grand-père Iordan s’est trouvé mal, cria-t-elle, effrayée, à sa maîtresse.
– J’arrive ! Mon Dieu, mon Dieu ! J’arrive, s’exclama celle-ci, et elle s’élança dans l’escalier, oubliant la poêle sur le feu.
En montant l’escalier, elle entendit les cris irrités de Iordan, que les coliques avaient repris. Elle le trouva dans la chambre d’en haut, se tordant et se roulant sur le plancher, en proie à des souffrances indicibles. Son visage était blême et déformé ; des cris désespérés s’échappaient de la poitrine du vieillard sans que sa douleur en fût allégée. Ces cris remplissaient d’horreur le cœur de tous les siens et on les entendait même de la rue.
On envoya vite un des ouvriers chercher le médecin grec. Il revint bientôt en disant qu’il ne l’avait pas trouvé ; le docteur était parti pour K... Alors, on chercha ce qu’on avait sous la main. Mais ni les compresses, ni les frictions, ni les gouttes n’eurent le moindre effet sur le malade. Il se tordait, se ramassait en boule et se roulait à travers la pièce. Sa femme ne savait que faire.
– Appelons le Dr Sokolov, dit-elle en se tournant vers le malade.
Steftchov grogna d’un air réprobateur, mais sa femme reprit :
– Il y a deux ans je l’avais appelé et il m’a guérie ! Iordan, appelons le docteur.
Iordan fit « non » de la main, puis continua à hurler.
– Tu m’entends, j’enverrai chercher le Dr Sokolov, appuya sa femme.
– Je ne veux pas..., gémit le vieillard.
– Tu ne veux pas, mais je ne t’écouterai pas, dit-elle, décidée, puis s’adressant à l’ouvrier : – Tchono, va chercher le Dr Sokolov, vite !
Tchono se dirigea vers la porte mais il fut arrêté par un cri terrible d’Iordan, un cri qui ressemblait à un sanglot.
– Ne l’appelez pas !... Je ne veux pas le voir, ce vaurien, ce brigand...
Sa femme le regarda avec désespoir.
– Est-ce que tu aimes mieux mourir ? cria-t-elle.
– Que je meure !... Allez-vous-en, maudits chiens ! brailla le vieillard.
Au bout de deux heures, la crise s’apaisa un peu. Quand il vit que son beau-père allait mieux, Steftchov s’habilla en hâte pour se rendre au konak. Il pleuvait.
Dans l’escalier, il rencontra un petit homme.
– Alors ? demanda-t-il, tu as bien regardé ?
– Ils y sont, chez Beïzédéto.
– Au jardin ?
– Non, il pleut trop. Ils sont dans la cave. Je les ai épiés. Je ne suis pas tombé de la dernière pluie, moi...
Cet homme, c’était Ratchko, l’ancien aubergiste de Karnary. Il travaillait maintenant chez Iordan et servait en même temps d’espion à son gendre.
– Apporte-moi mon parapluie.
Une minute après, Steftchov sortait rapidement.
Cachée derrière la porte, Lalka avait entendu la conversation. Elle suivit son mari d’un regard étrange, étonné et effrayé, puis elle monta vite l’escalier et disparut dans l’une des chambres.
5 TRAHISON
Lorsque Steftchov entra chez le bey, il le trouva en train de jouer au trictrac avec Zamanov.
Zamanov, espion officiel des autorités turques, recevait ses appointements du konak de Plovdiv. Il avait quarante-cinq ans, mais paraissait plus âgé ; son large visage maigre, noiraud, où luisaient d’un éclat trouble deux yeux noirs et mobiles, était prématurément creusé de rides et avait une expression repoussante et sinistre ; il portait le sceau du cynisme et de la misère ; sa moustache taillée court était presque blanche, de même que ses cheveux gras et mal peignés, qui dépassaient son fez crasseux ; le sommet de sa tête était chauve. Il portait un veston usé de bure mauve dont le col de drap noir luisait de graisse. Plutôt grand et élancé, il marchait ordinairement la tête penchée, comme courbée sous le poids du mépris général.
Zamanov habitait Plovdiv, mais il faisait souvent des tournées aux environs. Originaire de Biala-Tcherkva, il y connaissait tout le monde et tout le monde le connaissait : son arrivée à ce moment inquiéta tous ceux qui avaient des raisons de s’inquiéter : sans doute venait-il chargé de quelque sombre mission. Sa présence inspirait une crainte et une répugnance universelles, il le sentait bien, mais cela lui importait peu, il supportait les regards méprisants avec insolence, comme s’il disait : « Il n’y a là rien d’étonnant. C’est un métier comme un autre, je dois vivre, moi aussi ! » Déjà, il avait rencontré quelques-uns des notables, déjà il leur avait soutiré de l’argent : bien entendu, personne n’avait rien refusé à un débiteur aussi honnête et à un concitoyen aussi aimable. Était-il au courant de ce qu’on préparait à Biala-Tcherkva ? car il demandait, avec un sourire diabolique, à chaque jeune homme qu’il rencontrait : « Comment va l’armement ? » Pour aggraver encore le trouble de son interlocuteur, il ajoutait à voix basse : « Vous n’arriverez à rien ! » et il l’abandonnait, stupéfait, dans la rue. L’avant-veille, il avait interpellé de cette façon le président du comité ! Cette fausse franchise et cet abord direct faisaient fuir tout le monde devant lui.
Aussi le visage de Steftchov s’éclaira-t-il de satisfaction, quand il trouva chez le bey ce puissant allié. Il salua les deux joueurs en souriant et s’assit, en familier, pour suivre la partie, après avoir serré la main de Zamanov.
Le vieux bey, serré dans sa tunique noire bien boutonnée, continuait à jouer avec beaucoup d’attention, après avoir rendu, silencieusement, son salut à Steftchov. La partie terminée, Steftchov alla droit au but. Il exposa au bey, avec force détails, ce que la rumeur publique lui avait appris de l’effervescence révolutionnaire qui gagnait Biala-Tcherkva.
Le bey avait eu vent d’une certaine agitation des raïas mais, la considérant comme très peu sérieuse, il ne s’émouvait pas.
Il fut donc surpris d’apprendre, par Steftchov, que le mal était aussi étendu. D’un air interrogateur et sévère, il se tourna vers Zamanov :
– Christaki-efendi, nous jouons au trictrac avec toi et, autour de nous, cela fume déjà !
– Je ne suis que depuis quelques jours ici, répondit Zamanov, mais je suis au courant de tout cela et mieux que Kiriak.
– Tu le sais et tu ne m’en dis rien ? Tu sers bien le Sultan, il n’y a pas à dire ! s’écria le bey, mécontent. Steftchov s’est montré un pilier du trône plus solide que toi !
– C’est mon devoir, efendi, assura Steftchov.
De grosses gouttes de sueur perlaient sur le front de Zamanov. Il dit nerveusement :
– S’il y a ici une paille, ailleurs c’est une poutre. Si un brin de foin fume ici, vers Panagurichté, c’est toute une meule qui flambe ! Mais nos sages gouvernants ne sont ni sourds ni aveugles. Ils voient la fumée et ne bougent pas : ils ont pour cela leurs raisons. Ce serait une erreur de notre part de faire du bruit les premiers et de nous compromettre pour un rien. Ce que nous voyons à Biala-Tcherkva n’est que l’ombre de la fumée qui monte ailleurs jusqu’aux nues. À mon avis il ne faut pas se presser, il faut attendre dans le calme.
Ces paroles plurent au bey : elles répondaient à son penchant pour la tranquillité et à sa peur des responsabilités.
Steftchov s’en rendit compte et se mit en colère : il sentit que par cette explication Zamanov camouflait sa négligence des intérêts de l’État.
– Christaki-efendi n’a rien ici, ni famille, ni intérêts, ni même une couverture trouée, il lui est donc aisé de philosopher, dit-il fielleusement. Qu’y perd-il, lui, si ça flambe demain ?
– Je proteste, monsieur ! s’écria Zamanov, pâle de colère.
– Tu as raison, Kiriak ! je les enchaînerai tous ces vauriens, dit le bey, qui s’échauffait.
Steftchov prenait un air triomphant.
– Réflexion faite, moi aussi je suis de votre avis. Qu’on les prenne, ces ânes ! dit Zamanov, le visage mairqué par une haine subite.
– Alors, nous sommes d’accord ! fit le bey, avec un sourire de soulagement.
– Qu’on les arrête, et ce soir même ! dit Zamanov.
– Où se réunissent-ils ? demanda le bey.
– Chez Mitcho Beïzédéto.
– Maintenant, j’y vois clair. Qui est plus moscovite que les Moscovites eux-mêmes ne peut être un ami du Sultan. Qui est le chef ?
– Le Dr Sokolov, répondit Steftchov
– Encore Sokolov ? C’est lui qui remplace le consul ?
– Oui, bey-efendi, seulement ce que faisait le consul n’était qu’un jeu à côté des menées de Sokolov.
– Quels sont les autres ?
– Les instituteurs renvoyés et quelques autres voyous.
Le bey consulta sa montre.
– Y sont-ils en ce moment ? demanda-t-il.
– Oui, ils sont dans la cave. D’habitude ils se réunissent au jardin, quand il fait beau. Ils boivent de l’eau-de-vie et discutent.
– Comment faut-il s’y prendre ?
Ils sortent toujours de chez Mitcho à la nuit tombée. Les zaptiés n’ont qu’à les saisir à ce moment-là et à les emmener tous au konak.
– Non, ce n’est pas ainsi qu’il faut procéder, dit Zamanov. Vous allez vous emparer de ces gens sans posséder aucune preuve de leur culpabilité : ils pourront tout nier. Ce qu’il faut, c’est les surprendre chez Mitcho, dans la pièce même où ils siègent, en flagrant délit pour ainsi dire. Prenons-les en même temps que leurs papiers, leurs procès-verbaux, tous les documents... Voilà du travail propre, du noir sur blanc ! Il n’y aura pas de : « Je ne sais pas, je n’ai rien vu, rien entendu. » Je leur ferai subir moi-même le premier interrogatoire.
Ce conseil plut au bey et Steftchov lui-même fut enchanté par cette idée. L’espion remontait nettement dans son estime, son ingéniosité rivalisait avec son propre zèle.
– Mais il ne faut y aller que quand il fera complètement nuit, ajouta Zamanov, l’obscurité est propre à ce genre d’opérations.
– Entendu ! dit solennellement le bey ; et il frappa dans ses mains.
Un zaptié apparut.
– L’onbachi est-il là ?
– Non, mais il va rentrer bientôt.
– Dis-lui de venir me trouver dès qu’il sera là, ordonna le bey.
Le zaptié sortit.
– Ah ! j’oubliais, dit Steftchov, en se tournant vers Zamanov.
Ce dernier était plongé en de sombres réflexions ; des rides profondes et inquiètes sillonnaient son front ; elles semblaient le reflet de pensées et de plans ténébreux, agités au profond de son âme. Steftchov sortit de sa poche une lettre qu’il déplia.
– Qu’est-ce que c’est que ça ? demanda Zamanov, arraché à ses réflexions.
– Une lettre de Sokolov pour Panagurichté.
– Pas possible !
– Son courrier a dû la laisser tomber... Je l’ai trouvée devant la maison de mon beau-père.
– Qu’y a-t-il ? demanda vivement Zamanov, qui essayait de lire par-dessus l’épaule de Steftchov.
– C’est une lettre écrite d’après un code secret et adressée à un certain Louka Neïtchev. Le bonhomme est cordonnier à Panagurichté et passe chaque semaine par Biala-Tcherkva pour se rendre au marché de K..., mais je suis persuadé que la lettre est destinée à une tout autre personne, sans doute au comité de Panagurichté.
– Qu’est-ce que ce papier ? demanda le bey curieusement, car ils parlaient bulgare.
Steftchov expliqua.
– Lis donc voir, dit le bey, l’oreille tendue.
Steftchov lut les lignes suivantes :
« Baï Louka,
« J’espère que vous vous portez tous bien à la maison et que ta femme est déjà remise. Toutefois, continuez à lui donner les pilules que je lui avais prescrites. Comment vont les affaires par là ? Cela fait deux semaines que je ne t’ai vu passer chez nous, j’espère que ce n’est pas pour des raisons de santé. Si tu viens par ici, achète-moi pour dix sous de belladone de la droguerie de Ianko, car j’ai fini la mienne.
« Bien des choses à tout le monde.
SOKOLOV »
– En effet, c’est une lettre à double sens, dit Zamanov.
– Traduis-la maintenant en turc, ordonna le bey.
– Si vous voulez mon avis, elle dit tout ou rien, cela dépend de la façon de comprendre, dit Steftchov, se tournant vers le bey ; puis il se mit à traduire.
– Attends, interrompit tout de suite le bey, ici, sous le mot « pilules », il faut comprendre des balles !
– Oui, ce sont peut-être des balles, remarqua Zamanov.
Le bey laissa échapper un nuage de fumée avec une expression de fierté et de satisfaction et tendit de nouveau l’oreille. Steftchov poursuivit la lecture.
– Attends ! coupa le bey. Il s’intéresse aux « affaires ». J’ai compris, cela veut dire : comment marchent les préparatifs ? Nous ne sommes tout de même pas des ânes !
Et le bey eut à l’adresse de Zamanov un clignement d’œil significatif, qui voulait dire : « Il a beau être vieux, Husni-bey ; c’est un rusé renard et personne ne peut le mettre dedans. »
Steftchov poursuivit la lecture. Quand il arriva au passage : « ...ce n’est pas pour des raisons de santé », le bey l’interrompit à nouveau et demanda à Zamanov :
– Christaki-efendi, là où il parle de maladie et de santé, cela me paraît un peu obscur. Comment comprends-tu cela ?
– Je pense que, sous le mot « maladie », il faut entendre « santé » et sous le mot « santé », « maladie », dit l’espion, d’un air suffisant.
Le bey resta pensif, de l’air de quelqu’un qui a parfaitement saisi toute la signification de cette réponse profonde.
– Nous y sommes ! dit-il enfin, triomphant.
Lorsque Kiriak mentionna la belladone, le bey, tout joyeux, s’écria :
– Ah ! ça y est, il l’a dit enfin : la grosse Dona est aussi dans le coup ! Chaque fois que je la rencontre, cette vache, je me dis toujours que c’est une maligne et qu’elle est une ennemie de l’État !
Par ces paroles, le bey désignait la grosse mère Dona, âgée de soixante-cinq ans, qui, se rendant soir et matin à l’église, passait chaque fois devant le konak.
Steftchov et Zamanov échangèrent un sourire ; ils expliquèrent au bey que la belladone était une plante médicinale.
– Allons, continue ! dit le bey, un peu penaud.
Steftchov reprit :
– « Bien des choses à tout le monde. Sokolov. » C’est fini.
Le bey s’écria :
– « Bien des choses à tout le monde. » Bien sûr ! En un mot, cette lettre pue la rébellion, d’un bout à l’autre.
– Mais on ne peut rien en tirer de sérieux, dit Steftchov, mécontent.
– C’est obscur, c’est plutôt obscur, reprit Zamanov.
– C’est obscur, c’est vrai, rétorqua le bey, mais nous demanderons au docteur lui-même de nous expliquer ce que nous ne comprenons pas.
– Non, je suis curieux de connaître tout de suite le sens du message, dit Zamanov, regardant fixement la lettre. Donnez-la-moi, j’en trouverai le secret : j’ai chez moi un code pour les lettres de rebelles.
Et il mit la lettre dans sa poche.
– Bravo ! Christaki-efendi.
Steftchov salua à la turque, pour prendre congé.
– Alors, n’est-ce pas, c’est décidé ? demanda-t-il.
– Tout sera fini ce soir, répondit le bey. Tu peux dormir tranquille ! Mes salutations au tchorbadji Iordan.
Steftchov sortit, la mine rayonnante de satisfaction. À la porte du konak il fut rattrapé par Zamanov.
– Tu restes ici ce soir, n’est-ce pas ? C’est toi qui dirigeras l’arrestation de ces messieurs ? dit Steftchov.
– Bien sûr, j’ai pris tout cela sur moi, répondit l’espion. À propos, Kiriak, prête-moi une lire jusqu’à demain, j’en ai besoin, ajouta-t-il rapidement.
Steftchov fronça les sourcils mais fouilla dans la poche de son gilet :
– Voici deux roubles, c’est tout ce que j’ai.
Zamanov prit l’argent puis ajouta à voix basse :
– Donne, donne encore, parce que, si je glisse un mot à Strandjov de ce que tu manigances aujourd’hui, tu ramasseras sûrement un pruneau !
Et il ricana, comme pour montrer que cette menace n’était au fond qu’une plaisanterie.
Steftchov, inquiet, le regarda :
– Zamanov, si demain j’apprends que Sokolov et ses camarades sont à l’ombre, tu auras dix lires, parole d’honneur ! dit-il solennellement.
– D’accord. Maintenant, donne-moi encore trois ou quatre groches pour mon dîner, que je ne sois pas obligé de changer les roubles ce soir. Merci, adieu !
Et Christaki se dirigea vers l’auberge où il était descendu. En tournant le coin de la maison de hadji Tzatcho, il rencontra le pope Stavri et l’arrêta.
– Bénissez-moi, mon père ! dit-il, lui baisant la main. Comment allez-vous ? Les affaires marchent-elles bien ? Y a-t-il actuellement plus de naissances que de morts ?
– On se marie surtout, répondit le pope avec un sourire forcé.
Il se hâtait de poursuivre son chemin, effrayé par le regard inquisiteur de l’espion, mais Zamanov le retint par le bras en le fixant :
– C’est bien le moment de se marier, parce que, d’ici peu, ce sera peut-être le Jugement dernier ! – Il cligna de l’œil d’un air entendu puis changea soudain de sujet : Aurais-tu par hasard cinquante groches à me prêter jusqu’à demain ? j’en ai besoin.
Le visage du pope se tendit :
– Un pope n’a jamais d’argent. Si l’on veut sa bénédiction, ça oui !...
Après cette plaisanterie, le pope crut pouvoir s’esquiver. Mais Zamanov le regarda d’un air sévère et chuchota :
– Donne vite les cinquante groches, car ton fils Gantcho est le secrétaire du comité... Je n’ai qu’un mot à dire et c’en est fait de vous.
Le pope blêmit. Il sortit une pièce de monnaie de sa poche et la tendit, en faisant vite ses adieux.
– Au revoir, mon père, ne nous oublie pas dans tes prières !
– Anathème ! marmonna le pope en s’éloignant.
Il bruinait toujours.
– Garçon, apporte-moi un peu de braise que je me réchauffe, cria Zamanov au valet, en entrant dans sa chambre.
Le jeune homme le regarda, étonné, comme s’il voulait dire : « Quel type es-tu donc pour vouloir te chauffer à cette époque de l’année ? »
– Apporte un peu de braise, et plus vite que ça, ordonna l’espion, en enlevant son veston trempé.
Le valet apporta quelques morceaux de braise et les posa dans un petit brasero qu’il tira de dessous le lit.
– Va-t’en maintenant ! et Zamanov claqua la porte derrière le dos du garçon.
Alors il sortit la lettre de sa poche, la déplia, la tourna vers le feu du côté blanc et attendit avec patience. Après un moment, il éleva le papier à la hauteur de ses yeux, le regarda et une expression de vive curiosité mêlée de satisfaction se peignit sur ses traits. Comme on sait, les lettres des comités étaient écrites avec de l’encre sympathique ; elle devenait visible après avoir été chauffée. D’habitude, au recto, ces lettres contenaient des phrases anodines et sans importance, destinées à tromper les autorités entre les mains de qui elles tomberaient. Malheureusement aucun secret ne peut être gardé s’il est connu de plus de deux personnes, et le perspicace Zamanov l’avait surpris.
La lettre signée par le président Sokolov démasquait l’activité et les plans du comité de Biala-Tcherkva.
Après sa lecture, un sourire indéfinissable apparut sur la face repoussante de Zamanov. Il sortit un crayon et inscrivit quelque chose sous le nom du président.
Puis il sortit en hâte et se dirigea vers le konak.
6 UN CŒUR DE FEMME
Steftchov était à peine sorti de la maison de son beau-père pour se rendre chez le bey, que sa femme sortait derrière lui. La pluie, qui avait commencé à tomber l’après-midi, s’était changée en bruine et semblait vouloir persister jusqu’au soir, car le ciel était couvert de nuages épais.
Abritée sous son parapluie, Lalka marchait rapidement. Elle était à ce point absorbée et troublée qu’elle ne répondait pas aux salutations des gens qu’elle rencontrait et ne sentait pas que la pluie, qui la fouettait, la mouillait à droite jusqu’à l’épaule. Elle arriva sur la place de l’église, qui avait une cour commune avec le couvent des religieuses.
C’est seulement alors qu’elle s’arrêta sous un auvent, se demandant, étonnée, ce qu’elle faisait, dans la direction opposée de la maison de son mari. Tout à coup, elle se rappela qu’elle voulait sauver Sokolov d’un danger imminent, et elle s’étonna de l’aimer autant ! Elle s’était décidée à cette démarche sans savoir comment elle devait s’y prendre, poussée par une force invisible.
À ce seul moment elle se sentit dégrisée et se demanda comment elle ferait pour aider l’homme qu’elle aimait, et c’était difficile, elle s’en rendait bien compte. Elle savait que Steftchov était chez le bey, à qui, sûrement, il proposait de faire arrêter Sokolov ; elle savait que Sokolov était à la réunion du comité chez Mitcho.
Comment le prévenir du danger ? Courir elle-même chez baï Mitcho, sous prétexte de voir sa femme, et lui raconter tout était inconvenant, indécent, presque insensé. Aller sous cette pluie en visite chez la femme de Mitcho, qui était pour elle presque une étrangère et dont le mari était brouillé avec son père, était un acte humiliant et peu convenable. Et, d’ailleurs, comment lui dire qu’elle, la femme de Steftchov, s’intéressait si vivement au destin de Sokolov, un jeune homme sympathique mais frivole, et qu’elle avait renoncé à toute convenance, à toute décence, dans le seul dessein de lui être utile ? D’autre part, n’allait-elle pas compromettre involontairement son mari, le dénoncer comme un traître, le déshonorer ? Car, même si elle taisait son nom, tout le monde saurait que c’était Steftchov qui avait dénoncé les victimes qu’elle allait sauver : de toute façon, tout le monde avait pu le voir se rendre au konak aujourd’hui.
« Mon Dieu, pourquoi est-il donc si méchant ? »
Toutes ces pensées traversèrent comme un éclair l’esprit de Lalka. « Non, non, se disait-elle, c’est trop ignoble, c’est impossible ! » Et la pluie tombait, plus fort maintenant, et elle restait sous l’auvent comme dans une place assiégée, toute faible, tout étourdie. Si du moins une connaissance était venue par là, à qui elle se serait confiée, qu’elle aurait envoyée prévenir les conspirateurs. Mais personne ne passait. La pluie était devenue averse. L’eau qui ruisselait vidait les rues. Elle vit combien elle était ridicule et malheureuse, combien il était malaisé de jouer les providences. Elle sentait dans quelle situation impossible elle s’était mise, bloquée maintenant sous l’auvent, quand il lui suffisait de faire une vingtaine de pas pour entrer au couvent chez sa tante. Non, il n’y avait rien à faire là ! elle ne trouverait là aucun secours, ce n’était pas là que son chemin devait la mener. Aurait-elle pu rester une seule minute chez la religieuse à écouter son bavardage, pendant que son cœur débordait d’amertume et que l’angoisse la rendait folle ? Une seule chose la consolait : la pluie torrentielle qui l’assiégeait retenait aussi les policiers au konak ; Sokolov n’était pas encore attaqué, il lui restait malgré tout un espoir, quoique infime.
Soudain, une pensée joyeuse illumina son esprit... « J’irai chez ma tante Nedkovitsa, se dit-elle. C’est son fils Tacho que j’enverrai les avertir. »
En effet, chez sa tante Nedkovitsa, qui habitait non loin de là, Lalka pouvait épancher librement son cœur ; elle pouvait, sans aucune crainte, charger son fils d’une mission délicate.
Elle quitta l’auvent qui l’abritait et, courageusement, courut à travers la boue épaisse ; elle traversa un torrent d’eau trouble qui lui arriva jusqu’aux chevilles puis poursuivit vers la place, fouettée par la tempête et la pluie.
Elle arriva chez sa tante les vêtements dégoulinant d’eau. Celle-ci l’accueillit, stupéfaite de la voir arriver par un temps pareil.
– Mais comme tu es trempée ! Mais où vas-tu sous cette pluie ? Enlève ton manteau, il est trempé, criait la tante en l’accueillant à la porte d’entrée.
– Tante, Tacho est-il à la maison ?
– Non, il n’est pas rentré depuis ce matin, tu le connais ce coquin. Tu en as besoin ?
– Adieu, tante.
Et Lalka reprit son parapluie. Elle semblait ivre.
– Mais où vas-tu ? s’exclama la tante.
Lalka s’était élancée dans la rue. Heureusement la pluie avait cessé, les nuages s’ouvrirent et de nouveau le soleil brilla de tout son éclat joyeux.
La bruine presque invisible remplissait encore l’air apaisé, brillant au soleil comme les fils d’une gigantesque toile d’araignée. Un magnifique arc-en-ciel dont une des extrémités trempait dans la gorge sombre de la montagne se dessina très haut sur les têtes. Dans les cours des maisons, les couronnes touffues des arbres parurent plus vertes, plus fraîches et plus joyeuses ; les nuages s’enfuirent en hâte devant l’azur lumineux qui s’étendait triomphalement. Des passants réapparurent. Lalka se sentit mieux et son cœur battit plus légèrement ; cet arc-en-ciel, en réjouissant l’atmosphère, la remplissait d’espoir. Le cœur tremblant, elle fixait chaque passant dans l’espoir de rencontrer quelque ami.
Subitement elle pensa à Koltcho, l’aveugle, dont le dévouement avait sauvé une fois Ognianov d’un danger pareil.
– Mon Dieu, si je pouvais seulement l’apercevoir quelque part ! soupira-t-elle, jetant un regard troublé aux visages indifférents qu’elle croisait.
Le hasard, qui se joue souvent des humains et fait dévier leur destin de la façon la plus inattendue, joua maintenant aussi son rôle capricieux : à cinquante pas devant elle, elle aperçut Koltcho qui avançait doucement, à tâtons, s’appuyant d’une main sur sa canne, de l’autre tenant encore son parapluie ouvert. Joyeuse, émue, elle se précipita à la suite de l’aveugle. Il suivait justement la rue qui menait chez Beïzédéto ; probablement il s’y rendait aussi, car Lalka savait de Rada que Koltcho avait l’entrée libre aux séances du comité et qu’il n’en manquait pas une seule. Elle se pressait, accélérait le pas, elle courait presque. Ses yeux ne quittaient pas le pardessus noir de l’aveugle, un peu trop long pour sa petite taille, et le parapluie, trop grand. Elle ne voyait plus personne d’autre ; ni Barzobégounek, qui la salua de sa main gauche, ni hadji Smion, qui lui cria quelque chose ; elle aurait rencontré Steftchov qu’elle ne l’aurait pas reconnu. Bientôt elle fut à deux ou trois pas de l’aveugle. Il marchait tranquillement, de l’air rêveur des aveugles. Lorsqu’elle fut à ses côtés, elle jeta un regard furtif autour d’elle ; il n’y avait pas de témoin compromettant. Elle murmura tout bas :
– Koltcho, Koltcho !
Mais l’émotion éteignit sa voix, elle ne l’entendit pas elle-même.
Koltcho entra à la cordonnerie d’Ivan Doudito. Cette disparition fut si rapide et si soudaine que Lalka eut l’impression qu’une force invisible l’avait brutalement attiré par la porte ouverte de la boutique. Elle resta de nouveau seule, seule au milieu de la rue grouillante qui lui sembla un désert. Puis elle aperçut une ombre noire dans ce désert. C’était un zaptié, le fusil à l’épaule, mais il lui sembla que c’était toute une foule de zaptiés... Elle avait le vertige, ses pensées s’embrouillaient, elle ne savait plus si elle était éveillée ou si elle dormait ; c’était inconsciemment qu’elle avançait encore.
Lalka ne savait plus quelles rues elle traversait, elle ne sut pas davantage comment elle se retrouva chez elle. Sa tête bourdonnait, ses articulations semblaient se disloquer ; elle se sentait très faible, très mal ; à peine entrée dans sa chambre elle s’évanouit.
Lalka fut prise alors d’une très forte fièvre, la fièvre qui devait bientôt la mener à la tombe...
7 LE COMITÉ
Cette fois, à cause de la pluie, le comité s’était réuni dans la maison de baï Mitcho, et non, comme d’habitude dans le jardin, sous le pommier en fleurs et sous les hauts buis.
L’espion de Steftchov avait bien vu.
Sur les sofas étaient assises environ une dizaine de personnes. On y distinguait certaines de nos connaissances : d’abord le maître de céans, puis le président Sokolov, le pope Dimtcho, Frangov, Popov, Nikolaï Nedkovitch, Kandov, qui avait été admis le jour même par acclamation, de même que M. Fratiou, rentré pour Pâques de la Valachie et qui avait été admis après beaucoup d’insistance et de repentir de sa part. Il avait fui en Valachie aussitôt après la Saint-André, se jurant bien de ne plus jamais se mêler de politique et il arriva sain et sauf à Bucarest. Mais, dès qu’il se vit en sécurité, il redevint patriote et républicain ardent et se fit passer devant les émigrés pour un martyr échappé à la corde. De là, il écrivit, sans le signer, un article qui recommandait l’instauration de la république en Bulgarie. Mais Karavelov 102, fort occupé de la fédération balkanique qu’il organisait sous la direction du prince Milan, repoussa avec dédain ce chef-d’œuvre. Fratiou le présenta alors à Botev 103 pour son journal Znamé 104, mais, là, il eut le même sort – Botev rêvait alors de socialisme universel. Et Fratiou se fit photographier en costume de rebelle, armé, tout hérissé de son importance. Pourtant, réflexion faite, il décida qu’il n’était pas prudent de répandre des images aussi compromettantes et il les classa avec ses articles républicains.
Les autres membres du comité étaient Ilya Strandjov, un cordonnier, ancien exilé, terrible coupe-jarret ; Christo Vragov, un commerçant ; Dimo Kapassasa, qui se faisait appeler aussi Bezportev et Rédacteur, cordonnier de profession, boiteux et conspirateur éternel.
Un seul membre était absent : Pentcho Diamandiev. Il s’était rendu à K... pour acheter des fusils avec les cent lires qu’il aurait dû remettre à Tossoun-Bey.
La nuit tombait.
Bien que la séance fût ouverte depuis midi, elle se poursuivait encore et, d’après tous les indices, elle devait durer toute la nuit. Les discours éloquents et ardents de Kablechkov tenaient en haleine les membres qui, depuis deux heures déjà, l’écoutaient, silencieux.
Kablechkov, l’une des personnalités les plus sympathiques et les plus originales de l’essaim des « apôtres » qui préparèrent le mouvement d’Avril 1876, était un jeune homme de vingt-six ans, de taille moyenne, très maigre, au visage pâle, brun, aux moustaches à peine visibles, aux cheveux noirs comme du charbon, dont les mèches rebelles, que sans cesse il relevait, retombaient toujours sur son large front intelligent. Seuls les yeux vifs, ardents et pénétrants, qui s’illuminaient tantôt de l’enthousiasme du prophète et tantôt de l’inspiration du poète, éclairaient et ennoblissaient ce visage émacié par la fièvre et creusé par le travail et les veillées. Aucun regard ne pouvait résister à ce regard où se reflétait l’âme puissante, ardente et vigoureuse qu’on pouvait à peine deviner dans ce corps malingre.
Il était vêtu d’un pardessus de drap bleu et d’un pantalon noir usé jusqu’à la corde par ses fréquents voyages à cheval. Il ne cessait d’arpenter la pièce, en déversant un flot de paroles pressées, interrompu souvent par une toux tenace.
– Oui, l’aide, l’aide principale doit venir de nous-mêmes. Nous sommes assez forts pour venir seuls à bout de cette Turquie pourrie. La Turquie est faible et ruinée financièrement ; le peuple turc, appauvri, se tiendra à l’écart ; lui-même souffre sous le joug. L’armée est démoralisée et ne mérite aucune attention. Prenez l’exemple de l’insurrection d’Herzégovine ; on y a envoyé des milliers et des milliers de soldats ; pourtant, elle bat son plein. Et qui la fait, cette insurrection ? une poignée d’hommes ! Alors, que fera cet État pourri et effrayé lorsque nous nous soulèverons ? En une seule journée nous serons cent mille insurgés. Qu’ils envoient alors de la troupe... à qui ces hommes s’en prendront-ils d’abord ? D’ailleurs, nous ne serons pas seuls : à l’ouest de la Turquie se tiennent la Serbie et les faucons monténégrins, prêts à l’attaque et, derrière elle, c’est la Grèce, qui ne restera pas les bras croisés. L’Herzégovine et la Bosnie se soulèveront d’un bout à l’autre ; la Crète aussi. Ajoutez-y la révolution à Constantinople : on n’y attend que le moment propice pour renverser le sultan Aziz 105. C’est le chaos partout. Notre insurrection sera la messe funèbre de l’empire Ottoman !
Ses yeux brûlaient dans la pénombre comme des charbons ardents.
– Tu as oublié une chose, intervint Mitcho Beïzédéto : la Russie. Le grand-père Ivan s’envolera du Nord vers Constantinople et alors... alors la Turquie aura vécu. La prophétie s’accomplira mot à mot.
Il sous-entendait par là les prophéties du fameux Martin Zadek, auxquelles il croyait fermement.
– Quelles sont les localités prêtes à l’insurrection ? demanda Frangov.
– Toute la Bulgarie, répondit Kablechkov. Plovdiv et la région de Pazardžik sont en pleins préparatifs. Des armes sont distribuées en secret dans les villages des Rhodopes et à Batak ; Tirnovo, Gabrovo et Choumen mettront le feu à toute la Bulgarie de l’est ; en Bulgarie occidentale, il n’y a pas de troupes. Koprivchtitsa, Panagurichté et Strelcha garderont les cols de la Sredna-Gora ; vous et vos voisins, vous tiendrez le Balkan – et le Balkan est une forteresse qu’un million de soldats ne pourront ébranler. La Bulgarie se soulèvera comme un seul homme. Notre insurrection sera un miracle dans l’histoire de l’Europe ! L’Europe en perdra le souffle ! Je vous assure que la Sublime Porte ne pensera même pas à une répression armée : elle cherchera un accord avec nous. Pas d’autre salut pour elle !
Kablechkov parlait d’enthousiasme. Il était trop intelligent pour ne pas se rendre compte de la réalité qu’il présentait sous cet aspect trompeur, mais l’idée l’emportait et tous les moyens lui étaient bons qui la guideraient vers son couronnement. Seule sa foi sublime en la cause sacrée qu’il servait peut expliquer comment ce cœur honnête lançait à la fois des affirmations sincères ou intentionnellement fausses, si éloquemment persuasives qu’elles ne soulevèrent aucune objection. Tous étaient déjà convaincus ; tout se passerait, ainsi, c’était l’évidence même.
– Quelles conditions présenterons-nous si la Sublime Porte en venait à négocier avec nous ? demanda Popov.
– Elle y viendra, bien sûr. Qu’est-ce qu’elle peut f... sans cela ? remarqua le pope Dimtcho.
– Ça chauffe déjà drôlement pour elle, ajouta Bezportev.
– Ça, c’est la dernière question, répondit Kablechkov, mais, pour l’instant, voici ce qu’on pense : la Bulgarie, du Danube jusqu’à l’Arda et de la mer Noire à la mer Égée, sera une principauté autonome, sous la dépendance du Sultan. L’exarchat restera tel qu’il est ; un impôt fixe sera versé à la Turquie ; l’armée sera, avec des officiers pour moitié turc, pour commencer...
– Et le prince ? demanda Christo Vargov.
– Oui, le prince ? ajouta Bezportev.
– Un prince européen !
– Parbleu !
– Mais tu n’as rien dit de la Russie, est-ce qu’elle va nous aider, comme le dit baï Mitcho ? demanda le pope.
– Allons, mon père, ne fais pas l’enfant, gronda Mitcho renfrogné, comment peut-il en être autrement ? Des généraux russes attendent déjà à Bucarest.
Et il jeta un coup d’œil interrogatif sur Kablechkov. Tous les regards le suivirent pour entendre la confirmation de ces paroles. Kablechkov comprit ; il prit un air mystérieux pour dire à voix confidentielle :
– Au premier coup de feu, l’aigle bicéphale étendra ses ailes au-dessus de nous !
Et il les regarda, l’air solennel. Tous les visages s’illuminèrent.
– Je pense, reprit M. Fratiou, que le mieux pour nous, c’est la république ; on pourrait l’appeler « la république du Balkan ».
– Ou le royaume, qu’en dites-vous ? dit Frangov.
– Tu en demandes trop ! reprit le pope Dimtcho.
– Au fond, ça n’a pas d’importance, pourvu qu’on soit libre !
– Je suis aussi pour la république, intervint un autre.
– On vous l’a bien dit, c’est une autre affaire. Comment on va être gouverné, qui sera le prince, et ainsi de suite, laissons cela à Gortchakov. Que les diplomates se cassent la tête, dit Mitcho Beïzédéto.
– Allons, allons, messieurs, s’écria Sokolov, cessez de vous égarer et de faire de la haute diplomatie : le temps est précieux. Demain le premier coup de feu éclatera dans le Balkan et nous n’aurons pas encore tranché la question de savoir si ça doit être une république ou une comédie. Et pourtant, nous avons à faire ! Au diable vos républiques ! Je propose ceci : dans nos réunions, laissons de côté la diplomatie : sa place est au café de Ganko.
– Très juste, dit Kablechkov, on n’a pas besoin de paroles, messieurs, mais d’actes. Je vous ai exposé la situation, voyons maintenant ce que vous faites. Ne perdons dons pas de temps.
– C’est vrai, c’est notre faible de « diplomatiser ». Boïtcho – que Dieu ait son âme ! – nous le reprochait souvent ! Mais c’est comme ça qu’on est fait, nous autres de Biala-Tcherkva, dit baï Mitcho.
– Ah ! messieurs, la mort d’Ognianov est une grande perte pour vous et pour la Bulgarie ! dit Kablechkov tout ému, en poussant un profond soupir.
Le souvenir d’Ognianov assombrit tous les visages. Sa perte laissait chez eux un vide profond. Ils se regardèrent et plongèrent en de tristes réflexions. L’image tragique d’Ognianov se dressait devant eux, sanglante, terrible mais insaisissable. Chacun sentait sur sa poitrine un poids énorme, comme s’il regrettait de vivre alors que le héros était mort.
8 LES ÉMOTIONS DE KOLTCHO
À ce moment, des pas rapides sur la terrasse attirèrent leur attention. Ils s’élancèrent vers la fenêtre. Mais les pas étaient déjà derrière la porte.
– C’était Koltcho, dit Nedkovitch.
– Tu n’as pas bien vu, répliqua Mitcho, comment un aveugle peut-il courir si vite ?
– Il y a là quelque chose de louche, remarqua le pope Dimtcho.
Un frisson parcourut les membres du comité.
La porte fut pour ainsi dire défoncée. Koltcho pénétra en coup de vent, il haletait ; tout le monde se figea dans une attente anxieuse.
– On est tous des nôtres ici ? demanda l’aveugle, la voix entrecoupée par l’émotion.
– Tous des nôtres. Qu’y a-t-il, Koltcho ? demanda baï Mitcho.
– Vivat ! Hourrah ! Joie et gloire ! Réjouissez-vous, frères Soyez fous de joie, moi aussi je deviendrai fou ! criait Koltcho, comme si en effet il avait perdu la raison ; il lançait son fez en l’air, tapait des mains, bondissait ; saisissant par hasard baï Mitcho, il se mit à le baiser sur la bouche, sur les joues, sur les oreilles, sur l’épaule. Il l’étouffait. Baï Mitcho recula, encore plus interdit. Cette crise de joie hystérique, si peu naturelle, les stupéfia tous. Ils pensèrent tous que le pauvre aveugle avait perdu la tête.
– Mais qu’est-ce que tu as, Koltcho ? lui demanda le docteur apitoyé, tout en cherchant à déceler sur son visage les symptômes de la folie furieuse.
– Alors vous ne devinez pas ? Mais il vit ! hurlait Koltcho en se jetant cette fois sur le docteur. Vivat ! Mon petit comte est en vie !
– Comment ? Boïtcho ?
Cette exclamation partit de dix bouches à la fois.
– Il est vivant !
– Koltcho, tu es devenu fou, ou quelqu’un t’a menti ! dit baï Mitcho d’un ton sévère.
– Il est vivant, vivant, baï Mitcho ! Je lui ai serré la main, je lui ai caressé les joues, j’ai entendu sa voix, je l’ai presque vu ! Vous ne me croyez pas ?
Tout en Koltcho était convaincant. Les comitadjis regardèrent, éberlués.
– Où est-il ?
– Il attend à la porte et il m’a envoyé vous prévenir. Il m’a attrapé juste quand j’entrais. Je l’ai reconnu à ses mains.
À ce moment même, la porte du jardin s’ouvrit pour laisser passer un paysan. Il était coiffé d’un chapeau usé, une large pelisse de peau de chèvre l’enveloppait et il tenait deux poulets à la main ; un bandage couvrait un de ses yeux, probablement malade.
À tout autre moment personne n’aurait reconnu Ognianov sous cet accoutrement, mais alors ils le reconnurent tous.
Mitcho vola vers la porte en criant d’un air faussement calme :
– Baï Petko, viens, viens nous dire ce que tu deviens !
Mais la voix du pauvre vice-président était enrouée et sourde, comme si quelqu’un le serrait à la gorge. Ognianov traversa lentement la cour trempée de pluie, gravit lourdement l’escalier, puis il dit, d’une grosse voix :
– Mon mocassin salira ton plancher, baï Mitcho, mais tu m’excuseras.
Et il entra.
On se précipita, on embrassa le ressuscité. Questions, exclamations, épanchements, miracle, jubilation : Ognianov semblait le plus calme. Lorsque les esprits s’apaisèrent un peu, baï Mitcho dit, les yeux pleins de larmes :
– Monsieur le président, prenez donc votre place, la séance n’est pas terminée !
– J’accepte volontiers, mais rien que pour aujourd’hui, dit Boïtcho en souriant, et il s’assit dans le coin.
Alors tout le monde vit que ses yeux étaient pleins de larmes : l’affection profonde et sans réserve de ses amis et compagnons d’idées l’émouvait jusqu’au plus profond de son cœur.
Baï Mitcho dit, en désignant Kandov :
– Aujourd’hui, Kandov aussi est devenu notre frère.
Le regard d’Ognianov croisa celui de Kandov.
– Monsieur Kandov, la Bulgarie mérite qu’on se donne de la peine pour elle.
– Et même qu’on meure pour elle, répondit ce dernier.
Pendant ce temps, baï Mitcho regardait amicalement Ognianov, sans pouvoir en détacher ses yeux.
– Cette fois, on ne te laissera pas prendre si facilement, Boïtcho, dit-il ; puis il sortit sur la terrasse. – Vélizarié, cria-t-il, apporte donc vingt bûches de la cave et range-les ici.
Son fils apporta vingt fusils et les rangea derrière la porte.
– Ferme maintenant à clef la porte du jardin et mets-y le cadenas !
9 OGNIANOV PRÉSIDE
La séance se poursuivit sous la présidence d’Ognianov. Kablechkov était parti car la fièvre l’avait repris.
Beaucoup de questions importantes furent examinées, entre autres celle de la défense de la ville, car ses habitants se tenaient constamment sur le qui-vive, effrayés par les rumeurs d’une éventuelle attaque turque. Gancho Popov fut chargé de l’organisation d’une patrouille secrète, qui devait surveiller, la nuit, les quartiers éloignés. On adopta d’autres mesures de sûreté, visant à endormir la vigilance de la police. La lettre du comité de Panagurichté fut lue, elle était longue et contenait toutes sortes de recommandations, d’ordres et de dispositions à l’intention du comité dont l’activité devait s’harmoniser avec le plan général de l’organisation de l’insurrection. Elle portait la signature de Benkovski 106. Strandjov présenta la facture du plomb et de la poudre qu’il avait reçus et distribués, de même que celle de l’entrepôt des fusils : elle n’était pas entièrement payée et les armes avaient été retenues à K...
– Alors l’armement marche bien, remarqua Ognianov.
– Nous pouvons faire face à un bataillon et tenir vingt jours dans les tranchées, dit le pope Dimtcho.
Il n’y avait pas de tranchées, bien entendu, mais le pope appelait ainsi les haies basses des jardins potagers qui entouraient la ville.
– Mais s’ils ont des canons ? demanda Nedkovitch.
– Ça, ce serait mauvais, répliqua le pope, soucieux.
– Nous pouvons en avoir aussi, remarqua M. Fratiou ; je donnerai volontiers notre mortier en bois. Il tonnera comme un vrai canon Krupp. Que les autres en donnent aussi ; ça fera toute une artillerie. (Et Fratiou regarda fièrement autour de lui.)
– Ton mortier ne servira à rien. Ramasser les mortiers fêlés des vieilles femmes, il est même ridicule d’en parler, rétorqua Ognianov. Pourtant les canons nous sont indispensables car leur seul bruit agit de façon terrible sur le moral de l’ennemi. Mais on peut faire des canons avec des troncs de cerisiers, bien perforés et solidement cerclés de fer. On en a utilisé de pareils au cours des insurrections polonaises !
L’avis d’Ognianov fut approuvé et adopté à l’unanimité.
– Bouktchéto les fabriquera, dit Mitcho.
– Bouktchéto ? c’est une vieille connaissance, dit Ognianov.
– Tu le connais, le tonnelier ? C’est un type épatant, ajouta le docteur.
– Des canons de cerisier ? Mais qui laissera couper ses arbres ? demanda Vragov.
– Ça c’est la moindre des choses, dit Nedkovitch. Je m’en charge !
– Adopté ! Nedkovitch est chargé d’organiser l’artillerie, dit en riant Ognianov.
– Passons maintenant à d’autres questions. Qu’y avait-il encore, Gantcho ?
– L’essentiel : l’argent. De K..., Nikoltcho nous a fait savoir que nous devions payer dès demain les fusils et les amener ici. Il a peur de les laisser plus longtemps dans son magasin : il craint que les Turcs n’aient flairé quelque chose.
– C’est une question importante, dit Ognianov. Nous devons nous hâter. Si l’on découvre les armes, cet homme peut en pâtir terriblement, et d’autres avec lui.
– Laisse donc cela, mais les cent lires que nous avons envoyées seront aussi perdues, remarqua Sokolov.
– Nous devons retirer les fusils le plus rapidement possible et les cacher ici pendant la nuit. Combien nous en faut-il encore ? demanda Ognianov.
Le comité prit cette question à cœur. On proposa de faire une collecte pour réunir la somme, mais cette proposition fut rejetée comme irréalisable. Mitcho Beïzédéto offrit de prendre l’argent de l’école : après la victoire, la future principauté le rendrait à la municipalité ; cette proposition fut également rejetée. Quelqu’un suggéra d’emprunter de l’argent à Kourka au nom de tous les comitadjis, mais cette suggestion fut également laissée de côté comme étant le moins acceptable. Cette question était la plus importante, mais on ne lui voyait pas de solution.
Tout cela, qui nous fait sourire aujourd’hui, était discuté par des gens sérieux : l’éclat et la nouveauté de l’entreprise, vus à travers le prisme de l’imagination, troublaient leur raison. Seule une foi fanatique peut amener un tel aveuglement de l’esprit.
D’un air grave, Ognianov écoutait.
– Je le trouverai, cet argent ! dit-il soudain.
Tout le monde le regarda.
– Où le trouveras-tu ? demanda Vragov.
– C’est mon affaire, répondit Ognianov.
Ceci coupa court à d’autres questions. Gantcho Popov demanda la parole :
– Messieurs, il se fait déjà tard. Avant de lever la séance, terminons une petite affaire : de nouveaux membres n’ont pas encore signé le procès-verbal de la conjuration. Qu’ils s’approchent et apposent leurs signatures.
Et il tendit l’encrier.
Les nouveaux membres étaient Vragov, M. Fratiou et Kandov. Les deux derniers signèrent sans hésitation, mais Vragov subissait une lutte intérieure visible.
– Frères, dit-il confus, mais, si ce papier tombe entre les mains des Turcs, je serai pendu, pour rien !
– Comment pour rien ? N’es-tu pas conjuré et révolutionnaire ? demanda Frangov.
– Je le suis, frères, mais j’ai un foyer.
– Nous en avons un aussi, signe donc au plus vite, que nous ayons ton nom noir sur blanc, dit d’un ton courroucé le pope Dimtcho.
– Vragov, tu n’as pas honte ? s’écria sévèrement Ognianov.
Vragov signa, l’air abattu. Mais au lieu de Christo Vragov, comme sur ses lettres commerciales, il signa Risto Vragata, du nom dont on l’appelait couramment : on ne sait jamais...
10 UN ESPION EN 1876
Au-dehors il faisait complètement nuit.
– Monsieur le président, dit alors Kandov qui, jusqu’à ce moment, avait gardé le silence, je demande la parole.
– Moi aussi, j’allais la demander, pour proposer de lever la séance, fit M. Fratiou.
Plusieurs appuyèrent la proposition de Fratiou.
– Je demande la parole ! Je ferai une autre proposition. Il s’agit de Steftchov, reprit avec obstination l’étudiant.
– Ah ! tu m’y fais penser, interrompit Frangov. Steftchov a été aujourd’hui au konak, chez le bey ; Zamanov aussi. Et son valet, Ratchko le Péteux, tournait par ici et nous épiait pendant que nous entrions par la petite porte du jardin.
– Ratchko, dit involontairement Ognianov, mais je le connais ce crétin ; à l’auberge de Karnary...
– Comment ? est-ce que c’est vrai que tu l’as attaché ?
– Il racontait quelque chose dans ce genre mais personne ne le croyait : On te savait mort ! D’ailleurs il est un peu toqué.
– Il vous a dit la vérité, expliqua Ognianov qui, dans son bref exposé devant le comité, n’avait pas pensé mentionner ce détail ; mais laissons cela de côté. Alors Steftchov continue à espionner, selon son habitude ? Ah ! le salaud ! (Et le visage d’Ognianov s’enflamma.)
– Je demande la parole, répéta Kandov.
– Kandov, vous pouvez parler, dit Ognianov.
– Je sais, de source absolument sûre, que Steftchov a trahi Ognianov et qu’il est le seul responsable de tant de malheurs, dit l’étudiant.
Ses yeux brillaient maintenant comme deux charbons ardents. Il fixa un regard interrogateur sur Ognianov.
– Non, ce n’est pas Steftchov, c’est Mountcho, répliquèrent en chœur les autres.
– Vous vous trompez, messieurs !
Et l’étudiant leur exposa, d’une voix émue, la découverte qu’il avait faite par hasard ; il appuya ses dires de preuves irréfutables.
La rage s’empara de toute l’assistance ; des cris de fureur, des jurons éclatèrent. Steftchov était démasqué.
Ognianov pencha son front sillonné de rides profondes.
– Benkovski avait bien raison de nous traiter de nouilles.
– Ce soir encore, il nous a espionnés !
– Dieu sait ce qui plane sur nos têtes !
– Nous agissons si ouvertement et nous nous sommes tellement laissés aller que je commence à avoir peur, dit Frangov.
– Ognianov qu’en penses-tu, toi ? demanda Sokolov.
Ognianov, absorbé depuis un instant, sursauta, puis il dit :
– Je pense que nous avons agi en imbéciles en n’empêchant pas Steftchov de trahir.
– Comment pouvions-nous le faire ? demanda le pope Dimtcho.
– En le supprimant.
– Le statut révolutionnaire ne prévoit que cette peine, remarqua Popov.
Un silence plana sur l’assistance.
– Messieurs, je vous demande de me laisser tuer moi-même Steftchov, un de ces prochains jours, s’écria l’étudiant.
Tous le regardèrent, étonnés.
– Kandov ! Tu es trop pressé ! Steftchov m’appartient ! Personne d’autre n’a le droit... cria le docteur, et ses yeux flambaient de haine sauvage.
– Ah non ! s’écria Kandov d’une voix désespérée. Je me suis proposé le premier et c’est moi qui ai le premier découvert son crime.
– Steftchov est ma victime ; je ne le cède à personne, gronda Sokolov.
Kandov protestait.
– Que l’on tire au sort ! proposèrent des voix.
Mais ni Kandov ni Sokolov ne voulaient accepter cette solution. Chacun avait peur de perdre, comme s’il s’agissait non pas du meurtre d’un être humain, mais de l’acquisition d’un trône.
Alors Ognianov dit, d’un ton sévère :
– Si la question se réduit au droit que possède chacun de nous de liquider ce traître, alors je l’emporte sur vous deux. Je suis sa victime, j’ai priorité sur vous, mais j’ai une objection à faire : ce meurtre peut nuire à notre cause, je trouve le moment inopportun. Je propose donc que le châtiment de Steftchov ait lieu le premier jour de la révolution. Steftchov doit être la première victime.
Cette proposition judicieuse fut adoptée.
Kandov était au désespoir ; mais une expression de triomphe et de satisfaction se peignit sur la figure de Sokolov ; pendant quelques instants il resta pensif, étranger aux conversations, les yeux perdus dans le vague, puis son regard s’illumina d’un éclat inusité, deux rides affreuses barrèrent son front, ses lèvres se tordirent dans un sourire démoniaque. Soudain, il bondit et s’élança au-dehors pour envoyer un message à Netcho Pavlov ; il ne voulait pas lâcher Cléopâtre cette nuit, il avait besoin d’elle pour Steftchov ! Car il avait imaginé une mort horrible pour le traître.
Lorsqu’il revint, au bout d’un instant, la conversation roulait sur Zamanov.
– Je l’ai rencontré avant-hier, il est arrivé de Plovdiv, disait Gantcho Popov. Il s’est approché de moi et soudain m’a demandé à brûle-pourpoint : « Comment marchent vos affaires ? » ceci en clignant de l’œil, pour que je devine à quelles affaires il faisait allusion. Et il m’a posé un tas de questions afin d’apprendre quelque chose. J’ai eu drôlement chaud. Je ne suis pas tranquille : ce bandit à dû flairer nos affaires.
– Qu’il aille au diable, ce fils de chien ! dit Mitcho, furieux. Nous sommes parents, mais il me dégoûte autant qu’une charogne !
– Que de mères il a fait pleurer, ce scélérat ! ajouta le pope Dimtcho. Celui qui le supprimera, même s’il est enfoncé jusqu’au cou dans le péché, paraîtra devant Dieu pur comme un ange !
Et le pope Dimtcho souleva dévotement une petite gourde d’eau-de-vie qu’il avait sortie de sa poche, puis la tendit à Strandjov.
À ce moment, on frappa très fortement à la porte. Tout le monde tressaillit. Le spectre d’une trahison se dressa devant eux.
Sokolov saisit son revolver et s’élança.
– Qui frappe ? demanda-t-il.
– Ouvrez ! C’est Zamanov qui est venu, murmura la femme de Mitcho.
Bien que ces paroles fussent prononcées d’une voix à peine perceptible, le nom sinistre atteignit les oreilles des membres du comité. Un frisson les parcourut.
Le docteur ferma la porte puis s’approcha de l’iconostase et déplia la lettre qu’on lui avait remise pour la lire à la lumière de la veilleuse.
Une minute après, il tourna son visage défait vers ses camarades. Ses joues étaient creusées par l’étonnement et la frayeur. Tous les cœurs se serrèrent.
– Une dénonciation ? interrogeaient tous les yeux.
– Qu’est-ce que c’est que cette lettre ? demanda Ognianov.
– Une de nos lettres, que nous avons envoyée avant-hier au comité de Panagurichté, on nous la rend. Regardez qui nous la rend.
Il tendit la lettre à Ognianov.
– Lis ici, ajouta-t-il, en désignant les quelques lignes écrites sous la signature.
Ognianov lut à haute voix :
« Monsieur le président,
« Vous avez tort de semer votre correspondance dans les rues, pour que M. Steftchov puisse la trouver. Aujourd’hui, chez le bey, j’ai pris cette lettre de ses propres mains. Nous avons traduit au bey le recto avec la « belladone », le verso, je l’ai lu tout seul, chez moi, penché sur un brasero. Ne vous en inquiétez pas. Un autre orage planait au-dessus de vos têtes ce soir, mais il s’est dissipé. Vous pouvez m’en remercier ! Réunissez-vous ailleurs et plus discrètement. Bon succès et victoire !
« Le traître et espion bulgare, C. Zamanov »
La stupéfaction devint générale.
– Comment cette lettre est-elle tombée entre les mains de Steftchov ? demanda Ognianov indigné, le premier moment de stupeur passé.
– Pentcho l’a prise pour la remettre à notre courrier, qui a dû l’égarer, expliqua le docteur.
En réalité, la lettre était tombée dans la rue ce jour-là même, quand la servante du tchorbadji Iordan avait secoué par la fenêtre le veston de Pentcho. Ce dernier ne s’était pas encore aperçu de sa disparition.
–Et que ce soit précisément Steftchov qui la trouve ! Qu’on me dise après cela qu’il n’y a pas de fatalité ! dit Kandov.
– Et pas de Providence ! ajouta Nedkovitch.
– La Providence en la personne d’un espion ! Qui aurait pu croire qu’il y eût tant d’honnêteté en Zamanov ! dît Frangov.
– Il semble bien qu’on lui doive plus que nous ne le croyons, remarqua Gantcho Popov ; il fait mention d’un orage ; est-ce que nous ne devions pas être surpris et arrêtés ici ? Vous avez bien entendu. Steftchov a été au kanak et un de ses hommes nous a espionnés pendant que nous nous réunissions !
– Mais il y aurait donc quelque noblesse en cet homme ! s’étonna Ognianov.
– Et beaucoup de patriotisme, comme vous le voyez. En nous sauvant, il s’expose au plus grand danger, par sa seule signature, dit Nedkovitch.
– Messieurs, s’écria d’un ton solennel Ognianov, c’est un signe du temps ! Si les espions officiels des Turcs deviennent des patriotes et nos alliés, cela signifie que nous travaillons à un moment sublime, que l’esprit populaire est prêt et que le peuple est mûr pour une lutte grandiose.
– Pour moi, Zamanov est un saint maintenant, dit baï Mitcho, très ému.
Et sur tous ces visages, un instant avant si tendus, apparut une expression de calme courage. Nous devons ajouter qu’en effet, jusqu’à ce moment, la malheureux Zamanov n’avait à son compte aucune trahison politique. Contrairement à la rumeur, il avait embrassé la carrière d’espion dans le seul dessein de soutirer de l’argent, tant aux Turcs qu’aux Bulgares. Pour agir sur ces derniers, il usait de menaces mais sans aller plus loin. L’amour-propre était complètement mort en lui, mais sa conscience restait vivante. De toute évidence, il n’était pas né pour être espion ; seules, des circonstances néfastes l’avalent poussé dans cette voie fangeuse. Ajoutons encore qu’avant de rendre la lettre du comité, il avait réussi à convaincre le bey d’ajourner l’attaque.
Il mourut exilé en Asie, au moment même de la signature de l’armistice à San Stéfano.
11 LE DIACRE VIKENTI
Ognianov prit congé de ses camarades et suivit la rue qui conduisait au bout de la ville. Puis il s’engagera dans le chemin du monastère. La nature était déjà profondément endormie. Les noyers et les buissons qui longeaient le chemin se confondaient en une masse sombre avec les autres objets et bruissaient, ensommeillés ; le grondement sourd des cascades lointaines se répandait dans le silence comme l’accompagnement sensible de quelque chant inouï des séraphins dans les cieux. L’immense silhouette sombre du Balkan, que les ténèbres de la nuit semblaient rapprocher, s’élevait, silencieuse, vers les étoiles.
Ognianov s’arrêta devant le grand portail du monastère et frappa. Peu après, un valet demanda qui il était et lui ouvrit : il s’était présenté comme l’oncle du diacre. Deux gros chiens s’élancèrent sur l’hôte tardif, mais ils le reconnurent et leurs queues frétillèrent. Il passa silencieusement par la seconde porte du couvent, qui conduisait à la cour intérieure, passa devant les deux peupliers et frappa à la porte de la cellule du diacre Vikenti.
Elle s’entrebâilla.
– Qui est là ? demanda le diacre, qui ne reconnaissait pas, au premier abord, Ognianov dans son accoutrement de paysan, puis, subitement, il se jeta à son cou.
– Boïtcho, Boïtcho, c’est toi !
Et le pauvre Vikenti pleurait de joie. Il le bombarda de questions. Ognianov lui fit un bref récit de ses aventures puis, en terminant :
– Je viens te trouver, non pas pour te conter mon histoire, mais pour autre chose.
Étonné, Vikenti le regarda :
– Qu’est-ce qui t’amène donc ici à cette heure de la nuit ?
– Sois tranquille, je ne cherche pas de refuge, comme il y a un an. Je te demande un autre service, non pour moi, mais pour la cause. C’est en fait un exploit héroïque que je te demanderai.
– Dis vite, fit Vikenti avec inquiétude.
– Que fait en ce moment le père Iéroteï ?
– Il est à la chapelle pour sa prière, comme d’habitude, répondit Vikenti avec étonnement.
Ognianov réfléchit :
– Y restera-t-il longtemps ?
Il y reste d’ordinaire jusqu’à trois heures et demie du matin. C’est une règle chez lui. Maintenant il est deux heures. Pourquoi ?
– Tu sais où il garde ses ducats, n’est-ce pas ?
– Oui. Mais pourquoi ?
– Assieds-toi, je te le dirai.
Le diacre s’assit, les yeux fixés sur le visage de son hôte.
– Demain nous devons absolument remettre deux cents lires pour les fusils : l’organisation en a un besoin urgent. – Si demain nous ne retirons pas ces fusils de K.., cela devient dangereux. Il faut nous procurer cet argent, et j’ai promis aux gars de le leur procurer.
– Alors ? demanda le diacre.
– Il faut le prendre au père Iéroteï.
– Comment ? le lui demander ?
– Je ne dis pas cela. Il ne le donnera pas.
– Alors quoi ?
– Je te l’ai dit : le prendre.
– Le voler, alors ? s’exclama le diacre.
– Oui. Il n’en a pas besoin, tandis que cet argent est absolument indispensable à la cause populaire. Nous devons le prendre, ou le voler, appelle ça comme tu le voudras.
– Mais comment, Ognianov, un vol ?
– Oui, mais un vol sacré.
Le diacre regardait Ognianov en frémissant. Cette proposition, en contradiction si brutale avec ses principes, le laissait interdit. Il en aurait été révolté si quelqu’un d’autre la lui avait faite. « Un vol sacré ! » C’est qu’il entendait une chose pareille pour la première fois de sa vie – et elle était dite par l’homme le plus honnête du monde ! Ognianov devenait pour lui une personnalité encore plus mystérieuse, qui le captivait et le subjuguait. À ce moment aussi il subissait son charme puissant.
– À quoi penses-tu, frère Vikenti ? demanda Ognianov d’un ton sévère.
– Tu me demandes quelque chose d’impossible. Je ne puis me décider à voler comme un criminel mon protecteur. C’est malhonnête, monsieur Ognianov.
– La libération de la Bulgarie est-elle une cause malhonnête ? demanda Ognianov, le foudroyant du regard.
– Non, c’est honnête.
– Alors, les moyens dont on se sert pour y arriver sont également honnêtes.
Le diacre comprenait qu’il avait affaire à un adversaire redoutable, mais il voulait lutter jusqu’au bout.
– Mais rends-toi bien compte, je dois voler mon bienfaiteur, qui m’aime comme son propre fils ; je dois voler un noble vieillard, de plus, un patriote ; mon âme en est révoltée. Mets-toi à ma place et tu comprendras à quel point ce vol est criminel.
– Il est sacré !
Le diacre regardait, interdit, cet homme qui lui parlait avec tant de calme d’une action aussi méprisable.
– Il vaut mieux lui en demander. Il en donnera petit être.
– Le père Iéroteï est un moine, il ne lâche pas si facilement l’argent !
– Essayons, on ne sait jamais. Il en donnera peut-être..., insistait Vikenti, suppliant.
– En ce cas il faudra tout lui dire, d’un bout à l’autre, et il est très ami avec Iordan Diamandiev. Quand il va en ville, il descend toujours chez lui. D’ailleurs je sais qu’il ne donnera rien, nous perdrons seulement un temps précieux. Allons, dépêche-toi, Vikenti !
– Mais c’est horrible ! ! Comment le regarderai-je demain dans les yeux ? Et lorsqu’il découvrira la disparition de l’argent, alors ses soupçons tomberont sur moi : il sait que je suis seul à connaître ses secrets.
– Tu n’attendras pas qu’il te soupçonne, ni qu’il te regarde dans les yeux, comme un condamné, répondit Ognianov.
Le diacre le regarda, les yeux écarquillés :
– Comment ? Est-ce que tu me conseilles de m’enfuir ensuite ?
– Au contraire, demain encore tu t’agenouilleras à ses pieds et tu te confesseras à lui... Si c’est vraiment un vieillard aux sentiments nobles et qui aime sa patrie, comme tu le dis, il te pardonnera. Et je crois qu’il lui sera plus facile de sacrifier ses lires lorsqu’il les aura perdues, que maintenant qu’elles sont encore dans son coffre.
Vikenti était plongé dans une profonde méditation. Entièrement pris par les paroles d’Ognianov, il sentait bien qu’il ne sortirait pas victorieux de cette lutte inégale.
– Alors, tu te décides, frère Vikenti ?
– C’est vraiment difficile, mon vieux, dit le diacre, pleurant presque.
– Une fois qu’on est décidé, c’est facile.
– Je n’ai jamais volé de ma vie.
– Moi non plus, je n’avais jamais tué, mais lorsqu’il le fallut, j’ai tué deux hommes, comme s’il s’agissait de deux mouches : n’oublie pas que j’avais deux fauves armés devant moi.
– Justement, pour toi c’était plus facile, tu avais deux fauves devant toi, tandis que moi j’ai un bienfaiteur, un vieillard sans défense, qui se confie à moi comme à lui-même.
– Mais tu ne lui feras pas le moindre mal ! Décide-toi pendant qu’il est encore temps. « Le temps vient, le temps s’enfuit, les siècles ont des ailes », a dit Rakovski 107 : tiens, prends exemple sur celui-là, il a volé le monastère de Cyprien, où il était invité, pour organiser la légion. Du courage, Vikenti ! Ognianov ne te fera jamais faire une bassesse.
– Attends, laisse-moi reprendre mes esprits, dit Vikenti, appuyant sa tête sur son bras.
Ognianov le regardait en silence. La lutte intérieure de Vikenti ne fut pas de longue durée. Il leva la téta et dit en soupirant :
– J’y vais !
– Par où entreras-tu ?
– Par la porte, bien entendu.
– Comment ? le père Iéroteï laisse sa porte ouverte ?
– Non, mais je peux l’ouvrir avec ma clef. Je l’ai appris par hasard : je lui ai ouvert un jour qu’il avait perdu la sienne.
– Et son coffre, comment l’ouvriras-tu ?
– La clef se trouve dans la poche de son gilet mauve, qui est accroché au mur... Si elle n’y est pas, j’enfoncerai le coffre... Il ne quitte jamais l’église avant trois heures et demie. Il me reste encore une heure... Oh ! ! Boïtcho, va au...
– Écoute, prends aussi ton coutelas.
– Pour quoi faire ?
– On ne sait jamais, tu en auras peut-être besoin.
– Comment, je ne vais tout de même pas tuer ? s’écria le diacre, indigné.
– L’arme donne du courage. Tu veux que je t’accompagne ?
– Je ne veux pas, bourreau, dit le diacre, presque haineusement.
Ognianov était à son tour étonné par la sombre détermination du jeune homme, si craintif et si sentimental tout à l’heure.
– Tu n’as plus peur du péché ? dit en riant Ognianov.
– S’il existe des vols sacrés, il y a aussi des péchés de justes, répliqua en plaisantant le diacre.
– C’est le catéchisme du nouvel enseignement chrétien, blagua Ognianov à son tour et c’est le meilleur.
– C’est en enfer que nous l’apprendrons.
Le diacre ouvrit la porte :
– Attends-moi ici, ne fais pas de bruit.
– Bonne chance !
Vikenti sortit sur la pointe des pieds.
La cour était silencieuse et sombre. Les vignes touffues de la treille rendaient l’obscurité encore plus épaisse et plus mystérieuse. Les terrasses qui l’entouraient étaient silencieuses. Les fenêtres ressemblaient à des yeux qui regardaient dans la nuit. En passant, le diacre jeta un coup d’œil par la porte de la chapelle et aperçut le père Iéroteï, qui lisait prés du lutrin. Il hâta le pas. Le clapotis monotone de la fontaine étouffait ses pas, d’ailleurs si légers qu’il put passer près des oies sans les réveiller. En arrivant à la porte de la cellule, il sentit ses jambes ployer comme s’il venait de marcher pendant des heures. Son cœur battait fort et lui faisait mal. Le diacre sentait ses forces l’abandonner en même temps que sa résolution. Cette action qu’il avait enfin acceptée tout à l’heure, d’un cœur presque léger, lui apparaissait maintenant difficile, effrayante et au-dessus de ses forces. Un autre être s’éveillait en lui qui l’apostrophait, le jugeait, le clouait au sol. Il toucha par hasard son poignard. Comment l’avait-il pris ? Il eut peur de lui-même. Comment pouvait-il se trouver maintenant ici, devant la porte du père Iéroteï ? Il était venu pour voler ! Voler son bienfaiteur ! Et tout ceci s’était passé si soudainement ! Est-ce qu’il ne rêvait pas ? Quelle force le poussait ? Demain le diacre Vikenti allait s’éveiller voleur, peut-être criminel ! Toute sa vie dépendait de cette nuit ténébreuse ! Mais il ne pouvait plus reculer.
Vikenti s’approcha résolument de la porte.
Les fenêtres de la cellule étaient obscures. Tout autour un silence de mort régnait. Il resta une ou deux minutes aux aguets puis introduisit la clef, la tourna doucement et poussa la porte. Elle s’ouvrit. Il entra. La veilleuse clignotait et répandait dans l’iconostase une clarté mourante. Vikenti trouva en tâtonnant le gilet, fouilla dans la poche, en sortit la clef et pénétra rapidement dans le réduit. Il y alluma un cierge et, s’approchant des deux coffres, le colla au couvercle de l’un d’eux. Vikenti s’accroupit devant l’autre mais ses genoux tremblaient, alors il s’assit à la turque. Il souleva le couvercle qui grinça. Des bourses, dont l’une était verte, étaient rangées tout au fond, à côté d’autres objets précieux : de longs chapelets d’ambre, des icônes russes en or, de l’argenterie, des croix ornées de perles, des estampes du mont Athos. Vikenti soupesa les bourses : il se rendit compte que deux d’entre elles contenaient de la grosse monnaie – roubles, pièces d’argent turques – dans une autre, il y avait de la petite monnaie. L’or brilla dans la bourse verte. Il compta juste deux cents lires, qui formèrent un tas brillant dans son giron. Vikenti n’était pas avide d’argent mais la vue de ce métal étincelant le fascinait. « Voilà ce qui incite aux crimes les plus atroces, pensait-il, et l’homme lutte toute sa vie pour l’obtenir. Voilà avec quoi on peut acheter le monde entier. » Mais on en avait également besoin pour le salut de la Bulgarie : le sang et les milliers de sacrifices humains ne suffisaient pas. Au fait, était-ce là tout l’or du vieillard, que la rumeur publique évaluait à des milliers de lires ? Vikenti était perplexe. Il se mit à ramasser à pleines mains les pièces d’or qu’il fourrait dans ses poches.
Tout à coup, quelque chose bougea dans la pièce. Il se retourna.
Derrière lui se tenait le père Iéroteï.
12 LA BOURSE VERTE
La stature majestueuse du vieillard atteignait le plafond. Sa longue barbe blanche recouvrait sa poitrine. Son large visage décharné, empreint de bonté, à peine éclairé par le cierge, paraissait aussi calme que son regard.
Il approcha doucement. Vikenti s’agenouilla.
– Mon fils, dois-je en croire mes yeux ? dit d’une voix douloureuse et tremblante le vieillard.
– Pardonnez-mol ! et Vikenti leva ses mains jointes dans un geste suppliant.
Le père Iéroteï le regarda pendant une longue minute. Le visage de Vikenti était si livide qu’il était devenu méconnaissable. Ses membres semblaient pétrifiés. Immobile, il ressemblait à une statue des catholiques.
Un silence de mort régnait dans le réduit, comme s’il n’y avait pas eu là deux êtres vivants.
– Diacre Vikenti ? Depuis quand le maudit Satan s’est-il introduit dans ton âme ? Depuis quand cet amour de l’or et du vol ? Oh, Dieu ! oh Jésus ! pardonnez-moi, moi qui ne suis qu’un pauvre pécheur !
Le vieillard fit le signe de la croix.
– Lève-toi, diacre Vikenti ! lui dit-il sévèrement.
Vikenti se redressa comme un automate. Sa tête restait penchée, telle une branche cassée.
– Dis-moi, pourquoi t’es-tu introduit ici en larron de nuit ?
– Pardonnez-moi, pardonnez-moi ! J’ai péché, mon père, murmura Vikenti d’une voix entrecoupée et sourde, qui ressemblait à un sanglot.
– Mon enfant, que Dieu te pardonne ! Tu as pris le chemin du péché, mon fils, tu t’achemines vers la perte éternelle, vers la perdition du corps et de l’esprit. Qui t’a poussé à ce péché mortel ?
– Mon père ! Pardonnez-moi, ce n’est pas pour moi-même que j’ai pris cet argent, marmonnait Vikenti, anéanti.
– Et pour qui t’es-tu laissé aller à cette tentation, Vikenti ?
– Pour la cause populaire, mon père.
Le vieillard le regarda, étonné :
– Quelle cause populaire ?
– Celle que nous préparons, l’insurrection bulgare. Il fallait de l’argent, et j’ai osé toucher à votre argent.
Le doux visage du vieillard s’éclaira. Son regard troublé par l’âge brilla puis se voila de larmes :
– Est-ce la vérité, mon fils ?
– La vérité même, mon père, je vous le jure sur le sang sacré du Christ et sur la Bulgarie. C’est pour la cause commune que je l’ai pris.
Un sentiment nouveau éclaira le visage du vieillard.
– Mais pourquoi ne me l’as-tu pas demandé, mon enfant ? Crois-tu donc que je n’aime pas la Bulgarie ? Notre Père éternel peut à tout moment rappeler à lui mon âme pécheresse... À qui laisserai-je alors ce que je possède ? Mes héritiers, c’est vous, les jeunes Bulgares. Nous, les vieux, nous ne comprenions, nous ne pouvions rien. Que Dieu vous aide à sauver les chrétiens de la race maudite des infidèles. Pourquoi me regardes-tu ainsi ? Ne me crois-tu pas ? Viens, viens donc.
Il prit Vikenti par le bras et l’amena devant l’armoire dont il sortit un gros cahier vert. Il l’ouvrit de ses vieux doigts tremblants et lui dit :
– Lis ici, mon fils ; je ne me cacherai plus. Pardonnez-moi, mon Dieu !
Vikenti lut, écrites de la main du moine, les notes suivantes :
« 1865 – le 5 février. Envoyé à Son Excellence, monsieur ***, à Odessa, 200 lires ottomanes pour les frais d’études de cinq jeunes Bulgares.
1867 – le 8 septembre. Envoyé à Son Excellence, monsieur ***, à Gabrovo, 100 lires ottomanes pour les frais d’études de cinq jeunes Bulgares.
1870 – le 1er août. Envoyé à son Excellence, monsieur ***, à Plovdiv, 120 lires ottomanes pour les frais d’études de cinq jeunes Bulgares. »
Le père Iéroteï mouilla son doigt et tourna la page :
– Lis ici !
Vikenti lut :
« Qu’on le sache : il y a dans la petite bourse verte 600 lires ottomanes. Je destine cet argent au diacre Vikenti, de Klissoura, entré dans les ordres au couvent de Saint-Spas, pour qu’il puisse poursuivre ses études théologiques à Kiev, dans l’intérêt de la Bulgarie. »
Tel était le testament du vieillard.
Vikenti avait l’impression de rêver. Il n’osait lever ses yeux et rencontrer le regard brûlant du père Iéroteï. Il s’empara de sa main droite qu’il baisa avec dévotion, pendant que des larmes de reconnaissance coulaient de ses yeux que la honte tenait baissés.
Le moine eut pitié du malheureux Vikenti. Il lui dit d’un ton encourageant :
– Console-toi, mon enfant, Dieu pardonne le pénitent. Ton intention était bonne et louable. Dieu tout-puissant voit tout. Dis-moi, maintenant, combien vous faut-il pour les armes ?
– Deux cents lires. Mon père, vous êtes un saint ! Votre nom doit rester éternel ! s’écria Vikenti, enthousiasmé et ému.
– Ne dis pas de sacrilèges, mon fils ! répondit gravement le vieillard. Prends autant d’argent qu’il t’en faut et employez-le, ainsi que vous le conseillera Dieu, pour le salut de la Bulgarie. Je vous bénis. Si vous en avez encore besoin, demandez-en. Et quant à ton argent...
– Mon père ! je vous remercie profondément de votre grandeur d’âme et de tous vos bienfaits, mais je n’ai plus le droit d’utiliser cet argent ; je ne veux pas quitter la Bulgarie, je lutterai et mourrai pour sa liberté. Vous avez été pour moi l’exemple du véritable patriotisme.
– Vikenti ! poursuivit le vieillard, c’est bien, mon fils, mets-toi au service de la Bulgarie si le temps en est venu. Mais l’argent qui t’est destiné, tu le retrouveras dans la bourse verte, ne t’en soucie pas. Seulement, je le placerai à un endroit plus sûr ; tous les voleurs ne sont pas des anges innocents comme toi. Et lorsque je ne serai plus, souviens-toi de moi...
Vikenti sortit de la cellule du père Iéroteï comme s’il était ivre ; il traversa en courant la cour et pénétra comme le vent dans sa propre cellule, épuisé par l’émotion.
Ognianov le regarda, ébahi.
– Qu’y a-t-il donc ? tu en as mis un temps... Pourquoi es-tu si pâle ? questionna-t-il rapidement. Mais pourquoi ne dis-tu rien, Vikenti ? Est-ce que tu as l’argent ?
Vikenti retourna ses poches :
– Le voici ! fit-il.
Les pièces d’or résonnèrent sur le carrelage.
– Combien en as-tu pris ?
– Il a tout donné.
– Qui a tout donné ? Le père Iéroteï ? Alors tu as mendié ? Tu es allé le trouver ?
– Non, il m’a surpris pendant que je volais.
– Quoi ?
– Oh, Ognianov ! qu’avons-nous fait, mon frère ? Que nous connaissions mal le père Iéroteï ! Toi, passe encore, mais moi, moi qui vis depuis trois ans ici de ses bienfaits ! Je ne pourrai jamais me pardonner cela. Cette nuit, c’est la foudre qui est tombée à mes pieds, elle m’a ouvert les yeux et elle m’a tué. Je donnerais volontiers vingt ans de ma vie pour ne pas avoir vécu cette heure. Moi, jeune, soi-disant patriote, Bulgare ardent, j’ai été écrasé par la grandeur et par le patriotisme modestes de cette ombre qui glisse dans la tombe, inconnue de tous ! Tu t’imagines, Boïtcho, il m’a trouvé devant le coffre, le giron plein d’or !
Et le diacre raconta ce qui venait de se passer.
– Comment ? Mais, cette fois-ci, il est sorti plus tôt ?
– Non ! Toujours à la même heure ! Mais j’ai perdu du temps à hésiter dans la cour, sans m’en apercevoir. Tu t’imagines ma situation ?
Ognianov restait figé, les bras croisés, absolument ahuri...
– Mais cet homme était un saint !
– Je te l’avais bien dit : « Demandons-lui ! »
– Je n’avais pas une bonne opinion du patriotisme des moines.
– Mais abandonne donc enfin cette maudite opinion ! Tu t’es mis dans la tête, tout comme Karavelov, que le moine est une bête antédiluvienne, qui ne fait que s’engraisser et dormir, enveloppée d’une épaisse couche de graisse, et qui passe sa vie à bavarder avec les chats du couvent ! Tu souris et tu oublies les patriotes issus de nos rangs, depuis Paissi 108 qui, le premier, il y a un siècle, a écrit l’histoire de la Bulgarie, jusqu’au diacre Levski, qui est mort pour elle. Les moines n’ont jamais été étrangers au mouvement bulgare et, avant-hier, l’un d’eux a fait prêter serment au comité, ici même. Et l’exemple de ce soir, ne te convainc-t-il pas ?
Les coqs chantèrent dans la nuit.
– Bonne nuit ! dit Ognianov et il s’étendit sur le petit divan.
– Bonne nuit, si elle peut être bonne pour les voleurs ! répondit le diacre qui souffla la bougie.
Mais longtemps encore se tint devant leurs yeux, comme une apparition, la figure majestueuse du père Iéroteï.
Le père Iéroteï appartenait à cette race de moines, si sympathiques, auxquels la Bulgarie doit une si grande part de sa renaissance. C’était d’ailleurs un ami intime de Néophite Bosvéli 109. Si les circonstances ne lui avaient pas permis de servir moralement l’éveil spirituel de la Bulgarie, il put du moins y contribuer en envoyant une dizaine de jeunes gens poursuivre leurs études en différentes écoles. Simple moine, éloigné des intérêts temporels, son cœur souffrait pour la Bulgarie et, comme il n’avait pas de parents, la patrie lui tenait lieu de tout ; il lui avait voué toute son affection, tout l’amour de son cœur. Il s’estimait heureux de pouvoir aider tant soit peu son peuple ; les bienfaits qu’il dispensait étaient pour lui un sacrement dont le seul témoin était Dieu. Cette âme simple et profondément religieuse se gardait de s’enorgueillir des bienfaits qu’elle prodiguait, il craignait ces flatteries du monde extérieur auxquelles aspire avidement le pharisien frivole ; il faisait le bien comme l’avait conseillé le Sauveur : « Que l’une des mains ignore ce que fait l’autre » ; il avait déposé chez divers particuliers des sommes destinées à l’entretien d’étudiants, à la condition expresse que le nom du bienfaiteur ne fût pas dévoilé. Il était satisfait de la façon dont il achevait sa longue vie et, l’esprit en paix, il attendait la mort.
Quelque temps après cette dernière preuve de sa grandeur d’âme, il s’éteignit doucement.
Lorsque son coffre fut ouvert, on n’y trouva qu’un sac de monnaie, pour les pauvres et pour son enterrement.
Vikenti n’assista pas aux obsèques. Le lendemain même de la scène que nous venons de relater, la honte lui avait fait fuir le monastère, il était allé s’installer à Klissoura.
13 UNE JOYEUSE RENCONTRE
La veille, en sortant de chez baï Mitcho, Koltcho s’était dirigé, courant à la grande stupéfaction des passants, vers la maison de Rada. Il voulait être le premier à lui annoncer la bonne nouvelle.
Mais, cette fois, il décida d’être plus modéré. Ses bonds de panthère, qui avaient ébahi les hommes, pouvaient rendre folle une jeune fille aussi éprouvée que Rada. Mais le contrôle de soi était au-dessus de ses forces ; il sentait que cette joie débordante pouvait l’étouffer s’il essayait de la freiner, ne fût-ce que pour un instant. En approchant de la porte de Rada, il sentait son cœur battre à se rompre ; afin d’assourdir ses battements, il se força à entonner son joyeux cantique.
La porte s’ouvrit instantanément.
– Sois le bienvenu, Koltcho, dit gentiment Rada.
– Rada, y a-t-il des oreilles étrangères, par ici ? demanda Koltcho.
L’aveugle était tout essoufflé.
– Assieds-toi, repose-toi, Koltcho, invita Rada, qui prenait son émotion pour de la fatigue.
Mais il se tint debout, ses deux yeux éteints la fixant attentivement.
– Rada, que me donnes-tu pour la bonne nouvelle que je t’apporte ? dit-il soudain. (C’était toute la concession qu’il put faire à sa conscience.)
Le cœur de Rada battît violemment. Elle sentit que l’aveugle allait lui annoncer une chose si belle qu’elle en était presque effrayante. Sans doute était-ce un ange qui amenait Koltcho.
– Qu’est-ce, Koltcho ?
– Tu dois te réjouir, ma petite Rada, mais te réjouir terriblement, tu m’entends... C’est pour cela que tu t’appelles Rada 110, n’est-ce pas ?
Et Koltcho se mit à danser comme un enfant et à chanter pour ne pas trahir trop vite son secret.
Madame Séraphima
Et la douce Chérubine,
La belle Enokha,
L’ornement du couvent...
Rada était muette d’émotion. Elle devina et ne put que murmurer :
– Koltcho, ne me fais pas peur !
– Je ne veux pas t’effrayer, je te dis de te réjouir... Il est vivant !
Koitcho ne put tenir la résolution qu’il avait prise dans la rue : donner avec ménagements à Rada la bonne nouvelle. Peut-être aurait-ce été possible à un homme normal, chez qui des milliers de sensations extérieures peuvent émousser l’intensité des sensations intérieures, mais, dans son océan de ténèbres, l’aveugle, éclairé brusquement par un seul rayon, par une seule joie, s’il ne s’exprimait pas très vite en paroles, devait le faire par des bonds et des cris. Son âme devait s’épancher sans retard.
À ces mots de Koltcho, dont son cœur avait à l’avance deviné le sens, Rada s’appuya au mur pour ne pas tomber.
Il est de grandes joies et de grandes douleurs que la faible nature humaine semble incapable de subir. Pourtant elle supporte tout. Plus la tension est forte et plus l’âme sait se dilater. Peut-être l’instinct secret du cœur de Rada l’avait-il préparée. Elle s’écria, folle de joie :
– Vivant ? Mon Dieu ! Mais où est-il ? Qui te l’a dit, Koltcho ? Vivant ? Boïtcho vivant ! Oh, mon Dieu ! je mourrai de joie ! Que faire maintenant ?
Les larmes vinrent à son secours, elle y épancha le flot tumultueux des sentiments qui l’étouffaient.
Koltcho, plus calme, lui contait en détail sa rencontre inattendue avec Boïtcho, devant la porte de Mitcho Beïzédéto, et ce qui avait suivi.
– Et quand viendra-t-il me voir ?
– Ce soir, à la tombée de la nuit ; d’ailleurs ils ont beaucoup à faire maintenant.
– Oh, mon Dieu ! mon Dieu ! disait Rada, serrant sen mains et riant à travers ses larmes.
Elle était ainsi merveilleusement belle.
– Koltcho, je te remercie, Koltcho, je te remercie répétait-elle, transportée de joie.
Koltcho partit, le cœur léger. Cet être doux et dévoué se satisfaisait de la joie d’autrui ; la nature, qui l’avait privé de tout, lui avait laissé cette consolation...
Rada ne savait plus que faire. Comment tuer le temps jusqu’à l’arrivée de l’hôte bien-aimé ? comment cacher sa visite discrète ? devait-elle parler aux amis qui l’avaient hébergée, ou non ? Chez eux, elle ne pourrait limiter sa joie ; rester ici ? elle en mourrait ! Pour tuer les siècles qui la séparaient de l’arrivée de Boïtcho, elle se mit à faire le ménage, à ranger la chambre, elle se peigna, s’arrangea devant la glace, lui sourit et lui tira la langue, en se voyant belle. Puis elle ne sut plus que faire, pirouetta sur un pied comme un enfant de cinq ans et se mit à fredonner une chanson dont elle ne saisissait plus le sens et qu’elle n’entendait même pas. Son esprit ne pouvait quitter la porte et le moindre bruit la faisait tressaillir comme un oiseau. Elle était si heureuse !
Ce ne fut que le lendemain, à la tombée de la nuit, qu’Ognianov put quitter le monastère pour se rendre chez Rada. Elle habitait chez la mère Lilovitsa, dans une petite chambre indépendante, tout au fond d’une cour ombragée par le feuillage des arbres fruitiers. Au-dehors, sous la fenêtre de la chambre et adossée au mur, il y avait une banquette couverte de coussins, où Rada s’asseyait pour travailler et lire à l’ombre.
Ces deux jours d’attente lui semblèrent interminables, les longues heures remplies du frémissement de l’attente, d’émotions cuisantes et d’angoisse, furent longues comme des siècles. L’impatience la fit aller au jardin.
La nuit avançait ; au ciel les étoiles scintillaient comme des diamants vivants ; dans l’air pur et apaisé flottait le doux parfum des fleurs endormies des jardins voisins, dominé par les effluves d’un acacia en fleurs ; les feuilles ensommeillées des arbres chuchotaient en frissonnant sous les caresses du zéphyr nocturne ; le silence de cette nuit sans lune était enchanteur et mystérieux. Sur une solive, au-dessus de la banquette, les deux hirondelles, réveillées par le bruit que faisait Rada, la regardèrent de leurs yeux endormis, puis se blottirent de nouveau dans leur nid l’une contre l’autre. Un fluide amoureux, une joie céleste et insaisissable vibraient partout ; ce ciel azuré, ces étoiles de diamant, l’air, les arbres, les hirondelles dans leur lit de plumes, et les fleurs, et les parfums, tout remplissait son âme d’un calme bienfaisant, tout lui parlait de paix, d’amour, de poésie et de baisers sans fin dans le doux silence de la nuit.
Rada était toute langueur.
Lorsque, enfin, Ognianov frappa à la porte, elle sentit ses jambes se dérober sous elle, mais elle vola pour lui ouvrir.
Les deux amoureux unirent leurs lèvres dans un long et ardent baiser.
Après les premiers épanchements passionnés, les deux amoureux se regardèrent, un peu calmés. Ils ne pouvaient détacher les yeux l’un de l’autre. Rada était ravissante, ainsi illuminée par son amour. Boïtcho lui semblait encore plus beau dans son habit de paysan, qui faisait mieux ressortir les traits intelligents et expressifs de son visage viril.
– Qu’as-tu fait tout ce temps, mon amour ? disait-il. Mais tu es devenue une vraie martyre, mon pauvre petit ! Je t’ai tuée, je t’ai offerte en holocauste, Rada, et tu n’as pas un mot de reproche, tu es toujours cet être aimant, ce cœur tendre né pour pleurer, pour languir et pour aimer. Pardonne-moi, pardonne-moi, mon amour !
Ognianov serrait ses mains entre les siennes et se perdait dans la profondeur de ses grands yeux brillants.
– Te pardonner ? Non, je ne te pardonnerai pas ! lui disait-elle, fâchée mais câline. Que crois-tu donc ? Tu meurs et tu veux que je n’en souffre pas ? Et ne pas m’avoir fait au moins un tout petit signe ! Oh ! Boïtcho, Bunche, ne meurs plus, pour l’amour de Dieu ! Je ne te laisserai plus mourir. Je veux être toujours avec toi, te garder comme la prunelle de mes yeux, t’aimer beaucoup, beaucoup, jouir de ta présence. Tu as terriblement souffert, n’est-ce pas, Boïtcho ? Oh ! mon Dieu, que je suis bête ! Je ne te demande même pas comment tu as vécu, ce que tu as souffert pendant tous ces longs mois, qui m’ont semblé des siècles !
– J’ai souffert. J’ai affronté beaucoup de dangers, Rada, mais Dieu a été bon pour nous, il nous a réunis.
– Non, non, raconte-moi tout, absolument tout, et en détail. On en a répandu des histoires sur toi, des bruits plus terribles les uns que les autres ! Mon Dieu, pourquoi les gens n’ont-ils pas de pitié, pourquoi inventent-ils toutes ces choses ? Boïtcho, raconte-moi ! Tu es bien vivant là, tout près de moi, et je peux écouter avec courage tout ce que tu as enduré, si terrible et si effrayent que ce soit.
Elle le regardait avec des yeux suppliants, pleins d’amour et de compassion. Boïtcho ne put résister à sa prière. Elle avait raison. D’ailleurs, il était avide d’épancher son cœur devant un être aimé qui le comprenait : le souvenir des souffrances passées et des malheurs vécus possède un charme particulier quand il est évoqué dans un moment de bonheur. Boïtcho narra simplement, mais non pas sèchement et en courant comme il l’avait fait hier devant le comité et ensuite devant Vikenti, ses aventures, depuis le moment où il avait quitté Biala-Tcherkva. Pendant qu’elle l’écoutait, les émotions qui s’emparaient de l’âme de Rada se reflétaient dans ses yeux limpides et enfantins ; Boïtcho y lisait tantôt la frayeur, tantôt la pitié et l’intérêt, tantôt le triomphe et la joie ; elle buvait chaque parole, elle pressentait et vivait chaque évènement. Son regard, qui ne quittait pas Ognianov, le brûlait et l’enivrait.
– Oh ! Boïtcho, quelqu’un a dû te trahir ! s’écria-t-elle, anxieuse, quand il en vint à raconter comment les Turcs l’avaient poursuivi à l’auberge d’Altanovo.
– Je l’ignore, je n’ose pas accuser un Bulgare. Je me suis peut-être trahi tout seul, au café turc, par quelque geste imprudent.
– Et alors ?
– De ma chambre, j’ai entendu les pas des Turcs et j’ai compris qu’ils venaient pour moi. J’ai vu rouge. Il n’y avait plus d’espoir pour moi, j’étais perdu. Je sortis mon revolver et me tins derrière la porte. J’avais six balles, j’allais leur en offrir cinq et garder la sixième pour moi.
– Mon Dieu, mon Dieu, quels moments ! Et moi, qui ne savais rien, je riais peut-être ici !
– Non, tu devais sans doute prier, Rada, car Dieu a eu pitié de moi et m’a sauvé du péril.
– Il a fait un miracle, Boïtcho !
– Oui, si tu veux, un miracle. Il a ébloui les Turcs. Au lieu d’entrer dans ma chambre, ils sont entrés dans une autre, qui donnait vers la cour. Comme je l’ai appris plus tard, peu avant moi, un Grec était arrivé à l’auberge, un commis-voyageur de Plovdiv, qui se trouvait être mon voisin. Il devait me ressembler, ce qui a égaré le zaptié qui m’avait vu le jour précédent...
Rada poussait un soupir de soulagement.
– J’entendis le bruit, je compris le malentendu ; l’instant d’après les Turcs seraient dans ma chambre... Une minute me séparait d’eux, de ma mort... Je ne sais plus comment j’ai pu arracher un barreau de la fenêtre et me jeter dans la rue, où plutôt dans la rivière gelée. La glace s’étant rompue, je me suis enfoncé jusqu’aux genoux dans l’eau froide. Pendant que je m’efforçais de gagner le bord, j’entendis une détonation : cinq ou six coups de feu étaient partis de la fenêtre, au-dessus de ma tête. Je ne fus pas touché... Alors je me suis mis à courir. Une course folle. Combien de temps ai-je couru dans la nuit ? par où ai-je passé ? je n’en sais rien.
– On t’a poursuivi ?
– Oui. Pendant quelque temps, je les ai sentis à mes trousses, puis plus rien... J’avais pénétré dans la forêt. Il faisait déjà complètement nuit. La bise sifflait. Mon pantalon était gelé. J’ai marché pendant deux heures vers l’ouest, en suivant sans cesse le pied de la montagne et c’est à moitié mort que je suis arrivé au village d’Ovtchéri. De bonnes gens m’y ont accueilli, réchauffé ; seul un de mes orteils a gelé, mais ce n’est rien. Je suis resté là deux semaines, mais, de peur de leur attirer un malheur – le malheur me poursuivait – je suis allé à Pirdop où le frère de Mouratliiski est instituteur. Chez ce dernier, je suis resté trois mois malade, c’était, paraît-il, une grave maladie.
– Pauvre Boïtcho, tu as pris froid en errant tout l’hiver sur les routes et dans les montagnes. Tu es un vrai martyr, dit Rada, compatissante.
– Il a un cœur d’or, ce jeune homme, le frère de Mouratliiski. Il m’a soigné comme une mère.
– Le noble Bulgare ! dit Rada, émue.
– Et quel grand patriote ! Il m’a payé au centuple un petit service que j’avais rendu à son frère.
– Après ?
– Une fois rétabli, il m’a procuré de l’argent, les vêtements que je porte et il m’a fait ses adieux, les larmes aux yeux, et je me suis mis en route pour Biala-Tcherkva.
– Et personne ne t’a reconnu ?... Boïtcho, tu dois être prudent ici !
Ognianov avait enlevé son bonnet et son bandeau. Debout devant la glace, il rabattit son chapeau, composa son visage et se retourna ; il était tout à fait changé.
– Tu me reconnais, maintenant ?
– Tu peux te mettre un masque, si tu veux, je te reconnaîtrai toujours. Tu as beau me regarder comme ça... Que tu es drôle, Boïtcho ! disait-elle, toute joyeuse.
– Tu me reconnais parce que tu m’aimes, mais les étrangers, comment peuvent-ils deviner ?
– Celui qui hait a aussi une vue perçante, ne plaisante pas.
– Pour lui, j’ai préparé ça, dit Ognianov, soulevant les pans de son gilet sous lequel apparurent les crosses de deux revolvers et le manche d’un poignard.
– Brigand, dit en riant Rada, Mme hadji Rovoama avait bien raison...
– Si je suis un brigand, toi tu es tout le contraire, tu es un chérubin.
– Ne te moque pas d’une pauvre fille !
Il se rassit.
– Allons, continue ! Raconte-moi comment tu es arrivé. Et qui sont au juste ces Mouratliiski ? questionnait Rada.
– C’est le frère de Barzobégounek.
– De l’Allemand ? Le photographe ?
– Oui, Rada. C’est un faux nom. Il s’appelle Dobri Mouratliiski. Il n’est pas plus Allemand que photographe. Il s’est enfui après l’insurrection de Stara-Zagora. Je l’ai recueilli ici et je l’ai caché sous ce nom. C’est un vieux camarade et un ami dévoué. Tu peux recourir à lui en cas de besoin.
Rada le regarda, inquiète :
– Pourquoi m’adresser à des étrangers ? Je n’en ai pas besoin. Tu sais bien que je vis de ce que j’ai économisé sur mon traitement d’institutrice.
– Je t’ai dit de ne pas le considérer comme un étranger.
– Mais toi, tu es là !
– Je pars, Rada !
– Tu pars de nouveau ? Quand pars-tu ? Tu m’abandonnes ?
– Cette nuit même. Dans deux heures, dit Ognianov, après avoir regardé sa montre qu’il remit dans la poche de son veston.
Rada pâlit :
– Pourquoi partir si vite ? Je ne t’ai pas encore vu !
– À l’aube je dois être à K... Je suis chargé d’une mission et de toute façon je ne puis plus rester à Biala-Tcherkva. Quel dommage de ne pouvoir même pas remercier Marko de sa générosité pour toi... et pour moi donc ! Il y a des cœurs vraiment nobles parmi nous, Rada, et cela me fait aimer encore davantage la Bulgarie. Et je l’aime aussi très fort parce qu’elle donne le jour à des êtres adorables comme toi.
– Boïtcho, pourquoi t’en vas-tu ? Oh ! mon Dieu... Non, Il faut que tu m’emmènes. Tu dois partir, tu t’es sacrifié pour la Bulgarie, mais tire-moi de cette ville affreuse, mets-moi dans un village où je puisse te voir plus souvent... ou, non, si tu veux, fais-moi travailler pour le peuple, je suis aussi une Bulgare. Ton idéal est le mien ; Boïtcho, si tu meurs pour la Bulgarie, je veux mourir avec toi, mais ne nous séparons plus, j’ai peur de rester de nouveau seule, de trembler sans cesse pour toi, d’entendre les nouvelles les plus horribles. Mon Dieu, que je suis bien maintenant ! – Et elle posa ses mains sur les épaules du jeune homme.
– Rada, je le vois bien, ta situation ici est difficile, dit Ognianov. Je devine ce que tu ne me dis pas : mes ennemis ne te laissent pas tranquille, n’est-ce pas ? La méchanceté humaine ne pardonne rien, je le sais. Tu es la victime des préjugés et de la lâcheté des hommes, ma pauvre petite ! Hadji Rovoama n’est pas seule et tu supportes tout en silence, comme une véritable héroïne. Mon pauvre ange ! La grande cause qui a absorbé tout mon être ne me laisse pas un moment de répit pour penser à ton sort. Je suis un méchant, un égoïste, tout est de ma faute, pardonne-moi, ma chérie !
– Oh ! Boïtcho, si tu me quittes encore, il me semble que je te perdrai pour toujours, que je ne te reverrai plus jamais, murmura Rada, et ses yeux s’emplirent de larmes. Puis, elle ajouta doucement, d’une voix suppliante : Ne me laisse pas ici, Boïtcho, que tu vives ou que tu meures, je veux être près de toi. Je ne serai pas une entrave, mais une aide pour toi. Je ferai tout ce que tu me diras, pourvu seulement que je te voie plus souvent.
– Non, tu ne peux rien... la révolution exige des forces viriles, il faut être cruel, implacable, et toi, tu es un ange. Déjà tu as accompli ton devoir : le drapeau au lion brodé de ta main nous donnera du courage et nous inspirera. C’est suffisant pour une femme.
Puis après avoir réfléchi un instant, il ajouta :
– Écoute, Rada, viendras-tu à Klissoura, chez Mme Mouratliiska ? Elle habite là, maintenant. J’arrangerai ça. Là-bas, aussi, il y a du danger, mais au moins tu seras débarrassée des intrigues de cette ville.
– Partout où je pourrai te voir...
– Je suis maintenant propagandiste dans cette région et j’y suis plus à l’abri. Je ne reviendrai à Biala-Tcherkva que pour y déclencher l’insurrection. D’ici là nous nous verrons de temps en temps, Rada, et, après, Dieu sait qui sortira vivant de la lutte. Elle sera sanglante, grandiose. Si Dieu bénit nos armes, si notre Patrie, notre Patrie martyre, ressuscite ensanglantée mais libre, c’est avec joie que je mourrai pour elle ! Je ne regretterai qu’une chose : c’est que cette mort me sépare de toi. Car je t’aime infiniment, mon enfant chérie ; car mon cœur t’appartient ; il est à toi, mais ma vie appartient à la Bulgarie ; en mourant, du moins, je saurai qu’il y aura sur terre une âme qui souffrira pour moi et qui versera des larmes sur ma tombe.
Un nuage sombre obscurcit le visage de Boïtcho. Rada lui prit les mains avec émotion.
– Boïtcho, tu vivras ! Dieu te gardera pour la Bulgarie et tu seras couvert de gloire, Boïtcho, et moi, je serai si heureuse !
Ognianov secoua la tête d’un air incrédule.
– Mon ange chéri... commença-t-il, mais il s’interrompit brusquement. Puis lui prenant les mains il ajouta : Rada, quoi qu’il arrive, je veux avoir la conscience tranquille. Je mourrai peut-être, j’en ai presque le pressentiment...
– Oh ! tais-toi, Boïtcho !
– Écoute, il se peut que je meure, Rada, car je m’en vais au-devant de la mort. Mais je voudrais être tranquille pour toi. Tu as lié ton destin au mien, à moi, le condamné, le hors-la-loi ; ton amour m’a rendu le plus heureux des hommes, tu m’as sacrifié quelque chose de plus précieux que la vie, ton amour, et tu en as cruellement souffert ; tu as tout abandonné pour moi ! Je voudrais, si je meurs, que tu restes, sinon heureuse, au moins honnête devant Dieu et les hommes... Je veux que tu portes mon nom, mon nom d’Ognianov, il n’est en rien déshonoré, ce nom, Rada. Quand tu viendras à Klissoura, je demanderai au prêtre de nous bénir. Je penserai aussi à assurer ton avenir. Mon père est aisé et il accomplira les dernières volontés de son fils unique. Je l’aurais fait ici même, mais c’est impossible en ce moment. Nous pourrions faire autre chose : je n’ai pas de bague, Rada, ni en or, ni en fer. Le fer que je porte est destiné à l’ennemi. Mais nous n’en avons pas besoin. Dieu est avec nous. Dieu, le grand, le juste, le Dieu de la Bulgarie, des opprimés, des cœurs meurtris, le Dieu de l’humanité douloureuse. Il nous voit, il nous entend.
Et, lui prenant le bras, il s’agenouilla :
– Prêtons serment devant lui. Il bénira notre honnête union.
Elle s’agenouilla aussi. Et leurs lèvres murmurèrent des paroles que Dieu seul entendit.
14 AUTOUR D’UN TRONC D’ARBRE
Le lendemain matin, le soleil s’était de nouveau levé majestueusement ; le ciel d’azur brillait d’un éclat joyeux ; les jardins embaumaient et les jeunes rosiers montraient leurs boutons pourpres ; les arbres fruitiers, feuillus, triomphalement parés de fleurs couleur de neige, donnaient à toutes les cours de Biala-Tcherkva un aspect de fête ; les rossignols chantaient, les hirondelles traversaient comme des flèches l’espace, le remplissant de leur gazouillement et s’enivrant d’air, de soleil et de liberté. La nature débordait de vie et de jeunesse. Le ciel et la terre se confondaient dans les rayons, la lumière, les couleurs, les chansons, les parfums, l’amour et la joie.
Marko Ivanov s’arrêta au fond d’une impasse, au bout de la ville, et frappa à une porte.
Elle fut aussitôt ouverte par un vigoureux jeune homme, nu-tête, en bras de chemise et en culotte turque.
– Est-ce ici qu’on a apporté le tronc ? demanda Marko à voix basse.
– C’est ici, baï Marko, entrez ! Et le jeune homme le précéda : – Ils sont là, entrez seulement !
Au même instant la porte s’ouvrit et la première chose que vit Marko fut un tronc, le tronc d’un cerisier.
Kaltcho, le tonnelier, notre vieille connaissance, perché sur un amas de bois, tournait un vilebrequin géant dans l’extrémité supérieure de ce tronc de cerisier, bien calé en bas. La sueur ruisselait sur le visage fatigué du tonnelier.
– À la bonne heure, Kaltcho ! dit en souriant Marko, examinant avec curiosité le travail, mais ça avance, ma parole !
– Chaque chose craint son maître, dit une voix.
Marko regarda autour de lui. À côté du mur était accroupi Mitcho Beïzédéto.
– Oh ! monsieur Michto ! dit aimablement baï Marko, en tendant la main au vice-président du comité.
– Nous avons une réunion aujourd’hui et, en passant, je me suis arrêté pour voir ce que fabrique notre Bouktchéto.
– Mais où se tient votre réunion, dans les champs ? demanda Marko, s’asseyant, sans quitter des yeux le tronc du cerisier.
– Aujourd’hui, on se réunira dans la Fosse verte.
C’est ainsi qu’on appelait une dénivellation du versant nu du coteau, au nord de la ville, qui formait la première marche vers le Balkan. Depuis le fameux soir où Zamanov avait apporté la lettre, le comité se réunissait à des endroits toujours différents. Il avait été décidé que la réunion se tiendrait, ce jour-là, à la Fosse verte.
Kaltcho, rouge et essoufflé, continuait à faire tourner, de ses bras musclés, le gigantesque vilebrequin. Il retirait de temps en temps son instrument pour enlever les copeaux, jetait un coup d’œil dans le trou et reprenait son travail. Il avait déjà creusé jusqu’au point voulu, c’est-à-dire à une coudée environ du gros bout du tronc qui formerait la culasse du canon. Kaltcho nettoya le trou, regarda au-dedans, souffla une dernière fois puis se tourna, d’un air satisfait vers ses visiteurs. Ils se levèrent à leur tour et regardèrent aussi dans la bouche de l’arme future.
– Le poids d’une grande balance pourra y entrer, remarqua baï Mitcho, mais nous le chargerons de mitraille. Il abattra ainsi plus de Turcs. Ton cerisier fera des miracles.
Le visage de Marko brilla, triomphant. En effet le cerisier venait du jardin de Marko Ivanov. Depuis quelque temps un revirement complet s’était produit dans ses opinions et ses convictions : l’effervescence révolutionnaire, gagnant Biala-Tcherkva, ne le laissa pas longtemps indifférent. Elle l’intéressa, l’étonna, le réveilla. Il s’était dit, dans son for intérieur : « Si c’est partout ainsi, comme on le dit, la Turquie entière ne flambera-t-elle pas bientôt ? Ne sera-ce pas la fin de cet empire, si les enfants mêmes prennent les armes ? Qui sait ? » Ces réflexions eurent raison de ses craintes et renforcèrent sa confiance dans l’avenir. Bien qu’il fût un homme positif, de bon sens et sans la moindre imagination, il se laissa entraîner par le courant général et commença à croire ; ainsi l’épidémie toucha également cette âme bulgare sobre et honnête.
Mais ce processus ne s’accomplit pas d’un seul coup. Les convictions solides se forment sous l’influence de toute une série de faits importants. Tout d’abord, à l’automne dernier, ayant appris que les atrocités et les crimes de la population turque augmentaient chaque jour, il s’était dit à lui-même : « Ce n’est pas une vie, ça ! » C’était la première colère, le premier pas.
Puis, ce printemps, après le passage de Kablechkov, observant l’enthousiasme des jeunes qui se préparaient résolument à une entreprise aussi noble que folle, il dit un jour à sa femme :
– Qui sait ? Ce sont peut-être les fous qui feront quelque chose.
Et enfin, à Pâques, quand un jour, au café, la conversation roula sur les obstacles que rencontrerait un tel mouvement et sur les conséquences terribles qu’il pourrait avoir, Marko dit d’un ton sec à Alafranga :
– Mikhalaki, « celui qui lésine sur la dépense ne fait pas de noces ».
Le pope Stavri renchérit par un autre proverbe :
– « Pour manger du poisson, il faut se mouiller le cul. »
Mais notons bien qu’en fait Marko était partisan des préparatifs et non de l’insurrection elle-même. Il n’était pas enthousiaste au point de croire en celle-ci comme Mitcho, par exemple, et sa foi dans le succès de la lutte n’était pas assez aveugle pour qu’il risquât le tout pour le tout, comme Ognianov. Biala-Tcherkva, pensait-il, devait être prête à repousser l’attaque des bachi-bouzouks qui devaient déferler sur elle de tous les villages turcs de la vallée de la Stréma. La ville en était entourée de boutes parts et, depuis longtemps, elle faisait envie aux Turcs.
Si ça éclatait partout, alors ce serait différent. Mais qui pouvait le convaincre qu’il en serait ainsi ? En tous cas, Biala-Tcherkva devait se tenir prête ! Et il insistait pour que l’armement suive son cours...
– Après ça dépendra des circonstances, disait-il.
Trois jours avant, Nikolaï Nedkovitch lui avait conté ses tentatives infructueuses pour trouver des troncs de cerisier.
– Coupez donc le mien, avait-il dit.
Mais soit par égoïsme humain, soit par amour paternel, un sentiment bien naturel d’ailleurs, il ne permettait pas à ses fils de se mêler de l’affaire. Il voulait qu’ils résistent au courant qui l’avait entraîné. C’était demander l’impossible. « Ça suffit d’un de la famille... », se disait-il. Le revirement ne s’était pas complètement effectué en lui ; de là ses hésitations, ses contradictions. En un mot, Marko était, dans le parti populaire, le représentant des éléments modérés, éléments utiles dans toute autre occasion mais non dans les révolutions, où les violences et les excès sont le seul moyen d’arriver à la fin. La modération y joue souvent le rôle du frein sur la roue : dans le cas présent, ce n’était peut-être pas exactement ce qu’il fallait.
Kaltcho se mit à percer le bassinet du cerisier pour en faire un vrai canon. Il le creusa avec une vrille très fine dans une loupe lisse de l’arbre, du côté de la culasse. Il s’acquitta vite de cette nouvelle tâche, souffla dans le trou, et des brins de sciure s’envolèrent par la bouche du canon.
– Voilà qui est fait ! Il les réduira en bouillie, les Turcs, fit Kaltcho, d’un air de triomphe.
– Bravo ! Bouktchéto, c’est toi qui seras le canonnier. Maintenant baï Lilo le forgeron lui mettra les cercles de fer et tout le reste et ça sera un vrai Krupp, s’exclama Mitcho.
– Bon Dieu, que ça va gronder ! dit Marko.
– On le placera au-dessus de la Fosse verte et de là on sera maître de toute la vallée. Dès qu’ils se montrent, tire sans pitié ! La position est excellente.
Des pas s’approchèrent au-dehors.
– Ce doit être un des nôtres, dit Mitcho, car on avait donné la consigne au jeune costaud de ne laisser entrer personne d’autre.
C’était Popov, le secrétaire du comité. Il serra la main de Mitcho et de Marko.
– Quel bon vent t’amène par ici, Gantcho ? demanda le président.
– Je vais à la Fosse verte et j’entre en passant, pour voir notre artillerie.
– Bon, bon, aujourd’hui on doit se réunir tous, pour décider qui on va envoyer à Panagurichté. On nous demande un représentant. Mol, je propose Sokolov.
– Quel représentant vous demande-t-on ? questionna Marko.
– Quelqu’un pour l’assemblée générale.
– De quoi va-t-elle s’occuper, cette assemblée générale ?
– On y fixera la date de l’insurrection, parbleu !
– Ça sera sans doute pour le 1er mai, remarqua Gantcho.
Le visage de Marko s’assombrit.
– Non, ça sera pour plus tard, pour qu’on puisse au moins faire la cueillette des roses, fit Mitcho.
– Mais est-ce que nous nous soulèverons aussi ? demanda Marko.
– On se soulèvera partout le même jour.
– Ne faites pas de folies, voyons !
– Folies ou pas, il faut se soulever, répondit brièvement Mitcho.
– Ce n’est pas pour rien qu’on se prépare depuis si longtemps, ajouta Ganteho.
– On les réduira en bouillie, baï Marko ! dit Kaltcho en s’échauffant.
– Je pensais qu’on se préparait uniquement à se défendre contre les bachi-bouzouks, jusqu’à ce que nous voyions au clair ce qui se passe autour de nous... J’ai peur que nous soyons seuls à payer les pots cassés, dit Marko.
– Ce serait une honte et une infamie pour Biala-Tcherkva d’être en retard d’un seul jour. Tout le peuple se soulèvera en même temps et c’en sera fait de la Turquie ! dit baï Mitcho, enflammé.
Marko réfléchit.
– Est-ce que vous êtes sûrs, demanda-t-il, que ça se passera comme cela ?
–
– Bien sûr ! ! Nous ne sommes pas des enfants. C’est pour cela que je t’invitais à adhérer au comité, pour pouvoir lire de tes propres yeux les lettres et entendre Kablechkov et Boltcho.
Marko hocha la tête avec incertitude.
– Que vous sachiez vous-même quelque chose ou que les autres vous le disent, cela fait deux. Réfléchissez bien avant de commencer, pour qu’on ne répète pas l’affaire de Stara-Zagora.
Mitcho se fâcha :
– Maintenant, c’est tout autre chose, Marko, ne fais pas l’enfant. Je te le dis, ça flambera partout. Tout est organisé. Qu’on nous fixe seulement le jour.
– Si ça flambe partout, je prendrai aussi le fusil à l’épaule ! Mais si ça ne flambe pas partout et que nous soyons les seuls ? Voilà ce que je voulais dire ; il faut d’abord nous en assurer.
– Ça flambera !
– On ne sait jamais.
– Ça flambera, Marko ! Veux-tu qu’on t’en fasse le serment ?
– Je ne veux pas.
– Mais tu es Thomas l’incrédule !
– Je voudrais comme lui toucher du doigt. Il y va de nos têtes...
– Tu dois croire que nous vaincrons.
– Pourquoi ?
– Parce que la Turquie doit s’effondrer.
– Qu’est-ce que cela veut dire ?
– Simplement qu’il est temps qu’elle s’effondre. Parce que c’est écrit !
Marko comprit que Mitcho avait en tête la prophétie de Martin Zadek.
– Je ne crois pas aux nouvelles prophéties. Le calendrier prédit des pluies et des orages, et nous avons un temps splendide. Des blagues, tout ça.
– Zadek c’est autre chose, Marko, les savants même le reconnaissent, dit Mitcho avec ardeur.
– Allons, assez, mon vieux ! C’est toujours lui que tu nous cites. On en a assez de ton Zadek.
Mitcho s’empourpra :
– Si tu n’en veux pas, de Zadek, je te montrerai une autre prophétie bien plus profonde et plus claire.
– De qui est-elle ?
– De la Providence divine. Seul le Saint-Esprit peut l’inspirer, la raison humaine ne peut l’inventer.
Et Mitcho se mit à fouiller dans la poche de son vêtement. Marko l’observait, étonné.
– Oh ! mon carnet est resté à la maison, dit Mitcho avec dépit, mais, attends, je vais me rappeler... Et si tu me dis encore que tu ne crois pas à la chute de la Turquie, je renonce à toi ! « Il n’y a pire sourd que celui qui ne veut entendre. »
Mitcho sortit son porte-plume, trempa la plume dans l’encrier et se mit à fouiller dans sa poche.
– Tu n’as pas un bout de papier ?
– Non, dit Marko, après avoir cherché lui aussi.
– Attends, j’écrirai ici !
Mitcho s’appuya au canon et se mit à gratter sa surface lisse.
Marko le suivait avec curiosité.
Bientôt quelques lignes de lettres paléoslaves et de chiffres arabes s’alignèrent dans l’ordre suivant :
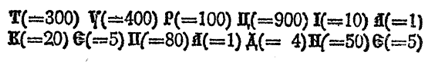
Les lettres lues l’une à la suite de l’autre formaient le texte : « La Turquie tombera », tandis que l’addition des chiffres donnait l’année fatidique 1876 111 !
Qui avait inventé cette combinaison étrange et découvert cette coïncidence ? Quel esprit avait saisi dans l’obscurité cette luciole, ce jeu inexplicable du hasard ? On l’ignore. De tels phénomènes sont appelés par les hommes modernes « le caprice du hasard » et les vieux les appellent tout simplement « le sort ». C’est ainsi que le préjugé explique ce devant quoi la raison abdique...
Mitcho Beïzédéto dévoila le double sens du chronogramme ; Marko vérifia lui-même. Il en perdit le souffle d’étonnement et ne dit plus rien. Mitcho le considéra d’un air vainqueur. Dans ses yeux noirs et ardents brillait une fière satisfaction et, sous le fin sourire ironique avec lequel il observait le malheureux Marko, on lisait à la fois la pitié pour son incrédulité pusillanime, et le triomphe, le bonheur, l’enthousiasme. Ce regard et ce sourire semblaient dire à Marko : « Vas-y, parle maintenant, qu’on entende ton opinion ; tu ne reconnais pas Martin Zadek ? Allons, que dis-tu de ça ? As-tu compris maintenant qui est Beïzédéto ? »
Pendant que cette conversation allait son train, quelques-uns des membres du comité étaient entrés dans la pièce, sans attirer leur attention. Eux aussi étaient venus voir le Krupp de Biala-Tcherkva. D’autres vinrent les joindre, et bientôt tous les membres furent là, à l’exception de Dimo Bezportev.
– On n’a pas pu le trouver aujourd’hui, rapporta Ilya Strandjov, il doit être complètement saoul, dans quelque bistrot.
– Il n’est pas bon de boire sans mesure, remarqua le pope Dimtcho en soulevant sa gourde.
Les membres du comité, transportés d’admiration à la vue du canon, ne pouvaient en détacher les yeux. Il était là devant eux comme une bête oblongue, énorme, sans tête et sans pattes, un seul œil sur le dos et une gueule terriblement profonde, qui allait cracher du feu et de la lave. Sur son ventre jaune et lisse se détachait en lettres noires la phrase cabalistique que Mitcho avait tracée, l’effrayant mené, thécel, pharès de l’empire Ottoman : « La Turquie tombera –1876. »
– Écoutez, les gars, déclara le vice-président, se tournant vers les assistants, est-ce à la Fosse verte qu’on avait décidé de se réunir ?
– Oui, oui, allons-y
– Écoutez, nous sommes maintenant tous réunis, est-ce qu’on ne ferait pas mieux de tenir la réunion ici ? D’ailleurs, si vous voulez mon avis, on y sera mieux... avec cet ours...
Tout le monde fut enchanté de cette heureuse idée du vice-président !
– Asseyez-vous alors !
– Et vous, où vous mettrez-vous ?
– Voici mon trône, dit Mitcho en s’asseyant sur le canon.
Et la réunion commença.
15 LA NOUVELLE PRIÈRE DE MARKO
Marko sortit assez pensif de l’arsenal de Kaltcho.
– Qui sait ?... murmurait-il en cheminant à travers les jardins potagers.
Il marcha ainsi jusqu’à, la rivière qui descend du Balkan à l’est de Biala-Tcherkva. Là il s’arrêta dans son propre verger et jeta un coup d’œil à la souche du cerisier coupé, souriant sous cape. Puis il rebroussa chemin, à travers jardins et prés, pour entrer dans la ville par la rue principale, d’où partait la route pour K... Lorsqu’il eut dépassé les cabanes des nomades, éparses sur un terrain poussiéreux au bout de la ville, il se trouva soudain devant une ronde joyeuse. Quelque faubourien pauvre célébrait sans doute ses noces et tout le quartier devait y assister, car la ronde était interminable.
– Voilà la vie, pensa-t-il, là-bas on prépare des canons, ici on se marie, sans penser à demain...
Mais il s’aperçut aussitôt qu’ici même l’élément révolutionnaire était présent ; la ronde était menée par Bezportev qui, bien qu’un peu boiteux, était un danseur fameux. D’une main il agitait un mouchoir blanc, tout en bondissant de façon assez excentrique et en imprimant à l’interminable chaîne humaine qui le suivait les figures les plus capricieuses : la ronde dessinait tantôt un demi-cercle absolument parfait, tantôt elle semblait une couleuvre endormie, enroulée sur elle-même, pour se dérouler peu après et former une ligne droite ou des tracés fantaisistes. Le large fond de sa culotte à la turque se gonflait d’un air victorieux, chaque fois qu’il s’élançait en avant.
Peu à peu, Marko s’approcha de la ronde, et il s’aperçut alors que Bezportev était très ivre et qu’il bondissait et se démenait comme s’il conduisait sa souple colonne à l’assaut d’une forteresse. Bezportev avait communiqué son enthousiasme jusqu’au dernier chaînon, composé de tout petits enfants. Sur son ordre, les musiciens s’étaient tus et danseurs et danseuses s’accompagnaient tout seuls, en chantant. En passant, Marko entendit les couplets de la chanson :
Est-ce que tu espères, Kalina,
Que ton frère Kolio viendra ?
Que ton frère Kolio viendra ?
Qu’un présent il t’apportera ?
Un collier pour ta gorge blanche,
Une ceinture pour ta taille fine,
Une coiffe pour tes cheveux blonds,
Des souliers pour tes petits pieds.
Et les danseurs se trémoussaient de plus belle.
Marko s’arrêta sous l’auvent de la forge pour se reposer et contempler le joyeux spectacle. Bezportev l’aperçut. Il se détacha de la ronde et courut vers lui, agitant son mouchoir et sautillant au rythme de la chanson. Son long visage blanc et osseux, orné d’une petite moustache rousse et de deux yeux bleus et mobiles, était empreint d’une joie sauvage et d’un enthousiasme animal, causés par l’ivresse, l’ivresse provoquée par quelque terrible et écrasante angoisse de l’âme.
– Vive baï Marko, vive la Bulgarie et vivent les glorieux fils bulgares ! Baï Marko, paie-moi un verre de vin. Merci. Vivat ! Vive celui qui verse à boire ! Excuse, baï Marko, je suis saoul comme un porc, mais j’ai toute ma tête à moi. C’est moi qui bois le vin, ce n’est pas lui qui me boit. Oui, comme un Bulgare sensible ! Car le peuple souffre et moi je crie : assez d’esclavage et d’ivrognerie ! Mieux vaut mourir que supporter cette vie de chien. On dira peut-être : il est saoul comme un Polonais. Celui qui le dira est un traître. Mon cœur saigne pour la Bulgarie, cette malheureuse esclave turque. Nous voulons des droits, des droits humains ! Nous ne demandons pas de richesses, pas de femmes. Mais tu me diras : les gens se marient ! Je te répondrai : c’est ça le peuple ; mais lorsque demain tu lui diras : « En avant, marche ! » il brûlera sa maison et prendra le Balkan ! Celui qui craint les oiseaux ne sème pas de millet. Tu comprends tout, toi ! Vivent les patriotes comme toi ! Je leur baise les mains et les pieds ! Mais le tchorbadji Iordan... on va l’écorcher vif... et Steftchov ! Mais motus ! bref, je voulais dire que je suis saoul comme un... comme un... L’heure approche. Si aujourd’hui je suis en vie, demain je serai un esprit, un rien, une ombre. Un monde de chien, en un mot ! Et celui qui meurt pour le peuple, il restera vivant à travers les siècles. Vive... Vive la Bulgarie ! Et moi, qu’est-ce que je suis ? Un âne qui craint l’eau claire...
Brusquement le Rédacteur s’interrompit car il apercevait un Turc qui passait à cheval, ce qu’on voyait rarement depuis quelque temps. Il se mit à chanter en le désignant du doigt :
Le combat commence, nos cœurs battent,
Les voici tout près, nos ennemis.
Courage, compagnie fidèle et unie.
Nous ne sommes plus des esclaves soumis.
– En avant, en avant ! cria Bezportev, comme s’il conduisait quelque compagnie invisible, et il s’élança vers le Turc.
Ce dernier se retourna, l’aperçut et s’arrêta. En quelques pas, le Rédacteur fut près de lui et lui cria :
– Où vas-tu, Tchitak ? Comment oses-tu fouler ce sol sacré ? C’est la terre bulgare ça, la tienne est dans les déserts de l’Asie, va t’y faire pendre ! Descends, animal, baise cette terre sacrée. Sinon, ton Sultan ira à tous les diables, avec ses soldats et ses harems...
Le Turc ne comprenait pas ce que lui disait Bezportev, mais il se rendit compte qu’il était très ivre ; après un instant de trouble, il éperonna son cheval et repartit. Bezportev se précipita et saisit les brides.
– Que me veux-tu, tchorbadji ? demanda le Turc éberlué.
– Descends ou je te crève ! hurla sauvagement Bezportev sortant son poignard étincelant.
Le Turc portait lui aussi une arme à la ceinture, mais il l’oublia complètement et descendit, tremblant, de son cheval.
– Que veux-tu, Tchorbadji ? répétait-il, effrayé par l’air féroce du Rédacteur.
– Où vas-tu, Tchitak ?
– À K...
– Et quand iras-tu à La Mecque ?
Le Turc était complètement abasourdi ; sa voix s’arrêta dans sa gorge, il n’arriva qu’à souffler, à grand-peine
– Laisse-moi, Tchorbadji !
– Allons, on ira ensemble à La Mecque, cria Bezportev ; attends que je monte sur ton dos ! Pendant des siècles les Bulgares t’ont porté sur le leur !
Et Bezportev sauta avec agilité sur le dos du Turc, enroulant ses bras autour de son cou.
– En avant pour La Mecque ! criait-il.
Et devant tout le monde, au milieu des exclamations et des rires, le Turc, monté par Bezportev, se mit à trotter, son cheval le suivant d’un air mélancolique.
« Qui sait ? qui sait ? » murmurait Marko sur le chemin du retour. Il n’en revenait pas encore de ce qu’il venait de voir. Il avait vécu cinquante ans ; il se rappelait le temps où il était défendu à un Bulgare de porter du vert, où tout Bulgare devait descendre de cheval chaque fois qu’il rencontrait un Turc ; lui-même avait vu, vécu, subi, digéré tant d’humiliations que maintenant il n’en croyait pas ses yeux : il avait vu au milieu de la fête, devant mille spectateurs, un Turc descendre de son cheval sur l’ordre d’un Bulgare, boiteux et saoul, et ce Turc oublier son arme et sa qualité d’Osmanli et se prêter, comme une bête, pour que Bezportev monte sur son dos et se fasse porter aux yeux de tous. Et tout cela s’était produit si simplement, d’une façon si inattendue ! oui, terriblement inattendue ! Et ce n’était pas un fait dû au hasard ou à l’ivresse : hier ou avant-hier cela n’aurait pu avoir lieu, aujourd’hui cela se produisait et tout le monde riait et applaudissait, comme s’il s’agissait de la chose la plus naturelle. Quels temps vivait-on ? D’où venait cette témérité chez l’esclave et cette peur chez le maître ? Le glas aurait-il déjà sonné pour cet empire, Beïzédéto et les jeunes avaient-ils raison ? « Qui sait ? qui sait ? »
Absorbé par ses méditations, il se heurta aux enfants qui rentraient de l’école. C’étaient les élèves de Merdévendjiev, qui formaient une longue colonne, en rang de deux. Ils allaient au pas, comme des soldats, sous le commandement des surveillants qui marchaient de côté et du général qui marchait devant... Assen, le fils de Marko, agitait un mouchoir rouge accroché à une baguette : c’était le drapeau.
Marko resta saisi : « Mais tout le monde est devenu fou : tous, jusqu’aux nourrissons ! » pensa-t-il.
Il pinça l’oreille d’Assen et lui dit en souriant :
– Qu’est-ce que tu portes, toi, petit mulet ?
À ce moment il pensa avec gratitude que ses fils aînés étaient restés loin de la contagion, qu’il n’avait pas remarqué chez eux l’esprit rebelle qui s’était emparé de tous, jusqu’à lui-même.
« Qu’eux au moins se tiennent à l’écart de cette purée où je me suis enfoncé. Mais moi, je suis vieux. Qu’ils restent au moins en vie ! »
Une pensée amère le fit se renfrogner : « N’ont-ils pas de sang dans les veines, ces chenapans ? Sont-ce des fripiers que j’ai engendrés ? Non, tout de même, mieux vaut qu’ils se tiennent à l’écart. Un de la famille suffit. »
Le soleil était très haut dans le ciel. Il arriva chez lui inquiet et dépité. Il entra dans la grande pièce, examina les pistolets accrochés au mur dans leurs étuis, puis ouvrit la porte du réduit, dans l’intention de remettre des silex à deux vieux pistolets hérités de son arrière-grand-père et abandonnés depuis de longues années dans la poussière. Le réduit était très sombre et servait de cachette. Il y fouilla à tâtons, puis fut obligé d’allumer une bougie pour mieux voir. Quel fut alors son saisissement ! Au lieu des deux vieux pistolets, il trouvait un arsenal de fusils, de pistolets, de revolvers ! Un véritable dépôt d’armes, en même temps qu’une sorte de vestiaire : dans un des angles, pendaient des sacs, des mocassins, des bandes molletières, d’étranges habits français ornés de galons, ainsi que d’autres objets mystérieux et suspects.
Il appela à grands cris sa femme, qui accourut :
– Mère, qui donc a ouvert le réduit ? Qui a apporté ces horreurs ici ?
Sa femme le regarda, abasourdie :
– Mais qui ça peut-il être ? pas moi en tout cas ! Tous les autres : Vassil, Dimitar, Kiro fouillent ici toutes les cinq minutes et y ramassent les toiles d’araignée. Dieu sait ce qu’ils cherchent dans l’obscurité !...
Marko s’emporta :
– Oh ! qu’ils aillent se faire pendre, ces haïdouks ! cria-t-il en se grattant la nuque.
Puis il tint encore un moment la bougie, regarda un peu et murmura avec une expression indéfinissable sur son visage :
– Les fous, les fous ! Que Dieu les garde !
Il sortit en refermant la porte. Puis il s’approcha de l’iconostase et s’agenouilla devant l’image de Dieu. Il murmurait une prière qui ne figurait pas dans son livre de messe : il priait pour la Bulgarie.
16 IVRESSE D’UN PEUPLE
À mesure que le printemps avançait, le bouillonnement révolutionnaire prenait de plus en plus d’ampleur. Son foyer principal, la Thrace occidentale, ressemblait à un volcan dont le sourd grondement laisse prévoir l’éruption. Organisant la lutte, un essaim d’apôtres et de prédicateurs allait par monts et par vaux ; le peuple, impatient de porter sa croix du calvaire, avide de la parole sublime de la liberté, le cœur franc, les bras largement ouverts à l’accueil, les recevait chaleureusement. Déjà une longue file de précurseurs avait labouré ce champ spirituel et jeté le germe de la conscience nationale. Inaugurée par Païssi, un moine ; close par Levski, un diacre – deux saints –, elle avait ensemencé et fumé ce champ, béni par le premier du haut du mont Athos, par le second du haut de la potence. Vingt ans plus tôt, Rakoski, pour avoir seulement, dans un village, fait allusion à l’insurrection, ne put qu’à grand-peine échapper, travesti en femme, à la poursuite des gardes ruraux. À présent, à la seule rumeur de l’arrivée d’un « apôtre », le peuple, loin de lui donner la chasse, envoyait des députations à sa rencontre. Et il écoutait, il buvait avidement la parole vivifiante, comme un gosier sec un filet d’eau cristalline. Lui disait-on : « Sois prêt à mourir ! » et l’église donnait son pope, l’école son maître, le laboureur son champ, la mère son fils. Avec la force déchaînée des éléments, l’idée pénétrait partout, embrasait tout, la montagne et la plaine, la chaumière du pauvre et la cellule du moine. Même les tchorbadjis, ces membres d’une classe stigmatisée, entrave au progrès du peuple, tombèrent eux aussi sous l’empire de l’idée qui bouleversait leur milieu spirituel. Ils prirent, il est vrai, une part relativement faible au mouvement patriotique, mais ne l’ayant pas dénoncé, ils ne l’entravèrent pas. Les délations et les lâchetés, ces monstres impies qu’engendre infailliblement l’insuccès, vinrent seulement, de toute part et de la part de tous, à la suite de la catastrophe. En vain, certains désirent-ils, au détriment de la vérité historique, faire de cet enthousiasme le monopole de ceux qui portent des tsarvoulis 112 aux pieds. Vainement, car ceux-là ne sont qu’une partie du peuple bulgare. L’esprit révolutionnaire, cet ange de feu, effleura de son aile ardente aussi bien les porteurs de tsarvoulis que les étudiants, les porteurs de bonnets de fourrure aussi bien que les porteurs de fez, les coiffures de moine autant que les chapeaux. Comme dans toutes les luttes de la Bulgarie pour le progrès, la science et la croix, c’est-à-dire les forces spirituelles, tenaient le premier rang. Le martyrologe bulgare en donne l’irréfutable preuve. Le principal contingent fut, il est vrai, puisé jadis comme de nos jours dans la masse populaire dont la force réside avant tout dans le nombre, mais il fallait à cette masse un sens et une âme que seuls pouvaient lui donner les intellectuels.
Submergeant tout, l’enthousiasme prenait chaque jour une force nouvelle. Les préparatifs suivaient ; vieux et jeunes s’étaient mis au travail. Pour fondre des balles les paysans laissaient inachevé le labour de leurs champs et les citadins plantaient là leur commerce. Des courriers secrets faisaient jour et nuit la navette entre les divers groupements et le comité central de Panagurichté ; la police clandestine surveillait la police officielle. Les jeunes gens allaient aux exercices militaires l’arme à la main, commandés par des centeniers et des dizainiers ; les femmes tissaient des molletières, tricotaient des cordons, enroulaient des mèches ; les vieilles pétrissaient et cuisaient des biscuits ; les bottiers ne fabriquaient plus que les sacs, les tsarvoulis, les cartouchières et les autres accessoires indispensables aux insurgés ; même les notables des bourgades, les percepteurs, les maires et les autres personnages officiels prenaient part avec zèle aux préparatifs. Dans chaque village le dépôt d’armes, de cartouches et de poudre, celle-ci fournie par les Turcs eux-mêmes, s’enrichissait sans cesse ; des troncs de cerisiers, vrillés, taillés, renforcés par des cercles de fer, constituaient l’artillerie ! Des drapeaux de soie, bordés de lions d’or rugissants, des parures fantaisistes d’insurgés, de brillantes chasubles de prêtres, des croix, des bannières constituaient le décor de la lutte imminente. Cette griserie générale avait gagné jusqu’aux jeux des enfants. La guerre au milieu des rues remplaça le tchélik, la balle, le piko 113 et la toupie. Des fusils de sureau et des sabres de bois furent fabriqués. Les gens d’âge se disaient, étonnés : « Ceci est un signe de Dieu. » Mais il n’y avait pas de présages célestes annonçant la terrible tempête : seule, répandue partout, l’extraordinaire prédiction : « La Turquie, tombera – 1876 », troublait même les plus sceptiques... Au contraire, le printemps, venu très tôt cette année-là, avait transformé la Thrace en un jardin de paradis. Plus merveilleuses et luxuriantes que jamais, les roseraies étaient épanouies. Les plaines, les champs portaient des moissons magnifiques, que jamais personne ne récolterait...
Et, en quelques jours, en secret, en silence,
De plusieurs siècles le peuple s’élance...
Quant à l’indifférence du gouvernement turc devant cette agitation ouverte et insolente, en présence de ces armements et de ces bruyants préparatifs d’insurrection, elle s’explique par son aveuglement autant que par son mépris des forces accrues de la raïa. « Charivari de lièvres », disaient les efendis débonnaires. « Ce sont des braillards de vivats », disaient les maîtres hautains, et ils riaient dédaigneusement sous cape. Il y a des mots qui expriment une époque. « Les braillards de vivats » étaient l’incarnation de la conscience nationale, sortie triomphante de la lutte de trente ans pour l’indépendance de l’Église. Mais ces mêmes « braillards de vivats » qui, en 1870, avaient bu à l’honneur de l’exarchat bulgare, métamorphosés en révolutionnaires, coulaient en 1876 des balles et fabriquaient des canons destinés à saluer la liberté de la Bulgarie.
Les Turcs n’avaient pas saisi cette métamorphose. Ils ne pouvaient marcher du pas de leur époque, ni voir les fortes positions acquises par les idées de progrès. Leurs yeux se fussent-ils dessillés que c’eût été trop tard : ils ne disposaient pas de geôles assez vastes ni de chaînes assez longues pour contenir cette idée gigantesque, semblable en son immense essor au légendaire Krali-Marko 114, capable de déplacer des montagnes. Nos descendants seront stupéfaits – que dis-je ? – nous-mêmes, les contemporains, qu’une longue suite d’exemples infligés par l’Histoire vient de tirer de cette griserie, nous nous demandons, éblouis, ce qu’était cette ivresse de l’esprit, cette sublime folie d’un peuple, qui le poussaient à lutter contre un empire redoutable et disposant encore d’immenses forces militaires ? S’y préparer dans l’espoir de l’abattre par des moyens ridiculement insignifiants, lui disputer le pouvoir au cœur même de son territoire, dans les « boyaux de l’enfer », selon l’expression de Marko Ivanov, sans autres alliés que l’enthousiasme, ce feu de paille, et que l’illusion, fantôme qui se perd vite dans le néant. Les exemples sont rares dans l’Histoire d’une telle présomption frisant la folie. L’esprit national bulgare n’a jamais atteint pareille hauteur et il est peu probable qu’il puisse encore s’y élever.
Si nous nous sommes attardés sur ce prélude de la lutte, c’est qu’il est admirable et donne la mesure de la force qu’acquiert une grande idée tombant sur un sol favorable. La lutte même qui suivit ne mérite pas cette épithète. Nous ne songeons même pas à la décrire. Mais notre récit se heurte forcément à elle car il touche à l’un des épisodes qui illustrent ce krach 115 monstrueux des plus radieux espoirs que fut la révolution.
17 LA GIFLE
Le lendemain du jour où, de la fonderie de Kaltcho, nous avons suivi Marko Ivanov jusqu’à l’arsenal, le café de Ganko, regorgeant de fumée, retentissait de la bruyante hilarité de ses hôtes.
Celle-ci était provoquée par un calembour d’Ivantcho Iotata : Frangov, lisant un article du journal Pravo, sur la politique de l’Autriche en Orient, avait buté sur l’expression « Drang nach Osten » ; Iotata traduisit cette phrase allemande par les mots « Drague nache ostène » qui en bulgare signifient : « Notre cher aiguillon. »
Le rire général assourdissait le café.
Seul Kandov, silencieusement assis dans un coin, ne riait pas. Il semblait ne rien voir, ne rien entendre de ce qui se passait autour de lui. Sans doute son esprit planait-il en d’autres sphères. Sur son visage hâve et pensif, une mélancolie, une tristesse plus profondes encore que d’habitude, quelque chose d’inexprimablement douloureux était répandu qui contrastait singulièrement avec les autres physionomies, insouciantes et élargies par le rire.
Celui-ci s’apaisa car, à ce moment, le service divin étant terminé, les clients du café se mirent aux fenêtres pour mieux observer les passants et les passantes endimanchés.
Parmi ces dernières apparut Rada.
Elle était modestement vêtue de noir. Un bonheur secret faisait s’épanouir ses joues comme des pivoines. Elle attira tous les regards, dont bon nombre n’étaient guère bienveillants ; une rumeur très défavorable ayant couru sur Rada ces jours derniers, il en était même de méprisants.
Hadji Rovoama avait répandu le bruit que Rada recevait à la nuit close des amoureux déguisés ; elle prenait Dieu à témoin et jurait les avoir vus de ses propres yeux.
La vérité était qu’on avait par hasard aperçu Ognianov au moment où il sortait de chez Rada, sans toutefois le reconnaître ; la rumeur étant parvenue aux oreilles de la religieuse, celle-ci s’était évertuée à la répandre dans tout le couvent. Du couvent ce bruit était passé à la ville. Les cancaniers l’avaient accueilli avidement et le nom de Rada roulait dans les commérages des bavards et des ennemis de Boïtcho qui, à travers Rada, se vengeaient de lui et insultaient sa mémoire. Rada était la seule à ne rien savoir. Absorbée par son bonheur, elle ne pouvait deviner ni dans les regards, ni dans les demi-sourires perfides, la basse calomnie dont elle était la victime.
Kandov en était profondément indigné.
Au moment où Rada passait devant le café, Steftchov se pencha et, un sourire sardonique aux lèvres, murmura quelque chose à Merdévendjiev. Le chantre se retourna, suivit du regard la jeune fille qui s’éloignait et cligna malignement de l’œil. Le murmure se transmit de proche en proche, et fit naître des ricanements. Steftchov, triomphant, ne se contenta pas de si peu : il déclama ironiquement le vers bien connu du chant révolutionnaire :
Où es-tu, fidèle amour de la Patrie ?
et toussota avec impudence.
Beaucoup comprirent vers qui était dirigée sa cognée et ils échangèrent des regards pleins de sous-entendus.
Steftchov menait habilement la conversation. Les railleries et les pointes commencèrent à pleuvoir sur la malheureuse jeune fille.
Kandov qui, tout en écoutant les moqueries, avait jusqu’ici patienté, ne put plus se contenir. Il se tourna vers Steftchov :
– Qui visez-vous par vos railleries ? Rada Gospojina ?
Le silence se fit dans le café.
– Pourquoi cette question ? Et quand ce serait Rada Gospojina ? répondit Steftchov d’un ton obstiné.
– Si c’est d’elle que tu parles, tu es un calomniateur, un bas et vil personnage, c’est moi qui te le dis ! cria l’étudiant, et il se dressa haletant.
– Le public jugera qui, de toi ou de moi, est un bas et vil personnage, mais quant à être le calomniateur de Rada Gospojina, mes excuses ! Interroge même les chiens, eux aussi sont au courant. Je te conseille de ne pas t’époumoner à défendre une fille sans honneur. Ne fais pas le chevalier, c’est ridicule.
Kandov perdit contenance. Il s’avança jusqu’au milieu du café et, pâle, tremblant de rage, il lança :
– Tu attaques grossièrement une jeune fille sans défense. Retire tes paroles !
– Prouve-moi que ta jeune fille n’a pas reçu de visite secrète il y a une semaine. Une jeune fille qui...
Steftchov ne put achever.
– Cette visite secrète était celle de Boïtcho Ognianov, son fiancé, espèce de mufle ! hurla Kandov en lui appliquant une gifle dont le claquement sonore retentit dans tout le café.
Étourdi, Steftchov chancela d’abord sous le coup puis il se jeta sur l’étudiant qui brandissait sa canne.
Mais les assistants les séparèrent. Le café se remplit d’altercations bruyantes. Au-dehors les curieux s’attroupaient aux vitres.
Steftchov se précipita hors du café, la joue en feu, fou de rage, et se dirigea directement vers le konak, décidé à se venger cette fois-ci de Kandov et de Rada. Il allait amener le bey à les soumettre tous deux à un interrogatoire serré au sujet d’Ognianov ; même si l’étudiant arrivait à s’en tirer par des négations, la jeune fille serait définitivement déshonorée ; or, c’était elle la cause du scandale d’aujourd’hui.
Mais, dans la rue, le domestique de Steftchov accourait à sa rencontre, lui annonçant l’arrivée du médecin de Plovdiv appelé auprès de Lalka grièvement malade. Aussi Steftchov rentra-t-il chez lui.
18 KANDOV
Les mots dont Kandov avait accompagné sa gifle frappèrent les assistants de stupeur. Steftchov le premier, comme la foudre tombant d’un ciel sans nuage. Mais l’exaltation du bouillonnant étudiant n’eut pas de suites fâcheuses pour lui.
Les plus perspicaces comprirent que l’emportement de Kandov avait des racines plus profondes que son caractère chevaleresque. Un courroux si impétueusement passionné, qui l’avait poussé à l’extrême au sujet d’une personne étrangère, ne pouvait être motivé que par des mobiles personnels. Ces personnes perspicaces comprirent, grâce à cet incident, aussi bien qu’à d’autres indices, toujours perceptibles pour tout observateur attentif, que Rada Gospojina n’était pas indifférente à Kandov.
Ils ne se trompaient pas. Kandov était amoureux de Rada. Cela s’était produit très simplement. Le jeune étudiant était de ces natures passionnées pour lesquelles la vie n’a de sens que dans la poursuite de quelque idéal. Ces natures ne peuvent vivre que sous l’empire d’attachements profonds et fougueux.
Jeune, ardent, idéaliste, Kandov, revenu en Bulgarie, était tout étourdi de ces théories et de ces principes extrémistes qu’une âme pure rend généreux mais qui deviennent affreux quand un être corrompu les adopte. Son premier contact avec la vie ébranla ses profondes convictions. Il vit que le terrain leur était ici absolument inhospitalier. Il ne pouvait adorer une idole fêlée. Il en chercha une autre ; elle était là, toute prête : la Bulgarie.
Mais, avant même d’avoir aperçu celle-ci, une autre idole s’était introduite dans son âme : il avait vu Rada.
C’était peu après qu’Ognianov eut fui de Biala-Tcherkva, l’année précédente. Ce sentiment, faible au début, avait grandi, puis, rapidement, il avait pris une place immense dans son âme. Il s’était emparé de tout son être, il était devenu passion. Kandov, peu à peu, s’éloigna de son milieu et des intérêts de celui-ci, il tomba dans une apathie rêveuse que seule la vue de Rada pouvait secouer. Ceci dura jusqu’au printemps, puis un beau jour, il eut un sursaut, revint à lui, s’indigna de sa propre conduite. Il jugea que sa passion était lâche, déloyale envers Ognianov, son ami, et criminelle à l’égard de la Bulgarie, à laquelle il était tenu de se consacrer.
Il s’effraya de son état et voulut étouffer, extirper de son âme, pendant qu’il en était encore temps, ce sentiment démoniaque. Seule, pensa-t-il, une préoccupation encore plus violente et plus redoutable pourrait le sauver, le faire renaître. Il décida de se jeter dans la lutte qui se préparait et d’affronter ses épreuves imprévisibles ; de plonger dans les flots tumultueux et déchaînés ; de s’enivrer du souffle brûlant du fol enthousiasme et du bouillonnement révolutionnaire. Il voulut chasser Lucifer par Belzébuth. C’est alors que nous l’avons vu arriver à l’improviste chez Sokolov et prier d’être reçu membre du comité en offrant de tuer Steftchov.
Il était surtout fasciné par le changement qu’apporterait à son affreuse angoisse ce meurtre, noble par ses motifs. Il comptait sur cet attentat : c’était là l’épreuve dont son âme devrait sortir renouvelée ; le coup qui porterait la mort au traître, la porterait, en même temps, à l’âme d’une autre terrible ennemie : l’image enchanteresse de Rada.
Oui, avant tout, le meurtre, baptême dans le sang, et la révolution. Un pas terrible, mais décisif vers le salut...
Et, avant même d’avoir fait part au président de son projet, plusieurs nuits de suite, il cajola, choya, caressa passionnément son idée dès qu’elle eut surgi dans son esprit inquiet, comme une mère son enfant. Rêveur, il dressait, au cours de ses longues insomnies, le plan de la suppression de Steftchov et cette idée brûlante l’absorbait entièrement, accaparant son esprit au point d’en interdire l’accès à tout autre sentiment, à tout autre intérêt. Kandov se souvint de Raskolnikov. Le héros de Dostoïevski avait, lui aussi, conçu l’idée d’accomplir un meurtre pour le bien de l’humanité – le meurtre de l’usurière. Et il était si sympathique, si émouvant ! Kandov fut stimulé par la similitude des deux situations, il en fut ravi, exalté... Raskolnikov surgissait dans son esprit comme une figure radieuse et encourageante, comme un idéal. Il adopta même la manière employée par Raskolnikov pour tuer la vieille femme : il coudrait à l’intérieur de sa longue veste, sous l’aisselle, les extrémités d’un cordon auquel une hache serait suspendue par son fer. Personne ne remarquerait ainsi qu’il portait une arme.
Par bonheur ou par malheur, l’exécution fut différée et le projet de Kandov s’écroula comme un château de cartes. Il fut au désespoir. Mais la révolution était devant lui, hérissée et flamboyante comme un monstre d’Apocalypse, le consolant un peu de son malheur. Dans son âme, cependant, la lutte continuait à s’amplifier. En dépit de la passion qu’il mettait à servir la cause de la révolution, le souvenir de Rada ne le quittait point. Derrière l’image de la patrie, l’image de Rada se glissait traîtreusement ; elle était logée très au fond de son âme et de là, pleine d’assurance, elle contemplait avec pitié l’hôte de passage qui venait d’être introduit dans une demeure où elle régnait en maîtresse.
Si du moins son être avait pu nourrir et garder côte à côte ces deux attachements, l’un imposé par la raison et la volonté, l’autre par la nature, les concilier, les équilibrer, les affaiblir l’un par l’autre. Il s’étonnait qu’Ognianov pût aimer avec la même ardeur la Bulgarie et Rada, se partager ainsi et demeurer allègre et fort, se sentir tranquille et même heureux ! Quelle nature, généreuse et riche, qui pouvait porter si librement à la fois deux grandes passions ; qui pouvait y puiser une vaillance, une alacrité nouvelles !
Combien il enviait Merdévendjiev qu’un grognement d’ours avait guéri de sa ridicule passionnette.
Aujourd’hui, en donnant le soufflet, Kandov avait senti la fausseté de sa situation. Il s’était consacré à la cause de la Bulgarie et pourtant il aimait Rada. Et la force des choses faisait d’Ognianov, son compagnon d’idées, un rival ; l’Idée l’attachait à lui, la passion l’en éloignait.
En châtiant avec sa généreuse impétuosité l’insulte faite à l’honneur de Rada, il avait en même temps vengé Ognianov ! Mais, dans la lutte cruelle qu’ils se livraient, le cœur, la force vitale, eut vite fait de vaincre la raison. Kandov se livra entier à son nouvel amour.
Passé brusquement des bancs de l’Université au tumulte de la vie, il semblait un être brutalement ramené du ciel sur la terre. L’âme confiante, le cœur ignorant des épreuves de la vie, il n’était nullement préparé à subir les chocs de celle-ci. La première épreuve qu’un sort adverse lui envoya fut cet amour. Il s’y abandonna avec l’ardeur sans réserve qu’il avait vouée à l’idéal socialiste. Mais tandis que naguère c’était le cerveau qui agissait, cette fois le cœur le menait, le cœur, cet obstiné que ni la raison, ni l’expérience, ni la sagesse de tous les philosophes n’arrivent à dompter.
Cette passion allait-elle être payée de retour ? Kandov pourrait-il trouver un bonheur à la mesure de sa passion ? Ou bien la désillusion la plus amère allait-elle empoisonner sa vie ?
Aucun amoureux ne s’est jamais posé pareille question. S’il l’eût posée, il n’eût pas été amoureux. L’amour ignore les points d’interrogation.
Par surcroît, le cœur de Rada n’était pas libre et il le savait. Mais son propre cœur aveuglé par l’amour ne s’en inquiétait pas : ce n’est pas en vain que l’ancien art grec a souvent représenté le dieu ailé de l’amour avec les yeux bandés.
Tant que Rada avait cru qu’Ognianov était mort, elle était si accablée par son malheur qu’il ne lui était même pas venu à l’esprit de remarquer les visites, encore espacées d’ailleurs, de l’étudiant ; peu à peu, celles-ci, de même que les rencontres en apparence provoquées par lui, devinrent plus fréquentes. Le temps passa, accentuant les choses ; enfin, sa perspicacité féminine fit sentir à Rada que, décidément, elle n’était pas indifférente à l’étudiant. Les symptômes de ce sentiment s’accentuaient : il gagnait en intensité.
Rada fut d’abord surprise et troublée, puis elle fit semblant de ne rien comprendre ; peut-être cet amour la flattait-il un peu ? Bientôt enfin elle s’effraya de sa force croissante. Mais, timide, elle n’eut pas le courage d’éteindre brutalement ce feu et de fermer sa porte à cet adorateur dont la délicatesse et la sincérité la désarmaient. Seuls des hommes tels que Steftchov auraient pu lui donner le courage de les souffleter.
Rada ne savait que faire. Elle continuait à être aimable envers Kandov, ami plein de noblesse de Boïtcho. Elle pensait, la pauvre, qu’en l’accueillant affectueusement, en le caressant du feu de ses yeux noirs, elle apaiserait son ardent désir, dont d’ailleurs, elle ne soupçonnait même pas l’intensité. Mauvais moyen : ni elle ni Kandov ne savaient que le seul moyen efficace contre ce genre de maladie est la séparation. « Loin des yeux, loin du cœur », dit le proverbe.
19 UNE VISITE MATINALE
Kandov, après le scandale de sa querelle avec Steftchov, était rentré chez lui très agité ; il s’était enfermé dans sa chambre et jusqu’au soir il avait lu sans répit un seul et même livre. Il n’interrompait sa lecture que pour marquer au crayon certains passages et s’y enfonçait de nouveau.
Entièrement absorbé par cette occupation, il ne déjeuna pas. Sa mère l’appela, il répondit qu’il avait mal à la tête. Le soir aussi il ne dîna pas. Il resta pendant des heures étendu sur le divan, pensif, le regard au plafond. Quand vint le silence de la nuit, il se leva, s’assit à la table et commença à écrire une lettre, cela jusqu’au milieu de la nuit. Alors il se jeta de nouveau sur le divan, non pour dormir mais pour rêver ; la bougie brûla jusqu’au matin. Les premières lueurs de l’aurore tombèrent sur le visage de l’étudiant assoupi ; il s’éveilla en sursaut, ouvrit les yeux fatigués par ce sommeil inquiet. Il alla à la table, relut sa lettre, la plia, chercha une enveloppe et n’en trouvant pas, posa de nouveau la lettre sur la table.
« Maintenant ou plus tard ? » se demanda-t-il dans un murmure.
Il demeura un instant pensif.
« Non plus tard, je la donnerai plus tard.... Quand je la verrai. »
Et il commença hâtivement à se préparer à sortir.
Une fois dans la rue, Il s’aperçut que le jour pointait à peine. Le soleil était encore bas à l’horizon ; la maison où logeait Rada projetait son ombre sur la maison d’en face. Il savait par expérience qu’au moment où l’ombre s’était retirée jusqu’au ruisseau au milieu de la rue, la jeune fille se levait pour arroser le jardin de Lilovitsa. Elle serait alors habillée et l’heure conviendrait à une visite. Kandov passa et repassa plusieurs fois, jetant des regards tantôt vers le mur de Lilovitsa (la chambre de Rada était à l’intérieur de la cour), tantôt vers l’ombre. Celle-ci descendait du mur de la maison d’en face avec une lenteur désespérante et il restait encore beaucoup d’ombre jusqu’au ruisseau : il fallait attendre une heure et plus avant que le soleil éclaire toute cette moitié de rue. Et Kandov, les mains derrière le dos, continua sa promenade ; il s’engagea dans d’autres rues pour ne pas attirer l’attention des passants qu’il rencontrait plus nombreux. Le soleil éclatait déjà sur le Balkan, sur les collines au-dessus de la ville, les ardoises des toits, les cheminées blanches, les fenêtres tournées au levant. Les cafetiers matinaux avaient ouvert leurs cafés, les épiciers ceints de tabliers blancs balayaient le pavé devant leur boutique. Les passementiers battaient les soutaches sur de larges pierres devant les fontaines, les gens commençaient à circuler, le mouvement, la vie reprenaient, le bourdonnement habituel de la ville, fait de mille bruits confus, se rétablit.
Tout pour Kandov restait inaperçu. Ni le soleil, ni le bruit, ni les passants, ni la vie qui recommençait à bouillonner autour de lui ne l’intéressaient. Son regard, sa pensée, son attente n’avaient qu’un objet : l’ombre ; elle approchait de la limite sacrée, du ruisseau, et cette limite devait marquer aussi la fin de ses émotions passionnées et douloureuses, de ces minutes longues comme des siècles. L’ombre recula jusqu’au ruisseau et laissa l’autre moitié de la rue baignée de lumière : alors seulement il parut à Kandov que le soleil se levait. À pas rapides, il se dirigea vers la porte de grand-mère Lilovitsa. Il fixait cette porte de chêne, basse, ferrée de clous à grosses têtes aplaties et rouillées, fendue, vétuste. Il savait le nombre de clous, il savait le nombre des raies et des fentes et comment, en s’ouvrant, la porte grinçait, tel un chien grognon : elle était comme un être vivant, ayant des yeux, des oreilles et une voix... De quel doux écho faisait-elle résonner son cœur chaque fois qu’elle s’ouvrait devant lui ! De quel son, lugubre comme un glas funèbre, transperçait-elle son âme chaque fois qu’à sa sortie elle se refermait !
Elle s’ouvrit tout d’un coup. Un Bulgare, un homme du peuple, en potouri 116, coiffé d’un chapeau, sortait. Kandov voulût l’arrêter et s’enquérir de Rada mais il se sentit gêné. Il examina cet homme avec émotion et même avec une certaine jalousie, et il continua son va-et-vient. Un certain temps passa. La porte s’ouvrit de nouveau et le cœur de Kandov se mit à battre à coups précipités.
Grand-mère Lilovitsa et Rada apparaissaient. Elles se dirigeaient à pas pressés vers le haut de la rue. À cet instant seulement Kandov entendit le tintement de la simandre 117. « C’est probablement quelque fête, pensa-t-il, elles vont ensemble à l’église. » Il s’arrêta, figé, continuant à suivre du regard la jeune fille qui s’éloignait. Elle ne l’avait pas aperçu car elle avait en sortant gardé les yeux constamment baissés. Il remarqua qu’elle avait mis sa nouvelle robe noire. Elle ne portait plus son tablier d’indienne grise à petits pois blancs. Qu’il était rose ce visage, empreint toutefois d’une certaine sévérité – et si séduisant !
L’étudiant attendit longtemps. Une heure, deux heures passèrent. Avec indignation il écoutait la simandre qui tantôt se taisait et tantôt retentissait ; ce son sec, sonore, insolent, agissait sur ses nerfs jusqu’à l’exaspération et le jetait dans le désespoir.
« Quelle diable de fête est-ce donc ? se répétait-il avec rage. Où est-elle allée avec cette horrible vieille ? Qu’est-ce que cette stupide simandre ? Qu’est-ce que ces éternelles fêtes ? Comme si les gens n’avaient pas d’autres soucis ! Quel besoin ai-je de cette fête, de la fête de ces adorateurs d’idoles ! »
Ces exclamations s’échappaient de ses lèvres, tandis qu’il continuait à surveiller la rue. Rada n’apparaissait pas.
Le soleil avait depuis longtemps franchi le ruisseau et conquis l’autre moitié de la rue, il avait grimpé tout le haut du mur de la maison de la vieille Lilovitsa. Des passants allaient et venaient : ni Rada, ni la vieille n’étaient parmi eux. Et la simandre continuait à retentir.
« Qu’est-ce que c’est que cette fête impie ? » éclata de nouveau l’étudiant avec méchanceté.
Il ne désirait d’ailleurs pas le savoir. Le premier venu qu’il aurait interrogé le lui aurait appris. Que lui importait ! Il y avait belle lurette qu’il ne savait plus les dates et ne remarquait pas le temps qu’il faisait. Le printemps était en plein épanouissement, il ne le voyait pas. À quoi bon ce printemps, si insolemment beau, si perfidement séduisant, quand son cœur bouillonnait d’un tel océan de douleur ! La nature lui paraissait même avoir un air impudent, comme si elle se moquait de lui. Avec dégoût il cracha... sur la nature, sans doute.
Mais bientôt son exclamation impatiente reçut une réponse.
20 LA PERPLEXITÉ DE KANDOV AUGMENTE
Un chant aigu et monotone de voix enfantines vernait de la rue opposée. Se détachant du chœur une voix plus haute et moins jeune psalmodiait un chant d’église, l’étrange concert devenait plus distinct et s’approchait. Soudain une procession d’enfants portant des bannières et de grands cierges blancs enrubannés de noir surgit, puis vinrent un autre groupe d’enfants et, avec eux, le chantre Merdévendjiev ; les popes en chasubles suivaient, l’air se remplit d’une odeur d’encens : le convoi funèbre de Lalka apparut.
La pauvre martyre avait expiré cette nuit même.
La ville presque entière accompagnait ses restes. La mort de cette femme, fauchée en pleine jeunesse, avait attristé tous les cœurs. Chacun voulait dire adieu à la défunte et lui rendre les ultimes honneurs en l’accompagnant dans son dernier voyage. Ce pieux hommage ne fut empêché ni par l’antipathie qu’inspirait son père, ni par la haine que suscitait son mari. Lalka avait été très aimée, elle avait été douce et bonne, et maintenant son image chassait des cœurs toute animosité. L’affluence à ces funérailles (le père, accablé par la douleur, n’avait pas épargné l’argent afin de les faire riches et solennelles) était donc très grande, ceci les rendait encore plus solennelles et émouvantes. Mais ce qui avait le plus contribué à attirer la foule était ce qu’on avait su de la cause de la maladie et de la mort de Lalka, ce que sa sœur n’avait pu taire – Lalka, mourante, avait tout confié à Guinka. La mort de la malheureuse amenait les larmes aux yeux de toutes les femmes et même de quelques hommes complètement étrangers à sa famille. Tous les jeunes gens étaient accourus et l’on remarquait à leur tête les membres du comité profondément émus et affligés. C’étaient eux qui portaient le cercueil.
Quand le convoi arriva sur la place où Kandov était planté comme un pieu, ils posèrent le cercueil à terre pour qu’une nouvelle prière fût dite. C’est alors que, dans ce cercueil, Kandov reconnut Lalka.
Elle gisait, ses longues paupières bien closes, semblant dormir. De la blancheur de son visage de marbre se distinguait à peine le coussin de duvet où s’enfonçait sa tête ; son petit corps disparaissait sous la masse de couronnes et de bouquets de fleurs printanières, présents d’adieu de jeunes femmes et de nouvelles mariées. Près des deux épaules gisaient des bouquets de roses blanches rares, qu’elle avait plantées de ses propres mains ; il y en avait aussi dans ses cheveux. Ses mains, blanches et délicates comme celle des Grâces et qui semblaient aussi taillées dans le marbre, étaient croisées sur sa robe de mariée ; une icône – l’Assomption de la Vierge – était posée sur sa pauvre poitrine. Un parfum capiteux, fait de l’arôme de fleurs mêlé à celui de l’encens de Smyrne, remplissait l’air et étourdissait les sens.
On avait à peine posé le cercueil à terre, que la mère, poussant un cri déchirant, se jeta comme une insensée sur le corps de sa fille, l’étreignit de ses deux bras, enfouit son visage dans les fleurs et les parures. Sourdes, entrecoupées, follement passionnées s’égrenèrent les paroles qu’arrachent aux mères l’amour et le désespoir, ces paroles qui, telles des aiguilles de glace, vous transpercent et vous font dresser les cheveux sur la tête. Chaque mot est un lambeau du cœur, chaque cri un océan de douleur inapaisable. Les pleurs et les lamentations reprenaient alentour ; parents et étrangers, les visages ruisselants de larmes, pressaient leurs mouchoirs sur leurs lèvres pour ne pas crier. Guinka, très belle dans ses vêtements de deuil, sanglotait éperdument ; son père, écrasé de chagrin, soutenu par deux hommes, branlait sa tête blanchie. Steftchov, tête nue, le mouchoir sur les yeux, restait debout près de la bière, les yeux secs ; son visage, rougeâtre et terne à l’ordinaire, était devenu tout pâle ; il jetait çà et là les regards ahuris d’un homme qui ne voit rien... Non loin de lui s’élevait au-dessus de la foule la tête blonde de Sokolov ; ses yeux étaient rivés au visage de la morte ; du regard il s’emparait, s’abreuvait à souhait de l’image de la malheureuse femme qu’il avait passionnément aimée et dont il avait été aimé. Combien ils auraient pu être heureux, hélas ! si le destin... Le destin !... Tout d’un coup, il aperçut à ses côtés Steftchov. Leurs regards se rencontrèrent, et Sokolov, foudroyant des yeux le mari, lui dit à haute voix :
– Monsieur, votre lâcheté a tué cette femme ! Vous en rendrez compte à moi d’abord et ensuite à Dieu !
La prière était achevée. La voix de la mère déchira l’air de nouveau. La bière fut soulevée et le convoi repartit. Kandov se joignit presque machinalement à la foule. Son visage gardait le même calme ; le spectacle émouvant auquel il assistait ne parvenait pas à le toucher. Au contraire, une certaine satisfaction farouche éclairait ses traits : il avait compris que Rada, amie de Lalka, devait être ici, donc, il allait la voir. C’était là la seule pensée qu’avait pu éveiller en lui l’interminable et lugubre procession funèbre. Des yeux il chercha Rada dans la foule des femmes mais ne la vit pas. Son regard s’attachait à chaque vêtement noir, à chaque joli visage. Aucune trace de Rada... Il resta un peu en arrière pour laisser passer devant lui les femmes du cortège ; mais en vain son regard d’épervier fondait-il, fouillant la multitude mouvante qui, devant lui, coulait comme un fleuve. Soudain il aperçut grand-mère Lilovitsa et à ses côtés il chercha Rada. Elle n’y était pas ! Son cœur saigna. Comment Rada pouvait-elle ne pas assister à l’enterrement de Lalka, son amie ? Impossible ! impossible ! Et il se démena de nouveau dans la cohue, la cherchant et ne la trouvant pas. Comment ? Était-il possible que Rada ne fût pas ici ? Où était-elle ? Elle était sortie avec grand-mère Lilovitsa ; où donc la vieille avait-elle pu la laisser seule en pareil moment ? Qu’avait donc Rada de plus important à faire que d’accompagner son amie la plus chère jusqu’à sa dernière demeure ? Mais n’était-elle pas ici sans qu’il pût la voir de ses yeux qui se troublaient ? Pourtant, il avait vu la vieille femme ! Aller l’interroger ? folie ! ce serait inconvenant. Le malheureux étudiant ne se rendait pas compte que ses regards inquisiteurs et son va-et-vient dans la triste procession étaient par eux-mêmes fort inconvenants et attiraient l’attention.
Le convoi s’engageait dans une rue étroite ; soudain de la rue opposée parvinrent le son aigu d’une clarinette et le roulement d’une grosse caisse : un joyeux horo 118 berçait sa ronde insouciante. Cette gaieté sembla horrible, sacrilège, à côté de tant de douleur. L’indignation et la colère se peignirent sur beaucoup de visage. Puis, brusquement, la musique se tut et, comme touché par une baguette magique, le horo se dispersa. Seul, dans le silence rétabli, s’élevait le chant funèbre des enfants dirigé par Merdévendjiev. Resté en arrière, Kandov entendit des pas bruyants et se retourna, et il vit le Rédacteur avec quelques autres personnes qui avaient quitté le horo pour se joindre au cortège. Le Rédacteur étai ivre, son fez était rejeté en arrière, son visage était bouleversé. Lui et ses camarades se hâtaient pour rattraper la queue du cortège. Et Bezportev, tout en marchant, parlait d’une voix avinée :
– Venez donc, ne soyez pas des ânes, allons baiser sa main. Et disons-lui : « Adieu, sœur ! Que le Ciel soit ton royaume ! Car qui meurt pour son peuple est immortel ! Comprenez-vous, espèces d’oies ? Si vous êtes ivres ne le montrez pas du moins. Et quand je vous dis : bas les caboches, inclinez-vous ! Celle-ci est une âme sainte ! Dites-moi, combien y en a-t-il de pareilles en ce monde ? Quant aux traîtres, il y en a autant que de grains de sable dans la mer... mais vous n’avez jamais vu de mer ! aussi ne soyez pas des ânes, et faites ce qu’on vous dit.
Le Rédacteur avait à peine fini sa tirade qu’il aperçu Ratchko ; celui-ci passait en courant près de lui, portant un objet destiné à l’église.
Il lui cria impérieusement :
– Hé là ! Attends que je te demande quelque chose ! Voilà ! c’est celui-là l’espion de Steftchov ! Mort à ces païens ! ajouta-t-il en s’adressant à ses camarades.
Ratchko vit le visage furieux du Rédacteur et s’enfuit à toutes jambes par une autre rue.
– Attrapez-le ! Demandons-lui de quel droit il empeste de son nom la rue tout entière ! cria Bezportev, et tous se mirent à la poursuite du malheureux Ratchko. Celui-ci, léger, menu et volant comme une plume, prit rapidement assez d’avance sur ses poursuivants ivrognes. Bientôt tous disparurent au tournant de la rue...
Kandov vit la scène d’un œil indifférent, l’esprit ailleurs. Baissant la tête, il continua à suivre machinalement le cortège et, entraîné par lui, il s’engouffra dans l’église.
21 LE SERVICE FUNÈBRE
La foule qui, de rue en rue, avait grossi comme un torrent, remplit littéralement le sanctuaire. La bière, posée face au trône épiscopal sur une dalle de marbre quadrangulaire où était gravé un aigle bicéphale, était le centre autour duquel tous se pressaient, le cierge allumé à la main.
Les prières pour le repos de l’âme commencèrent solennellement : les volutes bleues de l’encens s’élevaient vers la voûte et les grands chandeliers brûlaient devant l’autel ; tous lustres également allumés, l’église resplendit de lumière. Cet éclat devait apporter quelque petite consolation à la famille de Lalka...
Dans le même dessein, l’instituteur Klimeinte fut prié de prononcer une oraison funèbre. Théologien, il possédait aussi l’art oratoire et se servait surtout de citations tirées de l’Écriture ; mais, souffrant ce jour-là, il se récusa. Or invita alors Frangov. Après avoir un peu hésité, celui ci accepta et monta sur la deuxième marche du trône épiscopal. Les popes suspendirent leurs chants, le silence se fit.
L’instituteur, très ému, le regard fixé sur la défunte, commença d’une voix forte mais tremblante :
– Frères et sœurs !...
Mais il fut aussitôt obligé de s’interrompre. Quelque chose d’insolite se passait près de la porte où la foule s’agita ; un murmure confus courut, des voix effrayées s’élevèrent, le trouble se transmit jusqu’aux premiers rangs, devant le cercueil, où se produisit un terrible remous.
– Ils viennent ! criaient les uns.
– Oh ! Bonne Mère ! ils viennent, criaient, perçant l’air, les femmes.
– Qui donc ? firent quelques voix d’hommes.
– Les Turcs ! Les Turcs !
Ce fut la panique ; cris aigus, lamentations, vociférations remplirent la demeure du Seigneur. Les gens couraient de-ci et de-là, troupeau épouvanté qui ne savait où se réfugier. Un groupe se forma autour du tchorbadji Iordan et de Steftchov : leur influence sur les Turcs étant considérable, on pensait pouvoir trouver protection et être épargné en même temps qu’eux. Mais la plupart des assistants, en proie à une peur insensée, traversaient en tous sens l’église, fuyaient, revenaient, criaient. Les jeunes femmes poussaient des cris perçants et tombaient évanouies sans que personne les secourût ; quelques vieilles s’effondrèrent sur les marches de l’autel et furent piétinées. La folle terreur marquait les visages ; beaucoup étaient plus blancs que celui de Lalka.
Kandov, seul, restait indifférent à tout ce qui se passait autour de lui ; les mains jointes, immobile près du cercueil, il regardait tristement la défunte.
À ce moment, dans la galerie retentit la voix de Sokolov :
– Rassurez-vous ! Il n’y a rien !
Dès le commencement de la panique, il était monté à cette galerie pour voir de la fenêtre haute ce qui se passait hors de l’église, sur la place. Il n’avait rien vu d’inquiétant. De Turcs point ; seulement le Rédacteur et ses camarades qui entraient sous le porche. Il s’était époumoné à crier là-haut, mais sa voix se perdait dans la rumeur générale.
D’autres voix se firent entendre :
– Tenez-vous donc tranquilles, voyons, il n’y a rien !
– Qui est l’idiot qui nous a fait si peur ? se demandait-on.
– Se moque-t-on de nous ?
À ce moment le Rédacteur et ses compagnons, haletants, passèrent le seuil et commencèrent à se signer. Ils ne se doutaient pas qu’ils avaient été la cause de la panique : Ratchko, fuyant devant ses poursuivants, s’était jeté, éperdu, dans l’église et, interrogé par des vieilles femmes sur la cause de sa précipitation, avait répondu :
– Ils viennent !
– Qui vient ?
– Le kapassaz 119 et les autres, beaucoup, beaucoup...
On avait compris : « les kapassaz, beaucoup, beaucoup... »
Il n’en avait pas fallu davantage à des gens qui, depuis un mois, vivaient dans la terreur d’un massacre turc !
22 LA PHILOSOPHIE ET LES DEUX MOINEAUX
Sans attendre la fin du service funèbre, Kandov regagna la rue. Chose étrange ! Il sortait de l’église un leu réconforté. La vue de la mort ne manque jamais d’apaiser les troubles de l’âme ; si liée qu’elle soit aux choses terrestres, le spectacle de la fragilité humaine affaiblit les attaches qui l’enchaînent aux choses de ce monde. En face de l’éternité, les soucis, les amitiés ardentes, les passions, les aspirations pâlissent et s’évanouissent comme de ridicules fantômes.
« La voilà morte, cette Lalka, aujourd’hui dépouille mortelle, demain poussière. Qu’elle était donc effroyablement pâle ! Elle est morte, morte ! Et Rada n’était pas là ! Mais quoi, Rada ? C’est curieux comme je suis aveuglé par cette fille : qui m’observerait dirait que je suis fou. Peut-être suis-je fou, en effet ? Et pourquoi ? pour elle évidemment. Mais que représente-t-elle ? pourquoi ces tourments sans fin, pourquoi ces longues insomnies, oui, pourquoi tout cela ? Pour une femme, pour une autre Lalka qui demain se transformera en dépouille mortelle, en poussière. Il serait intéressant de savoir si je l’aurais aimée encore, la voyant portée ainsi dans un cercueil au cimetière, pour nourrir les vers. Quelle bêtise ! quelle sottise ! Vraiment, qu’est-ce, en réalité, que cette Rada, ce quelque chose, ce rien, ce néant qui remplit tout mon être, tout mon univers, le paradis et l’enfer ? Qu’est-elle ? un squelette revêtu de substance sanguine, un amas d’os, de chair, de sang, de tendons, de fibres, de nerfs, de vaisseaux, de glandes, de tissus, de cartilages, d’ordure, qui s’appelle Rada et qui, demain, deviendra pourriture et poussière. Et j’aime tout cela ! Et je me perds pour cela ! Mon esprit tout-puissant, ma raison divine, ma pensée infinie se sont agrippés à ce périssable et stupide lambeau, se sont suspendus à cette toile d’araignée ! C’est affreux, insensé. Comment n’avoir pas recouvré ma raison plus tôt ; comment ne pas m’être dit : « Mon vieux Kandov, tu as une mission plus élevée à remplir que de gémir après une jupe. » De si vastes horizons se découvrent devant moi ; deux mondes, merveilleux, sublimes, s’ouvrent pour moi : la science, la patrie ! Et je ne les aperçois pas, ne voyant que ce pauvre être dont auparavant je ne soupçonnais même pas l’existence et qui, à son tour, ignore pourquoi il existe. C’est honteux, honteux, honteux ! Il m’a fallu voir Lalka pour saisir à quel néant s’était attachée mon âme, mais comme un aigle, maintenant celle-ci s’éveille, bat des ailes, les déploie et s’élève, libre, hardie, dans l’espace infini. Que je suis heureux ! »
Et Kandov poursuivit sa route, plongé dans ces réflexions vivifiantes. Il sentait glisser de ses épaules le poids qui l’accablait. Il souriait victorieusement et, en souriant, il s’étonnait de voir la lutte qui avait bouleversé son âme se terminer si pitoyablement, si petitement. Il avait rejeté Rada de son cœur comme on lance par la fenêtre le tesson inutile d’une écuelle brisée. Dans un espace brumeux et illimité l’image de Rada apparaissait très lointaine, pâle, irréelle comme une de ces figures de rêve que dissipe un brusque réveil. Kandov se sentait renaître ; le voile était tombé à ses yeux, il voyait tout, reconnaissait tout, s’intéressait à ce qui l’entourait, prenait part aux plus menues manifestations de la vie. Il salua plus affablement qu’il ne l’avait jamais fait les personnes de connaissance qu’il rencontrait, parla avec Pavlaki Nedev de son essence de roses, lui demanda le prix de l’année passée et combien de mouskals 120 il estimait pouvoir obtenir cette année-ci. Enfin il s’arrêta à une épicerie, acheta une oka 121 de cerises et, joyeux, se dirigea vers sa maison.
Kandov était très gai, comme s’il revenait d’une noce et non d’un enterrement. Le long d’un mur de jardin une pluie de pétales blancs, semblables à des perles, se déversa sur lui. Il leva les yeux et vit que c’étaient les fleurs d’un prunier dont les branches ployaient au-dessus de la rue. Les pétales tombaient d’un rameau sur lequel deux moineaux sautillaient et se becquetaient...
Il resta pétrifié. À la vue de cette scène d’amour, toute son éloquence et toute sa philosophie s’envolèrent comme fumée au vent. Il secoua le mouchoir contenant les cerises, se débarrassa d’elles, se prit le front, resta longtemps ainsi.
« Tu es malade, Kandov ! se dit-il avec désespoir. Tu es malade, mon ami ; cherche un remède pour ta pauvre tête, mon vieux Werther ! »
Et il continua à marcher machinalement.
« Oui, un remède radical ! se répétait-il. Mais lequel ? Si c’était une maladie physique ! Mais cette plaie est dans l’âme. On ne peut la cautériser au fer rouge. Que faire ? consulter le médecin de Plovdiv ? Les médecins ne soignent pas seulement les infirmités du corps mais aussi celles de l’âme. C’est clair comme le jour. Dommage qu’il n’y ait pas ici des psychiatres spécialistes, car je suis fou, réellement fou. N’importe, allons chez celui-là. Qui sait, peut-être me donnera-t-il un conseil efficace. Oui, profitons de l’occasion. Je n’y perds rien ? Mais il y a une autre difficulté : se confesser au médecin, s’exposer au ridicule. Non, c’est impossible... Cherchons un autre moyen. »
Pourtant il se dirigea vers la maison où était descendu le médecin.
23 REMÈDE
Arrivé à la porte de cette maison, Kandov essuya son visage ruisselant de sueur et frappa.
– Entrez 122 ! cria-t-on de l’intérieur.
Il entra. Le médecin était devant lui, un homme d’environ quarante ans, frêle quoique de haute stature, au visage allongé, maigre et pâle, encadré de favoris clairsemés, au regard ironique. En bras de chemise, il rangeait ses vêtements dans une valise ; selon toute évidence, il était sur le point de partir : ayant expédié Lalka, il n’avait plus rien à faire ici.
Kandov se nomma.
– Asseyez-vous, monsieur, lui dit poliment le médecin. Il y a un peu de désordre, vous voudrez bien m’en excuser.
L’accueil courtois encouragea l’étudiant :
– Je vous demande pardon de vous déranger, monsieur le docteur, mais je ne resterai que quelques minutes.
– Bah ! un médecin n’est jamais dérangé par la visite de patients car, sans malades, il ne saurait être gai, comme le malade ne saurait l’être sans santé.
Après cette plaisanterie cynique, il jeta un regard scrutateur sur le visage hâve et mélancolique de son visiteur.
– Comment vous portez-vous ?
– Merci, je suis en bonne santé, répondit l’étudiant avec un sourire forcé ; je suis venu vous demander conseil pour quelqu’un d’autre.
– Est-il d’ici ?
– Oui d’ici, mais...
– Pourquoi ne l’avez-vous pas amené ? Voyez, je dispose de peu de temps.
Kandov se troubla :
– Comment vous dire, docteur, je suis plutôt venu vous demander votre avis au sujet d’un travail littéraire...
Le médecin le regarda avec étonnement.
– Vous pourriez m’éclairer sur une question psychologique qui m’embarrasse beaucoup. Cette question est du domaine de la médecine.
Le médecin attendit, l’air interrogatif.
– J’écris un roman, dit Kandov en appuyant sur chaque mot.
– Comment, vous êtes écrivain ?
– Non, j’essaie. J’ai commencé un roman. Le héros est amoureux, follement, désespérément amoureux d’une personne aimée d’un autre et qui l’aime à son tour ; cette passion l’amènera au suicide.
– Il y a une nouvelle allemande que j’ai lue autrefois à Vienne, dit le médecin en se grattant derrière l’oreille comme pour réveiller ses souvenirs, on y parlait d’un pareil amour...
– Werther, de Goethe ? demanda vivement l’étudiant.
– Oui, le roman de Goethe, confirma le médecin ; Werther se suicide, n’est-ce pas ?
– Oui, mais moi je veux sauver mon héros...
– Tuez-le ; ça vaudra mieux ; mettez-y un point et qu’il ne se tourmente plus. Faites ce que nous autres médecins nous faisons de nos malades. C’est le mieux.
Le médecin accompagna ses paroles d’un nouveau sourire cynique qui trahissait le manque de cœur des médecins ; pour eux le spectacle des souffrances et de la mort des patients n’est plus qu’une question d’habitude.
Kandov pâlit :
– Mais ce sera un mauvais exemple pour les lecteurs. Le suicide est, lui aussi, contagieux.
– De quelle nationalité est votre héros ?
– C’est un Bulgare.
– Un Bulgare ? Il me semble que les Bulgares n’ont pas d’amours tragiques. Leurs cœurs sont gainés de peau de buffle. Savez-vous ce qu’est « l’amour noir ? » l’amour désespéré 123 ?
– Oui, l’amour désespéré, fit sourdement l’étudiant.
– Cependant, autant que je sache, il n’y a pas de Bulgare qui soit mort d’amour. Un jeune homme s’est pendu il n’y a pas longtemps, mais parce que son juif ayant fait faillite, il avait perdu de l’argent...
– Mon héros, comme je vous l’ai dit, monsieur le docteur...
– Oui, une exception, je comprends, interrompit le médecin, mais puisqu’il est Bulgare, nous ne devons pas le faire se suicider, ce ne serait pas vraisemblable. Il doit souffrir, il faut qu’il souffre.
Et de nouveau sur les lèvres du médecin apparut ce désagréable sourire. Il regarda sa montre. De toute évidence, il était pressé. Kandov remarqua son impatience et dit, en hâte :
– C’est justement pour cela que je vous demande votre conseil, monsieur le docteur. Le développement ultérieur de mon roman exige que mon héros vive pour accomplir de grandes choses. Mais, pour cela, je dois d’abord le guérir de cette terrible passion qui le paralyse, qui le tue. Comment cela peut-il se faire de la façon la plus naturelle, la plus vraisemblable ?
Le médecin fixait Kandov avec attention et curiosité. C’était la première fois, depuis qu’il pratiquait la médecine, qu’une pareille consultation lui était demandée. Il s’efforçait de lire dans les yeux et sur le visage de son visiteur, cherchant à découvrir un autre sens à ses paroles. Ce regard troubla l’étudiant et une rougeur inopportune envahit son visage hâlé. Le sourire ironique qui se montra sur les lèvres minces et exsangues du médecin augmenta encore sa confusion.
– J’ai compris, j’ai compris, vous cherchez un remède contre l’une des gales psychiques les plus tenaces.
– C’est cela.
– Ces remèdes existent mais, malheureusement, leur efficacité n’est pas aussi complète que celle de la quinine contre la fièvre, monsieur Kandov.
Et de nouveau le médecin le scruta du regard.
– Indiquez-moi les plus efficaces, monsieur le docteur.
– Avant tout, je vous recommanderais un remède de bonne femme : cherchez l’herbe que les bonnes femmes appellent « l’herbe de la haine » (j’ai oublié son nom latin), faites-la bouillir dans un pot la veille d’un samedi et aspergez de cette décoction votre héros pendant son sommeil. Aussitôt, il prendra en haine sa bien-aimée.
Et le médecin éclata de rire.
Kandov fronça le sourcil :
– Vous ne parlez pas sérieusement, monsieur le docteur.
– Vous refusez ce remède ? continua le médecin en riant. Alors je vous conseillerai de l’envoyer boire de l’eau de Léthé et il oubliera. Vous savez ce qu’est le fleuve Léthé ?...
À cette question, dont l’insolence venait mettre un comble aux railleries du médecin, le sang afflua aux joues de Kandov.
– Malheureusement, le Léthé est depuis longtemps desséché, ajouta le médecin.
Kandov se prépara à partir.
Le docteur fit un signe de la main puis prit un air sérieux :
– Eh bien écoutez ! pour que votre bonhomme se détache de celle qu’il aime, faites-le tomber amoureux d’une autre, et cela tout aussi aveuglément et passionnément...
Kandov secoua la tête :
– Ce serait remplacer le diable par le démon.
– C’est vrai, c’est vrai, dit en riant le médecin. Il y a encore un autre remède : faites-le sombrer dans une vie de débauche, qu’il noie son âme et ses sentiments dans l’ivresse de la volupté. Qu’il s’abrutisse, mais qu’il oublie.
Le visage de Kandov exprima le plus profond dégoût :
– J’ai besoin de mon héros pour lui faire accomplir plus tard de grands exploits. D’ailleurs, c’est une nature noble, incapable de s’abrutir.
– Alors c’est une autre chose. Du moment que votre héros est un monsieur si délicat, il ne reste plus qu’un seul remède, mais ce n’est qu’un palliatif. Vous savez ce que c’est qu’un palliatif ?
L’étudiant, de nouveau assombri, fit « oui » de la tête.
– Éloignez Sa Grâce de sa bien-aimée, envoyez-le se promener une année ou deux quelque part, très loin. Qu’il aille, par exemple, au Brésil, ou qu’il navigue sur l’océan Glacial, qu’il y reste dans les glaces pendant neuf mois avec, pour toute nourriture, de la graisse de baleine. Ou encore, si vous craignez qu’il prenne froid et attrape le scorbut, expédiez-le dans le désert du Sahara se faire élire roi par quelque tribu noire entièrement soumise à son pouvoir.
Après cet exposé qu’il assaisonna encore d’autres sarcasmes, le médecin se leva, Kandov aussi :
– Je vous remercie, monsieur le docteur, je profiterai de vos conseils.
Il tendit la main et prit congé.
– J’en suis ravi. Adieu. Je souhaite bonne santé et longue vie à votre malade ainsi qu’à vous-même.
Mais, comme Kandov atteignit la porte, le médecin lui dit gravement :
– Monsieur, veuillez payer la consultation. Nous autres médecins, nous vivons de cela.
Kandov le regarda, ébahi, puis il fouilla dans son gilet et en sortit un rouble qu’il posa sur la chaise. Après quoi il sortit en toute hâte.
« Cette tête fêlée, se disait le médecin en rangeant soigneusement le rouble dans son porte-monnaie, cette tête fêlée voulait m’en faire accroire... Dès les premiers mots j’ai compris qu’il demandait un remède pour lui-même. Je parie qu’il est amoureux comme une mésange et songe au nœud coulant d’une corde. Dumstein 124 ! »
Et il se remit au rangement de sa valise.
« Ce bouffon, pensait Kandov, en se retrouvant dans la rue, a dit une seule chose sensée parmi tant de fadaises ; il a raison : seule la séparation, seul l’éloignement me sauveront. Je dois trouver d’autres cieux, un autre coin de la terre où rien, rien ne me fera souvenir d’elle. Oui, je me rappelle maintenant que, dans des cas semblables, on recommande l’éloignement, la fuite ! Voilà qui va me conduire aux rives de ce fleuve dont parlait ce phraseur viennois. « Fuis, fuis, Kandov ! À Moscou ! À Moscou ! »
Et Kandov illuminé par cette idée, enthousiasmé par cette décision salutaire, se mit à fredonner le refrain de la chanson populaire russe :
Ah ! Moscou, Moscou, Moscou !
À la tête dorée !
Ah ! Moscou, Moscou, Moscou !
À la tête dorée !
De pierres blanches bâtie...
Il arriva rapidement chez lui, dit à tous que dès le lendemain il s’en allait à Moscou poursuivre ses études, et se mit en devoir d’emballer ses affaires, avec une hâte fébrile.
Le soir même, il remplit sa valise jusqu’à la faire craquer ; il fit en outre un petit ballot et, comme il n’avait pas fermé l’œil plusieurs nuits de suite, il dormit cette nuit-là profondément et d’un trait.
À l’aube il se réveilla frais et dispos. Pour éviter de songer à Rada, il s’efforça de penser à son voyage et à la nouvelle vie qu’il allait mener là-bas, dans la ville bâtie de pierres blanches. Plein d’enthousiasme, il fredonnait :
Loin de toi je suis en détresse, ma patrie,
Oh, Moscou ! À la tête dorée,
Au bois qui brillent de l’or des clochers ;
Oh, Moscou ! gloire de toutes les Russies...
On lui amena le cheval qu’il devait monter pour traverser le Balkan. « À Moscou ! À Moscou ! » répétait-il encore en fourrant dans sa valise des livres oubliés. Mais, courbé près de la fenêtre et jetant un regard distrait dans la rue, il vit grand-mère Lilovitsa avec une autre vieille femme. Il tressaillit puis, d’instinct, prêta l’oreille à ce que les deux femmes disaient :
– Ainsi, Lilovitsa, te voilà de nouveau seule ?
– Eh ! que faire ! Hier Rada m’a quittée. Elle est partie pour Klissoura. Mon cœur se déchirait en la voyant partir si soucieuse. Que Dieu lui vienne en aide !
Kandov resta sidéré. Une heure plus tard il partait. Il partait pour Klissoura !
Ce même jour, Nikolaï Nedkovitch et Frangov, étonnés de l’étrange changement qu’ils avaient remarqué chez l’étudiant, allèrent lui faire visite, mais ils apprirent qu’il était parti pour Klissoura « faire un tour chez des parents ».
Le désordre régnait dans sa chambre : la valise bâillait, les vêtements étaient jetés ci et là. Sur la table se trouvait une pile de livres russes. En lisant les titres, les visiteurs virent que c’étaient des publications socialistes ou anarchistes éditées à Londres et à Genève. Mais le volume au-dessus de la pile était un roman : Crime et Châtiment de Dostoïevski. Un autre roman avait été laissé entrouvert sur la table : Les Souffrances du jeune Werther 125, des lignes, des pages entières marquées au crayon rouge. Ces lectures laissaient deviner les chimères qu’avait poursuivies Kandov dans le triste désert de son égarement ; oui, et il y avait encore, entrouverte, la lettre adressée à Rada.
Tout devint clair pour les visiteurs. Par délicatesse et afin qu’elle ne tombât entre des mains étrangères et indiscrètes, Nedkovitch glissa la lettre dans son portefeuille.
24 BOURRASQUE AVANT L’ORAGE
Le départ de Rada pour Klissoura avait été brusque et inattendu. Ce même matin où Kandov faisait les cent pas devant sa porte, un Klissourien digne de toute confiance, qui rentrait en charrette de K..., était venu lui dire qu’à la prière de Boïtcho il était prêt à la ramener à Klissoura. Dès qu’elle eut reçu cette nouvelle à laquelle, d’ailleurs, se raccrochait son espoir, elle se hâta d’aller donner le dernier baiser à son amie Lalka, morte cette nuit-là, et de lui faire, les larmes aux yeux, son adieu suprême. La famille de Lalka lui avait depuis longtemps fermé sa porte. Toutefois, sa présence auprès de la morte ne surprit ni n’indigna personne. Avoir été une amie de Lalka justifiait suffisamment cette présence et nul ne croyait avoir le droit de priver une défunte de ces ultimes adieux car, au souffle de la mort, les portes s’ouvrent d’elles-mêmes. Au seuil de l’Éternité le même accueil est réservé aux grands de ce monde et aux humbles, aux amis et aux ennemis... Émus, les proches parents lui firent place. Rada s’agenouilla et lorsque, couvrant le front de la défunte de larmes et de baisers, elle l’étreignit en criant : « Lalka, ma petite sœur, qu’as-tu fait ? » les sanglots, jusqu’alors étouffés, s’élevèrent de tous côtés. On souleva Rada, défaillante, on l’emmena.
À Klissoura, Rada s’installa chez Mme Mouratliiska, établie depuis peu dans cette bourgade et qui, à la requête d’Ognianov, avait accueilli de bon cœur la jeune fille sans abri.
Les fenêtres de la maison ouvraient au nord sur le panorama de Klissoura et de sa vallée dominée par le vieux Balkan. Du gigantesque pic de Ribaritsa, appelé ici Végène, et qui portait encore sa couronne d’hiver, se précipitaient ses contreforts abrupts au pied desquels s’abritait le bourg. Çà et là, accrochés aux flancs verts de la montagne, rampaient les troupeaux des nomades valaques, dont les fromageries se peignaient en rouge. Les hautes falaises déchiquetées et les côtes friables, tantôt arides, tantôt couvertes de vignobles et de roseraies entouraient la ville à l’est. Un sentier sinueux montait au sommet et menait de là au ravin suivant, le Zli-Dol 126, où débouche la route menant à la vallée de la Stréma. D’autre part aussi, des collines enfermaient la ville ; elle était nichée au creux d’un vallon profond, enfouie dans la verdure, les arbres fruitiers et les roseraies qui remplissaient l’air de leur arome capiteux. Klissoura, privée d’horizon, triste et isolée en hiver, était à présent un coin délicieux plein d’ombre, de fraîcheur et de parfums.
Kandov était arrivé la veille, c’est-à-dire un jour après Rada. Il était descendu chez un de ses parents, en visite, disait-il : un prétexte pour être plus près de Rada.
Le jour même, il était allé chez elle. Il la trouva tout en larmes, accablée par le chagrin que lui avait causé la mort de son amie Lalka. Il eut conscience de l’inopportunité de sa visite, mais y puisa du réconfort, du bonheur même.
Le lendemain, Kandov lui fit une nouvelle visite, très matinale. Rada lui parut encore plus abattue car au chagrin de la perte de Lalka s’ajoutait l’angoisse provoquée par les rumeurs d’une insurrection imminente à Koprivchtitsa et par le manque de toute nouvelle de Boïtcho. Dans son accablement, la visite de Kandov lui fit plaisir.
– Dites-moi, monsieur Kandov, que se passe-t-il ? demanda-t-elle, inquiète.
– On parle d’insurrection, répondit Kandov d’un ton sec.
– Mon Dieu ! que vont-ils faire ? Et Boïtcho n’est pas là ! Aucun signe de vie...
Le regard distrait de Kandov s’accrochait au pic de Ribaritsa.
– Et que pensez-vous, monsieur Kandov ? demanda Rada avec impatience.
– Moi ?
– Oui.
– Au sujet de l’insurrection ?
– Oui, de l’insurrection.
Sans se retourner il dit, avec indifférence :
– Une insurrection comme une autre ! Ils se battront, se tireront des coups de fusil, s’entrégorgeront, pour libérer la Bulgarie...
– Et Klissoura ?
– Elle aussi, peut-être... d’ailleurs c’est égal...
– Comment : c’est égal ? Et vous, alors ?
– Pour moi aussi c’est égal.
Les réponses de Kandov étaient distraites, comme s’il avait été question des mœurs de la Nouvelle-Zélande. Mais cet air distrait, cette froide indifférence à l’endroit des évènements qui devaient décider du sort de la Bulgarie, cachaient un désespoir sans bornes. Seulement ni lui ni Rada n’en avaient conscience.
– Que comptez-vous faire lorsque le soulèvement deviendra général ? demanda encore Rada.
– Ce qu’il faut faire.
– Comment : ce qu’il faut faire ? Vous ne vous battrez pas ?
– Que puis-je faire, moi, Rada ? Une seule chose : mourir ! répondit sombrement Kandov.
Trois coups sourds se firent entendre à la porte.
– Boïtcho ! s’écria Rada, et elle lui ouvrit.
Boïtcho entra, déguisé en paysan, couvert de poussière, éreinté. Il revenait de Panagurichté. Il avait assisté près de Metchka à l’assemblée générale où avait été fixée la date de l’insurrection : le 1er mai. Maintenant Ognianov se hâtait d’aller à Biala-Tcherkva ; il devait, dans le peu de jours dont il disposait, veiller aux derniers préparatifs et, à la date fixée, lever à Biala-Tcherkva l’étendard de l’insurrection. Il était à Klissoura pour faire ses adieux à Rada mais, à peine arrivé à la maison qui, à l’entrée de la ville, lui servait de refuge, il y trouva une lettre de Biala-Tcherkva, et, sans avoir vu personne, se précipita chez Rada.
Il toisa d’un regard froid et méprisant Kandov, qui se tenait près de la fenêtre. Rada voulait dire sa joie mais, à la vue du visage bouleversé d’Ognianov, elle s’arrêta, stupéfaite.
– Excusez-moi d’avoir dérangé si tôt votre entretien, dit Ognianov très pâle, un sourire amer aux lèvres.
C’est alors seulement qu’il regarda Rada.
– Qu’y a-t-il, Boïtcho ? fit d’une voix étranglée celle-ci, qui s’avança vers lui.
– Assez de simagrées ! dit froidement Ognianov.
Elle eut un élan, voulut l’étreindre, mais il recula.
– Excusez-moi, mais je vous prie de m’épargner vos tendresses.
Puis, se tournant vers Kandov, il ajouta nerveusement :
– Monsieur Kandov je ne sais comment vous remercier d’être venu de Biala-Tcherkva, de si loin, pour répondre à l’invitation...
La haine étouffait sa voix.
Kandov quitta la fenêtre.
– Quelle invitation ? demanda-t-il sèchement.
– Que signifient ces paroles, Boïtcho ? demanda Rada, ébahie. M. Kandov est venu en visite chez des parents... Il...
Elle s’interrompit et fondit en larmes.
Elle pleurait d’être obligée, par suite d’un fatal concours de circonstances, de mentir pour la première fois et malgré elle. Au cours de sa brève entrevue avec Boïtcho à Biala-Tcherkva elle n’avait eu ni le temps ni même l’idée de lui parler de la façon étrange dont Kandov lui faisait la cour, façon qui paralysait sa volonté de le congédier. Maintenant Ognianov le surprenait chez elle, et de si bonne heure ! Il avait probablement eu vent de ces visites et cette maudite coïncidence venait confirmer ses soupçons avant qu’elle eût pu les dissiper.
Rada espérait être tirée de cette pénible situation par des explications qu’aurait dû donner Kandov lui-même. Mais celui-ci se taisait.
– Allons, Kandov, racontez-moi quelque chose, vous aussi, cela m’égaiera, dit Ognianov, plein de fiel, et il jeta un regard méprisant sur son rival.
– Je n’ai rien à dire, j’attends que vous parliez, répliqua l’étudiant, gardant tout son sang-froid.
– Quelles bassesses ! leur lança Ognianov, les enveloppant d’un même regard.
Kandov blêmit encore davantage. Sa fierté blessée l’arracha à sa sombre apathie.
– Ognianov ! cria-t-il.
– Crie plus fort, fais-moi peur ! fit de même Boïtcho.
Sa mâchoire tremblait de rage.
Rada se jeta sur lui, craignant sa violence.
– Mon Dieu ! Boïtcho ! Que fais-tu ? Attends que je te raconte ! répétait-elle en pleurant.
Ognianov lui décocha un regard haineux.
– Inutile, Rada, ne t’humilie pas à verser des larmes. Et moi, imbécile, qui croyais avoir trouvé la pureté même ! J’ai gaspillé tant d’amour ! J’ai jeté mon cœur au ruisseau. Quel aveuglement !
– Boïtcho ! criait désespérément Rada à travers ses sanglots.
– Assez ! Entre nous il n’y a plus rien de commun. Le voile est tombé de mes yeux. Quel égarement ! Croire que tu m’aimerais, moi, un vagabond, qu’attendent seulement le pal et la potence, alors qu’il ne manque pas de chevaliers servants gonflés de phrases ronflantes, de sages poltrons de tout repos... Mon Dieu ! que de bassesses dans ce monde !
Et il se dirigea vers la porte.
– Ognianov, retire tes paroles ! s’écria Kandov en le suivant.
Ognianov s’arrêta :
– Je te les répète : bassesses et lâchetés ! C’est un infâme abus de la confiance d’un ami. Oserais-tu nier l’évidence ? – et Ognianov enveloppa l’étudiant d’un regard enflammé.
– Retire tes paroles ou je te tue ! hurla Kandov, l’écume aux lèvres.
– La mort ? Elle ne peut faire peur qu’aux révolutionnaires qui travaillent au salut de la Bulgarie empêtrés dans les jupons des femmes.
Kandov se rua sur Ognianov, voulut le frapper à la tête. Toute sa douleur, ses longs tourments se transformèrent en un ouragan de furieuse colère contre celui qui en était la cause indirecte.
Ognianov était fort. Il repoussa Kandov jusqu’au mur puis sortit deux pistolets de sa ceinture.
– Pas comme des portefaix, prends ce pistolet, et Ognianov lui tendit l’arme.
Rada, folle de terreur et de désespoir ouvrit la fenêtre donnant sur la rue et se mit à crier pour attirer l’attention des passants.
Mais, dans la chambre entra un puissant appel : les cloches sonnaient à toute volée. Ognianov s’immobilisa, la main tenant le pistolet encore tendue vers son adversaire. Des pas rapides se firent entendre et la porte s’ouvrit avec fracas.
Des Klissouriens armés se précipitèrent dans la pièce.
– L’insurrection est proclamée ! Vive la Bulgarie ! criaient-ils.
– Où se rassemble-t-on ? demanda Ognianov d’un ton cassant.
– Aux confins de la ville, à Zli-Dol, à Présvéta. Dépêchez-vous !
Et les insurgés sortirent rapidement en criant : « Vive la Bulgarie ! » et chantant : « L’heure du combat a sonné... »
Les cloches continuaient de sonner avec rage.
Ognianov se tourna vers Kandov :
– Maintenant je vais avoir quelque peu à faire. Si j’en reviens, je te donnerai satisfaction ! Pour le moment, tiens compagnie à mademoiselle, afin qu’elle n’ait pas peur.
Et il sortit rapidement.
Rada, frappée par ce nouveau malheur, s’effondra sans connaissance sur le divan. Mme Mouratliiska, attirée par ses cris, accourut et essaya de la ranimer.
Kandov écoutait comme dans un rêve sonner les cloches. Il aperçut une lettre froissée qu’Ognianov avait laissée tomber à terre ; il se baissa, la ramassa, la lut :
« Cher petit comte ! écrivait-on. Il est bon d’avoir des amis ; Kandov, tu ne pourrais pas le payer son poids d’or ! Sache que, tant qu’il était ici, il ne lâchait pas d’une semelle Rada Gospojina, ta colombe fidèle, ton ange innocent ! ! Aujourd’hui, le petit Kandov s’en va à Klissoura ; il a reçu un billet de la petite colombe dont le cœur est serré à cause de toi et qui l’appelle, lui, pour la consoler. Je te félicite à propos de Rada et aussi de ton ami. Tu es vraiment digne d’envie ! D’ailleurs, sache aussi que ce que je te dis est « chose secrète » : sauf le pope et tout le pays, tu es le seul à n’en rien savoir. Allons, va libérer la Bulgarie ! Nous y ferons régner Rada Gospojina. »
La lettre était arrivée la veille par une voie inconnue.
Kandov déchira cette ordure, cracha dessus et sortit.
25 L’INSURRECTION
Depuis cinq jours déjà, Klissoura est en état de révolte. Tout travail est arrêté ; tout intérêt autre que l’insurrection est oublié ; une extraordinaire excitation se peint sur les visages. La ville est enthousiaste, anxieuse, hérissée, imprégnée d’ivresse révolutionnaire. Ces cinq jours ont été pour les habitants de Klissoura cinq siècles d’angoisse, d’espérance, d’enthousiasme et de désespoir.
Le 20 avril, le plénipotentiaire de Klissoura à l’assemblée générale, près de Metchka, était arrivé de Koprivchtitsa qui, ce jour-là, avait déclenché l’insurrection. Il embrassa sa famille et annonça que l’heure du soulèvement avait sonné. Les principaux conjurés se rassemblèrent rapidement à l’école, et Karadjov, après avoir chanté l’hymne révolutionnaire : « Le combat commence, nos cœurs palpitent », prononça un discours enflammé. Klissaura, avec des cris d’enthousiasme et au son des cloches, se proclama en révolte. On envoya tout de suite des lettres aux comités des autres villes du Balkan, pour les inviter à suivre l’exemple et à soutenir le soulèvement de Klissoura et de Koprivchtitsa ; on expédia des dizainiers et des capitaines de gardes, on courut prendre des armes ; on tira des coups de feu ; on poursuivit les zaptiés que les balles ne purent atteindre et qui s’enfuirent dans la montagne. Tous les hommes valides furent envoyés hors la ville, sur les hauteurs. Sur ces points stratégiques furent postés des groupes de défense de quinze à vingt personnes qui creusèrent des tranchées. Presque toute la population mâle, de dix-huit à cinquante ans, était répartie sur les positions. Personne ne pouvait rentrer en ville ; la nourriture et les objets nécessaires devaient être apportés aux hommes par les membres de leur famille. Chaque insurgé s’était armé comme il l’avait pu.
Le lendemain, alors que, dans l’église, les fidèles – les prêtres et les femmes, car les hommes étaient sur les positions – priaient à genoux pour la libération de la Bulgarie du joug turc, les notables de la ville, qui avaient embrassé avec joie le mouvement révolutionnaire, nommèrent un Conseil militaire et un commandant en chef des insurgés. À midi, le drapeau brodé du lion d’or fut solennellement porté sur la hauteur de Zli-Dol où il fut remis aux défenseurs. Le reste de la journée fut employé à la désignation des chefs des plus importants sommets fortifiés, à la répartition des munitions et des autres accessoires de combat, aux dernières dispositions pour la défense de la ville. Mais les nouvelles arrivant du dehors n’étaient pas réconfortantes : sauf la région de Sredna-Gora, aucun point ne s’était soulevé. La nuit trouva les insurgés très découragés.
Le 22 avril, les défenseurs tuèrent deux voyageurs turcs. Ainsi l’insurrection était ensanglantée ; le sort était jeté. Mais c’est en vain que, des hauteurs, les regards cherchaient quelque incendie de village turc dans la vallée de la Stréma, signal qui devait annoncer que Kablechkov avait soulevé par là les villages bulgares. Alors on chercha dans la montagne des abris et des cachettes pour les familles et on envoya chercher du secours à Koprivchtitsa.
Les insurgés virent venir l’aube, sombres et abattus. La Saint-Georges n’égaya personne et le son de la cloche qui appelait les fidèles à l’église était triste comme un glas. Soudain ce son devint plus vif, plus alerte, les visages rayonnèrent de joie. Volov 127 amenait de Koprivchtitsa un renfort de cinquante hommes, pour la plupart des paysans des villages de la Sredna-Gora et était allé droit à l’église où un Te Deum fut chanté. Les cloches retentirent encore plus solennellement. Après quoi, Volov avec son détachement et des bannières se rendit aux positions ; là il condamna à mort quelques tziganes et Turcs arrêtés comme espions ; il en tua lui-même un de son sabre. Après cette exécution, il rentra seul à Koprivchtitsa. Le reste de la journée passa aux travaux de tranchées.
Le lendemain, le découragement reprit. En vain, les sentinelles avancées passaient-elles des heures entières à chercher des yeux la trace tant désirée d’un incendie dans la vallée. L’expédition de Kablechkov avait échoué et le groupe était rentré à Koprivchtitsa. Les rares voyageurs qui avaient réussi à se frayer un chemin pendant les premiers jours de l’insurrection racontaient que tout était calme en bas et qu’il n’y avait nul indice d’insurrection prochaine. Depuis la veille, aucun voyageur. Mais, dans le lointain, sur la route, apparaissaient quelques cavaliers turcs qui tournaient bride après avoir tiré quelques coups de fusil. L’abattement augmentait. Les exhortations des plus courageux, dont le nombre diminuait d’ailleurs chaque jour, les promesses, les plus sévères réprimandes même n’y pouvaient rien.
Le 25 avril, ce lamentable état d’esprit des défenseurs de Klissoura s’était encore aggravé. Ils se voyaient abandonnés à eux-mêmes, c’est-à-dire promis à une perte certaine... Cela, crevait les yeux. La poignée de défenseurs que pouvait donner la ville, en tout, deux cent cinquante hommes au plus, dispersés sur les différentes positions, ne pouvait guère suffire à repousser la terrible horde des bachi-bouzouks qui allait fondre sur elle aussi bien de l’est que de l’ouest. Inutile d’attendre un nouveau renfort de Koprivchtitsa, elle-même avait besoin de secours. Le découragement, l’abattement, s’emparèrent de toutes les positions. Le relâchement de la discipline, les regrets, les mécontentements, les reproches, toute l’avant-garde de la démoralisation remplacèrent l’enthousiasme des premiers jours. Sans avoir encore aperçu l’ennemi, les insurgés le sentaient proche, inévitable, terrible, ils semblaient déjà une armée vaincue sans combat, un troupeau tremblant de biches qui, acculé dans une gorge sans issue, entend déjà le rugissement des bêtes féroces. Bien rares étaient ceux qui gardaient leur présence d’esprit et moins nombreux encore étaient ceux qui gardaient une lueur d’espoir sur l’heureuse fin de l’insurrection. Aux souffrances morales s’ajoutèrent les souffrances physiques : dès le coucher du soleil un vent glacial soufflait du Balkan et engourdissait les insurgés dans les tranchées humides où ils étaient obligés de passer les nuits sans allumer de feu. Ces pauvres artisans, pour la plupart des tailleurs, habitués à couler, l’aiguille à la main, une vie paisible, transformés tout à coup en insurgés hérissés d’armes, étaient vraiment à plaindre. De sourds gémissements et des soupirs s’élevaient la nuit des tranchées où, de froid et d’inquiétude, personne ne pouvait fermer l’œil.
– À la bonne heure, boulka 128 ! Heureux soit notre royaume de Bulgarie ! se félicitaient les vieilles femmes en s’abordant dans les rues le premier jour de l’insurrection.
– C’en est fait de nous, frères, nous sommes perdus ! chuchotaient maintenant même les conjurés qui avaient été les plus enflammés.
Le désespoir montait. Il était marqué sur les visages hâves. Cependant, les mots de retraite ou de fuite ne s’étaient échappés d’aucune bouche mais ils étaient sur toutes les lèvres.
Tel était l’état d’esprit sur les hauteurs. Tel était-il aussi à peu près à Zli-Dol, le point le plus important de la défense.
20 LA BATTERIE DE ZLI-DOL
La hauteur de Zli-Dol, au nord-est de la ville, était une bonne position stratégique : elle dominait la région, elle était la clef de la route qui reliait Klissoura à la vallée de la Stréma. De là, le regard plongeait au loin, sur les plateaux ondoyants et dénudés de l’est, où apparaissaient les silhouettes des sentinelles, qui marquaient la ligne de l’armée klissourienne.
La garde de Zli-Dol était la plus farouche. Renforcée par les hommes de Sredna-Gora de Volov, restes de groupes d’insurgés décimés dans les combats livrés précédemment aux Turcs, elle se préparait à saluer de ses balles la première attaque de l’ennemi.
Ce jour-là, on y remarquait une animation particulière. L’allégresse brillait dans les regards, mais ils étaient tournés non pas dans la direction d’où devait venir l’ennemi mais vers la vallée où se blottissait Klissoura. Tous les yeux scrutaient intensément le sentier qui de là s’élevait en serpentant jusqu’aux retranchements. Un insurgé de stature gigantesque, portant sur son épaule un long objet blanc, de forme cylindrique, avançait sur ce sentier. Derrière lui, une femme aux formes robustes, une paysanne à en juger par son costume, suivait, ployée sous un fardeau qui semblait très lourd.
C’étaient précisément ces deux personnes qui fascinaient tous les regards. Et pour cause : elles montaient à Zli-Dol l’artillerie. Celle-ci consistait en tout et pour tout en une seule pièce faite du tronc creusé d’un cerisier. Le géant portait le canon sur son épaule. La charge du canon, composée de morceaux de fer, de balles, de gros clous forgés, de fers à cheval et autres objets hétéroclites, pendait dans un sac sur le dos de la paysanne.
Les yeux des insurgés flambaient de joie. Un enthousiasme général s’empara de Zli-Dol.
Enfin, trempé d’une sueur chaude qui roulait en grosses gouttes de ses sourcils et de son cou, le géant parvint avec le canon jusqu’au sommet.
– Tonnerre de Dieu ! souffla-t-il en laissant tomber l’engin meurtrier.
Tous se pressèrent autour du canon, l’examinant avec curiosité. Il y avait une douzaine de pièces semblables, destinées aux autres retranchements, mais elles étaient encore en ville. Celle-ci avait été amenée ici pour une épreuve préalable, on voulait entendre sa détonation, voir partir le boulet, connaître sa portée. Elle fut hissée encore plus haut, en un point d’où l’on pourrait bombarder la route et les pentes dénudées ; on la bourra de mitraille, on la cloua solidement au sol par des pieux, et un large trou fut creusé derrière elle pour abriter les canonniers.
Les insurgés brûlaient d’impatience d’entendre la voix du premier canon bulgare ! Une joie enfantine, un enthousiasme inexprimable les soulevaient. Certains pleuraient...
– Écoutez bien, les gars ! Vous allez entendre rugir le lion du Balkan. Sa voix ébranlera le trône du Sultan et annoncera au monde entier que la Stara-Planima est libre ! s’écria le chef des défenseurs de Zli-Dol.
– Ce grondement va réveiller aussi nos autres frères, ceux de la vallée de la Stréma, et leur rappeler le devoir : ils prendront les armes et se dresseront contre l’oppresseur commun ! dit un autre.
– D’ici nous dominons toute la vallée. Que les tyrans se montrent : nous les mettrons en bouillie !
– Nous n’en laisserons pas un seul... Tonnerre de Dieu ! hurla Ivan Borimetchka, continuant à essuyer de son bonnet son visage empourpré et ruisselant.
Car le géant qui avait apporté le canon était notre vieil ami, Borimetchka ; sa femme avait hissé la mitraille. Depuis un mois déjà, ils s’étaient établis à Klissoura pour y travailler, et ils avaient été entraînés par la vague de l’enthousiasme révolutionnaire.
Le bombardier s’apprêtait à mettre le feu à la mèche.
– Attends donc, Deltcho ! Les femmes et les enfants vont s’effrayer. Il faut les avertir, dit Niagoul, le drapier.
– C’est bien parler, reprit un autre, envoyons le crieur public annoncer la chose à la ville : il y a des femmes enceintes.
– Pourquoi gaspiller du temps à l’envoyer jusqu’en ville ?... Il suffirait que celui qui a le plus de voix crie d’ici et chacun l’entendra.
– Borimetchka ! Borimetchka ! s’écrièrent plusieurs, qui connaissaient la force terrible de ses poumons.
Borimetchka accepta de bon cœur cette nouvelle tâche. Il demanda ce qu’il fallait crier, le répéta avec soin et alla sur la hauteur opposée, située plus près de la ville. Là, il se dressa de toute sa gigantesque stature, bomba la poitrine, leva bien haut la tête, ouvrit largement les mâchoires et cria, en prolongeant les mots :
– Hé ! hé ! Bonnes gens ! Le canon va gronder ; c’est pour l’essayer ! Tonnerre de Dieu ! Les femmes et les enfants n’ont pas de quoi s’effrayer ! Qu’on reste tranquille !... Il n’y a pas encore de Turcs. On n’en voit pas ! Tonnerre de Dieu !
Il répéta plusieurs fois et à deux minutes d’intervalle cette information. Les échos du Balkan répondirent à cette voix puissante. Elle pénétra dans chaque maison de la ville. Après avoir prévenu leurs familles d’une façon aussi rassurante, les insurgés se mirent à l’œuvre. Deltcho alluma un grand morceau d’amadou, l’enfonça au bout d’une longue perche et l’approcha de la culasse du canon. L’amadou s’enflammait et fumait ; de petits nuages bleus s’élevèrent. Dans l’attente palpitante du grondement, les insurgés s’écartèrent un peu, quelques-uns se couchèrent dans les tranchées pour ne rien voir, certains même se bouchèrent les oreilles, fermèrent les yeux. Quelques secondes passèrent dans une atroce, une indicible tension... La fumée bleue continuait à planer au-dessus de la mèche, mais n’arrivait pas à l’allumer. Les cœurs battaient à se rompre. Cette attente torturante devenait insupportable. Enfin une petite flamme blanche courut à la mèche, celle-ci s’enfuma... et le canon rendit un son grêle, grognon, rauque comme celui d’une planche sèche qu’on rompt, quelque chose de semblable à une toux, puis il s’enveloppa d’un épais nuage de fumée...
Sous la pression de cette toux, le canon se fendit et cracha sa charge à quelques pas de distance. Bon nombre des insurgés couchés à terre n’entendirent même pas la détonation.
Un plaisant prétendit même qu’il avait pris ce bruit pour un son incongru sorti de l’orifice innommable d’Ivan Borimetchka.
Ce pitoyable résultat mit en évidence les défauts de l’artillerie. On s’empressa donc de réparer les autres canons, en les entourant de cercles de fer étroitement rapprochés et solidement serrés, ainsi que de cordes ; on alla jusqu’à revêtir de fer-blanc l’intérieur de quelques-uns. Ce jour-là même on amena à chaque position deux canons, on les chargea, on les cloua fermement au sol par des pieux et on pratiqua derrière eux des abris pour les allumeurs de mèches. Chaque canon était destiné à servir une seule fois et à tirer dans une seule direction déterminée à l’avance.
Ajoutons qu’on avait oublié d’annoncer à la ville que le canon avait déjà « éclaté ». De sorte que les pauvres femmes, jeunes et vieilles, les oreilles bouchées d’ouate, attendirent jusqu’au soir le fracas d’un coup à faire tinter les vitres.
27 L’INTERROGATOIRE
Ognianov se trouvait sur une éminence, entre Zli-Dol et la Stara-Réka, où avaient été préparés les retranchements orientaux. Ceux-ci non seulement étaient dans une aussi bonne position stratégique que ceux de Zli-Dol, mais avaient encore l’avantage que de là on pouvait voir une partie de la vallée de la Stréma qui, à l’est, verdoyait au loin dans la déclivité creusée derrière les collines dénudées. Les défenseurs, une trentaine en tout, en bras de chemise, à cause de la grande chaleur, erraient çà et là, le visage sale, l’air soucieux. Le découragement pesait ici comme sur toutes les positions.
Ognianov, en tenue d’insurgé, les deux indispensables revolvers à la ceinture, était monté sur le remblai du retranchement et, les jumelles aux yeux, scrutait la vallée. Il observait une petite fumée bleue que certains avaient prise pour un incendie.
Il laissa retomber les jumelles et descendit du remblai :
– Non, ce n’est pas cela, murmura-t-il sombrement. On brûle du charbon dans la Sredna-Gora.
À ce moment, il aperçut Borimetchka qui venait vers lui et menait une personne n’appartenant pas au groupe des insurgés : un homme de petite taille, un Bulgare, l’air obtus et effrayé, vêtu d’une saltamarka 129 et d’un potouri usés ; il portait un sac bigarré sur le dos.
– Un espion ! dit Borimetchka. On lui a mis la main dessus dans la vallée. Nous l’avons interrogé de toutes les manières possibles mais il se tait comme un imbécile. Qu’ordonnes-tu que j’en fasse ?
Un sourire involontaire joua sur les lèvres d’Ognianov. Il avait reconnu Ratchko surnommé Pradletto : « Le Péteux. »
Ratchko avait quitté la veille Biala-Tcherkva et était parti pour Rahmanlari où il allait faire des raccommodages pour les Turcs, métier qui assurait un modeste gagne-pain aux indigents de Biala-Tcherkva. Il était si borné qu’il n’avait compris ni ce qui se préparait à Biala-Tcherkva, ni ce qui se passait ici, aussi avait-il été ébahi quand, à Rahmanlari, il avait reçu, au lieu de commandes de pièces à appliquer à quelque habit déchiré, une volée de coups, appliquée sur son dos par des Turcs exaspérés qui ensuite l’avaient chassé avec force injures. Pour ne pas rentrer les mains vides, il avait décidé d’aller à Klissoura qui était tout près. Mais l’apparition d’un détachement de cavaliers turcs l’avait effrayé et il s’était engagé dans le vallon de la Stara-Réka pour passer de là à Klissoura. C’est ainsi qu’il était tombé aux mains des avant-postes.
– Qu’est-ce que tu viens chercher par ici, hein ? demanda Ognianov.
Ratchko qui, effrayé par tant d’hommes en armes que jusqu’ici il avait pris pour des brigands, avait perdu la tête, se ressaisit. Quoiqu’il gardât un mauvais souvenir d’Ognianov, celui-ci apparaissait être un homme plus proche de lui, un ami parmi tant d’étrangers. Sa langue se délia et il raconta tant bien que mal son odyssée.
Boïtcho apprit avec plaisir que Ratchko avait quitté Biala-Tcherkva la veille.
– Quoi de nouveau à Biala-Tcherkva ?
– Rien, rien, grâce à Dieu, rien.
Ce « rien » transperça Ognianov comme une lame.
– Pas de mensonges, dis la vérité !
– Il n’y a rien, sois tranquille, il n’y a rien.
– Comment donc ! il n’arrive rien par là ?
– Ma foi ! rien. Veux-tu que je te le jure ?
« Cette bûche ne sait rien, pensait Boïtcho avec indignation. À moins qu’il ne cache quelque chose, qu’il ne soit envoyé par les Turcs. Comment est-il parvenu jusqu’ici, alors que personne d’autre n’a pu passer ? »
Et fouillant Ratchko de son regard perçant :
– Écoute, dis la vérité ou je te fais écrabouiller la tête sur cette pierre ! (Le visage de Boïtcho s’était soudain empourpré de colère.)
– Non, maître, celui-là il faut me le laisser, intervint Borimetchka, j’ai besoin de sa tête : je vais la lui arracher de ma propre main, je la fourrerai dans notre canon pour qu’elle aille jusqu’à Rahmanlari raconter aux Turcs ce qu’elle a vu par ici.
Et le colosse attachait un regard avide d’épervier sur le petit Ratchko.
– Je dirai tout, tout..., balbutia celui-ci, épouvanté.
– Rappelle-toi ce que je t’ai dit ! menaça Ognianov.
– Je me rappelle, je te dis que je me rappelle.
– Est-ce vraiment hier que tu as quitté Biala-Tcherkva ?
– Hier, hier. Le soleil était, hé, là-bas !
– Qu’est-ce qu’il y avait à Biala-Tcherkva ?
– Il n’y avait rien, sois tranquille.
– Pourquoi as-tu quitté Steftchov ?
– Il m’a chassé. Que Dieu l’écrase ! foi de Ratchko le Péteux ! On ne vit que pour l’honneur, quoi !
Ognianov d’un signe l’interrompit :
– Hier, avant de partir, qui as-tu vu à Biala-Tcherkva ?... As-tu vu Sokolov ?
– Je l’ai vu, mais pas hier, avant-hier ; il entrait chez lui avec l’Allemand.
– Alors, il n’y a pas eu de tapage ?
– Non, il n’y avait rien.
– Il n’y a pas eu de Turcs ?
– Pas un chien.
– Le bey n’a fait arrêter personne ?
– Bien entendu.
– Donc, tout est calme ?
– Je te le dis, crois-moi.
– Que disent les gens là-bas ?
– On dit du bien.
– Quel bien ?
– Chacun s’occupe de ses affaires ; par exemple, moi, j’ai ma maison et mes enfants, eh bien ! j’ai jeté le sac sur le dos et en avant, au travail ! de village en village. Mais tu diras que c’est honteux. Non, comte, ce n’est pas honteux : Ratchko le Péteux reste ce qu’il est, son honneur intact. Pourquoi qu’on vit, je vous le demande ? Pour sa bonne renommée dans ce monde...
Boïtcho joignit les mains avec rage. Il était avide d’arracher des lèvres de ce nigaud la plus insignifiante information sur une action prochaine à Biala-Tcherkva. Mais, après un second essai, il se convainquit qu’il ne pouvait rien apprendre pour la simple raison que Ratchko lui-même n’avait rien compris, rien vu, et qu’en vérité il ne se passait rien à Biala-Tcherkva.
– Que vas-tu faire, Ivan ? demanda Ognianov, voyant que Borimetchka fouillait dans le sac du prisonnier.
– On aura besoin de ces ciseaux ou je ne suis qu’un bœuf, dit Ivan en tirant du sac une grande paire de ciseaux, une autre plus petite ainsi qu’une autre, pliante en fer.
– Qu’est-ce que tu en feras ? Tu ne vas pas lui couper les oreilles ?
– Pour le canon ! Tonnerre de Dieu ! On a besoin de mitraille, pas vrai ?
Et Borimetchka tordit les grands ciseaux et les sépara en deux parties. Puis il les serra l’une après l’autre sur son genou : le fer se rompit avec un bruit sonore et dans chacune de ses mains resta la moitié de chaque partie. Quant à l’autre, il la mit en morceaux, en ne se servant que de ses doigts, comme s’il cassait des baguettes. Puis s’adressant au prisonnier :
– Et rappelle-toi, si ton affaire n’est pas propre, ta tête aussi je la tordrai, je l’arracherai et j’en bourrai le canon ! – et il enveloppa d’un regard terrible la petite tête qui aurait pu entrer aisément dans la gueule du canon.
– Ivan, toi, va à Zli-Dol, celui-ci restera ici. Ce n’est pas un espion mais un grand benêt.
En entendant qu’on expédiait l’effrayant Borimetchka, Ratchko poussa un soupir de soulagement et recouvra un peu de son assurance :
– Mes excuses, comte, mais, voilà, je peux rafistoler les vêtements de ces chenapans. Moi, quand je suis au travail..., le travail n’est pas une honte, et quand on a son honneur...
– Quels chenapans ? demanda sévèrement Ognianov.
Ratchko baissa confidentiellement la voix :
– Ces brigands, Dieu nous préserve ! ils allaient boire mon sang. (Et il montra du regard les défenseurs du retranchement.)
– Faites travailler celui-là à la tranchée ! leur cria Ognianov, et il s’éloigna.
– Un dizainier, s’approcha d’Ognianov.
– Qu’y a-t-il, Martchev ?
– Ça ne va pas, chuchota le dizainier, la démoralisation gagne les hommes.
Le visage d’Ognianov s’assombrit.
– Celui qui décourage les autres sera immédiatement puni de mort ! dit-il, irrité. Qui as-tu remarqué, Martchev ? Le dizainier cita quatre noms.
– Apelle-les !
Les accusés parurent. C’étaient des hommes âgés, artisans et marchands.
Ognianov les foudroya du regard :
– Est-ce vous, messieurs, qui démoralisez les gars ?
– Nous ne démoralisons personne, répondit l’un d’eux avec colère.
– Savez-vous comment on punit une telle conduite dans un moment aussi critique ?
Ils ne répondirent rien, mais leur silence exprimait plutôt l’obstination qu’un sursaut de peur. Une colère subite rida le front d’Ognianov, il se contint pourtant et dit avec calme :
– Retournez à vos postes, messieurs. Nous avons déclenché une révolution, il est trop tard maintenant pour s’en repentir. C’est ici que nous rencontrerons l’ennemi, personne ne doit tourner ses regards vers Klissoura. Vous défendrez vos maisons et vos familles non pas en retournant dans la ville, mais bien en restant hors d’elle ! Je vous en prie, ne me mettez pas dans une situation embarrassante !
Les insurgés ne bougeaient pas.
Ognianov les observa avec étonnement. C’était, évidemment, une façon de protester.
– Qu’avez-vous encore à dire ?
Les hommes se consultèrent du regard, puis l’un d’eux dit :
– Nous n’étions pas faits pour cela.
– De ma vie je n’ai touché un fusil, ajouta un autre.
– Qui de nous a touché un fusil ? dit le troisième.
– Nous ne pouvons pas verser le sang...
– Êtes-vous donc des poltrons ? (Ognianov cherchait leur faire honte.)
– Ce n’est pas un péché de dire...
– Nous avons peur, voilà ! s’écria le premier avec animosité.
– Nous avons des enfants.
– On n’a pas trouvé sa vie dans le ruisseau, ajouta le plus hardi d’une voix où montait la colère.
– Votre vie, vos enfants et vos maisons ne comptent pas lorsqu’il s’agit de la libération de la Bulgarie ! s’écria Ognianov, la voix tremblante d’émotion. Je vous prie encore une fois de ne plus vous montrer lâches et de m’épargner d’avoir à prendre des mesures extrêmes contre vous.
– On n’a pas l’habitude des fusils et des révoltes, nous autres. Laisse-nous partir.
Ognianov vit qu’il ne pourrait vaincre leur opiniâtreté par de bonnes paroles. Il bouillonnait de colère, mais s’efforçait de ne pas éclater. Il comprenait que, seuls, le désespoir et l’épouvante pouvaient donner à ces poltrons, la hardiesse d’avouer devant leur chef, à haute voix et sans rougir, qu’ils étaient des couards.
Un pas séparait cet aveu de la panique, de la fuite. Ognianov décida d’agir impitoyablement. Il ne fallait pas laisser la contagion s’emparer des autres sous cette forme aiguë. La discipline l’exigeait.
– Messieurs, remplirez-vous votre devoir ? Oui ou non ? demanda-t-il impérieusement.
Et il attendit leur réponse, l’œil sombre, le cœur battant.
À ce moment, des cris se firent entendre derrière lui. Il se tourna et vit que, non loin du plateau, Borimetchka poursuivait un tzigane. Les autres insurgés étaient accourus pour voir le spectacle et par leurs vociférations encourageaient Borimetchka qui, en dépit de ses enjambées de géant, n’arrivait pas à rattraper le tzigane, léger et nu-pieds. Quelques-uns le mirent en joue, mais Ognianov les arrêta. Le fuyard s’était jusqu’alors caché à Klissoura et avait essayé de s’enfuir pour se cacher dans quelque village turc. Les tziganes qui, dans les premiers jours, avaient réussi à fuir, avaient, les premiers, porté aux Turcs la nouvelle de l’insurrection de Klissoura ainsi que des renseignements sur la disposition de la défense. Par nature et par intérêt, les tziganes agissaient en fidèles alliés des Turcs aussi bien dans ce cas que dans d’autres analogues. Borimetchka continuait à poursuivre le tzigane, en faisant d’immenses bonds et filant comme le vent. Mais le tzigane le devançait de beaucoup et tous deux s’éloignaient de plus en plus du retranchement. Maintenant il eût été difficile d’atteindre le tzigane, même d’un coup de fusil. Mais, tout à coup, celui s’arrêta, saisi : en face de lui avaient bondi deux insurgés de l’avant-poste et il se trouvait entre deux feux. À cette minute même, Borimetchka l’atteignit, l’entraîna dans son élan et tous deux roulèrent à terre. Du retranchement s’élevèrent des cris joyeux, accompagnés de signaux :
– Par ici ! Par ici !
Borimetchka, furieux, amenait le tzigane, tout en déversant sur lui un torrent d’invectives malsonnantes qui parvenaient jusqu’au retranchement.
Bientôt le fuyard s’y trouva ramené.
Les insurgés l’entourèrent. Des sentiments sauvages animaient leurs visages hâves. Tous connaissaient le tzigane. Il avait déjà essayé à deux reprises de fuir de Klissoura, la première fois avec une mission secrète pour les gens de Rahmanlari, mission dont il avait été chargé par un Turc du konak retenu dans la ville. Le tzigane avait été seulement arrêté. Mais, à présent, il ne pouvait même pas être question de lui faire grâce.
Le chef de la position prit à part son dizainier et délibéra un moment avec lui.
– Oui, oui, conclut Ognianov, toute indulgence, toute pitié seraient fatales en ce moment. La vue de la mort habituera peut-être les peureux à l’affronter avec plus de courage. Mais la sentence doit être prononcée par un conseil de guerre. Martchev, va de suite à Zli-Dol exposer l’affaire. Mon opinion et ma demande sont la peine de mort. Fais vite.
Le dizainier partit.
Ognianov s’adressa gravement à un insurgé d’un certain âge :
– Oncle Marine, mets ce tzigane sous bonne garde ! Puis, s’adressant à deux insurgés plus jeunes : – Vous, les gars ! emmenez les froussards de l’autre côté, prenez leurs fusils et surveillez-les jusqu’à nouvel ordre.
Les quatre insurgés démoralisés se soumirent et se dirigèrent, très pâles, suivis de leurs gardes, vers l’endroit où ils devaient être mis aux arrêts.
29 LE BAPTÊME DU SANG
Ognianov, très ému, allait et venait le long des tranchées ; son visage exténué reflétait ses sombres pensées. Il s’arrêta près d’un groupe d’insurgés qui creusaient une nouvelle tranchée, les regarda machinalement, sans même remarquer le large sourire amical de Ratchko, monta de nouveau sur le remblai, leva ses jumelles, scruta à l’est la vallée puis, les traits figés, retourna à la première position.
– Quel peuple ! Quel peuple ! murmurait-il.
Martchev revint.
– Arrêt de mort ! dit-il, haletant.
– Le conseil de guerre s’est-il prononcé ?
– Oui, la mort sans délai ! ajouta Martchev, ensuite il ajouta quelques mots à voix basse.
Ognianov fit un signe de tête approbateur.
Les mots « morts sans délai » furent entendus plus loin. Ils se transmirent dans un murmure, de bouche en bouche, et arrivèrent jusqu’au coin où étaient les détenus. De pâles qu’ils étaient ceux-ci devinrent aussi blancs que le plâtre. Ils comprirent qu’ici on ne plaisantait pas. Brusquement la cour martiale se dressait devant eux, terrible, grandiose, implacable comme le Destin. En ce lieu, Dieu seul était plus grand.
Un insurgé s’approcha d’Ognianov :
– Les condamnés se repentent et demandent grâce.
Ognianov répondit sèchement :
– C’est trop tard. La sentence est prononcée.
Puis il ajouta impérativement :
– Braïkov, prends avec toi Niagoul, Blagoï et Iskrov, et conduisez les quatre condamnés dans le val où ils subiront leur châtiment. L’arrêt de la cour martiale doit être exécuté à la lettre.
Braïkov, ahuri, troublé par tout ce qui se passait autour de lui, alla pourtant remplir l’ordre du chef du retranchement. Aucune voix ne s’éleva en faveur des condamnés. Personne ne voulait avoir l’air de se solidariser avec eux. Chacun sentait que sa vie dépendait maintenant de la volonté du conseil de guerre, seul juge et juge sans appel.
Les condamnés, conduits par quatre insurgés, traversèrent le retranchement et descendirent dans le val.
– Menez-y aussi le tzigane ! cria Ognianov.
Puis il donna à voix basse quelques instructions à son dizainier qui dévala la pente derrière les autres.
Le lieu du supplice était un endroit clos, plein d’ombre, d’humidité et de verdure, où susurrait un ruisseau. Presque de tous côtés des pentes abruptes et des falaises. Le retranchement d’Ognianov était sur la hauteur qui surplombait le val à l’ouest. C’est de là que les insurgés allaient voir l’exécution.
À gauche du ruisseau se dressait un chêne à demi calciné par la foudre. C’est à cet arbre solitaire que fut accoté le tzigane et deux insurgés déroulèrent sa longue ceinture rouge avec laquelle ils l’attachèrent au tronc. L’épouvante avait paralysé la bouche du malheureux. Du sang coula de ses lèvres crevassées.
Non loin de là, sur le bord du ruisseau, les quatre autres condamnés restaient immobiles : ils attendaient leur tour. Leurs traits étaient défigurés par une terreur animale.
Martchev cria :
– Eux aussi ! Amenez-les ici !
Les condamnés se mirent en marche. Mais trois d’entre eux trébuchaient, leurs jambes ne pouvaient les porter, aussi leurs gardiens durent-ils les prendre sous les aisselles pour les amener à l’endroit indiqué.
Martchev les plaça à dix pas du tzigane attaché à l’arbre, sans doute voulait-il qu’ils assistassent de plus près à ce terrible spectacle qu’eux-mêmes, dans quelques instants, allaient à leur tour offrir à leurs camarades insurgés, rassemblés sur l’escarpement.
Ils n’étaient pas attachés, eux. Mais la terreur les avait paralysés et l’idée d’une fuite ne leur passait pas par la tête. D’ailleurs elle eût été impossible.
Une minute s’écoula dans un silence de mort.
Puis Martchev prononça à haute voix et d’un ton solennel les paroles suivantes :
– Le tzigane Mehmed, de la ville de Klissoura, coupable d’une triple tentative d’évasion dans le but infâme de servir les ennemis de la Bulgarie, est condamné à mort par le conseil de guerre, à titre d’exemple pour les traîtres de son espèce !
Il s’adressa ensuite aux insurgés condamnés :
– Messieurs, tournez-vous vers Mehmed.
Les condamnés exécutèrent cet ordre en automates.
– Donnez un fusil à chacun de ces messieurs...
Les insurgés, émus, passèrent leurs fusils. Les condamnés les prirent, le visage abêti de stupéfaction.
– Maintenant, fusillez celui-là, à mon commandement : un, deux, trois...
Les coups de feu ébranlèrent les échos des escarpements et un nuage de fumée enveloppa les quatre hommes.
Le tzigane restait debout, attaché comme il l’était au tronc. Pas une balle ne l’avait touché, les tireurs n’ayant probablement pas visé ; mais il ressemblait à un mort.
– C’est une honte, messieurs ! cria Martchev avec colère. Recommencez !
Et il répéta le commandement. Encore une fois les coups de feu éclatèrent... la tête du tzigane s’affaissa, ses bras retombèrent.
Des applaudissements retentirent sur la hauteur.
– Pour cette fois, messieurs, c’est là tout votre châtiment : le baptême du sang. Vous le devez à la générosité d’Ognianov et à l’indulgence du conseil de guerre.
Ayant compris qu’ils étaient sauvés, les quatre hommes jetèrent autour d’eux des regards effrayés de dormeurs brusquement tirés d’un lourd cauchemar, puis un faible sourire de bonheur perça enfin à travers le masque jaune et rigide que la peur avait appliqué sur leurs visages.
De nouveaux applaudissements de joie retentirent dans le retranchement.
30 LA VALLÉE DE LA STRÉMA EN FLAMMES
« Étrange, étrange... Inexplicable... Affreux ! Jusqu’à cette heure rien... Que font-ils donc ? Que fait Biala-Tcherkva ? Ils se taisent comme s’ils étaient morts. Ils se taisent ! Ce silence affreux est terrible... Je n’ose penser que là-bas, ils ont prudemment croisé les bras. Est-ce qu’il ne dirait pas la vérité, la pure vérité, cet idiot ? Là-bas est Sokolov, et Popov, et le Rédacteur ; mes faucons sont là, des hommes sûrs, des têtes chaudes. Qu’attendent-ils ? Est-ce moi qu’ils attendent ? Mais si je n’apparais pas, si je crève, ne feront-ils rien ? Sont-ils sourds et aveugles pour ne rien voir ? Klissoura en révolte, Koprivchtitsa en révolte, Panagurichté en révolte, la Sredna-Gora en flammes ! Seule la vallée de la Stréma dort ! Mais peut-être un malheur est-il arrivé ? ou quelque obstacle imprévu ? Non, cela est impossible ! Si Biala-Tcherkva ne peut se soulever, elle peut au moins envoyer une tchéta 130 d’une dizaine d’hommes au moins, elle aurait ranimé les autres ! Mais Biala-Tcherkva ne bouge pas ! Tous les renseignements le confirment. Et c’était un si grand enthousiasme ! Et quels préparatifs ! Serait-ce partout la même chose ? Alors le désastre, la malédiction divine sont suspendus au-dessus de la Bulgarie ! »
Tout en ressassant ces sombres pensées, Ognianov, déguisé en Turc, pénétrait ce jour-là avec précaution dans le ravin de la Stara-Réka qui s’ouvre dans la vallée de la Stréma.
On se rappelle que, le 20 avril, il passait par Klissoura pour aller à Biala-Tcherkva dans l’intention de soulever la ville dès que sonnerait l’heure de l’insurrection générale. Mais, pour Klissoura, l’heure avait sonné ce même jour. Surpris par la révolte au moment où son cœur venait de recevoir un coup terrible, il s’y était jeté aveuglément, cherchant à étourdir sa douleur dans le tourbillon de la lutte, à trouver la mort dans le combat pour la liberté de la patrie. Mais l’ennemi ne se montrait pas. Les communications entre Klissoura et la vallée étaient coupées. Ognianov passa cinq jours et cinq nuits sur les positions, déployant une activité fiévreuse pour organiser la défense, torturé dans l’attente impatiente d’une nouvelle de Biala-Tcherkva lui annonçant son soulèvement. Le cœur saignant, il maudissait le hasard qui l’avait amené à Klissoura... Il se rendait compte de l’influence désastreuse de ce sinistre silence sur le moral des insurgés. Tous ses efforts pour leur faire croire que l’insurrection à Biala-Tcherkva et, tout de suite après, dans les autres centres, allait éclater échouèrent. Il finit par perdre lui même l’espoir, il eut la vision épouvantable de Klissoura, de toute la révolution, vouée à la catastrophe. Alors il se décida à une entreprise d’une folle audace : se faufiler, à travers la population turque en plein émoi, jusqu’à Biala-Tcherkva et la soulever.
Il s’exposait à de terribles risques, mais la révolte de Biala-Tcherkva serait l’étincelle qui enflammerait, tout le long de la Stara-Planina, les localités prêtes à s’insurger. Alors les forces des Turcs seraient divisées. Klissoura sauvée, l’incendie propagé et, qui sait ? la révolution triompherait ! Nombre de grands revirements de l’Histoire sont dus aux plus infimes circonstances. L’enjeu valait le risque. Et l’exploit avait trouvé son homme.
Le soleil était au zénith quand Ognianov pénétra dans la vallée épanouie, pleine d’ombrages et de verdure. Des ruisselets roulaient leur eau cristalline dans l’herbe drue, parmi les bouquets de chênes. L’air, comme celui du boudoir d’une favorite royale, était saturé des parfums qu’exhalaient les roses de la vallée. Celle-ci, dans le radieux rayonnement du soleil et sous le ciel d’azur, semblait un paradis terrestre. Mais le voyageur restait aveugle à tant de beauté. Il aurait préféré voir cette vallée en flammes.
Son chemin traversait le village turc de Rahmanlari, la localité la plus proche de Klissoura. Il s’en approcha délibérément. Aux abords du village, entre les roseraies, il fut arrêté par des sentinelles turques :
– D’où viens-tu, frère ?
– D’Altanovo.
– Et où vas-tu ?
– À Ahiévo. Là-bas, tout est tranquille ?
Ahiévo était un village turc, le plus proche de Biala-Tcherkva.
– Grâce à Dieu ! tout est calme par là.
Le cœur d’Ognianov se serra de douleur.
– Tu ferais mieux de rester dans le village. Demain nous attaquerons Klissoura.
– Je verrai. Adieu !
Et Ognianov entra dans le village.
Une grande animation régnait dans les rues. Des groupes de Turcs, hérissés d’armes, faisaient la navette. Les estaminets étaient bondés, de même que les épiceries et l’auberge. De toute évidence il y avait là quelques centaines d’hommes accourus des villages voisins pour prendre part à l’attaque de Klissoura. Le point de ralliement était Rahmanlari. Envahi par de terribles pressentiments sur le sort de Klissoura, Ognianov voulait obtenir des renseignements plus précis sur Biala-Tcherkva ; qui sait, peut-être s’était-elle soulevée au dernier moment ? Ognianov pensa donc à entrer dans l’auberge qui était tenue par un homme né à Biala-Tcherkva. Mais, craignant la trahison, il n’en franchit pas le seuil et reprit sa marche, cherchant des yeux un groupe de Turcs qu’il pourrait aborder. Le hasard le conduisit devant la mosquée. Il vit qu’elle aussi regorgeait de monde. À la porte se pressait une foule de fidèles, et de nouvelles vagues affluaient toujours. Quelque chose d’insolite se passait là. Ognianov se douta bien que cette foule féroce serait haranguée par le hodja 131 qui s’évertuerait à porter au comble leur fanatisme. Une curiosité irrésistible le poussa à se faufiler parmi les fidèles. Il ne s’était pas trompé : juste à ce moment, le prédicateur montait sur la petite estrade de bois qui fait office d’ambon dans les mosquées. L’éclairage lui permit de distinguer que ce n’était pas le hodja ordinaire du village, mais un softa 132 venu probablement exprès de K...
Le silence se fit et le softa commença solennellement :
– Fidèles ! Il y eut un temps où, sous le règne glorieux de nos illustres sultans, le monde entier tremblait au seul nom de l’Osmanli. L’Orient et l’Occident lui rendaient hommage, les mers lui envoyaient des présents, les rois et les reines se prosternaient et léchaient la poussière sacrée devant le trône du Calife. Grande était alors la toute-puissance d’Allah, et de son prophète sacré Mahomet ! Mais nous avons beaucoup péché devant Dieu ! Nous nous sommes adonnés à l’ivresse et à la débauche, nous avons fraternisé avec les infidèles et adopté leurs lois. Et voici : Dieu permet que les outragés nous outragent et que les opprimés nous oppriment. Oh ! Allah ! Allah ! Envoie-nous le glaive flamboyant de l’ange Azraël, afin que nous noyions l’Orient et l’Occident dans le sang de tes ennemis ! Empourprons les mers ! et nous glorifierons les Cieux. Voilà ce que j’ai à vous dire, fidèles ! Aiguisez vos yatagans, préparez dans la prière vos armes et soyez prêts, car l’heure a sonné, l’heure de laver notre honte dans le sang des giaours, sous l’œil du Dieu unique et puissant de l’Islam !
C’est dans cet esprit et sur ce ton emphatique que l’orateur commença son discours. Il le prolongea longtemps ; une centaine de fidèles l’écoutaient, tendus, les yeux brûlants.
« Voilà donc ce qui se passe ici », se dit Ognianov. Sans attendre la fin de la harangue, il sortit dans la rue. « Ainsi, le bruit qui court sur ces prédicateurs n’est pas sans fondement. Nous prêchions le soulèvement contre le gouvernement turc ; leurs apôtres prêchent l’extermination du peuple bulgare ! Donc, nous aurons à mener une lutte terrible, lutte de peuple contre peuple ; ne nous faisons plus d’illusions. La terre bulgare est trop étroite pour les deux races ! Qu’il en soit donc ainsi ; pas de recul ! Le sort de la Bulgarie est jeté ! Mais comme elle commence mal, notre sainte révolution, notre révolution si ardemment désirée ! Seigneur, protège la Bulgarie ! »
Et il recommença son va-et-vient. La prière était terminée et les fidèles se répandirent sur la place publique ; ils formaient de petits groupes qui, sous l’impression de la harangue, parlaient avec animation. Ognianov se rapprocha de l’un des groupes et prêta l’oreille aux conversations. La situation lui devint claire : la population turque des villages voisins, ayant cru qu’une armée russe était arrivée à Klissoura, avait d’abord été effrayée par l’insurrection. Épouvantés, les hommes pensaient déjà à prendre la fuite avec leurs familles. Mais bientôt ils avaient appris, par des coreligionnaires, sortis sains et saufs de Klissoura, et aussi par les maladresses des insurgés, qu’ils n’avaient affaire qu’à de simples raïas, pour la plupart des tailleurs, et à quelques instituteurs, et ceci leur avait rendu tout leur courage, toute la confiance : ils avaient décidé d’avoir raison de la ville de Klissoura sans attendre le secours de la force armée. Ognianov comprit encore que les villageois de Rahmanlari avaient fait une habile reconnaissance et que, désormais, l’aménagement et la force de chaque position étaient presque entièrement connus de l’ennemi. On attendait pour le lendemain Tossoun-Bey qui venait avec de nouvelles hordes de bachi-bouzouks de K..., ils allaient frapper sans tarder la ville en révolte.
Ces révélations firent trembler Ognianov. Elles rendaient encore plus évidente la nécessité de hâter l’insurrection des autres villes bulgares. Il fallait devancer Tossoun-Bey.
Ognianov se dirigea vers l’est. Il traversa sans incident le village turc de Tékia. Il y avait des sentinelles à la seule entrée ouest ; donc, vers l’est, il n’y avait aucun danger. Ognianov remarqua dans cet autre village la même animation, et de même on attendait ici l’arrivée de Tossoun-Bey pour se joindre à sa horde.
« À Biala-Tcherkva, à Biala-Tcherkva ! Plus vite. Tossoun-Bey doit se heurter d’abord à la poitrine de fer de ma bonne ville de Biala-Tcherkva. Et cela aura lieu, oh ! cela aura lieu, dès que j’arriverai ! Il me suffit du seul Rédacteur pour déclarer l’insurrection et une demi-heure plus tard j’aurai cinq cents hommes sous le drapeau. Biala-Tcherkva s’enveloppera des flammes de l’insurrection ou des flammes de l’incendie. En avant ! Dieu, prête-moi des ailes ! »
Et, en effet, Ognianov volait vers Biala-Tcherkva. Encore deux ou trois heures de marche et il apercevrait dans le lointain les cheminées blanches de la ville et le fronton pyramidal de l’église ; son cœur battait d’une joie délirante.
Non loin du village resté derrière lui, il prit un chemin qui descendait dans un val ombragé, coupant la plaine. Arrivé là, il entendit un bruit confus de tambours et de clarinettes. C’était sans doute une noce de village turque, qui choisissait vraiment mal son moment. Bientôt le silence se rétablit et Ognianov n’y pensa plus mais, comme il remontait la pente opposée, les tambours et les clarinettes retentirent de nouveau. Cette fois-ci tout près. Il courut jusqu’au sommet, et alors il vit un spectacle qui le pétrifia.
La plaine était noire d’une multitude de Turcs qui avançaient aux sons de cette musique barbare. Au-dessus flottaient quelques étendards rouges. Cette horde s’avançait vers lui, en désordre, confuse et bruyante. Fusils, faucilles, haches, piques, hérissés au-dessus des épaules et des turbans des bachi-bouzouks, brillaient au soleil. La plupart étaient en bras de chemise, n’ayant gardé que leur gilet à cause de la brûlante chaleur de midi. Partout où le flot avait passé, il avait vidé de leurs hommes les villages turcs. Aucune discipline ne liait entre eux ces rangs tumultueux mais un but les attirait, un dessein sauvage, féroce, les poussait en avant, les exaltait : le sang et le butin. Pour répandre le sang ils portaient des fusils et des outils, pour transporter le butin ils se faisaient suivre d’une longue suite de chariots. Au son des tambours et des clarinettes, la horde, enflammée de fanatisme, avançait telle une nuée de sauterelles, lente mais inévitable.
Un seul cavalier, au turban blanc, de haute taille, décharné et noir, marchait en tête : le chef.
Il fit signe aux musiciens tziganes de s’arrêter.
– Hé ! musulman, viens par ici ! cria-t-il à Ognianov.
Ognianov s’approcha avec un profond salamalec.
– D’où viens-tu ?
– De Téka.
– Qu’y a-t-il par-là ?
– Rien. Grâce à Dieu, tout va bien.
– Que dit-on ? Sont-ils nombreux à Klissoura ?
– Il y en a passablement, à ce qu’on assure. Qu’Allah protège notre empire !
– Quelle espèce de gens sont-ils ?
– Des Moscovites, dit-on.
– Tais-toi, maquereau ! Il n’y a là que des rajas galeux.
– Excuse-moi, bey-efendi.
– Et toi, où vas-tu ?
– À K...
– Allons, retourne avec nous !
Ognianov pâlit :
– Bey-efendi, permets que...
– En arrière ! hurla Tossoun-Bey, piquant des deux.
La horde se mit en mouvement. Les clarinettes et les tambours retentirent. Le courant emporta Ognianov en arrière.
Il eût été insensé de tenter de résister ou de se glisser à travers la foule qui inondait tous les alentours. Le malheureux s’abandonna au courant, le désespoir au cœur. Il était anéanti. Son dernier espoir s’évanouissait. Il allait machinalement comme dans un rêve, poussé et bousculé par ces foules violentes qui, d’heure en heure, grossissaient, tandis que leur allégresse devenait de plus en plus féroce. Et le flot humain entraînait Ognianov en arrière, toujours plus en arrière, vers les collines dénudées derrière lesquelles se cache Klissoura.
31 NOUVELLE TENTATIVE
La racaille de Tossoun-Bey arriva vers le soir à Rahmanlari, fortement accrue et encore plus fanatisée. Elle trouva là, l’attendant, un autre ramassis de Turcs arrivés des villages voisins. Tossoun-Bey allait donc attaquer Klissoura le lendemain avec deux mille hommes.
Le village regorgeait de monde. Il ne pouvait pas abriter ces nouveaux hôtes. Mais, la nuit étant sereine, la plupart pour dormir se couchèrent dans les rues.
Ognianov dut faire de même.
Il était couché sur un tas de foin juste en face de l’auberge tenue par l’homme de Biala-Tcherkva. Quoiqu’il fût tard, les fenêtres de l’auberge étaient encore éclairées. Elle était pleine de clients.
Ognianov avait décidé de ne pas dormir et d’ailleurs il y était obligé. Il lui fallait essayer cette nuit même, pendant qu’il en était encore temps, de s’arracher à cette gueusaille parmi laquelle il était coincé ; demain il serait trop tard. Il scrutait, l’esprit tendu, les fenêtres éclairées de l’auberge, se creusant la tête pour trouver le moyen de passer à travers le réseau serré de sentinelles postées aux abords du village.
Il espérait s’en tirer facilement grâce à son déguisement turc et à sa connaissance de la langue. Mais hélas ! à quoi lui servirait-il de s’échapper et de rentrer sain et sauf au camp ? Biala-Tcherkva ne bougerait pas et la perte de Klissoura serait certaine.
Essayer de partir cette nuit même pour Biala-Tcherkva était presque impossible : la garde à l’issue est du village avait ordre de ne laisser passer personne, afin d’empêcher d’éventuelles désertions. Attendre le lendemain était encore moins possible... Mais eût-ce été possible qu’il ne serait plus parti maintenant pour Biala-Tcherkva car il n’avait pas le cœur de s’absenter de Klissoura à l’heure terrible où son sort allait se jouer. Son absence serait considérée comme une fuite, une lâcheté. Non, impossible ! Mais comment faire parvenir un message à Biala-Tcherkva ? N’y avait-il vraiment aucun moyen ? L’esprit d’Ognianov se tendait douloureusement.
Enfin une idée lui vint. Il essaierait de persuader l’aubergiste d’envoyer le lendemain matin un de ses fils à Biala-Tcherkva ; par précaution, celui-ci pourrait être accompagné d’un voyageur turc, le lendemain étant justement jour de marché à K...
Ce projet sourit à Ognianov. Sa réalisation était difficile, il est vrai, mais l’importance de l’enjeu méritait tous les efforts et valait tous les risques – risques fort grands car, d’abord, il devait se découvrir, se mettre à la merci de cet aubergiste peu sûr.
Par bonheur, le fils aîné ayant été son élève, Ognianov connaissait la famille de l’aubergiste et cela le rassurait un peu. Il se leva donc, franchit délibérément la porte de la cour, traversa celle-ci et s’approcha de la lucarne d’une petite pièce accolée à l’écurie ; là, sous l’appentis, il se mit à faire les cent pas dans l’espoir de voir quelqu’un de la famille. Il n’osait frapper à la lucarne ou à la porte pour ne pas donner l’alarme.
Personne ne se montrait. L’aubergiste, aidé de son fils, servait les clients dans le cabaret. Selon toute probabilité, la femme de l’aubergiste et les petits enfants se trouvaient seuls dans la chambre. Comptant là-dessus, Ognianov se décida à frapper à la porte.
Mais le hasard vint à son aide. La porte s’ouvrit et une silhouette féminine parut. Ognianov reconnut la femme de l’aubergiste, elle se dirigeait vers l’écurie, portant un auget plein d’orge. Ognianov l’atteignit et d’une voix claire lui dit en bulgare :
– Bonsoir, tante Avramitsa.
Elle se retourna, étonnée, ou plutôt effrayée.
– Ne me reconnaissez-vous pas ? fit-il d’une voix douce pour la rassurer, et il se hâta d’ajouter : L’instituteur de votre fils Nanko... Ognianov...
– Qui ? le comte ? demanda-t-elle, surprise, en plaçant l’auget sous son autre bras. Et pourquoi es-tu ainsi ? (Mais elle comprit aussitôt.) Viens, viens à la maison. Attends seulement que je verse l’orge dans la musette du cheval, et entrons chez nous.
Une minute plus tard, Avramitsa et Ognianov entraient par un petit vestibule dans un réduit sombre. Avramitsa frotta une allumette et alluma une lampe à pétrole en fer-blanc qui éclaira vaguement le réduit et son hôte.
– Par cette petite porte, on entre dans notre potager, de là, par la haie, on passe dans la rue. Sache-le au cas où tu en aurais besoin, chuchota la femme en montrant à Ognianov une petite porte, si basse qu’il fallait se courber pour y passer.
– Mais toi, que viens-tu faire ici ? continua-t-elle.
– J’allais de Klissoura à Biala-Tcherkva. J’ai rencontré Tossoun-Bey après Tékia, et il m’a fait rebrousser chemin.
Ognianov jugea qu’il devait répondre par une entière franchise à cette hospitalité si bienveillante. D’ailleurs il ne pouvait compter que sur cela...
Avramitsa le regarda avec compassion.
– Oh, ma mère ! dit-elle, ces pauvres Klissouriens, que vont-ils devenir ? Cette racaille vient pour eux...
– Klissoura sera écrasée, tante Avramitsa, elle sera mise à sac. C’est pourquoi j’ai essayé de la sauver mais, malheureusement, je n’ai pu me frayer passage jusqu’à Biala-Tcherkva.
– Mais qu’allais-tu y faire ?
– J’aurais soulevé Biala-Tcherkva aussi, et l’insurrection se serait propagée autour d’elle, de village en village. Alors Tossoun-Bey se serait retiré.
– Que Dieu le foudroie, ce noir tzigane... Mais que vas-tu faire maintenant ? questionna de nouveau Avramitsa, ne sachant ce qu’Ognianov allait lui demander.
– Où est votre Nanko ? Est-il ici ?
– Oui, il est là.
– Et Kouzman ?
– Lui aussi.
– Où sont-ils ?
– Dans la boutique, à aider leur père, ils sont tous à surveiller ces monstres-là, pour qu’ils n’aillent pas nous voler.
Ognianov réfléchit :
– Pouvons-nous envoyer quelqu’un, Nanko ou Kouzman, à Biala-Tcherkva, demain ?
La mère le regarda, interloquée. L’inquiétude se peignit sur son visage.
– Il peut faire route avec quelque Turc d’ici qu’il connaît. Demain est jour de marché à K... et les gens de Rahmanlari vont là pour y faire leurs achats.
– Mais, daskal, c’est dangereux...
– S’il a pour compagnon de route un Turc, ce n’est pas dangereux. D’ailleurs, là-bas tout est calme... Personne ne lui voudra de mal.
– Mais pourquoi veux-tu l’envoyer là-bas ?
– Pour remettre un billet à un de mes hommes de confiance ; il rentrera de suite. Demain, à midi, il sera de retour.
Ici Avramitsa se rappela les premiers mots de Boïtcho et devina avec quelle sorte de message il voulait envoyer son fils à Biala-Tcherkva. Son visage devint soucieux :
– Pour cette affaire-là, tu sais, il faudra en parler à son père.
– Je t’en prie, tante Avramitsa, ne disons rien à baï Avram. Ne peux-tu pas appeler Nanko en cachette, lui dire que je veux le voir, qu’il vienne ici ?
Ognianov savait que son ancien élève l’adorait et ferait tout ce qu’il lui demanderait.
Le visage de la femme devint sévère :
– Non, non, ça ne peut pas aller sans la permission d’Avram.
– Mais baï Avram ne le laissera pas partir !
Il était évident que la bienveillance d’Avramitsa s’était quelque peu refroidie. En un instant son esprit lui représenta les dangers auxquels serait exposé son enfant s’il partait pour Biala-Tcherkva. Elle avait peur, en face de cet homme terrible et étrange ; elle regretta de ne pas l’avoir renvoyé tout de suite et commença à tourner anxieusement les yeux de tous côtés. Cependant son bon cœur ne permettait pas à une pensée méchante de pénétrer dans son esprit.
Ognianov remarqua son trouble. Il comprit qu’on ne pouvait pas traiter une question si sérieuse avec une femme faible et indécise. Le temps passait et il lui fallait réfléchir aux moyens de s’évader. Il résolut d’être plus net :
– Tante Avramitsa, dis à baï Avram de venir un instant ici. Je lui parlerai.
Avramitsa se sentit aussitôt soulagée :
– Je vais le lui dire à l’oreille ; toi, reste ici et n’oublie pas la petite porte. Si tu entends du vilain dehors, rappelle-toi...
Et elle sortit.
32 AVRAM
Ognianov demeura seul. Il décida d’être franc avec Avram lui aussi. Il devait donc se confier entièrement à lui, compter sur sa loyauté ou être le jouet de sa félonie. Mais le but qu’il se proposait valait, pour être atteint, cent fois le sacrifice de sa vie. Quoi qu’il en fût, il tablait sur les sentiments de bon Bulgare d’Avram : capable d’un refus mais non d’une trahison. Boïtcho entendit dans le vestibule des pas sourds, les pas d’une seule personne ; il comprit que c’était Avram et il attendit tranquillement près de la porte.
Elle livra passage à l’aubergiste. Son visage gras, rougeaud, était épanoui dans un large sourire. Il verrouilla l’huis.
– Oh ! sois le bienvenu, comte, sois le bienvenu ! Ça va la santé, ça va ? Tu as très bien fait de venir, on va faire un brin de causette. Je suis content, ah ! que je suis content ! Tout le monde, ma femme et mes garçons se réjouiront : pense un peu, ça fera une demi-année que Nanko ne t’a pas vu. Tu as été son maître à l’école, tu es son éducateur. Sois le bienvenu parmi nous, sois le bienvenu. Quelle bonne aubaine, tiens ! quelle bonne aubaine !
L’enthousiasme et les joyeuses effusions de l’aubergiste n’en finissaient plus.
Ognianov était enchanté. Il aborda hardiment la question, exposa la situation en quelques mots, renouvelant la demande qu’il avait faite à Avramitsa.
De contentement et de joie la figure de l’aubergiste se détendait de plus en plus.
– Mais oui, mais oui, comment donc !... Très bien ! Ça va de soi ! Ça ne se refuse pas, un coup de main pour le bien du peuple.
– Je vous remercie, baï Avram, dit Ognianov, ému. À cette heure suprême tout Bulgare a le devoir de s’imposer des sacrifices et d’apporter son aide à la patrie.
– Y en a-t-il qui ne voudraient pas aider, un seul Bulgare qui s’y refuserait ! Celui qui marchanderait son secours à une chose si sacrée serait maudit de Dieu. C’est bon, c’est bien comme ça. Lequel des garçons voudras-tu ?
– Envoyons Nanko. Étant le plus âgé, il sera plus malin.
– Ça va, ça va. Ton élève... Pour toi il donnerait sa tête. Ah ! qu’il sera content quand je lui aurai dit. As-tu écrit le petit mot ?
La voix d’Avram tremblait de joyeuse émotion.
– Je vais l’écrire.
Et Ognianov fouilla dans ses poches :
– Tu as un bout de papier ?
L’aubergiste sortit un bout de papier fripé, posa son encrier devant Ognianov et dit :
– Écris ta lettre, toi, pendant que je ferai un saut à la boutique : ces chiens, tu les connais – de vrais pillards !
– Reviens vite, baï Avram, et amène Nanko ; comme je te l’ai dit, je ne m’attarderai pas, je pars.
– Tout de suite.
Et l’aubergiste, après avoir jeté un dernier et radieux regard à son hôte, claqua la porte derrière lui.
Une minute suffit à Ognianov pour écrire le billet, quelques lignes seulement :
« Insurrection éclatée, en plein essor ! N’hésitez pas une minute : déclarez immédiatement la révolte. Qu’une tchéta frappa l’arrière de Tossoun-Bey ; qu’une autre soulève les villages. Courage et confiance !... Bientôt, je serai à vos côtés. – Mourir pour la Bulgarie ! Vive la révolution !
« Ognianov. »
Boïtcho se félicitait d’avoir réussi ; il n’aurait Jamais supposé chez Avram un tel empressement, un tel patriotisme. Il guettait maintenant, avec impatience, le bruit des pas du père et du fils. La rumeur de la rue et l’aboiement des chiens lui parvenaient, assourdis. La lampe clignotante luisait tristement et envoyait au plafond une colonne de fumée étouffante.
Soudain, un cri déchirant, un sanglot de femme, se fit entendre dans la chambre contiguë. Ognianov frissonna. C’était la voix d’Avramitsa. Il eut peur.
De nouveau il tendait l’oreille : des pas étouffés s’éloignaient de l’appentis.
Il alla à la porte basse qu’il tira.
La porte ne s’ouvrit pas. Il tira de toutes ses forces ; elle ne cédait pas, semblait clouée. L’épouvante s’empara de lui, ses cheveux se hérissèrent.
« Je suis trahi ! » gémit-il.
Au même instant un bruit se fit à la porte, comme si on y poussait une clef. Elle s’ouvrit brusquement, laissant pénétrer le souffle de la nuit. Ognianov scruta le trou sombre ouvert sur le jardin. Une tête apparut.
C’était Avramitsa.
– Sors vite, chuchota-t-elle.
Bien que la lueur de la lampe éclairât faiblement son visage, Ognianov vit briller des larmes dans ses yeux.
Il se glissa par la porte et se trouva dans le jardin.
– Par ici, fit tout bas Avramitsa, lui montrant un prunier près de la clôture.
Et elle disparut dans la nuit.
Se jetant par-dessus la haie, Ognianov atteignit la rue qui passait derrière la maison. Il enfila la rue et se retrouva devant l’auberge où il se heurta à une bande de Turcs armés qui, passant en trombe par la porte cochère, s’engouffrèrent dans la cour...
Ognianov lui aussi se perdit dans les ténèbres.
33 LA NUIT
Minuit était depuis longtemps passé quand Ognianov, ayant réussi à éviter les multiples dangers semés sur sa route, fut enfin de retour dans les retranchements.
Les défenseurs, couchés dans l’obscurité sur des tapis et des nattes apportés de leurs maisons, ne dormaient pas encore. Ils causaient à voix basse sous leurs houppelandes, les yeux levés vers un ciel sans lune où brillaient les étoiles. Ognianov se faufila sans bruit et se laissa tomber à terre, exténué, dans un complet abattement physique et moral. Il tâchait de concentrer ses pensées ou au moins de trouver le sommeil qui lui était si nécessaire pour pouvoir accueillir en pleine force le lendemain. Mais ses pensées s’envolaient dans l’espace, dispersées comme un essaim d’abeilles effrayées, et le sommeil continuait à fuir ses paupières alourdies. Le sommeil ne vient pas facilement à la veille d’une bataille ou plutôt d’une catastrophe.
Un petit groupe d’insurgés, couchés assez près de là, parlaient à voix basse. Ognianov les écouta.
– Tourne et retourne la chose autant que tu voudras, notre compte est bon, disait l’un d’eux.
– On nous a trompés, frère, on nous a trompés, soupirait un autre.
– Nous avions dû perdre l’esprit, pour obéir à ces coquins. Nous avons nous-mêmes mis le feu à nos maisons, fit un troisième.
– Quel besoin avait-on de se révolter ?
– Il est trop tard pour se lamenter là-dessus.
– Alors quoi ?
– Un remède, c’est un remède qu’il faut chercher.
– Il n’y a qu’un seul remède : prendre nos jambes à notre cou, fit une voix qu’Ognianov crut reconnaître.
– C’est ça, c’est ça : c’est pas les mères des fuyards qui versent des larmes.
– Bien au contraire : celles de ceux qui restent.
– Décampons demain par Varlichtnitsa.
– Non, mieux vaut tout de suite...
– Pas moyen, la garde nous arrêtera...
– Demain, demain.
– Oui, pendant la mêlée.
– Alors tout le monde sera pressé de s’enfuir et les autres prendront le devant.
– Seul Ognianov est un chien... Il n’y a que lui pour nous attraper.
– Hé ! hier déjà Ognianov a déguerpi.
– Déguerpi ?
– Pour des mauvais coups il n’y a que nous, pauvres malheureux !
Ognianov se dressa et cria :
– Vous mentez, misérables, je suis ici !
Au son de cette terrible voix sortant des ténèbres, les autres se tinrent cois. Ognianov avait suivi la conversation, indigné ; nul doute, elle révélait l’état d’esprit des insurgés dans ce retranchement, comme dans les autres. L’une des voix lui avait paru familière. Mais qui était-ce ? Il ne pouvait se le rappeler.
« Mon Dieu, mon Dieu ! pensait-il en serrant sa houppelande sur sa poitrine, pour ne pas être pénétré par le souffle tranchant de la nuit. Quels concours de malheurs ! Quelles désillusions ! Quelles trahisons ! Après cela, va chérir cette maudite vie, cramponne-toi à elle ! Demain aura lieu le combat et j’entrevois dès à présent son issue. La panique est dans les cœurs : de peur de la mort qu’ils étaient venus chercher ici, leurs bras défaillent, leur raison s’obscurcit. Ce peuple était plein d’enthousiasme, plein d’espoir, il avait confiance comme un enfant, et maintenant, comme un enfant, il tremble. La lâcheté des uns entraîne les autres à la lâcheté... Biala-Tcherkva et les autres centres ont trompé notre espoir, ont démoralisé Klissoura. C’est une trahison de la cause commune. Cette ville d’intrigues n’était donc capable que de donner naissance à des traîtres ? Elle met au monde des Kandovs, des Avrams, elle a su créer Rada ! Ah ! cette Rada qui empoisonne les dernières heures de ma vie ! Je cherche la mort en la maudissant. J’aurais pu mourir heureux et fier, ah, mon Dieu ! aimé, enveloppé des rayons de l’amour, sachant qu’au moins une larme pure serait versée à l’évocation du lieu inconnu de ma tombe. Non, il te faut mourir quand tout dans ce monde est mort pour toi, quand tes idoles sont dans la boue et quand ton idéal est enseveli ! Amour, révolution ! Combien pénible et sans espoir est une telle mort, mais comme elle est désirable, nécessaire pour des malheureux comme moi ! »
Le vent de la montagne soufflait tristement sur les champs assoupis. Les ténèbres rendaient encore plus sinistre le sourd bruissement des forêts voisines. Cimes, vallons, montagnes, la nature entière gémissait farouchement. Au ciel, les étoiles anxieuses clignotaient rapidement. Les cris d’oiseaux nocturnes déchiraient de temps à autre le silence des solitudes, puis de nouveau se faisait le silence. Au-dessus des têtes des insurgés étendus à côté de leurs tranchées, le vent de la montagne bruissait, traînant et triste comme une plainte lointaine. Éveillant un écho douloureux dans leur âme, cette plainte les faisait tressaillir et scruter les ténèbres. Puis ils sombraient de nouveau dans un sommeil inquiet, plein des fantômes blafards de l’épouvante, entrecoupé par le baiser glacial du vent.
Enfin, montant de Klissoura, le chœur strident des coqs fendit l’air nocturne, emplissant les solitudes montagneuses de son allègre salut, précurseur de l’aurore, du soleil doré, de la vie de l’éternel renouveau printanier.
34 AU MATIN
En dépit de son trouble, Ognianov finit par s’endormir d’un sommeil profond qui dura deux heures ; un sommeil pareil s’empare, dit-on, des condamnés à mort à la veille de leur exécution. Se réveillant dès l’aube, Ognianov regarda autour de lui. La nature s’éveillait. Il commençait à faire jour. Le ciel d’un bleu très pâle avait perdu jusqu’au dernier clignotement d’étoile. À l’est, il blanchissait toujours davantage. Une traînée rouge feu s’étendait le long des crêtes des montagnes, elle ressemblait au reflet d’un lointain incendie. Des lambeaux de brouillard transparent se blottissaient encore au fond des ravins de la Ribaritsa, mais la couronne de neige du pic rosissait déjà sous les rayons de l’aurore. Seul, le sommet froid de Bogdan était encore enveloppé de brume. Mais peu à peu la brume se dissipa, la lumière devint plus blanche et plus forte, et les montagnes, les forêts, les collines sourirent à l’entour joyeusement sous la voûte azurée de l’aube printanière. La forêt retentit du chant matinal des rossignols.
Ognianov se leva, jeta un regard sur les insurgés encore couchés et qui grelottaient sous les tapis de poil de chèvre et les houppelandes dans lesquelles ils s’étaient enroulés, puis il se dirigea vers Zli-Dol : il allait examiner la situation avec le Conseil militaire. Il disparut bientôt dans le vallon qui coupait sa route.
Maintenant il faisait tout à fait clair. Le soleil se levait. Déjà debout, les insurgés, sous la direction des dizainiers, se mirent au travail : ils devaient terminer les nouvelles tranchées destinées au petit détachement envoyé la veille en renfort. Les insurgés étaient ragaillardis ; Martchev leur avait confié qu’Ognianov avait fait une reconnaissance au-delà de Tékia et qu’il savait pertinemment que, ce jour même, Biala-Tcherkva allait se soulever. Cette nouvelle avait remonté leur courage. Les gars s’animaient, leurs yeux brillaient, ils s’égayaient, certains même fredonnaient des chansons railleuses. L’humour, propre au Bulgare, ne tarda pas à se manifester. On se gaussait des quatre Klissouriens qui avaient été condamnés à exécuter le tzigane.
– Avoir manqué Mehmed à cinq pas, et tirer une seconde fois ! ses péchés retomberont sur vous. La minute de vie que vous lui avez involontairement octroyée équivaut à un siècle de tourments. Il a expié tous ses péchés, disait l’un.
– Le diable vous emporte ! reprit un autre, vous avez fait de lui un martyr et maintenant il est dans le paradis de Mahomet.
– Tu mens, riposta un troisième, Ditcho et Stamen le Corbeau l’ont jeté là-bas dans la mare et maintenant il est au royaume des grenouilles.
Les rires fusèrent.
– De si près et pas une balle ne le touche ! s’écria un autre. À cette distance-là, je l’aurais atteint avec un jet de salive.
– Je donnerais ma tête à couper si seulement vous avez visé.
– Oui alors, pour sûr, ma grand-mère elle-même l’aurait touché à cette distance.
– Mais si, on a visé, disait une des victimes de ces quolibets.
– Visé oui, mais les yeux fermés.
– C’est vrai, je les ai fermés, mais pas avant de presser la gâchette...
Nouveaux rires.
D’autres taquinaient Ratchko au sujet de son nom.
– Dis donc, le Péteux, qui t’a honoré d’un si glorieux nom ? demandait l’un.
– Ratchko ! Ce n’est pas ton nom, tu mens ! disait un autre.
Ratchko se blessa :
– Qui ment ? Demandez au comte.
– Non, non, tu mens : prouve donc que tu es bel et bien péteux.
Et le farceur expliqua quelle démonstration il exigeait.
– Et savez-vous ? Hier, il nous a pris pour des brigands !
– Et il avait raison, remarqua quelqu’un. Boritmetchka l’a dépouillé : il a raflé ses ciseaux et son aune.
– Oui, oui, il les a pris comme ça dans mon sac, le méchant, confirma Ratchko.
– Pour quoi faire ?
– Il les a mis en pièces pour en faire de la mitraille.
– Oh, mais alors, même Sébastopol ne pourrait pas nous résister !
– Si notre batterie se distingue comme celle de Zli-Dol, il ne restera plus un seul Turc en vie.
– Et le royaume de Klissoura restera dans tous les siècles des siècles intact !
– Qu’est-ce que c’est, ces signaux là-bas ? s’écria un des insurgés qui s’était tourné vers l’est.
Tous dirigèrent leurs regards de ce côté.
Les sentinelles signalaient aux retranchements qu’ils avaient aperçu l’ennemi. En même temps, deux hommes de cette garde couraient vers Zli-Dol pour porter des détails au Conseil militaire.
Les messagers étaient à peine arrivés sur les remparts que, du côté de Rahmanlari, apparurent deux détachements turcs de vingt cavaliers chacun. L’un passait sur la route, l’autre à travers champs. Les insurgés, très émus, scrutaient l’horizon : les cavaliers n’étaient-ils pas suivis de quelque autre force ? Mais plus rien n’apparut.
Tout de suite, deux détachements d’insurgés, plus forts en nombre que les détachements turcs, mais à pied, descendirent en courant des remparts pour affronter les Turcs. Le plus fort de ces détachements sortait du retranchement de Zli-Dol.
– Qui le mène ? demandaient les insurgés et ils fixaient celui qui était en tête.
– Ne voyez-vous pas ? Ognianov ! crièrent quelques-uns.
– C’est le comte, c’est le comte, je le jure. Sous quelque déguisement que ce soit, je le reconnaîtrais. Dans l’auberge de Karnary, croyez-moi ou non...
Mais personne n’écoutait Ratchko.
Ayant aperçu les détachements bulgares, les Turcs s’arrêtèrent puis tournèrent bride.
– Ils ne s’y frotteront plus, les amis ! lancèrent joyeusement quelques insurgés.
– Aujourd’hui non plus, il n’y aura pas de combat.
– Il semble que Biala-Tcherkva leur a donné du fil à retordre, conclurent quelques autres.
Et le retranchement retentit de nouveau du bruit du travail et des joyeuses reparties.
35 LE COMBAT
L’heure du repas vint et passa. Le soleil était au zénith. Sur la position d’Ognianov, les insurgés achevaient leur repas et se hâtaient de fourrer dans leurs sacs les miches de pain et les autres restes de nourriture. Leurs visages, tourmentés, noirs de poussière, et qu’ils n’avaient pas lavés depuis toute une semaine, étaient inquiets. Le trouble revenait dans leur esprit. Le faible succès les avait ragaillardis mais pour quelques instants seulement. Ils savaient qu’aujourd’hui ou demain serait le jour décisif. Ils sentaient accourir l’orage et, d’heure en heure, ils jetaient des regards anxieux vers l’est, vers les plateaux dénudés où les sentinelles dispersées semblaient de petits points noirs.
Le soleil était brûlant. À droite de la batterie, montée la veille au soir, Ognianov, à peine arrivé de Zli-Dol, ruisselant de sueur, s’était mis vivement au travail avec quelques autres hommes : ils se hâtaient de terminer la nouvelle tranchée. Comme nous l’avons dit, la veille, le Conseil militaire leur avait envoyé un renfort d’une dizaine d’hommes et les tranchées ne suffisaient plus.
– Daskal ! appela un paysan d’une cinquantaine d’années.
Ognianov se retourna :
– Qu’y a-t-il, oncle Marine ?
L’homme de Vérigovo lui tendit un billet plié en quatre :
– On a apporté une lettre pour toi.
– Qui l’a apportée ? demanda Boïtcho avant de déplier le papier.
– Ivan Borimetchka. Il te cherchait hier soir, mais comme il ne t’a pas trouvé, il me l’a donnée pour te la remettre dès que tu apparaîtrais.
– A-t-il dit de qui c’était ?
– De l’institutrice.
Une douleur aiguë serra le cœur d’Ognianov. Il froissa convulsivement le papier, voulut le jeter, mais changea d’idée : on aurait pu remarquer le geste. Il fourra machinalement la lettre dans sa poche et il reprit aussitôt son travail, avec des gestes rapides et fiévreux, cherchant à dominer le trouble de son âme.
– Et cette Rada, à ce moment ? Pourquoi m’écrit-elle et que me veut-elle ? Ne verrai-je pas enfin le combat, pour y trouver la mort et que tout soit fini ?
À ce même instant un mouvement insolite se produisit parmi les insurgés. Tous se précipitaient sur les remparts et regardaient vers l’est.
Ognianov leva la tête et regarda aussi les collines dénudées. Là-bas les hommes en sentinelle faisaient des signaux d’alarme. Puis ils tirèrent quelques coups de fusil : ils signalaient ainsi qu’ils avaient observé de grandes forces ennemies. Bientôt ils accoururent en criant :
– Les Turcs, beaucoup de Turcs !
Le trouble s’empara du retranchement. Ses défenseurs, pâles d’émotion, se mirent à courir de-ci de-là.
– À vos places ! Je vous l’ordonne ! rugit Ognianov saisissant son fusil dans le tas des armes.
Le cri d’Ognianov secoua les insurgés et ils commencèrent à prendre place derrière les remparts.
Aux moments critiques, le courage et la présence d’esprit d’un seul agissent magiquement sur les masses et les subjuguent. Le chef est alors celui qui veut bien l’être.
Quelques hommes des avant-postes arrivaient. Ils étaient exténués. Ognianov alla à leur rencontre :
– Qu’avez-vous vu ?
– Des Turcs ! Une terrible horde s’approche. Ils doivent être un millier. La route est noire de bachi-bouzouks.
Ognianov leur fit signe de se taire.
– Restez à vos places ! cria-t-il vers les remparts, voyant que bon nombre d’insurgés avaient perdu patience et sortaient des tranchées.
– Oh ! il y en a beaucoup, beaucoup ! s’écriaient d’autres en fixant le regard par-dessus les remparts.
– À vos places ! Aux armes, tous ! commanda de nouveau impérieusement Boïtcho.
Ils retournèrent derrière les remparts.
– Les voilà !
En effet, dans le lointain, à l’endroit où la route débouche de derrière le plateau, apparut la tête d’une épaisse colonne ; à chaque instant elle s’allongeait un peu dans la direction des positions, rampant comme une immense chenille. C’était la horde de Tossoun-Bey. Plus elle avançait, plus on voyait combien elle était large et nombreuse. Les Turcs marchaient par quatre de front ; vingt petits étendards et trois grands drapeaux, blancs, rouges, verts et d’autres couleurs, flottaient au-dessus d’eux. Bientôt la colonne couvrit toute la route, de la tour jusqu’à Biala-Voda, sur environ deux kilomètres de longueur.
Dans les rangs des insurgés, l’agitation se manifestait de nouveau. Personne ne tenait en place ; chacun se levant et essayant craintivement de se rendre compte de ce qui se passait à l’entour. Seul le regard farouche d’Ognianov les retenait quelque peu.
La colonne noire continua sa marche sur la route jusqu’à ce qu’elle fût arrivée à un petit puits qui se trouvait à portée de fusil des retranchements.
Alors la garde de Zli-Dol tira quelques coups de feu ; au même instant, sur le commandement d’Ognianov, sa position fit une décharge générale. Et le canon gronda à son tour. Une fumée épaisse couvrit les remblais ; la détonation fendit l’air et réveilla les échos de la montagne.
À ce moment, Ognianov aperçut les têtes de trois hommes qui dévalaient le chemin menant au vallon de Stara-Réka ; ces insurgés abandonnaient la position à la faveur du désordre et du rideau de fumée. Dans ce groupe de fuyards, Ognianov reconnut les hommes qui, la veille, près de lui, combinaient des plans de désertion.
En quelques enjambées, il fut au bord de l’éminence qui dominait le val. Les fugitifs s’étaient engagés dans un étroit sentier creusé par les torrents et marchaient l’un derrière l’autre.
– En arrière ! Rebroussez chemin ou je vous abats ! leur cria-t-il en les mettant en joue.
Les fuyards se retournèrent et restèrent pétrifiés. Ils avaient laissé leurs fusils en haut. Ognianov reconnut l’un d’eux : le diacre Vikenti ; il était rasé et portait des habits d’insurgé. Le pauvre garçon avait rougi de honte jusqu’à la racine des cheveux.
Machinalement, ils revinrent sur leurs pas.
– Oncle Marine, amène ici ces poltrons et fourre-les dans les tranchées. S’ils regimbent, tu peux leur casser la tête.
Et Ognianov retourna rapidement à son poste.
– Eh, fils de chien ! si au moins, avant de prendre la poudre d’escampette, vous vous étiez donné la peine de tirer un coup de fusil, gourmandait l’oncle Marine en les menant à la tranchée, son fusil braqué dans leur dos.
L’énergie du chef en imposa aux autres insurgés. Ils se retinrent de manifester leur peur mais pendant quelques instants seulement. Les lèvres de la plupart s’étaient crevassées et saignaient. Les Turcs n’avaient pas encore tiré un seul coup de fusil. La chute de leurs camarades atteints par les premières salves des remparts avait causé un trouble momentané dans leurs rangs. Ils avaient transporté les blessés près des clôtures des jardins de roses et avaient reculé. Ce premier succès encouragea les insurgés et ils continuèrent énergiquement à faire feu sur l’ennemi. La montagne et les collines étaient secouées par ces détonations ininterrompues.
De petits nuages blancs planant au-dessous des éminences indiquaient la présence des retranchements et le tir continuait, alors que les Turcs étaient déjà hors de portée. À une assez grande distance derrière la horde apparurent quelques cavaliers. Ils constituaient l’état-major de Tossoun-Bey. Les Turcs s’approchèrent d’eux et les entourèrent. Un conseil avait probablement lieu et le plan d’attaque allait être changé. En effet, on remarqua un certain mouvement dans la colonne : elle se déchira en plusieurs groupes qui se séparèrent puis, comme sur un signal, tous ces détachements poussant des cris affreux et ne gardant plus aucun rang, se ruèrent dans un élan violent. Les uns couraient, sur les hauteurs dénudées, vers la montagne ; les autres vers les ravins de Zli-Dol ; les troisièmes vers la Sredna-Gora, vers le vallon où la Stara-Réka ouvre le défilé de Klissoura ; les quatrièmes vers les vignobles, vers le retranchement bulgare. De loin encore, les insurgés les accueillirent par des décharges, mais les Turcs ne commencèrent à tirer que quand ils furent dans la zone de feu. Pendant quelques minutes, la fumée du tir continu voila complètement le retranchement, mais le nombre des tirailleurs diminuait, baissait toujours davantage. Ognianov, le visage noirci de poudre, éclaboussé d’une boue où la sueur traçait des rigoles, ivre de l’odeur du sang, étourdi par le sifflement des balles filant au-dessus de sa tête, tantôt se dressait, déchargeant son fusil qui crachait une fumée blanche, et tantôt s’abritait derrière le rempart.
D’instant en instant, il criait inconsciemment, sans même jeter un regard à travers la fumée qui l’enveloppait :
– Frappez ! Tirez ! Courage, frères !
Tout à coup, il entendit à ses côtés la voix d’oncle Marine s’adressant à quelqu’un :
– Baisse-toi, mon gars, baisse-toi... Tu vas être touché !
Ognianov se tourna involontairement à droite et, à travers la fumée balayée par le vent, il vit un insurgé qui tirait sur les ennemis, debout, sans jamais se baisser, complètement exposé aux balles. Cette témérité était une véritable folie.
Ognianov, stupéfait, reconnut Kandov.
Saisi d’émotion, il alla vers lui et, dans le nuage de fumée, lui tendit la main :
– Frère, donne-moi ta main.
L’étudiant se retourna, regarda calmement et froidement Ognianov, mais pourtant lui serra la main avec force. Ce geste des deux adversaires était le signe de la réconciliation devant la patrie ensanglantée et sans doute le symbole de l’adieu suprême, de la séparation éternelle.
Un filet de sang mouilla la main d’Ognianov qui tenait celle de Kandov : il avait coulé de la manche de l’étudiant.
Ognianov le vit, mais sans s’étonner, il ne comprit même pas ce que signifiait ce sang, ce qui le saisissait était de voir là Kandov.
L’étudiant, après avoir quitté la chambre de Rada peu après Ognianov, s’était rendu au dépôt d’armes et de là vers les retranchements du côté de la Stara-Réka. Envoyé la veille avec le renfort, il n’avait pas été remarqué par Boïtcho, plongé dès le matin dans les occupations absorbantes de sa fonction.
Se reculant quelque peu, Ognianov, debout, regarda autour de lui.
Alors seulement il remarqua que la tranchée était presque vide. Les insurgés avaient disparu de la position. Cinq ou six hommes seulement, dont Kandov, étaient restés et continuaient un tir de moins en moins nourri. Des autres positions aussi le feu devenait toujours plus rare ; leurs défenseurs avaient déjà commencé à les abandonner. Au contraire, les balles de l’ennemi se déversaient avec abondance et rendaient dangereuse toute sortie des tranchées.
Ognianov, désespéré, fou de colère, décidé à mourir à son poste, soutenait, avec le peu de braves qui étaient restés, cette lutte inégale. D’ailleurs, du côté est, la fumée ne s’attachait plus qu’à ce seul retranchement.
– Oh, ma mère ! gémit quelqu’un tout près.
Ognianov, saisi, se tourna vers sa gauche, d’où il venait. Dans la tranchée, étendu sur le dos, gisait Vikenti. Un filet de sang coulait entre son cou et sa poitrine, empourprait la terre molle. La balle l’avait mortellement atteint. Ce sang lavait sa honte.
Oncle Marine le porta sous un abri, un peu de côté, de là d’autres insurgés auraient dû le porter à la ville, mais plus personne n’était là. La hauteur était déserte.
Un silence lugubre régnait derrière le rempart. Quelques rares coups de feu, partis des hauteurs non menacées, au nord et à l’ouest de la ville, se joignaient, inutilement du reste, à ceux du retranchement d’Ognianov qui attirait les balles ennemies comme l’aimant attire la limaille de fer. Les Turcs continuaient à avancer, tirant sans interruption. Ils se glissaient avec précaution à travers les vignobles et les roseraies qui les séparaient encore des retranchements, s’accroupissaient derrière des abris accidentels, s’aplatissaient d’instinct dès qu’ils remarquaient qu’on allait tirer d’une des hauteurs. Ils s’emparaient l’un après l’autre des remparts que la panique avait déjà vidés. Au lieu des défenseurs ou de leurs cadavres, ils trouvaient là des armes, des cartouchières, des havresacs, des vêtements, d’autre butin encore. Ils trouvèrent aussi les canons en bois de cerisier apportés la veille, par deux, par trois, dans chaque retranchement. À deux exceptions près, les canons étaient restés chargés, aucun des combattants n’avait eu l’idée d’allumer leurs mèches.
Les Turcs apparurent sur les hauteurs de Chaïkovetz et au-dessus de la ville. Dans les rues on tira sur eux et leur porte-étendard ainsi qu’un autre homme furent abattus. Mais le sort du combat et de la ville même, qui déjà fumait à plusieurs endroits, avait été décidé en faveur des hordes de Tossoun-Bey, noires et hurlantes nuées qui dévalaient les collines pour s’abattre sur la malheureuse Klissoura, comme de noires nuées de corbeaux sur un cadavre encore chaud.
36 RADA
Dès que les premiers coups de feu tirés sur les hauteurs annoncèrent à la ville de Klissoura le début du fatal combat, les habitants, saisis d’une terreur panique, se mirent à fuir vers Koprivchtitsa, en passant par Varlichtnitsa, gorge étroite de la Sredna-Gora, où coule la rivière de même nom qui, au sud-ouest de la ville, se jette dans la Stara-Réka.
Mme Mouratliiska, chez qui habitait Rada, prit à la hâte chez elle les choses les plus précieuses, rassembla les enfants et, en quelques minutes fut prête à abandonner sa maison et à fuir avec les autres. Elle entra chez Rada et voulut l’emmener mais ses supplications furent vaines ; Rada refusait de la suivre, elle était décidée à rester ici... La bonne Mme Mouratliiska, les larmes aux yeux, tombait à genoux, l’adjurait de partir immédiatement ; elle ne pouvait l’abandonner à un sort si affreux. Les Turcs apparaissaient déjà sur les escarpements : chaque minute devenait précieuse.
– Va, va, Anitsa, emmène les enfants... Je t’en prie, laisse-moi ici, criait Rada, poussant Mme Mouratliiska vers la porte.
Mme Mouratliiska la regardait avec effroi et joignait les mains dans un geste d’impuissance. Jetant un coup d’œil par la fenêtre, elle vit que les Turcs dévalaient déjà vers la ville. Elle ne savait plus que faire. Seul le désespoir avait pu amener Rada à cette obstination insensée. Et, en effet, Rada était en proie à un profond abattement.
Depuis l’affreuse querelle entre Ognianov et l’étudiant, elle était restée comme écrasée, anéantie par le mépris de son bien-aimé. Dans son effarement, elle n’avait pu se disculper dès l’abord et ensuite elle ne l’avait plus revu. Donc Ognianov se trouvait encore à présent dans son affreuse erreur et ne devait éprouver pour elle que haine et répulsion. S’il tombait dans le combat, il mourrait, la malédiction aux lèvres et dans des souffrances morales atroces. Cette pensée épouvantait Rada. Elle n’avait plus une minute de paix. Sa conscience la tourmentait ; elle aurait pu le calmer, lui ouvrir les yeux, elle ne l’avait pas fait. Cet homme, d’une telle droiture, allait mourir, malheureux, désespéré ; il était allé à la rencontre de la mort ; certes, il ne la craignait pas, mais elle, Rada, devait la lui rendre plus légère, elle devait agir de telle façon qu’il quittât la vie serein, consolé par la pensée qu’il mourait aimé. Et peut-être même cette pensée l’arracherait-elle des griffes de la mort ; peut-être ne la rechercherait-il plus ; peut-être conserverait-il la vie pour lui-même et pour la patrie...
Mais il n’était pas descendu une seule fois dans la ville. En vain elle avait cherché, plusieurs fois et sous divers prétextes, à aller jusqu’aux retranchements pour le voir, ne fût-ce qu’une minute, même si elle devait subir son indignation, soutenir son regard flamboyant : on lui avait obstinément refusé tout accès aux positions. Sa seule consolation avait été son entrevue avec sa voisine Staïka, la femme de Borimentchka. Celui-ci était descendu trois fois en ville, chargé de diverses missions et, en passant chez sa femme, il lui avait donné des nouvelles d’Ognianov. C’est donc par Staïka que Rada savait qu’Ognianov était sain et sauf, qu’il était très occupé, mais rien de plus. Au cours de ces six jours, longs comme des siècles, en même temps que ses tourments croissait son amour pour Boïtcho, si malheureux et si brave. Cette passion était devenue un culte. Elle se représentait ce preux, magnifié par sa témérité, auréolé de gloire, affrontant la mort haut, un sourire amer aux lèvres, sans se retourner pour jeter un dernier regard vers la ville, sans murmurer un adieu suprême à celle qui ne pourrait vivre sans lui et qu’il avait écrasée de son mépris. La veille au soir, pour la première fois, elle avait rencontré Borimetchka ; elle s’était abandonnée à sa douleur, avait pleuré des larmes brûlantes devant lui. Le brave Ivan l’avait consolée autant qu’il l’avait pu, et lui avait promis de remettre à Boïtcho, sans tarder, une lettre écrite à la hâte, au crayon. Pour les raisons que nous savons, cette lettre avait été remise à Ognianov juste avant le combat. Mais pas un mot de réponse : le désespoir de Rada n’avait plus de bornes. Elle sentait qu’elle ne vivrait pas si Boïtcho emportait avec lui son mépris dans la tombe vers laquelle elle l’avait poussé ; la vie lui paraissait affreuse où la source de l’amour et du bonheur était à jamais tarie. Que pouvait lui offrir, à l’avenir, l’existence ? Des souffrances sans remède, des regrets amers, le mépris de tous, le désespoir... À quoi bon une telle vie ? Qui donc en avait besoin ? Sur qui s’appuierait-elle sans humiliation ? Tcherkva se dressait maintenant devant elle, hideuse et noire comme la mort. Irait-elle auprès de hadja Rovoama, se soumettre de nouveau à celle-ci ? Auprès de Marko pour demander sa protection ? Oserait-elle lever les yeux vers lui ? Elle mourrait de honte devant cet homme si bon. Lui aussi avait, probablement, entendu les abjectes calomnies répandues sur elle et se repentait de la bonté qu’il lui avait montrée, car Rada, le jour même où elle quittait Biala-Tcherkva, avait su la vilaine rumeur qui essayait de la déshonorer. Non, non, seul Boïtcho pouvait la consoler, la sauver ! Mais s’il mourait ? Mme Mouratliiska avait raison, elle, de vouloir vivre. Elle savait pour qui et pour quoi elle vivait et il y aurait quelqu’un pour la pleurer, parce qu’il y avait quelqu’un pour l’aimer... Mais elle, Rada ? Elle ne pourrait pas porter le poids de son malheur, elle était trop faible. Elle n’avait que faire dans ce triste monde auquel plus rien ne la reliait. Et si Boïtcho restait en vie ? Comme il la mépriserait, puisqu’elle ne pourrait se justifier : les faits étaient contre elle. Son amour-propre blessé ne pourrait lui pardonner, le coup porté à son cœur et à son orgueil était trop cruel... Jamais, jamais Boïtcho ne voudrait la revoir. Il était inflexible quand il s’agissait de l’honneur, elle le savait. Non, non, elle devait mourir. On pouvait mourir facilement, et même glorieusement, sous les ruines, les nobles ruines de cette ville héroïque. Que Mme Mouratliiska parte donc ! elle, elle restera ici, pour mourir ! Oui, puisque Boïtcho ne lui a pas dit de vivre, puisqu’il ne lui a pas fait l’honneur de lui écrire un seul mot, elle mourra. Et si la mort l’épargne, lui, il saura que la Bulgare, elle non plus, ne redoute pas la mort, que Rada était une fille honnête et qu’elle s’est sacrifiée à son amour.
Ces réflexions, et d’autres encore, fruit du désespoir dans une âme tendre, abattue par le chagrin, tourbillonnaient comme des nuées d’orage dans la tête de Rada, au moment où Mme Mouratliiska la tirait et la suppliait de la suivre. Mais Rada était inflexible.
À ce moment, on entendit des Bulgares crier dans la rue. Mme Mouratliiska courut à la fenêtre ; elle vit des insurgés et demanda à l’un d’eux :
– Baï Christo, que se passe-t-il là-haut ? Où est Ognianov ? Et vous, où fuyez-vous ?
L’homme répondit, hors d’haleine :
– L’affaire est perdue, perdue ! Anitchka, Ognianov, le pauvre, il est resté là-bas. Que de monde a péri ! Fuyez, fuyez au plus vite vers Varlichtnitsa !
Et les insurgés disparurent. Baï Christo était, évidemment, du détachement d’Ognianov. Rada poussa un cri déchirant. Alors Mme Mouratliiska, ayant fait un dernier et vain effort pour l’entraîner, abandonna sa maison.
Il était grand temps. Quelques instants plus tard, Rada entendit des cris désespérés de femme venant du côté nord de la ville, déjà envahi par les Turcs. Comme elle était là, devant la fenêtre, étourdie de douleur, elle vit dans la rue une bande de bachi-bouzouks qui, le yatagan à nu, poursuivaient deux personnes ; ils les atteignirent, ils les égorgèrent. Elle vit quelques chose de rouge jaillir des corps, elle vit la mort, la mort sous la forme la plus hideuse, et une peur épouvantable s’empara d’elle. L’instinct de conservation s’éveilla chez la jeune fille avec la force d’un élément déchaîné et étouffa en elle tous les autres sentiments, paralysa le désir de mourir, né du désespoir. Elle voulut fuir, se sauver de la mort ou de la vie affreuse que pourraient lui offrir ces hommes ivres de sang et de désirs bestiaux. Elle voulut se précipiter dans l’escalier mais, au même moment, elle entendit la porte de la cour s’ouvrir avec fracas et, à travers les branches des arbres fruitiers, elle vit un homme armé et, derrière lui, un autre qui se dirigeaient rapidement vers cet escalier où, figée, elle s’était arrêtée. Elle reprit ses sens, retourna dans la chambre, claqua la porte, la ferma à clef et, demi-morte d’effroi, alla se blottir dans le coin opposé. Elle y était à peine que des coups formidables furent assenés contre la porte, une voix terrible, une voix de bête féroce rugit. La porte ne s’ouvrant pas, l’homme qui voulait entrer se mit à l’enfoncer, à la briser à grands coups de quelque instrument, une hache à ce qu’il semblait : le battant grinça, craqua, béa d’un côté et, par l’ouverture, se glissa le canon d’un fusil avec lequel l’agresseur s’efforça d’ouvrir. Rada entendait l’éclatement des planches sèches qui cédaient sous la pression du fer, puis elle vit un pied énorme passer par la brèche : l’agresseur pénétrait.
Alors une épouvante inexprimable s’empara d’elle. La mort lui sembla mille fois meilleure que les minutes qu’elle allait vivre. Elle s’élança vers l’iconostase, alluma un cierge à la flamme vacillante de la veilleuse et retourna vite à l’angle de la pièce. Là, sur une table, gisait un havresac plein de poudre, oublié par les insurgés. Le cierge dans sa main droite, elle introduisit l’index de l’autre main dans l’ouverture du sac et commença à y creuser un trou. La flamme entrerait là. Le trou se fit immédiatement.
Au même instant, avec un fracas formidable, la porte s’écroula et un homme d’une taille gigantesque apparut.
C’était Borimetchka, dressé sur le seuil. Derrière lui, Staïka.
Rada ne les reconnut pas et approcha le cierge de la poudre.
87 DEUX RIVIÈRES
À ce moment, Ognianov était loin dans la montagne. Il avait été le dernier à abandonner le retranchement, alors qu’une bande de Turcs escaladaient déjà le rempart, tandis que d’autres tiraient sur lui du retranchement voisin. Sanglant, noir de poudre, la veste trouée, il avait échappé, comme par miracle, aux mains et aux balles de l’ennemi. Il cherchait la mort mais l’instinct de conservation, plus fort que la volonté, l’avait sauvé.
Maintenant il se trouvait sur la crête de la Varlichtnitsa, sur son versant gauche, au pied de laquelle coule la rivière.
Sur son visage, noirci par la poudre, couvert de sang, de sueur, de poussière, coulaient des larmes. Ognianov pleurait.
Il s’était arrêté et regardait les affreux tableaux du naufrage de la révolution. Il restait là, nu-tête, debout.
En bas, dans le vallon, une foule d’insurgés, de femmes, d’enfants, en proie à une folle terreur, cherchaient un refuge à l’intérieur de la montagne. Les cris de ces malheureux parvenaient jusqu’à lui.
En face, Klissoura flambait.
Soudain, son regard tomba sur sa main droite couverte de sang. Il se rappela que c’était le sang de Kandov. De Kandov sa pensée passa à Rada. Ses cheveux se dressèrent sur sa tête : il sortit de sa poche la lettre froissée de Rada et rouvrit. Il lut ces quelques lignes écrites au crayon d’une main tremblante :
« Boïtcho,
« Tu m’as abandonnée avec mépris. Je ne puis vivre sans toi. Je t’en supplie, envoie-moi un seul mot. Si tu l’ordonnes, je resterai en vie. Je suis innocente. Réponds-moi, Boïtcho. Je vis des heures affreuses. Sinon, adieu, mon bien-aimé, je m’enterrerai sous les ruines de Klissoura...
« Rada »
Une douleur indicible se peignit sur le visage d’Ognianov. Il dirigea son regard sur la ville où le feu continuait à se propager. Sur divers points, de nouvelles flammes jaillissaient au-dessus des toits et s’élevaient, léchant l’air de leurs langues rougeâtres. De noirs nuages de fumée s’étendaient, se confondant avec les nuages qui couvraient déjà le ciel entier ; la tombée de la nuit en fut hâtée. Les incendies gagnèrent rapidement tous les quartiers. Les reflets de leur sanglante lueur éclairaient les escarpements, les ravins de la Ribaritsa et les eaux de la Stara-Réka. Ognianov cherchait à voir la maison à deux étages de Mme Mouratliiska. Il parvint à la repérer bientôt et reconnut en tremblant les deux fenêtres de Rada. La maison n’était pas encore atteinte, mais les flammes des bâtiments voisins n’allaient pas tarder à s’emparer d’elle.
« Ah ! la malheureuse, elle doit être là ! C’est affreux ! »
Et il se précipita, par le ravin, vers la vallée. Il dégringolait les pentes friables, se jetait à travers les fossés, se dirigeant vers l’embouchure de la rivière où se trouvait Klissoura.
La gorge de Varlichtnitsa était obstruée de fugitifs des deux sexes, de tout âge et de toute condition. Cette masse de gens affolés, étirée au long de la rivière, semblait une autre rivière coulant en sens inverse. La panique avait vidé en une seule heure Klissoura tout entière et avait rempli cette gorge. Tous couraient, tous fuyaient, hors d’haleine, éperdus, comme si l’ennemi les talonnait. Les uns étaient partis avec les seuls vêtements qui les couvraient, d’autres étaient chargés de couvertures, d’objets ménagers, de chiffons, et même de choses absolument inutiles, saisies à la hâte et au hasard. Il saisissait même des scènes comiques : tel homme, qui possédait beaucoup d’objets de valeur, avait abandonné sa maison et ses biens, n’emportant sous son bras qu’une horloge dont, à cette heure, il n’avait guère besoin. Plus loin, une femme portait un tamis qui entravait sa fuite. De vieilles femmes et des jeunes filles couraient nu-pieds sur les cailloux, leurs souliers à la main, comme si elles avaient peur de les user... Ognianov se heurtait à ces groupes terrifiés ou bien trébuchait sur des femmes tombées à terre, exténuées, et qui criaient désespérément, sans que personne s’arrêtât pour les relever. Il voyait toutes ces horreurs et, épouvanté, étourdi, nu-tête, courait comme un insensé vers la ville, n’ayant plus qu’une seule pensée consciente : sauver Rada. Il la cherchait instinctivement du regard parmi tous ces visages de femmes et de jeunes filles, défigurés par la peur, qui venaient à sa rencontre. Ces gens étaient pour lui des étrangers, des fantômes, quelque chose d’inexistant. Il ne comprenait même pas pourquoi ils fuyaient, il ne pensait pas à eux, comme ils ne pensaient pas à lui, et personne ne s’étonnait ni ne se demandait pourquoi il allait vers l’arrière quand tout le monde fuyait en avant. Le jugement était perdu, on ne voyait que la route. À chaque pas les scènes horribles devenaient plus fréquentes et plus saisissantes. À un tournant du ravin, il vit un garçonnet qui, épuisé par sa course, étourdi de peur, était tombé dans la rivière et criait au secours. Plus loin, il trébucha contre un nourrisson devenu bleu à force de pleurer ; sa mère l’avait sans doute abandonné pour alléger sa propre fuite. Vieilles femmes, jeunes femmes, hommes, tous enjambaient cette pauvre créature, sans la voir ni l’entendre. Chacun pensait, uniquement, à soi. La peur, cette forme suprême et répugnante de l’égoïsme, endurcit totalement les cœurs : la honte même ne marque pas les visages d’une empreinte aussi infamante que la peur. Ognianov se baissa machinalement, ramassa l’enfant et continua sa route. Près d’un buisson, à l’écart de la route, une femme avait avorté ; le visage tordu par la douleur, elle tendait les bras vers les fuyards. Pleurs, cris rauques, plaintes d’enfants remplissaient l’air. Pour comble de malheur, une pluie diluvienne se mit à tomber. Elle cinglait les fuyards épuisés et réveillait les échos sauvages des montagnes. La giboulée devenait de minute en minute plus violente, des eaux bourbeuses se ruèrent des ravins vers la rivière, atteignant les pieds de ces malheureux, frappés au visage par la pluie, trempés jusqu’aux os et gelés de froid. Les enfants, traînés par leurs mères, poussaient des cris déchirants, pataugeaient dans le torrent, tombaient... Les pleurs et les gémissements devenaient toujours plus forts. Les escarpements du défilé renvoyaient les échos des souffrances humaines et des éléments déchaînés, auxquels se mêlait le fracas de la rivière.
Soudain, à travers le rideau de pluie, Ognianov reconnut dans la file opposée une femme, la première personne qu’il reconnaissait dans cette cohue. C’était Mme Mouratliiska, un nourrisson dans les bras, suivie de trois autres enfants plus âgés. Il traversa la rivière fangeuse, aborda la mère, brisée de fatigue.
– Où est Rada ? demanda-t-il.
Elle ouvrit la bouche mais, d’essoufflement, ne put parler.
Elle lui montra d’un geste la ville.
– Chez vous ?
– Là-bas, là-bas, plus vite, balbutia-t-elle.
Faible comme elle l’était, il était douteux que Mme Mouratliiska pût poursuivre sa fuite. Les yeux lui sortaient des orbites, tant ses efforts étaient tendus pour marcher sur cette mauvaise route. Mais à ses forces physiques insuffisantes l’énergie s’était substituée, une énergie insufflée par ses enfants, beaux comme des anges.
– Où portes-tu cet enfant ? demanda-t-elle de sa douce voix, assourdie par la pluie.
Ognianov se regarda. Alors seulement il vit qu’il avait pris quelque part cet enfant et qu’il le portait sans s’en rendre compte. Maintenant seulement, il sentait le poids de ce petit être, il entendait sa voix perçante.
Il regarda, effaré, Mme Mouratliiska.
– Donne-le, donne-le.
Elle prit le bébé des mains d’Ognianov, le serra à gauche contre sa poitrine, ruisselante de pluie, serra son propre enfant de l’autre côté et continua sa route.
Il faisait complètement noir quand Ognianov arriva à l’embouchure de la Varlichtnitsa. De là, on pouvait embrasser d’un coup d’œil toute la ville de Klissoura. La pluie avait éteint l’incendie ; seuls les feux, abrités sous les toits, brillaient encore et, par les fenêtres de la ville assombrie, jetaient des gerbes rougeâtres de lumière. Des écroulements lointains se faisaient entendre. Des flammes reprenaient force et se propageaient. Soudain Ognianov aperçut un nouvel et grand incendie qui éclatait dans la partie sud de la ville. Les flammes montaient avec fracas, vomissant des milliards d’étincelles qui se répandaient. Ognianov remarqua que c’était l’endroit même où se trouvait la maison de Mme Mouratliiska. Oui, cette maison-là brûlait. Au même moment, l’étage supérieur s’écroula dans une mer de flammes et de fumée jaune. À cet étage se trouvait la chambre de Rada.
Il se jeta comme un fou dans les rues en flammes où couraient les Turcs ivres de sang, et disparut.
TROISIÈME PARTIE
1 RÉVEIL
En quelques jours, la révolte fut écrasée. La panique s’empara des révoltés. La révolution devint capitulation.
L’histoire nous offre des exemples d’insurrections tout aussi saintes, tout aussi malheureuses, mais aucune ne fut si tragiquement privée de gloire. L’insurrection d’avril était un enfant mort-né, conçu dans l’enivrement de l’amour le plus ardent et étouffée par sa propre mère dans les douleurs de l’enfantement. Elle n’a même pas d’histoire. Elle mourut avant d’avoir vécu.
Espoirs dorés, foi profonde, force redoutable et enthousiasme nés de plusieurs siècles de souffrances, tout croula en quelques instants ! Le réveil fut terrible.
Combien de martyrs ! Combien de victimes ! Combien de morts et combien de déchéances ! Sans doute, et aussi un peu d’héroïsme ! Pérouchtitsa – Saragosse ; mais Pérouchtitsa n’est pas entrée dans l’histoire universelle.
Batak 133 !
Seul ce nom surgit de la lutte, des incendies, des foyers détruits, prit son vol à travers le monde et s’établit dans la mémoire des peuples. Batak ! Ce nom qui désigne une ville, ce nom commun qui signifier « affaire perdue », caractérise notre révolution.
Le sort se plaît quelquefois à ces jeux de mots.
Dans le cas présent, le sort fut pour nous la Providence : il nous donna Batak, mais Batak créa Alexandre II 134.
Si ce mouvement révolutionnaire n’avait pas amené par ses malheureuses suites la Guerre de Libération, un jugement implacable aurait pesé sur lui : le bon sens l’aurait qualifié de folie, les peuples de honte, l’histoire de crime. Hélas ! l’Histoire, cette vieille courtisane, ne s’incline, elle aussi, que devant le succès.
Seule, la Poésie lui aurait pardonné et l’aurait couronné des lauriers de la gloire, à cause de l’enthousiasme qui fit monter les doux abadjis 135 d’Anatolie jusqu’aux hauteurs de la Sredna-Réka – hauteurs sublimes – avec des canons de cerisier. Ce fut une folie poétique. Car les jeunes peuples, comme les jeunes gens, sont poètes.
■
Depuis trois jours et trois nuits, Ognianov errait dans la Stara-Planina. Il se dirigeait vers l’est, pour descendre à Biala-Tcherkva et apprendre ce qui s’y passait. De Klissoura jusque-là, un voyageur met six heures ; pour un insurgé qui fuit les balles ennemies, ce n’est pas assez de soixante !
Le jour, Ognianov se glissait dans les forêts et dormait au creux des arbres, comme une bête fauve, pour se dérober aux meutes des poursuivants ; la nuit il marchait dans les ténèbres, recherchant les lieux déserts, grelottant sous la pluie et sous le vent qui descendait des sommets couverts de neige du Balkan, sans pouvoir s’orienter, allant souvent à l’opposé de sa route. Il se nourrissait surtout d’herbe et il était donc plus affamé qu’un loup. Demander l’hospitalité dans les rares chaumières de la montagne, il ne l’osait : à la porte de la plupart d’entre elles la trahison montait la garde, ou pis encore, ce cerbère aux aboiements menaçants – la peur.
Souvent, quand la nuit le surprenait sur quelque sommet, il voyait le ciel rougeoyer vers le sud. Il crut d’abord à un jeu des rayons du soleil couchant. Mais plus les ténèbres se faisaient profondes, plus cette lumière d’un pourpre trouble devenait plus vive et embrasait une plus grande partie de l’horizon. On eût dit une aurore boréale. C’était, spectacle terrible et grandiose, la lueur des incendies qui réduisaient en cendres de nombreux villages florissants.
Une nuit, une percée de montagne découvrit devant ses yeux, vers le sud, un plus large panorama. Ognianov vit avec horreur les flammes elles-mêmes sur la Sredna-Gora elle : semblait un volcan vomissant le feu par une vingtaine de cratères, et ces incendies jetaient une brume rougeâtre sur tout le firmament.
Ognianov était au désespoir.
« Elle a péri ! Elle a péri, la Bulgarie ! se disait-il avec désespoir, en regardant les flammes. Voilà les fruits de nos saints efforts ! Voilà où sont noyés nos fiers espoirs : dans le sang et dans le feu ! Mon Dieu ! mon Dieu ! Et là-bas, continuait-il, se tournant vers Klissoura, là-bas c’est mon cœur qui a péri. Double écroulement des deux idoles en qui j’avais foi : l’une dans la peur, l’autre dans la honte de l’infidélité et dans la mort. »
2 UN MORCEAU DE PAIN DE KIR IANI
Ce jour-là, à l’aube, Ognianov se trouvait dans une petite futaie qui couvrait le flanc septentrional d’une colline, près d’un affluent de l’Osam, à l’est du sommet dénudé d’Ambaritsa.
Il était épuisé par la fatigue et la faim ; son estomac ne parvenait plus à digérer les herbes amères qu’il avait mangées ; et, à cent pas de lui, se trouvait une bergerie de Grecs nomades, pleine de pain, de fromage, de lait et de caillebotte... Il ressemblait à Tantale, brûlant de soif devant un frais ruisseau dont il ne pouvait boire une seule goutte.
Un loup ne se résigne jamais à mourir de faim devant un troupeau de moutons. Les crocs des chiens de garde mordent moins cruellement que les dents de la faim. Ognianov se décida à faire le loup. Il quitta la futaie, traversa le ruisseau et monta résolument vers la cabane des bergers.
Deux femmes s’y trouvaient, occupées à raccommoder, et deux jeunes filles tressaient quelque chose. Les chiens étaient probablement auprès des troupeaux, non loin de là. À la vue de cet inconnu aux yeux enfoncés, nu-tête, habillé de façon bizarre, les femmes poussèrent des cris d’effroi.
– Que veux-tu ? cria-t-on du dehors en mauvais bulgare.
Et, au même instant, un berger grec de haute taille, aux cheveux blancs, s’approcha, le fusil braqué sur Ognianov. Ognianov reconnut Kir Iani, qui descendait souvent à Biala-Tcherkva avec son beurre. Le Grec le connaissait aussi.
– Bonjour, Kir Iani, donnez-moi un morceau de pain, pour l’amour de Dieu, s’empressa de dire Boïtcho, pour montrer ses intentions pacifiques.
Kir Iani le toisa des pieds à la tête. L’avait-il ou non reconnu, en tout cas son aspect lui avait fait une mauvaise impression. Il entra, renfrogné, dans la chaumière, rompit un pain en deux, tout en disant quelque chose à un garçon.
– Et va-t’en, pour ne pas amener quelque malheur sur ma tête ! Ici, on te verra, chrétien ! dit-il gravement, tendant le pain.
Ognianov le remercia et descendit vite vers le vallon pour se cacher de nouveau dans la futaie où il avait passé la nuit.
« Mon Dieu ! se disait-il avec amertume, un Grec, ce demi-sauvage, a eu pitié de moi, tandis qu’hier les Bulgares m’ont renvoyé avec des malédictions et fait pourchasser par leurs chiens ! »
Ognianov dévorait gloutonnement le pain, ses yeux brillaient d’avidité. La faim mettait dans le noble feu de son regard une lueur sauvage ; à ce moment, Ognianov n’aurait pas épargné son père lui-même, si celui-ci avait voulu lui arracher le morceau de pain. Le comte Ugolin, pour ne pas mourir de faim, avait bien mangé ses propres enfants ! La faim est un conseiller plus implacable encore que le désespoir.
Dans le vallon, Boïtcho se désaltéra au ruisseau et remonta la pente pour entrer dans le bois. Il ressentit aussitôt l’action bienfaisante de la nourriture : ses forces lui revenaient. Comme il s’approchait de la forêt, des voix lointaines se firent entendre. Il se retourna. De la colline où se trouvait la bergerie descendaient des Circassiens qui lui faisaient signe d’attendre. Devant eux bondissaient quelques lévriers. En ces tristes jours, les détachements de poursuite, composés surtout de Circassiens, utilisaient des lévriers dressés à découvrir les traces de l’homme aussi bien que celles du gibier, et à se jeter sur lui. Au sommet de la colline, Kir Iani, dans sa houppelande blanche, regardait avec curiosité cette chasse qu’il avait préparée : en même temps qu’il donnait au fuyard un morceau de pain, il avait envoyé son fils le dénoncer au détachement caché dans le voisinage.
Hospitalité et trahison ! L’âme endurcie de ce nomade sauvage conciliait ces deux choses. Il les avait accomplies la conscience tranquille : il avait nourri l’homme affamé qu’il connaissait, et il avait livré l’insurgé pour s’épargner des ennuis. Maintenant, il assistait, paisible, au spectacle de la chasse à l’homme.
Ognianov se vit perdu. Gardant sa présence d’esprit que le danger ôte à la plupart des hommes, il pesa ses chances. De l’autre côté du vallon, une petite éminence le cacherait aux poursuivants pour une ou deux minutes, jusqu’à leur descente dans la combe, et ce court délai lui permettrait d’entrer sous la futaie, mais cela ne servirait à rien, on l’atteindrait. Échapper en courant aux balles et aux lévriers était impossible. Dans le val, près de la rivière, était un fourré assez bas, entre deux rives érodées, mais ce fourré ne pourrait pas le cacher davantage : même si Boïtcho égarait les poursuivants, les chiens le découvriraient. Là, et partout, la mort ! Boïtcho n’avait pas le temps d’hésiter ; il fallait prendre une décision. Il préféra d’instinct le vallon et descendit la pente d’un trait. La forte inclination du terrain facilita sa fuite. Une minute après, il s’engageait dans le fourré, au fond du vallon qu’entouraient des escarpements rocheux. Au pied des roches s’ouvraient des trous profonds qui semblaient creusés de main d’homme. Ognianov se glissa dans un de ces repaires de bêtes sauvages. Là, il attendit, décidé à vendre chèrement sa vie.
Il resta ainsi quelques secondes, aux aguets, revolver au poing, et ces secondes semblaient des siècles. Les aboiements s’approchèrent puis s’affaiblirent, s’éloignèrent. Il attendait. Qu’était-ce ? Les poursuivants avaient, probablement, fait fausse route, mais ce ne serait pas pour longtemps. Ognianov comprit qu’ils le cherchaient dans le bois et que, ne le trouvant pas là, ils penseraient au vallon où d’ailleurs les chiens les mèneraient ; l’instinct des animaux ne se trompe pas deux fois. Combien de temps dura cette tension de tous ses sens, cette attente longue comme une agonie, Ognianov n’aurait pu le dire. Son regard était fixé sur les feuillages brûlés qui tremblaient près du ruisseau. À chaque instant, il s’attendait à voir le museau du fatal lévrier pénétrer dans le trou ou, au moins, à entendre son jappement.
Soudain ce jappement se fit entendre. Les yeux d’Ognianov, immenses, terribles, sortaient de sa tête, ses cheveux se hérissaient comme des épines.
Il braqua convulsivement le revolver, prêt à faire feu.
3 AU NORD
L’aboiement qu’Ognianov avait entendu à droite et tout près ne se répéta pas mais, à sa place, il entendit un autre bruit, celui de pas humains. Oui, des gens venaient, ils descendaient l’escarpement : la terre friable s’éboulait et le sable roulait jusqu’à l’ouverture du repaire où se cachait le fugitif. Bientôt deux pieds, chaussés de mocassins, se posèrent devant le trou puis passèrent outre ; deux autres pieds suivirent et de même allèrent plus loin, puis un autre homme passa et disparut, toujours aussi silencieusement. Un quatrième obscurcit l’ouverture. Celui-là ne la dépassa pas. Il s’arrêta, se baissa. Et Ognianov vit une tête ébouriffée, oblongue, la tête d’un gorille. Celui à qui appartenait cette tête renouait les lacets de sa molletière.
Le revolver braqué, Ognianov s’était mué en statue.
La tête regarda dans le trou puis elle se releva et un long sifflement traversa de nouveau la solitude. C’était un signal pour faire revenir les autres. La tête se pencha de nouveau et scruta le trou. Ognianov décida de faire feu, mais une voix tonitruante demanda :
– Qui es-tu ?
– Baï Ivan ! s’écria Ognianov.
– Le daskal ! crièrent les autres en se penchant aussi.
Sans attendre une invitation, Borimetchka s’introduisit le premier dans la tanière et, les larmes aux yeux, serra les mains d’Ognianov. Les trois autres entrèrent à leur tour. C’étaient des Klissouriens.
– Qui était ce chien qui jappait ? demanda Boïtcho.
Les Klissouriens répondirent :
– Mais il n’y avait pas de chien ! C’est Borimetchka qui aboyait.
Ognianov sourit. Il se souvint de cette habitude du géant. Alors, il les accabla de questions.
– Nous avons fait du beau ! Tonnerre de Dieu !... et Borimetchka poussa un soupir retentissant.
– Courage, baï Ivan ! Dieu n’abandonnera pas la Bulgarie !
– Mais Klissoura est fichue, dit sombrement un des Klissouriens.
– Elle est réduite en cendres, elle brûle, ajouta le second.
– Frères, à quoi bon nous repentir ? Nous cherchions à bien faire, nous n’avons pas réussi, voilà tout. Courage et patience ! Les sacrifices ne seront pas vains. Avez-vous mangé ?
– Depuis notre départ, nous n’avons pas vu une miette de pain, dirent tristement les Klissouriens.
Ognianov voyait leurs visages émaciés, aux yeux enfoncés dans les orbites. Il rompit le reste de la miche et le distribua à ses hôtes. Ils dévorèrent avidement le pain. Borimetchka refusa sa part.
– Garde le pain pour toi-même, tu es décharné comme un ascète ; moi, j’ai mon dîner.
Et Borimetchka sortit de son sac un lièvre écorché, couvert de sang noirâtre. Il découpa un morceau, le plongea dans du sel et se mit à le déchiqueter à belles dents.
– Comment, mais c’est cru ?
– Cru ou cuit, la faim n’est pas exigeante. Des insurgés qui fuient n’allument pas de feu. Ces chrétiens que tu vois ont horreur de faire gras : ils ont mangé des herbes comme des tortues, ajouta Ivan, en léchant ses lèvres barbouillées du sang de la bête.
– Et comment as-tu tué ce lièvre ? Tu as tiré ? demanda Boïtcho curieusement.
– J’ai tué le lièvre, faute de sanglier, car si j’en avais rencontré un, je l’aurais, lui aussi, attrapé avec mes mains.
Borimetchka avait, en effet, coincé ce lièvre dans un buisson et l’avait pris sans tirer un seul coup de feu.
– Mais pourquoi es-tu entré dans cette caverne d’ours ? demanda le géant, en examinant l’intérieur du trou.
– Des Circassiens étaient à mes trousses, et il est bien étonnant qu’ils ne m’aient pas attrapé, ils avaient des lévriers avec eux.
– C’est pour ça que tu as demandé qui aboyait ? Je comprends maintenant. Les lévriers, c’est probable, ont vu un autre gibier, quelque lièvre, et sont partis sur ses traces. Voilà l’affaire, ton baï Ivan s’y connaît.
– Ça devait être ces mécréants que nous avons aperçus là-bas sur l’autre versant, dit un autre.
– Que Dieu les écrase ! Il y a tant de détachements qu’on ne peut montrer le bout du nez. Le Balkan est plein de cette vermine de Turcs et de Circassiens. Dieu te donne vie et santé, Ognianov, pour ce pain ! Encore un peu et j’allais tourner de l’œil.
À présent seulement, Ognianov se tranquillisa. Il comprit qu’il n’avait été sauvé que par miracle, ce que d’ailleurs le Destin avait maintes fois fait pour lui.
– Où allez-vous maintenant ?
– Nous passerons en Roumanie. Et toi ?
– Il y a trois jours que je me suis mis en route pour Biala-Tcherkva et vous voyez jusqu’où je suis arrivé.
Un Klissourien éleva la voix :
– Ils ont été malins, nos amis les Bialo-Tcherkoviens ! ils se sont tenus cois, eux...
Ceci était dit avec colère. Non pas tant parce que Biala-Tcherkva ne s’était pas soulevée, mais parce qu’elle n’avait pas souffert comme les autres localités. Hélas ! telle est la nature humaine. Les malheurs se supportent plus facilement quand on les sait partagés, serait-ce par des amis, même des proches. Ce cruel sentiment, si fortement développé dans nos âmes, est aussi un stimulant de l’héroïsme du soldat : au milieu des siens, il se rue dans le combat, sans craindre la mort qui fauche à droite, à gauche, partout autour de lui. Ce héros, laissé seul en face du danger, fuira, lui aussi, pris de panique. Un de nos proverbes dit : « Malheur commun n’est pas malheur, mais fête. »
– Que savez-vous de Biala-Tcherkva ? demanda Ognianov.
– Nous te l’avons dit : ils ont été malins. Il ne s’est trouvé que nous pour nous charger de la libération du royaume bulgare.
« Pourtant, c’est étrange, l’enthousiasme y était si grand », se disait pensivement Ognianov.
– Voyons, il ne faut pas leur en vouloir ! C’est heureux qu’ils aient pu rester sains et saufs. À quoi aurait servi leur perte ?
– Eh ! que de villages ont été réduits en cendres, dit un autre. As-tu vu comme le ciel flamboyait, la nuit dernière ?
– J’ai vu, répondit sombrement Ognianov.
– Que de monde a péri ! Mais était-ce une insurrection, ça ? C’était ridicule. Et nous, les vieux ânes, nous nous sommes laissés entraîner. Ceux qui ont trompé le peuple devront en rendre compte à Dieu : puisque rien n’était prêt, pourquoi ne sommes-nous pas restés tranquilles ?
Ognianov écoutait en silence insinuations et malédictions. Elles le torturaient mais il ne se fâchait pas. Elles étaient sinon justes, du moins assez naturelles dans la bouche de ces gens ruinés. N’avait-il pas, lui-même, plus d’une fois accusé dans son âme ce peuple, qui, maintenant, accusait ses chefs ? Telles sont les tristes, mais logiques conséquences de l’échec.
Borimetchka s’efforçait de les consoler :
– Eh donc ! pourquoi vous laissez-vous aller, pourquoi pleurez-vous comme s’il était arrivé Dieu sait quoi ! Dieu et la Sainte Vierge en avaient décidé ainsi. Si Klissoura périt, la Bulgarie elle, ne périra pas, voyons !
– Baï Ivan, comment va ta femme ? Où l’as-tu envoyée ? demanda Boïtcho.
– Staïka ? saine et sauve ; je l’ai envoyée à Altanovo, et de là à... Ah ! mais j’ai oublié de te dire ce qui s’est passé avec l’institutrice !
Ognianov tressaillit à ces mots. Il pressentait ce qui était arrivé à Rada mais craignait d’apprendre la terrible vérité. Il avait vu, pendant la nuit, la maison de Rada s’effondrer dans les flammes ; sous ces ruines avait été ensevelie la jeune fille, à moins qu’elle n’eût auparavant mis fin à sa vie. Quand il avait cherché à la sauver, il était trop tard. Cette pensée pesait lourdement sur son âme, et un autre sentiment encore, dont il ne voulait pas se rendre compte, agitait douloureusement son âme.
– Il s’en est fallu de peu que la belle fille périsse...
– Comment ! Elle vit ? s’écria Boïtcho.
– Elle vit, elle vit, daskal ; mais si ton Borimetchka n’avait pas été là...
– Où est-elle maintenant ? demanda Ognianov, étourdi, voulant en un clin d’œil lire tout sur le large visage rude et bonhomme d’Ivan.
– Je l’ai remise en bonnes mains, déclara Borimetchka.
– Boïtcho se sentait soulagé. Une grande douceur envahissait son cœur. Le visage radieux, il dit avec émotion au géant :
– Je te remercie, baï Ivan. Tu m’as ôté un grand poids !
– Eh bien ! reprit Ivan, heureusement que notre Staïka nous a avertis à temps, parce qu’Anitchka, la propriétaire, quand elle a pris la fuite, l’a vue et lui a dit : « Staïka, dis à Ivan (c’est-à-dire à moi) que, malgré mes prières, Rada ne veut pas fuir ; ne laissez pas l’institutrice, emmenez-la par force avec vous. » Quand j’ai entendu ça, tonnerre de Dieu ! est-ce moi qui la laisserais ? J’y cours ; elle avait fermé sa porte à clef : je cogne, je crie, elle n’ouvre pas. J’enfonce la porte, j’entre. Et je la vois : elle est là près de la table, un cierge à la main, fouillant dans un havresac posé sur la table.
– Le sac avec la poudre ? cria Ognianov, horrifié, comprenant quelle espèce de mort Rada s’était préparée.
– Ben oui, le sac avec la poudre, pour s’envoler jusqu’aux nuages, en mille morceaux ! Vois donc, quelle sotte, cette fille. Mais moi, à ce moment, il ne me vient pas à l’esprit que c’est de la poudre, continua Borimetchka, j’entre donc droit vers elle. Est-ce Dieu qui l’envoie ? Le vent entre en même temps que moi et éteint le cierge. « Que fais-tu ici, daskalitsa ? Tout le monde fuit, et toi ? » Je la saisis, et en route pour le Balkan ! notre Staïka derrière nous. Staïka la console et elle, elle pleure, gémit. Eh, daskal, combien de larmes elle a versées pour toi ! Moi, je te crois mort mais je mens : la ruse est nécessaire en ce cas, n’est-ce pas ? Je lui dis : « L’instituteur est sain et sauf, daskalitsa ; ne t’en fais pas, daskalitsa... Mais nous avions perdu trop de temps. Près de Varlichnitsa : les Turcs. On ne peut plus passer. Ah ! les choses se gâtent ! Que faire ? Alors nous entrons dans la forêt et au milieu de la nuit nous arrivons dans notre village. Je remets l’institutrice et Staïka à notre Valko, le frère de Staïka donc, et je m’en vais de nouveau dans la Stara-Planina. Et toi tu es donc en vie ? Tonnerre de Dieu !
Ognianov serra silencieusement les mains de Borimetchka.
– Je les ai laissées à Altanovo, mais elles doivent être maintenant à Biala-Tcherkva ; Valko allait les conduire là le lendemain matin, revêtues de fèredjès 136. À Altanovo, c’est encore dangereux, à cause des villageois turcs. À Biala-Tcherkva, tout est calme, dit-on. Toi, daskal, quand tu arriveras à Biala-Tcherkva, va trouver aussi notre Staïka, ma femme donc, salue-la de ma part et dis-lui que tu m’as vu ici sain et sauf. Et dis-lui encore que je ne mange que des lièvres rôtis et de la caillebotte et qu’elle ne s’inquiète pas pour moi.
– Baï Ivan, je ne crois pas que j’irai maintenant à Biala-Tcherkva.
Borimetchka le regarda, ébahi :
– Mais c’est là que tu vas, n’est-ce pas ?
– Non, je ne veux plus y aller.
– Mais où iras-tu ?
– Je verrai...
– Allons, nous te mènerons en Roumanie.
– Non, partez seuls, et séparons-nous il est dangereux de circuler en groupe.
Le crépuscule s’étendait sur le vallon et remplissait la caverne. Le ruisseau murmurait tristement. La nuit tombait. Les fugitifs pouvaient à peine se voir. Ivan Borimetchka et les Klissouriens se levèrent pour partir.
– Allons, daskal, embrassons-nous trois fois. Dieu sait qui de nous restera en vie, dit Borimetchka.
Ils se firent leurs adieux et se séparèrent.
Ognianov resta seul. Alors il se coucha à plat ventre, sur le sol, et pleura comme une femme.
Comme la lave vomie par le volcan, toutes les douleurs dont son cœur était plein se déversèrent en un seul flot de larmes brûlantes. Pour la première fois, cet homme de fer sanglotait. Sa force morale se brisait. Tourments, désillusions, remords, souffrance pour les innombrables victimes sacrifiées en vain, amour tué à jamais, amertume, désespoir, affreux sentiment d’être seul et sans but dans la vie, essaim de souvenirs – radieux ou sombres, également empoisonnés – tout passait dans ces larmes. Il avait tâché de relever le courage de ces pauvres gens, victimes des flammes allumées par lui et ses camarades, et lui-même était abattu, anéanti. Devant eux, il avait subi en silence son châtiment. Il s’était efforcé de se dominer devant les Klissouriens, alors que son cœur saignait et se tordait comme un serpent frappé à mort. Et cette Rada qu’il ne pouvait oublier ! Comme elle avait pleuré là-bas ! Il s’indignait contre lui-même : à côté de la douleur qu’il ressentait pour les maux de la patrie, son cœur était torturé par une autre douleur. Mais comment ordonner à ce cœur de ne plus souffrir ? tout était fini : pas de pardon ni de réconciliation, un éloignement définitif de Biala-Tcherkva, ce berceau de son amour et qui, désormais, lui semblait une tombe. À Klissoura, il avait bien dit à l’infidèle qu’il rompait avec elle ; il l’avait anéantie sous son regard, il l’avait écrasée de son mépris. Si, dans l’incendie de Klissoura, il avait risqué sa vie pour sauver Rada, ce n’était pas par amour, c’était impossible ! Il avait subi une autre impulsion, peut-être un sentiment chevaleresque. Il l’avait fait inconsciemment et, maintenant, il n’irait pas dans cette ville pour voir, même de loin, l’idole qu’il avait foulée aux pieds ! Son orgueil se révoltait à cette pensée. Il partirait pour la Roumanie, il y arriverait, d’une façon ou d’une autre ; tant de personnes y allaient... À Biala-Tcherkva, il devrait se terrer comme une bête sauvage, il pourrait même être livré par ses ennemis et, d’ailleurs, il n’avait plus rien à y faire. En Roumanie, terre hospitalière de la liberté, il pourrait encore travailler pour la Bulgarie, jusqu’à ce que se ferment les blessures qu’elle venait de recevoir ; là-bas, on pouvait respirer librement. Au nord, donc ! Au nord !
Et Ognianov se dirigea vers le nord.
Le ciel était couvert de nuages. Les ténèbres et le silence enveloppaient la montagne. Il marcha toute la nuit, par monts et par vaux, afin de s’éloigner plus rapidement de sa première direction... Sa ferme résolution lui donnait des ailes, ses forces, soutenues par la nourriture qu’il avait prise, étaient revenues.
À l’aube, il arriva sur un sommet. De là on voyait s’étendre au sud une ravissante vallée verte. Il reconnut la vallée de la Stréma : au pied de la montagne était Biala-Tcherkva ! L’arrêt du Destin devait s’accomplir.
4 LE DRAPEAU
Ognianov eut l’impression de se réveiller d’un lourd sommeil. Il comprit son erreur : croyant se diriger vers le nord, il avait marché en sens inverse. Et c’était trop tard...
Arrivé au-dessus de Biala-Tcherkva, surpris par le jour sur cette colline dénudée, loin de tout bois, de tout abri, il comprit que ce serait folie de retourner en arrière, de s’exposer volontairement à une mort certaine. La seule chose qui lui restait à faire était de descendre dans le profond vallon de la rivière du monastère, où il pourrait se cacher, et passer de là à Biala-Tcherkva. Il devait donc se soumettre à l’arrêt du Destin et aller vers l’endroit qu’il avait fui toute la nuit.
Ognianov, de même que Kandov, aimait pour la première fois. Il était novice dans le combat de l’amour, qui ne ressemble à aucun autre. Le blessé hait en générai l’ennemi qui lui a porté le coup dont il souffre ; or, le plus souvent, un cœur torturé aime plus ardemment encore l’être qui l’a fait souffrir ; mieux : il excuse. Alfred de Musset aurait dit : il pardonne.
L’amour-propre blessé – qui dans le domaine de l’amour s’appelle jalousie – tue l’être qui lui a porté le coup, ou cherche en cet être même un remède à son mal : dans le premier cas, la blessure guérit plus facilement ou, plutôt, la douleur est étouffée par une autre douleur, plus forte encore ; dans le second cas, la blessure est à la fois soignée avec un baume et fouillée par un fer rouge : c’est le moyen le plus souvent employé.
L’amour, le plus égoïste de tous les sentiments, est enclin aux accommodements. Par bonheur, Ognianov avait été blessé par sa propre imagination et non par l’infidélité de Rada. La plus simple explication avec son amie aurait mis fin à ses souffrances. Il fallait seulement que le hasard lui vînt en aide. Et voilà que ce hasard se présentait ! mais Ognianov ne voyait là qu’une perfidie du Destin.
Aussi quand il fut arrivé au-dessus du vallon où la rivière du monastère prend sa source, quand il vit la petite pinède clairsemée poussée sur le versant rocheux, il changea brusquement d’idée.
« Non, se dit-il, je me cacherai aujourd’hui dans cette pinède mais, ce soir, je retournerai en arrière. Je changerai de vêtements dans quelque hameau de la montagne et, ensuite, en route pour la Roumanie ! Jamais, plus jamais de Rada ! »
Et il se glissa entre les troncs des pins dont le pied était enfoui dans un amas de branches mortes et d’herbes sauvages qui le rendrait invisible s’il restait couché ; il y resta étendu de longues heures, attendant patiemment la tombée de la nuit.
Tout à coup, vers le soir, Ognianov aperçut au sommet de la colline opposée quelque chose de sombre qui se balançait en l’air ; cela ressemblait à un oiseau géant qui, arrêté dans son vol, aurait seulement battu des ailes. Ognianov, étonné, le fixa.
« Un drapeau ! » s’écria-t-il, ébahi. En effet, à la lueur du soleil couchant, il venait de reconnaître un drapeau rouge : le vent agitait doucement ce drapeau ; il devait se voir également de Biala-Tcherkva. Près du drapeau, il n’y avait personne.
Qui l’avait arboré là ? Et dans quel dessein ? Était-ce le signal d’un soulèvement ? Ognianov décida que oui : la présence de ce drapeau ne pouvait avoir un autre sens raisonnable.
Il ne tenait plus en place ; oubliant toute précaution, il abandonna sa cachette et remonta vite sur le sommet d’où il regarda Biala-Tcherkva. Il lui semblait maintenant entendre le bruit sourd de lointains coups de feu. D’où venaient-ils ? Ognianov braquait les yeux sur la ville. Soudain, grâce à la transparence de l’air, il put distinguer, à l’entrée de Biala-Tcherkva, de petits nuages blancs semblables à ceux que produisent des armes à feu.
– Insurrection ! C’est l’insurrection à Biala-Tcherkva ! s’écria-t-il avec joie. Mes fidèles amis, Sokolov, Popov, le Rédacteur, baï Mitcho ne sont pas restés bras croisés. L’insurrection a, sans doute, éclaté aussi dans les autres localités. Et ce drapeau est le signal convenu !... L’incendie étouffé s’est ranimé. Insurrection ! mon Dieu ! tout espoir n’est pas perdu !
Et comme si des ailes lui avaient poussé, Ognianov descendit le versant abrupt, dans une course vertigineuse.
5 DANS LE CIMETIÈRE
La nuit était tout à fait tombée quand Ognianov sortit du sombre vallon de la rivière du monastère. Il passa près des bâtiments mais ne jugea pas sage de s’arrêter chez le père Natanaïl. Déjà il avait perdu trop d’un temps précieux. La pensée d’une insurrection à Biala-Tcherkva l’avait galvanisé, lui rendant toutes ses forces physiques et morales.
Il prit le chemin de la ville et, quelques minutes plus tard, il vit, dans l’obscurité, les silhouettes noires des vieilles maisons, des cheminées et des arbres fruitiers. Alors il changea de route et monta sur la hauteur qui domine Biala-Tcherkva au nord et sur laquelle se dresse l’école. De là il jeta un coup d’œil sur la ville. Elle dormait... Aucune lumière... Aucun bruit, aucun signe n’indiquait qu’elle fût en révolte. Seuls les aboiements habituels des chiens rompaient le silence. Ognianov fut étonné. Il réfléchit. S’introduire dans la ville et frapper chez quelque ami n’était guère raisonnable. Il décida alors d’aller à l’école des garçons. Ce n’était pas loin. Là il apprendrait par la vieille gardienne de l’église ce qui se passait à Biala-Tcherkva. Ognianov grimpa donc sur le mur ouest de l’école et sauta dans l’enclos : il se trouvait dans le cimetière qui occupait une grande partie de ce terrain. Au milieu se dressait une vieille église, silencieuse et morne, semblable à quelque tombe gigantesque. Au fond de la cour se découpait en noir la masse de l’école et de quelques autres bâtiments, le tout plongé dans l’obscurité et le sommeil. Cet engourdissement général, au lieu du bruit et de l’animation propres à une ville en révolution, troubla Ognianov et lui inspira les pensées les plus sombres. Un froid étrange se dégageait du terrible silence et des ténèbres qui enveloppaient les tombeaux ; la nuit leur prêtait des formes bizarres, les faisait ressembler tantôt à des hommes vivants, tantôt à des morts sortis jusqu’à la ceinture du sépulcre. Ognianov ne pouvait surmonter le serrement de son cœur et son désir de se trouver, au plus vite, hors de ce glacial royaume des ténèbres et du mystère. En pareil moment, l’âme frissonne involontairement ; notre nature, au contact de l’au-delà, ressent un grand froid. Le couvercle du cercueil, en retombant sur un mort, sépare deux mondes étrangers l’un à l’autre, deux mondes ennemis. Le mystère et les ténèbres éveillent la peur. La nuit est une ennemie, la tombe un mystère. Il n’est pas de brave qui ne subisse sans peur la vue d’un cimetière par la nuit, il n’est pas d’athée qui oserait rire dans un pareil lieu : il s’effraierait de son propre rire. Je ne crois pas qu’Hamlet, seul dans un cimetière, la nuit, aurait pu plaisanter aussi spirituellement sur des crânes humains.
Soudain, dans l’obscurité à laquelle ses yeux s’étaient habitués, Ognianov remarqua un point lumineux, immobile, comme un œil qui brillait à travers la fenêtre basse de l’église. Sans doute, une veilleuse ou un cierge était allumé là-bas... Cette faible lueur, la seule chose vivante dans l’obscurité, rompait la léthargie générale de la ville ; elle scintillait, affable, amicale, presque joyeuse. Ognianov, poussé par une curiosité invincible, enjamba les tombes, arriva jusqu’à la fenêtre éclairée et regarda au-dedans. Le cierge brûlait devant une colonne de l’église, dans un grand candélabre de cuivre. La flamme clignotante éclairait à peine une petite surface du sol autour du candélabre ; le reste était plongé dans l’obscurité. Dans le cercle si faiblement éclairé, Ognianov vit des formes vagues étendues. Qu’était-ce ? Il colla son front à la vitre froide et regarda intensément. Alors il comprit. Trois hommes étaient étendus sur une natte, trois cadavres. Sur eux et sur la natte, des taches noires, luisantes : du sang. La petite flamme jetait sur eux une lueur vacillante et craintive. Les visages tordus, aux bouches béantes, portaient le sceau d’une mort affreuse. L’un d’eux, les yeux écarquillés, fixait sévèrement, obstinément, un point de la sombre voûte. L’autre était placé sur le côté et l’un de ses yeux, où se jouait le reflet de la flamme, regardait droit vers la fenêtre d’Ognianov. Des frissons parcoururent l’épiderme de l’apôtre, mais il n’avait pas la force de se retirer : le regard du mort le clouait sur place, pénétrait dans le sien avec la funèbre lueur du cierge, le fixait comme l’eût fait le regard d’un vivant qui le reconnaîtrait et voudrait être reconnu de lui. Soudain, Ognianov eut un gémissement : il avait reconnu Kandov. Un trou noir s’ouvrait dans son cou. Il avait été égorgé.
Ognianov s’éloigna de cet horrible spectacle et retourna sur ses pas, trébuchant sur quelques tombes qui crièrent avec colère dans les ténèbres.
Arrivé au mur, il chercha à s’expliquer tout cela. Pourquoi et comment Kandov était-il arrivé, blessé, à Biala-Tcherkva ? Comment avait-il été tué ici avec les autres ? L’insurrection avait-elle éclaté ici et Kandov était-il une de ses victimes ? Ou bien avait-il seulement cherché un refuge à Biala-Tcherkva et avait-il été découvert et tué ? Et ce drapeau sur la colline, qu’était-ce ? Et les coups de fusil dans la ville ? Et ce silence maintenant ? Ognianov ne pouvait trouver le mot de l’énigme. Quoi qu’il en fût, un grand malheur s’était abattu.
Ognianov s’interrogeait. Entrer au milieu de la nuit dans cette ville morte et frapper aux portes en ignorant absolument la situation était dangereux et déraisonnable. Ce terrible silence étendu sur Biala-Tcherkva le glaçait ; c’était plus affreux que le bruit le plus affreux. Cela ressemblait à un traquenard. Il décida d’attendre la venue du jour dans le vallon du monastère et alors seulement de prendre une résolution.
Il franchit de nouveau la clôture.
6 LA MESSAGÈRE
Ognianov passa la nuit dans un moulin désert, sur la rivière du monastère. Au point du jour, il monta la rive escarpée, hérissée de rochers de toutes formes, semblables à des statues informes, et se dissimula derrière eux. Personne ne l’avait vu. De ce point d’observation, il pouvait surveiller la vallée.
Elle était encore déserte. Le bruit de la rivière, mêlé à celui des moulins et des scieries, retentissait entre les versants granitiques de la montagne. Le ciel devenait toujours plus bleu sous les rayons joyeux du soleil levant ; ils éclairaient l’espace à tire-d’aile, se poursuivaient en zigzags fantasques et descendaient pour se baigner dans les ondes invisibles. La brise matinale se leva et les herbes folles poussées sur les rochers ; la vague dorée du soleil, glissant sur la verdoyante pente du nord, inonda la masse noire des pins, descendit sur l’herbe veloutée et illumina la berge escarpée où se trouvait Ognianov. Mais personne ne passait encore sur le sentier du vallon. Le cœur d’Ognianov se serrait dans cette attente et cette ignorance de ce qui se passait. Il fixait les yeux sur le vallon, espérant voir quelqu’un qui le renseignerait et lui donnerait, si c’était possible, des vêtements avec lesquels il lui serait plus facile de s’introduire à Biala-Tcherkva. Mais personne n’apparaissait et l’impatience du fugitif grandissait toujours. Seul le bruit de la rivière répondait à l’angoisse de son âme.
Enfin son regard brilla. La porte d’une des scieries venait de s’ouvrir : une fillette sortit et alla à la rivière où elle commença à s’asperger le visage.
« Marika ! » se dit joyeusement Ognianov. Son regard perçant avait reconnu la fille du pauvre père Stoïan. Il se rappela qu’après la mort de celui-ci, elle était venue à la scierie aider son oncle. La Providence venait donc à son aide.
En un clin d’œil il fut à la rivière et, dissimulé derrière un rocher, il appela la fillette par son nom.
Marika s’essuyait déjà le visage avec son tablier. Elle se tourna vers l’endroit d’où venait la voix et, voyant Boïtcho qui se montrait à demi, courut vers lui :
– Grand frère Boïtcho, c’est vraiment toi ?
– Viens ici, Marika ! appela Ognianov sans quitter son abri.
La fillette, les yeux écarquillés par un joyeux étonnement, examinait Ognianov de la tête aux pieds. Son visage défait, ses vêtements maculés de sang et de boue, sa tête nue, son air exténué, tout son aspect était celui d’un homme qui, dix jours et dix nuits durant, avait lutté à chaque instant contre les obstacles, l’insomnie, les hommes, les éléments, la faim, les privations, les dangers de toute sorte. N’importe qui, à cette heure et dans ce désert, aurait fait peur à Marika, mais Ognianov exerçait sur elle un attrait délicieux et terrible.
– Marika, qu’y a-t-il en ville ? furent ses premiers mots.
– Des Turcs, grand frère Boïtcho.
Ognianov se prit la tête entre les mains et réfléchit un instant.
– Et cette fusillade d’hier ? qu’était-ce ? Que se passe-t-il ?
– Hier ? Je ne sais pas, grand frère Boïtcho.
– N’as-tu pas entendu les coups de feu ?
– Hier, je n’étais pas à Biala-Tcherkva, grand frère Boïtcho.
Marika ne pouvait pas lui fournir de réponse, mais Ognianov devinait ce qui s’était passé : une tentative d’insurrection étouffée aussitôt par les Turcs qui, en ce moment, occupaient Biala-Tcherkva.
Il arrivait trop tard. S’il avait été là une ou deux heures plus tôt, peut-être aurait-il pu donner un autre cours aux évènements. Ce retard était une de ces fatalités qui souvent ont une influence décisive sur les destinées d’un peuple.
Après deux minutes de réflexion, Ognianov demanda :
– Marika, y a-t-il quelqu’un d’autre dans la scierie ?
– Oncle Mitcho, il dort encore.
– Marika, sais-tu où demeure le Dr Sokolov ?
– Oui, chez la vieille Iakimtchina.
– C’est ça. Sais-tu où habite Barzobégounek, l’Allemand aux favoris ?
– Celui qui fait de petits hommes noirs ?
– Oui, lui-même, répondit Ognianov, souriant à l’épigramme sans malice lancée au pauvre photographe.
– Peux-tu, ma petite colombe, leur porter quelque chose ?
– Oh oui ! grand frère Boïtcho, répondit Marika avec joie.
– Ognianov fouilla dans la poche de sa veste, en sortit un crayon puis un bout de papier très froissé. C’était la lettre de Rada. À sa vue, quelques gouttes de sueur perlèrent au front d’Ognianov. D’une main tremblante, il déchira la moitié blanche de la lettre, l’appliqua sur le rocher et griffonna quelques mots. Puis il plia la feuille.
– Marika, prends ce billet et porte-le au Dr Sokolov ; si tu ne le trouves pas, porte-le à l’Allemand. Cache-le soigneusement dans ton corsage.
– Bien, ce sera fait.
– Si on te demande où je me cache, tu le diras, mais à eux seulement, tu comprends, n’est-ce pas ? Tu diras que je suis dans le moulin désert, derrière le moulin d’Hambarov.
Marika tourna les yeux vers l’extrémité nord du vallon où se dressait, solitaire, un moulin à moitié détruit.
Ognianov ne mit pas son nom au bas du billet et n’indiqua pas le lieu de sa cachette de peur que, par suite de quelque incident malheureux, la lettre tombât en mains ennemies. Il avait pleinement confiance dans le dévouement de Marika, mais il n’osait la charger de transmettre oralement le message : dans sa simplicité, elle aurait pu faire quelque bévue.
Afin d’imprimer encore plus fortement ses recommandations dans l’esprit de Marika et lui faire comprendre l’importance de la mission dont il la chargeait, il ajouta doucement :
– Parce que, vois-tu, Marika, si tu perds ce billet ou si tu te laisses tromper par quelqu’un, si tu dis que tu m’as vu et indiques le lieu de ma cachette, les Turcs viendront et m’égorgeront. Va, ma colombe !
À ces mots, le visage de Marika devint grave et craintif, et elle passa involontairement sa main sous son aisselle où, entre la peau et le vêtement, était cachée la lettre de Boïtcho.
– J’irai prévenir mon oncle que je m’en vais chercher le pain, dit Marika.
Marika entra dans la scierie.
Boïtcho se cacha de nouveau derrière un rocher et attendit ; il voulait voir partir Marika. Il passa ainsi une heure dans une extrême inquiétude. Enfin, il vit Marika sortir et courir dans la direction de Biala-Tcherkva, pieds nus, sur les cailloux pointus du sentier.
7 LES INSUCCÈS DE MARIKA
Arrivée à la clairière qui s’ouvrait devant le monastère, Marika s’arrêta, essoufflée, et regarda anxieusement de tous côtés puis, s’étant assurée que personne ne l’avait vue, elle continua, en courant, sa route. Jusqu’à la ville elle ne rencontra âme qui vive. La campagne était déserte, déserte également la rue où la petite orpheline allait s’engager. Soudain Marika s’arrêta de nouveau. Elle avait vu apparaître à l’autre bout de la rue trois Turcs ; Ils venaient vers elle. Elle prit peur de ces gens et, sans plus réfléchir, fit volte-face et courut à travers les jardins et les roseraies, dans l’intention d’entrer dans la ville par l’autre rue, celle de l’ouest. De cette façon, elle faisait un grand détour, ce qui augmentait la distance entre elle et la maison de Sokolov.
Marika arriva enfin à l’extrémité ouest de la ville. À droite s’étendait la campagne dénudée, à gauche la ville, où l’on pénétrait par une rue étroite bordée de deux rangées de boutiques basses ; cette rue était déserte : ni Turc, ni Bulgare n’étaient en vue. Toutes les épiceries étaient fermées, ainsi que toutes les portes et les fenêtres qui avaient des contrevents ; cet aspect désert tranquillisa la fillette et elle s’élança vers cette rue. Elle avait à peine fait une dizaine de pas que quelque chose l’obligea à se retourner. Elle resta clouée sur place. Dans la plaine, à faible distance, s’élevait au-dessus des champs un grand nuage de poussière et de ce nuage sortait une sourde rumeur de pas pesants, de piétinements de chevaux et de voix humaines, et bientôt apparut ce qui soulevait poussière et rumeur. C’était la horde de Tossoun-Bey. Elle revenait, victorieuse et effervescente, de Klissoura incendiée, que, trois jours durant, elle avait pillée. Piétons et cavaliers avançaient mêlés les uns aux autres, encombrés d’armes et de butin. Quelques moments plus tard, le torrent se précipita dans la rue en vague fangeuse, la remplit et y coula avec un mugissement sauvage. Ce n’était qu’une partie de la bande, quelques centaines de bachi-bouzouks, habitants de la région à l’est de Biala-Tcherkva. Ils arrivaient avec leurs drapeaux, leur butin, leurs trophées, tout ce qu’ils pouvaient porter. Le reste les suivait, remplissant une file interminable de charrettes. Pour plus de facilité, les bachi-bouzouks avaient mis sur eux les vêtements les plus précieux emportés de la malheureuse Klissoura, de sorte que cette racaille sanguinaire avait en même temps un aspect comique et ressemblait à un cortège de carnaval. Beaucoup d’hommes, malgré la grande chaleur, avaient endossé de riches pelisses de femmes, en peau de lynx ou de martre. Quelques bachi-bouzouks, afin d’outrager les chrétiens, s’étaient parés de chasubles tissées d’or, dérobées dans les églises de Klissoura. Quant au chef, Tossoun Bey, il se pavanait dans une magnifique robe de chambre à l’européenne, en cachemire gris bordé de drap écarlate d’où pendaient de longs glands rouges. Comme on l’apprit, Tossoun-Bey, ne connaissant pas la destination de ce vêtement, l’avait pris pour la tenue d’apparat d’un noble personnage et avait voulu entrer à Biala-Tcherkva ainsi vêtu.
Un seul trophée vivant ornait son triomphe ; un prisonnier qui marchait derrière lui, les mains liées au dos : Ratchko le Péteux.
Horrible spectacle !
Marika ne vit presque rien. Dès qu’elle avait aperçu la horde, elle avait détalé et était passée par d’autres rues désertes et silencieuses. Elle arriva enfin à la porte de Sokolov. Elle la poussa, et comme elle ne s’ouvrait pas, cogna plusieurs fois.
– Qui frappe ? dit de l’intérieur une voix de vieille femme.
– Grand-mère Iakimitsa, ouvre-moi ! put à peine dire Marika, hors d’haleine.
– Que cherches-tu ici ?
– Le Dr Sokolov... Ouvre donc ! cria la petite, prête à pleurer.
La vieille marmotta avec colère, mais se décida à ouvrir.
– Pourquoi le cherches-tu ? Il n’est pas là, dit-elle avec brusquerie.
– Où est-il, grand-mère ?
– Dis-le-moi, que je te le dise. On le recherche depuis Mer. Et, jusqu’à présent, il n’y a aucune trace de lui. Allons, file !
Et la vieille claqua la porte. Marika resta interdite. Puis, elle reprit sa course. La porte du photographe n’était pas loin. Marika la poussa.
– Que veux-tu, fillette ? lui demanda une femme en loques, pâle et voûtée.
– L’Allemand...
– Qu’est-ce que tu veux ?
– Laisse-moi entrer chez l’Allemand ! dit Marika en poussant la femme pour pénétrer dans la cour.
– As-tu perdu la tête ? Tu sais bien qu’on l’a égorgé, l’Allemand ! répondit avec irritation la femme déguenillée, et elle repoussa Marika dans la rue.
À ces mots, l’enfant se figea d’épouvante. Elle s’imagina que grand frère Boïtcho allait être égorgé lui aussi, que les Turcs étaient venus pour lui, qu’ils allaient saisir la lettre parce que quelqu’un leur avait dit qu’elle portait une lettre de grand frère Boïtcho. Et maintenant ? Que devait-elle faire ? Elle regarda et, à présent seulement, remarqua que la rue était déserte, que personne n’y passait. Elle eut plus peur encore et commença à pleurer. Elle était plongée dans ce désespoir quand quelqu’un la poussa par-derrière. Elle se retourna et vit Koltcho.
Il était seul à circuler dans cette rue, frappant de son bâton le pavé, l’air pensif et soucieux.
– Pourquoi pleures-tu, petite fille ? demanda l’aveugle, fixant ses yeux blancs sur Marika, comme s’il cherchait à la reconnaître.
Si Marika avait mieux connu Koltcho, elle aurait enfreint l’ordre d’Ognianov et dit à l’aveugle de quoi il s’agissait. Celui-ci aurait remplacé Sokolov. Mais cet étranger l’effrayait : elle s’enfuit de l’autre côté de la rue, puis s’engagea dans une autre.
– Fillette ! Marika ! cria Koltcho qui, à ce même instant, grâce à son extraordinaire intuition venait de reconnaître, en entendant les sanglots, que c’était là l’enfant du père Stoïan. Aussitôt après Marika, Koltcho avait frappé à la porte de Sokolov pour demander à la vieille femme des nouvelles de celui-ci et il avait appris qu’une fillette venait de le chercher. Il avait deviné que la fillette était Marika, que, si elle cherchait le docteur, c’était pour quelque chose de très grave, que ces sanglots éperdus étaient causés par son insuccès. Qui pouvait bien l’envoyer à cette heure chez Sokolov ? Quelqu’un qui ne savait quelle était la situation ici, quelqu’un du dehors. Ne serait-ce pas « lui » ? Depuis hier s’était répandue la rumeur que Boïtcho n’aurait pas péri, qu’il se serait enfui dans la montagne et que, probablement, il y errait encore. Boïtcho ne serait-il pas descendu jusqu’à la rivière du monastère, où Marika demeurait dans la scierie de son oncle, et ne l’aurait-il pas envoyée avec un message pour Sokolov ? Oui, oui, cette Marika était un instrument de la Providence ! Toutes ces suppositions surgissaient dans l’esprit de Koltcho et son cœur aimant était plein d’anxiété. Il cria encore, en continuant sa marche :
– Eh, petite ! Marika ! Marika ! Fillette !
Personne ne lui répondit. Koltcho gémissait, désespéré. Il était arrivé sur la place publique. Elle n’était ni déserte, ni silencieuse. Brouhaha, cris des hommes, trépignement des chevaux sur les pavés. En un mot, la cohue. On entendait des cris en turc. Qu’était-ce ? Koltcho, étonné, s’arrêta devant le café et tendit l’oreille.
Une voix qui criait en bulgare parvenait de l’intérieur :
– Voilà ce qu’ils ont fait : nous sommes devenus la risée de tous. Mettre le feu à notre ville ! Il s’en est fallu d’un cheveu que nous soyons tous tués comme des chiens et qu’il ne reste pierre sur pierre de notre ville ! Où sont-ils maintenant, ces coquins, que je leur pose la question : « Nous avez-vous demandé si nous voulions ou non l’insurrection ? » Amenez-les-moi ici que je leur règle leur compte. Ils se révoltent. Contre qui ? contre le Sultan, contre leur père, contre celui qui ne leur veut que du bien, qui les défend comme la prunelle de ses yeux, qui ne permet pas qu’un cheveu tombe de leurs têtes. Pendant des centaines d’années, nous avons été l’ombre du trône des sultans et nos aïeux, et nos frères, et nous, nous avons tous vécu dans le bien-être, et nos petits-fils ne pourront trouver mieux. Reprenons nos esprits, ou que le diable nous emporte ! Celui qui ne se plaît pas ici, qu’il s’en aille en Moscovie. Nous, nous sommes contents !
Koltcho comprit que l’orateur était le tchorbadji Iordan.
– Vive sa Majesté le Sultan ! cria une voix.
Koltcho reconnut la voix de M. Fratiou.
Les deux hommes étaient, pour le moment, l’incarnation même de cette panique qui rend l’homme semblable à la bête. Le tchorbadji Iordan n’était haïssable que pour la franchise de ses paroles : bien avant l’insurrection aussi, il pensait et parlait comme aujourd’hui ; mais M. Fratiou était répugnant parce que son cri était une lâcheté. Personne ne répondit à son cri ; le silence même qui le suivit était une réponse. Les temps étaient tels que les Iordans avaient raison, et que les Fratious étaient honnêtes. Toute lâcheté des vaincus était tolérée parce que toute violence des vainqueurs était admise. Væ victis ! La catastrophe d’Avril n’a pas été moins terrible par les massacres de Batak que par la honte des déchéances.
Koltcho poussa un profond soupir puis, retournant sur ses pas, il se dirigea vers la maison de Guinka.
8 LA PRAIRIE
En ce même jour, dans une ravissante prairie qui s’étendait aux environs de la ville, sous l’ombre d’un vert feuillage, une famille était assise.
Au sud de la prairie s’élevait la muraille d’un jardin dont la porte était ouverte, au nord s’étendait le panorama de la Stara-Planina, avec ses sommets dénudés, ses collines escarpées, ses pentes au sol friable, sa pittoresque et florissante campagne.
Cette prairie et ce jardin appartenaient au tchorbadji Iordan, cette famille était la sienne.
En dehors de cette compagnie, il était rare que quelqu’un apparût en ces lieux. Après la capitulation, la ville s’était, il est vrai, un peu tranquillisée, et ses rues étaient ranimées. Mais personne n’osait en sortir, aller dans ses environs soit pour travailler, soit pour se promener et jouir de la radieuse beauté de la nature. Seule, la famille de Iordan eut cette audace.
La femme de Iordan, cruellement frappée par la mort de Lalka, était tombée gravement malade et, plusieurs jours de suite, n’avait pu quitter le lit. Sur l’instante recommandation du médecin, aujourd’hui seulement, on l’avait amenée, par les cours des maisons, jusqu’à ce jardin de campagne de Iordan, où elle pourrait remuer un peu et respirer l’air frais. Elle avait immédiatement ressenti l’action bienfaisante de la promenade. Alors, on était sorti dans la prairie où paissaient deux magnifiques buffles qui appartenaient également à Iordan.
Un zaptié, assis à côté, veillait à la sécurité de la famille du tchorbadji.
À la famille s’étaient jointes deux étrangères : une solide paysanne et Rada. La paysanne était Staïka, la femme de Borimetchka, que Guinka avait prise chez elle depuis la veille pour l’aider dans les travaux du ménage.
Guinka avait également donné l’hospitalité à Rada. Personne ne s’en était indigné, ni la femme de Iordan, ni les autres membres de la famille. Au contraire, la vue de Rada, tendre amie de la défunte, leur apportait une douce et triste consolation ; le mépris et la haine avaient été remplacés dans leurs âmes par des sentiments bienveillants à l’égard de la malheureuse fille privée de foyer.
Comme nous le savons, Staïka et Rada, qui avaient fait connaissance encore à Klissoura, étaient toutes deux victimes de l’anéantissement de celle-ci. Grâce à Staïka, Ivan avait pu sauver à temps Rada. En route, la paysanne avait tâché de réconforter Rada et, depuis leur arrivée, l’avant-veille, à Biala-Tcherkva, elle n’avait plus voulu se séparer d’elle. Simple, inculte, elle avait pourtant compris l’état douloureux de Rada et prenait part à ses souffrances. Avant peu, il avait été question de Boïtcho, et Mme hadji Rovoama avait affirmé qu’il était mort dans le combat. Staïka avait vu, avec pitié, le visage de Rada changer, blêmir. Et la paysanne avait pris en haine la religieuse qui parlait avec une telle légèreté.
– L’a-t-elle vu de ses propres yeux, que l’instituteur est mort ? Et pourquoi se réjouit-elle, cette chouette ? murmurait avec irritation Staïka, en se penchant sur Rada.
– Tais-toi, tais-toi, répondait tout bas celle-ci.
Staïka prêta de nouveau l’oreille à la conversation qui se poursuivait. Puis, elle souffla à Rada :
– Rada, la noire, elle a des moustaches. Pourquoi ne les rase-t-elle pas ?
Rada sourit involontairement :
– Tais-toi, sœur.
Staïka voyait pour la première fois Mme hadji Rovoama et ne savait pas qu’elle était la tante de sa maîtresse. Le chapelet de hadji Rovoama s’étant rompu, Staïka, pour se venger, avait prestement ramassé et dissimulé quelques-uns des grains d’ambre, et maintenant elle regardait avec malice la religieuse les chercher autour d’elle. Staïka pouffa enfin de rire et tira Rada par la manche.
– Pourquoi ris-tu, Staïka ? lui demanda Guinka.
– Je regarde comment, pour deux grains de mais, se démène hadji Vrana 137 !
– Hadji Rovoama ! la corrigea tout bas Rada.
Par bonheur, l’inconvenant jeu de mots de Staïka n’avait pas été entendu par les autres ; ils venaient tous de se tourner dans la direction de la ville : Steftchov était en vue. Le gendre du tchorbadji Iordan n’était pas encore parti pour Gumurdjina 138. Son entrée en fonctions avait été ajournée par le soulèvement.
Dès qu’il arriva, tous se suspendirent à ses lèvres. Il raconta avec feu l’exploit qu’avait accompli ce jour-là la députation dont il faisait partie. Celle-ci, avec Iordan Diamandiev en tête, avait été envoyée à la rencontre de Tossoun-Bey qui venait attaquer la ville, considérée comme séditieuse. La députation, chargée de demander grâce, avait réussi à grand-peine à sauver Biala-Tcherkva du sort de Klissoura, mais à trois lourdes conditions : la ville devait compter immédiatement à Tossoun-Bey mille lires pour qu’il puisse calmer et renvoyer la horde à laquelle il avait promis la mise à sac de Biala-Tcherkva ; puis toutes les armes, jusqu’au dernier canif, devaient être livrées ; enfin, chaque suspect devait être livré aux autorités. Cette capitulation totale, qui n’avait pas sauvé Batak de Mehmed Tamrachliat, sauvait Biala-Tcherkva. Tossoun-Bey n’était entré à Biala-Tcherkva qu’avec une partie de sa horde et pour recevoir les armes. Donc le tchorbadji Iordan et, jusqu’à un certain point, Steftchov étaient les sauveurs de la ville.
Tout en racontant ces choses avec suffisance et fierté, Steftchov jetait parfois des regards haineux sur Rada. Elle ne le regardait pas, mais la présence de cet homme détesté pesait lourdement sur elle. L’insolence de sa voix agissait sur ses nerfs, chaque son retentissait sinistrement dans son cœur. Steftchov était pour elle l’image fatale de la catastrophe qui avait anéanti son bonheur ; il lui inspirait une peur et une haine insurmontables. « Mon Dieu, pensait-elle, tant de gens, toutes les bonnes gens ont péri ou périssent ; lui seul vit et se réjouit. Maintenant, il est entouré d’honneurs, il est parmi les premiers de la ville. Est-ce parce qu’il est si méchant, si mauvais ?... » Mais, soudain, elle se tourna vivement vers Steftchov, le regard brillant : il parlait à présent de Boïtcho et, cette fois, ce qu’il disait la remplissait de joie.
– Ce vaurien est donc en vie ? criait avec étonnement Mme hadji Rovoama.
– Il était en vie et il s’est enfui dans la montagne, expliquait Steftchov, mais est-il encore en vie, cela je ne le sais pas. Peut-être en ce moment les aigles sont-ils en train de le déchiqueter.
Rada, d’émotion et de douleur, pressa les mains sur son cœur.
– Je vous dis, moi, que le comte est vivant, que le comte ne peut pas mourir, s’écria hadji Smion. On l’a si souvent dit mort, et il a réapparu vivant ensuite ! Je ne crois pas... Quand j’étais en Moldavie, tout le monde disait que Ianculescu, le brigand, était mort, les journaux l’écrivaient aussi... « Buna diminiata, domnule Ianculescu 139 ! » lui dis-je... Et lui, il me prend seulement ma montre, en réponse à mon « bonjour ». Je veux dire qu’il ne m’a pas tué. Donc, ma pensée est qu’un brigand ne meurt pas.
Et hadji Smion cligna amicalement de l’œil à Rada, voulant lui dire par-là : « Toi, crois-moi, le comte est vivant ! »
– Pourvu que ce vaurien ne s’amène pas ici, il mettra le feu à notre ville, comme à Klissoura.
– Qu’il ose seulement ! On n’arrive pas non plus à se saisir du conducteur d’ours : il faudrait en finir avec lui aussi, comme avec le petit Kandov et les autres, dit Steftchov.
– C’est triste, mais il n’y avait pas moyen de faire autrement. Il fallait sacrifier quelques hommes pour en sauver des milliers d’autres, dit un des assistants.
– C’est certain : pourquoi viennent-ils chez nous, les vagabonds ?
– Pourquoi ils viennent ? Ils viennent pour chercher refuge, dit vivement Guinka.
Steftchov la regarda avec étonnement :
– Alors, sœur Guinka, selon toi, notre père Iordan a mal agi ?
– Ah oui ! il a bien agi ! Vous avez bien agi, papa et vous ! Comme si vous étiez des Juifs ou des Turcs et non pas des Bulgares. Pensez-y donc : pour quoi et pour qui ces gens-là s’en vont-ils à la mort ?
Le visage de Guinka s’était enflammé et ses yeux lançaient des éclairs.
– Tu es folle ! gémit sa mère, la malade.
– Selon toi, riposta méchamment Steftchov, à ces gens-là, tes patriotes, quand ils daignent nous visiter, nous devons amener les enfants des écoles pour leur chanter la bienvenue, et ensuite leur ouvrir nos maisons et leur servir de la baklava ; d’ailleurs il y en a qui leur ont bien fait des galettes...
– Je sais, je sais, interrompit avec colère Guinka, livrez-les aux Turcs, égorgez-les, exterminez-les, buvez leur sang comme aux gars d’hier. Avez-vous vu la mère de Kandov, comme elle s’est jetée par terre, au milieu de la rue ! Oh ! ma sœur, oh ! Lalka ! Oh ! mon Dieu ! mon Dieu ! mon Dieu !
Et Guinka s’appuya au tronc du noyer, couvrant de son mouchoir ses yeux d’où jaillit un flot de larmes, puis elle sanglota sans retenue. Ces pleurs subits étaient pour les insurgés tués la veille ; mais les assistants crurent que c’était pour Lalka, dont le nom s’était mêlé aux paroles de Guinka. Rada, les larmes aux yeux, courut à Guinka pour la consoler. Le nom de la défunte avait troublé le cœur de la vieille Iordanitsa et elle commença aussi à pleurer.
Cette douleur mit Steftchov en rage : il comprit qu’elles pleuraient pour les insurgés.
Le zaptié, qui avait à peu près compris quel était le sujet de la conversation, s’approcha de Steftchov et de hadji Smion, et leur dit à voix basse :
– Vous a-t-on dit ? Un des Komitadjis de Klissoura serait descendu au bord de la rivière du monastère.
– Comment ? Qui te l’a dit ? demanda Steftchov en sursautant.
– Arabia, la tzigane, l’a vu en allant cueillir du sumac.
– Quand ?
– Aujourd’hui à midi.
– A-t-elle averti les autorités ?
– Je ne sais pas.
– Il faut le dire au plus vite, murmura Steftchov, saisissant rapidement son fez resté dans l’herbe. Aujourd’hui, il ne s’en est fallu que d’un cheveu pour que tout aille au diable, et voilà comment encore un mauvais sujet...
– C’est le même, bien entendu, dit tout à coup hadji Smion.
– Qui ? demanda Steftchov.
– Le comte... N’ai-je pas dit qu’il est en vie ?
– Tant mieux : il y aura une nouvelle tête à l’abattoir.
Hadji Smion était effrayé de ses propres paroles, dites sans y penser. Il pâlit et, s’adressant à Steftchov :
– Tu vas là-bas ?
– Oui, j’y vais.
– Quel besoin as-tu de faire cela ? Laisse le pauvre homme tranquille, supplia hadji Smion. Il se trouvera bien dans tout Biala-Tcherkva un coin où nous le cacherons... Si c’est le comte, tout le monde l’aime.
– Tu es fou, hadji ! s’écria Steftchov, lui jetant un regard haineux. Nous devons sauver Biala-Tcherkva.
Et, sans prendre congé de la compagnie, il partit pour la ville en continuant à parler avec le zaptié qui le suivit jusqu’à la clôture.
Hadji Smion était atterré.
9 UN ALLIÉ
La plupart des assistants n’avalent même pas remarqué le brusque départ de Steftchov ; ils étaient tous occupés à consoler la vieille mère.
– Allons, tchorbadjika, rentrez dans le jardin ; nos Osmanlis apparaissent déjà de-ci de-là dans les potagers, dit le zaptié, revenant prendre son fusil pour rejoindre Steftchov qui l’attendait.
Iordanitsa se leva. Guinka la prit sous le bras et l’emmena. Les autres suivirent. En dernier lieu venaient Rada et Staïka. Celle-ci serrait avec force le bras de sa compagne et lui disait :
– Rada, l’instituteur est en vie. Tu as entendu ?
Mais Rada ne répondait pas, saisie de nouveau par l’anxiété.
Un pressentiment lui disait que cet homme échappé de la catastrophe de Klissoura, descendu aujourd’hui du Balkan, et que Steftchov allait si vaillamment livrer, ne lui était pas étranger ; que c’était peut-être « lui ». Son cœur se serrait, plein d’une anxiété et d’une peur inexprimables.
– Hé ! pourquoi court-elle ainsi pieds nus, cette gamine ? s’écria Staïka, s’arrêtant et montrant une fillette qui arrivait en courant à travers la prairie.
C’était Marika. L’enfant, inquiète, retournait chez elle, après avoir, pendant plusieurs heures, cherché à apprendre où était le Dr Sokolov. En vain ! Aussi fut-elle remplie de joie en apercevant Rada, la seule personne proche de Boïtcho et qui pourrait lui venir en aide. Quoiqu’elle se rappelât la recommandation de Boïtcho, elle devinait que Rada n’était pas dangereuse, que grand frère Boïtcho avait oublié de l’orienter vers Rada et qu’elle pouvait tout raconter à celle-ci.
Rada vint à sa rencontre :
– Viens, viens, Marika, que deviens-tu ?
La fillette s’arrêta, regarda craintivement autour d’elle et demanda :
– Grande sœur Rada, sais-tu où est le docteur ?
– Sokolov ? Je ne sais pas. Quelqu’un est-il malade ?
Marika, troublée, bégaya quelque chose.
– Qui t’envoie chez le docteur, mon enfant ? Quelqu’un est-il malade ? répéta Rada.
– Non, celui qui m’envoie est... grand frère Boï... Marika, effrayée, n’acheva pas le mot.
Rada avait compris. Elle se sentit défaillir et regarda anxieusement autour d’elle. Au même instant, Steftchov apparut, dardant un regard d’épervier sur Marika. Il l’avait aperçue et était revenu exprès pour elle.
– Petite, que tiens-tu dans la main ? lui demanda-t-il.
Marika pâlit. Elle recula comme prise en faute et cacha sa main derrière son dos.
– Donne voir ce papier, fillette ! dit-il en s’avançant vers elle.
L’enfant poussa un cri sauvage et s’enfuit à travers la prairie vers l’étang.
Un soupçon traversa l’esprit de Steftchov. Il avait reconnu la fillette du père Stoïan. Pourquoi cherchait-elle Rada et de qui était la lettre adressée à celle-ci en ce moment critique ? Ne serait-elle pas d’Ognianov ? Ne serait-ce pas lui l’insurgé descendu du Balkan ? À cette pensée, son visage s’illumina d’une joie mauvaise et il se mit à poursuivre Marika.
Rada suivait anxieusement des yeux Marika qui, ayant aperçu le petit bouvier près de l’étang, retournait sur ses pas pour prendre une autre direction. Ainsi elle se jetait dans les mains de Steftchov qui s’était élancé à sa rencontre.
Marika vit le nouveau danger ; elle poussa un second cri strident comme si elle demandait secours contre son cruel poursuivant.
Staïka regardait, ahurie, ce qui se passait autour d’elle. Elle ne pouvait comprendre pourquoi ce bout de papier était si nécessaire à Steftchov, mais elle lut sur le visage de Rada que le billet ne devait absolument pas tomber dans les mains de cet homme. Elle s’élança légère comme une biche, à travers la prairie, atteignit Steftchov, le saisit par la veste et le retint, donnant ainsi à la fillette le temps de s’enfuir.
Steftchov se retourna, vit la paysanne. Il ne pouvait en croire ses yeux. Une telle audace !
– Oncle, pourquoi cours-tu après la fillette ? lui demanda-t-elle avec colère et sans le lâcher.
– Lâche-moi, espèce de truie ! hurla Steftchov avec mépris. Ah ! rustaude, c’est l’autre qui t’envoie. Je sais, je sais. Kosta, Kosta, attrape-la ! criait-il de toutes ses forces au bouvier de Iordan, que le cri de Marika avait réveillé.
Celui-ci coupa la route à la pauvre fillette qui s’arrêta étourdie en face de ce nouveau persécuteur, puis revint en arrière comme une chevrette aux abois et se glissa entre les buffles, cherchant leur appui contre les hommes.
Staïka, dont la nature sauvage s’était éveillée, voulut se jeter sur Steftchov et le bouvier – devant elle, ils étaient comme des poules en face d’un aigle – mais elle resta sur place, pétrifiée : Rada lui faisait désespérément signe de rebrousser chemin.
La paysanne, n’y comprenant plus rien n’osa pas venir en aide à Marika. Elle vit, le cœur déchiré, l’enfant à moitié morte de peur se laisser tomber à côté des buffles et perdre connaissance. Depuis la nuit terrible dans le moulin, Marika souffrait de crises nerveuses chaque fois qu’elle avait peur et s’évanouissait. Le buffle qui était debout pencha son énorme tête au-dessus de la fillette inanimée, flaira doucement et comme avec pitié son visage, et releva ensuite son mufle humide, ruminant tranquillement et regardant devant lui de ses gros yeux bleus.
Steftchov ouvrit le corsage à moitié déboutonné de Marika et chercha le billet, car il avait vu qu’elle l’avait fourré là. Mais il ne trouva rien. Lui et le bouvier cherchèrent au-dessous d’elle, en vain. Ce morceau de papier semblait avoir disparu sous terre.
Steftchov jeta des regards courroucés autour de lui :
– Ne serait-ce pas celui-ci qui l’aurait avalé ? et il fixa sévèrement le buffle.
Goliou, comme s’il comprenait qu’on le soupçonnait de vol, ouvrit largement sa bouche gluante : seules de longues herbes à moitié mâchées et baveuses en pendaient.
Steftchov était stupéfait. Il ne pouvait s’expliquer où avait disparu le bout de papier.
– Cette salope a dû le laisser tomber dans la prairie, dit-il, et il s’éloigna avec Kosta. Ils se mirent à fouiller l’herbe.
Marika revint bientôt à elle. Son premier mouvement fut de chercher dans son sein. Ne trouvant rien, effrayée, elle se mit à pleurer. Elle se leva et s’en fut, toujours gémissante.
Steftchov et le petit bouvier cherchèrent longtemps. À la fin, Steftchov partit rapidement pour la ville. Il avait probablement trouvé le billet. En passant près de Rada, il lui dit avec un regard féroce :
– Aujourd’hui même nous verrons sa tête au bout d’une corde.
Rada, abattue par l’angoisse, restait clouée sur place. Staïka, debout près des buffles, partageait son inquiétude, mais ne comprenait toujours pas pourquoi celle-ci l’avait empêchée de couvrir la fuite de Marika. Elle continuait à regarder avec fureur dans la direction où avait disparu Steftchov et, en même temps, caressait machinalement le front, au poil frisé et rougeâtre de Goliou.
Goliou flaira la main caressante de l’inconnue et déplaça un de ses sabots de devant.
– Rada ! Voilà ton billet ! s’écria la paysanne en ramassant un papier froissé.
En effet Goliou, pendant qu’il flairait la fillette évanouie, avait mis son sabot sur le billet qu’elle venait de lâcher.
Rada saisit, le bout de papier, le défroissa d’une main tremblante et y jeta un coup d’œil.
– De Boïtcho ! s’écria-t-elle.
Elle pressa ses mains sur son sein, se sentant prête à défaillir d’émotion. Le billet ne contenait que deux lignes :
« Je suis descendu du Balkan. Apporte-moi ou envoie-moi des vêtements et des renseignements. Au plus vite. »
Le message n’était pas signé.
Rada le relut encore deux, trois fois, et vit alors que ses mots étalent écrits sur la moitié libre de la lettre qu’elle avait envoyée à Boïtcho, par Borimetchka, dans un des moments les plus terribles. En même temps que ce morceau de papier avait été déchiré son nom : Rada, écrit au crayon. Les larmes inondèrent ses joues.
– Que dit le billet, Rada ? demanda Staïka.
– Il est en vie, en vie, sœur ! put lui dire Rada, qui perdait le souffle.
Staïka éclata de rire, tant elle était heureuse.
– L’instituteur est en vie, Rada ! Ne te l’avais-je pas dit que l’autre, la noire, ne savait rien du tout quand elle bavardait à son sujet ?
– Boïtcho vit, il vit, ma sœur ! Va vite dire à Guinka que je me suis sentie mal et que je suis partie. Ne parle pas du billet.
Rada se dirigea vers les potagers.
10 AMOUR ET HÉROÏSME
La jeune fille s’abrita derrière un buisson voisin, qui la cachait à tout regard et se mit à réfléchir. Sa situation était critique. La vie de Boïtcho était suspendue à un cheveu, et il ne s’en doutait pas. L’homme que la tzigane avait vu, c’était lui : il fallait donc immédiatement l’avertir du danger et lui donner le moyen de se sauver. Pour elle, pour une jeune fille, ce n’était pas chose facile : la campagne était maintenant déserte et parcourue seulement par les bachi-bouzouks qui rôdaient et pillaient. Les cheveux se dressèrent sur sa tête à la pensée qu’elle pourrait rencontrer quelques-uns de ces hommes féroces, mais rien ne pourrait l’arrêter puisqu’il s’agissait de Boïtcho. Son amour braverait toutes les cruautés, celle du Destin et celle des hommes... Oui, elle partirait immédiatement... Mais il demandait des vêtements : bien entendu, des vêtements ordinaires, de ceux que portent les hommes paisibles ; ainsi il n’éveillerait pas les soupçons. Déguisé, il pourrait même descendre à Biala-Tcherkva. Ceci dressait devant elle de terribles difficultés : où trouverait-elle à cette heure des vêtements ? qui s’exposerait à un danger certain en donnant les siens ? et quand les chercherait-elle, alors que chaque minute était précieuse ? Puis une autre pensée traversa son esprit, celle qu’elle aurait dû avoir tout d’abord : où se cachait Ognianov ? Le billet ne le disait pas. Probablement par prudence, il ne l’avait confié qu’à Marika, afin qu’elle le révélât oralement à Sokolov. Mais Marika s’en était allée. Comment n’avait-elle pas eu l’idée de lui demander où se trouvait Boïtcho ? Heureusement, elle avait au moins appris par le zaptié qu’il se trouvait dans la vallée du monastère. La vallée était grande mais elle allait la fouiller d’un bout à l’autre et elle trouverait Boïtcho. Hélas ! ses ennemis ne perdraient pas tant de temps, ils savaient l’endroit précis où Boïtcho attendait la réponse à son message, mais elle le trouverait, elle les devancerait parce qu’elle aurait des ailes. Une seule chose était impossible : trouver des vêtements ! Et c’est ce qu’il voulait avant tout ! Mon Dieu ! mon Dieu ! Le temps fuyait si vite... Et elle n’avait personne à qui elle pût demander conseil.
Toutes ces pensées et considérations traversèrent son esprit avec la rapidité de l’éclair. Elle décida d’abandonner son abri et d’aller à la vallée du monastère, mais elle regarda d’abord attentivement à travers les branches du fourré vers le jardin. Là-bas, devant la porte, se tenait un homme coiffé d’un grand fez et habillé d’un costume à la mode française, en drap gris. Elle le prit d’abord pour Steftchov, mais non, cet homme là-bas était de plus petite taille et d’aspect fort différent. Elle reconnut Koltcho, l’aveugle. Son cœur battit de joie, bien que Koltcho, privé de la vue, ne pût lui être très utile dans sa présente tâche : au moins, elle lui demanderait conseil. Dieu lut envoyait Koltcho.
Mais elle vit, avec anxiété, Koltcho franchir le seuil de la porte ; il entrait dans le jardin.
Elle cria de toutes ses forces :
– Baï Koltcho, baï Koltcho, attends-moi, je viens !
Et elle courut vers lui comme une flèche.
Koltcho l’entendit et s’arrêta. En un clin d’œil Rada fut auprès de lui.
– Baï Koltcho !
– Rada, c’est toi que je cherchais, dit l’aveugle.
Et s’approchant d’elle, il lui souffla :
– On dit que Boïtcho est en vie.
– Oui, il est en vie, baï Koltcho dit Rada, haletante.
– Il serait dans la montagne, ajouta Koltcho.
– Non, Koltcho, Boïtcho est descendu à la rivière du monastère.
Le visage de Koltcho refléta son émotion.
– Que dis-tu, Rada ?
– Oui, là-bas, baï Koltcho, il est là-bas. J’ai reçu une lettre de lui... Il demande des vêtements, il a besoin de vêtements, baï Koltcho. On l’a dénoncé aux Turcs, des tziganes l’ont vu. Mais je courrai l’avertir. Il fuira. Ils ne l’attraperont pas, seulement on reconnaîtrait partout que Boïtcho est de l’insurrection, il lui faut des vêtements. Mon Dieu, mon Dieu ! Et il n’y a plus le temps...
Pendant que Rada disait son anxiété en phrases entrecoupées et d’une voix pleine de larmes, Koltcho avait déjà trouvé une solution.
– Il aura des vêtements, Rada, dit-il.
– Oh ! baï Koltcho, dis vite ! Où les prendrai-je ?
– Ici tout près, dans une maison amie.
– Baï Koltcho, il faut se dépêcher.
– Attends une minute.
Et Koltcho retourna en arrière, en courant.
Rada, abritée sous l’auvent, attendait avec impatience. Deux minutes s’étaient à peine écoulées et ces minutes lui semblaient des heures. Elle craignait, d’autre part, que quelqu’un, sortant du jardin, la vît seule et si émue... Elle gémissait d’angoisse.
À ce moment apparut une fillette, un baluchon à la main. L’aveugle avait mis dedans un fez, un veston long et un pantalon de drap gris : deux ou trois minutes plus tôt, ces vêtements étaient sur Koltcho ! Sa bonté d’âme lui avait encore fait prévoir deux choses auxquelles Rada, dans son trouble, n’avait pas songé : il avait ajouté une miche de pain et fourré une centaine de groches dans une des poches.
Rada ne regarda pas le baluchon ; elle le prit des mains de la fillette et se dirigea vers le nord, à travers les potagers.
– Mon Dieu, mon Dieu ! se disait-elle avec amertume, il ne veut plus me voir ! Que lui ai-je fait ? Et moi, je l’aime...
Comme nous l’avons dit, la campagne était déserte. Aucun Bulgare n’osait s’aventurer hors de la ville ; seuls quelques bachi-bouzouks y rôdaient. Et pour une jeune fille, surtout seule, le danger était terrible. Mais Rada ne pensait même pas à cela. L’amour sublime n’a qu’une mesure, une mesure sublime, comme lui : l’abnégation.
11 LE BACHI-BOUZOUK
Caché dans le moulin désert, Ognianov attendait l’apparition de quelque ami ou du moins celle de Marika. Ce moulin abandonné, à moitié écroulé, était isolé au fond de la vallée, non loin d’une bruyante cascade ; ensuite, il n’y avait plus d’autre bâtiment. Dans les murs béaient de grands trous, là où se trouvaient auparavant les fenêtres et les portes. Une partie de la toiture avait été emportée par le vent.
Ognianov surveillait par ces ouvertures le sentier qui longe la rivière jusqu’à la cascade et grimpe ensuite à droite sur le versant escarpé de la montagne.
Il attendit longtemps, plein d’impatience et d’inquiétude ; les heures passaient, le jour déclinait, la vallée restait toujours déserte.
La perplexité d’Ognianov augmentait de plus en plus. Son incertitude se transformait en une indicible anxiété. Il cherchait à deviner la cause de ce retard. Le pire était que Marika n’avait réussi à trouver ni le docteur ni Barzobégounek, obligés peut-être de se cacher. Il ne se doutait même pas du terrible danger qu’il courait. Il ne pouvait savoir que sa présence en ce lieu était déjà connue non seulement de ses amis, mais aussi de ceux qui lui voulaient du mal, et que son sort dépendait d’une seule chose : qui arriverait le plus vite – ses ennemis ou ses proches ?
Brusquement apparut sur le sentier un homme dont la vue troubla Ognianov. C’était un Turc.
Il était corpulent et de haute stature ; sa tête était coiffée d’un turban vert ; il portait un pantalon turc, et un long yatagan sortait à demi de sa ceinture. Il avait un havresac au dos, probablement un de ces Turcs dont lui avait parlé Marika, un bachi-bouzouk. Que cherchait-il ici ?
Ognianov sortit son revolver et continua à surveiller le bachi-bouzouk. Celui-ci poursuivait sa route à grands pas, montant toujours.
Il arriva à la hauteur du moulin désert, à une distance d’une cinquantaine de pas, et passa sans se retourner.
Ognianov était étonné. Mais il était maintenant condamné à une entière inaction, à une complète immobilité. Il ne pouvait que surveiller et attendre. Le Turc marchait, montait toujours sur le chemin. Il passa la rivière, sautant d’une pierre à l’autre, s’engagea dans le fouillis des herbes folles qui verdoyaient au pied de la pente, et s’arrêta.
Ognianov remarqua qu’il s’était arrêté juste au point où commençait le sentier menant à la montagne. Il pâlit. Ce sentier était le seul par où, en cas de besoin, il aurait pu fuir dans la montagne. Les escarpements qui surplombaient le val étaient inaccessibles en tout autre point. Ognianov tressaillit. Ne lui coupait-on pas la route ? Ce bachi-bouzouk n’était-il pas suivi par d’autres ?
Le Turc enleva son turban, dont une extrémité s’était déroulée, sans doute allait-il la fixer. Ainsi, le visage et la tête du bachi-bouzouk étaient à découvert pour Boïtcho ; et celui-ci vit un beau visage de jeune homme, au large front blanc couronné d’une chevelure blonde qui retombait en boucles.
Ognianov ne put retenir un cri de stupéfaction ; il courut à la fenêtre, mit deux doigts dans la bouche, siffla. Le canon aigu retentit dans le val et fut répété par les échos des rochers.
Le bachi-bouzouk darda son regard sur le moulin d’où partait le sifflement et, voyant les signaux d’Ognianov, s’élança dans cette direction : c’était Sokolov. Les deux amis s’étreignirent.
– Boïtcho, Boïtcho, tu es vivant, frère ! Que fais-tu là ? criait Sokolov, ému jusqu’aux larmes.
– Et toi, docteur, dans cette tenue d’apparat ?
– Que fais-tu ici, frère, quand es-tu venu ?
– Cette nuit. Mais toi, pourquoi as-tu tant tardé ?
– Moi ? demanda Sokolov, étonné.
– Marika t’a trouvé trop tard ?
– Quelle Marika ?
– Comment ? Elle ne t’a pas trouvé ? s’écria Ognianov, stupéfait. Je l’ai envoyée auprès de toi ce matin.
– Personne ne m’a trouvé et d’ailleurs personne ne pouvait me trouver, répondit Sokolov.
Ognianov le regarda, ahuri :
– Mais alors pourquoi es-tu ici ? Pour qui es-tu venu ?
– Je fuis.
– Tu fuis, docteur ?
– Ne le vois-tu pas à mes habits ?
– Es-tu sorti ainsi de Biala-Tcherkva ?
– Je suis sorti cette nuit de Biala-Tcherkva et je me suis caché jusqu’à présent dans le moulin d’Hambarov...
– Comment, nous étions si proches l’un de l’autre et nous ne le savions pas ? Étrange ! étrange ! étrange ! Et où s’est perdue Marika ? dit Ognianov repris d’inquiétude. Où vas-tu maintenant ?
– Dans la montagne, j’ai attendu jusqu’à présent qu’on m’apporte un passeport et de l’argent. Mais maintenant nous ne nous séparerons plus. La vie et la mort, ensemble ! Ah ! Boïtcho, Boïtcho, mon frère, quels terribles malheurs se sont abattus sur notre pays ! Qui aurait cru que les choses tourneraient ainsi ?
– Assieds-toi, assieds-toi ici, par terre, que nous puisions causer.
12 UNE VILLE NON INSURGÉE
Tapis dans leur coin, les deux hommes se mirent au courant de ce qui s’était passé depuis neuf jours, à Klissoura comme à Biala-Tcherkva. Le récit, ou plutôt le compte rendu de Sokolov, éclaira Ognianov sur la situation et lui donna la clef de l’énigme. Biala-Tcherkva ne s’était pas plus soulevée que les autres villes et les villages aussi prêts et même plus prêts qu’elle à l’insurrection. La proclamation prématurée de celle-ci avait tout gâté. À la première nouvelle du soulèvement de Klissoura, le comité s’était divisé : les uns pensant qu’on devait se borner à la défensive, sans donner aucune prise à l’agression, et ne se soulever que si une tchéta de renfort venait en aide à Biala-Tcherkva ; les autres estimant qu’il fallait immédiatement aborder le drapeau de la révolution et puis, advienne que pourra ! Il y avait eu encore une troisième opinion et c’était celle de la majorité : capituler. Au moment où le comité décidait de déployer le drapeau, cette majorité avait, par ruse, réussi à enfermer dans la cave du pope Stavri les membres les plus fougueux : le docteur, Popov et le Rédacteur, et on avait envoyé à K... une députation, le tchorbadji Iordan en tête, porter l’assurance des sentiments de soumission et de fidélité des Bialo-Tcherkoviens, et demander secours.
Le gouvernement, lui-même troublé, avait accueilli avec joie cette déclaration et avait envoyé à Biala-Tcherkva cinquante bachi-bouzouks pour rafler les armes et défendre la ville. Bientôt dans la cour du konak, s’était élevé un amas de fusils, de pistolets et de yatagans. Biala-Tcherkva, ayant ainsi dressé au-dessus de sa tête le paratonnerre de la capitulation, était sauvée. Elle n’avait donné qu’une victime : Marko Ivanov. Chargé de chaînes, il avait été traîné à pied jusqu’à Plovdiv et cela à cause du cerisier. Qui l’avait dénoncé ? on l’ignorait.
Cinq jours plus tard, c’est-à-dire la veille, un drapeau apparut sur la montagne. Que de commentaires, de rumeurs, d’espoirs ! Les esprits étaient bouleversés. Le bruit courut que plusieurs milliers d’insurgés arrivaient du Balkan au secours de Biala-Tcherkva. Ces forces militaires étaient, disait-on, commandées par des officiers russes et serbes. Personne ne savait au juste d’où venait cette aide qui semblait tomber du ciel. Kablechkov avait si souvent parlé d’une mystérieuse armée, prête à surgir à l’heure propice, que même les plus sceptiques commencèrent à prêter foi à ce bruit. Tous fixaient joyeusement leurs regards sur le drapeau qui flottait au sommet du Balkan. D’aucuns avaient même cru apercevoir, sur la crête de la montagne, des hommes debout, fusil au dos : ils prenaient, à n’en pas douter, des buissons pour une armée. D’autres, aux yeux plus perçants, avaient reconnu les Moscovites à leurs bonnets de fourrure. Alors le pope Stavri était allé ouvrir la cave :
– C’est un péché, mes enfants, de vous tenir encore sous clef. Mitcho a eu raison : venez voir ce qui a surgi sur la montagne.
Les trois prisonniers s’élancent au-dehors. Une demi-heure après, suivis d’une vingtaine de cordonniers, ils s’emparent du konak, du bey, des armes – et du pouvoir. Enthousiasme indescriptible dans la ville, Biala-Tcherkva se soulève ! Le drapeau, au lion brodé par Rada, est arboré sur la place publique. Mais, juste à ce moment, une affreuse nouvelle atterre tout le monde : le bouvier, descendu en courant de la montagne, déclare qu’il n’y a personne dans le Balkan. Et Tossoun-Bey est déjà en route pour Biala-Tcherkva qu’il va dévaster ! En même temps une seconde nouvelle redouble l’angoisse : trois insurgés klissouriens avaient dévalé la montagne et s’étaient cachés dans l’école, à l’entrée de la ville. C’étaient Kandov, blessé au bras, et deux autres Klissouriens. La vieille femme chargée de l’entretien de l’école les avait reçus et cachés dans le grenier, leur avait donné du pain : depuis deux jours ils n’avaient mangé que de l’herbe ; ils avaient envoyé un message à Barzobégounek, qui leur avait apporté des vêtements, des fez et du tabac.
Avant même d’avoir fumé leur première cigarette, ils virent par les fentes du toit que l’école était cernée par des Turcs. À ce moment, Barzobégounek était aussi dans le grenier. Il n’y avait aucun moyen de fuir. Les Turcs se mirent à tirer de la cour dans les fenêtres du grenier. Les deux Klissouriens furent blessés. Ils descendirent, se rendirent et furent sur place lardés de coups de yatagan. Barzobégounek sauta du grenier, tira deux fois et blessa un Turc mais au même instant il tomba, atteint par une dizaine de balles. Il fut égorgé. Seul Kandov n’était pas descendu. Les Turcs visaient l’ouverture du grenier où il aurait dû se montrer, mais il n’apparaissait pas. Soudain, le plancher pourri du grenier s’effondra et Kandov tomba sur la véranda. Il se dressa, s’appuya à a balustrade, croisa les bras et cria :
– Je suis prêt ! Tirez !
Les Turcs crurent qu’il était le chef et qu’il se rendait : il parlait en bulgare. Ils attendirent.
– Barbares ! Tirez donc ! Des Bulgares il en restera toujours ! s’écria-t-il.
Alors, ils comprirent. En réponse, ils tirèrent une trentaine de coups de feu sur cette cible proche : aucun ne porta. Kandov descendit en courant les escaliers de la véranda et s’élança vers l’église dont le portail était ouvert. Les balles le suivaient sans d’abord l’atteindre mais, sur le seuil, deux balles le frappèrent enfin et il s’effondra à l’intérieur de l’église. Lui aussi fut égorgé.
Après cet exploit, les bachi-bouzouks se lancent à la recherche du docteur. Beaucoup de citoyens se joignent à eux. Qu’il soit pris vif ou mort et la ville sera sauvée du terrible courroux de Tossoun-Bey. Le docteur doit servir de bouc émissaire. À la nuit tombante, le propriétaire de la maison où il se cache, pris de peur, le met dehors. Dans la rue, Sokolov se heurte à un détachement de poursuivants. Ils courent sur ses traces. Mais Sokolov les devance ; tout en fuyant dans la longue rue de Muhluz, il pousse une porte ou l’autre, cherchant à se glisser par l’une d’elles, mais aucune n’est ouverte et il continue sa course. Sur la place publique, il lui semble qu’au lieu d’un seul détachement il y en a deux à ses trousses, car une dizaine d’hommes lui barrent la route. Il tourne alors à gauche, revient par une autre rue ; ses poursuivants perdent sa trace, et il peut s’arrêter pendant quelques secondes, reprendre son souffle. Le danger n’est pas passé. Le détachement ne tardera pas à enfiler aussi cette rue et à l’atteindre d’une balle, ici ou ailleurs, grâce à la clarté de la nuit étoilée. Essayer de sortir de la ville serait insensé ; toutes les issues sont gardées. Le seul salut serait de se cacher dans une maison amie. Il lui vient heureusement à l’esprit que la maison de pope Dimtcho est tout près. Il y court, frappe à la porte. Celle-ci s’ouvre. Le pope Dimtcho, membre du comité, est là.
– Père, cache-moi, dit Sokolov.
– Impossible, impossible, docteur ! Si on te voit entrer ici, ce sera mauvais pour moi aussi, chuchote le pope et il le pousse délicatement dehors.
Sokolov, effaré, sent que les poursuivants approchent : ils débouchent de la rue opposée ; il s’élance, à l’aveuglette, plus loin s’engage dans un cul-de-sac : là, au fond, habite un de ses parents. Il pousse la porte, demande asile.
Baï Netcho saisit de suite la gravité de la situation :
– Es-tu fou, docteur ? Tu veux donc mettre le feu à ma maison ! Tu sais bien que j’ai une femme et des enfants !
Et, le prenant par la main, il le met à la porte.
Sokolov se hâte de sortir du cul-de-sac, pénètre dans la rue Petkantchova : sa mauvaise étoile le ramène exactement vers ceux qu’il fuit. Il court, ses poursuivants à ses trousses.
– Si tu ne t’arrêtes pas, je tire ! Attends, docteur ! crie derrière lui un des pandours.
En effet, Sokolov s’arrête, mais non pas là où le lui propose ce zélé pandour : il frappe à la porte de Sarafov. Sokolov est le médecin de Sarafov et aussi son ami. Il tente donc sa chance.
– Qui frappe ? demande Sarafov.
Le médecin se nomme.
Il entend alors Sarafov qui, au lieu d’ouvrir la porte cochère, fait claquer celle de sa maison.
13 SUITE DE L’HISTOIRE DE SOKOLOV
– Quelle infamie, mon Dieu ! soupira douloureusement Ognianov.
– Maintenant, frère, dans la ville c’est la panique, ce sont les dénonciations, les lâchetés... Biala-Tcherkva n’est plus la même, dit sombrement Sokolov.
– Les dénonciations et les lâchetés, dis-tu ? Ce sont les monstres engendrés par toute révolution ratée. Ils la hantent comme les loups et les corbeaux hantent les champs de bataille... Et qui a planté le drapeau au sommet de la colline ? C’était un mouchoir rouge au bout d’un pieu.
– Je ne sais pas.
– Mais, selon toi, qui est-ce ?
– Les Turcs.
Ognianov le regarda, incrédule.
– Oui, les Turcs, continua le docteur. C’est devenu évident hier, quand Tossoun-Bey est parti de Klissoura pour attaquer et dévaster Biala-Tcherkva. Il ne lui fallait qu’un prétexte ! C’est probablement dans ce même dessein perfide qu’a été répandue la rumeur d’une nombreuse armée venant à notre aide. Or, celui qui venait, c’était le Tossoun.
– Donc, il doit être aujourd’hui à Biala-Tcherkva ?
– Oui.
– Que de malheurs à Biala-Tcherkva en ce moment ! dit Ognianov bouleversé.
– Des malheurs ? non, des lâchetés ! répondit Sokolov. Un homme que j’ai envoyé aujourd’hui jusqu’à la ville m’a rapporté que Tossoun-Bey, ayant été solennellement accueilli par une députation de Biala-Tcherkva, a gracié celle-ci. Cet homme, en passant devant la cour du konak, y a vu un amas d’armes apportées là par les Bialo-Tcherkoviens eux-mêmes. Le canon de cerisier y était aussi... Le pauvre baï Marko, c’est lui que je plains le plus !
Ognianov soupira.
– Oui, le plus dur c’est pour baï Marko. Il a été victime d’une infâme dénonciation. De même que Kandov, ajouta Sokolov.
– Mais qui a dénoncé Kandov et les autres ? demanda Ognianov, et son front se couvrit de rides profondes.
– Ah ! j’ai oublié de te le dire : c’est le tchorbadji Iordan Diamandiev qui les a livrés. La stupide vieille femme a confié la chose au pope ; le pope l’a répétée à Iordan. Et celui-ci haranguait les bachi-bouzouks sur la place : « Attaquez ! Qu’attendez-vous donc ? Nous n’admettrons pas de bandits dans notre ville, nous ne voulons pas des ennemis du Padischah ! »
– Mon Dieu ! mon Dieu ! Le pauvre Kandov, je l’ai vu se battre comme un héros sur la position de Klissoura, et ici il est mort en brave. Sa vue m’a porté un coup terrible !... Et toi, comment t’en es-tu tiré à la fin ?
– On m’a caché dans une maison. Devine où, Boïtcho.
– Chez des amis, bien entendu, pas chez le tchorbadji Iordan.
– Comme je te l’ai raconté, les amis et les conjurés m’ont chassé d’une façon indigne, répondit amèrement Sokolov, tous m’ont fermé la porte au nez.
– Mais alors qui ? Continue.
– Bien, reprit Sokolov. Les poursuivants se rapprochaient et moi j’étais arrivé au bout de la ville. Alors je prends une décision désespérée : essayer de passer à travers les balles des sentinelles et m’enfuir dans la campagne. D’ailleurs, c’était la seule chance qui me restait, pris comme je l’étais entre deux feux. Arrivé à une trentaine de pas de la cour de Valtchov, où la patrouille était en embuscade près d’une vieille clôture, je vois une porte s’entrouvrir. J’entends son grincement et je m’arrête. Je regarde autour de moi ; je comprends alors que je me trouve devant la porte de Milka Todoritchkina. Sur le seuil se tient la jeune fille en personne. Je m’approche et lui dis : « Milka, le détachement me poursuit, peux-tu me cacher ? – Entrez, monsieur le docteur » me dit-elle. Et j’entre. Une minute plus tard la meute passe en courant devant la porte et s’en va plus loin.
– Et c’est elle qui t’a sauvé ? s’écria Ognianov.
– Oui, Boïtcho. Elle, Milka, une débauchée ! La Providence s’est présentée cette fois sous les traits de Milka Todoritchkina, la fille dévergondée, déshonorée, rejetée de tous. Pauvre petite ! Elle n’a d’ailleurs plus rien à craindre, plus rien à perdre, plus rien à regretter.
– Peu importe, cette débauchée a fait preuve d’héroïsme, alors que, chez les honnêtes gens, il n’y avait que de la lâcheté ! remarqua Ognianov. Mon Dieu ! mon Dieu ! dire que la bravoure s’est retirée là !
– En ce moment, on doit me chercher dans toute la ville, mais ils ne m’auront pas !
– Quelles sont maintenant tes intentions, docteur ? Où iras-tu ?
– En Roumanie, bien entendu.
– Moi aussi, je m’étais mis en route pour là-bas, mais le drapeau m’a fait descendre de la montagne.
– Et moi, il m’a fait monter vers elle. Mais toi, avec ces vêtements ? Et tu n’as pas de chapeau ?
– C’est pourquoi je t’avais envoyé Marika avec une lettre où je te priais de m’apporter tout le nécessaire. C’est curieux ! Où peut-elle bien s’attarder ?...
– Maintenant ce n’est plus nécessaire, dit Sokolov. Dès que la nuit tombera, nous passerons dans le moulin d’Hambarov et baï Lilko nous trouvera tout ce qu’il faut. Par bonheur, j’ai, en plus du mien, encore un vieux passeport. Ce sera pour toi. Dans le sac nous avons aussi de la nourriture...
– Parfait. Mais je ne venais pas ici pour fuir de nouveau... Je croyais trouver l’insurrection.
– Et c’est le gâchis que tu trouves, dit Sokolov avec colère. Nous n’avons fait que troubler l’eau, assez pour causer la ruine de la ville.
– Avez-vous quelques nouvelles des autres endroits ?
– Seulement de vagues rumeurs ! partout la débâcle... L’insurrection n’a pu se propager, rien que des catastrophes. Mais tu dois en savoir plus long que moi...
– Oui, du haut de la montagne j’ai vu les incendies luire à vingt endroits, dit Ognianov.
– Le peuple n’était pas mûr pour une telle action. Nous nous sommes cruellement trompés, dit Sokolov. La Bulgarie compte à présent tant de victimes, et cela en vain...
– Oui, nous nous sommes trompés. Mais il fallait que la révolution fût faite, que les sacrifices fussent offerts. J’aurais voulu qu’ils fussent plus nombreux et plus sanglants encore. Nous ne pouvons pas, par nos simples moyens, abattre la Turquie, mais nous pouvons gagner les sympathies du monde entier par nos terribles malheurs, par notre martyre, par les flots de sang qui s’écoulent du corps de la Bulgarie. C’est un signe de vie. Personne ne se soucie d’un mort. Seul a droit à la vie celui qui est vivant. Si les gouvernements de l’Europe n’interviennent pas pour nous, ils ne méritent pas le nom de chrétiens ou de civilisés. Et, même si rien n’advient, nous n’avons pas à nous repentir. Nous avons rempli notre devoir d’hommes : nous avons essayé de gagner la liberté au prix de notre sang. Nous n’avons pas réussi, c’est triste, mais non pas honteux. Il serait infâme et criminel de nous croiser maintenant les bras, de cracher sur notre idéal, d’oublier le sang et les flammes dans lesquels est plongée aujourd’hui la Bulgarie...
– Ognianov, dit Sokolov après un court silence, il me semble qu’à cette heure nous sommes les seuls à penser ainsi. La Bulgarie tout entière, nous maudit à présent à cause des malheurs qui ne sont abattus sur elle. Va, prête l’oreille : chacun donne raison à Steftchov.
14 UN DIALOGUE IMPORTANT
Pour la première fois, au cours de cet entretien, Ognianov entendit le nom de Steftchov. Son front se rida.
– Comment ! cet être méprisable respire encore ?
– Un être méprisable ? riposta Sokolov. Steftchov est maintenant l’homme le plus intelligent, le plus dévoué, le plus fier. Je n’ai pas pu boire son sang 140. Sais-tu, j’avais préparé Cléopâtre à son intention... Maintenant, il triomphe aux côtés du tchorbadji Iordan. Il passe pour le sauveur de la ville... et nous, si on nous découvre, on nous abattra comme des chiens.
– Quoi qu’il en soit, c’est une vile créature. La pauvre Lalka doit être très malheureuse...
– Tu ne sais pas ? Lalka est morte.
– Morte ? Que dis-tu ?
– Elle est morte le 18 avril, murmura Sokolov.
– Que de malheurs en si peu de temps... C’est lui, ce lâche, qui l’a tuée, s’écria Ognianov.
– Oui, il l’a tuée.
Et Sokolov raconta, les larmes aux yeux, la mort de Lalka. Ognianov, ému, saisit sa main :
– Frère, nous sommes tous deux également malheureux.
Sokolov l’interrogea du regard.
– Lalka, l’être que tu as tant aimé, est dans la tombe, reprit tristement Boïtcho ; un autre être, que j’aime, est lui aussi dans la tombe, perdu pour moi.
– Mais Rada est en vie ! Elle est à Biala-Tcherkva ! s’écria Sokolov.
– En vie ?... Oui, en vie, mais morte pour moi.
Sokolov le regarda avec étonnement.
– Oui, morte à jamais, répéta sombrement Boïtcho. Le pauvre Kandov, Dieu ait pitié de lui ! Pourquoi lui ai-je survécu ?
Sokolov fixa Ognianov :
– Boïtcho, n’aurais-tu pas eu une querelle avec Kandov à Klissoura ?
– Oui, et à mort.
– Au sujet de Rada ?
Ognianov s’assombrit encore plus :
– Ne parlons plus de cela.
– Mais tu es fou, Boïtcho. Soupçonner Rada ! C’est révoltant !
– Révoltant ? Je croyais qu’elle était la candeur même et, en réalité, qu’était-ce ! gémit Ognianov. J’avais foi en elle, je l’aimais, oh combien ! Et mon amour pour la patrie était alors plus radieux, j’avais confiance en moi-même, mon courage était invincible... Mais quelle débâcle ! Figure-toi... Mais il suffit que je te dise qu’après cela, à Klissoura, je me suis battu non pas dans l’espoir de vaincre l’ennemi, mais pour mourir sous ses coups ! Ne me parle plus de cela.
Et Ognianov baissa tristement la tête.
– Tu te trompes, Rada t’a fidèlement aimé et t’aime encore, mais elle est très malheureuse, calomniée, par tous et par toi, tout d’abord ! dit Sokolov avec indignation.
Ognianov lui jeta un regard de reproche :
– Docteur, pour la mémoire de ce pauvre Kandov, cesse de me parler de cette triste affaire !
– C’est justement la mémoire de Kandov que je veux laver de tes soupçons. Ne crois pas qu’il ait agi bassement. C’est vrai qu’il était amoureux de Rada ; c’était un rêveur, il s’enflammait... Cette passion inexplicable lui avait fait fuir et la société et le comité. Mais cela n’avait eu aucune influence sur les sentiments de Rada à ton égard, et lui, il n’avait blessé Rada par aucune proposition malhonnête. Par pudeur, elle ne t’avait pas parlé des assiduités platoniques de Kandov, mais elle s’en était plainte à Lalka... Bon ! Voilà que cela me vient à l’esprit : lis la lettre de Kandov, écrite le 19 avril, le jour même où il l’a suivie à Klissoura. Elle m’a été remise par Nedkovitch.
Et Sokolov sortit de son portefeuille la lettre et la tendit à Boïtcho.
Celui-ci lut rapidement et des larmes montèrent à ses yeux. Le bonheur illumina son visage !
– Je te remercie, Sokolov. Tu as enlevé le terrible poids qui pesait sur mon âme ; tu l’as éclairée, tu l’as fait renaître !
– La pauvre Rada, comme elle serait heureuse si elle apprenait cela ! Je n’ai pas eu le temps de la voir, mais j’ai compris qu’elle était désespérée, probablement pour toi, te croyant mort, comme nous l’avons tous cru. Écris-lui, envoie-lui quelques mots avant notre départ, pour lui rendre la joie, la malheureuse.
– Comment lui écrirais-je !
– Écris-lui, l’humanité l’exige.
– C’est ce sentiment qui exige que je ne lui écrive pas, mais que je coure vers elle, que je tombe à ses genoux et lui demande pardon. J’ai été cruel jusqu’à l’infamie envers Rada ! s’écria Ognianov.
– Oui, je t’aurais moi-même conseillé de faire cela, mais maintenant c’est impossible...
– Même si c’est impossible, j’irai, dit résolument Ognianov.
– Comment ! tu entrerais à Biala-Tcherkva ? s’écria Sokolov, stupéfait. Mais c’est se jeter au feu ! Là, Iordan et Steftchov sont les sauveurs. Tu t’exposeras à une mort certaine !
– Docteur, tu sais que je ne pense guère à ma vie quand il s’agit de rester honnête homme. Toute la horde de Tossoun-Bey ne pourrait m’arrêter. Je dois implorer le pardon de Rada pour ma cruelle conduite envers elle, cette conduite qui l’a tant fait souffrir, qui l’a poussée à une résolution désespérée, à chercher la mort dans l’incendie de Klissoura.
Ognianov lui raconta en deux mots l’incident.
– Alors, frère, je ne te retiens pas, dit Sokolov avec émotion.
Ognianov réfléchit un moment et continua doucement :
– Et puis, il y a encore autre chose : Rada est à moi. Avant mon dernier départ d’ici, nous nous sommes unis devant Dieu et au lieu d’anneaux, nous avons échangé nos serments. Je ne puis l’abandonner, comprends-tu ? Et si je parviens jusqu’en Roumanie, je l’appellerai pour qu’elle vienne partager avec moi la pauvreté, le dénuement, les souffrances, tout ce qui constitue la vie d’un émigré. Oh ! elle viendra avec joie partager mon sort comme elle l’a partagé ici. Dans son amour, elle s’est montrée héroïque et le monde entier ne vaut pas son cœur.
Sur le visage de Sokolov se peignait l’admiration.
– Je partirai au crépuscule et je reviendrai cette nuit encore. Et, je te l’assure, sain et sauf. Je ne mourrai pas, je ne veux pas mourir, docteur, parce que Rada vit pour moi et parce que la Bulgarie n’est pas encore libérée !
15 LA RENCONTRE
Sokolov jeta un coup d’œil par la brèche :
– Quelqu’un vient ! Marika !
Ognianov fixa, à son tour, les yeux sur la vallée :
– Ce n’est pas Marika. Marika est plus frêle et elle est vêtue de bleu.
– Celle-ci est en noir et elle porte un baluchon.
– Rada ! cria Ognianov en s’élançant vers l’issue.
Sokolov s’y précipita aussi. Ognianov se dressa sur le seuil du moulin, en agitant les deux bras au-dessus de sa tête.
Rada qui, depuis un certain temps, errait entre les rochers, cherchant en vain Boïtcho, l’aperçut maintenant. Elle courut vers lui et un instant plus tard se trouva dans le moulin.
– Rada !
– Boïtcho ! Boïtcho ! sanglotait-elle.
Elle ne pouvait reprendre son souffle et serrait contre sa joue la tête de l’aimé.
Sokolov suivait cette scène avec une profonde émotion.
– Mais comment es-tu ici, Rada ? dit Ognianov dès qu’il put dominer son trouble.
– Marika m’a remis le billet que tu avais adressé au docteur. Ah ! Boïtcho, pourquoi m’as-tu ainsi torturée ? disait Rada, le visage inondé de larmes de joie. Tu n’es plus fâché contre moi ? Tu n’as pas le droit d’être fâché contre moi... Tu sais bien qu’il n’y avait aucune raison...
– Pardonne-moi ! Pardonne-moi, mon amour ! (Boïtcho couvrait ses mains de baisers.) Sokolov vient de me montrer mon erreur. Elle m’a fait cruellement souffrir, moi aussi. J’allais descendre dans la ville pour implorer le pardon... de ma cruauté. Je suis indigne de l’amour d’un ange. Mais tu as oublié, n’est-ce pas, Rada ? Tu me pardonnes, n’est-ce pas ?
Et Ognianov plongeait un regard d’adoration dans les yeux humides de la jeune fille, rayonnants de bonheur et d’amour infini... Mais Rada devint soudain plus blanche que le mur et s’échappa des bras de Boïtcho en criant :
– Fuis, Boïtcho ! J’ai oublié de vous dire. Fuyez !... On vous a vus ici et les Turcs arrivent ! Plus vite, fuyez dans la montagne, répétait Rada, épouvantée.
– Comment ? s’écria Sokolov, n’en croyant pas ses oreilles.
– Une tzigane t’aurait aperçu et elle t’a dénoncé avant que je voie Marika. En route, j’ai remarqué une bande de bachi-bouzouks qui descendaient des vignobles ; ils ont pris cette direction. C’est pour toi qu’ils viennent, Boïtcho. Et moi j’ai oublié de te le dire tout de suite. J’ai perdu une heure à te chercher dans le vallon. Nous nous verrons ailleurs. Maintenant, fuyez !
Dans les moments critiques, Ognianov se distinguait par sa présence d’esprit. Mais maintenant, étourdi par la joie de la rencontre avec la jeune fille que l’héroïsme de son amour lui rendait encore plus chère, il ne pouvait prendre une décision rapide ; il ne se sentait pas la force de se séparer d’elle aussi brusquement. Ces secousses sont bouleversantes. Or, chaque instant était précieux.
– Fuir ? mais toi ? demanda Boïtcho.
– Ne vous inquiétez pas de moi... Fuyez au plus vite... Voilà, prends cela, il y a là des vêtements... Fuis, Boïtcho ! Adieu, nous nous reverrons, nous nous réunirons de nouveau. Boïtcho, Boïtcho, mon cher aimé, où que ce soit. Adieu !
Et Rada tendit le baluchon à Ognianov, le prit par la main, le tira de force vers l’issue du vieux moulin.
– Non, dit résolument Ognianov, je ne puis te laisser dans un tel moment. Si ces barbares te suivent...
– Oui, ils viennent, Boïtcho !
– Ils viennent et ils te rencontreront dans ce lieu sauvage ! Ces monstres ! Non, je mourrai ici en te défendant...
Mais Boïtcho comprit tout de suite la folie et l’inutilité de cette décision désespérée. Soudain, sa question jaillit :
– Rada, peux-tu venir avec nous ?
À cette proposition inattendue, Rada répondit, transportée de joie :
– Oui, oui, Boïtcho, avec vous jusqu’au bout du monde. Fuyons, fuyons, Boïtcho !
Le regard d’Ognianov brilla.
Sokolov intervint :
– Si nous pouvions arriver au Malki Stol, au-dessus de la cascade ! De là je les retiendrai jusqu’au soir, et toi, tu emmèneras Rada plus haut.
En effet, au-dessus de la chute d’eau se dressaient des rochers déchiquetés appelés Malki Stol. Abrité derrière eux, un homme armé pouvait défendre contre tout un détachement l’unique sentier qui, sur le versant escarpé, sinuait vers le sommet de la montagne.
Il n’y avait plus une minute à perdre.
– En route ! Vers la montagne ! cria ou plutôt ordonna Ognianov.
Et il sortit le premier sur le seuil, en jetant un regard sur la vallée.
Il était trop tard.
Sur le versant opposé, entre les rochers dentelés, apparaissaient des taches sombres : les Turcs. Ils s’abritaient derrière les rochers et les buissons, ne laissant voir que leurs têtes et le canon de leurs fusils. Au sommet de la colline, un être vêtu d’un large pantalon bouffant de couleur blanche montrait du doigt le moulin. C’était la tzigane. Sur l’autre versant aussi, des Turcs s’étaient tapis.
Ognianov et Sokolov se voyant acculés ne pensèrent plus à fuir ; c’était impossible.
Les Turcs continuaient à descendre les versants avec prudence, se blottissant derrière les rochers et les accidents de terrain. Ils devaient être une centaine.
Le sentier de la vallée était libre. Boïtcho se tourna vers la jeune fille :
– Rada, prends le sentier et longe la rivière. Mais, tout de suite, une pensée affreuse assombrit son visage : Non ! reste plutôt ici !
Le regard de Rada exprimait la même résolution.
– Avec toi, avec toi, Boïtcho, murmura-t-elle en joignant les mains sur sa poitrine.
Tant de douleur, d’amour et de tragique abnégation se lisaient dans ses yeux humides ! Une telle résignation à la mort !
Ognianov et Sokolov comptèrent leurs balles.
– Nous en avons dix-huit, dit Sokolov.
– C’est suffisant pour mourir avec honneur.
Tossoun en personne avait conduit sa bande et c’était lui qui commandait. Avant de se montrer sur le versant, il avait fait cerner le vallon et avait ainsi enfermé dans un cercle infranchissable les insurgés, ou plutôt l’insurgé, car il croyait qu’il n’y en avait qu’un : Ognianov.
Aussi avant de donner l’ordre de tirer, Tossoun-Bey fit crier en turc :
– Rends-toi, consul-komitadji !
Seuls les échos répondirent à cette sommation.
Rada, blottie dans un coin, ne disait plus un mot.
– Courage, Rada ! lui dit tristement Boïtcho.
Elle lui fit de la main un signe, et ce signe voulait dire : « À Klissoura j’ai eu peur, parte que j’étais seule et abandonnée. Maintenant, je ne crains pas la mort avec toi, parce que tu m’aimes. Tu verras... »
Boïtcho comprit l’héroïsme de cette muette réponse et les larmes montèrent à ses yeux. Les secondes s’écoulaient.
Ognianov et Sokolov, collés au mur pour être moins exposés, serraient leurs revolvers. Ils jetèrent un regard sur les deux versants d’où allait partir le tir dirigé sur eux.
Une minute passa. C’était probablement le délai accordé par Tossoun-Bey.
Puis les coups de fusils partirent de l’escarpement de l’ouest, de l’escarpement de l’est et du vallon même. Les assiégés entendirent le sifflement des balles qui entraient par l’ouverture du toit, par les trous des murs, se heurtaient contre les pierres et tombaient, aplaties, à leurs pieds. La vallée retentissait d’échos.
Tout d’un coup le feu cessa.
Bien qu’à demi en ruines, la bâtisse avait pourtant protégé les trois malheureux. Aucun n’avait été atteint mais Rada était tombée par terre, évanouie : ses forces l’avaient trahie. Son fichu ayant glissé de sa tête, ses cheveux se répandaient en longues ondes noires sur ses épaules et jusque dans la poussière du sol.
La seconde salve n’allait pas tarder et Rada, ainsi étendue, était exposée aux balles. Ognianov se baissa, la prit dans ses bras et la porta dans le coin le plus abrité et plaça le baluchon sous sa tête. Il la secoua légèrement, mais elle ne se réveillait pas, gisait, inconsciente, ne sentant plus rien de ce qui se passait autour d’elle. Alors, regardant le visage charmant, aux yeux clos et aux lèvres pâlies, de cette jeune fille qui avait lié son destin au sien et qu’un sort affreux attendait dès qu’il ne serait plus là pour la défendre contre ces monstres, il fut envahi par la douleur et le désespoir :
– Devrai-je la tuer moi-même ? se demanda-t-il.
Ne recevant aucune réponse du moulin, les assaillants s’enhardirent : ils descendirent jusqu’aux rochers les plus bas, s’approchèrent du vallon. Le cercle autour du moulin se rétrécissait ; l’instant de l’action décisive arrivait.
– Rends-toi, komitadji !
Aucune réponse.
Une grêle de balles s’abattit sur le moulin. Tout en activant le tir, les Turcs se rapprochaient. Le moulin continuait à se taire, ils crurent que l’insurgé qui s’y cachait n’avait pas d’armes. Les balles cinglaient les murs, l’attaque prenait la forme d’une charge.
Maintenant les Turcs étaient suffisamment près. Le moment était venu. Ognianov était debout à l’une des fenêtres, Sokolov au seuil du moulin.
Ils échangèrent un coup d’œil. Puis, en même temps, Ils déchargèrent leurs revolvers au milieu de la foule serrée des ennemis. Cette riposte inattendue abattit trois hommes mais révéla aussi la force dont disposait la place attaquée. Les Turcs comprirent qu’il y avait plus d’un défenseur. Cela les troubla, mais pour un instant seulement. Les vainqueurs de Klissoura se précipitèrent avec des cris sauvages vers la dangereuse bâtisse. Une partie des tireurs, restés sur les versants, prenaient pour cibles les ouvertures du moulin, afin d’empêcher ses défenseurs de s’y montrer et de faire feu sur les assaillants. L’attaque devenait de plus en plus violente.
– Docteur, nous allons mourir ! adieu à jamais ! s’écria Boïtcho.
– Adieu, frère !
– Docteur, aucun de nous ne doit tomber vivant entre leurs mains !
– Aucun de nous, Boïtcho ! J’ai encore quatre balles ! J’en garde une pour moi.
– Moi, j’en garde deux, docteur, et Ognianov se tourna involontairement vers Rada. Elle était étendue dans la même position, mais son visage était maintenant blanc comme un linge ; du côté gauche de sa poitrine coulait doucement un filet de sang rouge qui se répandait dans les plis de sa robe. Une balle l’avait atteinte par ricochet. Elle était morte. Elle avait passé de l’inconscience au sommeil éternel.
Boïtcho quitta son poste, s’approcha d’elle, se mit à genoux, saisit ses mains déjà froides, posa un long baiser sur ses lèvres glacées puis couvrit de baisers son front et la blessure où le sang cessait de couler. Lui dit-il une suprême parole, lui murmura-t-il dans le dernier baiser d’adieu : « Au revoir, Rada, dans un monde plus heureux ! » Qui le saura ? Même s’ils n’avaient pas été seuls, nul ne l’aurait entendu, car les détonations au-dehors, et le claquement des balles au-dedans couvraient les voix. Il la recouvrit de son manteau. Quand il se releva, les larmes coulaient le long de ses joues.
Dans ces larmes il y avait un océan de souffrance mais, qui sait, peut-être aussi un peu d’ardente gratitude envers la Providence !...
16 MORT HÉROÏQUE
Durant ces suprêmes adieux, Sokolov soutenait seul le combat contre une centaine d’ennemis. Tout à coup, il se retourna et vit Rada. Ses cheveux se hérissèrent, ses yeux étincelèrent comme ceux du tigre, il se dressa de toute sa hauteur sur le seuil, abandonnant toute précaution, défiant les balles et criant à la horde, en turc :
– Chiens galeux ! Vous payerez chèrement chaque goutte de sang bulgare !
Puis il déchargea son revolver.
La horde s’élança avec une rage redoublée contre la forteresse que représentait maintenant le moulin en ruine. Un rugissement de fauves, suivi d’une décharge générale, fendit l’air.
– Ah ! gémit Sokolov, et il laissa tomber son revolver.
Une balle avait percé sa main droite de part en part. La terreur, le désespoir se peignirent sur son visage. Ognianov qui tirait sur les assaillants, lui-même déjà ensanglanté, le remarqua :
– Tu souffres, frère ?
– Non, mais j’ai tiré ma dernière balle, j’ai oublié...
– J’en ai encore deux dans mon revolver, prends... (Et Ognianov lui donna son arme.) Ils verront maintenant comment meurt un apôtre bulgare !
Et, tirant du fourreau le long yatagan de Sokolov, il s’élança hors du moulin et se rua au milieu des assaillants, portant des coups terribles à gauche et à droite.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Une demi-heure après, la horde victorieuse, féroce, soulevée par une joie démoniaque, quittait le vallon, portant, piquée au bout d’une perche, la tête d’Ognianov. Le crâne de Sokolov, mis en pièces par les yatagans (le premier coup, une balle de revolver, Sokolov se l’était donné lui-même), ne pouvant servir de trophée. La tête de Rada avait été respectée mais pour des raisons politiques : Tossoun-Bey était plus rusé que le Tamrachli 141.
Derrière venait un char avec les morts et les blessés turcs.
La bande entra dans la ville en poussant des cris sauvages, mais Biala-Tcherkva était plus déserte et plus nette qu’un cimetière abandonné. Un seul être y errait, semblable à un spectre. C’était Mountcho.
Quand il reconnut la tête de son cher Russian, il fixa sur elle des yeux pleins d’une rage insensée et, dans un jet de salive, proféra à l’adresse de Mahomet et du Sultan une colossale obscénité.
Il fut pendu à la porte de la boucherie.
Seul, ce fou avait osé protester.
Odessa, 1888.
Ivan VAZOV (1850-1921), Sous le joug,
Sofia, 1961.
Traduit du bulgare par Stoïan Tsonev,
Sonia Pentecheva et Violeta Ionova.